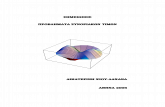PRO_266_0095
description
Transcript of PRO_266_0095
-
CONCLUSIONSPierre Martinot-Lagarde
C.E.R.A.S | Revue Projet 2001/2 n 266 | pages 95 100 ISSN 0033-0884
Article disponible en ligne l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-projet-2001-2-page-95.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierre Martinot-Lagarde, Conclusions , Revue Projet 2001/2 (n 266), p. 95-100.DOI 10.3917/pro.266.0095--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution lectronique Cairn.info pour C.E.R.A.S. C.E.R.A.S. Tous droits rservs pour tous pays.
La reproduction ou reprsentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorise que dans les limites desconditions gnrales d'utilisation du site ou, le cas chant, des conditions gnrales de la licence souscrite par votretablissement. Toute autre reproduction ou reprsentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manireque ce soit, est interdite sauf accord pralable et crit de l'diteur, en dehors des cas prvus par la lgislation en vigueur enFrance. Il est prcis que son stockage dans une base de donnes est galement interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
D
ocum
ent t
lc
harg
de
puis
www.
cairn
.info
- -
- 8
5.16
9.11
8.21
4 - 2
4/06
/201
5 21
h28.
C
.E.R
.A.S
D
ocument tlcharg depuis www.cairn.info - - - 85.169.118.214 - 24/06/2015 21h28. C.E.R.A.S
-
95
Conclusions
A quoi comparer le jeu des acteurs dans le march de lconomiemondiale? Peut-tre une salle de classe rassemblant une multitudedlves auxquels on demande de raliser les pices dun jeu de domi-nos. Chaque lment comporte deux faces, avec des nombres de 1 6. Une fois assembls, ceux-ci peuvent former une chane complteet unique. Pour cet exercice on invite chaque lve choisir deuxfigures en se mettant daccord avec deux comparses qui reproduisentchacun lune des figures sur sa pice.
Aprs un temps dexplications, le brouhaha sinstaure. Les lvesdiscutent entre eux, parfois en groupes, plusieurs. Lun ou lautremeneur, par sa force de conviction, par sa position dominante ou pardes arguments de raison, essaye de structurer la discussion, le choixde motifs. Puis tous se mettent au travail. A la fin de la matine, ils serassemblent et construisent leur chane. Mais l, surprise : les domi-nos assembls forment plusieurs boucles et non pas une seule commeils en avaient lintention. Pourtant, ils ont bien respect les rgles dujeu. Chacun a construit son domino avec deux figures en stant misdaccord avec deux camarades. Aucun navait anticip ce rsultat.Tous les lves ont jou cte cte le mme jeu mais ils nont pasparticip la mme partie.
Un visiteur de Manhattan prouve une impression analogue celle de lobservateur de la salle de classe. Dans ce microcosme otous les pays du monde se trouvent reprsents, tout le monde parti-cipe-t-il au mme jeu conomique? Pour tous, les dominos sont lesmmes : un mme dollar schange Wall Street, dans China Townou Harlem. Mais les circuits conomiques sont probablement ind-pendants. Les uns se dplacent en limousine, frquentent les restau-rants de luxe, shabillent chez les grands couturiers. Les autresvoyagent en mtro, portent une chemise fabrique pour un dollar lle Maurice. Une part des circuits est visible, formelle, lgale, une
D
ocum
ent t
lc
harg
de
puis
www.
cairn
.info
- -
- 8
5.16
9.11
8.21
4 - 2
4/06
/201
5 21
h28.
C
.E.R
.A.S
D
ocument tlcharg depuis www.cairn.info - - - 85.169.118.214 - 24/06/2015 21h28. C.E.R.A.S
-
autre est cache, informelle, clandestine, peut-tre mafieuse. Comme dansla salle de classe, il y a des rgles ou des manires de faire choisies,dautres crites et imposes qui permettent au jeu de se drouler.
Au terme de ce dossier, on a lenvie de se demander quelles rgles,lectives ou structurelles, permettraient de rduire le nombre de circuitsconomiques, de donner chacun davantage de place ou de possibilitdintgrer dans le jeu? En posant cette question, on pense videmmentnon pas seulement aux limites de Manhattan, mais lensemble de lco-nomie mondiale.
Des rgles lectives
Les premires de ces rgles rsultent de lintrt bien compris desacteurs. Ainsi lactionnaire, qui ne se contente pas dun profit immdiatmais souhaite en bnficier aussi pour lavenir, porte-t-il le souci dunecroissance durable de lentreprise, il souhaite la prservation des savoir-faire, lintgration progressive dune main duvre la fois mobile etqualifie. De mme, linvestisseur socialement responsable pourrainfluer sur la marche mme du capitalisme. Il contribue utilement au vivreensemble. Ces rgles dcrites par Etienne Perrot ou Daniel Michel ren-dent possible lintgration des acteurs les plus divers dans le jeu cono-mique. Elles sont comme la synthse dune thorie et dune pratique :fruit dune rflexion critique sur des manires de faire, comme peut ltrelthique du management. Elles contribuent sans nul doute transformerle jeu conomique. Dans le contexte de la mondialisation, elles se heur-tent cependant trois obstacles.
Aujourdhui, le premier dbat est celui de la prise en charge des exter-nalits dont le poids pse sur lenvironnement social ou cologique. Lesngociations pour louverture dun nouveau round de ngociations lOMC butent prcisment sur ce point. Dans de nombreuses situations,lindustrie et lagriculture ont exploit une part du patrimoine naturel,dtriorant parfois les sols ou latmosphre avec des pollutions chimiquesaux effets long terme. Elles rejettent des dchets, charge pour lacollectivit de les rsorber. Aux Etats-Unis, la pratique est courantedabandonner, sans dcontamination, les friches industrielles. Lanciennegouverneur du New Jersey avait lutt contre elle efficacement. Dautrescots sociaux sont renvoys la collectivit. En France, cest le cas desformations initiales et continues dont une faible part est la charge desentreprises mais dont celles-ci bnficient amplement. A moins de rendreobligatoire la prise en charge de ces cots sous forme de taxe, un droit polluer par exemple, la logique entrepreneuriale na aucune raison de lesintgrer.
96
Conclusions
D
ocum
ent t
lc
harg
de
puis
www.
cairn
.info
- -
- 8
5.16
9.11
8.21
4 - 2
4/06
/201
5 21
h28.
C
.E.R
.A.S
D
ocument tlcharg depuis www.cairn.info - - - 85.169.118.214 - 24/06/2015 21h28. C.E.R.A.S
-
97
Le second obstacle provient de la difficult des acteurs disposer desinformations ncessaires leur prise de dcision. La volont des investis-seurs dimposer des choix thiques se heurte en effet lopacit, pour untmoin extrieur, des choix industriels et de fabrication. Les dlocalisa-tions rcentes et la fluidit des projets souvent transitoires rendent illu-soires un contrle de linformation. Lactionnaire demeure tributaire despolitiques de communication des entreprises mais aussi des intermdiairesfinanciers. Le dveloppement de labels sociaux , un chelon interna-tional et sous lgide dorganisations comme le BIT, pourra-t-il rpondreen partie cette critique?
La focalisation sur ces rgles implicites peut laisser penser que toutesles motivations sont dordre rationnel . Rappelons cependant que lacomptition conomique est source de violence et quelle est susceptibledengendrer des ractions de peur, de panique, ractions quun rappel laraison ne suffit pas toujours contrler. Au sein des marchs boursiers,les oprateurs financiers, fortement intgrs, sont entrans dans des rac-tions en chanes. Il appartient souvent des organismes publics de semontrer davantage capables dassurer un suivi et de protger contre lescrises de liquidit et les dstructurations quelles engendrent. De faonplus classique, le choix de parents de se saigner pour duquer un ou plu-sieurs enfants chappe au choix rationnel tel quil est prsent danslutilitarisme. A la rationalit cohrente et goste soppose un com-portement altruiste . Comme le discute Amartya Sen, le choix irration-nel du pre peut tre rintgr dans le raisonnement comme une externalit que lon fait porter la famille, mais il peut aussi tre vucomme un comportement irrationnel.
Des rgles structurelles
A travers chacun de ces exemples apparat limportance dorganismesou dinstitutions en particulier internationaux susceptibles ddicterdes rgles et dinstaurer une confiance indispensable la tenue deschanges. Plus largement, le mouvement contemporain de globalisationet le dveloppement dun capitalisme patrimonial invitent revisiterles questions de proprit, daccs au capital financier mais aussi culturelet intellectuel.
LEtat de droit figure parmi les conditions premires dmergence ducapitalisme. Paradoxalement, ce rappel nous vient dun conomiste pru-vien sinterrogeant sur le triomphe du capitalisme lOuest et sur ses dif-ficults dans les pays du Sud. Hernando de Soto rappelle en effet quelEtat de droit, notamment en ce qui concerne le droit conomique et de
Conclusions
D
ocum
ent t
lc
harg
de
puis
www.
cairn
.info
- -
- 8
5.16
9.11
8.21
4 - 2
4/06
/201
5 21
h28.
C
.E.R
.A.S
D
ocument tlcharg depuis www.cairn.info - - - 85.169.118.214 - 24/06/2015 21h28. C.E.R.A.S
-
proprit, a t impos et non choisi parmi les acteurs conomiques. EnFrance, Colbert a largement contribu son extension. Aux Etats-Unis,dans un espace ouvert la colonisation, limposition de droits de pro-prit sur les terres ne sest faite que progressivement, au moyen decompromis permettant de faire prvaloir le droit sur le fait accompli, delinstallation et la mise en valeur dune terre encore vierge. Dans ce pro-cessus, linstitution judiciaire se chargeant de rgler les litiges, a conquisses lettres de noblesse. Linstauration de titres de proprits a permis ledveloppement des changes et des transactions.
Aujourdhui, les projets conomiques internationaux, associs une clture du monde, soumettent lextension du droit de nouveauxdfis. Faut-il laisser de grandes firmes breveter des savoir-faire ances-traux et traditionnels ou au contraire protger ces derniers? Quel droit dela pche organiser au sein de lUnion europenne et vis--vis de pays tierspour prserver des ressources dj fortement amoindries ? Mais aussi,comment empcher le dveloppement de zones de non-droit ou demoindre droit o le dplacement et la mobilit des capitaux ne sont guresoumis contrle?
Dans un contexte conomique qui renforce le pouvoir associ ladtention du capital, il peut tre aussi ncessaire de revenir sur les rglesqui en rgissent lacquisition. La socit qui semble sloigner de nous grands pas assurait une double forme de redistribution par le salaire et parles prestations sociales garanties par lEtat-providence. La socit patri-moniale qui sannonce lui substitue le capital, la fois garant de revenus,mais de plus en plus synonyme dentre dans les changes conomiqueset par l de capacits agir. Comme le rappelle Jean-Yves Calvez, onparle aujourdhui du droit de proprit comme faisant partie des droits delhomme et on le dcrit comme un droit de tout homme la proprit.Mais comment honorer ce droit, bien plus exigeant que le droit pour lepropritaire effectif dtre garanti couramment contre le vol ou lintrusiondans sa proprit qui est le droit de proprit au sens le plus ancien?Ncessairement par des mesures dgalisation et de correction des chancesen matire de proprit au sens le plus ancien? 1 Lauteur suggre desmcanismes de redistribution patrimoniale mis en uvre soit par les pou-voirs publics, soit par les entreprises.
Mais lacquisition du capital, condition dentre souvent rappele, nepeut tre envisage seulement sous langle financier. Ainsi que le sou-ligne Amartya Sen, une double perspective anthropologique doit treconsidre. Dune part, lhomme aspire agir et transformer le mondemais, dautre part il aspire aussi la libert : La libert peut tre juge
98
Conclusions
1. Jean-Yves Calvez, Changer le capitalisme, Bayard-ditions, Paris, 2001, p. 94.
D
ocum
ent t
lc
harg
de
puis
www.
cairn
.info
- -
- 8
5.16
9.11
8.21
4 - 2
4/06
/201
5 21
h28.
C
.E.R
.A.S
D
ocument tlcharg depuis www.cairn.info - - - 85.169.118.214 - 24/06/2015 21h28. C.E.R.A.S
-
99
prcieuse non seulement parce quelle permet daccomplir des choses,mais aussi de par sa propre importance, au-del de la valeur dexistencerellement atteinte. 2 Sous cet angle, les droits possder slargissentet doivent sentendre de manire dynamique. Il importe non plus dassu-rer chacun un accs au seul capital conomique. Il faut y joindre unaccs au capital culturel et intellectuel. Dans tous les cas, les rgles nontpas pour but premier de faciliter la possession ou lavoir , mais desoutenir la capacit agir et la libert en acte.
De nouvelles relations entre lEtat et lconomie
Action et libert renvoient aux sphres politique et conomique, et leurs interrelations. Dans le cadre de la globalisation, llargissement desterritoires conomiques force les rexaminer. Une relative indpendanceentre les sphres nous apparatra, nous, Occidentaux aussi bien histo-rique que ncessaire. Pourtant, celle-ci na jamais t absolue, bien aucontraire. Plutt que denvisager les figures historiques qui devront natre,il sagit de rflchir aux inflexions qui pourront les sous-tendre.
Autonomie mais non indpendance. Dans la tradition de Montesquieuet de lindpendance des pouvoirs, le philosophe amricain MichaelWalzer ambitionnait dans son livre Sphres de justice de dcrire unesocit dans laquelle aucun bien social ne sert ou ne peut servir de domi-nation . Cette conception est sans doute fortement inscrite dans lhis-toire de nos pays. Ainsi, lconomiste Robert Heilbroner attribue-t-il ledveloppement du capitalisme, distingu de la relative stabilit des soci-ts traditionnelles et fodales, et mme son acclration la constitutiondu groupe social des bourgeois en Angleterre, en France ou aux Etats-Unis. En se retirant dans la sphre conomique, ce groupe sest dlibr-ment affranchi dambitions politiques, entrant dcidment dans unelogique daccumulation. Ainsi la capacit dagir de lhomme sest-ellefortement dveloppe. Mais dans le mme temps, un rgime dmocra-tique, plac sous le signe de la libert, a vu le jour grce, en partie, lanaissance dun espace public ouvert dans lequel le citoyen peut entrerindpendamment de sa richesse, de sa naissance ou de son mrite.
En rester lindpendance des deux sphres nous amnerait unevue tronque de lhistoire. Car aujourdhui la relation entre la Cit etlconomie a encore chang, cette fois-ci, cest lEtat qui a pris en chargeles fonctions ncessaires pour protger lconomie des consquences dunmarch non rgul. Ces interventions ont commenc avec des problmes
Conclusions
2. Amartya Sen, Ethique et conomie, Puf, philosophie morale, Paris, 1993, p. 57.
D
ocum
ent t
lc
harg
de
puis
www.
cairn
.info
- -
- 8
5.16
9.11
8.21
4 - 2
4/06
/201
5 21
h28.
C
.E.R
.A.S
D
ocument tlcharg depuis www.cairn.info - - - 85.169.118.214 - 24/06/2015 21h28. C.E.R.A.S
-
aujourdhui familiers comme lassurance chmage et les retraites,et maintenant ils prennent une direction nouvelle avec la protectionde lconomie contre les incursions des forces de lconomie glo-bales 3 . Comme nous lindiquait Olivier Dard, ce commentaire deR. Heilbroner sappliquant aux Etats-Unis a aussi des rsonances enFrance. Le choix de la stabilit montaire, plus rcent, peut-il long-temps se faire aux dpens des politiques conomiques menes pouravancer un projet de socit?
Mais au-del des politiques conomiques nationales, cest lchelle internationale que la relation entre les deux ples appelle tre redfinie. Le politique se trouve devant un double dfi. Dunepart, il sagit douvrir et dlargir un espace public au sein duquel lesattentes conomiques des citoyens trouveront saiguiser et seconfronter. Jusqu prsent, le poids des ONG mais aussi des organi-sations (patronales, syndicales et ouvrires) a contribu faonner ledbat. Dautres instances relais doivent natre, pour quau-del desconfrontations symboliques de Seattle ou de Nice, un vritable dia-logue puisse se nouer. Seule cette voie donnera aux gouvernements lalgitimit ncessaire la mise en place des instances capables de rgu-ler les concurrences internationales et de promouvoir une participa-tion de tous au jeu conomique. Si la voie dun gouvernementmondial parat trop lointaine ou totalitaire, comme le notaient SusanGeorge et Erik Izraelewicz, de nombreuses questions restent encoreen suspens. Les rgles du jeu ont-elles besoin dun arbitre? Quelleest la place de linstance administrative, de linstance judiciaire? Peut-il y avoir un garant de lintrt commun? Sous quelle forme?
Dautre part, il sagit de trouver des voies nouvelles de prospec-tive pour lavenir de notre plante et de nos pays. Les gouvernementsoccidentaux ont une longue tradition de rflexion et de projets.Llaboration de scnarios permettrait dvaluer et de confronter lesperspectives : comment les plus faibles, les moins duqus, ont-ilsleur place dans lavenir des pays? Comment les solidarits internatio-nales continuent-elles de se nouer entre pays proches ? Entre paysplus lointains? Quel partage des ressources entre les gnrations?
Pierre Martinot-Lagarde
3. Robert Heilbroner, 21 st Century Capitalism, WW Norton and Company, NewYork et Londres, 1993, p. 78 (traduction PML).
100
Conclusions
D
ocum
ent t
lc
harg
de
puis
www.
cairn
.info
- -
- 8
5.16
9.11
8.21
4 - 2
4/06
/201
5 21
h28.
C
.E.R
.A.S
D
ocument tlcharg depuis www.cairn.info - - - 85.169.118.214 - 24/06/2015 21h28. C.E.R.A.S