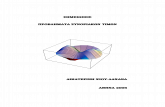Boutan_2012
description
Transcript of Boutan_2012
-
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
1
RENOUVELER LENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANAISE PAR LA GRAMMAIRE HISTORIQUE ?
BRAL, BRACHET, DUSSOUCHET
Pierre Boutan IUFM de Montpellier
LA GRAMMAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANAISE DE BRACHET, UN VNEMENT MARQUANT
Tout suse et tout passe dans ce monde, mme la routine. Nous commenons ne pas dsesprer quun jour les recherches qui ont renouvel depuis cinquante ans la science du langage, et de la langue franaise en particulier, finissent par profiter lducation. Tandis que lUniversit garde fidlement les traditions de la rhtorique et demeure le royaume glorieux de l-peu-prs ; tandis que les lves de lEcole normale, de cette cole o il ny pas une chaire de linguistique, pas une chaire darchologie, suivent un cours dconomie politique, et peuvent, grce la sollicitude de M. le Ministre, apprendre au moins la thorie de la richesse, quils ne connatront jamais autrement, ltude nouvelle du langage et les rsultats obtenus se rpandent peu peu en dehors de lenseignement officiel. Il existe un petit groupe de jeunes savants affranchis des prjugs et des sots ddains qui ont si longtemps ferm la France aux travaux trangers, svres pour eux-mmes et pour les autres, parce quils savent le prix de la rigueur et les justes exigences de la science, qui svertuent introduire chez nous les vrais mthodes. Ils ont leur journal, la Revue critique, qui les met en communication rgulire avec le public ; ils font des livres o lon reconnat lesprit positif, qui est la force du sicle. Cest parmi eux que sest form M. A. Brachet, lauteur dune grammaire historique de la langue franaise, dont nous croyons pouvoir prdire le succs. La grammaire qui prtend enseigner lart dcrire correctement et les rgles du beau parler, la grammaire qui sait rgenter jusquaux rois, na rien faire avec celle-ci. []
En consacrant les trois-quarts de la 3me page du numro du 24 mars 1868 du journal Le Temps, dj connu pour son srieux, un article rendant compte de louvrage dAuguste Brachet, paru chez lditeur Hetzel, Paul Challemel-Lacour, ancien normalien, professeur de philosophie, rpublicain rfugi dans le journalisme culturel1, prsente un tableau clair des enjeux de lpoque, quant aux relations entre le savoir savant et le savoir enseign. Le point de vue est critique : Gabriel Bergougnoux2
Lenthousiasme de Littr dans le Journal des Dbats
souligne cependant les efforts de Fortoul aprs 1851 pour dvelopper la grammaire compare, tout comme la cration par Duruy, en 1868 justement, de lcole Pratique des Hautes tudes, destine contourner la Sorbonne pour dvelopper le modle allemand des tudes suprieures, en associant haut enseignement et recherche.
3 du 1er avril 1868 nest pas moindre : 5 colonnes sur 6 la 3me page4
Quand on est vieux et prs de quitter la carrire, il y a satisfaction se tourner vers ceux qui viennent, et rendre bon tmoignage luvre des jeunes gens.
, article qui sera dailleurs utilis pour servir de prface la deuxime dition. Pour conclure, Littr souligne lui aussi la jeunesse de lauteur, et son appartenance une nouvelle gnration :
1 La troisime Rpublique lui permettra de devenir prsident du Snat et ministre dans les dernires
annes du sicle. 2 Aux origines de la linguistique franaise, p. 124. 3 Journal libral non moins srieux, o sillustrent Renan, Bersot ou Prvost-Paradol. 4 Il faut rappeler que les quotidiens dalors tirent sur 4 pages.
-
PIERRE BOUTAN
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
2
En effet, dans le petit groupe de jeunes savants , qui ont tous fait une partie de leurs tudes en Allemagne, Auguste Brachet est le plus jeune : il a 22 ans (n en 1845), alors que les chartistes Gaston Paris (n en 1839) et Paul Meyer (1840) ont pour leur part dj entam leur uvre savante, et commenc occuper des postes universitaires parisiens5
Gaston Paris nest pas en reste dans la Revue critique dhistoire et de littrature
. Seul cependant Michel Bral, il est vrai un peu plus g n en 1832, il a donc dpass la trentaine , a dj atteint le collge de France.
6
Grce M. B., il ne sera plus permis dignorer, comme on le fait jusquici, les premiers lments de notre vraie grammaire, et de spculer laventure sur des faits dont on ne connat ni lorigine ni le caractre ; on ne pourra plus opposer la critique cette fin de non-recevoir tire de lignorance o on est de lallemand ; et nous aurons le droit dexiger de tous ceux qui prtendent parler de la langue franaise quils possdent fond au moins ce petit volume.
:
La Grammaire de M. B. est destine, je nen doute pas, avoir plusieurs ditions []
Sauf que, comme lindiquait Challemel-Lacour propos des auteurs de cette revue, la partie critique lemporte de trs loin sur les compliments : Gaston Paris, qui collaborera avec Brachet pour traduire luvre de leur matre Diez, peut se rfugier derrire le genre spcifique du petit volume (311 pages tout de mme) : le choix de lditeur Hetzel, peu susceptible daccueillir des ouvrages savants, indiquait quil sagissait bien dune uvre destine au public plus largi des non-spcialistes7, sans doute pas le grand public, mais au moins le public lettr. Le Journal des Instituteurs, un des plus influents priodiques pdagogiques, dans sa Chronique hebdomadaire du 18 avril 1868 va mme reproduire larticle de Littr8
Quant au succs ditorial, il va sans aucun doute correspondre au pronostic : le titre 20 entres dans le catalogue de la BNF, la dernire datant de 1911.
Mais ds 1869, le libral Duruy quitte le ministre de lInstruction publique : les grandes rformes, celles de lenseignement suprieur, du secondaire ou du primaire quil souhaitait ont avort.
5 Lcole anthropologique, rivale mais en situation dinfriorit universitaire, est de la mme
gnration : Abel Hovelacque et Julien Vinson sont ns tous deux en 1840. Sa Revue de linguistique et de philologie compare est cre aussi en 1867.
6 1er semestre, p. 24. 7 Cest dans le mme catalogue de Hetzel que lon retrouve aussi bien Jules Verne que Camille
Flammarion. 8 Consultation du 27 juillet 2010 :
http://www.inrp.fr/numerisations/fascicule_res.php?periodique=1&annee_from=1867&annee_to=1868&pdf=INRP_JDI_18680419_FA&search=brachet
Page de titre de ldition de 1895. Origine gallica.bnf.fr
-
RENOUVELER LENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANAISE
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
3
APRES LA DEBACLE, UN NOUVEAU CONTEXTE POLITIQUE, BREAL AU PREMIER PLAN
Aprs les terribles vnements de 1870-71 : la droute face aux Prussiens, qui produit leffondrement de lEmpire et la guerre civile de la Commune, le temps est venu de procder aux rformes longtemps retardes, tant il apparat lopinion que cest linstituteur prussien qui a gagn la guerre . Cest alors Bral qui va occuper le devant de la scne, par le dveloppement de son uvre scientifique sans doute, mais surtout par ses interventions dans le domaine de lenseignement. Son ouvrage paru au lendemain de lanne terrible , Quelques mots sur linstruction publique en France, fait sensation, au moins dans le public lettr : ainsi Frdric Baudry, qui dans Le Temps du 27 mars 1872, lui consacre sur 6 colonnes presque toute la page 3. Michel Bral y prsente une analyse svre de lducation en France, porte par une tradition catholique peu soucieuse de rationalisme et de libre examen, la diffrence de la tradition protestante des pays anglo-saxons ; et un ensemble de rformes conduire de lenseignement primaire lenseignement suprieur, sur le modle prussien. Il montrait que la Prusse avait acquis sa supriorit aprs sa dfaite face la France du Premier Empire, en construisant un systme ducatif qui solidarisait enseignement de llite et enseignement populaire : ctait ce modle quil fallait reprendre pour la France. La critique tait particulirement aigu sur lenseignement de la langue nationale, apprise selon lui comme une langue morte, en faisant appel seulement la mmoire, sans tenir compte des connaissances de lenfant acquises dans sa famille, et submerge par les dictes au dtriment de la composition franaise, alors qu il fallait apprendre la grammaire par la langue, et non la langue par la grammaire , citation de Herder qui allait fournir dinnombrables sujets de compositions de pdagogie La premire leon de Bral la rouverture du collge de France en 1872 est consacre la question : Quelle place doit tenir la grammaire compare dans lenseignement classique , o il met en garde contre un usage du savoir savant sans retraitement didactique :
Limportant nest pas de transmettre nos lves la science toute faite, mais de leur en donner le got et de les rendre capables de lacqurir. 9 Lutilit de la grammaire compare naurait jamais donn lieu discussion, si nous avions lhabitude de mieux distinguer entre les tudes du matre et celles de llve.
10
Mais Bral ne se contente pas de thoriser : il devient membre du cabinet officieux du ministre de lInstruction publique Jules Simon, et joue sans aucun doute un rle dans ladoption dune rforme de lenseignement secondaire, il est vrai seulement sous la forme de la circulaire aux proviseurs du 27 septembre 1872. On y trouve, en plus de la ncessit de mieux organiser les relations entre matires, la volont de rquilibrer partir de la 6me langues mortes et langues vivantes : On ne perdra pas de vue, dans ces commencements, quil sagit de lire le latin, et de parler lallemand ou langlais Je voudrais que lon cesst presque compltement de faire apprendre des rgles par cur.
11
En rduisant de fait la place du latin, la circulaire ne pouvait que susciter la rsistance du corps professoral, hostile depuis toujours aux diverses tentatives dinstaurer des filires sans latin dans lenseignement secondaire. Par contrecoup, la grammaire franaise tait dsormais prsente de la 8me la 4me dans le plan dtudes du 23 juillet 1874.
Et pour cela, Jules Simon appelle faire des comparaisons entre langues
9 Citation daprs Mlanges de Mythologie et de linguistique, p. 339-340. 10 Id. p. 343. 11 Cit daprs le Manuel Gnral de lInstruction primaire, n 49, 5 octobre 1872, p. 477 et p. 478.
-
PIERRE BOUTAN
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
4
Edition de 1884, fonds du
QUELLE PLACE POUR LA GRAMMAIRE HISTORIQUE A LECOLE ?
Cest dans ce contexte que Brachet fait paratre en 1874 chez Hachette sa Nouvelle grammaire franaise fonde sur lhistoire de la langue. Accompagne en 1875 dun volume dExercices sur cette grammaire d J. Dussouchet, et dune Petite grammaire, destine aux plus jeunes lves12
Le Temps accueille un article favorable de Frdric Baudry
.
13
La Nouvelle grammaire franaise, de M. Brachet a enfin vu le jour pour ldification des uns et le scandale des autres. Depuis quelques annes, notre enseignement grammatical classique est branl jusque dans ses fondements. Il reposait sur de vielles mthodes que maintenait une tradition paresseuse ; mais voici quil scroule sous les coups de lesprit scientifique, qui la convaincu dtre faux en plus dun endroit, et, dans tous les cas, de mconnatre les lois dune saine pdagogie. La critique en est aise, et lon na qu relire M. Bral pour apprcier le nant dune tude ainsi conduite. Mais la remplacer, fonder un enseignement nouveau sur des bases solides, en se gardant galement de la routine et du charlatanisme des fausses innovations, voil le difficile et ce qui demande la fois la science de
lrudit, la mthode du philosophe et lexprience du professeur. M. Brachet y a-t-il russi du premier coup ? Comme philologue, on ne pouvait assurment trouver un crivain plus comptent et plus ingnieux que lauteur de la Grammaire historique et du Dictionnaire tymologique ; mais au point de vue de lenseignement, lusage seul nous apprendra comment son uvre sera accepte par les lves, et surtout par les matres, parfois un peu rtifs aux nouveauts. Ds aujourdhui pourtant, on peut esprer quil est dans la bonne voie. De quoi sagit-il en effet ? Dcarter un procd purement mcanique, imposant la mmoire des rgles ou plutt des oracles quon ne prenait jamais la peine de justifier, et dy substituer une mthode qui fait appel la raison comme auxiliaire de la mmoire. Pour faire retenir les faits grammaticaux, lenseignement nouveau sefforce de les expliquer. A cet gard, ltat prsent de la langue dpend de ltat ancien et s claire par lui. Parmi les faits grammaticaux actuels, ceux qui ne portent plus en eux-mmes leur lumire et leur raison dtre logique, lont eue autrefois, et pour la retrouver, il ne sagit que de remonter assez haut.
, mme si, cette fois, la place est rduite une seule colonne.
AUGUSTE BRACHET, SAVANT, CAUSEUR, PEDAGOGUE
Luvre dAuguste Brachet se dveloppe alors en effet la fois sur le plan scientifique et sur le plan pdagogique, au moins jusqu 1876. Ainsi publie-t-il chez Franck un Dictionnaire des doublets ou doubles formes de la langue franaise, prfac par Bral (1868-1871), puis, avec Gaston Paris, la traduction du premier tome de la Grammaire des langues romanes de Diez (1873-1874). Un Dictionnaire tymologique de la langue franaise, avec une prface par mile Egger (1re dition en 1870) parat aussi chez Hetzel. Du ct pdagogique, outre sa Nouvelle grammaire, des Morceaux choisis
12 Selon une tradition qui remonte aux Petits et Grands Catchismes, prototypes des tous les manuels
scolaires. 13 6 janvier 1875, p. 3. Frdric Baudry est par ailleurs bibliothcaire de lArsenal.
Edition de 1884, fonds du CEDRHE de lIUFM de Montpellier
-
RENOUVELER LENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANAISE
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
5
des grands crivains du XVIe sicle, accompagns d'une grammaire et d'un dictionnaire de la langue du XVIe sicle, sort la mme anne 1874 chez Hachette.
Dsormais, Brachet abandonne les publications savantes. Professeur par ailleurs lEcole Pratique, il enseigne lallemand lEcole polytechnique, mais des problmes de sant vont lobliger frquenter villes deaux et rives de la Mditerrane, ce que sans doute les revenus tirs de ses manuels lui permettaient. Le catalogue de la BNF dcompte 132 entres son nom, dont 58 aprs sa disparition 53 ans, en 1898. Sur ce total, 40 ouvrages de grammaire scolaire sont signs avec J. Dussouchet. Pour autant, la clbrit dAuguste Brachet passe aussi par le succs quil acquiert dans les salons, o il impressionne aussi bien Alphonse Daudet, Sully-Prudhomme (qui donne son nom au titre de lun de ses sonnets) et mme Edmond de Goncourt qui linvite Champrosay et tmoigne dans son Journal14
Cest en effet un causeur suprieur par la science profonde quil possde de toutes les questions quil aborde, par le jugement original quil porte sur elles []
:
Pour autant, sil ne publie plus dans le domaine de la science philologique, Brachet va se faire remarquer en suscitant une polmique avec un ouvrage sur la francophobie italienne, repre dans les programmes et les manuels scolaires : LItalie quon voit et lItalie quon ne voit pas, a 5 entres au catalogue de la BNF, de 1881 1883.
SAVOIR SAVANT, SAVOIR SCOLAIRE
Mais revenons la rception de sa Nouvelle grammaire. Dans le Manuel gnral de linstruction primaire, le principal priodique pdagogique du genre, dpendant de Hachette, Charles Delon15 consacre trois articles, les 6, 13 et 20 fvrier 1875, une Esquisse des origines et de lhistoire de la langue franaise et de ses congnres qui associe Bral et Brachet : lenthousiasme est sans limite16
Une science ne dhier est en train de transformer tout un enseignement, celui-l mme quon et cru le plus inbranlable sur ses bases traditionnelles ; le mieux labri contre toute tentative rvolutionnaire : je veux parler de lenseignement grammatical [] [V]oil que la rvolution est faite, vaste et profonde, tout dabord sur le terrain des hautes tudes [] [L]e mouvement ne sarrte pas l. Dj il nest question que de rformes, de modifications apporter, non seulement dans lenseignement des langues anciennes, lcole secondaire, mais, qui le croirait ? jusqu lcole primaire [].
.
Le livre de M. Bral, Quelques mots sur linstruction publique en France, a fait profonde sensation ds son apparition, et le public lettr la accueilli avec faveur. Dautre part, symptme plus pressant, des livres denseignement, des livres classiques destins au pupitre de lcolier [] M. Brachet [avec] Grammaire historique, Nouvelle grammaire, un ouvrage scolaire [] la Petite Grammaire, menace daller poursuivre la routine dans ses derniers retranchements En un mot, le mouvement est imprim, lide est dans lair, elle pntre par toutes les issues. Elle entre par les fentres dans lenseignement officiel, en attendant quon lui ouvre la porte toute grande : ce qui ne saurait tarder. Et quand ce sera fait, ilfaudra bien que lcole primaire lui ouvre son tour []. La moderne science du langage, la linguistique applique ltude des langues les procds rigoureux que le physicien, le naturaliste appliquent ltude de la nature [].
14 Journal, 25 juillet 1889, Collection Bouquins, t. III, Robert Laffont, 1989, p. 302. A la suite, un
portrait physique moins avantageux : Un petit homme aux yeux noirs, la barbe grle, au teint marbr de plaques rougeaudes de bromure, au crne la conformation assez semblable celui de Drumont.
15 Auteur pdagogique prolixe, qui touche tous les domaines denseignement (131 entres au catalogue de la BNF).
16 Manuel gnral, 1875, n 6, p. 42. Les soulignements en italiques sont de lauteur. Les journaux pdagogiques ont alors un large public dinstituteurs.
-
PIERRE BOUTAN
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
6
Dans larticle suivant17
Toute langue (tandis quelle vit) est en tat de transformation continue []. , Charles Delon prsente ainsi les thses de la linguistique :
[L]es langues qui appartiennent un mme groupe ont une origine commune. [] [Le franais, le provenal, lespagnol et le portugais, litalien] toutes sont du latin.
Et dans son dernier article18
Telle race, telle langue []. [L]histoire des mots est en mme temps celle des ides.
, faisant rfrence Schlegel, Bopp et Chave, il sinscrit dlibrment dans le naturalisme linguistique, dbordant alors Bral comme Brachet :
Considrations de nature donner une nouvelle dimension patriotique lenseignement des langues, dans un contexte de revanche et de colonisation qui ne pouvait tre sans consquence. On aura remarqu pour le moment que, pour Charles Delon, domine aussi lide que cest par le haut que les changements soprent, puis descendent vers le secondaire, avant de toucher le primaire.
Or on a vu plus haut que Michel Bral mettait en garde contre un transfert naf du savoir savant dans lusage scolaire. Auguste Brachet, qui vise explicitement le public scolaire du seul secondaire (cest--dire alors moins de 3% dune classe dge) tait pleinement conscient des problmes, comme il lexplique ds la prface de sa Nouvelle grammaire.
Je nai point dfendre lutilit de la mthode historique, puisque son application lenseignement du franais est une doctrine officielle aujourdhui. Mais elle ne sest pas galement impose lopinion du public pdagogique, et bien des matres (oubliant quon doit toujours lexplication des choses quon enseigne) se refusent encore ladopter, soit par dfiance de linconnu, soit par attachement aux vieilles mthodes. Leur argument dcisif, cest que lexplication de la grammaire franaise nest autre chose, disent-ils, que ltude du vieux franais, et que cette rudition est un objet de luxe pour des enfants qui ont tout juste sept annes devant eux pour apprendre le ncessaire.
Brachet entend rpondre largument en rappelant le rle secondaire et progressif de la mthode historique, et donc de la grammaire franaise, par rapport au latin :
Quand llve possdera pratiquement et par le seul effort mnmonique les faits grammaticaux, alors, et seulement alors, il sera temps pour le matre dveiller par degrs la curiosit de lenfant. [] Ltonnement une fois n dans ces jeunes esprits, le matre satisfera avec discrtion leur curiosit, en commentant lesexplications en petit texte que jai places, dans cette Grammaire, la suite des diffrentes rgles. Sil est essentiel, pour que lenfant soit touch des lumires de la grammaire historique, de respecter au pralable les droits de la mmoire et de nintroduire les explications des rgles que dans la rvision du cours, il est une autre prcaution tout aussi importante observer : cest de graduer les explications suivant lintelligence de lenfant et sa connaissance du latin : ce sera la tche la plus difficile du matre que dchelonner, depuis la classe de septime jusqu la quatrime, les claircissements historiques, en profitant chaque anne de la connaissance plus familire de la langue latine, et en atteignant ainsi le but par des rvisions annuelles et des retouches successives.
DUSSOUCHET, LES SUCCES DE LIBRAIRIE DUN PEDAGOGUE ECLAIRE
Ctait faire face aux objections sans doute, mais avec le risque de rduire la mthode historique de simples remarques Situation aggrave de ce point de vue lorsque les Rpublicains arrivent pleinement au pouvoir en 1879, et que Jules Ferry repousse lenseignement du latin la 6me. Ds lors, ltiquette historique va tre conduite
17 Id., n 7, p. 51. 18 Id, n 8, p. 57.
-
RENOUVELER LENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANAISE
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
7
une rduction drastique aprs 1887 dans les titres des grammaires toujours signes par le couple Brachet et Dussouchet.
On aura une ide du travail la fois des auteurs et de lditeur Hachette, en utilisant les entres communes aux deux auteurs dans le catalogue de la BNF, entre la premire dition de la Grammaire historique de Brachet, et 1910, date la fois de la disparition de Dussouchet et de la publication de la premire nomenclature grammaticale officielle commune, qui va obliger les diteurs rviser tous leurs manuels. Lhistoire ditoriale de nos deux auteurs ne sarrte nullement, pas plus avec le dcs de Brachet (1898) quavec celui de Dussouchet (1910), puisquelle continue encore plus de 20 ans aprs cette date : phnomne banal pour les uvres succs. Il sagit ici dindications qui ne peuvent prtendre lexhaustivit, les diteurs ayant tendance en matire de manuels scolaires ngliger le dpt lgal pour chaque dition nouvelle. Et la confusion est dautant plus grande que le mme titre peut tre ensuite diffrenci en livre de llve, exercices, corrigs des exercices, livre du matre Ainsi la chronologie suivante ne distingue pas les livres du matre, mais fait valoir la prsence des livres dexercices, dans la mesure o ils sont dits sparment du livre de llve, ce qui est assez variable.
Quelques brves remarques : Dussouchet devient dabord le collaborateur de Brachet pour les livres dexercices, puis leur couple est insparable jusquau dcs de ce dernier. Ensuite Dussouchet signe seul uniquement les manuels destins lenseignement primaire, quil renomme Cours primaire de grammaire franaise. La stratgie ditoriale mise en uvre est conforme au mouvement du haut vers le bas cher Bral, vrai dire classique depuis au moins Condorcet. Aprs un ouvrage de vulgarisation scientifique, Brachet publie lusage des classes de collge et de lyce une Nouvelle grammaire fonde sur lhistoire de la langue , accompagne pour les lves les plus jeunes, dune Petite grammaire cette fois en commun avec Dussouchet. Aprs les nouveaux programmes en primaire de 1882, un cours complet de grammaire franaise fonde sur lhistoire de la langue dclinant les trois niveaux officiels parat partir de 1883. 1887 1888 : aprs le recul du latin de la 8me la 6me, une nouvelle dition va dtailler les diffrents niveaux du cours lmentaire au cours suprieur de lenseignement secondaire. Le Nouveau cours pour le secondaire abandonne la rfrence lhistoire de la langue et deux autres ouvrages ( grammaire franaise complte et grammaire franaise abrge ) pour lenseignement primaire suprieur et lenseignement secondaire de jeunes filles (tous les deux sans latin) sont publis. Ds lors lappellation Brachet et Dussouchet couvre tous les niveaux et tous les enseignements.
Il va de soi que Hachette, dj le principal diteur de manuels scolaires, ne se contente pas de cette production pourtant abondante : il a dans les annes 1880 son catalogue, en particulier pour le primaire, dautres grammaires destines faire face aux divers gots des matres, mme une grammaire de Lhomond qui fleure bon la fin du XVIIIe sicle et bien sr une grammaire de Noel et Chapsal, tmoin de la premire grammaire scolaire au sens dAndr Chervel. Mais aussi des Leons de grammaire franaise de Pauline Berger et Eugne Brouard, dont paraissent en 1879 un cours lmentaire, et en 1883 un cours moyen. Ces auteurs viennent directement du primaire, alors que Brachet vient du suprieur et Dussouchet des petites classes de lenseignement secondaire. Le prestige ne suffit pas : lorsquil produira des grammaires pour lenseignement primaire, Dussouchet ne manquera pas de faire figurer dans une prface les noms de plusieurs instituteurs qui auront collabor louvrage.
Sil na pas produit douvrage scientifique, Jean Dussouchet (1843-1910), dabord aspirant puis matre rptiteur au lyce dAngoulme, charg de cours en 7me Paris,
-
PIERRE BOUTAN
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
8
passe son agrgation de grammaire en 187419
Abrviations : B : Brachet D : Dussouchet - GHLF : Grammaire historique de la langue franaise NGFFHL : Nouvelle grammaire franaise fonde sur lhistoire de la langue PGFFHL : Petite grammaire franaise fonde sur lhistoire de la langue NCGF : Nouveau cours de grammaire franaise CGF prim : Cours de grammaire franaise lusage de lenseignement primaire GFCompl : Grammaire franaise complte GF Abr : Grammaire franaise abrge Ex : Exercices CE : Cours lmentaire - CM : Cours moyen - CS : Cours suprieur CP : Cours prparatoire Gram E : Grammaire enfantine
. Nomm au lyce de Vanves, puis Henry IV, il enseignera de la 8me la 4me, jusqu sa retraite en 1908. Le Bulletin de la socit linguistique de Paris nous apprend quil entre la Socit, patronn par Egger et Bral, le 18 novembre 1876, et quil assiste plusieurs sances entre 1877 et 1882. Membre de nombreuses commissions, en particulier sur lenseignement secondaire de jeunes filles, il sintresse plus particulirement lenseignement des aveugles et des sourds-muets (il fait diter en braille une grammaire Brachet et Dussouchet). On retiendra que Buisson le choisit comme matre duvre des articles consacrs la langue franaise dans son Dictionnaire de pdagogie et dinstruction primaire ( ct notamment de Bral). Enfin, il est assurment lorigine du mouvement, qui, aprs plusieurs annes, aboutira lanne de sa mort la premire nomenclature grammaticale officielle.
Les cours prparatoire, lmentaire, moyen et suprieur dsignent dans lenseignement secondaire : 10me et 9me pour le cours prparatoire, 8me et 7me pour le cours lmentaire (soit les classes lmentaires) ; 6me et 5me pour le cours moyen, 4me et 3me pour le cours suprieur (classes de collge).
Dans lenseignement primaire, ne sont officiels avant le dbut du XXme sicle que la classe enfantine (avant 6 ans lcole primaire), le cours lmentaire (8 et 9 ans), le cours moyen (10 et 11 ans) : le cours suprieur (12-13 ans) est en gnral rduit quelques units qui forment rarement une classe homogne. Le cours prparatoire nexiste dans les textes officiels quaprs le dbut du XXme sicle.
CHRONOLOGIE DES OUVRAGES DE GRAMMAIRE DAUGUSTE BRACHET (1867-1910)
Dates GHLF (B)
NGFFHL (B)
PGFFHL (B et D)
CGFFHL prim (B et D)
NCGF (B et D)
CGFprim (B et D)
GFCompl (B et D)
GF Abr (B et D)
1867 * 1868 * 1869 1870 * 1871 * 1872 ** 1873 ** 1874 * * Ex par D
19 Il faut rappeler qualors lagrgation est un concours de recrutement rserv aux normaliens et aux
enseignants en poste. Lagrgation de grammaire, destine produire des professeurs jusquen 3me, est rmunre un niveau infrieur.
-
RENOUVELER LENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANAISE
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
9
1875 * * * 1876 * * Ex par D
1877 * ** Ex par D
1878 1879 1880 1881 * 1882 * Ex par D
1883 *CE *CM *CS
1884 *CE 1885 * 1886
1887 * *CE *CM *CS * Ex
1888 *CS *Ex *CM *CS *Ex *
1889 * Ex * Ex
*
1890 1891 1892 1893 1894 * Ex 1895 * * Ex 1896 *CE *CE *Ex 1897 *CP *Ex 1898 *CE 1899 *CS *Ex 1900 1901 *Ex *CE par D *
1902 *CM par D *CP par D
1903 *CS par D 1904 *CE *CS par D * 1905 *CS 1906 *CS par D 1907 *CE *Gram E par D 1908 *CS *CE *CS 1909 *Gram E 1910 * * Comme le remarque Jean-Claude Chevalier, louvrage de Brachet et la suite ceux quil produit avec Dussouchet, noffrent pas de grande innovation. On aborde en premier ltude des lettres (en fait leur valeur phontique) ; puis ltude classique des
-
PIERRE BOUTAN
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
10
parties du discours , appele ici Etude des mots , ou ailleurs, et plus classiquement, Lexicologie , constitue lessentiel, suivie dune partie Syntaxe , cest--dire les questions daccord orthographique, avec pour finir une syntaxe des propositions , lanalyse tant limite un simple appendice. Cependant, ds que le niveau dge des lves augmente, les ouvrages commencent par une Histoire de la langue franaise .
En dfinitive, lapport de la grammaire historique pour le secondaire reste limit, tant que bientt il disparat des titres douvrages. La grammaire historique a toutes les
chances dtre rduite dans cette configuration un simple moyen de montrer le rapport entre franais et latin, au-del des apprentissages initiaux. Ds lors, les professeurs fidles la tradition antrieure ne peuvent qutre rassurs, mais avec le risque de remettre en selle lenseignement dogmatique, pourtant vivement critiqu, puisquil est reconnu comme ncessaire au dbut, et quil ne pourra qutre seulement suivi plus tard dun enseignement plus rationnel.
INTRODUIRE LA GRAMMAIRE HISTORIQUE DANS UN ENSEIGNEMENT
SANS LATIN ?
Les partisans dun enseignement secondaire moderne allaient marquer des points avec la rforme de 1902, crant une filire B moderne , rapproche ainsi de lenseignement secondaire fminin dj sans latin : ctait avancer aussi vers ce que lon commenait dj appeler lcole unique , soit la fin des deux coles, lune pour les enfants du peuple, lautre pour les enfants
bien ns , les deux enseignements tant, contrairement une lgende commode mais fausse, soigneusement spars par les Rpublicains la Jules Ferry.
Distinction par le latin ou cohsion autour de la langue nationale commune ? Situation complique de plus par le fait que cette langue nationale tait la langue maternelle de moins de la moiti de la population franaise encore en 1900. Lannexion de lAlsace et de la Lorraine par la Prusse stait justifie par le moyen de la langue, mme si les cartes linguistiques taient passes au second plan par rapport aux besoins stratgiques, puisque Metz par exemple navait jamais t germanophone. Mais pouvait-on reprocher aux Prussiens ce qui avait lgitim lannexion dix ans plus tt par la France cette fois des Savoies et du comt de Nice20
20 Cette annexion fut cependant couverte par un plbiscite, ce qui ne fut pas le cas videmment pour
lAlsace-Lorraine.
? Aprs Fustel de Coulanges et Renan, Bral se garde de confondre langue et nationalit, ce qui aurait justifi lannexion prussienne de lAlsace-Lorraine Bral avait pris bras le corps le problme dans Quelques mots, en nhsitant pas, et contre le courant dominant de lopinion, dvelopper des vues originales sur le rapport avec les patois , identifis des langues nayant pas eu la chance dtre valorises par lhistoire politique. A chaque fois quil en aura loccasion, Bral va inviter les instituteurs les utiliser au lieu de les ignorer ou de les combattre pour apprendre le franais : dabord parce quil est
Edition circa 1896, fonds du CEDRHE de lIUFM de Montpellier
-
RENOUVELER LENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANAISE
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
11
dommageable de donner aux enfants le sentiment dsastreux que la langue quils parlent dans leur famille est nie dans son existence mme, ensuite parce que21
On ne connat bien une langue que quand on la rapproche dune autre de mme origine. Le patois, l o il existe, fournit ce terme de comparaison. Quelques rgles de permutation, donnes par linstituteur, mettront llve en tat de trouver les liens de parent qui unissent les deux langages.
:
Lide que le patois est un parler tout fait digne de mpris est si bien tablie dans lopinion gnrale quil faudra dabord quelque prcaution pour lintroduire lcole.
Cette lucidit, dont on voit bien lorigine dans sa pratique savante de linguiste, a bien sr ses limites, ne serait-ce que parce que, parmi les idiomes locaux , tous ne sont pas de mme origine justement que le franais. Certes, les instituteurs, recruts localement, ont la mme langue maternelle que leurs lves. Mais comment transformer cette connaissance naturelle en moyen pdagogique ?22
Nos instituteurs, qui pour la plupart sont ns la campagne, et quon place ordinairement dans le dpartement mme dont ils sont originaires, sont bien placs pour donner lenseignement dont nous venons de parler. La seule difficult, cest de vaincre le prjug qui existe chez eux, et peut-tre chez ceux-l le plus fortement, chez ceux-l mme qui ont le plus longtemps parl patois au foyer domestique. Mais un cours dhistoire de la langue franaise donn lcole normale triomphera sans peine de ces prjugs. La grammaire historique dAuguste Brachet, si claire et si intressante, tiendra lieu de cours pour ceux qui sont dj en fonctions. Il serait aussi souhaiter que tous nos instituteurs reussent lavenir des leons de latin [...]
Cest ici que la Grammaire historique de Brachet simpose.
Bral obtiendra satisfaction pour les programmes des coles normales en 1881, puisquon trouve en 2me et 3me annes23
Rvision approfondie des parties les plus importantes du cours de premire anne, en y ajoutant des notions historiques sur lorigine de certaines rgles. [...]
:
- Notions dtymologie. Mots dorigine populaire et mots dorigine savante. Doublets. Mots dorigine trangre. - Notions historiques sur la formation de la langue franaise. Les anciens dialectes ; ce qui en reste dans les patois. Parent du franais avec les langues no-latines.
Par contre il chouera y faire entrer des cours de latin, malgr plusieurs annes defforts au Conseil suprieur de lInstruction publique, o il reprsente le Collge de France.
Il restait construire des objets pdagogiques adapts chaque langue, avec leurs variantes invitables, compte tenu de leur absence ancienne dofficialit. Bral ne manquera pas de soutenir, voire de susciter les entreprises dans ce sens, notamment de ses amis du Flibrige mridional, mais avec un succs bien sr limit24
21 Quelques mots, Hachette, 1872, p. 59.
. Les
22 Id., p. 66. 23 Arrt du 3 aot 1881, in Chervel, A., Lenseignement du franais lcole primaire t. 2, INRP
Economica, 1995, p. 88. 24 Voir Boutan P., Arsne Darmesteter et Michel Bral .
Edition postrieure 1930, Fonds du CEDRHE, IUFM de Montpellier
-
PIERRE BOUTAN
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
12
tmoignages existent cependant jusque loin dans le XXme sicle, que ce chemin fut pris par un certain nombre dinstituteurs, voire quelques inspecteurs, utilisant le silence relatif des textes officiels, se gardant dinsister sur la proscription des langues vernaculaires. La tradition populaire sera marque plus souvent par les avanies destines aux lves qui usaient de leur langue maternelle hors du cadre intime et familial, ce qui correspond sans aucun doute une situation trs largement dominante.
Ferdinand Brunot, successeur de Bral au moins en ce qui concerne lattachement du savant aux questions denseignement, va choisir une voie diffrente de la sienne : peu soucieux des vernaculaires, il va dvelopper, contre le latin, langue de lEglise, le thme patriotique de lancien franais comme vritable origine du franais national, mais il chouera crer une agrgation de lettres modernes. A la suite dun cours en Sorbonne en 1908-1909 sur Lenseignement de la langue franaise. Ce quil est et ce quil devrait tre25
UNE CONCLUSION PESSIMISTE ?
, o il met en accusation la tradition de la grammaire gnrale, il produit une collection de manuels pour lenseignement du franais lcole primaire, avec laide de linspecteur primaire Bony, o il cre le modle encore largement utilis de la leon de grammaire partant de lobservation dun exemple choisi, loin des proccupations de la grammaire historique. Faute daboutir une rforme de lorthographe, il parviendra au moins tre le matre duvre de la premire nomenclature grammaticale officielle en 1910, que Dussouchet avait souhait quelque dix ans auparavant, nomenclature qui allait connatre plusieurs dizaines dannes de persistance.
Le courant rnovateur dans lenseignement en gnral, et dans celui de la langue nationale en particulier, port par les avances de la science linguistique et les circonstances politiques dans la France daprs 1870, eut donc des effets limits par rapport aux pratiques des matres, comme le montrent les formes et contenus des manuels, comme si, aprs loffensive, la vague dassaut tait contrainte au repli devant la rsistance du milieu. Certes, il nest gure possible de modifier les pratiques avant quune gnration de matres puisse remplacer la prcdente. Certes, toutes les grammaires scolaires du temps vont intgrer, non seulement dans le secondaire, mais aussi aux cours moyen et suprieur du primaire, une rfrence lhistoire de la langue, comme par exemple les ouvrages de grammaire scolaire de Larive et Fleury (pseudonyme humoristique de Merlette et Hauvion, deux instituteurs) parus chez Armand Colin, de loin les plus rpandus aprs 1878. Mais de toutes faons, la grammaire historique navait pas les moyens pratiques de modifier la tradition du prestige confr aux langues anciennes dans le curriculum : elle contribuera seulement confirmer que le latin, mme entrain dans un dclin inexorable, pouvait continuer servir de moyen distinctif pour apprendre le franais, perptuant la mise distance des enfants dorigine populaire. En effet, la perspective historique redonne au latin une lgitimit, compte tenu de la difficult remplacer son tude par celle dun ancien franais qui aura du mal justifier son installation, hors de luniversit. Et il est vrai quhistoriquement, le latin a prcd lancien franais. Quant la perspective compare, les idiomes locaux, idiomes dorigine et dusage populaire par excellence, ne pourront participer qu la marge lapprentissage de la langue nationale, sous les auspices dun colinguisme qui leur sera refus dans la situation franaise.
Il nest pas sans ironie de lhistoire de constater que la difficult tirer du savoir savant des propositions de rnovation pdagogique se confirmera un sicle aprs, avec la linguistique triomphante des annes 1970, qui cette fois privilgiera une dmarche synchronique mieux adapte. Au moment pourtant o la ncessit dapprendre trs tt,
25 Titre de louvrage paru chez Armand Colin en 1909.
-
RENOUVELER LENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANAISE
DO
SSIE
RS
DH
EL 2
012
SH
ESL
13
et pour tous, une autre langue que le franais simpose progressivement, on voit dans notre actualit la plus immdiate, un discours officiel tendant nier quil soit besoin de rflchir rationnellement aux pratiques denseignement. Lhistoire des thories et des pratiques des langues et de leur enseignement, montre cependant que si les progrs ne sont certes pas linaires, les avances et les reculs ne font pas ncessairement revenir en arrire, ni mme au point de dpart.
Certes, comme lcrivait linstituteur Menneglier de Navenne (Haute-Sane) en 1878, la pratique se heurte des obstacles que la thorie na pas toujours prvus .26
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE
Raison de plus pour poursuivre la recherche en reposant sur nouveaux frais les rapports entre thorie et pratique , dans un domaine o penser lobjet thorique est si troitement li la pratique de son apprentissage mme.
AUROUX S. (2000). Histoire des ides linguistiques, t. III, Mardaga, Sprimont. BERGOUNIOUX G. (1994). Aux origines de la linguistique franaise, Pocket. BOUTAN P. (1998). De lenseignement des langues. Bral linguiste et pdagogue, Paris, Hatier. BOUTAN P. (2001). Ferdinand Brunot et la nomenclature grammaticale officielle de 1910 ,
COLOMBAt B., SAVELLI M. (dir.), Mtalangage et terminologie linguistique, Leuven, Peeters, 643654.
BOUTAN P. (2004). Arsne Darmesteter et Michel Bral : linguistique, enseignement, politique... avec passage par Montpellier , Revue des langues romanes, Montpellier, CVIII, n 2, 327-354.
BOUTAN P. (2005). La grammaire gnrale dans le Dictionnaire pdagogique de Ferdinand Buisson , BOURQUIN J. (coord.) Les prolongements de la Grammaire gnrale en France au XIXe sicle, Besanon, Presses universitaires de Franche-Comt, 233-246.
BOUTAN P. (2006). La question des patois : prsence et disparition de Michel Bral dans les deux Dictionnaires de Buisson , DENIS D. et KAHN P. (d.), Lcole de la Troisime Rpublique en questions. Dbats et controverses dans le Dictionnaire de pdagogie de Ferdinand Buisson, Bern, Peter Lang, 179-192.
BOUTAN P. (2007). BRAL, Michel und die deutsche Pdagogik , in GIESSEN, H. W., LGER H.-H & VOLZ G. (d). Michel Bral: Grenzberschreitende Signaturen, Landau, Verlag Empirische Pdagogik, 321-342.[coll.: Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kulturwissenschaft 13]
BOUTAN P. (2009). Des effets scolaires du dveloppement de la linguistique romane la fin du XIXe sicle : tentatives de renouvellement de lapprentissage de la langue nationale, Brachet, Savinian, Bral , A. GARABATO, C., ARNAVIELLE, T., CAMPS C., (dir.), La romanistique dans tous ses tats, Paris, LHarmattan, 83-96.
CHERVEL A. (2007). Histoire de lenseignement du franais du XVIIe au XXe sicle, Retz. CHEVALIER J.-C., notice 2517 sur la Grammaire historique de Brachet, Corpus de textes linguistiques
fondamentaux, base de donnes ladresse : http://ctlf.ens-lsh.fr/n_fiche.asp?num=2517&mot_recherche= (consult le 20 08 2008).
DESMET P. & SWIGGERS P. (1992). Auguste Brachet et la grammaire historique du franais : de la vulgarisation scientifique l'innovation pdagogique , Cahiers Ferdinand de Saussure, n 46, 91-108.
LIEUTARD H. & VERNY M.-J. (dir.) (2007). Lcole franaise et les langues rgionales XIXe-XXe sicles, Montpellier, Presses Universitaires de la Mditerrane.
26 Mmoire loccasion de lExposition universelle, A. N., F 17 10998.