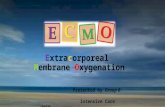ECLS et ECMO || ECMO et échocardiographie
-
Upload
jean-philippe -
Category
Documents
-
view
316 -
download
4
Transcript of ECLS et ECMO || ECMO et échocardiographie

ECMO et échocardiographie
C. Basquin, E. Flécher et P. Seguin
Depuis plusieurs années, l’utilisation de l’échocardiographie trans-thoracique (ETT) et œsophagienne (ETO) en réanimation est croissante (1, 2). Peu nombreux sont les centres de réanimation ou de chirurgie cardiaque ne disposant pas actuellement de cet outil parfaitement adapté à la prise en charge de nos patients.
Dès la phase initiale, l’échocardiographie permet d’établir rapidement, et de manière non invasive, le diagnostic étiologique des états de choc et des détresses respiratoires, grâce à sa capacité d’analyse anatomique et fonc-tionnelle, en temps réel, des fonctions systolo-diastoliques ventriculaires gauche et droite. La dernière conférence de consensus internationale sur le monitorage hémodynamique dans la prise en charge des états de choc ne recommande pas l’utilisation en première intention du cathétérisme artériel pulmonaire (CAP) chez les patients en état de choc. À l’inverse, le recours à l’échocardiographie est conseillé chez les patients présentant des signes clini-ques de défaillance myocardique avec état de choc persistant après optimisa-tion de la volémie (3). Dans les situations de choc cardiogénique ou d’arrêt cardiaque réfractaire au traitement médical, la mesure des bas débits cardia-ques extrêmes par les outils de monitoring hémodynamique classiques (CAP, méthodes de thermodilution transpulmonaire (Picco®) ou encore Doppler œsophagien) n’a pas été validée. De même, en cas d’assistance circulatoire mécanique en place, les fl ux parasites engendrés par la pompe rendent ininterprétables les mesures recueillies par thermodilution. C’est donc natu-rellement que l’échographie s’est imposée comme un moyen de diagnostic et de monitorage privilégié. L’analyse échocardiographique intervient avant, pendant et après l’implantation de l’assistance circulatoire (4-7).

240 ECLS et ECMO
AVANT : DIAGNOSTIC DE L’ÉTAT DE CHOC RÉFRACTAIRE ET DE SON ÉTIOLOGIE, RECHERCHE DE CONTRE-INDICATIONS RELATIVES
L’ETT et l’ETO sont capables de résoudre respectivement 38 % et 98 % des questions cliniques avec un impact thérapeutique plus impor-tant pour l’ETO (36 %) que pour l’ETT (16 %) (8, 9). L’échocardio-graphie, en permettant d’établir d’une part le diagnostic d’état de choc cardiogénique réfractaire au traitement médical optimal, et d’autre part d’en comprendre son mécanisme, contribue à la décision de mise sous assistance circulatoire. L’examen devra également rechercher des anoma-lies cardiaques pouvant contre-indiquer ou compliquer l’assistance. Ces anomalies, listées ci-dessous, pourront éventuellement être corrigées avant la mise en place de l’assistance :
un foramen ovale perméable ou un défect du septum interauricu- −laire peut être responsable d’une hypoxémie sévère ou d’une embolie paradoxale postimplantation ;les valvulopathies : l’insuffi sance aortique (IA), surtout modérée à −sévère, entraîne sous assistance une distension ventriculaire gauche avec baisse du débit systémique généré par le cœur natif (10). Cette surcharge volumétrique, majorée sous assistance, peut se compliquer d’œdème pulmonaire, notamment en cas d’assistance circulatoire péri-phérique, sans décharge des cavités gauches. L’insuffi sance mitrale (IM), souvent présente, a tendance à diminuer après une assistance prolongée (11). Les rétrécissements mitraux et tricuspides sévères interviennent également en diminuant le remplissage ventriculaire, rendant ineffi cace une éventuelle assistance gauche centrale ;la dissection aortique, au mieux visualisée par ETO ; −les thrombus intracavitaires : mieux visualisés en coupe apicale 4 cavités, −ils sont souvent localisés dans le ventricule ou l’auricule gauche.
PENDANT : AIDE ET CONTRÔLE À L’IMPLANTATION DE L’ASSISTANCE CIRCULATOIRE
La position optimale des canules varie en fonction des différents types d’assistance (périphériques/centrales). Un défaut de leur positionnement peut entraîner des dysfonctionnements (drainage ineffi cace) ou complica-

ECMO et échocardiographie 241
tions. L’incidence d’une malposition des canules est de l’ordre de 10 % à 25 % et nécessite généralement une nouvelle intervention pour reposition-nement avec des risques infectieux et hémorragiques accrus. Le contrôle radiographique de la position des canules s’avère imparfait avec, dans une série pédiatrique, un taux d’échec de détection des malpositions allant jusqu’à 55 % (12). L’échocardiographie permet d’avoir un contrôle direct de la position de ces canules en post mais surtout en perprocédure.
Pour une ECMO veino-veineuse périphérique (ECMO-VVP), les extré-mités distales des canules veineuses doivent être positionnées à l’abou-chement des veines caves inférieure ou supérieure dans l’oreillette droite (OD). La coupe transœsophagienne centrée sur l’OD bicavale à 90° permet la visualisation des extrémités des canules. Un aliasing (Doppler couleur) traduisant la turbulence du fl ux artifi ciel peut faciliter leur loca-lisation. Parfois, la canule est visualisée en butée contre le septum inter-auriculaire et doit alors être repositionnée. Ainsi, un cas de déchirure du septum interauriculaire a été décrit (13). Il existe désormais des canules jugulaires à double courant (drainage bicave et réinjection atriale droite, canule Avallon®) dont l’évaluation est en cours, permettant un accès vasculaire unique. La pose et le positionnement de ces canules seraient également facilités par l’échographie.
Pour une ECMO veino-artérielle périphérique (ECMO-VAP) fémoro- fémorale, l’extrémité de la canule artérielle située dans l’aorte abdominale peut être visualisée et contrôlée en échographie-Doppler abdominale (rarement fait en pratique). Un aliasing (Doppler couleur) traduisant la turbulence du fl ux artifi ciel peut faciliter leur localisation. Les vélo-cités en sortie de canule aortique peuvent être mesurées en Doppler pulsé afi n de calculer le débit réellement délivré par l’assistance (14, 15). Pour ce type d’assistance, il est souhaitable de conserver une éjection résiduelle par la valve aortique afi n de prévenir la formation de syné-chies des commissures (16) et la surcharge gauche. C’est surtout le posi-tionnement de la longue canule veineuse introduite sur guide depuis la veine fémorale commune (droite le plus souvent) jusqu’à l’OD qui sera contrôlé.
Pour une ECMO veino-artérielle centrale, les canules de drainage veineux (OD) et de réinjection aortique (aorte ascendante) sont associées à une canule de décharge ventriculaire gauche (VG), bien observée en ETO par la fenêtre 4 cavités à 0° puis 130°, et pour l’ETT en fenêtre apicale

242 ECLS et ECMO
4 cavités, puis parasternale gauche grand axe. L’ETO offre un contrôle plus aisé de ces positions que l’ETT, notamment en peropératoire.
Comme le site d’implantation des canules varie on sera amené à utiliser différentes fenêtres échographiques :
à l’apex du VG (coupe 4 cavités) ; −dans la veine pulmonaire supérieure droite (coupe 4 cavités) ; −dans le tronc de l’artère pulmonaire (ETO en coupe transœsophagienne −à 0° petit axe et en ETT en fenêtre parasternale gauche petit axe passant par les vaisseaux de la base).
La canule doit être dirigée vers la valve mitrale et située au mieux loin des parois ventriculaires, et en particulier du septum interventri-culaire. Cette canule de décharge des cavités gauches sera raccordée à la ligne veineuse du circuit d’ECMO (branchement en Y). Lors d’une décharge ventriculaire gauche, il peut être constaté une diminution de la taille des cavités cardiaques gauches (17), une absence d’ouverture des sigmoïdes aortiques en mode TM, une absence de fl ux au Doppler couleur et continu au niveau des sigmoïdes aortiques, et la présence d’un fl ux laminaire intracavitaire.
APRÈS : ÉVALUATION QUOTIDIENNE (COMPLICATIONS, OPTIMISATION HÉMODYNAMIQUE, SEVRAGE)
LES COMPLICATIONS
Une baisse inexpliquée du débit de l’ECMO doit faire réaliser en urgence un examen échocardiographique (ETT/ETO) à la recherche des complications suivantes :
un défaut de remplissage : le fonctionnement d’une assistance dépend −à la fois du volume de remplissage et de la résistance à l’éjection (18). En réanimation, chez le patient sous ventilation mécanique, l’évaluation d’une précharge dépendance est réalisée par l’analyse des paramètres statiques (POD, PAPO) et dynamiques (variations respiratoires des veines caves, pressions pulsées, ITV sous-aortique et Vmax). Ceux-ci n’ont pas été validés chez les patients sous ECMO. Néanmoins, des critères quali-tatifs tels que la diminution des volumes ventriculaires et auriculaires, avec à l’extrême un collapsus des cavités cardiaques, le diamètre des veines caves ainsi que leurs variabilités respiratoires, notamment de celle

ECMO et échocardiographie 243
ne contenant pas la canule, peuvent être utilisés pour guider le remplis-sage vasculaire. En défi nitif, le contrôle de l’effi cacité du remplissage vasculaire va reposer sur l’amélioration clinique (temps de recoloration cutanée, diurèse) biologique (lactate, SvO
2), hémodynamique (débit de
l’assistance) et échographique ;un mauvais positionnement de la canule (cf. supra) ; −un thrombus au niveau des canules ou intracavitaire : sa recherche se −fera plus particulièrement lors de la survenue d’un événement throm-boembolique ou d’une diminution du débit de l’assistance. Sa formation est plus fréquente pendant la période de sevrage car le débit de la pompe est diminué. Différentes incidences sont nécessaires pour mettre en évidence un thrombus intraventriculaire ou adhérent à la canule (arté-rielle ou veineuse). La visualisation d’un contraste spontané intra-VG ou OD doit être considérée comme un équivalent au thrombus et nécessite une majoration du traitement anticoagulant. Une décharge ventriculaire gauche doit être envisagée si des signes de surcharge coexistent ;une tamponnade : fréquente en postopératoire. Le premier signe reste −une baisse du débit de l’assistance consécutive à la diminution du remplissage. L’ETT peut être mise en défaut et l’ETO permet alors de redresser le diagnostic (19). Le doute doit faire privilégier la reprise chirurgicale, parfois simplement sur des éléments cliniques ;une surcharge ventriculaire gauche : visible à la radiographie standard, −l’échographie permet de diagnostiquer soit l’apparition ou la majora-tion d’une IA (multiplier les incidences), soit un déplacement ou une obstruction de la canule de décharge ventriculaire pour une ECMO centrale. Il est important de détecter précocement une distension ventri-culaire gauche car celle-ci, en témoignant d’un défaut de décharge VG, diminue les possibilités de récupération myocardique. Une surcharge ventriculaire expose au risque d’œdème pulmonaire postcapillaire et, secondairement, à des lésions pulmonaires de type SDRA. Les théra-peutiques envisageables peuvent être la dobutamine (réintroduction ou majoration), l’implantation d’une contre-pulsion intra-aortique, la canule trans-septale, la septostomie atriale percutanée ou encore le passage à une ECMO centrale ;une insuffi sance valvulaire : il est habituel de voir apparaître sous −ECMO-VAP une IA minime (effet postcharge) qui disparaît après décanulation (20). De même, une IM peut apparaître ou se majorer

244 ECLS et ECMO
lors des périodes d’implantation et de sevrage de l’ECMO, alors qu’à la décanulation ou lors d’assistances prolongées, elles ont tendance à régresser (diminution taille du VG) ;une insuffi sance ventriculaire droite (VD) : complication classique après −implantation d’une assistance ventriculaire gauche exclusive de longue durée, elle est peu probable sous ECMO veino-artérielle puisqu’il s’agit alors d’une assistance biventriculaire (drainage veineux droit et réin-jection artérielle gauche). Néanmoins, elle est le plus souvent due à l’interaction VG-VD qui est modifi ée par l’assistance (21). La fonc-tion VD est primordiale pour un bon fonctionnement d’une assistance ventriculaire gauche de longue durée car le remplissage de l’assistance gauche est dépendant de l’éjection ventriculaire droite (22). À la diffé-rence du VG, le VD peut se dilater brutalement par un changement de confi guration ; il s’adapte diffi cilement à une augmentation de charge : sa fonction diastolique est dite « tolérante » et sa fonction systolique « sensible ». En échocardiographie, le diagnostic de cœur pulmo-naire aigü (CPA) repose sur la constatation d’une dilatation ventri-culaire droite associée à la présence d’un septum paradoxal lié à une surcharge systolique (23). La dilatation ventriculaire droite est défi nie par un rapport des surfaces ventriculaires télédiastoliques du VD sur les surfaces ventriculaires télédiastoliques du VG. Elle est dite modérée si > 0,6 et sévère quand > 1 (24). La fonction systolique du ventricule droit, par sa confi guration tridimensionnelle, est plus diffi cile à évaluer que la fonction VG. Néanmoins, certains indices, comme le Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) ou l’étude de la vélocité maximale de l’onde S (Doppler Tissulaire (DT) à l’anneau tricuspide) sont bien corrélés à la fonction systolique (fi g. 1). Des valeurs de TAPSE < 12 cm et d’onde S < 11,5 cm/s témoignent d’une altération de la fonction systolique ventriculaire droite. Des niveaux de pression arté-rielle pulmonaire systolique (PAPs) de l’ordre de 40-45 mmHg associés à un tableau de CPA évoquent un cœur droit antérieurement sain, alors que des niveaux plus élevés doivent faire évoquer un cœur pulmonaire chronique associé. Dans ce cas, on note une hypertrophie de la paroi libre du VD de plus de 6 mm.

ECMO et échocardiographie 245
À gauche : Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) ; à droite : Fig. 1 – Vélocité maximale de l’onde S à l’anneau tricuspide.
L’ÉVALUATION ET L’OPTIMISATION HÉMODYNAMIQUE
Elle est complexe et doit prendre en compte de multiples paramè-tres interdépendants les uns des autres. Ainsi, au moment de l’examen, doivent être connus et intégrés à l’analyse hémodynamique :
la situation anatomique précise et la taille des canules (diamètre de la −lumière) ;le débit de pompe et le niveau de décharge ventriculaire droite et − gauche ;la précharge qui dépend elle-même : −
du débit d’assistance −de la volémie ; −
la postcharge qui dépend elle-même : − du débit d’assistance et du fl ux rétrograde « antiphysiologique » prove- −nant de la canule artérielle pour les ECMO fémorales périphériquesde la volémie −d’une HTA ; −
le type et les posologies des catécholamines ; −l’effet hémodynamique des drogues sédatives. −
L’optimisation de la volémie et l’évaluation de la fonction systolique ventriculaire gauche guident la thérapeutique (remplissage vasculaire et adaptation des niveaux de catécholamines) et sont ainsi des éléments importants à prendre en compte (cf. supra).
LE SEVRAGE
La détermination du moment optimal pour le sevrage de l’assis-tance reste une problématique diffi cile puisque aucun critère clinique

246 ECLS et ECMO
ou échocardiographique n’a pour l’instant été validé. Il est admis que le sevrage doit être réalisé progressivement avec une baisse des débits de l’assistance de 25 % toute les 12 heures. Un contrôle échocardiographique est réalisé après chaque diminution du débit de pompe et la poursuite du sevrage n’est souhaitable que si plusieurs conditions sont réunies :
d’une part l’index cardiaque doit être supérieur à 2,5 l/min/m². Son −calcul nécessite la mesure du diamètre (D) de la chambre de chasse du VG afi n d’en déduire la surface (πD²/4). Le volume d’éjection systolique est ensuite obtenu en multipliant la surface par l’ITV sous-aortique mesurée dans la chambre de chasse du VG (coupe apicale 5 cavités en ETT ou transgastrique à 120° en ETO). En multipliant ce dernier par la fréquence cardiaque, on détermine ainsi le débit cardiaque, puis en divisant celui-ci par la surface corporelle, l’index cardiaque. (fi g. 2) ;d’autre part la fonction systolique, appréciée par la fraction d’éjec- −tion (FE) du VG, doit être supérieure à 30-35 %. On procède dans un premier temps à une analyse des fonctions systoliques globales et segmentaires (mode 2D en coupe apicale 4 puis 2 cavités), puis dans un second temps, on calcule la FEVG (méthode de Simpson) (25) (fi g. 3) et la fraction de raccourcissement des surfaces (coupe transgastrique en ETO et petit axe parasternale ou sous-costale en ETT). Il est impor-tant de s’assurer de la bonne concordance entre ces valeurs calculées et l’évaluation visuelle de la FEVG. Rappelons également que cette frac-tion d’éjection n’est qu’une estimation de la contractilité myocardique et qu’elle est extrêmement dépendante des conditions de charges (pré et postcharge) ainsi que de la fréquence cardiaque.
Plus récemment, une étude a évalué la performance d’indices clini-ques, hémodynamiques et échocardiographiques pour la prédiction du succès du sevrage de l’ECMO (26). Dans cette étude, 2 indices échocar-diographiques (ITV sous-aortique > 10 cm/s et une onde S > 6 cm/s) permettent de prédire le succès du retrait de l’ECMO avec une sensibi-lité de 100 % et une spécifi cité de 90 %. L’échocardiographie de stress a également été proposée pour le sevrage des assistances gauches (27). Les autres éléments à surveiller sont l’absence d’une dilatation ventriculaire gauche avec l’apparition d’une IM sévère. Il est à noter qu’au cours du sevrage, un débit de pompe < 2 l/min nécessite une augmentation du niveau d’anticoagulation.

ECMO et échocardiographie 247
Enfi n, lors de l’ablation de l’ECMO, au bloc opératoire le plus souvent, un ultime contrôle échocardiographique du maintien de l’hémodynamique est réalisé en clampant quelques minutes le circuit (une interruption plus prolongée expose au risque de thrombose). On confi rme ainsi à l’arrêt de la circulation extracorporelle, canules en place et sous anti coagulation effi cace, la stabilité du patient, après avoir réintroduit ou majoré éventuel-lement les amines vasopressives.
Calcul du débit cardiaque. Fig. 2 – Calcul de la fraction d’éjection Fig. 3 – du VG.
En conclusion, l’échocardiographie (ETT ou ETO) est l’examen d’excellence dans la prise en charge d’un patient sous ECMO. Elle permet de manière non invasive, au lit du malade, d’évaluer rapidement et en temps réel la fonction myocardique et de faire un bilan hémodynamique. Elle est l’outil privilégié du clinicien qui le guide de l’implantation jusqu’au retrait de l’assistance circulatoire. Les autres outils de monitorage hémo-dynamique, qu’ils soient directs (CAP à SvO
2 ± débit continu, PICCO) ou
indirects (SvO2, microcirculation), sont parfois utilisés en complément de
l’échocardiographie.

248 ECLS et ECMO
RÉFÉRENCES
Cholley BP, Vieillard-Baron A, Mebazaa A (2006) Echocardiography in the 1. ICU : time for widespread use. Intensive Care Med 32(1) : 9-10 Vieillard-Baron A 2. et al, (2008) Echocardiography in the intensive care unit : from evolution to revolution? Intensive Care Med 34(2) : 243-9Antonelli M 3. et al. (27-28 April 2006) Hemodynamic monitoring in shock and implications for management. International Consensus Conference, Paris, France. Intensive Care Med 2007 33(4) : 575-90Augoustides J 4. et al. (2003) CASE 1-2003. The use of intraoperative echocardiography during insertion of ventricular assist devices. J Cardio-thorac Vasc Anesth 17(1) : 113-20Heath MJ, Dickstein ML (2000) Perioperative management of the left 5. ventricular assist device recipient. Prog Cardiovasc Dis 43(1) : 47-54Scalia GM 6. et al. (2000) Clinical utility of echocardiography in the manage-ment of implantable ventricular assist devices. J Am Soc Echocardiogr 13(8) : 754-63Simon P 7. et al. (1991) Transesophageal echocardiographic evaluation in mechanically assisted circulation. Eur J Cardiothorac Surg 5(9) : 492-7Slama MA 8. et al. (1996) Diagnostic and therapeutic implications of transesophageal echocardiography in medical ICU patients with unex-plained shock, hypoxemia, or suspected endocarditis. Intensive Care Med 22(9) : 916-22Vignon P 9. et al. (1994) Diagnostic accuracy and therapeutic impact of tran-sthoracic and transesophageal echocardiography in mechanically ventilated patients in the ICU. Chest 106(6) : 1829-34Mets B (2000) Anesthesia for left ventricular assist device placement10. . J Cardiothorac Vasc Anesth 14(3) : 316-26Holman WL 11. et al. (1994) Infl uence of longer term left ventricular assist device support on valvular regurgitation. ASAIO J 40(3) : M454-9Irish MS 12. et al. (1998) Cervical ECMO cannula placement in infants and children : recommendations for assessment of adequate positioning and function. J Pediatr Surg 33(6) : 929-31Baker JE 13. et al. (2004) Profound hypoxemia resulting from shunting across an inadvertent atrial septaltear after left ventricular assist device place-ment. Anesth Analg 98(4) : 937-40 table of contentsJegger D 14. et al. (2006) A novel technique using echocardiography to eval-uate venous cannula performance perioperatively in CPB cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg 29(4) : 525-9

ECMO et échocardiographie 249
George SJ, Black JJ, Boscoe MJ (1995) Intraoperative transoesophageal 15. echocardiography for implantation of a pulsatile left ventricular assist device. Br J Anaesth 75(6) : 794-7Rose AG 16. et al. (2000) Partial aortic valve fusion induced by left ventricular assist device. Ann Thorac Surg 70(4) : 1270-4Nakatani S 17. et al. (1996) Left ventricular echocardiographic and histologic changes : impact of chronic unloading by an implantable ventricular assist device. J Am Coll Cardiol 27(4) : 894-901Nussmeier NA 18. et al. (2003) Anesthetic management for implantation of the Jarvik 2000 left ventricular assist system. Anesth Analg 97(4) : 964-71 table of contentsImren Y 19. et al. (2008) The importance of transesophageal echocardiog-raphy in diagnosis of pericardial tamponade after cardiac surgery. J Card Surg 23(5) : 450-3Deye N (2008) Devenir des patients traités par assistance circulatoire 20. périphérique en réanimation médicale pour état de choc ou arrêt cardiaque réfractaire, in congrès SRLFMoon MR 21. et al. (1997) Septal function during left ventricular unloading. Circulation 95(5) : 1320-7Mandarino WA 22. et al. (1997) Right ventricular performance and left ventricular assist device fi lling. Ann Thorac Surg 63(4) : 1044-9Vieillard-Baron A 23. et al. (2002) Echo-Doppler demonstration of acute cor pulmonale at the bedside in the medical intensive care unit. Am J Respir Crit Care Med 166(10) : 1310-9Jardin F, Dubourg O, Bourdarias JP (1997) Echocardiographic pattern of 24. acute cor pulmonale. Chest 111(1) : 209-17Smith MD 25. et al. (1992) Value and limitations of transesophageal echocar-diography in determination of left ventricular volumes and ejection frac-tion. J Am Coll Cardiol 19(6) : 1213-22 Aissaoui (2008) Prédiction du succès du sevrage de l’ECMO après assis-26. tance circulatoire pour choc cardiogénique réfractaire : comparaison d’indices cliniques, hémodynamiques et échocardiographiques, in SRLF, ParisKhan T 27. et al. (2003) Dobutamine stress echocardiography predicts myocar-dial improvement in patients supported by left ventricular assist devices (LVADs) : hemodynamic and histologic evidence of improvement before LVAD explantation. J Heart Lung Transplant 22(2) : 137-46