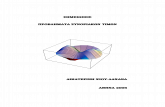2232897740
-
Upload
oussama-el -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of 2232897740
-
8/17/2019 2232897740
1/14
01Les relations interpersonnelles constituent le ciment des relationshumaines. C’est un processus complexe qui s’inscrit toujours dansun contexte socioéconomique, culturel, technologique…
Les statuts, les rapports de place, le contexte spatiotemporelconstituent autant de clefs nécessaires à la compréhension dessituations de communication interpersonnelle.
Notions
Contexte général • Contexte situationnel • Acteurs • Positionnement • Statut •Groupes sociaux • Rapport de place • Rituel • Contexte spatial • Contexte
temporel.
u Le contextegénéral
u Le contextesituationnel
Analyser le contextede communication
1 Le contexte général et situationnel 3
Scènes de la vie d’entreprise2 Le contexte sociétal et culturel 3
Photos de classe3 Le lien social 3 Le mobile
Travaux dirigés
4 La proxémie 3 À chacun son territoire
5 Les rituels 3 Histoire de Gab’s
Vers l’épreuve E4 Une situationde communication (1) 3 Akoun Import
-
8/17/2019 2232897740
2/14
C o u r s
14 Partie 01 1 Les bases de la communication
Communiquer, c’est mettre en commun. En communiquant, les individus se construi-sent, s’affirment, échangent des informations, nouent des liens, produisent des actes,entrent en conflit… La variété des contextes, des situations, des acteurs rend trèscomplexe l’analyse des relations interpersonnelles. La communication interperson-nelle est le rapport qui s’établit entre des personnes dans un contexte donné, à traversdes interactions.
Le contexte « pèse » sur toute situation de communication. Si, dans certains cas, le
contexte s’impose fortement à un individu, dans d’autres c’est l’individu qui peut agiret influer sur la situation. En fait, le contexte peut être plus ou moins déterminant etl’individu peut plus ou moins agir. Dans un contexte hiérarchique rigide par exemple,il est difficile pour un subordonné de ne pas exécuter l’ordre d’un supérieur qu’ilconsidère comme non pertinent. Cependant, le salarié peut chercher à négocier mêmesi la situation s’annonce difficile.
1. LE CONTEXTE GÉNÉRAL
Le contexte général comprend les contextes technologique, socioéconomique, cultu-rel et institutionnel. Il est difficile pour les acteurs de la communication d’agir sur cecontexte.
1. 1. Les contextes technologique et socioéconomique
Les contextes technologique et socioéconomique modifient nos conditions de vie etont une forte répercussion sur nos relations.
LE CONTEXTEÉCONOMIQUE
La mondialisation, l'état socioéconomique de la France,la richesse de notre région… mais aussi la croissance ou la récession
LE CONTEXTESOCIAL
Le niveau d'instruction, la montée du communautarismeet de l’individualisme, la natalité, la structure familiale…
LE CONTEXTETECHNOLOGIQUE
La technologie dans les transports, la santé, les biotechnologieset surtout les NTIC…
Dans le contexte économique, le contexte mercatique joue un rôle important pour lacommunication commerciale et plus spécialement dans la négociation commerciale.
Marché Demande forteOffre peu concurrentielle OUI NON
Entreprise Puissance importante (taille…)Expérience forteBonne renommée
OUI NON
Politiquecommerciale
Large offre de produits adaptés à la demandePrix concurrentielsImage forte (notoriété)Réseau de distribution adapté
OUI NON
CONTEXTEFAVORABLE
AU VENDEUR
CONTEXTEDIFFICILE POUR
LE VENDEUR
-
8/17/2019 2232897740
3/14
C o u r s
Chapitre 01 1 Analyser le contexte de communication 15
1. 2. Le contexte culturel
Catherine Danou, Composition bleue.Détail, format 55 × 46 cm
La culture peut être comprise commel’ensemble des règles communes àune société, à un groupe social (laculture chinoise ou espagnole, laculture bourgeoise ou ouvrière), maisaussi comme la production et laconsommation d’un ensemble debiens dits « culturels » (l’art, la litté-rature, les musées…). Les pratiquesculturelles restent différenciées sui-
vant les groupes sociaux ou les classessociales. Dans la vie quotidienne, àtravers les relations interpersonnelleset la consommation, on peut observer des différences culturelles (tenue vestimentaire,accessoires, automobile, langage, loisirs, lectures, maintien à table, rituels…).
La culture peut différencier les individus, les groupes sociaux entre initiés et non-ini-tiés, comme une marque de « distinction ». Au risque de choquer l’interlocuteur, voirede rompre la communication, il est indispensable de connaître et de prendre en comptela variété des pratiques culturelles.
Structuration du temps et cultures
Chaque culture comporte une relation au temps à partir de la façon dont sont structu-rées les activités dans la journée, la semaine, l’année, mais aussi à travers les pratiquesquotidiennes, les styles de vie, les traditions et les valeurs héritées du passé. T. Hall dis-tingue les cultures monochrones (Europe du Nord, États-Unis) dans lesquelles le tempsest segmenté en fonction des différentes tâches et activités, et les cultures polychrones (cultures méditerranéennes) où les individus ont plutôt tendance à faire plusieurs chosesen même temps, c’est-à-dire conduire différentes activités en parallèle.
La notion de temps social varie à l’intérieur d’une culture selon les classes, les groupes,les lieux, les professions, les âges, les sexes, la situation. Dans nos sociétés occidenta-les, les temps sociaux (temps de travail, temps familial, temps libre…) sont générale-ment cloisonnés chacun ayant son propre rythme, ses propres règles relationnelles.Cependant, cette segmentation est parfois rompue : un commercial « grands comp-tes » peut, par exemple, partager son temps avec un client sur un terrain de golf etnégocier un contrat pendant ou après ce « temps commun ».
Programmation sociale et culture
Les rituels, pratiques respectant des règles ou des manières de faire habituelles,facilitent les relations sociales et constituent des signes de reconnaissance, d’apparte-
nance ou de considération. Par exemple : se dire bonjour en se serrant la main, remer-cier quelqu’un, rendre une invitation.
Ces rituels sont appris et stéréotypés. Ils résultent des conventions sociales et des tradi-tions culturelles. Ils favorisent la préservation de la face des interlocuteurs en les présentantde façon adéquate et valorisante. Ils permettent la définition de la situation en distribuantles rôles de chacun selon les conventions et le protocole en vigueur. Enfin, ils régulent lesrelations interpersonnelles en établissant un équilibre entre les interlocuteurs.
Les passe-temps sont des « transactions complémentaires dont le but principalconsiste à structurer un certain laps de temps » à travers la conversation, que ce soit àl’occasion d’une soirée ou encore d’une rencontre amicale ou professionnelle. Ils per-mettent d’occuper le temps avec quelqu’un et d’échanger des signes de reconnaissance
au cours de l’interaction, sans pour autant s’engager dans une relation durable.
Savoirs partagés et culture
Dans un pays, une région ou une ville donnée, les habitants partagent des savoirs. Au-delà de la situation d’interaction, des savoirs communs existent également entre grou-
−
−
-
8/17/2019 2232897740
4/14
C o u r s
16 Partie 01 1 Les bases de la communication
pes sociaux comme, par exemple, entre amateurs de jazz ou pratiquants d’arts mar-tiaux. Dans une relation interpersonnelle qui s’instaure, ces savoirs communs partagésrévèlent des affinités et favorisent la « proximité relationnelle ».
1. 3. Le contexte institutionnel
L’institution (État, entreprise, association, famille, le café…) dans laquelle s’inscrit
l’interaction « prescrit » un type de rapports, des rituels spécifiques, un registre delangage particulier, le respect de normes et de règles. Par exemple, dans une sociétéd’informatique, une entreprise de mode, une école de théâtre, un club de football oude rugby… les relations interpersonnelles, les comportements sont empreints del’« esprit » de l’organisation ; la façon de s’exprimer, le langage utilisé varient.
2. LE CONTEXTE SITUATIONNEL
Ce contexte correspond au cadre « immédiat » dans lequel la situation de communica-
tion se joue. Les acteurs disposent généralement de marges de manœuvre pour agir.
2. 1. Le positionnement des acteurs
Les acteurs
Les individus intervenant dans une interaction « impriment » leur présence dans la rela-tion à travers l’expression de leur personnalité, de leurs croyances, de leurs valeurs. Dans lacommunication interpersonnelle, les individus peuvent revendiquer leur place, défendreleurs intérêts, agir en fonction de leur statut ou des affinités qu’ils ont avec l’interlocuteur.
On peut analyser la société en termes de catégories en classant les acteurs seloncertains critères. Par exemple, la France compte 48 % d’hommes et 52 % de femmes.
D’autres catégories existent : citadins/urbains, classes d’âge, tranches de revenus, pro-fessions, type d’habitat. On peut également combiner ces critères. Une classificationimportante est la classification socioprofessionnelle de l’Insee, appelée PCS (profes-sions et catégories socioprofessionnelles).
Rapport de place, statuts et rôles
Dans toute interaction, chacun cherche à se situer par rapport à l’autre, chacuncherche sa « place ». Dès le début d’une conversation, une définition de la situation estnégociée explicitement ou implicitement entre les interactants.
Trois collègues dans un bureau :Marc : « Éric, tu pourrais expliquer au nouveau comment la machine marche ? Bon j’y vais. Salut ! »
Éric (au nouveau) : « Le mieux c’est que vous lisiez le mode d’emploi ! »Le nouveau : « Ce serait peut-être plus facile si vous m’expliquiez ? »Éric : « Si vous ne comprenez pas tout, vous n’aurez qu’à me demander ; le mode d’emploi est là ! »En fait, Marc donne un ordre à Éric et se place donc en position haute par rapport à ce dernier.Éric refuse cette place et indique au nouveau qu’il doit se débrouiller avec le mode d’emploi. Lenouveau refuse à son tour cette place. Mais Éric persiste.
Au sein d’une interaction, les places ne sont pas indépendantes. Quand quelqu’un viseune certaine place, il assigne à son interlocuteur une place corrélative qui valide etrenforce la sienne. On parle de rapport de place.
Ce rapport peut être déterminé par le statut des interactants. Le statut est la placequ’occupe un individu dans la hiérarchie sociale (directeur de société, élu municipal,
avocat, étudiant…).L’appartenance à des groupes sociaux contribue à caractériser le statut social et laplace des individus dans la société. Elle positionne l’individu dans la société, rappro-che ou éloigne les acteurs dans une relation de communication. Les individus appar-tiennent tous à différents types de groupes sociaux.
−
−
−
−
exempleexemple
-
8/17/2019 2232897740
5/14
C o u r s
Chapitre 01 1 Analyser le contexte de communication 17
GROUPES D’APPARTENANCE ET GROUPES DE RÉFÉRENCE
Les groupes d’appartenance Les groupes de référence
Un individu se rattache à un groupe d’appartenancepar son histoire, ses caractéristiques sociodémo-graphiques (âge, sexe, profession…), donc en raisonde facteurs plutôt objectifs.
Contrairement aux groupes d’appartenance, lesgroupes de référence reposent plutôt sur des rai-sons subjectives, dans la mesure où ces groupessont composés d’individus qui partagent générale-ment des valeurs identiques ou proches (goûts,idéologie, préférences…).
Les groupes d’appartenance peuvent influencer lechoix des groupes de référence.
Ces groupes peuvent être des groupes primaires ou
restreints dans lesquels il existe une grande proxi-mité, généralement affective, entre les individus.La famille, un groupe d’amis, une bande de jeunes…
Ces groupes peuvent être des groupes secondai-res ou larges, composés d’individus qui partagenten général des points communs sans être néces-sairement très proches.Une entreprise, un club sportif, une association…
Le champ lexical ou le registre de langue, les structures de phrases, renvoient à l’ex-pression d’un statut. Le parler d’un individu est un indicateur de son statut.
Le rôle est l’ensemble des conduites attendues compte tenu du statut. Même dansun contexte très institutionnalisé, un rôle peut être investi et interprété différemmentsuivant la situation et la personnalité de l’individu. Le statut renvoie chacun à desrôles (professeur/élèves, vendeur/acheteur, médecin/patient…).
La négociation du rapport de place
Les rituels s’imposent à nous en tant que pratique culturelle reconnue. Ils permettentde préserver sa place mais aussi d’établir le rapport de place ou d’agir sur lui.
Dans une manifestation, lorsqu’une personnalité serre la main d’un individu, ce geste lui confèreune place valorisante aux yeux des autres.
LES TROIS CATÉGORIES DE RITUELS SELON E. GOFFMANRituels d’accès Facilitent les moments délicats de rapprochement
ou d’éloignement, de contact ou de séparation.« Bonjour, ça va ? Oui, bonjour. Ettoi ça va ? Ça va. »
Rituelsde confirmation
Confirment l’image que chacun souhaite don-ner, manifestent son intérêt et sa considérationpour l’interlocuteur, telle la déférence commeles compliments ou les rituels d’entretien.
« Quel beau travail ! »Déjeuner ensemble, offrir desfleurs, des cadeaux…
Rituelsde réparation
Transforment en acceptable ce qui pourraitparaître offensant.
Excuses, justifications ou deman-des d’autorisation.
Lors d’une rencontre, E. Goffman distingue deux catégories de personnes suivantleur place :
Personnes« ratifiées »
Reconnues officielle-ment comme partici-pant à l’interaction.
Qu’elles interviennent ou non, elles sont considérées commeautorisées à intervenir ou à assister à la relation.
Personnes« non ratifiées »
Exclues de l’interac-tion, non qualifiéespour y participer.
Voisin de table dans un restaurant ou de voyage dans un train :la personne doit faire « comme si » elle était absente. Cettefiction est une règle de politesse de base. Mais si l’opportunitése présente, il arrive que la « non-personne » intervienne !
Dans tous les cas, il est possible que l’interlocuteur refuse la place qu’on souhaite lui
assigner, soit par intérêt, soit pour des raisons morales, culturelles, ou encore de face oude territoire à préserver, et donc pour des raisons identitaires et d’affirmation de soi.
Suivant les situations et les interlocuteurs, un même individu peut occuper des statutset des rôles différents. Une même personne peut être médecin, époux, parent, ami,collègue, témoin ou victime d’un accident. Et pour chacun de ces statuts, elle peut
−
exempleexemple
-
8/17/2019 2232897740
6/14
C o u r s
18 Partie 01 1 Les bases de la communication
interpréter le rôle à sa façon, même si celui-ci est parfois fortement déterminé par lecontexte. Entre inconnus, lors du premier contact, la place du sérieux, du « savant »,du rigolo, du séducteur… n’est pas posée d’avance.
2. 2. Le contexte spatial
Ce contexte est présent dans toute communication puisque toute relation interpersonnellese déroule dans un lieu donné. Ce lieu n’est jamais neutre dans la communication.
LE CONTEXTE SPATIAL
Type de lieuet relation
Lieux privés et lieux publics. Dans les premiers (domicile, voiture…), le comporte-ment accepté n’est pas le même que dans les seconds (rue, café, salle d’attente…).Chaque lieu est porteur de règles, de conduites attendues.
Le lieu comme espace de représentation public et les coulisses. Dans le premier,on investit une image de soi compte tenu du public présent et, généralement, dans lerespect des normes, des règles de politesse… Les rôles sont généralement modéli-sés au sens où les conduites sont normalisées. Dans les coulisses, la parole et lescomportements peuvent être plus libres.
Un espace plus personnel, appelé réserves du moi : la place où l’on s’assied habi-tuellement, l’espace personnel de travail, l’espace où l’on pose ses affaires… là où
autrui ne peut pénétrer qu’avec tact et autorisation du « propriétaire ».
−
−
−
Configuration/aménagementde l’espaceet relation
La configuration des protagonistes influence la relation. Les personnes « égales »adoptent de préférence une configuration circulaire qui favorise les relations socio-émotionnelles. L’accessibilité visuelle joue un rôle déterminant dans la communica-tion, la configuration en ligne étant celle où elle est la plus faible et la prise de risqueplus réduite.
L’aménagement de l’espace n’est pas neutre. Un bureau « ministre » avec un fau-teuil directorial et en face deux petits fauteuils bas ou bien une table basse avecquatre fauteuils identiques autour ne signifient pas le même rapport de relation.
−
−
Distanceinterpersonnelleet relation
La notion de proxémie, développée par E.T. Hall, s’articule autour de celles de terri-toire et de distance interpersonnelle. On distingue quatre zones (cf. schéma ci-des-sous). En modifiant leur distance, les acteurs modifient la relation et le sens de l’in-teraction. Le comportement spatial se manifeste dans la façon dont on occupe unezone, un territoire et celle dont on le défend. Là aussi, les normes culturelles, la
qualité de la relation, le statut et la personnalité des protagonistes interviennentdans la définition des différentes distances interpersonnelles.
Zone publiqueau-delà de 3 m :relation officielle
Zone publique sociale1 m 20 à 3 m :
relation courante
Zone personnelle60 cm à 1 m 20 :
relation conviviale
Zone intimemoins de 60 cm :
relation intime
J.-C. Martin, Le Guide de la communication, Éditions Marabout, 1999
2. 3. Le contexte temporel
Toute relation s’inscrit dans le temps, avec un avant, un pendant et un après. Durantl’interaction, le rappel d’événements passés, l’anticipation, le rythme adopté dans lacommunication, la ponctuation de l’interaction dans le temps (pause, relance,écoute…), les changements de rythme, le temps dont on dispose pour un entretien, laperspective temporelle de se revoir… mais aussi, en dehors de l’interaction, le nombrede fois où l’on va se revoir, le temps qui s’écoule entre chaque visite… constituent la
dimension temporelle qui structure toute relation interpersonnelle.
Les acteurs d’une relation interpersonnelle partagent des informations communesliées aux contacts antérieurs, à la nature de leur relation. L’ensemble de ces informa-tions peut influer sur les stratégies de communication, sur la conduite de l’interaction.Par exemple, l’implicite peut être utilisé dans la relation entre collègues de travailalors qu’il faudra parler plus clairement à une personne étrangère au service.
-
8/17/2019 2232897740
7/14
T r a
v a u x
d i r i g é s
Chapitre 01 1 Analyser le contexte de communication 19
1 Le contexte général et situationnel u Scènes de la vied’entreprise
Bousculée par le stress et la course à l’efficacité, la courtoisie est partout en recul, mêmechez les cadres… alors qu’elle contribue à la qualité de la communication interpersonnelle.
1 Analyser le texte ci-dessous en termes de contexte général et situationnel.2
Analyser, dans les mêmes termes, l’enregistrement d’une séquence des émissionsde M.-O. Fogiel et de M. Drucker.
ANNEXE : Et la politesse, bordel !
AU PAYS DE L’« ADULESCENT »Chez Adecco, un chef d’agence a reçu insul-tes et crachats à la figure parce qu’il informaitun candidat qu’il n’était pas retenu. « Cettemontée de l’agressivité concerne essentielle-ment les moins de 25 ans ayant un emploiprécaire, issus des banlieues défavorisées »,tempère Tristan d’Avezac, chargé de la com-munication chez Adecco. N’empêche. Signede l’ampleur du phénomène, l’entreprise detravail temporaire a mis en place une forma-tion spécifique à l’usage de ses recruteurs.Mais, si les sociétés les plus exposées sont cellesqui emploient du personnel peu qualifié, lesrustres se rencontrent aussi parmi les cadres. Etde plus en plus. Vendredi, 17 heures, au sièged’une start-up. Affalés dans leur fauteuil, lespieds sur la table, deux salariés se racontentleur dernière « RTT ». Après six sonneries dans
le vide, l’un finit par décrocher le téléphone.« C’est la meuf de Rennes qui veut te parler »,grogne-t-il à son collègue sans même prendre lapeine de masquer ses paroles, pour le moinsdésinvoltes, à son interlocutrice.« C’est le règne de l’“adulescent”, commenteRoland Brunner, psychanalyste. L’imageparentale – la hiérarchie – n’étant plus incar-née par des symboles puissants, les rapportsprofessionnels sont de plus en plus rugueux.
On agit par pulsion sur fond d’agressivité etd’érotisation. Ils pensent qu’il faut avoir duculot et être cynique pour réussir. »« Une stagiaire m’a dit : “Au fait, quand pars-tu en congé maternité ? Ton bureau m’inté-resse”, raconte une cadre sup d’un grandgroupe de communication. En clair, se faireune place au soleil, c’est foncer, tête baissée,sur l’objectif.« Avec la net-économie, le jeu relationnels’est complexifié, souligne Éric Albert, psy-chiatre et dirigeant de l’Institut français del’anxiété et du stress (Ifas). Plus de cravate,tutoiement de rigueur, travail en réseau… Oncroit que l’on peut se passer des rituels de lapolitesse. L’informel prime sur le formel, et lafamiliarité, sur la distance. »« Partout, l’exigence de performance raidit
les relations entre les individus », analyse lasociologue Nicole Aubert.
FOGIEL PLUTÔT QUE DRUCKER « C’est la télévision qui offre aujourd’hui lesmodèles, ajoute R.B. Les jeunes préfèrent s’iden-tifier à un Marc-Olivier Fogiel, insolent, plutôtqu’à un Michel Drucker, trop courtois, qui faitun peu figure de dinosaure des médias. »
Corine Moriou, L’Entreprise, n° 213, juin 2003
2 Le contexte sociétal et culturel u Photos de classe
Zoom sur la société française d’aujourd’hui.
1 Expliquer les termes sociologiques soulignés (annexes 1 à 5).2 Analyser et commenter l’ensemble de ces documents.
ANNEXE 1 : Les usages du temps : cumuls d’activités et rythmes de vie
Avoir des ressources culturelles élevées ethabiter dans des grandes villes favorisent uncumul d’activités. Les hommes et les femmesles mieux dotés cumulent ainsi les activitésprofessionnelles, sportives, culturelles et asso-ciatives en réduisant le temps consacré aux
activités dites « passives » (sommeil et télévi-sion). À l’inverse, les moins bien dotés cultu-rellement, les inactifs et les ruraux ont desactivités moins variées. Ils tendent, en parti-culier, à accroître le temps consacré aux activi-tés d’intérieur (sommeil, télévision, bricolage
-
8/17/2019 2232897740
8/14
T r a
v a u x
d i r i g é s
20 Partie 01 1 Les bases de la communication
ANNEXE 1 (suite)
pour les hommes, production domestique ettâches ménagères pour les femmes) et à res-treindre le nombre et la durée des activitésextérieures (sorties culturelles, sport, visitesà des amis, etc.).
Ces différences entre ceux qui cumulent lesactivités et sont tournés vers l’extérieur et ceuxqui en ont moins et sont centrés sur la maisonse retrouvent dans les couples. Un double effetd’homogamie des modes de vie et de socialisa-tion conjugale différencie les couples de « grostravailleurs » de ceux qui sont plus investisdans les loisirs, intérieurs (notamment la télé-
vision) ou extérieurs. La division sexuée dutravail, professionnel et domestique, et desactivités intérieures et extérieures perduretoutefois : dans les couples, hommes et fem-mes se ressemblent dans leur usage des temps
sauf dans un domaine, celui du travail domes-tique : l’asymétrie entre homme et femmereste ici la règle même si elle est atténuée dansles couples, aujourd’hui les plus nombreux, oùles deux conjoints travaillent.
Alain Degenne, Marie-Odi le Lebeauxet Catherine Marry, Économie et statistiques,
INSEE, n° 352-353, septembre 2002
ANNEXE 2 : La vie de famille – Le partage des tâches
Tâches domestiques
La tâche est principalementeffectuée par (en %)
l’homme la femme
Pôle féminin Laver le linge à la mainLaver le gros linge à la machineLaver le petit linge à la machineRepasserRecoudre un boutonFaire les sanitaires
1,12,62,02,22,04,4
96,794,295,089,393,389,7
Tâches négociables Faire la cuisineFaire les vitresPasser l’aspirateur et le balai
Faire la vaisselle à la mainFaire les coursesRemplir et vider le lave-vaisselleMettre le couvert
8,313,613,5
16,419,921,923,5
84,077,975,3
73,767,463,052,0
Pôle masculin Porter du bois, du charbon, du mazoutLaver la voiture
74,171,3
20,212,3
Nota : le total en ligne ne fait pas 100 % car les tâches peuvent être effectuées par les deux conjointement, par uneautre personne de la famille ou par un tiers rémunéré.
ANNEXE 3 : Contrôle social – Campagne anti-tabac
Ministère de la Santé
et des Solidarités
-
8/17/2019 2232897740
9/14
T r a
v a u x
d i r i g é s
Chapitre 01 1 Analyser le contexte de communication 21
ANNEXE 3 (suite)
LE DÉCRET SUR L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS SERAIT APPLICABLE DÈS LE 1ER FÉVRIER 2007
L’interdiction de fumer dans les lieux publics prend forme. Mardi, la mission parlementaired’information sur le tabac doit voter le rapport sur lequel elle travaille depuis plusieurs mois.
Parallèlement, selon nos informations, le décret prévoyant l’interdiction de fumer est quasibouclé au ministère de la Santé : il serait applicable dès le 1er février 2007, hormis pour lescafés-hôtels-restaurants-discothèques (CHRD) qui devraient bénéficier d’un délai jusqu’en2008 pour bannir la fumée de leurs établissements.
Dans ses recommandations, la mission parlementaire ouvre la possibilité – facultative – decréer des fumoirs « hermétiquement clos » avec des systèmes d’extraction et des normes sani-taires très rigoureuses dans lesquels il n’y aurait aucun service.
http://www.liberation.fr/actualite/societe/208112.FR.php
Par P.V. LIBERATION.FR : Lundi 2 octobre 2006 – 19:23
LES NOUVEAUX PAQUETS DE CIGARETTESUn gros encart noir fond blanc sur les paquets avec dedans du texte de taille deux fois plus grandque la marque en elle-même en gras noir. Les différents messages varient selon les paquets :FUMER TUEFUMER PROVOQUE UN VIEILLISSEMENT DE LA PEAUFUMER PEUT NUIRE AUX SPERMATOZOÏDES ET RÉDUIT LA FERTILITÉFUMER NUIT GRAVEMENT À VOTRE SANTÉ ET À CELLE DE VOTRE ENTOURAGEFUMER PEUT DIMINUER L’AFFLUX SANGUIN ET PROVOQUE L’IMPUISSANCEFAITES VOUS AIDER POUR ARRÊTER DE FUMER, TÉLÉPHONER au 0 825 309 310
ANNEXE 4 : Les pratiques culturelles selon l’âge, le sexe et le lieu de résidence
Données en %Lecturede livres
CinémaMusée,
expositionThéâtre ou
concert
Pratiquesamateurs,(musique,théâtre…)
Ensemble 58 50 45 29 14
Âge
15-24 ans 72 89 46 40 24
25-44 ans 59 61 49 31 16
45-64 ans 56 40 47 30 11
65-74 ans 49 21 39 24 9
75 ans et plus 48 11 28 11 5
Sexe
Femme 66 50 45 30 16
Homme 50 51 45 28 12
Lieu de résidence
Commune rurale 48 38 40 22 12
– de 100 000 hab. 56 43 43 24 13
100 000 hab. et 62 60 46 33 15
Unité urbaine de Paris 71 66 54 44 18
Nota : répartition des activités culturelles pratiquées au moins une fois au cours des 12 derniers mois en 2000.
-
8/17/2019 2232897740
10/14
T r a
v a u x
d i r i g é s
22 Partie 01 1 Les bases de la communication
ANNEXE 5 : Les pratiques culturelles selon la catégorie sociale
Données en %Lecturede livres
Cinéma
Musée,exposition,musique,théâtre…
Théâtreou
concert
Pratiquesamateur
Ensemble 58 50 45 29 14
PCSAgriculteurs exploitants 31 12 24 12 4
Artisans, commerçants, chefsd’entreprise
50 40 41 24 13
Cadres et professions libérales 84 71 76 60 19
Professions intermédiaires 73 62 61 41 20
Employés 64 49 44 25 12
Ouvriers 33 29 27 14 7
Étudiants 80 94 53 44 29
Chômeurs et inactifs 37 34 29 16 12
Niveau de vie
1er quartile* (les + pauvres) 46 39 29 16 11
2e quartile 50 41 37 22 10
3e quartile 61 54 48 32 16
4e quartile (les + riches) 76 68 68 49 19
Diplôme
Sans diplôme 31 27 23 12 6
CEP 46 19 31 17 6
CAP, BEP 45 39 39 18 9
BEPC 68 63 48 30 17
Bac 73 69 57 41 22
Supérieur 85 80 72 57 25* Quart de la population. « Les chiffres de l’économie 2004 », Alternatives économiques, HS n° 58.
3 Le lien social u Le mobile
Les nouvelles technologies amènent-elles à une nouvelle définition des relations sociales ?
1 Définir la notion de lien social.2 Le mobile (voir annexe) est-il une menace ou une opportunité pour le lien social ?
Justifier votre réponse.
ANNEXE : Le téléphone portable pour une nouvelle écologie de la vie urbaine
Un francilien doit compter de une à quatre heures quotidiennes de temps de déplacemententre son domicile et son lieu de travail. Ce temps passé en transit dans des sortes de « non-lieux » successifs, au milieu d’une foule anonyme qui entraîne une perte d’identité, est aussi,souvent, un temps où l’on cherche à prolonger par un lien symbolique le confort abandonné dela maison, du « chez-soi », que ce soit par la lecture d’un livre, l’écoute de musique à l’aide d’unbaladeur ou la possession d’un portable […]La voiture est elle-même une extension de la maison dans la mesure où elle constitue un uni-
vers privé propre à la personne, relevant d’une forme particulière de confort, et de la conser- vation d’un certain espace vital propre […] on y lit son journal, on y écoute la radio, ou on yparle au téléphone […]
-
8/17/2019 2232897740
11/14
T r a
v a u x
d i r i g é s
Chapitre 01 1 Analyser le contexte de communication 23
ANNEXE (suite)
Les villes n’étant plus à échelle humaine, et ses habitants s’y trouvant sans cesse en déplace-ment, le téléphone portable permet de rétablir un lien affecti f pur, l’accessibilité à l’autre […]Nous pouvons reconnaître au mobile deux fonctions. Grâce à lui, nous sommes en mesure detransporter virtuellement, et en permanence, notre cercle relationnel – ou capital relationnel,pour reprendre une expression bourdieusienne – partout où nous allons. Parallèlement, il faci-
lite le quotidien en nous autorisant à nous décharger dans l’instant d’un rendez-vous à prendre,d’un oubli […] De cette caractéristique personnelle et individuelle, voire individualiste du télé-phone portable, il ressort que son utilisation en société peut avoir par ailleurs des répercus-sions négatives sur le lien social général. Il n’est pas rare en effet que l’on se trouve, en tant quespectateur, incommodé, voire exclus, par l’intrusion d’un téléphone qui sonne dans le bus, dansle train, au restaurant, lors d’une réunion ou, pire, au cours d’un dîner avec des amis, particu-lièrement si la conversation se prolonge et n’est pas purement informative, donc brève. Le liensocial peut s’en trouver distendu ou même devenir conflictuel. Il permet de choisir d’être ounon avec les autres dans une relation globale de foule ou en communication unique avec uncorrespondant particulier.
Béatrice Fracchiolla, doctorante à Paris-III
« Esprit critique », Revue internationale de sociologie et sciences sociales, www.espritcritique.org
4 La proxémie u À chacun son territoire
Dans toute communication, nous devons prendre conscience de la notion de distance etde l’influence de celle-ci sur la relation interpersonnelle.
1 Placez-vous debout chacun à un bout de la salle. Parlez-vous. Que ressentez-vous ?2 Rapprochez-vous l’un de l’autre en maintenant le contact visuel jusqu’à ce que vous
commenciez à vous sentir à l’aise pour parler. Mesurez la distance qui vous sépare.3 Avancez jusqu’à ce que vous vous sentiez mal à l’aise. Mesurez à nouveau cette dis-
tance.4 Reprenez cet exercice avec d’autres personnes, comparez les distances et les sen-
sations.
-
8/17/2019 2232897740
12/14
T r a
v a u x
d i r i g é s
24 Partie 01 1 Les bases de la communication
5 Les rituels u Histoires de Gab’s
Gab’s, dessinateur humoristique, a croqué nos « petits travers ».
Associer rituels et dessins. Justifier vos choix.
ANNEXE : Les rituels chez Gab’s
1
3
2
54
6 87
9 10
11 12
Types de rituels
A. Rituels d’accèsB. Rituels de confirmation : déférenceC. Rituels de confirmation : entretienD. Rituels de confirmation : ratificationE. Rituels de réparation : justificationF. Rituels de réparation : excuses
D’après Gab’s, Commercial je me marre !!! – Management je me mar re !!!, Éditions Eyrolles, 2000
-
8/17/2019 2232897740
13/14
Chapitre 01 1 Analyser le contexte de communication 25
Une situation de communication (1) u Akoun Import
Pour répondre au développement de la demande de produits naturels, Éric Akoun vientde créer la société Akoun Import spécialisée dans l’importation des produits cosméti-ques de la mer Morte, réputée pour les vertus millénaires de ses oligo-éléments.
Embauché(e) depuis peu, un(e) jeune commercial(e) est chargé(e) de prospecter les phar-macies afin de référencer ces produits et de développer le chiffre d’affaires. Il (elle) a
rendez-vous avec M. Ludovic Laruelle, pharmacien, propriétaire de la pharmacie du Cen-tre, située dans le quartier historique de La Rochelle. Il (elle) entre dans la pharmacie. Unemployé lui désigne le pharmacien, en conversation avec une cliente.
Après avoir examiné les trois annexes :
1 Dans cette situation de communication définir les différents contextes :– le contexte général (contextes socioéconomique, technologique, culturel, institu-tionnel) ;– le contexte situationnel (spatial, temporel, savoirs communs partagés).
2 Comment les contextes vont-ils peser sur le comportement du (de la) commercial(e)dans la situation de communication de négociation-vente ?
3
Quel est le positionnement des acteurs (pharmacien, cliente, commercial[e]) audébut de la situation de communication : statut, rapport de place.4 Le pharmacien étant occupé, comment le (la) commercial(e) peut-il (elle) entrer en
contact avec lui ? Lors du rituel d’accès, comment peut-il (elle) se présenter ?
ANNEXE 1 : Politique mercatique d’Akoun Import
• Politique de produits : des soins de beauté de qualité aux minéraux naturels de la mer Morte,purs extraits de plantes et huiles essentielles (crèmes de soin visage et mains, crèmes amincis-santes…).• Politique de prix : tarifs et marges alignés sur la concurrence. Pas de prix promotionnel pour
le lancement.• Politique de communication : aucune publicité média, pas de PLV, échantillons possibles,documentation de qualité pour la force de vente comme aide à l’argumentation. Un service detéléprospection prend les rendez-vous pour les commerciaux.• Politique de distribution : pharmacies et parapharmacies.
ANNEXE 2 : Fiche contact (remplie par le téléprospecteur)
Pharmacie du Centre : place de l’Horloge – La RochelleContact : Ludovic LARUELLE, pharmacien, propriétaire
Date Action Suite à donner
Mardi 5 septembre Prospection téléphonique RV pris pour le vendredi 8 septembre à 18 h 30
Commentaires : l’argument « produits naturels de qualité » a été déterminant pour obtenir le RV enraison de sa clientèle de CSP+.
Vers l’épreuveE4
Vers l’épreuveE4
-
8/17/2019 2232897740
14/14
ANNEXE 3 : Dans la pharmacie
L’INTÉRIEUR DE LA PHARMACIE
LE PHARMACIEN EN CONVERSATION AVEC UNE CLIENTE
,