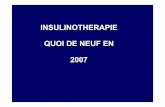Partage de matériel d'autocontrôle glycémique, risque d'hépatite B
Transcript of Partage de matériel d'autocontrôle glycémique, risque d'hépatite B

Actualit6s
0 0 0
Si me patient se contamine en manipulant de la viande de singe contamine, les proches aussi,
mais en lui donnant des soins rapproches alors qu'il se trouve dans la phase hemorragique et diarrheique tres contagieuse. Le scenario est
le meme pour les deux maladies.
Isolement pour les soignants aussi
La maladie de Marburg est pour les Euro-
peens un mauvais souvenir. C'est sur notre continent que cette nouvelle maladie emer- gea en 1967, premiere maladie emergente,
bien avant le sida (1981 ) mais le terme n'exis-
tait pas & I'~poque. EIle fit 7 deces dans un laboratoire de recherche allemand, &
Marburg precisement, des medecins conta- mines par des singes verts importes
d'Ouganda sans precautions veterinaires et
sanitaires particuli~res (imposees depuis), des laboratoires de Francfort et de Belgra-
de (ex-Yougoslavie) en touchant un lot. II y eut au total 25 cas humains.
Des resurgences se sont produites en 1975 en Afrique du Sud, en 1980 et en 1987 au
Kenya, en 1998-2000 au Congo (128 dbces sur 154 cas, 83 O/o de mortalite). La flambbe
actuelle aurait debute en octobre 2004 & Uige.
La maladie-fievre hemorragique de Marburg est donc encore aujourd'hui une maladie virale severe, grevee d'un fort taux de leta-
lite, mais pour le continent africain il faut tenir compte de la penurie d'infrastructures de rbanimation-isolement-rehydratation.
Virus de Marburg et virus d'Ebola sont des agents de la meme famille, les Filovirus, et sont pratiquement indistincts I'un de I'autre, formes de longs filaments parfois enroules
en ,< formes ~tranges ,, (dixit I'OMS). Agents infectieux parmi les plus virulents connus
chez I'homme, ils dbclenchent des epide- mies qui ne se revelent que par I'accumu-
lation des deces (1).
Quarante ans apres 1'emergence, malgre des recherches intensives, on ne sait
pas qui est le vecteur du virus Marburg, le singe n'btant qu'un relais de I'infection,
const i tuant une populat ion el le aussi vulnerable & I'infection. Tous tes animaux
infectes meurent rapidement, trop vite pour permettre la survie du virus.., qui a
donc un hete different ? L'homme n'est
qu'un hSte accidentel et n'est pas un vec- teur : I'infection secondaire (entourage,
personnel de sante) tient & I'absence de precautions vis-&-vis du patient hemor-
ragique. La maladie n'est pas transmissible
PartJcules virus-like de Marburg obtenues par ultracentrifugation du surnageant de virions (MARk/), Un colorant r#v~le leur ultra-structure. Grossissement
40 O00x. In : Vaccine 22 (2004) 3495-3502 : Marburg virus-like particles protect guinea pigs from lethal Marburg virus infection, Kelly L. Warfield et coil
(Editions Elsevier).
Iors de I'incubation (3 A 10 jours). Apres
contamination, le deces peut survenir en
8 eu 9 jours. J.-M. M,
m
Sources : OMS, INVS, Vaccine 22 (2004) 3495-3502,
(1) Le minist#re de la Sant~ met un site d'information & la disposition des voyageurs : http://www.france.diplo- matie.fr/voyageurs/etrangers/avis/conseils/default2.asp
mmmamm • m • n • mmmmm • m m m m m m m • i ! m la m m m | i • i I n • m m m
Partage de materiel d'autocontr61e glycemique, risque d'hepatite B Uusage collectif de materiel de surveillance
glycemique de sujets diabbtiques peut favo- riser la transmission par voie sanguine du
virus de I'hbpatite B (VHB). Plusieurs cas ont et6 rapportes ces dernieres annees, en
Amerique du Nord et en Europe, y compris en France.
Ulnspection generale de la sante d'Anvers
rapporte 4 cas d'hepatite dans 2 maisons de retraite mbdicalisees en 2004. En cause
les dispositifs de prelevement de sang capil- laire au bout du doigt chez des diabetiques.
Les services de sante publique flamands ont
mene une etude sero-epidbmiologique chez 94 residents et 47 membres du
personnel paramedical apres
un cas d'hepatite fulminante
chez un patient &g& Cinq des residents etaient porteurs du
VHB, dont 2 decederent. Aucun soignant n'etait seropositif.
On a pu etablir que les patients
diabetiques qui partagent le dispositif de prblevement de sang
capillaire ont 8,7 fois plus de risque de contracter une hepa- tite (autre facteur de risque : par-
rage d'un rasoir). I 'apparition d'hepatites B a cesse
avec des mesures anti-infectieuses et la vac-
cination des residents vulnbrables. La Beigique a connu de tels cas en 2002 et 2003, les E~tats-Unis en 2003 et 2004 & trois reprises.
H6patite et erreur de soins
Aux Etats-Unis, le premier des trois cas rep6-
res en maison de soins pour sujets &gbs concer- nait un patient decbd6 d'hepatite B. I'etablis-
sement n'avertit pas les autoritbs sanitaires ni
n'entreprit une enquete interne. Au deces d'un
second patient par hepatite aigue puis au dia- gnostic d'hepatite chez un troisieme, un test
sanguin chez les 158 residents en revela 15 cas. Parmi les 38 patients avec glycemie
quotidienne, 14 etaient au stade aigu d'hepati- te. Uenquete a revele un usage en commun du dispositif de scarification (changement d'aiguille 0 0 0
1 2 Revue Francophone des Laboratoires, mai 2005, N ° 3"73

mais sans desinfection) et du lecteur de glyc& ~ @ mie, ainsi que la disponibi l i te de f lacons @ d'insuline non nominatifs des patients, a usage @
aleatoire. Une surveillance discrete revela qu'on reutilisait les aiguilles ou qu'on ne changeait
pas de gants entre deux prelevements chez ~ deux patients. @ @ Second cas ; 4 hepatites B au stade aigu. Sur @
25 residents, 22 ont accept@ la recherche du @ VHB : 4 autres sujets en etaient porteurs. Le
personnel soignant mesurait chaque jour la @ @
glycemie des 8 positifs. Chaque resident avait @ son propre scarificateur, mais les infirmieres @ ont admis ufiliser le meme lecteur de glycemie pour plusieurs patients & la suite. Le port de @
gants n'etait pas encourage et I'hygiene des @ @
mains etait pauvre. @
Tmisi~me cas • une hepatite B a justifie le test @ chez 192 residents, permettant d'en decouvrir @ 11 au stade aigu. Sur 45 patients testes chaque @
jour pour la glycemie, 8 avaient une hepatite @ aigu& L& encore, I'enquete a montre que les @
@ equipes soignantes utilisaient une seule aiguille ® et un seul flacon par patient mais un seul appa- @
reil de mesure de la glycemie pour tous, sans chart- @ ger de gants entre deux patients.
Le VHB, tres stable & rair ambiant, est hautement @ @
transmissible par le sang, dont des traces peu- @ vent subsister sur le scarificateur : aiguille, emba- @
se (support du doigt pour la piqOre), corps de @
I'appareil, sur le lecteur de glycemie, les gants @ du personnel, des surfaces diverses. Un VHB- @
positif peut 6tre asymptomatique, et transmet- ~ @
teur non reper& La pratique de glycemies non @ justifiees augmente le risque de contaminations @
en maison de retraite medicalisee.
J.-M. M. @ @
Source : Eurosurveillance Weekly, mars 2005. @ @
@ @ @@@@ @@ @ ® @@ @ ~ ~ @ @~ @ @@
o. rn @
!L
l HH La revue Pediatric Critical Care Medicine
(prise en charge de cas p~diatriques au stade critique) a publi~ 4 observations dramatiques d'adolescents
diab~tiques de type 2 (~mergence 6pid#.mique m~connue en France), admis pour une pr#.sentation inhabituelle :
/e syndrome hyperg/yc#.mique hyperosmotaire n o n c~tosique (HHS ou HHNS), en soins intensifs
(intensive care unit) au Centre hospitalier universitaire de Chapel Hill (Caroline du Nord)o
D eux des patients n'ont pas survecu, le
premier apres choc hypovolemique, le second & la suite d'une rhabdomyolyse et
d'une defaillance multiviscerale, malgre les
soins intensifs. Le H H NS, rappellent les auteurs de ces obser- vations (1), possede un taux de letalite elev6
(10 a 50 %) et peut entrafner diverses com- plications. Les strategies therapeutiques ne
sont pas clairement etablies.
La frequence du HHNS a augment@ de plus de 10 fois dans la population pediatrique am&
ricaine ces dernieres annees. II est decrit dans
la litterature medicale, mais c'est ici la pre- miere fois qu'est envisage le traitement en pediatrie.
,, Nous pensons que le HHS deviendra plus courant dans la population pediatrique en
raison du caractere 6pid#mique recent de I'obesit~ chez les enfants, disent les auteurs.
L'ob#sit~ est un facteur de risque majeur
du diabete de type 2. Le HHS peut #tre la
premiere presentation d'un diabete de type 2 p#diatrique comme c'etait le cas pour nos
[quatre] patients ,~. IIs ont regu un serum iso-
tonique et de I'insuline. Du fait du taux eleve de letalite et du risque de
complications, il est essenflel que les pediatres, les urgentistes et les services de medecine
et de biologie en unites de soins intensifs (la
biologie peut aussi repondre & I'urgence) connaissent le HHNS, soulignent les memes
auteurs. II est egalement important qu'ils repE- rent la deshydratation des patients et le trai-
tent de fagon intensive. Le risque d'oedeme
cerebral associe a la rehydratation intensive n'est
pas completement evalu&
Triade biologique
Le HHNS presente la triade: hyperglycemie
severe : > 6 g /L ; hyperosmola l i te :
> 320 mOsm/L ; acidose : pH > ?,3 sans cetose. Les patients sont tres deshydrates :
perte de 15 & 20 % de I'eau corporelle (soif
intense). Neanmoins, nombre de ces patients ne presentent pas ces valeurs biologiques,
d'oQ risque de confusion entre HHS et
acidocetose.
Le t ra i tement propose repose sur une rehydratation rapide, pour eviter le choc
hypovolemique dO & la diurese osmotique,
ce risque etant, semble-t-il, superieur & celui
d'oedeme cerebral. La rhabdomyolyse dolt etre recherchee : elle peut Etre cause de
defaillance renale. Ces propositions sont extrapolees de ce que
donne la litterature medicale du HHNS de
I'adulte : on n'y trouve encore pas de strat& gie precise pour reduire la mortalit& Le risque
letal semble augmenter chez I'adolescent avec
une forte oh@site et le diabete de type 2. Des
enquetes en population pediatrique, tenant
compte des differences ethniques, sont neces- saires, et des essais therapeutiques pour
mettre fin.., aux controverses sur le mode et le contenu des traitements proposes.
L'incidence du HHS va augmenter, avertis-
sent reanimateurs, pediatres et diabetologues de cette etude americaine.
J.-M. M.
(1) Pediatric Critical Care M#decine 6 (2005) 20-24 (janvier 2005) : www.pccmjournaLorg.
Revue Francophone des Laboratoires, mai 2005, N ° 373 13