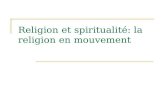Étude 2017 - L’ENTREPRISE, LE TRAVAIL ET LA RELIGION
-
Upload
groupe-randstad-france -
Category
Recruiting & HR
-
view
3.140 -
download
0
Transcript of Étude 2017 - L’ENTREPRISE, LE TRAVAIL ET LA RELIGION

Observatoire du FaitReligieux en Entreprise
L’ENTREPRISE,LE TRAVAILET LA RELIGION
Étude 2017


3
L’année 2017 marque la 5e édition de l’étude sur le fait religieux au travail réalisée de concert par l’Institut Randstad et l’Observatoire du Fait Religieux en Entreprise (OFRE). L’occasion de dresser le premier bilan d’un phénomène de société devenu, comme nous l’écrivions il y a un an, un fait social à part entière.
Les cinq années écoulées nous ont permis de prendre toute la mesure du fait religieux au travail. Depuis 2013, date de la première enquête, nous avons été les témoins de sa progression puis de sa banalisation. À cet égard, l’étude 2017 livre un enseignement de taille. Pour la première fois, l’observation « quantitative » du fait religieux ne progresse pas. La part des personnes interrogées qui, en 2017, déclarent observer de façon régulière ou occasionnelle des faits religieux dans leur situation de travail est identique à ce qu’elle était un an plus tôt : 65 %.
L’enquête 2017 confirme donc la banalisation du fait religieux en entreprise. Elle donne aussi à voir son « plafond ». Car si l’édition 2016 avait révélé une progression de 10 points en un an de l‘observation des manifestations du fait religieux au travail, la stabilité constatée en 2017 n’est vraisemblablement pas un hasard. Elle témoigne du poids des entreprises qui, par leur secteur d’activité et/ou leur implantation géographique, présentent une porosité au fait religieux. Aussi pouvons-nous considérer que le fait religieux touche, d’une façon ou d’une autre, environ deux-tiers des managers en France. Un résultat davantage structurel que conjoncturel.
PRÉFACE
Lionel HonoréProfesseur des
Universités – Directeur du Laboratoire GDI de l’Université de la Polynésie française
et Directeur de l’Observatoire du Fait
Religieux en Entreprise
Laurent MorestainSecrétaire Général
du groupe Randstad en France – Président de l’Institut Randstad
pour l’Egalité des Chances et
le Développement Durable

4
SYNTHÈSE
Les manifestations du fait religieux en entreprise progressent… lentement34 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont déclaré avoir régulièrement observé des manifestations du fait religieux dans leur situation de travail, contre 28 % en 2016 et 12 % en 2014.
Demandes et pratiques personnelles en tête des manifestations du fait religieuxLes trois manifestations du fait religieux les plus fréquemment observées en 2017 restent identiques à celles relevées lors de l’édition précédente : • port d’un signe religieux visible (22 %
en 2017, contre 21 % en 2016) • demande d’absence (18 %, comme en 2016)• demande d’aménagement du temps de
travail (12 %, contre 14 % en 2016)
Une stabilisation des cas problématiques nécessitant une intervention managérialeAlors qu’elle augmentait régulièrement depuis la 1re enquête (24 % en 2014, 38 % en 2015, 48 % en 2016), la part des cas nécessitant une intervention managériale est désormais stable, voire en très légère baisse (47 %).

5
Vers une augmentation des problématiques liées au fait religieux en entreprise ?Paradoxalement, une large majorité des personnes interrogées (63 %) anticipent une augmentation des problématiques liées au fait religieux en entreprise dans les années à venir.
L’entreprise doit-elle s’adapter à la pratique religieuse des salariés ?De plus en plus, la réponse est non. À présent, plus de 70 % des personnes interrogées pensent que l’entreprise ne doit pas s’adapter aux pratiques religieuses des salariés. Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2016 (60 %).
Neutralité religieuse : les évolutions réglementaires font bouger les lignes75 % des personnes interrogées considèrent comme une bonne chose qu’une entreprise puisse désormais, sous certaines conditions, inscrire ce principe dans leur règlement intérieur et l’imposer à leurs salariés. Elles étaient pourtant 65 % à s’opposer à cette idée en 2016. Pour autant, 41 % seulement des personnes souhaiteraient que des dispositions concernant le fait religieux et la neutralité soient intégrées dans le règlement intérieur de leur entreprise.
Un lien établi entre inconfort managérial et tendance à être confronté à des manifestations fréquentes et complexes du fait religieuxL’enquête 2017 tend à démontrer que les personnes qui font principalement face à des demandes personnelles, rarement des faits perturbants et transgressifs, sont aussi celles qui éprouvent le moins de difficultés à manager… et inversement.

6
1.1 La fréquence du fait religieux en entreprise
Pages 8-11
Pages 12-25
Pages 26-27
Caractériser le fait religieux au travail : fréquences et formes
L’entreprise faceau fait religieux
01 SO
MM
AIRE
022.1 Les cas complexes et
les situations délicates
2.2 Quelle prise en compte du fait 2.2 Quelle prise en compte du fait 2.2 religieux par l’entreprise ?
1.2 Les formes du fait religieuxen entreprise
2.3 La pratique managériale2.3 La pratique managériale2.3 face au fait religieux
Zoom sur le fait religieux au travail en Europe (et au-delà)

7
Pages 28-29
Pages 32-33
L’impact du fait religieux sur les relationsau travail
Méthodologie
03
Laïcité et fait religieux au travail
Pages 30-31
04
05
3.1 La place de la religionentre collègues
3.2 La question de la discrimination

8
1.1 La fréquence du fait religieux en entreprise
Le cadre juridique applicable au fait religieux en entreprise a fait récemment l’objet de clarifications. Par l’intermédiaire de la loi Travail d’abord, qui attribue en la matière un rôle particulier au règlement intérieur. Par l’intermédiaire ensuite de deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), qui légitiment sous conditions une restriction de l’exercice de la liberté religieuse au travail. Ces clarifications ont-elles pour autant conduit à un reflux du phénomène religieux en entreprise ? Rien ne permet de l’affirmer aujourd’hui.
Le fait religieux en entreprise poursuit sa banalisation
Les résultats de l’enquête démontrent que non seulement la fréquence d’observation des manifestations du fait religieux ne baisse pas, mais que la part des personnes interrogées qui en observent régulièrement dans leur situation de travail augmente.
Caractériser le fait religieux au travail : fréquences et formes01
des personnes rencontrent régulièrement (à une fréquence
journalière, hebdomadaire ou mensuelle) le fait religieux
dans leur situation de travail (12 % en 2014)
des personnes observent des faits religieux sur leur lieu de travail de manière
régulière ou occasionnelle (quelques fois par trimestre ou par an) (44 % en 2014)
35 % 65 %

À quelle fréquence observez-vous des faits religieuxdans votre situation de travail ?
régulièrement occasionnellement rarement
0 %10 %20 %30 %40 %
60 %50 %
2014
12 %
32 %
56 %
23 %28 %
50 %
28 %
36 % 35 % 34 %31 %
35 %
2015 2016 2017
Pensez-vous que l’entreprise devrait pouvoir inscrire dans son règlement intérieurun principe de neutralité religieuse et l’imposer à ses salariés ?
Si cela est souhaité par certains salariés pratiquants,pensez-vous que l’entreprise doive :
oui non
35%65 %
Adapter l’emploi du temps(pause pour prières, départ plus tôt...) 6 %
Permettre des vacances (RTT, joursde vacances) pour des motifs religieux 10 %
Proposer des menus religieux à la cantine 5 %
Mettre en place un lieu de prière 3 %
Rien de tout cela 84 %
Permettre des départs en pauselorsqu’un salarié doit aller prier 4 %
9
Quel regard portent les personnes interrogées sur cette banalisation ?
Paradoxalement, une très large majorité des personnes interrogées (62 %) anticipent une augmentation des problématiques liées au fait religieux en entreprise dans les années à venir, alors même que 73 % d’entre elles ne constatent pas, aujourd’hui, d’augmentation des faits religieux dans leur environnement de travail. De la même manière, 67 % n’observent pas d’augmentation du nombre de situations nécessitant une intervention quelconque du management.
Le fait religieux en entreprise
continue de progresser,
mais lentement
Pensez-vous que le nombre de situations problématiques liées au fait religieux va augmenter dans les années à venir ?
Constatez-vous une augmentation du nombre de situations marquées par un fait religieux qui nécessitent une intervention du management (opérationnel ou RH) ?
Constatez-vous une augmentation des faits religieux dans votre environnement de travail ?
27 %
33 %
63 %
73 %
67 %
37 %

Typologie des faits religieux
Port visible d'un signeDemande d'absence
Demande d'aménagement du temps de travailPrière pendant une pause
Refus de travailler sous les ordres d'une femmeRefus de travailler avec une femmePrières pendant le temps de travail
Refus de réaliser des tâchesPorsélytisme
Stigmatisation de personne Refus de travailler avec un collègue
Demande de travailler qu'avec des coreligionnairesPrière collective
Intervention d'un responsable religieux
22 %
18 %
12 %
10 %
8 %
6 %
5 %
5 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
1 %
10
1.2 Les formes du fait religieux en entreprise
Deux grandes catégories de manifestation du fait religieux en entreprise doivent continuer à être distinguées. • Les demandes et pratiques personnelles : demandes d’absence
pour une fête religieuse ou d’aménagement du temps de travail (planning, horaires), port ostentatoire de signes, prières pendant les pauses.
• Les manifestations qui perturbent et/ou remettent en cause l’organisation du travail et/ou transgressent des règles légales : refus de travailler avec une femme ou sous ses ordres, de faire équipe avec des personnes qui ne sont des coreligionnaires, refus de réaliser des tâches, prosélytisme, prières pendant le temps de travail, intervention de personnes extérieures, etc.
Comme lors de l’enquête précédente, le port de signes religieux visibles sur le lieu de travail constitue
la manifestation la plus courante (22 %) du fait religieux en entreprise, suivi des demandes d’absences (18 %) et
d’aménagement du temps de travail (12 %), ainsi que de la pratique de la prière pendant les pauses (10 %).

11
Demandes et pratiques personnelles constituent les manifestations les plus courantes du fait religieux
Si elles ne perturbent pas, en elles-mêmes, le bon fonctionnement de l’entreprise, leur impact doit toutefois être considéré dans un contexte plus large. Le port d’un signe religieux visible par exemple, n’est pas, en soi, de nature à perturber le bon fonctionnement d’une entreprise. Il peut toutefois le devenir en cas d’interaction avec un client ou pour des raisons de sécurité ou d’hygiène. De ce point de vue, la loi Travail de 2016 et les arrêts de la CJUE de mars 2017 donnent désormais la possibilité aux entreprises d’imposer une neutralité religieuse (ainsi que politique et philosophique) à leurs salariés à la double condition que le bon fonctionnement de l’entreprise soit en jeu et que le règlement intérieur définisse, par l’intermédiaire de règles précises, ce qui est attendu des salariés.
Bien plus problématiques pour l’entreprise, les manifestations du fait religieux entrant dans la 2e catégorie sont, quant à elles, stables ou en très légère baisse (38 % du total contre 39 % en 2016).
La majorité (53 %) des situations rencontrées par les personnes interrogées ne nécessitent pas d’intervention managériale, un chiffre quasi-stable par rapport à 2016 (52 %).
Stable

Part des cas nécessitant une intervention managériale
0 %10 %20 %30 %40 %
60 %50 %
70 %80 %
2014 2015 20172016
Cas nécessitant une intervention managérialeCas ne nécessitant pas une intervention managériale
24 %
76 %
38 %
62 %
48 %52 %
47 %53 %
12
2.1 Les cas complexes et les situations délicates
Les résultats de l’enquête 2017 traduisent une stabilisation des cas complexes et des situations délicates nécessitant une intervention managériale. Rappelons qu’une intervention managériale ne consiste pas systématiquement à résoudre des problèmes ou des conflits. Elle peut aussi prendre la forme d’une recherche de compromis ou d’une décision, acceptée par la suite par le salarié. Clarification du cadre légal, mise en lumière des questions liées au fait religieux au travail, actions de formation et d’information de plus en plus souvent mises en œuvre par les entreprises… tous ces éléments contribuent en effet à une meilleure prise en charge des situations par le management.
L’entreprise face au fait religieux02
Alors qu’elle augmentait
régulièrement depuis la 1re
enquête (24 % en 2014, 38 %
en 2015, 48 % en 2016), la part des
cas nécessitant une intervention
managériale est stable, voire
en très légère baisse (47 %).

Importance des cas bloquants et conflictuels(parmi ceux nécessitant une intervention managériale)
Cas bloquants et/ou conflictuelsCas non bloquants et/ou non conflictuels
2013
6 %
94 %
10 %
90 %
2014
12 %
88 %
2015
14 %
86 %
2016
16 %
84 %
2017
Importance des cas bloquants et conflictuels(parmi ceux nécessitant une intervention managériale)
Cas bloquants et/ou conflictuelsCas non bloquants et/ou non conflictuels
2013
6 %
94 %
10 %
90 %
2014
12 %
88 %
2015
14 %
86 %
2016
16 %
84 %
2017
13
Ce résultat est cohérent avec ce qu’observent les personnes inter-rogées, dans la mesure où :• 67 % d’entre elles ne constatent pas d’augmentation du nombre
de situations marquées par un fait religieux et qui nécessitent une intervention du management,
• 73 % d’entre elles ne constatent pas d’augmentation des faits religieux dans leur environnement de travail.
7,5 % du total cas sont bloquants
et/ou conflictuels
2.1.1 Des cas bloquants et/ou conflictuels qui continuent à progresser
Parmi l’ensemble des cas nécessitant une intervention du management, ceux qui se révèlent bloquants ou conflictuels continuent à progresser. Ils représentent aujourd’hui 16 % du total, contre 14 % en 2016 et 12 % en 2015. Même en progression, ce chiffre est à relativiser car il représente au final 7,5 % de l’ensemble des cas (contre 6,72 % en 2016). Toutefois ces situations sont celles qui posent le plus de problème aux managers et qui remettent le plus en question le fonctionnement des équipes et au-delà, le lien social.

Raisons expliquant la complexité des situations
Présence de tiers extérieursà l’entreprise 10 %
Demande collective 10 %
Remise en cause de la légitimitédu manager 18 %
Refus de discuter 25 %
Menace d’accusationde discrimination religieuse ou raciale 80 %
60 %Remise en cause de la légitimité
de l’entreprise
14
Menaces d’accusation de discrimination religieuse ou raciale, mise en cause de la légitimité de l’entreprise et du manager… les mêmes raisons expliquent, lors de cette enquête comme lors des précédentes, la complexité d’une situation.
2.1.2 Un manager sur cinq désormais débordé par la question religieuse
Comme en 2015 et 2016, nous avons distingué quatre types de situation rencontrées par les entreprises et les personnes et dont nous avons évalué la complexité sur une échelle de A à D. Nous avons ensuite croisé cette typologie avec la fréquence à laquelle les entreprises et les personnes étaient confrontées au fait religieux. Objectif : obtenir une typologie des situations des personnes ayant répondu à l’enquête, en fonction de ces deux variables (fréquence et complexité).
Principal enseignement : le lien entre ces deux variables est fort. Autrement dit, la tendance des personnes à être confrontées à des situations complexes, de type A ou B, est fortement corrélée à la fréquence à laquelle elles sont confrontées au fait religieux.

Les profils de situations des managerspar rapport au fait religieux
Profil 1 :situations fréquentes,
délicates et complexes
Profil 2 :situations régulières,
parfois délicates
Profil 3 :situations courantes,rarement délicates
0 %10 %20 %30 %40 %
60 %50 %
70 %
20162015 2017
16,8 %18 %20 % 21,3 %23 % 24,6 %
61,9 %59 %
55,4 %
15
Il en ressort trois types de profils :
Il fait face à des manifestations diverses et très fréquentes du fait religieux, correspondant autant à des demandes personnelles qu’à des manifestations transgressives et de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise. Ce profil correspond à 20 % des personnes interrogées dans l’enquête (contre 18 % en 2016 et 17 % en 2015), soit un manager sur cinq.
Il fait régulièrement face à des manifestations du fait religieux. Ces dernières sont en revanche moins nombreuses et variées : principalement des demandes personnelles mais aussi régulièrement des manifestations transgressives et de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise. Ce profil correspond à 24,6 % des personnes interrogées dans l’enquête (contre 23 % en 2016 et 21,5 % en 2015).
Il fait principalement face à des demandes personnelles, rarement à des manifestations transgressives et de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise. Ce profil correspond à 55,4 % des personnes interrogées dans l’enquête 2017 (contre 59 % en 2016 et 61,5 % en 2015). Même si ce profil reste majoritaire, il continue à rassembler moins de personnes d’année en année.
profil
1
2profil
3profil

16
Pour la première fois cette année, nous avons essayé de mesurer le lien entre le niveau de confort ou d’inconfort perçu par le manager dans sa situation de travail et différentes variables relatives à sa prise en compte du fait religieux. Pour cela, nous avons élaboré un score de confort dans la situation de travail à partir d’une série de onze questions visant à demander aux personnes d’évaluer leur sentiment d’efficacité au travail, la possibilité qu’ils ont de bien travailler, les difficultés qu’ils rencontrent, leur capacité à y faire face, leur niveau de stress, les relations avec leur hiérarchie et leurs collègues, etc. À chaque fois que cela a été possible, nous avons mesuré le lien entre ce score et les réponses aux questions des personnes sur leur appréhension du fait religieux en situation de travail et sur leur pratique de management du fait religieux.
Conclusion : il nous a été ainsi possible d’établir un lien entre le niveau de confort ou d’inconfort perçu par un manager et son profil de situation relative au fait religieux.
Il nous a été possible d’établir un lien entre le niveau de confort ou d’inconfort perçu par un manager dans sa situation de travail et son profil de situation relative au fait religieux.
Les managers qui font très fréquemment face à des manifestations du fait religieux, diverses et correspondant autant à des demandes personnelles qu’à des faits transgressifs et perturbants (profil 1) obtiennent les scores de confort significativement plus faibles (niveaux d’inconfort les plus élevés). Inversement, les managers qui font principalement face à des demandes personnelles, rarement des faits perturbants et transgressifs (profil 3), obtiennent des scores de confort significativement plus élevés (niveaux d’inconfort les plus faibles).
2.1.3 Une corrélation entre le niveau de confort ou d’inconfort perçu par un manager et sa prise en compte du fait religieux ?
12,2 %

17
61 % des personnes faisant principalement face à des demandes personnelles, rarement à des manifestations transgressives et de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise (profil 3), obtiennent des scores de confort significativement plus élevés.
Toutefois, à ce stade, il ne nous est pas possible de préciser dans quel sens joue ce lien : est-ce la complexité de la situation qui génère l’inconfort du manager ? Ou est-ce l’inconfort que le manager ressent dans sa situation de travail qui gêne sa bonne prise en charge des faits et comportements religieux ?
12,2 % des personnes interrogées sont confrontées à la fois à des difficultés dans leur travail managérial et à des situations complexes du fait de la dimension religieuse des événements, demandes ou comportements qu’ils doivent prendre en charge.
61 %
12,2 %

Pourcentage des personnes interrogées qui pensent que l’entreprise doit tenir compte de la pratique religieuse de ses salariés
s’ils en font la demande, pour établir :
Les plannings de vacances
Les plannings de travail
La composition des équipes
0 %10 %20 %30 %40 %
60 %50 %
70 %
20162017
61 %
34,6 %
50 %
36,1 %
11 %7,7 %
Pourcentage des personnes interrogées qui pensent que l’entreprise doit tenir compte de la pratique religieuse de ses salariés
s’ils en font la demande, pour établir :
Les plannings de vacances
Les plannings de travail
La composition des équipes
0 %10 %20 %30 %40 %
60 %50 %
70 %
20162017
61 %
34,6 %
50 %
36,1 %
11 %7,7 %
18
2.2.1 Une entreprise de moins en moins appelée par ses managers à s’adapter à la pratique religieuse de ses salariés
2.2 Quelle prise en compte du fait religieux par l’entreprise ?
40 % des personnes interrogées en 2016 considéraient que l’entreprise devait s’adapter pour tenir compte des pratiques religieuses de ses équipes. Elles ne sont plus que 28 % à le penser cette année. Conformément aux dernières éditions, les personnes interrogées continuent toutefois à distinguer les situations les unes des autres. À titre d’exemple, elles sont davantage ouvertes à ce que l’entreprise prenne en compte le critère religieux pour établir les plannings de vacances que pour composer les équipes. Toutefois, l’évolution observée sur les réponses aux questions posées ci-dessous va significativement dans le sens d’une limitation de la prise en compte de la religion dans les pratiques de gestion.
« Le travail, c’est le travail. Ce n’est pas à l’entreprise de faire des efforts. Les gens sont là pour travailler, pas pour prier ou faire de la politique. Sinon, on ne s’en sort plus ». Un cadre d’une entreprise pharmaceutique
« C’est une très bonne chose que le règlement intérieur permette de fixer des limites. Pour moi, il était temps de rappeler que l’on vient ici pour travailler. Celui qui rentre dans l’atelier est un salarié de l’entreprise et il doit se comporter tel quel. Donc, au travail, il doit mettre sa religion de côté ». Un chef d’équipe chez un équipementier automobile

19
2.2.2 Des répondants partagés quant à une éventuelle clarification des règles régissant le fait religieux dans leur entreprise
Les résultats de l’enquête 2017 montrent une nouvelle fois que les personnes interrogées préfèrent une approche pragmatique et au cas par cas de cette question et ne souhaitent, ni une laïcisation du fonctionnement de l’entreprise sur le modèle du public, ni une absence de règles et de limites pour encadrer l’expression de la liberté religieuse.
Une des évolutions majeures concernant ces questions est le rôle attribué au règlement intérieur par la loi Travail et par la jurisprudence récente de la CJUE. Comme l’illustrent les graphiques ci-dessous, il ressort de notre enquête que si peu d’entreprises ont déjà utilisé cette possibilité, 41 % des personnes interrogées souhaiteraient que des dispositions concernant le fait religieux et la neutralité soient intégrées dans le règlement intérieur de leur entreprise. Bien plus, pour 3 personnes interrogées sur quatre (75 %), cette évolution du cadre légal et cette possibilité donnée aux entreprises est une bonne chose. Elles étaient pourtant 65 % à s’y opposer en 2016.
Pensez-vous que l’entreprise devrait pouvoir inscrire dans son règlement intérieurun principe de neutralité religieuse et l’imposer à ses salariés ?
Si cela est souhaité par certains salariés pratiquants,pensez-vous que l’entreprise doive :
oui non
35%65 %
Adapter l’emploi du temps(pause pour prières, départ plus tôt...) 6 %
Permettre des vacances (RTT, joursde vacances) pour des motifs religieux 10 %
Proposer des menus religieux à la cantine 5 %
Mettre en place un lieu de prière 3 %
Rien de tout cela 84 %
Permettre des départs en pauselorsqu’un salarié doit aller prier 4 %
Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, inscrire dans leur règlement intérieur un principe de
neutralité religieuse et l’imposer à leurs salariés
S’il n’existe pas de disposition concernant le fait religieux et la neutralité dans le règlement intérieur de votre
entreprise, souhaiteriez-vous que cela soit fait ? :
Pensez-vous que cela soit une bonne chose ?
Cela a-t-il été mis en place dans votre entreprise ?
75 %
25 % 16 %
84 %
59 %
41 %

20
2.2.3 Des répondants sélectifs quant à la possibilité d’autoriser telle ou telle pratique religieuse au travail
Comme souligné plus haut, les personnes interrogées ne souhaitent pas pour autant bannir toute manifestation de religiosité de l’espace et du temps de travail. Si certaines pratiques et demandes sont considérées comme acceptables et admises (comme discuter de sujets religieux avec ses collègues), d’autres en revanche sont proscrites (refuser de réaliser des tâches pour des raisons religieuses par exemple).
73 % des répondants considèrent que le fait de prier pendant ses pauses est tout à fait admissible, à condition toutefois que cette pratique de la prière soit individuelle, ne perturbe pas le travail et se fasse dans un lieu discret (contre 75 % en 2016).
73 %
70 %
81 %
70 % des personnes interrogées considèrent que la personne n’a pas à demander la permission au management pour s’adonner à cette pratique de la prière si elle est réalisée pendant les pauses (contre 71 % en 2016).
81 % des répondants considèrent qu’il est tout à fait légitime de demander une autorisation d’absence pour une raison liée à la religion, comme se rendre à une cérémonie par exemple (contre 83 % en 2016).
« Si le salarié fait bien son travail, je dirais que le reste ne me regarde pas. En dehors du travail, sur la pause déjeuner, le salarié peut fumer s’il veut fumer, cela ne me regarde. Et bien c’est pareil pour la prière. S’il veut prier, cela ne me regarde pas. Il peut le faire du moment que le travail est fait, que c’est dans les règles et que ça ne gène personne ». Un chef d’atelier dans l’industrie

Une demande pour motifs religieuxdevrait simplement être traitée comme une demande pour motifs personnels
Une situation en lien avec le fait religieuxest plus délicate à aborder pour un manager qu’une autre situation
d’accord pas d’accord
75%
61%
25 %
39 %
21
2.3 La pratique managériale face au fait religieux
2.3.1 Des situations délicates mais à appréhender sans tenir compte de la dimension religieuse
Pour les personnes interrogées dans notre étude, une demande pour motifs religieux devrait simplement être traitée comme une demande pour motifs personnels et n’est pas plus délicate à aborder pour un manager qu’une autre situation. Il existe ici un lien entre le score de confort obtenu par la personne, le type de situation dans laquelle elle se trouve et ses réponses à ces questions. Certaines personnes estiment que les situations en lien avec le fait religieux sont plus délicates à aborder que d’autres situations. Quelles sont ces personnes ? Il s’agit des 12,2 % de répondants identifiés comme étant en difficulté managériale et devant faire face à des situations (évènements, demandes, comportements) complexes en raison de leur dimension religieuse.
« C’est sûr que, parfois, on marche sur des œufs. On ne sait pas trop comment réagir.Pour ma part, je fais attention à ce que je dis et à comment je le dis. Avec la religion, j’ai toujours un peu peur que ça dérape ». Un chef d’équipe dans l’industrie
Une demande pour motifs religieux devrait simplement être traitée comme une demande pour motifs personnels
Une situation en lien avec le fait religieux est plus délicate à aborder pour un manager qu’une autre situation
61 %
39 %
75 %
25 %une majorité de répondants
(61 %) estime qu’une situation
en lien avec le fait religieux est
plus délicate à aborder pour un manager qu’une
autre situation

Tenez-vous compte, dans l’organisation du travail de votre équipe,de la pratique religieuse de certains de vos collaborateurs ?
pour répartir les tâches,les rôles, les missions
pour établirles plannings de travail
pour établirles plannings de vacances
pour formuler des remarquessur le travail effectué
pour formuler des remarquessur le comportement au travail
OuiParfoisJamais
89 % 79 %
73 %
89 %
96 %
6 %14 %
20 %
10 %
4 %
5 %
7 %
1 %
7 %
Tenez-vous compte, dans l’organisation du travail de votre équipe,de la pratique religieuse de certains de vos collaborateurs ?
pour répartir les tâches,les rôles, les missions
pour établirles plannings de travail
pour établirles plannings de vacances
pour formuler des remarquessur le travail effectué
pour formuler des remarquessur le comportement au travail
OuiParfoisJamais
89 % 79 %
73 %
89 %
96 %
6 %14 %
20 %
10 %
4 %
5 %
7 %
1 %
7 %
Tenez-vous compte, dans l’organisation du travail de votre équipe,de la pratique religieuse de certains de vos collaborateurs ?
pour répartir les tâches,les rôles, les missions
pour établirles plannings de travail
pour établirles plannings de vacances
pour formuler des remarquessur le travail effectué
pour formuler des remarquessur le comportement au travail
OuiParfoisJamais
89 % 79 %
73 %
89 %
96 %
6 %14 %
20 %
10 %
4 %
5 %
7 %
1 %
7 %
Tenez-vous compte, dans l’organisation du travail de votre équipe,de la pratique religieuse de certains de vos collaborateurs ?
pour répartir les tâches,les rôles, les missions
pour établirles plannings de travail
pour établirles plannings de vacances
pour formuler des remarquessur le travail effectué
pour formuler des remarquessur le comportement au travail
OuiParfoisJamais
89 % 79 %
73 %
89 %
96 %
6 %14 %
20 %
10 %
4 %
5 %
7 %
1 %
7 %Tenez-vous compte, dans l’organisation du travail de votre équipe,
de la pratique religieuse de certains de vos collaborateurs ?
pour répartir les tâches,les rôles, les missions
pour établirles plannings de travail
pour établirles plannings de vacances
pour formuler des remarquessur le travail effectué
pour formuler des remarquessur le comportement au travail
OuiParfoisJamais
89 % 79 %
73 %
89 %
96 %
6 %14 %
20 %
10 %
4 %
5 %
7 %
1 %
7 %
22
Comme l’indiquent les résultats présentés ci-dessous, le critère religieux est rarement pris en compte par les personnes interrogées (et encore plus rarement de manière systématique) pour prendre des décisions relatives à l’organisation du travail. Un élément important à noter toutefois : il existe un lien statistiquement significatif entre l’appartenance à la catégorie des managers en difficulté (12,2 % du total de ceux qui sont confrontés au fait religieux) et le fait de tenir compte de la pratique religieuse des collaborateurs pour gérer l’organisation et les rapports interpersonnels. Plus les managers sont en difficulté, plus ils ont tendance à intégrer la dimension religieuse dans la gestion des situations qu’ils rencontrent.
91 %
73 %
86 %
73 %
95 %
3 %
10 %
4 %
8 %
2 %
6 %
17 %
10 %
19 %
3 %

En cas de blocage ou de conflit lié à une question religieuse le service juridique de l’entreprise doit systématiquement être informé
En cas de blocage ou de conflit lié à une question religieuse il revient au manager direct de la personne concernée de gérer le problème mais il doit en référer à sa hiérarchie et/ou au service RH
Une demande (par exemple d’absence, de modification des horaires de pauses ou de travail, d’aménagement des tâches) pour motifs religieux doit être traitée avant tout par le manager direct de la personne 67 %
77 %
65 %
33 %
23 %
35 %
Une demande pour motifs religieuxdevrait simplement être traitée comme une demande pour motifs personnels
Une situation en lien avec le fait religieuxest plus délicate à aborder pour un manager qu’une autre situation
d’accord pas d’accord
75%
61%
25 %
39 %
23
2.3.2 Comment réagir dans les situations marquées par le fait religieux ?
Comme cela était déjà le cas lors des enquêtes précédentes, les personnes interrogées soulignent le rôle de l’encadrement de terrain dans la prise en charge des situations marquées par le fait religieux. En cohérence avec le souhait exprimé d’une gestion pragmatique des situations, c’est au manager de proximité qu’il revient de prendre les décisions et de réaliser les arbitrages. Toutefois, il ne le fait pas seul ou, à tout le moins, ne doit pas le faire seul. En effet, notamment en cas de blocages ou de conflits, les personnes interrogées soulignent la nécessité d’informer et d’impliquer les services fonctionnels (services juridiques et ressources humaines).

24
2.3.3 Quelle attitude adopter en cas de port de signes visibles ?
Comme le montrent les graphiques présentés ci-après, les personnes interrogées dans l’enquête estiment que cette question du fait religieux peut être abordée avec les personnes concernées et que, si le cas se présente, il est opportun de demander aux personnes d’adapter leur comportement pour prendre en compte les règles et contraintes de l’entreprise. De même, la majorité des personnes estiment qu’en situation de représentation de l’entreprise, une personne doit se présenter de manière neutre.
71 % des personnes pensent qu’il convient de demander aux personnes portant des signes religieux de les enlever avant de se rendre chez un client, si le management estime que cela pourrait nuire à la relation commerciale.
71 %
75 %65 % des managers pensent qu’il faut aborder la question des signes religieux lors d’un entretien d’embauche avec une personne qui en porte. Même si ce chiffre est en baisse par rapport à l’étude 2016 (75 %), il reste significativement élevé.

Pensez-vous qu’il convienne de demander aux personnes portant des signes religieux de les enlever avant de se rendre chez un client si le management estime que cela pourrait nuire à la relation commerciale ?
Pensez-vous que lors d’un entretien d’embauche il convient de préciser à une personne visiblement pratiquante quelles sont les règles de l’entreprise en matière de pratique religieuse au travail ou de port de signes religieux ?
Pensez-vous qu’une personne qui doit représenter l’entreprise dans une situation commerciale ou de communication externe doit se présenter sans signes religieux même si elle en porte habituellement ?
Pensez-vous qu’une personne qui doit représenter l’entreprise dans une situation de communication interne doit se présenter sans signes religieux même si elle en porte habituellement ? 70,8 %
29,2 %
55 %
45 %
71 %
29 %
65 %
35 %
Pensez-vous que l’entreprise devrait pouvoir inscrire dans son règlement intérieurun principe de neutralité religieuse et l’imposer à ses salariés ?
Si cela est souhaité par certains salariés pratiquants,pensez-vous que l’entreprise doive :
oui non
35%65 %
Adapter l’emploi du temps(pause pour prières, départ plus tôt...) 6 %
Permettre des vacances (RTT, joursde vacances) pour des motifs religieux 10 %
Proposer des menus religieux à la cantine 5 %
Mettre en place un lieu de prière 3 %
Rien de tout cela 84 %
Permettre des départs en pauselorsqu’un salarié doit aller prier 4 %
25

26
Zoom sur le fait religieux au travail en Europe (et au-delà)
D e 2013 à 2017 inclus, les cinq études réalisées ont désigné le port de signes religieux comme le fait ou comportement le plus fréquent. Cette année encore le port de signes
religieux sur le lieu de travail représente 22 % des faits observés. Nous ne disposons pas de chiffres au niveau européen ou plus largement au niveau international. Toutefois l’étude des décisions de justice au niveau européen ou à celui des pays donne à penser que cette question des signes religieux est celle qui a l’actualité, notamment juridique, la plus importante.
De fait d’un pays à l’autre, les cas les plus emblématiques des problèmes soulevés par l’expression religieuse sur le lieu de travail sont, dans leur grande majorité, liés au port de vêtements, notamment le voile musulman, ou de symboles, notamment la croix chrétienne. Les cas Nur aux USA en 2001, Azmi en Grande-Bretagne en 2007, Baby Loup, Ebrahimian et Bougnaoui en France en 2013, 2015 et 2017, Achbita en Belgique en 2017, ou encore les cas de salariées portant le voile dans une parfumerie en Allemagne en 2003, dans une blanchisserie Suisse en 2016 ou dans un établissement privé de santé en Norvège en 2017 sont tous des cas liés au port de vêtements musulmans par des femmes et ont donné lieu à des arrêts de justice au niveau nationaux ou européens qui ont été largement commentés dans leurs pays respectifs et bien souvent au-delà. L’Islam n’est toutefois pas la seule religion concernée ici. En effet au Canada le cas Deepender Lumba en 2005 a impliqué un salarié Sikh refusant d’ôter son turban pour porter un casque de chantier. Plusieurs affaires célèbres impliquent des salariés portant non pas des vêtements mais des objets religieux, notamment des croix. C’est le cas pour les affaires Eweida et Chaplin en Grande Bretagne sur lesquelles la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’était prononcée en 2013. Plusieurs situations impliquant des salariés Sikh portant le Kirpan au travail et dans des lieux publics (poignard rituel) ont également fait débat au Canada. En mai 2017 le port de cet instrument a été interdit en Italie (il l’était déjà en France et au Danemark notamment) suite à une condamnation d’un pratiquant de cette religion qui avait sorti son poignard en public.

27
Outre le port de vêtements ou d’objets religieux les cas qui produisent des décisions de justice renvoient également à la question des temps de travail et des absences ainsi qu’à celle de la discrimination. Dès 1981 en France le cas Balki avait vu le licenciement d’une salariée absente sans autorisation pour assister à une fête religieuse être confi rmé par la justice. A l’inverse le cas Nuñez au Costa Rica a vu un salarié adventiste et refusant de venir travailler le samedi obtenir gain de cause. Dans le cas Mc Keever en Irlande une salariée protestante s’estimant discriminé à l’embauche en raison de sa religion a également obtenu réparation.
La quasi-totalité des pays de l’OCDE dispose d’une législation concernant la question religieuse et la protection de la liberté de culte. Depuis 2000 de nombreux pays européens ont, sur cette question, fait évoluer leur législation. Nous pouvons citer par exemple la Roumanie en 2006, la Pologne en 2008 ou encore la Grande-Bretagne en 2010. Comme c’est le cas pour ces trois exemples, il s’est agi la plupart du temps d’affi rmer le principe de liberté de culte et de renforcer la lutte contre les discriminations. Concernant les questions relatives au fait religieux au travail, l’initiative a le plus souvent été laissée à la jurisprudence nationale et/ou européenne. A ce titre le cas de la France fait exception relative puisque la Loi Travail de 2016 donne aux entreprises une possibilité d’encadrer et de limiter l’exercice de la liberté religieuse au travail.

Pensez-vous que lors d’un entretien d’embauche il convient de préciser à une personne visiblement pratiquante quelles sont les règles de l’entreprise en matière de pratique religieuse au travail ou de port de signes religieux ?
Etes-vous génés au travail par la pratique religieuse de certains de vos collègues
La pratique religieuse peut-elle avoir un effet sur les relations entre collègues
52 %
26 %
22 %
Etes-vous gênés au travail par la pratique religieuse de certains de vos collègues ?
2015
8 %
92 %
19 %
82 %
2016
21 %
79 %
2017
2016
30 %
25 %
33 %
24 %45 % 43 %
2017
oui non de certains
oui, un effet positifnon
oui, un effet négatif
ouinon
28
3.1 La place de la religion entre collègues
Chacune des éditions de notre enquête le démontre : la religion n’est pas un sujet tabou au travail. Lorsqu’une personne est pratiquante, il est courant que son entourage professionnel le sache.
Si 33 % (30 % en 2016) des personnes interrogées dans l’étude considèrent que la religion peut avoir des effets négatifs au travail, elles sont 43 % (45 % en 2016) à considérer que la pratique religieuse d’une personne n’a aucun effet sur le travail et les relations au travail et 24 % (25 % en 2016) à penser que cette pratique a un effet positif.
L’impact du fait religieux sur les relations au travail03

Avez-vous été témoin de pratiques discriminatoires à l’encontre d’autres personnes en raison de leur croyance et/ou de leur pratique religieuse ?
2015
22 %
78 %
22 %
78 %
2016
21,5 %
78,5 %
2017
2015 2016 2017
26 %
74 %
20 %
80 %
20 %
80 %
ouinon
29
3.2 La question de la discrimination
Les chiffres de notre enquête concernant la question de la discrimination religieuse au travail démontrent une certaine stabilité par rapport à ceux des enquêtes 2015 et 2016. Ils montrent en effet, comme les années précédentes, que près de 20 % des personnes interrogées disent avoir observé des situations de discrimination. 20 % des pratiquants disent par ailleurs en avoir subies.
21,5 % des personnes
interrogées disent avoir observé
des situations de discrimination.
20 % des pratiquants disent
avoir subi des situations de
discrimination.
Pensez-vous être ou avoir été victime de discrimination liée à votre pratique religieuse ?

Quelle est, selon-vous, la définition du principe de laïcité ?
30
La définition de la laïcité à laquelle se réfèrent les personnes interrogées dans l’enquête est protéiforme. Si elle vise avant tout la neutralité de l’État à l’égard des religions ainsi que la défense de la liberté de culte, elle intègre aussi des dimensions davantage liées aux limites de l’exercice de cette liberté : • cantonnement de la pratique religieuse à la sphère privée, • interdiction de la pratique religieuse dans des lieux qui accueillent
du public,• etc.
Laïcité et fait religieux au travail04
8 %
6 %
4 %
9 %
11 %
14 %
La neutralité de l'Etatvis-à-vis des religions
La défense de la libertéde culte
La neutralité des employésdes services publics
Le cantonnement de la pratique religieuseà la sphère privée
L'interdiction de la pratique religieusedans les services publics
L'interdiction de la pratique religieuse dans les lieuxqui accueillent du public y compris les entreprises
L'interdiction de la pratique religieusedans l'espace public
L'interdiction pour les religions de prendre partaux débats politiques
31 %
17 %

Pensez-vous que l’entreprise devrait pouvoir inscrire dans son règlement intérieurun principe de neutralité religieuse et l’imposer à ses salariés ?
Si cela est souhaité par certains salariés pratiquants,pensez-vous que l’entreprise doive :
oui non
35%65 %
Adapter l’emploi du temps(pause pour prières, départ plus tôt...) 6 %
Permettre des vacances (RTT, joursde vacances) pour des motifs religieux 10 %
Proposer des menus religieux à la cantine 5 %
Mettre en place un lieu de prière 3 %
Rien de tout cela 84 %
Permettre des départs en pauselorsqu’un salarié doit aller prier 4 %
Pensez-vous qu’il faille interdire les signes religieux visibles au travail ?
Pensez-vous qu’il faille interdire les signes religieux visibles dans les espaces publics (parcs, rues, etc.) ?
Pensez-vous que le principe de neutralité doit s’appliquer de la même manière au travail en entreprise que dans les administrations publiques ?
Pensez-vous que l’Etat devrait tenir compte de l’avis des organisations religieuses lorsqu’elles interviennent sur des questions de société ?
Pensez-vous qu’il soit normal que les organisations religieuses donnent leur avis sur les questions de société ?
32 %
67 %
19 %
45 %
62 %
68 %
33 %
81 %
55 %
38 %
31
Comme lors des éditions précédentes, les personnes interrogées dans le cadre de notre enquête 2017 reconnaissent la place des religions dans le débat public. Elles reconnaissent également, d’une part la nécessité de la neutralité du rapport entre l’État et les religions, et d’autre part, la place des religions en tant que partie à part entière de la société.

32
MÉTHODOLOGIE
1 397questionnaires en ligne ont été remplis entre avril et juin 2017.Après suppression des questionnaires non exploitables, 1 093 questionnaires ont été pris en compte pour cette étude.
Population cible : cadres et managers (environ 4,3 millions de personnes en France).La marge d’erreur retenue est de 2,96 % et le taux de confiance associé à cette marge est de 95 %.
Le questionnaire a été administré en ligne et compte 98 questions. Le traitement des réponses a été effectué à l’aide du logiciel SPSS.
des répondants exercent une responsabilité managériale d’une équipe pouvant aller
de 3 à 250 personnes.
63 %ont un statut de cadre sans
exercer directement de fonction managériale.
37 %
L’échantillon compte
48 % d’hommes
52 % de femmes

33
Zone d’activité professionnelle des répondants :
Zone urbaine : 83 %Zone urbaine sensible : 8 %
Zone rurale : 9 %
L’influence des différentes caractéristiquesde l’échantillon présentées ci-dessus (genre, appartenance religieuse, fonction exercée, degré de croyance et de pratique, etc.) a été systématiquement testée et prise en compte dans l’analyse des résultats, notamment à l’aide des tests couramment utilisés pour cela(Chi-deux, Odd-ratio Cramer, Cronbach).
Qu’ils soient ou non croyants et pratiquants, les répondants ont les appartenances religieuses suivantes :
CatholiquesProtestants
JuifsMusulmans
BouddhistesAthées
Agnostiques
49 %3 %
8 %
27 %11 %
1 %
2 %



www.grouperandstad.fr Retrouvez-nous sur : @GroupRandstadFR
Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin.
À proposde l’Institut RandstadCréé en 2005, l’Institut Randstad pour l’Égalité des Chances et le Développement Durable est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il agit en faveur de la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour dynamiser l’égalité des chances dans la vie professionnelle.L’Institut Randstad soutient le développement de la politique du groupe Randstad en France, en matière de diversité et d’égalité des chances.