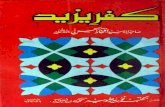djalal & yazid
-
Upload
abdeilah-btp -
Category
Documents
-
view
72 -
download
0
Transcript of djalal & yazid
-
Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire
En vue dobtention du diplme DIngnieur dtat en Travaux Publics
Propos par CTTP
Ministre de lEnseignement
Suprieur et de la Recherche
Scientifique
Ecole Nationale des Travaux Publics
E.N.T.P Kouba. Alger
Encadr par :
M r GHEFFAR.A
Elabor par:
HAMAIDI ZOURGUI DJELLOULBEGHDAOUI YAZID
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
Remerciement
Nous tenons remercier tout ceux et celle qui de loin ou de prs a contribu finaliser ce modeste travail que j espre sera a la hauteur de leur engagement.
Je cite nommment :
A notre encadreur Mr. GEFFAR,.A pour avoir accepter de
nous prendre en charge.
Nous sommes reconnaissants l ensemble des enseignants
qui ont contribus notre formation avec beaucoup de dvouement et
de comptence.
Les enseignants de l'E.N.T.P en gnral et Mme KALLI,
Mr.Boulaarak en particulier.
Nos remerciements s'adresse galement aux membres du jury
pour l'intrt qu'ils ont port notre travail, et qui nous feront le
plaisir d'apprcier.
En n oubliant jamais les personnes qui ont particips de prs ou
de loin ce modeste travail.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
REMERCIEMENTDIDICACEINTRODUCTION GENERALE.01
Chapitre I Prsentation du projetChapitre I 1 - Prsentation .................................................................................... .....02 Chapitre I 2 objectif de projet ...02 Chapitre II Etude de traficChapitre II 1- introduction...............03 Chapitre II 2- analyse de trafic.............................03
II 3- Donnes de trafic 03 II 4 diffrents type de trafic.03II 5 modle de prsentation de trafic.............04
Chapitre II 6 calcul de la capacit.....................................................05II 7 application au projet....07
Chapitre III Trac en planChapitre III 1 - introduction....09 Chapitre III 2- modernisation du trac en plan........09p
III 3 Rgles respecter dans le trac en plan ..10 Chapitre III 4 les lments du trac en plan 10
III - 5 la vitesse de rfrence16 III 6 choix de la vitesse de rfrence ......16III 7 vitesse de projet ..16treIII 8 devers... ........... .........................16III 9 calcul d axe ..17 III 10 application au projet. ...17
Chapitre IV Profil en longChapitre IV 1 - dfinition ......21 Chapitre IV 2- modernisation du profil en long..........................................21 Chapitre IV 3 Rgles pratiques pour le trac du profil en long ..........................21 Chapitre IV 4 coordination du trac en plan et profil en long22 Chapitre IV 5 Paliers et dclivits ..22Chapitre IV 6 Raccordements en profil en long ...........................23Chapitre IV 7 - Application au projet . ..25
IV 8- Elments ncessaires au calcul du profil en long26Chapitre IV 9 Dtermination pratiques du profil en long.27Chapitre IV 10 exemple de calcul de profil en long :30Chapitre V Profil en traversChapitre V 1 dfinition ....31 Chapitre V 2 - modernisation du profil en travers.. ....31 Chapitre V 3 les lments du profil en travers. ....31 Chapitre V 4 classification du profil en travers.........................................33 Chap V 5 application au projet........................ .......................................33 Chapitre VI Etude gotechniqueChapitre VI 1- introduction .....34 Chapitre VI 2- rglement algrienne en gotechnique..34Chapitre VI 3- les dfrent essais en laboratoire- 34 Chapitre VI 4 les essais d identification ....35 Chapitre VI 5 condition d utilisation des sols en remblais...36
VI 6 les moyens de reconnaissance.....36
Page
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
Chapitre VII Dimensionnement du corps de chausseChapitre VII 1- introduction37 Chapitre VII 2 principe de la constitution de la chausse.................................... 37 Chapitre VII 3 la chausse...............................................................38 Chapitre VII 4 dfrentes mthodes de dimensionnement40 Chapitre VII 5 application au projet......................................................45
VII 6 - Renforcement de la chausse existante du la RN17C48 Chapitre VIII CubaturesChapitre VIII 1- gnralit...........................................................................................50 Chapitre VIII 2- dfinition...........................................................50 Chapitr e VIII 3- mthode de calcul de cubature..50 Chapitre Chapitre IX Carrefours
IX-1 Introduction :...................................................................................52IX-2-Donnes essentielles pour l amnagement d un carrefour ....52 IX-3- Choix de l amnagement ..................................52 IX-4- Les types de carrefours ...........................53 IX-5- Principes gnraux d amnagements d un carrefour ......55 IX -6- Application au projet ...56
Chapitre X - AssainissementX-1 Introduction ..........................................................57X-2- Drainage des eaux souterraines .......................................57 X-3- dfinition . ...58 X-4- Calculs des dbits.. ......59 X-5- les donnes pluviomtriques.......61 X-6- Application au projet 62 X-7- Le rseau d assainissement du RN17C...68
Chapitre XI SignalisationXI-1- Introduction.......................................................................................72XI-2 - Historique de la signalisation ..................................72XI-3 - Les quipements et la signalisation existants .. ...72 XI-4 - les Dispositifs retenues ...............72 XI-5- Les diffrents types de signalisation ....73 XI-6- Marques sur les routes ...73 XI-7- Les critres de conception de la signalisation .. 74 XI-8 - Application au projet ... ...74
Devis quantitatif et estimatif...75 conclusion.76conclusion gnrale..77 bibliographie annexes photos.
annexes PISTE+
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
Introduction gnrale
E.N.T.P -1- Promotion 2008
Introduction
Pour concrtiser les connaissances techniques acquises pendant le cycle de
formation, l cole nationale des travaux publics propose ces lves ingnieurs
l laboration des projets de fin d tude pour l obtention du diplme d ingnieur
d tat en travaux publics.
Le travail qu on va laborer consiste faire la MODERNISATION De la
RN17C sur un tronon de route de 10 km qui se situe dans la wilaya de Sidi bel
Abbs (liaison entre M CID et SFISEF).
Ce projet est propos par le C.T.T.P (organisme National de contrle
technique des travaux publics) et dirig par MR GHEFFAR .A
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE -I- Prsentation du projet
E.N.T.P -2- Promotion 2008
1- Prsentation du projet :
L objectif recherch travers la prsente tude est de raliser une modernisation de la RN17C, qui dbute au niveau de la commune de SFISEF et se termine dans la localit de SIDI ALI BEN YOUB sur un linaire total d environ56 Km.
Dans la prsente tude il sera question d tudier un tronon de 10 kmdbutant dans la localit de M CID (PK46+300). et prenant fin dans la commune de SFISEF (PK57+000)
La RN17C est un axe routier stratgique, assurant la circulation du trafic routier de la rgion bel Abbssienne vers les wilayas de Saida et Tlemcen et les diffrents ples intrieurs de la Wilaya.
2- objectif de projet :
Le projet de modernisation de la RN17C a pour objectif de doter cette route des caractristiques d une route nationale. Cela se concrtisera moyennant les actions suivantes :- L largissement de la chausse revtue une largeur de 7,00m, dote d accotement de 1.80 de large. - L ouverture des fosss en terre (ou btonnes) le long des zones en dblais. - Les Rectifications des virages dont le rayon de courbure ne rpond pas aux normes minimales de scurit. - La Rectification du profil en long au niveau des sommets de cote ou points bas non conformes aux normes. - Le Renforcement de la chausse pour un apport structurel. - Le Traitement des zones inondables. - Le Prolongement d ouvrages d assainissement.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE II Etude de trafic
E.N.T.P Promotion 2008 -3-
1-Introduction : L tude de trafic constitue un moyen important de saisie des grands flux
travers un pays ou une rgion, elle reprsente une partie apprciable des tudes de transport, et constitue paralllement une approche essentielle de la conception des rseaux routiers. Cette conception repose, pour partie stratgie, planification sur la prvision des trafics sur les rseaux routiers, qui est ncessaires pour : - Apprcier la valeur conomique des projets. - Estimer les cots d entretiens. - Dfinir les caractristiques techniques des diffrents tronons. 2-Analyse de trafics :
Pour connatre en un point et un instant donn le volume et la nature du trafic, il est ncessaire de procder un comptage. Ces derniers ncessitent une logistique et une organisation appropries.
Les analyses de circulation sur les diverses artres du rseau routier sont ncessaires pour l laboration des plans d amnagement ou de transformation de l infrastructure, dtermination des dimensions donner aux routes et apprciation d utilit des travaux projets.
Les lments de ces analyses sont multiples : Statistiques gnrales. Comptages sur routes (manuels, automatique). Enqutes de circulation.
3-Donnes de trafic : On se basant sur les rsultats des comptages, et des prvisions effectues en
2007 par le service concern, pour estimer le trafic a l horizon on fait une projection jusqu a l an 2023, tout en sachant que la dure de vie de notre amnagement estimer a 15 ans, et sa mise en service est prvue pour l anne 2008 On a :TJMA (2007) = 4500 V/jL anne de mise en service : 2008 Le pourcentage (%) des poids lourds Z = 20%Taux d accroissement annuel du trafic = 4%
4-Diffrents types de trafic : a) Trafic normal :
C est un trafic existant sur l ancien amnagement sans prendre compte du nouveau projet.
b) Trafic dvi : C est le trafic attir vers la nouvelle route amnage, et empruntant sans
investissement d autres routes ayant le mme destination, la drivation de trafic n est qu un transfert entre les diffrent moyen d atteindre la mme destination.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE II Etude de trafic
E.N.T.P Promotion 2008 -4-
c) Trafic induit : C est le trafic qui rsulte de :
Des nouveaux dplacements des personnes qui s effectuer et qui en raison de la mauvaise qualit de l ancien amnagement routier ne s effectuaient pas antrieurement ou s effectuaient vers d autres destinations. Une augmentation de production et de vente grce l abaissement des cots de production et de vente due une facilit apporte par le nouvel amnagement routier.
d) Trafic total : Le trafic sur le nouvel amnagement qui sera la somme du trafic induit et du
trafic dvie. 5-Modles de prsentation de trafic :
Dans l tude des projections des trafics, la premire opration consiste dfinir un certain nombre de flux de trafic qui constitue des ensembles homognes en matire d volution ou d affectation.
Les diverses mthodes utilises pour estimer le trafic dans le futur sont : Prolongation de l volution passe. Corrlation entre le trafic et des paramtres conomiques. Modle gravitaire. Modle de facteur de croissance.
a) Prolongation de l volution passe :La mthode consiste extrapoler globalement au cours des annes venir,
l volution des trafics observs dans le pass. On tablit en gnral un modle de croissance du type exponentiel. Le trafic Tn l anne n sera :
TJMAh = (1+ ) n T J M A0Ou : T J M A0 : est le trafic l arrive pour origine.
: est le taux de croissance. b) Corrlation entre le trafic et des paramtres conomiques :
Elle consiste rechercher dans le pass une corrlation entre le niveau de trafic d une part et certains indicateurs macro-conomiques :
Produit nationale brute (PNB). Produits des carburants, d autres part, si on pense que cette corrlation restera vrifier dans le taux de croissance du trafic, mais cette mthode ncessite l utilisation d un modle de simulation, ce qui sort de cadre de notre tude.
c) Modle gravitaire : Il est ncessaire pour la rsolution des problmes concernant les trafics
actuels au futur proche, mais il se prte mal la projection
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE II Etude de trafic
E.N.T.P Promotion 2008 -5-
d) Modle de facteurs croissance :Ce type de modle nous permet de projeter une matrice origine-
destination. La mthode la plus utilise est celle de FRATAR qui prend en considration
les facteurs suivants : Le taux de motorisation des vhicules lgers et utilisation. Le nombre d emploi. La population de la zone.
Cette mthode ncessite des statistiques prcises et une recherche approfondie de la zone tudier
Conclusion : Pour notre cas, nous utilisons la premire mthode, c est dire la mthode
prolongation de l volution passe vu sa simplicit et parce qu elle intgre l ensemble des variables conomiques de la rgion. 6-Calcul de la capacit :
a) Dfinition de la capacit : La capacit et le nombre de vhicule qui peut raisonnablement passer sur
une direction de la route ou deux directions avec des caractristiques gomtriques et de circulation qui lui sont propre durant une priode bien dtermine, la capacit s exprime sous forme d un dbit horaire.
b) La procdure de dtermination de nombre de voies : Le choix de nombre de voies rsulte de la comparaison entre l offre et la
demande, c est dire, le dbit admissible et le trafic prvisible l anne d exploitation.
Pour cela il est donc ncessaire d valuer le dbit horaire l heure de pointe pour la vingtime anne d exploitation.
Calcul de TJMA horizon :La formule qui donne le trafic journalier moyen annuel l anne
horizon est : TJMAh = (1+ ) n TJMA0
TJMA0 , , n : sont dfinies prcdemment.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE II Etude de trafic
E.N.T.P Promotion 2008 -6-
Calcul de trafic effectif : C est le trafic traduit en units de vhicules particuliers (U.V.P) en
fonction de : - Type de route et de l environnement : Pour cela on utilise des coefficients d quivalence pour convertir les PL en (U.V.P).
Le trafic effectif donn par la relation : Teff = [(1 Z) + PZ] . TJMAhTeff : trafic effectif l horizon en (U.V.P/j) Z : pourcentage de poids lourds (%). P : coefficient d quivalence. pour le poids lourd, il dpend de la nature de la route.
Environnement E1 E2 E3 Routes bonnes caractristique
2-3 4-6 8-12
Routes troites 3-6 6-12 16-24
Dbit de point horaire normal : Le dbit de point horaire normal est une fraction du trafic effectif
l horizon, il est donn par la formule : Q = n
1 Teff
n1 = 0.12 en gnral
Q : est exprim en UVP/h . Dbit horaire admissible :
Le dbit horaire maximal accept par voie est dtermin par application de la formule :
Qadm (uvp/h) = K1.K2. Cth K1 : coefficient li l environnement. K2 : coefficient de rduction de capacit. Cth : capacit thorique par voie, qu un profil en travers peut couler en
rgime stable.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE II Etude de trafic
E.N.T.P Promotion 2008 -7-
Calcule de nombre de voies :- Cas d une chausse bidirectionnelle :
On compare Q Qadm et en prend le profil permettant d avoir : Qadm Q
- Cas d une chausse unidirectionnelle : Le nombre de voie par chausse est le nombre le plus proche du rapport S. Q / Qadm Avec :
S : coefficient dissymtrie en gnral = 2/3 Qadm : dbit admissible par voie
7-Application au projet :On a : TJMA (2007) =4500v/j ;
Z = 20% ;
= 4% ;
n = 15 ans
P = 4 (Environnement E2) ;
K1 = 0.85; K2 = 0.99
TJMAh = TJMAo(1+ )n
TJMA2008 =4500 (1 + 0.04)1
TJMA2008 =4680 v/j
TJMA2023 = 4680 (1 + 0.04)15
TJMA2023 =8428 v/j
Teff = (1 Z) + P.Z TJMAh
Teff = (1-0.20) + 4 0.20 8428
Teff = 13485 uvp/j
Q = (1/n).Teff
Q2023 = 0.12 13485 =1618 uvp/h
Q2023 = 1618 uvp/h
Ce dbit prvisible doit tre infrieur au dbit maximal que notre route peut offrir, c est le dbit admissible. Q Qadm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE II Etude de trafic
E.N.T.P Promotion 2008 -8-
Q K1 K2 Cth
Cth Q / (K1 K2)
Catgorie C1 et Environnement E2 alors K1=0.85 et K2 =0.99
Cth 1618 / (0.85 0.99)
Donc: Cth 1923 uvp/h
Qadm= K1. K2. Cth Cth= 2000 uvp/hQadm = 0, 85 x0.99 x 2000 Qadm=1683 uvp/h
-Le nombre des voies :
N= S x (Q/Qadm)
Avec S=2/3
n= (2 Q)/ (3 K1 K2 Cth)
n= (2 1618)/(3 0.85 0.99 2000)
N = (2/3) x (1618/1683) = 0.64 1
Donc on prend : N = 1 voie /sens
TJMA2007 (v/j)
TJMA2008 (v/j)
TJMA2023 (v/j)
Teff(uvp/j)
Q (uvp/j) N
valeur 4500 4680 8428 13485 1618 1
ConclusionD aprs le calcul de capacit de la route, on constate que son profil en travers est de:
Chausse de 1 voie par sens (2 3.50 m) et1.8m d accotement. Donc bidirectionnelle.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -9
1- Introduction :Lors de l laboration de tout projet routier l ingnieur doit commencer par
la recherche de l emplacement de la route dans la nature et son adaptation la plus rationnelle a la configuration du terrain. en tenant compte des obligations suivantes : - une obligation de scurit, lie au trac, la qualit des vhicules admis et l adhrence de la surface de roulement. - une obligation de confort, pour diminuer la fatigue des usagers et la nuisance. - une obligation d conomie globale, en vue de rduire le cot social des accidents et d exploitation. - dans le cas de l tude de projet routiers, il faudrait tenir compte des variationsconsidrables relatives aux caractristiques des vhicules admis aux conditions de surface de la chausse et aux conditions ambiantes ( mtrologie, visibilit etc).
les projets seront donc bass sur un certain nombre de paramtres physiquesmoyens choisis de telle sorte que la scurit et le confort soient assurs dans des conditions normale d utilisation .
2 Modernisation du trac en plan :
Le trac existant prsente une chausse rtrcie ainsi qu une faible sinuosit sur la grande partie de l itinraire, ce dernier est Caractris par des successions d alignements et courbes de faibles rayons qui varient entre R=30m et R=80m.
L amnagement et la modernisation consistent l amlioration du trac en augmentant les rayons des virages, largissement de la plate forme (chausse, accotement) tout ceci est pour garantir une vitesse de rfrence de 80km/h .
Pour assurer les meilleures conditions d excution, l largissement de la chausse sera Ralis le plus souvent du cot des dblais, par contre et pour prserver les constructions et les pistes d accs l largissement se fera du cot de remblais.
Vu le rapprochement des courbes et le relief caractris par une importante sinuosit, A partir du PK 51+600 au PK 53+000 une succession de virages en S (14 virages) sur un linaire d environ 1400m sont sources d accidents sur cette section de la RN17C . A cet effet une dviation est conue dont l objectif la suppression des virages. Cette dviation permet un gain en linaire d environ 400m (gain en CEV).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -10
3-Rgles respecter dans le trac en plan :Pour faire un bon trac dans les normes avec un minimum de cot, on doit
respecter certaines conditions savoir :- L adaptation du trac au terrain naturel afin d viter les grands mouvements de terre (les terrassements important).- Se raccorder au rseau routier existant. - Eviter de passer sur des terrains agricoles et zones forestiers. - Chercher le meilleur trac possibles vitant le maximum les proprits prives.- Eviter le franchissement des oueds afin d viter le maximum d ouvrages d art et cela pour des raisons conomiques, si le franchissement est obligatoire viter les ouvrages biais.- Eviter les sites qui sont sujet a des problmes gologiques (prsence de failles ou des matriaux presentant des caractristiques trs mdiocres)
4-les lments du trac en plan : 4-1 Alignement :
Bien qu en principe la droite soit l lment gomtrique le plus simple, son emploi dans le trac des routes est restreint.
La cause en est qu il prsente des inconvnients, notamment : -Eblouissement caus par les phares. -Monotonie de conduite qui peut engendrer des accidents. -Apprciation difficile des distances entre vhicules loigns. -Mauvaise adaptation de la route au paysage.
Il existe toute fois des cas ou l emploi d alignement se justifie : - En plaine ou des sinuosits ne seraient absolument pas motives. - Dans des valles troites. - Le long de constructions existantes. - Pour donner la possibilit de dpassement. - La longueur des alignements dpend de : - La vitesse de base, plus prcisment de la dure du parcours rectiligne.- Des sinuosits prcdentes et suivant l alignement. - Du rayon de courbure de ces sinuosits. Lmin = T.VB T= 5 sec VB : Vitesse en (m /s)Lmax = T.VB T= 60 sec
4-2 Arcs de cercle : Trois lments interviennent pour limit les courbures :
-Stabilit des vhicules en courbe. -Visibilit en courbe. -Inscription des vhicules longs dans les courbes de rayon faible.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -11
Stabilit en courbe :Dans un virage R un vhicule subit l effet de la force centrifuge qui tend provoqu une instabilit du systme, afin de rduire l effet de la force centrifuge en incline la chausse transversalement vers l intrieure du virage (viter le phnomne de drapage ) d une pente dite devers exprime par sa tangente .
Rayon horizontal minimal absolu :
)dmax ft(127VrminRH
2
Ainsi pour chaque Vr on dfinis une srie de couple (R, d).
Rayon minimal normal :
)maxdft(127)20Vr(RHN
2
Le rayon minimal normal (RHN) doit permettre des vhicules dpassant Vr de 20 km/h de rouls en scurit
Rayon au dvers minimal :C est le rayon au dvers minimal, au-del duquel les chausses sont dverses vers l intrieur du virage et tel que l acclration centrifuge rsiduelle la vitesse Vr serait quivalente celle subit par le vhicule circulant la mme vitesse en alignement droit. Dvers associ dmin = 2.5%.
mind2127VrRHd
2
Rayon minimal non dvers : Si le rayon est trs grand, la route conserve son profil en toi et le divers est ngatif pour l un des sens de circulation ; le rayon min qui permet cette disposition est le rayon min non dvers (Rhnd ).
)mind'f(127VrRHnd
2
f = 0.07 cat 3 f = 0.075 cat 4-5 Application au projet :
Pour notre projet qui situ dans un environnement 2 (E2), et class en catgorie1 (C1) Avec une vitesse de base de 80km/h. Donc d aprs le rglement des normes algriennes B40, on a le tableau suivant :
paramtres symboles valeurs Vitesse de base (km/h) Rayon horizontal minimal (m) Rayon horizontal normal (m) Rayon horizontal dvers (m) Rayon horizontal non dvers (m)
VB RHm (7%) RHN (5%) RHd (2.5%) RHnd (-2.5%)
80 250 450 1000 1400
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -12
4-3 Sur-largeur : Un long vhicule 2 essieux, circulant dans un virage, balaye en plan une bande
de chausse plus large que celle qui correspond la largeur de son propre gabarit.
Pour viter qu une partie de sa carrosserie n empite sur la voie adjacente, on donne la voie parcourue par ce vhicule une surlargeur par rapport sa largeur normale en alignement. S = L2 / 2R L : longueur du vhicule (valeur moyenne L = 10 m) R : rayon de l axe de la route.
Rayon (m) Sur-largeur (m) 40 1.25 45 1.00 60 1.00 80 0.5 100 0.5 160 0.25 180 0.25
4-4Courbe de raccordement :
Une trace rationnelle de route moderne comportera des alignements, des arcs de cercle et entre eux, des tronons de raccordement de courbure progressive, passant de la courbure 0 (R = infini) l extrmit de l alignement la courbure 1/R au dbut du cercle du virage.
4-4-1 Rle et ncessit du CR : L emploi du CR se justifie par les quatre conditions suivantes :
- Stabilit transversale du vhicule. - Confort des passagers du vhicule. - Transition de la forme de la chausse. - Trac lgant, souple, fluide, optiquement et esthtiquement satisfaisant.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -13
4-4-2 Types de courbe de raccordement :Parmi les courbes mathmatiques connues qui satisfont la condition dsirer d une variation continue de la courbure, on a retenu les trois courbes suivantes :
A -Parabole cubique :Cette courbe est d un emploi trs limit vu le maximum de sa courbure vite
atteint (utilise dans les tracs de chemin de fer).
B -Lemniscate :Courbe utilise pour certains problmes de tracs de routes trfle
d autoroute sa courbure est proportionnelle la longueur de rayon vecteur mesur partir du point d inflexion.
C -Clothode :La clothode est une spirale, dont le rayon de courbure dcrot d une faon
continue ds l origine ou il est infini jusqu au point asymptotique ou il est nul. La courbure de la clothode, est linaire par rapport la longueur de l arc. Parcourue vitesse constante, la clothode maintient constante la variation de l acclration transversale, ce qui est trs avantageux pour le confort des usagers.
Expression mathmatique de la clothode :Courbure K linairement proportionnelle a la longueur curviligne L.
K = C. LOn pose: 1/ C = A2 L. R = A2
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -14
Elments de la clothode :
(fig1)
- : Angle entre alignement -SL :La corde la clothode -T : Grande tangente - :L angle polaire - R : Ripage - L :longueur de clothode -XM : Abscisse du centre de cercle - KA: dbut de clothoide-R: Rayon de virage - KE : Fin de clothoide - : Angle de tangente
S0
S1
S2
M
R R
KE2 KE
KA2 KA
R R T
L/2
XM
ELEMENT DE LA CLOTHOIDE
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -15
Le choix d une clothode doit respecter les conditions suivantes :
C-1 -Condition optique : La clothode doit aider la visibilit de la route en amorant le virage, la
rotation de la tangente doit tre 3 pour tre perceptible l il. R A R/3REGLE GENERALE (B40) : R 1500m R =1m (ventuellement 0.5m ) L = RR241500 R 5000m L R/9 R 5000m R = 2.5 m L = 7.75 R
C- 2 -Condition confort dynamique : Cette condition Consiste a limite pendant le temps de parcoure t du
raccordement, la variation, par unit de temps, de l acclration transversale. dR
VrVrL 1271822
Vr : vitesse de rfrence en (Km /h). R : rayon en (m).
d : variation de dvers. C-3 -Condition de gauchissement :
Cette condition pour objet d assurer la voie un aspect satisfaisant en particulier dans les zones de variation des dvers. Elle s explique dans le rapport son axe. L l . d . VR Avec :L : longueur de raccordement. l :Largeur de la chausse.
d : variation de dvers.
Nota : La vrification des deux conditions relatives au gauchissement et au confort
dynamique, peut ce faire l aide d une seule condition qui sert limiter pendant le temps de parcours du raccordement, la variation par unit de temps, du dvers de la demie -chausse extrieure au virage.Cette variation est limite 2%.
36Vrd5L
Pour le confort et la scurit des usagers, la vitesse de rfrence ne devrait pas varier sensiblement entre les sections diffrentes, un changement de celle-ci ne doit tre admis qu en concidence avec une discontinuit perceptible l usager (traverser d une ville, modification du reliefect).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -16
5- La vitesse de rfrence :La vitesse de rfrence (Vr) est une vitesse thorique, qui sert dterminer
les Valeurs extrmes des caractristiques gomtriques et autres intervenant dans l laboration du trac d une route.6- Choix de la vitesse de rfrence :
Le choix dpend de : -Type de route. -Importance et genre de trafic (volume, structure). -Topographie. (Degr de difficult du terrain). -Conditions conomiques d excution et d exploitation. 7- Vitesse de projet:
La vitesse de projet VB est la vitesse la plus leve pouvant tre admise en chaque point de la route, compte tenu de la scurit et du confort dans les conditions normales. -Remarque : La vitesse de rfrence choisie dans notre projet et de Vr = 80 km/h.
8- Devers :Pour l vacuation des eaux pluviales au droit des alignements et assurer la
stabilit dynamique des vhicules en courbe, la route ncissite un dvers qui est par dfinition la pente transversale de la chausse.
Application au projet :
Rayon (m) 250 290 300 350 500 650 1400 Devers associ (%) 7 6.35 6.22 5.65 4.58 3.58 2.5 Rayon (m) 1500 Devers associ (%) 2.5
Le tableau des dfrents rayons horizontaux utiliss dans la trac en plan :
Rayon (m) 250 290 300 350 500 650 1400 1500 Longueurs (m)
126.52 338.52 87.34 60.51 46.93 261.13 84.86 19.12
Vr (km /h) 80 80 80 80 80 80 80 80
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -17
9- Calcul D axe :Le calcul d axe est l opration de base par le quelle toute tude d un projet
routier doit Commencer. Elle consiste au calcul d axe point par point du dbut de tronon jusqu la fin de celui-ci.
Le calcul d axe se faire partir d un point (A) prcise dont on connat ces coordonnes,Il ne peut se faire qu aprs avoir dterminer le couloir par le quel la route doit passer. 9-1 Dmarche a suivre :1-Tout calcul d axe doit suivre les tapes suivantes : 2-Calcul de gisements.3-Calcul de l angle entre alignements. 4-Calcul de la tangente T. 5-Calcul de la corde SL.6-Calcul de l angle polaire . 7-Vrification de non chevauchement.8-Calcul de l arc de cercle.9-Calcul des coordonnes des points singuliers.
9-2 Gisement :Le gisement d une direction est l angle fait par cette direction avec le nord
gographique dans le sens des aiguilles d une montre.10- Application au projet :
- formules et mthodes de calculs :Rayon R1 = 250 m
S0 (3902500,72 ; 744686,52) S1 (3902489,17 ; 745801,49)S2 (3902656,47 ; 746018,96 )
- Calcul des gisement :
| X | = | XS1 -XS0 | = 11.55
| Y | =| YS1 -YS0 | =1114.97
| X1 | = | XS2 XS1 | = 167.30
| Y1 |= | YS2 YS1 |= 217.47
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -18
s1s0 = )( 22 YX =1115.03 m
s2s1 = )( 2121 YX = 274.37 m
d ou : 01
ssG =400-arctg X
Y = 399.34 grade
12
ssG =arctg 1
1
XY = 41.74 grade
Calcul de l angle :
= 400- 12ssG - 01ssG = 42.4 grade Dtermination de L :
1-Condition optique :
L RR24On a R = 250 < 1500 R = 1
L 125024 = 77.4596m ----------- 1
2- Condition de confort dynamique et de non gauchissement :
L 365 d VB
d = ? d = d (- 2.5 )
RHm = 250 m d = 7 % d = 7 (-2.5) = 9.5 %
L < 365 9.5 80 = 105.5556 m --------- 2
1 et 2 L 105.5556 m . L = A2/R A = LR = 162.4465
On prend : A = 165 m
L = A2/R = 108.900 m.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -19
- Calcul de l angle :
= RL
2 .200 =
25029.108 . 200
avec :
= 13.87 grade
- Vrification de non chevauchement :
=13.87grade/2 =42.4 / 2 = 21.2grade
D ou : / 2 pas de chevauchement .
RL =
2509.108 =0.435600
D aprs le tableau de clothoide on tire les valeurs suivants :
Xm/R = 0.217456440 Xm = 54.36411 m R/R = 0.007893323 R = 1.9733307 m
X/R = 0.433538871 X = 108.384 m Y/R = 0.031518128 Y = 7.879 m
- Calcul de la tangente :
T= Xm + (R+ R) tg( /2) = 142.850 m T=54.36411+(250+1.9733307)tg21.2
T = 141.519 m
- Calcul des Coordonnes S L :
SL = 22 YXAvec :
SL = )879.7(108.384 = 108.67m
- Calcul de := arctg X
Y = 384.108
879.7 = 4.62grade
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE III Trac en plan
E.N.T.P - Promotion 2008 -20
- Calcul de l arc :
b= KE1 K E2b = 200
)2-R(
b = 200
)87.132(42.4250 = 57.54 m
- Calcul des coordonnes des points singuliers :
XKA = XS2 - (s2s1-T) .sin 12SSG KA
YKA = YS2 -( s2s1- T) .cos 12SSG
XKA =3902656.47-(274.36-141.519).sin (41.74) = 3902575.474m
KA YKA =746018.96- (274.36-141.519).cos (41.74) = 745913.6634m
XKE = XKA + SL. sin ( 12SSG - ) KE YKE = YKA + SL. Cos ( 12SSG - )
XKE = 3902575.474-108.67 .sin (41.74 4.62 ) = 3902515.641m KE YKE = 745913.6634- 108.67 .cos (41.74 4.62) =745822.9488m
XKA2 = XS1 + T . sin 01SSG
KA2 YKA2 = YS1 - T. Cos 01SSG
XKA2 = 3902489.17 + 141.519 .sin (399.34) = 3902487.703 m KA2 YKA2 = 745801.49 141.519 .cos (399.34) = 745659.9786 m
XKE2 = XKA2 + SL . sin ( 01SSG + ) KE2 YKE2 = YKA2 - SL . cos ( 01SSG + )
XKE1 =3902487.703 + 108.67.sin (399.34 + 4.62 ) = 3902494.458m KE2
YKE1 =745659.9786 108.67 .cos (399.34 +4.62) = 745551.5188 m
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 21
1-Dfinition :Le profil en long est une coupe longitudinale du terrain suivant le plan
vertical passant par l axe du trac, il est toujours compos d lments de lignes droits inclines (rampes et pentes) et arcs de cercle tangents aux droites, constituant les raccordements verticaux (convexes et concaves). 2- Modernisation du profil en long :
La route l tat actuel comporte des dclivits moyennes localises dans le majeur parti du trac. La modernisation du profil en long consiste adopter des dclivits Rgulires et liminer des ventuels sommets des cotes.
3-Rgles pratiques pour le trac du profil en long :Le cot d une construction routire vari en fonction de son profil en long,
les cots d exploitation des vhicules empruntant la route et le nombre d accident, cet effet, quelques rgles pratiques rgissant celui-ci doivent tre suivies.
Respecter les valeurs des paramtres gomtriques prconiss par les rglements en vigueur. Les sections ou la visibilit de dpassement est assur doivent alterner frquemment avec celles o ne peut pas l tre. Eviter les hauteurs excessives des remblais. Eviter les angles rentrants en dblai, car il faut viter la stagnation des eaux et assurer leur coulement. Un profil en long en lger remblai est prfrable un profil en long en lger dblai, qui complique l vacuation des eaux et isole la route du paysage. Pour assurer un bon coulement des eaux, on placera les zones des dvers nul dans une pente du profil en long. Rechercher un quilibre entre le volume des remblais et le volume des dblais. Assurer une bonne coordination entre le trac en plan et le profil en long.Il faut viter de placer un point bas du profil en long dans une zone de dblai et en sens inverse, il est contre indiqu de prvoir un remblai dans un point haut.
Comme pour les tracs en plan, la combinaison des alignements et des courbes en profil en long doit obir certaines rgles, notamment :
Eviter les lignes brises constitues par de nombreux segments de pentes voisines, les remplacer par un cercle unique, ou une combinaison de cercle et d arcs courbe progressive de trs grand rayon. Remplacer deux cercles voisins de mme sens par un cercle unique. Adapter le profil en long aux grandes lignes du paysage.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 22
4-coordination du trac en plan et profil en long :
Pour tablir une bonne route, il ne faut pas sparer l tude du profil en long celle du trac en plan, mme si considr isolment, sont la fois conformes aux normes et aux rgles de l art, et convenablement adapt au terrain. Comme l axe de la route est une courbe dont l aspect en perspective dpend de la combinaison du trac en plan et du profil en long, il faut aussi que le trac en plan et le profil en long de la route aient fait l objet d une tude d ensemble assurant leur coordination. Celle-ci pour objectif principal d assurer aux usagers :
De distinguer la chausse et les obstacles qu il pourrait trouver sur chemin suffisamment l avance (condition de visibilit). De distinguer clairement les dispositions des points singuliers (changeurs, carrefours, aires de services etc.) De prvoir de loin l volution du trac. D apprcier l adaptation au terrain, sans tre abus par des trompe-l il, ou gns par des coudes, des brisures, des discontinuits dsagrables.
Pour viter les dfauts de rsultats d une mauvaise coordination du trac en plan profil en long, les rgles suivantes sont suivre :
si le profil en long est convexe, augmenter le ripage du raccordement introduisant une courbe en plan. - Avant un point haut, amorcer la courbe en plan (rotation de l axe visible de 2 3 ) Lorsque le trac en plan et le profil en long sont simultanment en courbe, faire concider le plus possible raccordements en plan et en profil en long et porter les rayons de raccordement vertical 6 fois au moins le rayon en profil en plan.
5-Paliers et dclivits :Les paliers sont des sections de routes horizontales. Un vritable palier est
viter, parce que l coulement longitudinal des eaux y est mal assur et une humidit nfaste la chausse tend s y maintenir pendant toute la mauvaise saison.
La dclivit est la tangente de l angle que fait le profil en long avec l horizontale. Elle est dnomme rampe si la route s lve dans le sens du kilomtrage, et pentes dans le cas contraire.
a -Dclivit minimale : Il est recommand d vit les pentes infrieures 1%, et surtout 0.5% et ceci dans le but d viter la stagnation des eaux. Dans les longues sections en dblais on prend Imine= 0.5% pour que les ouvrages de canalisation ne soient pas profonds.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 23
b- Dclivit maximale : La dclivit maximale est accepte particulirement dans les courtes
distances infrieures 1500m, cause de : - La rduction de la vitesse et l augmentation des dpenses de circulation par la suite (cas de rampe Max). - L effort de freinage des poids lourds est trs important qui fait l usure de pneumatique (cas de pente max.).
Tableau de valeur de la dclivit maximale (B 40)
Vb(km/h) 40 60 80 100 120 140 Imax(%) 8 7 6 5 4 4
6-Raccordements en profil en long : Les changements de dclivits constituent des points particuliers dans le
profil en long. Ce changement doit tre adouci par l amnagement de raccordement circulaire qui y doit satisfaire les conditions de visibilit et de confort. On distingue deux types de raccordements :
6-1 Raccordements convexes (angle saillant) :Les rayons minimums admissibles des raccordements paraboliques en angles
saillants, sont dtermins partir de la connaissance de la position de l il humain, des obstacles et des distances d arrt et de visibilit. Leur conception doit satisfaire aux conditions suivantes :- Condition de confort. - Condition de visibilit.
a- Condition de confort : Lorsque le profil en long comporte une forte courbure de raccordement, les
vhicules sont soumis une acclration verticale insupportable, qu elle est limite (0.3m /s2 soit g /40), le rayon de raccordement retenir sera donc gal :
v2 /Rv
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 24
b- Condition de visibilit : Elle intervient seulement dans les raccordements des points hauts comme
condition supplmentaire a celle de condition confort. Il faut que deux vhicules circulant en sens opposs puissent s apercevoir a
une distance double de la distance d arrt au minimum. Le rayon de raccordement est donn par la formule suivante :
)hh(2h(h2DR
1010
21
V
D1 : Distance d arrt (m) h0 : Hauteur de l il (m) h1 : Hauteur de l obstacle (m)
6-2 raccordements concaves ( angle rentrant) :Dans le cas de raccordement dans les points bas, la visibilit du jour n est
pas dterminante, plutt c est pendant la nuit qu on doit s assurer que les phares du vhicule devront clairer un tronon suffisamment long pour que le conducteur puisse percevoir un obstacle, la visibilit est assurer pour un rayon satisfaisant la relation :
)0.035d(1.5d'R
1
21
V
a- Condition d ordre esthtique : Une grande route moderne doit tre conue et ralise de faon procurer
l usager une impression d harmonie, d quilibre et de beaut pour cela il faut viter de donner au profil en long une allure sinusodale en changent le sens de dclivits sur des distances courtes, pour viter cet effet on imposera une longueur de raccordement minimale et (b>50) pour des dvers d < 10% spcial changeur .
%d50100minRv
d : Changement de dvers (%) Rvmin : Rayon vertical minimum (m)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 25
7. Application au projet : Pour le cas de la RN17C, on a respect les paramtres suivants (selon le B40) :
RN17C
Vitesse de rfrence (km/h) 80
Rayon en angle saillant(Rv)
Minimal absolu Rvm 4500
Minimal normal Rvn 10.000
Rayon en angle rentrant(Rv)
Minimal absolu Rvm2
2400
Minimal normal Rvn2
3000
Dclivit maximale imax (%) 6
-Tableau des rayons verticaux utiliss dans le profil en long du projet
Rayon convexe (m)
Longueur Total (m)
Rayon concave (m)
Longueur Total (m)
4500 24.11 2400 16.8 5000 19.89 3000 115.77 8000 5.53 4000 32.30 15000 5.93 7000 100.30 3500 135.33 2200 81.30
2500 21.31
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 26
8- Elments ncessaires au calcul du profil en long :Aprs la projection des pentes du profil en long on procde au calcul des
coordonnes des points de tangence en coordonnes rectangulaires.
S
B
B A
G P1 A T T P2
R
O
Avec : A et B : extrmits du raccordement. T : tangente de part et d autre du sommet. G : milieu de raccordement situ sur la variante. B : Bissectrice. P, Q : deux points connus sur P1 et P2.O: centre du cercle de rayon R. X : distance entre le sommet et un point P sur P1. S : sommet ou point de changement de dclivit. L : distance entre les deux points P et Q.
P Q
X
TG
T
L
B
Figure Schma de la courbe du profil en long
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 27
9- Dtermination pratiques du profil en long :
Dans les tudes des projets, on assimile l quation du cercle :
X 2 + Y 2 -2 R Y = 0.
l quation du parabole X 2 -2 RY= 0 R
xY2
2
Pratiquement, le calcul des raccordements se fait de la faon suivante :
On Donne les coordonnes (abscisse, altitude) les points A, D.
On Donne La pente P1 de la droite (AS)
On Donne la pente P2 de la droite (DS)
On Donne le rayon R
A D
T S m n
B J P1 X1 C
X2 P2 A
D
x L-x
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 28
9-1- dtermination de la position du point de rencontre (s) :
On a :
ZA=ZD +L p2 , m= ZA - ZA ZD = ZA +Lp1 , n= ZD- ZD
Les deux triangles A SA et SDD sont semblables donc :
m/n = x/(L-x) x= m.3. L/(n +m)
XS = X+ XA S ZS = p1X+ZA
9-2 calcul de la tangente :
T= R/2 (p1 + p2)
On prend (+) lorsque les deux pentes sont de sens contraires, on prend (-) lorsque les deux pentes sont de mme sens.
La tangente (T) permet de positionner les pentes de tangentes B et C.
XB=XS-T Xc=XS+T B C ZB=ZS-T p1 Zc=ZS+T p2
9-3- projection horizontale de la longueur de raccordement :
LR=2T
9-4- calcul de la flche :
H=T2/2R
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 29
9-5- Calcul de la flche et l altitude d un point courant M sur la courbe :
HX=x2/2R
M ZM=ZB+X p1-X2/2R
Calcul des cordonnes du sommet de la courbe (T) Le point J correspond au point le plus hauts de la tangente horizontale.
X1=Rp1 X2= Rp2
XJ=XB-R.p1 J ZJ=Z B+X1.p1-X12/2R
Dans le cas des pentes de mme sens le point J est en dehors de la ligne de projet et ne prsente aucun intrt par contre dans le cas des pentes de sens contraire, la connaissance du point (J) est intressante en particulier pour l assainissement en zone de dblai, Le partage des eaux de ruissellement se fait a partir du point du J, c est dire les pentes des fosss descendants dans les sens J (A) et J(D).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE IV Profil en long
E.N.T.P - - Promotion 2008 30
10- exemple de calcul de profil en long :
A p1S
BR p2
C
R= 4500m D
S= 0 S= 200 S = 475 A S D
Z= 430.83 Z= 428.67 Z= 425.98
calcul des pentes :
P1 = Z1/ S1= 1.08 % P2 = Z2/ S2= 0.98 %
calcul des tangentes :
T=R/2 ( p1 - p2 ) = 2.25m calcul des flches :
H= T2/2R= 5.625 10-4m calcul des coordonnes des points de tangentes :
SB= XS-T = 197,75 B ZB= ZS+ T.P1 = 431.1
SC= XS+ T = 202.25 C ZC= ZS -T.P2 = 426.465 Calcul de la longueur de raccordement :L = 2 T'= 2 2.25 = 4.50m
Remarque:La conception de la ligne rouge est attache garder et rcuprer la chausse
existante, c est la raison pour laquelle on est conduit optimiser le trac sur les deux tronons suivants ;de PK1516.625 au PK 5541.625 , de PK 6716.625 au PK 10714.886
Les calculs sont faits l aide du logiciel (PISTE+) et vrifis manuellement et les rsultats du calcul sont joints dans l annexe.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE V Profil en travers
E.N.T.P - Promotion 2008 31-
1-Dfinition :Le profil en travers est une coupe transversale mene selon un plan vertical
perpendiculaire l axe de la route projete. Un projet routier comporte le dessin d un grand nombre de profils en travers,
pour viter de rapporter sur chacun de leurs dimensions, on tablit tout d abord un profil unique appel profil en travers contenant toutes les dimensions et tous les dtails constructifs (largeurs des voies, chausses et autres bandes, pentes des surfaces et talus, dimensions des couches de la superstructure, systme d vacuation des eaux etc.).
2- modernisations du profil en travers : La route existante prsente un profil en travers caractris par une chausse de largeur variable. En effet La sortie sur site nous a permis, en premier de relev que la largeur de la chausse existante n est pas fixe le long de trac (varie entre 4m et 6m), en second lieu de constater une insuffisance des accotements et leur absences au niveau de certaines sections de la route. La modernisation du profil en travers du tronon en question de RN 17C (lot A)ncessite des solutions dlicates d largissement du profil en travers actuel, mais le cot d largissement est variable le long de l itinraire, il est en fonction des contraintes rencontrs aux bords de la plate forme.
3-Les lments du profil en travers : La chausse :
C est la partie affecte la circulation des vhicules.La largeur roulable :
Elle comprend les sur-largeurs de chausse, la chausse et bande d arrt. La plate forme :
C est la surface de la route situe entre les fosss ou les crtes des talus de remblais, comprenant la chausse et les accotements, ventuellement les terre-pleins et les bandes d arrts.
L assiette :C est la surface de la route dlimite par les terrassements.
L emprise :C est la surface du terrain naturel affecte la route et ses dpendances
(talus, chemins de dsenclavement, exutoires, ect) limite par le domaine public.
Les accotements :En dehors des agglomrations, les accotements sont drass. Ils comportent
gnralement les lments suivants : - Une bande de guidage. - Une bande d arrt. - Une berme extrieure.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE V Profil en travers
E.N.T.P - Promotion 2008 32-
Le terre-plein central :Il s tend entre les limites gomtriques intrieures des chausses. Il
comprend : - Les surlargeurs de chausse (bande de guidage). - Une partie centrale engazonne, stabilise ou revtue.
Le foss :
C est un ouvrage hydraulique destin recevoir les eaux de ruissellement provenant de la route et talus et les eaux de pluie.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE V Profil en travers
E.N.T.P - Promotion 2008 33-
4. Classification de profil en travers : On distingue deux types de profils :
- Profil en travers courant ; - Profil en travers type.
Le profil en travers courant : Le profil en travers courant est une pice de base dessine dans les projets
des distances rgulires (10, 15, 20,25m).qui servent calculer les cubatures.
Le profil en travers type :C est une pice de base dessine dans les projets de nouvelles routes ou
l amnagement de routes existantes. Il contient tous les lments constructifs de la future route, dans toutes les situations (en remblais, dblais).ou mixte.
5. Application au projet :Aprs l tude de trafic, le profil en travers type retenu pour la RN 17C sera
compos d une chausse bidirectionnelle. Les lments du profil en travers type sont comme suit : -Chausse : 3.5 x 2 = 7.00 m -Accotement : 2 x 1,80m =3,60m -Plate forme : =10,60m
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VI Etude gotechnique
E.N.T.P - - Promotion 2008 34
1- Introduction:La reconnaissance de sol utilisant diffrents quipements et instrumentation
sur terrain ou au laboratoire est un moyen pour le gotechnicien, afin de mieux connatre les sols et surtout le massif de sol tudi appel supporter dans des bonnes conditions le projet.
La gotechnique routire est la branche de la gotechnique qui traite des problmes intressant la route, dans toutes ses parties. Elle tudie notamment :les remblais, les fondations de chausse, la construction des diverses couches de la chausse.
La gotechnique routire a pour objectif : -De dfinir les caractristiques des sols qui serviront d assise pour le corps de Chausse. - tablir le projet de terrassement. -Dtecter des zones d emprunts de matriaux de construction pour les remblais et le corps de chausse.
2- Rglementation algrienne en gotechnique :La gotechnique couvre un grand champ qui va de la reconnaissance des sols
au calcul et l excution des ouvrages en passant par les essais de sols en laboratoire ou en place (in situ).
Les normes algriennes adopt dans le domaine de la gotechnique sont relatives aux modes opratoires et des essais de sol couramment raliss en laboratoire dans le cadre des tudes gotechnique, par exemple :-les essais en place (essais pressiomtrique, pntromtre statique ou dynamique.etc.)-les essais de laboratoire : essais d identification et de classification.
3- Les diffrents essais en laboratoire :Les essais faits en laboratoire sont : Analyse granulomtrique. Equivalent de sable. Limites d atterberg. Essai PROCTOR. Essai CBR. Essai Los Angles. Assai Micro Deval. Le calcul de l paisseur des chausses souples ncessitera des Prlvements
destins des essais CBR en laboratoire. Les essais seront fait diffrentes teneurs en eau nergies de compactage,
afin d apprcier la stabilit du sol aux accidents lors des terrassements, ces essais seront prcds d essai PROCTOR.
La classification des sols rencontrs sera utile et ncessitera la dtermination des limites d Atterberg.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VI Etude gotechnique
E.N.T.P - - Promotion 2008 35
4- Les essais d indentification :
-Analyse granulomtrique :Est un essai qui a pour objet de dterminer la rpartition des grains suivant
leur dimension ou grosseur. Les rsultas de l analyse granulomtrique sont donns sous la forme d une courbe dite courbe granulomtrique et construite sur un graphique, cette analyse se fait en gnrale par un tamisage.
-Equivalent du sable:Le but de l essai de l quivalent est de dterminer la qualit d impuret (ou
pour dterminer le pourcentage d impuret dans un chantillon) soit des lments argileux ultra fins ou des limons.
-Limites d atterberg: Limite de plasticit (WP) et limite de liquidit (WL), ces limites
conventionnelles sparent les trois tats de consistance du sol : WP spare l tat solide de l tat plastique et WL spare l tat plastique de l tat liquide ; les sols qui reprsentent des limites d Atterberg voisines, c est--dire qui ont une faible valeur de l indice de plasticit. IP = WL WP, est donc trs sensibles une faible variation de leur teneur en eau.
-Essai Proctor: L essai PROCTOR est un essai routier, il consiste tudier le comportement
d un sol sous l influence de compactage et une teneur en eau, il a donc pour but de dterminer une teneur en eau afin d obtenir une densit sche maximale lors d un compactage d un sol prvu pour l tude, cette teneur en eau ainsi obtenue est appele optimum PROCTOR .
-Essai C.B.R : C est un essai qui a pour but d valuer la portance du sol en estimant sa
rsistance au poinonnement, afin de pouvoir dimensionner le corps de chausse et orienter les travaux de terrassements. L essai consiste soumettre des chantillons d un mme sol au poinonnement, les chantillons sont compacts dans des moules la teneur en eau optimum (PROCTOR modifier) avec 3 nergies de compactage 25 c/c ; 55 c/c ; 10 c/c et imbib pendant 4 jours.
-Essai Los Angeles: Cet essai a pour but de mesurer la rsistance la fragmentation par chocs des
granulats utiliss dans le domaine routier, et leur rsistance par frottements rciproques dans la machine Los Angles .
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VI Etude gotechnique
E.N.T.P - - Promotion 2008 36
-Essai Micro Deval: L essai a pour but d apprcier la rsistance l usure par frottements
rciproques des granulats et leur sensibilit l eau.
5- Condition d utilisation des sols en remblais :Les remblais doivent tre constitues de matriaux provenant de dblais ou
d emprunts ventuels. Les matriaux de remblais seront exempts de : -Pierre de dimension > 80 mm -Matriaux plastique IP > 20% ou organique. -Matriaux glifs. On vite les sols forte teneur en argile. Les remblais seront rgls et soigneusement compactes sur la surface pour laquelle seront excuts.
Les matriaux des remblais seront tals par couche de 30 cm d paisseur en moyenne avant leurs compactages. Une couche ne devra pas tre mise en place et compacte avant que la couche prcdente n ait t rceptionne aprs vrification de son compactage.
6- Les Moyens De Reconnaissance : Les moyens de reconnaissance du sol pour l tude d un trac routier sont
essentiellement : l tude des archives et documents existants. Les visites de site et les essais in site Les essais de laboratoire.
NOTA: A dfaut de ne pas avoir eu le rapport gotechnique nous n avons pas pu traiter la partie gotechnique l application de notre projet.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 37
1- Introduction :
On entend par dimensionnement des chausses l paisseur donner une chausse. Elle doit tre suffisante pour qu elle ait une dure convenable, et non surabondante pour viter les dpenses superflues.
Pour cela la qualit de la construction des chausses, passe d abord par une bonne reconnaissance du sol support et un choix judicieux des matriaux utiliser, lui permettant de rsister aux agression des agents extrieurs et aux surcharges d exploitation.
La chausse doit permettre la circulation des vhicules dans les conditions de confort et de scurit voulue. Si le corps de chausse se repose sur un sous-sol prsentant une portance insuffisante. On est donc amen apporter sur le sol naturel une paisseur quelque fois importante de matriaux choisis dont la qualit va crotre au fur et mesure qu on se rapproche de la surface de la chausse car les matriaux seront soumis pression fort au fur et mesure qu il se rapproche de la surface de roulement.
Le calcul et la justification des paisseurs des diffrentes couches de la structure de chausse retenue, sont fixs en fonction des paramtres fondamentaux qui sont : L environnement de la route. Le trafic. La nature du sol support. Les matriaux choisis La dure de vie de la chausse
2- Principe de la constitution de la chausse :La chausse est essentiellement un ouvrage de rpartition des charges
roulantes sur le terrain de fondation. Pour que le roulage s effectue rapidement, srement et sans usure exagre du matriel, il faut que la surface de roulement ne se dforme pas sous l effet :
De la charge des vhicules. Des chocs. Des intempries. Des efforts tangentiels dus l acclration, au freinage et au drapage.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 38
3-La chausse :3-1Dfinition : Au sens gomtrique : la surface amnage de la route sur laquelle circule les vhicules. Au sens structurel : l ensemble des couches des matriaux superposes qui permettent la reprise des charges. 3-2 diffrentes catgories de chausse :
les chausses classiques (souples et rigides) les chausses inverses (mixtes ou semi-rigides)
Chausse :
BB : bton bitumineuxGB : grave bitume GT : grave traitG.N.T : grave non trait
3-2-1 Chausse souple : La chausse souple est constitue de deux lments constructifs :
- Les sols et matriaux pierreux granulomtrie tale ou serre. - Les liants hydrocarbons qui donnent de la cohsion en tablissent des liaisons souples entre les grains de matriaux pierreux. La chausse souple se compose gnralement de trois couches diffrentes :
B.B
G.T Sol support
Bton de cimentG.T Sol support
B.B
G.N.T Sol support
B.B G.B G.T Sol support
Structuresouple
Structure semi-rigide Structurerigide
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 39
a. Couche de roulement (surface) :La couche de surface est en contact direct avec les pneumatiques des
vhicules et les charges extrieures. Elle a pour rle essentiel d encaisser les efforts de cisaillement provoque par la circulation. Elle est en gnrale compose d une couche de roulement qui a pour rle : - D impermabiliser la surface de chausse. - D assurer la scurit (par l adhrence) et le confort des usages (diminution de bruit, bon uni).
La couche de liaison a, pour rle essentiel, d assurer une transition, avec les couches infrieures les plus rigides.
b. Couche de base :Elle reprend les efforts verticaux et repartis les contraintes normales qui en
rsultent sur les couches sous-jacentes.
c. Couche de fondation :Elle a le mme rle que celui de la couche de base.
d. Couche de forme : Elle est prvue pour reprendre certains objectifs court terme.
- Sol rocheux : joue le rle de nivellement afin d aplanir la surface ;- Sol peu portant (argileux teneur en eau leve) : Elle assure une portance -suffisante court terme permettant aux engins de chantier de circuler librement. Actuellement, on tient compte d amliorer de la portance du sol support long terme, par la couche de forme.
Couche De Surface Couche de roulement. Couche de liaison.
Corps De Chausse
Couche de base. Couche de fondation. Sous couche (ventuellement.) Couche de forme (ventuellement.)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 40
3-2-2 chausses semi-rigides:On distingue :
Les chausses comportant une couche de base (et quelques fois une couche de fondation) traite au liant hydraulique (ciment, laitier, granulat,...) La couche de roulement est en enrob hydrocarbon et repose quelque fois par l intermdiaire d une couche de liaison galement en enrob strictement minimale doit tre de 15 cm. Ce type de chausse n existe l heure actuelle qu titre exprimental en Algrie (quelque kilomtre) : par contre, il constitue une partie importante des rseaux routiers trangers renforcs.
Les chausses comportant une couche de base ou une couche de fondation en sable gypseux.
3-2-3 chausses rigides :Elles sont constitues d une dalle de bton de ciment, ventuellement arme
(correspondant la couche de surface de chausse souple), reposant sur une couche de fondation qui peut tre un grave stabilis mcaniquement, un grave trait aux liants hydrocarbons ou aux liants hydrauliques. Ce type de chausse est pratiquement inexistant en Algrie
4- Diffrentes Mthodes de dimensionnement :Pour la dtermination de l paisseur de corps de chausse, il faut commencer
par l tude du sol. Les formules utilises sont empiriques et/ou rationnelles, et bases sur : -La dtermination de l indice portant du sol. -Apprciation du trafic composite. -Utilisation d abaque ou formule pour dterminer l paisseur de chausse. On distingue deux mthodes : Les mthodes empiriques, et semi empiriques. ces mthodes s appuient sur trois paramtres : -La force portante : Obtenue par les diffrents essais gotechniques. -Le trafic : Charge par voie, pression de gonflage et rptition des charges ; -Caractristiques mcaniques des diffrents matriaux constituant les couches
On peut citer :
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 41
a) Mthode C.B.R (California Bearing Ratio) :
C est une mthode (semi empirique), elle se base sur un essai de poinonnement sur un chantillon de sol support en compactant les prouvettes de (90 100 ) de l O.P.M. les abaques qui donnent l paisseur e des chausses en fonction des pneus et du nombre de rptitions des charges, tout en tenant compte de l influence du trafic.
L paisseur de la chausse, obtenue par la formule CBR amliore, correspond un matriau bien dfini (grave propre bien gradu). Pour ce matriau, le coefficient d quivalence est gal 1.
Et pour les qualits diffrentes, il faudra utiliser le coefficient (ei), tel que :e = ai ei
ai : coefficient d quivalence de chacun de matriau utiliser. Les coefficients d quivalence pour chaque matriau.
MATERIAUX UTILISEES COEFFICIENT D EQUIVALLENCE Bton bitumineux enrob dense 2.00 Grave bitume 1.70 Grave ciment grave laitier 1.50 Sable ciment 1.00 1.20 Grave concasse ou gravier 1.00 Grave roule grave sableuse T.V.O 0.75 Sable 0.50 Grave bitume 1.60 1.70 Tuf 0.60
b) Mthode A.A.S.H.O :Cette mthode empirique est base sur des observations du comportement, sous
trafic des chausses relles ou exprimentales. Chaque section reoit l application d environ un million des charges roulantes qui permet de prciser les diffrents facteurs :
L tat de la chausse et l volution de son comportement dans le temps. L quivalence entre les diffrentes couches de matriaux. L quivalence entre les diffrents types de charge par essai. L influence des charges et de leur rptition.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 42
c) Mthode de ASPHALT INSTITUTE :
Base sur les rsultats obtenus des essais AASHO on prend en considration le trafic composite par chelle de facteur d quivalence et utilise un indice de structure tenant compte de la nature des diverses couches. L paisseur sera dtermine en utilisant l abaque de l asphalt institute.
d) Mthode du catalogue des structures :
Catalogue des structures type neuf est tabli par SETRA Il distingue les structures de chausses suivant les matriaux employs (GNT,
SL, GC, SB). Il considre galement quatre classes de trafic selon leur importance, allant de
200 1500 Vh/J. Il tient compte des caractristiques gotechniques du sol de fondation. Il se prsente sous la forme d un jeu de fiches classes en deux paramtres de
donnes : -Trafic cumule de poids lourds la 20 me anne Tj. -Les caractristiques de sol (Sj).
Dtermination de la classe de trafic :
Tableau n 1Classe de trafic Trafic poids lourds cumule sur 15 ans T1 T 7.3 105
T2 7.3 105 T 2 105
T3 2 106 T 7.3 106
T4 7.3 106 T 4 107
T5 T 4 107
Le trafic cumul est donn par la formule suivante : Te = Tpl 1+ (1+ )n+1 / . 365 Tpl : trafic poids lourds l anne de mise en service.
: taux d accroissement annuel.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 43
Dtermination de la classe du sol :Tableau n 2 :
Classe de sol Indice C.B.R S1 25-40 S2 10-25 S3 05-10 S4
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 44
g) Mthode du catalogue de dimensionnement des chausses neuves :L utilisation de catalogue de dimensionnement fait appel aux mmes
paramtres utiliss dans les autres mthodes de dimensionnement de chausses : trafic, matriaux, sol support et environnement.
Ces paramtres constituent souvent des donnes d entre pour le dimensionnement, en fonction de cela on aboutit au choix d une structure de chausse donne.
La Mthode du catalogue de dimensionnement des chausses neuves est une mthode rationnelles qui se base sur deux approches : - Approche thorique. - Approche empirique.
La dmarche catalogue :
Trafic (campagne de comptage, enqute.)
Ressources en matriaux climat
Etudes gotechniques
Dtermination du niveau de rseau
Dtermination de la classe de trafic PL l anne de mise en service (TPi)
Dtermination de la classe du sol support de chausse (Si)
Choix d une ou plusieurs variantes de structures de dimensionnement
Dtermination de la structure optimale de dimensionnement
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 45
5-APPLICATION AU PROJET :
On a: PL = 20%; = 4%; CBR = 10 TJMAh = TJMAo (1+ ) n
TJMA2008 =4500 (1 + 0.04)1
TJMA2008 =4680 v/j
TJMA2023 = 4680 (1 + 0.04)15
TJMA2023 =8428 v/j
NPL 2023= 936 (1 + 0.04)15 = 1686 PL/j.
NPL 2023= 843 PL/j/sens
5-1-La mthode CBR :
5
)10N50log75)(P(100
CBRIe
843100 ( 6.5)( 75 50 log )10 35.78 cm
10 5e
e = 35.78 cm Donc : e 36 cm
Lorsque le corps de chausse est compos par des diffrents matriaux, on utilise le coefficient d quivalence de chaque matriau.
n
1i
ii e.ae
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 46
On propose les matriaux suivants pour chaque couche Couche de roulement a1 = 2 : bton bitumineux Couche de base a2 = 1.5 : grave bitume Couche de fondation a3 = 1 : grave concasses e = 6 2 + 1.5 10 + 1 15 = 42 cm
donc paisseur relle est de 6 (BB) + 10(GB) + 15 (GC)= 31 cm
BB : 6 cm GB : 10 cm
GC : 15 cm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 47
5-2 - Mthode du catalogue de dimensionnement des chausses neuves :
Dtermination du type de rseau : On a : TJMA0 =2250 v/j/sens 1500 v/j /sens.
La route principale prsentant intrt conomique et stratgique. Donc on est dans le rseau principal de niveau 1 (RP1).
Choix des structures types par niveau de rseau principal :
D aprs le catalogue de dimensionnement notre choix se fixe sur une structure de type : GB/GNT
Dtermination de la classe de trafic :
Zone climatique : II
Dure de vie : 15ans, taux de d'accroissement : 4 %.
N 0 = 2340 v/j/sens. (2008 c est l anne de mise en service).
N PL = 2340 20% = 468 PL/ j / sens.
Donc TPL = 468 PL/ j / sens.
D aprs le classement donn par le catalogue des structures, notre trafic est class en TPL 4.
Classe TPLi pour RP1 :
150 TPL3 300 TPL4 600 TPL5 1500 TPL6 3000 TPL7 6000
PL/ j /sens
Dtermination de la portance de sol support de chausse :Le sol doit tre class selon la valeur de CBR de densit Proctor modifi maximal.
On a : CBR =10.
D aprs le catalogue, l ordre de portance de sol est de : S2.
Choix de la couche de roulement :Le choix de la couche de roulement est fait en fonction du niveau de rseau
principal comme suit :RP1 : 6BB 8BB pour les structures traites au bitume.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 48
Pour notre projet ; on prend 6BB (TPL4 1500 v/j /sen D aprs les fiches du catalogue on a une structure comme suit :
5- 3 - Conclusion :
Couches CBR Catalogue du dimensionnementRoute Nationale17C
C.Roulement 6 BB 6BB C.base 10 GB 15GB C.fondation 15 GC 35GC
Le choix du corps de chausse d aprs le tableau rcapitulatif, nous remarquons que la mthode du catalogue de dimensionnement des chausses neuves nous a donn des paisseurs plus grandes que la mthode CBR. Pour cela et il y a aussi des autres raisons conomiques, On opte la Mthode CBR.
6- Renforcement de la chausse existante du la RN17C :
Introduction :La chausse se fatigue tout au long de sa dure de service et se dgrade.
Si la chauss atteint un tat de ruine faisant chuter considrablement le niveau de service et mettant en danger la scurit des usagers .il est ncessaire de construire une nouvelle chausse, non pas cot de l ancienne (ce qui revienne trop cher), mais sur l ancienne. Cette nouvelle chausse sera appele renforcement
Quant faut- il renforcer une chausse ?Une chausse peut tre renforce pour diffrentes raisons. Les principales
sont : Augmenter le niveau de confort de faon continu (renforcement entranant une amlioration gnrale de l uni longitudinal, l amlioration du guidage par une correction des dvers selon les nouvelles longueurs des raccordements progressifs, etc.)Assurer l uniformit de l tat de surface entre les largissements et la chausse actuelle. Amliorer la scurit de l axe.
BB : 6cm
GB : 15 cm
GC : 35 cm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VII Dimensionnement du corps de chausse
E.N.T.P - - Promotion 2008 49
Les mthodes de dimensionnement des renforcements : Le renforcement des chausses en paisseur consiste construire sur la
structure existante une ou plusieurs couches .en gnral, on se limite une ou deux couches : soit la couche de surface uniquement, soit la couche de surface et la couche de base. Pour le dimensionnement des renforcements, plusieurs mthodes existent. Cesmthodes sont bases sur l hypothse le plus souvent propre chaque pays ou rgion suivant le type du sol, le trafic et le climat.
Les mthodes de renforcement utilises en Algrie sont : o Mthode du catalogue des structures type de renforcement. o Norme Espagnole 6.3 IC. o Mthode SETRA-LCPC type de renforcement. o Mthode du guide SETI (dec 1978) Pour l utilisation du guide de renforcement, on fait intervenir les coefficients
d quivalence des matriaux neufs et matriaux uss, donc deux paisseursquivalentes.
La diffrence entre l paisseur de la chausse neuve et l paisseur rsiduelle
donne l paisseur du renforcement appliquer. L paisseur de la chausse existante :
5.5BB + 12GB + 15GC
Donc R = Eq Eq ex = 42 30.15= 11.75 cm D o le renforcement de la chausse est de: 6cm en bton bitumineux (BB).
Matriaux ERex Ce Eq exBB 5.5 1.5 8.25 GB 12 1.2 14.4 GC 15 0.5 7.5
Total 32.5 30.15
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VIII Cubatures
E.N.T.P - Promotion 2008 50-
1. Gnralits :La ralisation d un ouvrage de gnie civil ncessite toujours une
modification du terrain naturel sur lequel l ouvrage va tre implant. Pour les voies de circulations ceci est trs visibles sur les profils en longs et
les profils en travers courants. Cette modification s effectue soit par apport de terre sur le sol du terrain
naturel, qui lui servira de support remblai. Soit par excavation des terres existantes au dessus du niveau de la ligne rougedblai.
Pour raliser ces voies il reste dterminer le volume de terre se trouve entre le trac du projet et celui du naturel. Ce calcul s appelle ((les cubatures des terrassements)).
2. Dfinition : Les cubatures de terrassement, c est l volution des cubes de dblais et
remblais que comporte le projet fin d obtenir une surface uniforme et paralllement sous adjacente la ligne projet. Les lments qui permettent cette volution sont :- Les profils en long - Les profils en travers - Les distances entre les profils.
Les profils en long et les profils en travers doivent comporter un certain nombre de points suffisamment proches pour que les lignes joignent ces points diffrents le moins possible de la ligne du terrain qu il reprsente.
3 -Mthode de calcul : Les mthodes que nous allons utiliser sont celle de la moyenne des aires,
c est une mthode simple mais elle prsente un inconvnient de donns des rsultats avec une marge d erreurs, pour tre en scurit on prvoit une majoration des rsultats.
3-1 Description de la mthode :Le principe de la mthode de la moyenne des aires et de calculer le volume
compris entre deux profils successifs par la formule suivant :
V = 6h .(S1 + S2 + 4S0)
Avec : H : hauteur entre deux profils. S0 : surface limite mi- distances des profiles. S1, S2 : surface des deux profils.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE VIII Cubatures
E.N.T.P - Promotion 2008 51-
3-2 Application :La figure ci dessous reprsente le profil en long d un trac donn
S2 S3 S moy
S4 S1
L1 L2 L3 L4
Le volume compris entre les deux profils en travers P1 et P2 de section S1 , S2 sera gale :
V1 = 61L (S1 + S2 + 4Smoy )
Pour un calcul plus simple on considrer que : S moy = 2)( 21 SS
D ou :
V1 = L1. 2)( 21 SS
Entre P1 et P2 V1 = L1. 2)( 21 SS
Entre P2 et PF V2 = L2. 2)0( 2S
Entre PF et P3 V3 = L3. 2)0( 3S
Le volume total V :
V = 2
1L .S1 +2
21 LL .S2 + 232 LL .0 +
243 LL .S3 + 2
4L .S4
REMARQUE:
Les rsultats de calcul des cubatures sont joints en annexe.
P1 P2 PF P3 P4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE X Assainissement
E.N.T.P Promotion 2008 -57-
1-Introduction : L assainissement des voies de circulation comprend l ensemble des
dispositifs prvoir et raliser pour rcolter et vacuer toutes les eaux superficielles et les eaux souterraines, c est dire :
1/ l asschement de la surface de circulation par des pentes transversale et longitudinale, par des fosss, caniveaux, curettes, rigoles, gondoles, etc.
2/ les drainages : Ouvrages enterrs rcoltant et vacuant les eaux souterraines (tranches drainantes et canalisations drainantes).
3/ les canalisations : ensemble des ouvrages destins l coulement des eaux superficielles (conduites, chambre, chemines, sacs, )
2-Drainage des eaux souterraines :2-1 Ncessit du drainage des eaux souterraines :
Les eaux souterraines comprennent d'une part, les eaux de la nappe phratique et d'autre part, les eaux d'infiltrations. Leurs effets sont nocifs si ces eaux dtrempent la plate-forme, ce qui peut entraner une baisse considrable de la portance du sol.
Il faut donc veiller viter : La stagnation sur le fond de forme des eaux d'infiltration travers la chausse. La remonte des eaux de la nappe phratique ou de sa frange capillaire jusqu'au niveau de la fondation.
2-2 Protection contre la nappe phratique :La construction d'une chausse modifie la teneur en eau du sol sous-jacent,
car le revtement diminue l'infiltration et l'vaporation. Si la portance du sol est faible, on pourra :
- Soit dimensionner la chausse en consquence. - Soit augmenter les caractristiques de portance du sol en abaissant le niveau de la nappe phratique ou en mettant la chausse en remblai.
Le choix de l'une ou l'autre de ces trois solutions dpend :- Des possibilits de drainage du sol (coefficient de permabilit). - De l'importance des problmes de gel. - De leurs cots respectifs.
Il n'est pas ncessaire, en gnral, d'assurer le drainage profond d'une grande surface car un bon nivellement et un rseau de drainage superficiel convenablement conu suffisent garantir un comportement acceptable des accotements.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE X Assainissement
E.N.T.P Promotion 2008 -58-
3- DEFINITIONS :3-1 BASSIN VERSANT :
C est un secteur gographique qui est limit par les lignes de crtes ou lignes de rencontre des versants vers le haut, ou la surface totale de la zone susceptible d alimenter en eau pluviale, d une faon naturelle, une canalisation en un point considr.
3-2 Collecteur principal (canalisation) :Conduite principale rcoltant les eaux d autres conduites, dites collecteurs
secondaires, recueillant directement les eaux superficielles ou souterraines.
3-3 Chambre de visite (chemine) : Ouvrage plac sur les canalisations pour permettre leur contrle et le
nettoyage. Les chambres de visites sont prvoir aux changements de calibre, de direction ou de pente longitudinale de la canalisation, aussi qu aux endroits o deux collecteurs se rejoignent.
Pour faciliter l entretien des canalisations, la distance entre deux chambres conscutives ne devrait pas dpasser 80 100m.
3-4 Sacs :Ouvrage plac sur les canalisations pour permettre l introduction des eaux
superficielles. Les sacs sont frquemment quips d un dpotoir, destin retenir des dchets solides qui peuvent tre entran, par les eaux superficielles.
3-5 Gueule de loup, grille d introduction et gueulard :Dispositifs constructifs permettant l coulement de l eau superficielle dans
les sacs.3-6 Les regards :
Ils sont constitus d un puits vertical, muni d un tampon en fonte ou en bton arm, dont le rle est d assurer pour le rseau des fonctions de raccordement des conduites, de ventilation et d entretien entre autres et aussi rsister aux charges roulantes et aux pousses des terres.
3-7 Buses et dalots :En gnral, il est ncessaire de faire passer l eau sous les routes ou moyen de
buses ou dalot. Ceux-ci doivent tre construits en bton ou en maonnerie et conduisent les
eaux dans un bassin d amortissement
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE X Assainissement
E.N.T.P Promotion 2008 -59-
4- Calculs des dbits :
Le dbit d apport est valu l aide de la formule rationnelle suivante : Qa =K.C.I.A
Avec : - K : coefficient de conversion des units (les mm/h en l/s) K = 0.2778. - C : coefficient de ruissellement.- I : l intensit de l averse exprime mm /h - A : superficie du bassin versant.
4-1Coefficient de ruissellement cLe coefficient de ruissellement dpend de l tendue relative des surfaces
impermabilises par rapport la surface draine. Sa valeur est obtenue en tenant compte des trois paramtres suivants : la couverture vgtale, la forme, la pente et la nature du terrain.
Type de chausse Coefficient C Valeurs prises Chausse revtue en enrob 0.8 0.95 0.95 Accotement (sol lgrement permable) 0.15 0.4 0.35 Talus, sol permable 0.1 0.3 0.25 Terrain naturel 0.05 0.2 0.2
4-2Intensit de la pluie:La dtermination de l intensit de la pluie, comprend diffrentes tapes de
calcul qui sont :
a) Hauteur de la pluie journalire maximale annuelle
Pj Pjmoy
cu c
vv2
2
11.exp( . ln( )
(mm)
Pjmoy : pluie journalire moyenne (mm). Cv : Coefficient de variation. ln : Log. Nprien. U : Variable de Gauss. (Fonction de la priode de retour) dont les valeurs
sont donnes par le tableau suivant :
Frquence au dpassement (%) 50 20 10 5 2 1 Priode de retour (annes) 2 5 10 20 50 100 Variable de GAUSS (U) 0 0.841 1.282 1.645 2.057 2.327
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-
CHAPITRE X Assainissement
E.N.T.P Promotion 2008 -60-
tc = 40 8
1 5A LH,,
- RemarqueLes buses seront dimensionnes pour une priode de retour 10 ans. Les ponceaux (dalots) seront dimensionns pour une priode de retour 50 ans. Les ponts dimensionnes pour une priode de retour 100 ans.
b) Calcul de frquence d averse :Pour une dure de (t=15mn=0.25h), La frquence d averse est donne par la
formule suivante :
Pt(%) = Pj(%) . ( )tc b24
Avec : t=0.25 h, b=0.42.Pj : Hauteur de la pluie journalire maximale (mm). b : Exposant climatique. Pt : pluie journalire maximale annuelle. tc : Temps de concentration (heure).
c) Temps de concentration : La dure t de l averse qui produit le dbit maximum Q tant prise gale au
temps de concentration. Dpendant des caractristiques du bassin drain, le temps de concentration est estim respectivement d aprs Ventura, Passini, Giandothi, comme suit : - La formule de VENTURA :1 - Lorsque A < 5 km :
- La formule de PASSINI :
2 - Lorsque 5km A < 25 km :
-La formule de GIADOTTI :3 - Lorsque 25 km A < 200 km :
Tc : Temps de concentration (heure). A : Superficie du bassin versant (km ). L : Longueur de bassin versant (km). P : Pente moyenne du bassin versant (m.p.m). H : La diffrence entre la cote moyenne et la cote minimale (m).
tc = 0,127 . AP
tc = 0,108 3 A L
P.
PDF cr