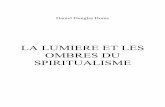Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
-
Upload
laurent-wawa -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
1/20
LON DENIS
Synthsedoctrinale et pratiquedu SPIRITUALISME
sous forme de questionnaire
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
2/20
INTRODUCTION
Cette synthse, ou plutt ce catchisme spiritualiste, na quun mrite : celui dtre conu et disposselon lordre naturel des ides. Lesprit humain, en effet, doit soumettre des rgles sa marcheprogressive et ses procds logiques. Il est dans sa nature de ne slever vers une vrit seconde quelorsquil sest assimil la premire, et de parcourir ainsi toute la chane des principes, sans en omettreun seul anneau. De la sorte, les vrits premires nont pas besoin, pour tre comprises, de celles qui
les suivent. Cest lerreur commise par la plupart des hommes suprieurs, auteurs de livreslmentaires, de leur appliquer la mthode scientifique qui prside leurs conceptions et leurs tudespersonnelles. Daprs eux, comme les vrits les plus complexes embrassent toutes les autres, cest parcelles-l quil faut commencer. Ce procd est videmment scientifique, puisque la science consiste partir dune vrit compose pour arriver une vrit plus simple et plus lmentaire. Toutefois, cenest point l le procd naturel ni la marche instinctive de la raison.Cest pour cela que, destinant ce modeste ouvrage des adolescents ou des adultes non encore initisau spiritualisme doctrinal et exprimental, nous avons prfr commencer par ce problme objectif queltudiant touche pour ainsi dire du doigt : Quest-ce que lhomme ? Les autres catchismes, faits pardes thologiens ou des philosophes, commencent ordinairement par cette question : Quest-ce queDieu? Cest plus solennel, mais beaucoup moins pratique. Il est infiniment plus logique de dbuter parles vrits lmentaires, celles qui se trouvent au niveau des plus humbles intelligences, pour slevergraduellement jusqu la notion de Dieu et aux vrits suprieures, qui sont comme un reflet de laPuissance suprme. Ainsi lascensionniste commence sa course au pied de la montagne, eninterrogeant les fleurs et les mousses qui tapissent les premires pentes, puis, au fur et mesure quilmonte, voit le ciel se rapprocher, lhorizon slargir, et finit par atteindre les cimes que recouvre laneige en sa blancheur immacule. Ainsi ceux qui liront ce livre, dont les dbuts sont simples, mesurequils en tourneront les pages accderont, eux aussi, des rgions plus hautes et finiront par atteindreles transcendants sommets de la mtaphysique ternelle.Nous avons voulu composer ce travail selon la vieille mthode dialogue, par demandes et rponses.Cest la forme la plus populaire et la mieux approprie lesprit des enfants, bien que ce livre, avons-nous dit, soit fait aussi pour les personnes de tous ges, car lhomme reste toujours un enfant, cest--dire ignorant vis--vis des augustes problmes. Les catchismes ont un avantage : ils permettent dunir
la simplicit de la forme la majest des doctrines. Ils sont la fois lhumble ruisseau o vient boire lacolombe, et le lac profond o laigle des grandes altitudes se dsaltre et vient mirer dans les eaux unregard qui fixe le soleil sans sourciller.A notre avis, un tel livre manquait. La doctrine parse dans ses groupes, diffuse dans les rvlationsmdianimiques de tous degrs et de tout nature, avait besoin dtre en quelque sorte rassemble,rcapitule avec simplicit, brivet, clart. LEsprit souffle o il veut, quand il veut, selon lescourants divins de linspiration : cest la loi de toutes les rvlations suprieures faites aux hommes. Ilappartient ceux-ci de runir, de condenser ces vrits fragments, ces rayons disperss, et denrefaire la synthse lumineuse, lenchanement harmonieux. Cest ce que nous avons tent de raliser.Daignent les Esprits ans et bienfaisants qui ont inspir ce travail, illuminer lintelligence de ceux quile liront ! Puisse Dieu en retirer quelque gloire, et les mes droites, chercheuses de vrit, y trouver unpeu de ces lumires de la destine et nous rendent plus aptes accomplir celle-ci en nous faisant plus
rsigns et meilleurs.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
3/20
I. - De lhomme.
1. Que sommes-nous, vous, moi, et nossemblables ? R. - Nous sommes des tres
humains.2. Quest-ce quun tre humain ? R. - Un trecompos dune me et dun corps, cest--diredesprit et de chair.3. Quest-ce donc que lme ? R. - Cest leprincipe de vie en nous. Lme de lhomme :cest un esprit incarn ; cest le principe delintelligence, de la volont, de lamour, lefoyer de la conscience et de la personnalit.4. Quest-ce que le corps ? R. - Le corps estune enveloppe de chair, compose dlmentsmatriels, sujets au changement, ladissolution, la mort.5. Le corps est donc infrieur lme ? R. -Oui, puisquil nest que son vtement.6. Il faut donc mpriser le corps, puisquil estinfrieur lme ? R. - Nullement : rien nestmprisable. Le corps est linstrument dontlme a besoin pour difier sa destine ;louvrier ne doit pas mpriser linstrumentavec lequel il gagne et fait sa vie.7. Comment lme est-elle unie au corps,lesprit la chair ? R. - Par le moyen dun
lment intermdiaire nomm corps fluidiqueou prisprit, qui tient la fois de lme et ducorps, de lesprit et de la chair, et les soude enquelque sorte lun lautre.8. Que veut dire le mot : prisprit ? R. - Cemot veut dire : qui est autour de lesprit. Demme que le fruit est entour dun enveloppetrs mince appele prisperme, lEsprit estenvelopp dun corps trs subtil nommeprisprit.9. Comment le prisprit peut-il unir la chair lEsprit ? R. - En les pntrant et en leur
permettant de se pntrer lun lautre. Leprisprit communique avec lme par descourants magntiques, et avec le corps par lemoyen du fluide vital et du systme nerveuxqui lui sert en quelque sorte de transmetteur.10. Lhomme est donc en ralit compos detrois lments constitutifs ? R. - Oui, ces troislments sont : le corps, lesprit, le prisprit.11. Quand et o commence cette union delme et du cops ? R. - Au moment de laconception, et elle devient dfinitive etcomplte au moment de la naissance.12.Lme est-elle renferme dans le corps, oubien est-ce le corps qui est contenu dans lme
? R. - Ni lun ni lautre. Lme, qui est esprit,ne peut tre renferme dans un corps ; elle
rayonne au dehors, comme la lumire traversle cristal de la lampe. Aucun corps ne peut laretenir matriellement captive ; elle peutsextrioriser.13. Cependant, ny a-t-il pas un point prcisdu corps o lme semble plus
particulirement attache ? R. - Quelquessavants lont cru, parce quils ont confondulme avec le fluide vital. Lme estindivisible, elle est donc tout entire partoutdans notre corps ; mais son action se fait plusparticulirement sentir au cerveau quand onpense, au cur quand on souffre et quon aime.14. Lme se spare-t-elle du prisprit quandelle se spare du corps ? R. - Jamais. Leprisprit est son vtement fluidiqueindispensable. Le prisprit prcde la vieprsente et survit la mort. Cest lui quipermet aux Esprits dsincarns de sematrialiser, cest--dire dapparatre auxvivants, de leur parler, comme cela arriveparfois dans les runions spirites.15. Le prisprit est donc un corps fluidique
semblable notre corps matriel ? R. - Oui :cest un organisme fluidique complet ; cest levrai corps, la vritable forme humaine, cellequi ne change pas dans son essence. Notrecorps matriel se renouvelle chaque instant ;ses atomes se succdent et se reforment : notrevisage se transforme avec lge ; le corpsfluidique, lui, ne se modifie pas matriellement; il est notre vraie physionomie spirituelle, leprincipe permanent de notre identit et de notrestabilit personnelle.16. O tait lme avant de sincarner dans un
corps ? R. - Dans lespace ; lespace est le lieudes Esprits, comme le monde terrestre est lelieu des corps.17. O donc le prisprit a-t-il pris son fluide ?R. - Dans le fluide universel, cest--dire dansla force primordiale, thre : chaque monde ason fluide spcial, emprunt au fluide universel; chaque esprit a son fluide personnel, enharmonie avec celui du monde quil habite etson propre tat davancement.18. Quest-ce que lespace ? R. - Cestlimmensit, cest--dire linfini o se meuventles mondes, la sphre sans limites que notrepense limite ne peut ni concevoir ni dfinir.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
4/20
II. De la rincarnation.
19. Pourquoi lEsprit qui est dans lespacesincarne-t-il dans un corps ? R. - Parce que
cest la loi de sa nature, la condition ncessairede ses progrs et de sa destine. La viematrielle, avec ses difficults, ncessiteleffort, et leffort dveloppe nos puissanceslatentes et nos facults en germes.20. LEsprit ne sincarne-t-il quune seule fois? R. - Non, il sincarne autant de fois que celaest ncessaire pour atteindre la plnitude deson tre et de sa flicit.21.Mais, pour atteindre ce but, la pluralit desexistences est donc ncessaire ? R. - Oui, car lavie de lEsprit est une ducation progressivequi suppose une longue srie de travaux raliser et dtapes parcourir.22. Une seule existence humaine, quand elleest trs bonne et trs longue, ne pourrait-ellesuffire la destine dun Esprit ? R. - non.LEsprit ne peut progresser, rparer quenrenouvelant plusieurs fois ses existences dansdes conditions diffrentes, des poquesvaries, dans des milieux divers. Chacune deses rincarnations lui permet daffiner sasensibilit, de perfectionner ses facults
intellectuelles et morales.23. Vous avez dit que lEsprit se rincarnepour rparer : est-ce donc quil a fait le maldans ses vies prcdentes ? R. - Oui ; lEsprit afait le mal par cela mme quil na pas fait toutle bien quil devait accomplir. Il y a l unelacune quil est ncessaire de combler.24. Quest-ce que le mal ? R. - Cest labsencedu bien, comme le faux est la ngation du vrai,la nuit, labsence de lumire. Le mal na pasdexistence positive ; il est ngatif de sa nature.Faire le bien, cest augmenter ltre en nous ;
lomettre, cest le diminuer.25. Comment les rincarnations nous
permettent-elles de rparer les existencesmanques ? R. - De mme que louvrier qui amal fait sa tche la recommence, ainsi lEspritqui a manqu sa vie la refait.26. Avons-nous des preuves de larincarnation des Esprits ? R. - Oui, dabordcelles que les Esprits eux-mmes nousapportent dans leurs rvlations ; ensuite, lesaptitudes innes de chaque individu, quidterminent sa vocation et lui tracent ici-basles grandes lignes de sa vie. De l lesdiffrences matrielles, intellectuelles et
morales qui distinguent entre eux les hommessur la terre et expliquent les ingalits sociales.
27.La doctrine de la rincarnation est-elle unedcouverte rcente de lesprit humain ? R. -Nullement : lhumanit y a toujours cru ; toutelantiquit la professe ; les grands Initislont enseigne au monde, et Jsus lui-mme yfait allusion dans son vangile.28. Puisque nous avons vcu plusieurs fois,comment se fait-il que nous ne gardions aucunsouvenir de nos vies passes ? R. - Dieu ne lepermet pas, parce que notre libert seraitdiminu par linfluence du souvenir de notrepass. Celui qui met la main la charrue, silveut bien tracer son sillon, ne doit pas regarderen arrire. 29. Par quel phnomne loubli de nos viesantrieures se produit-il ainsi en nous ? R. -Au moment o lesprit se rincarne, cest--dire rentre dans un corps, mesure quil ypntre, ses facults se voilent lune aprslautre ; la mmoire sefface et la consciencesendort. Au moment de la mort, cest lephnomne contraire qui se produit. Au fur et mesure que lEsprit se dsincarne, les facults
se dgagent lune aprs lautre, la mmoire sedvoile, la conscience se rveille. Toutes lesvies antrieures viennent peu peu se rattacher celle que lEsprit vient de quitter.30. Nexiste-t-il aucun moyen de provoquermomentanment le souvenir des anciennesvies? R. - Si, par lhypnose ou sommeilartificiel divers degrs. Des savantscontemporains ont fait et font encore tous lesjours des expriences concluantes qui prouventla ralit des existences antrieures.31. Comment se font ces expriences ? R. -
Lorsquun exprimentateur consciencieux etinstruit a rencontr un sujet apte subir soninfluence magntique, il lendort. Grce cesommeil, la vie prsente est momentanmentsuspendue : alors, le souvenir des viesantrieures, endormi dans les profondeurs de laconscience, se rveille, et le sujet hypnotisrevoit et raconte tout son pass. On a crit deslivres entiers sur ces rvlations prcieuses quinous font connatre les lois de la destine.32. Est-il ncessaire que la vie prsente soitsuspendue, endormie, pour que les vies
antrieures se rvlent ? R. - Oui, comme il estncessaire que le soleil se couche pour que les
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
5/20
toiles, caches dans les profondeurs de la nuit, apparaissent nos yeux.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
6/20
III. Le lieu de la rincarnation.
33. O lEsprit se rincarne-t-il ? R. - Partoutdans lunivers. Tous les mondes sont destins
recevoir la vie sous ses formes varies et tousses degrs.34. Pourquoi sommes-nous rincarns sur laterre ? R. - Parce que la terre, tant un mondergi par la loi du travail et de la souffrance, estun lieu propice lavancement et au progrs delEsprit ltat infrieur.35. Quest-ce que la terre ? R. - Cest un desmondes innombrables qui peuplent lespace ;lun des plus petits par le volume, puisquil naque 10.000 lieues* de circonfrence, maisgrand quand mme par les destines qui syaccomplissent. (* 1 lieue quivaut environ 4 km)36. La terre est-elle immobile dans lespace ?R. - On la cru longtemps, mais le savant etinfortun Galile a prouv quelle tourneautour du soleil. Le soleil est 1.400.000 foisplus gros que la terre et il en est spar par 37millions de lieues.37. Comment la terre accomplit-elle sarvolution autour du soleil ? R. - En unepriode de 365 jours et 6 heures, ce quiconstitue lanne; avec une vitesse de 7 lieues
par seconde, environ 660.000 lieues par jour.En mme temps quelle se meut autour dusoleil, la terre tourne sur elle-mme en 24heures, ce qui fait un jour, et avec une vitessede 6 lieues la minute.38. Comment la terre et les autres globes semaintiennent-ils ainsi dans lespace, cest--dire dans le vide, sans sortir de lorbite quils
parcourent ? R. - Par une force irrsistiblequon appelle la force dattraction. Le soleilattire la terre et les autres plantes : Mercure,Vnus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus,
Neptune, etc., comme laimant attire le fer.Tous les globes sattirent aussi les uns lesautres et se maintiennent dans lespace enraison de leur volume et de la distance qui lesspare. Les plus gros attirent les plus petits.Chaque toile est un soleil; les soleils, leurtour, sont attirs par dautres plus puissants, etentrans ainsi avec leurs plantes et leurssatellites, dans limmensit sans limites. Cestle mouvement perptuel dans lternelleharmonie qui constitue lquilibre universel.39. Ces millions de globes, qui gravitent ainsidans limmensit, sont-ils habits ? R. - Les
uns le sont ; les autres lont t ou le seront unjour : cest ce quon appelle la vie universelle.
40. Ces mondes sont-ils habits par des tressuprieurs, gaux ou infrieurs aux hommes ?R. - La science actuelle ne peut encorerpondre cette question ; mais, daprs lesrvlations des Esprits, nous savons que lesplantes voisines de la Terre sont habites :Mars, par exemple, par des tres un peusuprieurs nous ; Vnus, au contraire, par destres infrieurs. Le soleil est le sjour dEspritssublimes, qui ont atteint les plus hautssommets de lvolution et, du haut de cet astre,comme dun trne de lumire, font rayonnerleur pense et leur action sur les mondes aumoyen des transmissions fluidiques etmagntiques.41. Cependant, certains savants prtendentque la Terre est le seul globe qui runisse lesconditions physiques ncessaire la vie, et,
par consquent, le seul habit ? R. - Tous lesglobes qui roulent dans lespace ont leurstructure particulire et leurs conditionsphysiques diffrentes les unes des autres. Lavie sur chacun de ces mondes sadapte ces
conditions. En calculant les distances desplantes entre elles, leur masse et leur forcedattraction, on a dmontr que leursconditions physiques varient selon leurposition dans le systme solaire, et daprs leurinclinaison sur leurs axes respectifs. On a pucalculer ainsi que Saturne, par exemple, a lamme densit que le bois drable ; que Jupitera presque celle de leau ; que dans Mars lapesanteur des corps est moindre de moiti quesur la Terre, etc. Conclusion : les loisphysiques varient sur chacun de ces globes, et
les lois de la vie y sont en rapport avec cellesde leur nature intime.42. Pourrait-on classer ces diffrentes
plantes, et distinguer les mondes daprs ledegr de vie qui sy manifeste, et selon lavaleur des tres qui les habitent ? R. - Oui, lesEsprits nous ont rvl quil y a cinq classesparmi les mondes habits ou habitables quiflottent dans lespace : ce sont 1 les mondesrudimentaires ou primitifs; 2 les mondesexpiatoires ; 3 les mondes rgnrateurs ; 4les mondes heureux ; 5 les mondes clestes ou
divins.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
7/20
43. Quentend-on par mondes rudimentairesou primitifs ? R. - Les sjours des mesnouvelles. La vie y est simplement initiale. Cesont ces mondes infrieurs que les anciennesreligions nomment : inferi, les Enfers.44. Que sont les mondes expiatoires ? R. -Ceux o le bien et le mal sont en lutteperptuelle, o la vrit et lerreur sont sanscesse en conflit, mais o, en ralit, la sommedu mal lemporte sur celle du bien, enattendant que celui-ci ait le dernier mot de lalutte.45. Quentendez-vous par mondesrgnrateurs? R. - Ce sont des mondes dergnration par la vrit et la justice : ainsisera la Terre lorsque les hommes y seront plusclairs, plus justes et meilleurs.
46. Qui habite les mondes heureux ? R. - DesEsprits qui ont dj ralis une grande partie deleur volution, et qui vivent entre eux danslharmonie de la fraternit et de lamour.47. Quest-ce enfin que les mondes clestes oudivins ? R. - Cest le sjour des Esprits les pluslevs et les plus purs. De l partent lesmissionnaires spirituels que Dieu envoie porterses messages et ses volonts dans toutlunivers. Ces mondes sublimes reprsententles paradis ou lyses dont parlent les religionset que clbrent tous les potes de lhumanit.
48. A quelle classe de ces mondes notre Terreappartient-elle ? R. - Aux mondes expiatoires.49. Qui le prouve ? R. - Les lois physiques quila rgissent et les conditions de vie des tresqui lhabitent.50. Comment cela ? R. - La Terre est inclineprofondment sur son axe ; par l, elle estsujette des variations perptuelles quiamnent de brusques changements detemprature. La diffrence des saisons et desclimats et les perturbations atmosphriques
font de la vie humaine un combat perptuelcontre la nature, la maladie et la mort. Toutcela indique que la Terre est par excellence laplante de lexpiation, du travail et de ladouleur.51.Mais les autres globes ne sont-ils pas dansles mmes conditions physiques, et leur placenest-elle pas la mme dans le monde sidral ?R. - Nullement ; aucun de ces globes na lemme poids ni le mme volume et nest plac la mme distance du soleil qui lchauffe etlclaire. Aucun na non plus la mmeinclinaison sur son axe : Jupiter, par exemple,est dune fixit et dun quilibre inaltrables ;il rgne sa surface une temprature toujoursgale.52. Peut-on dire que sur la Terre, comme dans
tout le monde expiatoire, la somme du mallemporte sur le bien ? R. - Il ny a pas endouter. La plus simple exprience de la viesuffit pour le constater. Lhistoire nous montrecombien il a fallu de sicles pour permettre lhumanit datteindre le degr de civilisationrelative o elle est parvenue. Malgr cela, onne peut nier que lerreur y obscurcisse encorebien des intelligences : le vice y opprime lavertu ; la force y prime de droit ; lgosme ytouffe lamour. Prendre part cette lutte,vivre dans cette socit trouble, en tre
souvent la victime et le martyr : cest en celaque consistent le mrite et le progrs pour lesEsprits incarns sut Terre.53. Que faire alors et comment utiliser notrevie ici-bas pour tre un jour plus heureux ? R.- Faire le bien et profiter de notre sjour sur laTerre pour progresser en faisant progresser lesautres, de telle sorte que nous ne soyons plusobligs dy revenir, sinon en missionnaire, enguide de lhumanit.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
8/20
IV. Origine de la vie sur Terre.
54. La Terre fut-elle toujours la demeure desEsprits incarns, cest--dire des hommes ? R.
- Non. La Terre fut dabord une masse de feu,flottant dans lespace. Aprs stre refroidie,elle devint habitable ; la vie y apparut pardegrs. Les trois rgnes de la nature, lesminraux, les vgtaux, les animaux, symanifestrent de trs longues priodes dedistance, des intervalles de plusieurscentaines de sicles ; puis lEsprit descenditdans la chair, et lhomme parut, rsumant enson tre toutes les vies graduelles de lacration, runissant dans sa personne, par uneunion admirable, lme, tincelle divine, avecle corps qui vient de lanimal.55. Peut-on croire que lhomme a eu lanimal
pour anctre ? R. - Notre orgueil rpugne croire cela. Lorigine de lhomme reste encoremystrieuse ; il nest peut-tre pas bon que cemystre soit clairci. En tout cas, il nest pasdfendu de penser que notre esprit, avantdarriver au degr dvolution de la priodehumaine, ne se soit en quelque sorte essay lavie dans les rgions infrieures de la cration.Ceci est conforme aux lois de progression de la
nature. Dautre part, il est certain quen voyantltat rudimentaire de certaines races sauvages,et mme tel retour de bestialit chez lhommecivilis, on serait en droit de croire quelanimal a t la prface vivante du genrehumain.56. Lhomme constitue-t-il un rgne partdans la cration ? R. - Absolument. Si, par soncorps, lhomme garde une sorte de parentavec lanimal, par la liaison sa chair dunesprit conscient, lhomme constitue un rgnepersonnel sur la Terre. Il est le rsum vivant
des rgnes qui lont prcd ; seul, dans lanature, il est capable de connatre Dieu; davoirla notion de linfini et lintuition de
limmortalit, preuve de son aptitude lasurvie.
57. Lespce humaine a-t-elle commenc surla Terre par un seul couple, comme le disentles religions et la mythologie ? R. - Non. Lesraces humaines sont nes sur plusieurs pointsdu globe terrestres, simultanment ousuccessivement ; de l leur diversit.58. Adam ne fut donc pas lunique anctre dugenre humain ? R. - Adam est le nom dunhomme qui survcut aux cataclysmes quibouleversrent la jeunesse du monde ; il devintla souche dune des races qui le peuplentaujourdhui. La Bible a conserv son histoire etcelle de ses descendants ; mais Adam nestquun fragment des primitives humanits, peut-tre mme en mythe, cest--dire une allgoriequi symbolise les premiers ges de lhistoire.59. Est-il certain quil ait plusieurs racesdhommes ? Les diffrences qui les sparent nesont-elles pas simplement dues des influencessuperficielles, telles que le climat, lhrdit,etc.? R. - On ne peut nier quil existe entre lesraces humaines des diffrencesconstitutionnelles profondes : celles du cerveau
et de langle facial par exemple, qui sontcomme les mesures de leur volution. Dautrepart, il existe des types intermdiaires quisupposent des croisements de races ; et cescroisements de races impliquentncessairement leur diversit.60. Mais alors, si les hommes ne descendent
pas tous dun premier couple, ils ne sont pastous frres ? R. - Tous les hommes sont frresen Dieu, ce qui est une fraternit suprieure.De plus, tous sont parents en ce sens quils ontlunit de nature et la communaut des
destines. Tous sont un par lEsprit quisincarne en chacun deux et procde de Dieu.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
9/20
V. Les Esprits. Dieu.
61. Quest-ce que lEsprit ? R. - Cest une
substance immatrielle, indivisible,immortelle, principe intelligent de lunivers.62. Pouvons-nous voir et comprendre lEsprit? R. - Non. Sa nature intime nous est inconnue; nous ne connaissons point ici-bas lessencedes tres ni des choses ; mais nous le nommonsesprit par opposition la matire.63. Que sont les Esprits ? R. - Ce sont les tresintelligents, vivant dune vie personnelle etconsciente, destins progresser indfinimentvers le Vrai, le Beau, le Bien ternels.64. Y a-t-il plusieurs classes dEsprits ? R. -Oui: il y a dabord lEsprit Pur, qui est Dieu ; ily a les Esprits qui vivent libres dans lespace ;en enfin les Esprits incarns, cest--dire lesmes revtues dun corps matriel, habitant surla Terre et les autres mondes.65. Quest-ce que Dieu ? R. - Cest lEspritpur, incr, ternel, cause initiale etordonnatrice de lunivers.66. Peut-on dfinir Dieu ? R. - Dieu estindfinissable. Dfinir, cest limiter : or, Dieuest infini ; il est le cercle ternel dont le centre
est partout et la circonfrence nulle part.67. On ne peut donc jamais pntrer la natureintime de Dieu ? R. - Jamais ! Dieu est commele soleil ; si nous le regardons en face, il nousaveugle ; si nous le regardons dans son rayon,il nous claire.68. Peut-on prouver lexistence de Dieu ? R. -Dune manire directe et sensible, non ; car ilne tombe pas sous les sens.69. Cependant lunivers ne prouve-t-il paslexistence de Dieu ? R. - Si, mais il ne lemontre pas. Dieu se cache sous le voile
transparent des choses, comme pour nousforcer le chercher et nous procurer la joie dele dcouvrir.70. O est Dieu ? R. - Partout, puisque sontre infini ne peut tre circonscrit dans aucunlieu.71. Lhomme ne porte-t-il pas en lui lide de
Dieu ? R. - Oui, lide de Dieu est au fond dela conscience humaine, comme les toiles aufond de la nuit. De toutes les preuves de sonexistence, celle-ci est la plus sre et lameilleure, parce quelle est inne dans lme,comme un reflet de la vrit ternelle.
72. Dieu est-il seul dans linfini ? R. - Oui,
Dieu est seul, puisquil ny a quun seul Dieu ;mais il nest pas solitaire, car la vie universellevolue en lui et autour de lui.73.Les Esprits sont donc autour de Dieu ? R. -Oui. Dieu est le lieu des Esprits, cest--dire lefoyer ternel de lumire et damour auquelviennent silluminer toutes les Intelligences.74. Comment vivent les Esprits dans lespace ?R. - Les Esprits suprieurs vivent dune viepurement fluidique, cest--dire dgage de lamatire, en proportion de leur degrdavancement spirituel ; les Esprits infrieurs,encore alourdis par le poids de la matrialit,errent dans des sphres plus basses, enattendant que leur dgagement complet seralise.75. Un Esprit dsincarn peut donc tre encoreattach la matire ? R. - Oui, car le prispritdemeure imprgn des fluides pais quilempchent de remonter dans lespace,comme laile dun oiseau qui a tran dans laboue lempche de slever vers le ciel.76. Comment vivent les Esprits infrieurs ? R.
- Dune vie inquite et tourmente ; ilsparcourent sans but les rgions crpusculairesde lrraticit, sans pouvoir comprendre leurtat ni trouver leur voie : cest ce quon appelledes mes en peine.77. Les Esprits infrieurs sont-ils nuisibles ?R. - Quelques-uns le sont ; et leur mauvaiseinfluence sur les hommes a donn lieu lacroyance aux dmons.78.Les dmons nexistent donc pas ? R. - Non: il y a de mauvais Esprits, mais ceux quonappelle les dmons ou esprits ternellement
mauvais, nexistent pas ; le mal ni les mchantsne peuvent tre ternels.79. Les mauvais Esprits peuvent donc exercerune influence sur les hommes ? R. - Oui, surles hommes mchants qui les invoquent ou surles hommes faibles qui sabandonnent eux ;de l les phnomnes frquents de lapossession et de lobsession.80. Comment les hommes peuvent-ils entrer enrelation avec les mauvais Esprits ? R. - Par lemoyen des fluides et en vertu de la loidaffinit spirituelle : Qui se ressemble serassemble.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
10/20
81. Y a-t-il plusieurs classes dEsprits mauvais? R. - Oui, il y a les Esprits simplementinfrieurs, tels que les Esprits lgers,imparfaits, moqueurs, que nos pres appelaientles lutins, les farfadets, et qui se plaisent auxespigleries de toutes sortes ; puis il y a lesEsprits pervers, qui portent les hommes au malpour le plaisir de faire le mal, et ceux qui,comme les Esprits frappeurs, habitentordinairement les maisons hantes.82. Mais il y a aussi de bons Esprits ? R. - Oui,et cest le plus grand nombre. Lantiquit lesnommait : bons gnies ; la religion les appelle :anges gardiens ; les spirites les connaissentsous le nom dEsprits familiers ou Espritsprotecteurs.83. Chaque homme a-t-il un Esprit protecteur
attach sa personne ? R. - Ordinairementnous en avons plusieurs. Ce sont des parents,des amis qui nous ont connus ou aims ; ouencore des Esprits dont la mission consiste protger les hommes, les guider dans la voie
du bien, et qui avancent eux-mmes entravaillant lavancement des autres.84.Les hommes, dans ce monde, et les Esprits,dans lautre, travaillent donc dun communaccord ? R. - Certainement ; tout se tient etsenchane dans lunivers. Les corps, par leursradiations, agissent les uns sur les autres ; il enest de mme dans le domaine des Esprits. Toutce que les hommes font de bien, de beau, degrand sur la terre, leur est inspir le plussouvent par des influences invisibles ; cest parcette loi de solidarit morale que Dieugouverne lunivers.85. Ainsi, lhistoire humaine est dicte par lemonde invisible ? R. - Oui ; Dieu la dicte, lesEsprits la traduisent, et les hommeslaccomplissent. Toute la philosophie des
sicles est renferme dans ces trois termes.Mais il faut tenir compte de la libert humainequi, souvent, entrave les vues den haut. De lviennent les contradictions apparentes delhistoire.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
11/20
VI. La doctrine du Spiritisme.
86. Comment se nomme lensemble des
enseignements que nous venons dexposer ? R.- Lensemble de ces enseignements se nommeSpiritisme, ou spiritualisme exprimental.87. Que signifie ce mot : spiritisme ? R. - Ilsignifie : Science de lEsprit, car ce sont lesEsprits eux-mmes qui nous lont rvl.88. Pourquoi spiritualisme exprimental ? R. -Parce que cette doctrine repose sur des faitspositifs, contrls par lexprimentationscientifique.89. Le spiritisme est-il une science ou unecroyance ? R. - Le spiritisme est la fois unescience positive, une philosophique, unedoctrine sociale ; cest aussi une croyance,mais base sur la science exprimentale.90. Est-ce une science, une philosophie, unedoctrine, une croyance nouvelles ? R. -Nullement ; cest la science intgrale, laphilosophie humaine, la doctrine universelle.Elle est ancienne et nouvelle, comme la Vrit,qui est ternelle.91. Prouvez que le spiritisme est une science.R. - Le spiritisme est une science parce quil
repose sur des principes positifs, do lon peuttirer des dductions scientifiquesincontestables. En outre, il est la raison mmede la science, car la science qui nclaire paslhomme sur sa nature intime et sur sa destinenest quune science incomplte et strile,comme le positivisme. Or, le spiritisme est lascience complte de lhomme ; elle lui indiquesa vraie nature, son principe fondamental, sadestine finale, et par consquent sefforce, enlui donnant toute lumire sur la vie, de lerendre plus heureux et meilleur.
92. Quelles sont les preuves scientifiquesactuelles du spiritisme ? R. - Les preuvesactuelles du spiritisme sont les dcouvertesrcentes de la radioactivit de tous les corps etde tous les tres, lhypnose, le magntisme, lesphnomnes multiples de la tlpathie, duddoublement, les fantmes des vivants et desdfunts, en un mot tout lensemble desphnomnes de lordre psychique. Lesdcouvertes futures, dont celles-ci ne sont quela prface, donneront au spiritismeexprimental une conscration dfinitive.93. Puisque le spiritisme est une science
positive, pourquoi rencontre-t-il tant de
contradiction, dhostilit mme parmi les
savants ? Le spiritisme nest combattu, engnral, que par des savants officiels,prcisment parce quil est une rvolution dansla science officielle. La plupart des savantslibres et indpendants sont, au contraire,favorables au spiritisme et viennent chaquejour grossir nos rangs. Le spiritismeexprimental a t reconnu dutilit publique ;de nombreux Instituts psychiques se sont crsdans les grands centres intellectuels delEurope et du Nouveau Monde. La science,affranchie des mthodes surannes et desroutines sculaires, sera, dans un prochainavenir, entirement spiritualiste.94. Comment le spiritisme, qui est une science,est-il en mme temps une philosophie et unemorale ? R. - Parce que le spiritisme est unescience minemment pratique, qui enseigneaux hommes les deux grandes vertus surlesquelles repose toute la morale humaine : lajustice et la solidarit, cest--dire le progrsdans lordre et lamour.95. Est-ce que le christianisme nexplique pas
cette morale ? R. - Si, cest la moraleuniverselle crite de tout temps dans laconscience humaine. Jsus lenseigna aumonde il y a vingt sicles, mais les sacerdoceset les thologies lont dnature et altre pardes additions intresses ou des interprtationssubtiles. Le spiritisme lui restitue sa puretpremire, lappuie sur des preuves sensibles etla prsente au genre humain avec toutelampleur qui convient son volution actuelleet ses progrs futurs.96. Cependant toute morale demande une
sanction, cest--dire une rcompense pour lebien, un chtiment pour le mal ? R. - Larcompense du bien accompli, cest le bien lui-mme, comme le chtiment du mal commis,cest la conscience de lavoir fait avecprmditation : do le remords. Lesprithumain est lui-mme son proprermunrateur ou son justicier. Dieu ne punit nine rcompense personne. Une loi immuable,une justice immanente prsident lordre delunivers comme aux actions des hommes.Tout acte accompli renferme ses consquences.Dieu laisse au temps le soin de les raliser.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
12/20
97. Il ny a donc ni ciel ni enfer ? R. - Le cielou lenfer est dans la conscience de chacun denous; toute me porte en soi et avec soi sa joieou sa peine, sa gloire ou sa misre, suivant lesmrites ou ses dmrites.98. Alors, pourquoi faire le bien et viter lemal, si lon nest ni rcompens de lun par leciel, ni puni de lautre par lenfer ? R. - Il fautfaire le bien et viter le mal, non pas dans lebut goste dune rcompense ni dans la crainteservile dun chtiment, mais uniquement parceque cest la loi de notre destine et la conditionncessaire de notre avancement. Le progrs destres est le rsultat de leur effort individuel :ainsi svanouissent le dogme injurieux de lagrce et la thorie fataliste de la prdestination.99. Comment formulez-vous la loi de la
destine? R. - Chacun de nos actes, bon oumauvais, avons-nous dit, retombe sur nous. Lavie prsente, heureuse ou malheureuse, est larsultante de nos oeuvres passes et laprparation de nos vies futures. Nousrcoltons, mathmatiquement, travers lessicles, ce que nous avons sem. Le souvenirde nos vies antrieures sefface lors du retourde lme dans la chair ; mais le pass subsistedans les profondeurs de ltre. Ce souvenir seretrouve la mort et mme pendant la vie,lorsque lme se dgage du corps matriel,
dans les diffrent tats du sommeil. Alors,lenchanement de nos vies et, par suite, celuides causes et des effets qui les rgissent, sereconstituent. La ralisation en elle dune loisouveraine de justice devient vidente pournous.100. Nous venons de voir que le spiritisme estune science positive et une philosophie morale: commet est-il en outre une doctrine sociale ?R. - Parce que le spiritisme bien compris etbien pratiqu rend lindividu meilleur, et quecest uniquement par lamlioration delindividu que lon peut obtenir celle de lasocit.101. Comment le spiritisme rend-il lindividumeilleur ? R. - En lui donnant la vraie notionde la vie et, partant, celle de sa destine ; cest--dire en faisant lducation morale delhomme individuel et de lhomme social.102. Mais la sociologie et le socialismemodernes ne font-ils pas la mme chose ? R. -Ils font malheureusement le contraire. Lesocialisme actuel ne voit dans lexistence
prsente que ce quil appelle la concurrencevitale , cest--dire la lutte pour la vie. Cettethorie est dangereuse parce quelle consacre
le matrialisme, excite les apptits, dchaneles convoitises, lgitime tous les attentats etamne lanarchie. Elle ne vise que le bien-trematriel, cest--dire la vie du corps, et ne tientnul compte de la destine immortelle delesprit.103. Comment la doctrine spirite corrige-t-ellecette erreur de socialisme ? R. - Le spiritismedmontre lhomme que sa vie prsente nestquun anneau de la longue chane de sesexistences. Par consquent, il doit la considrersurtout son point de vue rel, celui delducation de lme, et non pour les avantagesmatriels quelle nous offre, ceux-ci nepouvant, si nous en abusons, que retarder notreavancement et notre vritable bonheur. Cetteseul considration nest-elle pas dj lun des
meilleurs arguments en faveur de lamodration des apptits, et la pus sre de nosscurits sociales ?104. Comment le spiritisme comprend-il lasolidarit humaine ? R. - Dans sa notion laplus haute et la plus tendue. Chaque hommedevant renatre pour rparer ses fautes ouperfectionner sa vie sur cette mme terre, quiest le champ de bataille de ses luttes et leterrain de ses labeurs, na-t-il pas tout intrt y faire le bien autour de lui, aimer sessemblables, leur rendre service pour se
prparer un retour heureux dans ce mondedpreuves ? Lhomme comprend, grce auxenseignements du spiritisme, quil travaillepour lui-mme en se dvouant pour tous : cestle principe de la vraie solidarit par le sacrificeindividuel, do rsulte le bnfice collectif. Sicette doctrine tait comprise etconsciencieusement applique, seulementpendant vingt-quatre sur terre, le problmesocial serait dfinitivement rsolu.105. Nest-ce point l un rve, une de cesutopies caresses par les esprits chimriques,mais impossible raliser ? R. - Les faits sontl pour prouver la possibilit de raliser cettedoctrine sociale. Il existe en Belgique et enFrance des groupes spirites douvriers, etsurtout des mineurs, qui fonctionnent depuisquinze ou vingt ans. Tous les dimanches, ils serunissent pour couter les enseignements desEsprits protecteurs et les communications delau-del. Chacun de ces humbles travailleursprend sa part de lvangile des invisibles.Quelques-uns se sont compltement guris de
leurs passions et corrigs de leurs vices ; toussont consols, instruits, rconforts etdeviennent meilleurs. Ces hommes, autrefois
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
13/20
incultes et grossiers, sont maintenant clairssur les problmes de la destine et de la vieternelle. Les voix doutre-tombe, celle deleurs amis, de leurs parents, leur ont apprisdavantage que les sermons du prtre ou lesdclamations du sophiste et du rhteur. Unjour, et ce jour ne tardera pas venir, ces
communications du monde invisibledeviendront la religion des peuples et celle delhumanit ; un nouveau principe dducationsociale sera rvl au monde, et la paix, lajustice, la fraternit rgneront parmi leshommes.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
14/20
VII. Pratique exprimentale.
106. Quest-ce que pratiquer le spiritisme ? R.
- Pratiquer le spiritisme, cest : 1 invoquer lesEsprits et se mettre en rapport avec le mondeinvisible ; 2 frquenter assidment lesrunions spirites ; 3 dvelopper les dons demdiumnit qui sont en germe dans chacun denous.107. Quest-ce quinvoquer les Esprits ? R. -Cest leur adresser des prires et leur demanderlumire, inspiration, aide et protection.108. La prire est donc entendue dans lemonde invisible ? R. - La prire est un lan delme qui se trace un chemin fluidique danslespace ; elle peut atteindre les Esprits les pluslevs et arriver jusqu Dieu.109. Quelle est la meilleure des prires ? R. -Toute prire est bonne quand elle est unelvation de lme et un appel sincre au cur.110. Quest-ce quune runion spirite ? R. -Cest un groupe compos de plusieurspersonnes unies par la communion despenses, laffinit des fluides et laccord desvolonts.111. Comment doit tre compose une vraie
runion spirite ? R. - Dun groupe dechercheurs clairs, dun prsident, dun ou deplusieurs mdiums, sous la protection des bonsEsprits.112. O doivent se tenir ces runions ? R. -Nimporte o, car lEsprit se manifeste o ilveut; mais de prfrence dans un lieu recueilli,car les bons Esprits naiment pas semanifester dans le trouble.113. Est-ce le jour ou la nuit que lon doit serunir ? R. - Tantt le jour, tantt la nuit, selonque les Esprits eux-mmes lauront dcid :
cependant la nuit est plus propice auxcommunications avec le monde invisible.114. Pourquoi cela ? R. Parce quelatmosphre nocturne est plus calme ;lactivit du jour nintercepte plus les courantsdes ondes magntiques ; dans ces conditions, ilest plus facile de tracer le chemin fluidiqueentre ce monde et lau-del. Cest dailleurs ceque signifie le proverbe antique : Le jour estaux hommes, la nuit appartient aux dieux ,cest--dire aux Esprits.115. Toutes les runions spirites sont-ellestmoins des mmes rvlations et des mmes
phnomnes ? R. - Non : chaque groupe a son
caractre, chaque groupe sa physionomie. Tout
dpend de llvation des Esprits qui secommuniquent, des dispositions intimes desassistants et, surtout, de la valeur des mdiums.116. Que veut dire le mot mdium ? R. - Ilsignifie intermdiaire, cest--dire qui occupele milieu entre les membres du groupe et lesEsprits qui se communiquent.117. Que faut-il pour tre un bon mdium ? R.- Il faut runir certaines conditions ou qualitspsychiques, intellectuelles et morales.118. Quelles sont les qualits psychiques dunbon mdium ? R. - Dabord et avant tout,lquilibre psychique et moral ; ensuite, unequantit de fluide magntique suffisante pourpermettre aux Esprits de se manifester.119. Quelles sont les qualits intellectuellesdun bon mdium ? R. - Il est souhaiter que lemdium soit intelligent et instruit. La valeurdes communications est en proportion de lavaleur intellectuelle du mdium. De mmequun grand artiste aime se servir dun boninstrument, ainsi un Esprit suprieur choisit deprfrence un mdium digne de lui et apte le
servir.120. Un Esprit suprieur ne peut-il suppler lincapacit du mdium ? R. - Cela arrivequelquefois ; mais ce nest pas la rglegnrale. Le mdium prtant ses facults lEsprit pour lui permettre de communiquer sapense et ses enseignements, il est facile decomprendre que plus ses facults serontaffines, mieux lEsprit pourra sen servir.121. Pourquoi le mdium doit-il avoir desqualits morales ? R. - Parce quun mdiumimmoral ou vicieux ne peut quattirer de
mauvais Esprits, ce qui est toujours dangereux.122. Mais alors, comment pourra-t-ondistinguer la part du mdium et la part delEsprit dans les communications ? R. - Celademande, en effet, une grande exprience desphnomnes psychiques ; cependant, il arrivetoujours un moment o la communicationatteint une ampleur et revt un caractre quidpassent les moyens personnels et lespossibilits du mdium : cest cette marqueque lon reconnat laction directe de lEsprit.123. Est-ce ltat de veille que le mdium
peut servir dintermdiaire avec le mondeinvisible ? R. - Les phnomnes de premier
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
15/20
ordre, les communications suprieures exigentordinairement ltat de somnambulisme oudhypnose tous ses degrs, cest--diredepuis lextriorisation partielle jusquaudgagement complet. Cet tat facilite la tranceet rend possible le phnomne si remarquablede lincorporation, par laquelle lEsprit entremomentanment dans la personnalit dumdium, psychiquement absente, comme untranger dans une demeure inhabite.124. A quel ordre appartiennent ces
phnomnes de la mdiumnit ? R. - A lordreappel psychique, cest--dire spirituel. Il nefaut pas oublier que les lois de lunivers sonttoute harmonie, et que, consquemment, nousqui sommes des esprits, nous ne pouvonscommuniquer avec le monde des Esprits que
par les sens de lesprit. Ce sixime sens, quicomplte la nature humaine, cest la perceptionspirituelle, cest--dire la mdiumnit.125. La mdiumnit nest donc pas unedcouverte rcente ? R. - Pas plus que lme,dont elle est une manifestation : elle fait partieintgrante de la nature humaine, elle prouvenotre affinit avec le monde invisible et divin.126. La mdiumnit a-t-elle t pratique dansle pass ? R. - Oui ; grce elle lantiquit,beaucoup plus que les temps modernes, fut encommunion avec le monde invisible.
Lgypte, la Gaule, la Grce, Rome, le peuplejuif, ont connu la mdiumnit. La pythie, lessibylles, les druidesses de lle de Sein, lesprophtes hbreux, les grands thurgesdAlexandrie, comme Apollonius de Thyane,ont t des mdiums clbres. Le Christ lui-mme fut le mdium de Dieu, intermdiaireentre le ciel et la terre ; on lappelle encoreaujourdhui le mdiateur.127. Cependant, lglise catholique rpudieviolemment cette explication de la mission de
Jsus ? R. - Oui, parce quelle a perdu le sensde son initiation premire. Pourtant, cest dufait spirite de la Pentecte quest sortie laprimitive glise, par leffusion de lEsprit deJsus sur les aptres. Les premiers chrtiensformaient des groupes spirites, dont Saint Paula t le lgislateur. Il suffit de lire quelquespassages de ses ptres, principalement de celleadresse aux Corinthiens, pour voir commentfonctionnaient ces groupes et quelles taientles diffrentes sortes de mdiumnits deschrtiens de ce temps. ni lvangile de Jsus,
ni les commencements de lglise ne peuventtre compris sans les donnes du spiritisme.
128. Vous avez dit quil fallait cultiver etdvelopper la mdiumnit : comment cela
peut-il se faire ? R. - Comme toutes lesfacults de lme, la mdiumnit estperfectible. On la dveloppe par lexercice,lentranement, lexprimentation. Mais il fautpour cela se laisser diriger par les Esprits eux-mmes, car ce sont eux qui prparent etforment leurs mdiums, comme un matre sageforme louvrier qui doit le seconder et le servir.129. Lexercice de la mdiumnit est-ildangereux ? R. - Comme toute chose, quandon en abuse ou quon ne sait pas bien senservir.130. Comment peut-on abuser de lamdiumnit? R. - Cela peut arriver de plusieursmanires : 1 Quand on sen sert trop souvent,
ce qui peut nuire la sant. Un mdium est unvivant et prcieux rservoir de forcespsychiques; mais ces forces ne sont pasinpuisables. Il faut donc cesser lesexpriences ds les premiers symptmes defatigue, et distancer les runions de manire laisser au mdium le temps de reconstituer saprovision fluidique. Les Esprits eux-mmessont les premiers mnager leur mdium et lavertir ds que la force psychique commence spuiser ; 2 On abuse galement de lamdiumnit quand on la fait servir des
amusements frivoles et la pure curiosit delesprit humain. Le mdium paie quelquefoistrs cher cette fantaisie tmraire ; il sexpose lobsession et la possession des mauvaisEsprits. Il ne faut pas abuser des dons de Dieu,sans quoi lon est svrement puni. Lemdium, en rgle gnrale, ne doit jamaisexprimenter seul.131. Comment les mdiums peuvent-ils
prvenir ces dangers ? R. - En se prparant leurs fonctions comme un ministre sacr,par linvocation, le recueillement et la prire.Liniti aux mystres antiques avait un rituel ;il ne se livrait lvocation quaprs streprpar par labstinence et la mditation, dansla solitude. La loi na point chang : quiconqueveut passer outre sexpose de relsinconvnients.132. Dans un groupe spirite, les membresassistants ont-ils galement certains devoirs remplir ? R. - Oui, et le premier de tous, cestde sunir par laffinit sympathique des fluideset laccord unanime des volonts. Une seule
volont discordante ou hostile neutralise lefluide collectif et peut empcher lacommunication. Il ne faut jamais introduire
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
16/20
dans une runion un lment nouveau, sansavoir pralablement demand lavis de lEspritprotecteur du groupe, car lui seul jugera desaffinits fluidiques du nouveau venu.133. Si les assistants sont mus par un simplesentiment de curiosit ou de scepticisme, quese passera-t-il ? R. - Les assistants ont lasocit des Esprits quils mritent. Sils sontlgers, ils auront des Esprits lgers etmystificateurs ; sils sont corrompus, ils aurontdes Esprit impurs et pervers, dont le contact,mme momentan, nest jamais inoffensif.134. Les groupes spirites doivent-ils trelimits quant au nombre des personnes qui lescomposent ? R. - Non, pas dune manireabsolument mathmatique ; mais, en rglegnrale, les groupes les moins nombreux sont
les plus unis et par consquent les meilleurs.135. Pourquoi ? R. - Parce que, sil est djdifficile dharmoniser les fluides de cinq ou sixpersonnes avec ceux de lEsprit, cela estencore plus difficile quand les membres sontplus nombreux. Il est bon de ntre pas moinsde trois et pas plus de douze. Ajoutons quil estprfrable de se runir autant que possible dansle mme lieu, aux mme jours et la mmeheure. Ces habitudes rgulires favorisentsensiblement linfluence et laction des Esprits.136. Combien y a-t-il de sortes de mdiumnit
? R. - Il est difficile de les classer, parce quilest impossible de limiter les dons dEn-Haut. LEsprit souffle o il veut, quand et commeil veut. Cependant, on distingue ainsi lesformes ou manifestations de la mdiumnit : latyptologie, cest--dire les coups frapps, lestables parlantes ; les phnomnes de lvitation,qui sont comme labc du spiritismeexprimental. La plupart des mdiumnitscommencent par l. Lcriture automatique oudirecte, cest--dire les caractres tracs pardes mains invisibles ou par les mdiums souslimpulsion des Esprits ; le phnomnedincorporation, qui a lieu lorsquun Espritvient momentanment semparer delorganisme du mdium endormi et sesubstituer en quelque sorte sa personnalit :cela suppose le sommeil magntique profond.Il y a enfin les apparitions ou matrialisationsdEsprits tous degrs ; quelques-unes peuventtre saisies linstantan par la photographie.Il y a dautres formes de la mdiumnit : parexemple, la mdiumnit voyante ou auditive,
qui peroit les tres, les bruits et les harmoniesdu monde invisible ; la mdiumnit gurissanteou curative, qui gurit par simple attouchement
les maladies, ou les diagnostiques lintrieurdu corps par la double vue. Il y a encore laglossolalie ou don des langues ; elle permet aumdium en tat de somnambulisme de parler,dcrire, de comprendre des langues mortes ouvivantes quil ignore ltat de veille, etc.137. Mais le charlatanisme, la simulation, lasupercherie ne jouent-ils pas un rleconsidrable dans la pratique du spiritisme ?R. - Oui, sans doute, cela arrive parfois. Quelleest la science qui na pas ses charlatans et sesexploiteurs ? Quelle est la religion qui nestpas corrompue et dshonore par ses fauxmiracles, ses faux prophtes, ses mauvaisprtres ou ses superstitions ? Cela prouve quele propre de la nature humaine et lune desmarques de sa faiblesse, cest dabuser de tout,
mme des choses les plus sacres, et de toutprofaner, mme les plus nobles dons quelle areus de Dieu.138. La pratique du spiritisme ne mne-t-elle
pas aussi quelquefois au suicide ou la folie ?R. - Nullement. Sil sest produit quelques casdexaltation, il faut remarquer que la science etla religion, qui sont deux choses ncessaires ettrs hautes, ont, elles aussi, dans le cours dessicles, lune, fait clater bien des cerveaux,lautre produit des cas de folie religieuse etcommis des crimes odieux. Ce nest pas une
raison, cependant, pour renoncer la religionqui a fait de grandes mes, ni la science qui aproduit de grands esprits. Il serait illogique etinjuste de ne voir les choses leves que parleurs petits ou mauvais cts. De ce que lecerveau humain ne peut pas toujours supporterle poids de certaines rvlations, on ne peutconclure quune seule chose : cest quelinvisible est sans bornes, et lhomme bienlimit devant linfini !139. Que penser du rle du dmon dans lesmanifestations spirites ? R. - Le dmonnexiste pas et ne peut pas exister, car, silexistait, Dieu ne serait pas ; lun estessentiellement exclusif de lautre.140. Comment cela ? R. - Si le dmon estternel comme Dieu, il y a deux tres ternels.Or, la coexistence de deux ternits estimpossible ; elle serait une contradiction danslordre mtaphysique. Ces deux dieux, lun dubien, lautre du mal, rappellent la thorieorientale des deux principes : cest unerminiscence du dualisme manichen. Si, au
contraire, le dmon est la crature de Dieu,Dieu devient alors responsable devantlhumanit de tout le mal que le dmon a fait et
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
17/20
fera encore ternellement. Cest la plussanglante injure que lon puisse faire Dieu,puisque cest nier sa justice et sa bont. Il y ade mauvais Esprits, nous lavons dit plus haut,qui poussent au mal lhomme enclin syabandonner ; mais le dmon, considr commela personnification individuelle du mal,nexiste pas.141. Pourtant, lglise enseigne et affirme lecaractre satanique de certainesmanifestations spirites ? R. - Lglise naquun seul mot pour expliquer ce quelle necomprend pas : Satan. Dans le cours dessicles, lglise a toujours attribu Satantoutes les inventions du gnie, depuis celle dela vapeur jusqu celles des chemins de fer etde llectricit. Il est dans sa logique habituelle
et dans son caractre de dire que lesphnomnes du magntisme et les rvlations
spirites sont luvre de Satan. Cependant,malgr les anathmes de lglise, la scienceprogresse, le gnie de lhomme volue et lespiritisme deviendra la foi universelle delavenir.142. Alors, le spiritisme est la religion delavenir ? R. - Il est plutt lavenir de lareligion. Le spiritisme, comme son nomlindique, est la forme la plus haute et la plusscientifique du spiritualisme. Il est la fois,nous lavons vu, une science positive et unescience morale, une solution sociale. A tousces titres, il rpond admirablement auxexigences de la pense moderne, aux besoinsdu cur humain, aux aspirations leves delme. Les progrs de lavenir confirmerontchaque jour davantage ses enseignements et sa
doctrine : nous pouvons donc affirmer que lespiritisme est le Credo futur de lhumanit.
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
18/20
VIII. Consolations. Esthtique : le Beau.le Vrai, le Bien.
143. Comme science, le spiritisme sadresse la raison ; mais comment sadresse-t-il aucoeur humain ? R. - 1 En le consolant danslpreuve ; 2 en lui faisant aimer la vie, lanature, lunivers, comme une oeuvre solidaireet harmonieuse, tout imprgne damour, deposie, de beaut.144. Comment le spiritisme console-t-illhomme dans ses preuves ? R. - En lui faisantcomprendre que la souffrance est uneducation ncessaire sa destine ; quelle
agrandit lme, forme le jugement, trempe lecaractre, affine les sensations, et inspire lenoble sentiment de piti, par lequel nousressemblons davantage Dieu.145. Ce sont l des consolations quisadressent encore la raison ; mais les vraies
peines du coeur, telles que la perte de ceux quenous aimons, dune mre, dun enfant, dunami, etc., ne sont-elle point des peinesinconsolables ? R. - Il nest pas de peinesinconsolables. ce sont prcisment celles-cique le spiritisme console le mieux, puisque,
grce son enseignement et ses pratiques,nous sentons autour de nous la prsence de nosmorts bien-aims. Leur fluide nous enveloppe ;ils nous parlent, parfois ils se laissent voir etmme photographier. La foi religieuse donneseulement lesprance : le spiritisme donne lacertitude et fait toucher la ralit.146.Le spiritisme nie donc la mort ? R. - non,mais la dlivre des terreurs et des craintes dontles prjugs lenvironnent. Le spiritisme nousfait aimer la vie et nous apprend ne pas
craindre la mort.147. Comment le spiritisme fait-il aimer la vie? R. - En nous la prsentant comme une destapes ncessaires de notre destine. De plus, ilnous fait comprendre comment lexistencehumaine, malgr sa dure et ses apparencesphmres, se rattache au plan gnraldvolution, damour et de beaut qui constituelunivers.148. Comment la vie humaine se rattache-t-elle au plan gnral de lunivers ? R. - Commela partie se rattache au tout ; comme le dtail se
ramne lensemble. Lunivers est lOcanternel de la vie : lexistence humaine en
procde comme de son principe et y retournecomme sa fin.149. Nest-ce point l ce quon appelle le
panthisme ? R. Nullement, car ltre humain,cest--dire lEsprit incarn ou dsincarn,garde sa personnalit et son identit dans la vieuniverselle, comme certains courants quicirculent dans lOcan sans y mlanger leurseaux.150. Si la vie humaine nexistait pas, ilmanquerait donc quelque chose lunivers ?
R. - Certainement, car lhomme rsume en luitoutes les vies des divers rgnes de la nature :celle du minral, de la plante, de lanimal, etles complte par la conscience et la libert. Lavie humaine est le phnomne conscient de lanature.151. La nature est donc ternelle ? R. - Lanature est leffet ; la cause seule est ternelle :cest Dieu.152.Dieu est donc lauteur de la nature ? R. -Oui ; partout nous retrouvons sa puissance, sonintelligence, son amour et le reflet de sabeaut.153.La nature est donc le reflet de Dieu ? R. -Oui ; la nature est un transparent sous lequelon dcouvre Dieu ; chacun des phnomnes dela nature est le symbole dune pense divine.15. Comment se fait-il que si peu dhommesvoient la nature de cette manire ? R. - Parceque le plus grand nombre des hommesregardent ces choses avec un oeil fatigu parlhabitude ou fauss par la passion. Lhommequi a gard la jeunesse du cur et la puret du
regard voit la nature et la vie dans la vraielumire. Cest dans ce sens que jsus a dit: Heureux les curs purs, parce quilsverront Dieu et encore : Si votre regard estsimple, tout votre corps sera illumin. 155. Mais cette manire de comprendre lanature nest-elle pas exclusivement mystique,
puisque la science moderne ny voit quunphnomne purement matriel ? R. - Cestprcisment lerreur de la sciencecontemporaine de ne voir dans la nature que lephnomne matriel ; et cest aussi sa punition
de ne pouvoir, cause de cela, saisir ni la loide la nature, ni la vie profonde des tres quelle
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
19/20
renferme. Le spirite, lui, comme son nomlindique, interroge en tout et partout lesprit des choses ; et cest lEsprit qui luirpond et linstruit.156. Ainsi, le spirite est en communion plusintime avec la nature ? R. - Certainement ;cest l la vritable communion universelle. Aumilieu de la nature, le spirite nest jamais seul.Le monde des Esprits lenvironne, uneprotection invisible lenveloppe : partout ildcouvre un mystre et entend des voix. Il sentquun immense amour demeure au fond detoute vie ; que chaque tre redit un chant dugrand pome et apporte sa note particulire auconcert universel.157. Vous avez dit que le spiritisme avait aussiune esthtique spciale, cest--dire une
conception de la Beaut ? R. - Cestlesthtique unique ; la seule qui soit adquate la raison universelle : lesthtiquespiritualiste.158. Quest-ce que lesthtique ? R. - Cest lascience des lois de la beaut.159. Quest-ce que la Beaut ? R. - Cest cequi plat lesprit et charme les yeux.160. Pourquoi ce qui est beau est-il ce qui
plat lesprit et aux yeux ? R. - Parce que lebeau est conforme la nature, comme lanature, son tour, est conforme lide divine,
qui en est le modle ternel.161. La nature est donc lexpression de la
Beaut ? R. - Oui, la nature est le premier faitesthtique qui simpose notre pense et nosregards. Elle est la rgle impeccable, le modleo les arts puiseront toujours la mesure de leurinspiration.162. Comment lhomme exprime-t-il la beautde la nature ? R. - Par les arts.163. Quest-ce que les arts ? R. - Les arts sontlexpression matrielle des trois lments quiconstituent la beaut : cest--dire lide, laforme et la vie.164. O lartiste puise-t-il lide ou pluttlidal de ses oeuvres ? R. - Dans lacontemplation intrieure dune beaut incre,entrevue comme un mirage de la beautternelle, qui est Dieu vu dans ses oeuvres.Cest cette vision interne que lon appelle :conception du gnie et inspiration.165. Lartiste ne doit donc pas simplementimiter la nature ? R. - Si, mais il ne doit pas entre le copiste servile, comme le prtend
lcole dite raliste. Il doit seulement luiemprunter les formes sensibles, les signesmatriels ncessaire pour donner corps
lidal qui est en lui. Plus un artiste approchede lidal, plus il exprime le rel ; de mmeque plus on approche dune me, mieux onpossde et lon connat lhomme tout entier.166. Quelle diffrence y a-t-il entre les Arts,les Sciences et lIndustrie ? R. - Ce sont ltrois formes de lactivit humaine, qui ontchacune leur objet particulier, mais qui sesolidarisent par lunit du terme quellesdoivent atteindre. Lindustrie a pour objetlutile sous toutes ses formes : mtiers,inventions, dcouvertes, etc., ; la science apour objet les lois qui rgissent lessence deschoses et des tres, cest--dire la vrai ; les artsont pour sujet le beau, qui est la splendeur duvrai, cest--dire le rayonnement de ltre danslunivers.
167. Le Vrai et le Beau ne doivent-ils passunir pour constituer le Bien ? R. -videmment, le vrai, le beau, le bien sont uneseule et mme chose ; ce sont trois facettesdun seul et mme diamant : le vrai qui est lascience, le beau, qui est lart, doivent sersumer dans le bien, qui est lamour. Toutescience, a dit un penseur, qui ne porte pas aimer est une science strile se trahissant elle-mme. 168. Tout doit donc se rsumer dans lamour ?R. - Oui, lamour est le principe et la fin des
choses ; tout procde de lui ; tout doit yretourner. Cest la loi de progrs pour lespeuples ; cest la condition de lavancementpour lindividu. Toute la loi de la destine estrenferme dans ce mot.169. Comment lamour est-il la loi du progrs
pour les peuples ? R. - De mme que Dieu afait les grains de sable pour vivre unis dans lemme rivage, les grains de bl poursembrasser sur le mme pi et les grains deraisin sur la mme grappe, ainsi il a fait leshommes pour vivre unis dans la famille, puisdans la cit, dans la patrie, et finalement danslhumanit. Cest la condition essentielle de lacivilisation.170. Il entre donc dans le plan de lamour,cest--dire dans la plan de Dieu, que tous leshommes soient frres et que tous les peuplessunissent un jour dans la fraternit universelle? R. - Oui, cest la loi de lamour de toutramener lunit, cest--dire limage et laressemblance de Dieu, qui est un.171. Cette notion de lamour humanitaire ne
dtruit-elle pas la notion du patriotisme ? R. -Nullement,, mais elle explique et la modifie
-
7/29/2019 Sythese Doctrinale Et Pratique Du Spiritualisme-Leon Denis
20/20
selon la loi mme de la nature et des progrs delhistoire.172. Comment cela ? R. - La loi de la nature etcelle de lhistoire demandent que le cercle delamour slargisse progressivement dans lecours des sicles. Lhumanit, chacune de sestapes, lhomme, chacune de ses existences,saffinent et se dilatent davantage. Cest pouraimer de plus en plus que les hommes et lespeuples sont soumis la loi inluctable desrincarnations ici-bas et dans les autres mondesde lespace. La vie individuelle et la viecollective voluent par cycles : le premier,cest la famille ; le second, la cit ; letroisime, la patrie ; la quatrime, lhumanit ;le dernier, lunivers.173. A quel cycle de lhistoire humaine
sommes-nous actuellement arrivs ? R. - Aucycle de transition entre lamour de la patrie etcelui du genre humain.174. Ainsi, le patriotisme est appel disparatre ? R. - Dans sa notion exclusive etjalouse, oui ; dans sa notion historique etintime, non !175. Quentendez-vous par l ? R. - Il y a unpatriotisme troit et froce qui est lgosmedes peuples. Celui-l doit prir. De ce quunhomme vit en de de la frontire, et un autreau-del, il ne sensuit pas quils doivent se
har, se battre et se tuer. Mais il y a unpatriotisme que chaque homme porte dans soncoeur, qui est fait dmotions intimes, de joieset de douleurs communes, de souvenirs sacrs ;celui-l ne prira jamais ; il fait partieintgrante de la conscience humaine.Toutefois, cette notion intime se dilate etsagrandit avec le progrs de la vie, lasuppression des distances qui sparent lespeuples, le caractre international des relationsqui les runissent. un jour, ce patriotisme seraabsorb par lhumanit tout entire ; la vraiepatrie sera partout o lhomme peut natre,aimer et mourir. la diffusion du spiritismeaidera cette transformation.176. Et aprs lamour de lhumanit, ce seralamour universel ? R. - Oui. La pense etlamour suivent la mme loi. De mme que le
progrs de la pense humaine consiste embrasser des horizons de plus en plus vastes,et que le gnie de lhomme peut tre adquat lunivers, ainsi le coeur humain, lui aussi, doitse dilater, slargir indfiniment par lesaccroissements de lamour. Cest par cette loique lhomme se rapproche de Dieu. nous noussommes faits son image et saressemblance que par la facult que possdenotre esprit dembrasser tout lunivers dans unseul et mme lan damour.177. Ne sommes-nous pas encore bien loin deraliser cet idal damour et de bontuniversels ? R. - Collectivement, si ;individuellement, non ! Il existe actuellementsur la terre des mes arrives un tel degrdvolution que leurs aspirations sont plus
vastes et plus grandes que le monde o ellesvivent. Leurs sacrifices, par exemple, leursactes damour sont la plus grande force dugenre humain. cest par ces mes sublimes queDieu prpare les grandes transformationsmorales de lavenir.178. Pouvons-nous esprer quun jourlhumanit collective atteindra cet idaldamour et de bont, qui est seulement le
partage de quelques mes dlite ? R. - Oui,soit en ce monde, soit en dautres. Cest a loides mondes queux aussi doivent monter dans
la lumire et dans lamour en mme temps queles esprits incarns leur surface.179 Ainsi les mondes habits voluent, euxaussi, dans lamour universel ? R. - Oui. Demme que les soleils innombrables sontemports, avec leurs cortges de plantes, versun centre irrsistible qui les attire, ainsi lesmes et les mondes gravitent autour de Soleilternel, de lIntelligence suprme : Dieu. Cetteascension, cette monte de lunivers vers lessommets constitue le progrs illimit dans lalumire, le mouvement, lactivit, la joiesereine. cest la vie ternelle dans la pleineacception de ce mot, qui rsume toute ladestine des tres, toute lhistoire des peuples,toute lvolution universelle.