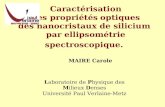Som Maire
-
Upload
fleur-lilas -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of Som Maire
SommaireDdicaces4Remerciements5Listes des tableaux et des figures91Listes des abrviations6Avant-propos7Introduction gnrale9Contexte dtude9La question centrale11Les sous-questions de recherche11Lintrt thorique du thme12Lintrt managrial du thme12Plan de la recherche12Chapitre ICadre conceptuel: la TPE, la gestion fiscale et la dcision dinvestissement14Section I.La TPE15Section II.La gestion fiscale22Section III.La dcision dinvestissement30Chapitre II: Limpact de la fiscalit sur la dcision dinvestissement39Section I.Impact de limposition directe des socits sur la dcision dinvestissement: fondement thorique et revue de littrature40Section II.Limpact de la fiscalit sur les paramtres conomiques de linvestissement47Section III.Les incitations fiscales ddies la TPE55Chapitre III: Exposition des principaux choix fiscaux affectant la rentabilit dune TPE: cas simulatifs68Section I.Lincident de la forme juridique sur la dcision dinvestissement69Section II.Lincident fiscal des choix oprs sur les actifs75Section III.: Lincident de la TVA sur linvestissement dune TPE85Lannexe94
Ddicaces
A mes trs chers parents,Aucun mot, aucune ddicace ne saurait exprimer mon respect, ma considration et lamour ternel pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon instruction et mon bien tre.Trouvez en ce travail le fruit de votre dvouement et lexpression de ma gratitude et mon Profond amour.A mes surs et mes frres,Vous mavez toujours soutenu durant toutes mes tudes, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de russite.A toute ma chre famille,A mes chres amies
Youness AZZIOUI
Remerciements
Au terme de ce travail, je tiens exprimer mes sincres gratitudes et ma profonde reconnaissance toutes les personnes qui ont contribu de prs ou de loin la ralisation de ce travail dans les meilleures conditions.Jexprime mes vifs remerciements Madame Saida AMANSOU, professeur lEcole Nationale de Commerce et de Gestion dOUJDA, davoir accept lencadrement de ce PFE, pour son soutient, ses directives prcieuses, ses motivations qui mont permis de donner le meilleur de moi-mme. Merci vous Madame.Je tiens remercier galement, M. Ahmed BENYETHO et M. Mohammed TIDDARH les grants de LA MAROCAINE DASSISTANCE FISCALE, pour tout le temps quils mont consacr et pour la qualit de leur suivi durant toute la priode de stage. Que messieurs les membres du jury trouvent ici lexpression de ma profonde reconnaissance pour avoir accept de juger ce travail.Que tout le corps professoral et administratif de lENCGO trouve ici le tmoignage de ma reconnaissance pour leur contribution notre formation.
Youness AZZIOUI
Listes des abrviationsBFR Besoin En Fonds De Roulement
CF Cash-flow
CR Capacit De Remboursement
DR Dure De Rcupration
IR Impt Sur Le Revenu
IS Impt Sur Les Socits.
RE Rentabilit Economique.
RNRRsultat net rel
RNS Rsultat net simplifi
SARL Socit A Responsabilit Limite
SARLAUSocit A Responsabilit Limite A Associ Unique
TEMI Taux Effectif Moyen Dimposition
TEMI Taux Effectif Moyen Dimposition
TP Taux De Profitabilit
TPTaux De Profitabilit
TRITaux De Rentabilit Interne
TRITaux De Rentabilit Interne
TVA Taxe Sur La Valeur Ajoute
TVA Taxe Sur La Valeur Ajoute
UGEP Union Gnrale Des Entreprises Et Des Professions
VAN Valeur Actuelle Nette
VAN Valeur Actuelle Nette
Avant-proposUn stage de fin dtudes est couronn par un projet dont lobjet consiste apporter une solution, scientifiquement fonde, une problmatique extraite du milieu professionnel, cest ce que prconise lorthodoxie acadmique. Or, extraire une problmatique dans un cabinet, nouvellement cr, soccupant de lassistance fiscale et comptable, nest pas une rflexion aise mener par un stagiaire sans une implication intgrale dans le quotidien professionnel du cabinet.La comptence pointue, lhonorable exprience professionnelle, dpassant les 35 ans dans des postes cls au sien de ladministration fiscale marocaine, des fondateurs de la Marocaine dAssistance Fiscale, ma servi de cl lamlioration de mes diligences en matire de fiscalit. Ainsi, les missions qui mont t confies lors de la priode de stage savoir la tenue de la comptabilit, la prparation des liasses fiscales et des dclarations fiscales, mont permis dobserver et de reprer un certain nombre de choix fiscaux irrationnels allant lencontre des intrts des TPE objet dtude.Les observations faites, nous ont permis davancer les apprciations fiscales ci aprs: Choix non pragmatiques du cadre juridique de lactivit exerce Choix arbitraires des rgimes dimposition au titre de limpt sur le revenu non-exploitation des incitations fiscales Suite lanalyse des dossiers contenant les anomalies repres, nous avons dcouvert que ces dossiers relvent des entreprises qui ont rcemment confi leur comptabilit LAMAF, aprs les avoir retir auprs des confrres, cause de la mdiocrit de lencadrement fiscal et comptable.Parmi les dossiers comptables traits, il y a des TPE ayant bnfici dun encadrement prs et post investissement du programme Moukawalati. Toutefois les choix oprs par ces dernires en matire fiscale prouvent la ngligence totale de cette dimension dans les tudes de faisabilit de leurs projets dinvestissement. Labsence dassistance fiscale pour une TPE pourrait remettre en cause la prennit de celle-ci. En effet, la situation de cessation de paiement dont souffrent les TPE finances par le programme Moukawalati en est une preuve.En menant une analyse critique sur quelques tudes de faisabilit des TPE ayant bnfici de ce programme, on a pu dceler les points suivants: choix non fonds de la forme juridique, non intgration des incitations fiscales dans lvaluation de la rentabilit des projets Absence du conseil juridique traitant de la responsabilit des associs. Ces constats sont dailleurs points sur le canevas du business plan raccommod par Moukawalati annex au prsent travail.Les constats ci-dessus mont incit me pencher davantage sur la question de lintrt de la lintgration du paramtre fiscal dans les dcisions de gestion se rapportant aux TPE marocaines.
Introduction gnrale
Contexte dtudeLintrt rcemment port aux TPE sexplique par le fait quelles jouent un rle important et complmentaire de celui des PME et des GE dans le dveloppement conomique et social du pays, plus encore elles conditionnent le dveloppement et renforce le tissu conomique national qui reste domin hauteur de 93% par des PME, dont les TPE constituent 80%. Elles font galement preuve dun dynamisme particulirement sollicit par les pouvoirs publics afin de mettre en uvre une politique de cration demplois, dans la mesure o celles-ci constituent le premier crateur demplois puisquelles emploient plus de 6 millions de personnes.Les spcificits des problmes de la TPE a fait cependant lobjet de nombreuses recherches et de commentaires, qui porte sur des domaines aussi varis que les objectifs, la stratgie, les outils de gestion. Il reste que limportance de la question fiscale dans la vie de cette catgorie dentreprises est encore imparfaitement connue. La fiscalit est frontalire entre la discipline juridique et les disciplines de gestions qui incluent la comptabilit et la finance, car les prlvements fiscaux se basent sur des assiettes dtermines par le droit comptable et influences par les choix faites en matire de structure de capital. De ce fait ignorer la variable fiscale dans la recherche en comptabilit et en finance serait une erreur conceptuelle. La norme fiscale s'impose aux activits et aux oprations de lentreprise.Historiquement, avant les annes 80, les papiers scientifiques traitant de la fiscalit taient focaliss sur la dimension juridique apprciant limpact des impositions sur les transactions exognes et les tudes politiques. Suite au paradigme de recherche nonc par Modigliani et Miller (1958, 1963), la recherche en finance a connu une transition notable et le paramtre fiscal a t intgre dans plusieurs tudes empiriques traitant de la comptabilit et la finance. Certains entre elle ont tudi linteraction entre la comptabilit et les facteurs fiscaux, dautres ont apprci limpact de la fiscalit sur les dcisions financires de lentrepriseLes recherches ayant trait limpact de la fiscalit sur les dcisions de gestion nous a permis daffirmer la prsence de la variable fiscale tout au long de la vie de lentreprise depuis sa cration jusqu sa liquidation. ARMEL .L raffirme ce postulat en disant: S'il est une rglementation administrative qui a toujours atteint l'entreprise, c'est bien la rglementation financire et fiscale : chaque firme est atteinte dans sa structure, ses objectifs de faon directe ou de manire incidente [footnoteRef:1]. [1: LIGER. ARMEL la gestion fiscale des PMI: un mythe Ed. Librairie gnrale de droit et de jurisprudence, 1988. p. 15.]
Latteinte des objectifs de lentreprise est le rsultat dun certain nombre de pratiques de gestion, telles, par exemple: la gestion financire, la gestion de production, la gestion commerciale etc. Dans la pratique, si l'ensemble de ces techniques sont prvues et couramment utilises dans la gestion dentreprise, la gestion fiscale ne lest pas. Actuellement les grandes entreprises sont conscientes de la ncessit de disposer dune gestion fiscale efficace leurs permettant de prvenir et de dominer limpt. La TPE, faute de la complexit de la matire fiscale et de linsuffisance de ses moyens financiers pour accder au conseil fiscal, se contente de remplir les imprims administratifs, tan dit que les grandes entreprises disposent la possibilit de prvoir et de dominer l'impt et utilisent bon escient les moyens fournis par une fiscalit incitative qui offre des choix multiples.Conscients de limportance capitale de linvestissement en tant que force motrice de lactivit conomique, les pouvoirs publics ont mis au point certaines mesures visant en faire un instrument de rgulation politique, conomique et sociale, en orientant et en agissant sur le comportement des entreprises en gnral et des TPE en particulieren matire dinvestissement.Les mesures incitatives prises par lEtat, visant stimuler linvestissement, incitent les entreprises en gnrale et les TPE en particulier vu leur poids dans le tissu conomique national, pratiquer des arbitrages fiscaux. En effet, il revient l'entreprise de rechercher et de slectionner loption fiscale qui lui permet doptimiser son imposition.Pour une TPE, la quasi-totalit des dcisions fiscales constituant la plate forme des ses impositions futures, doit tre prise dans la phase de cration de lentreprise, cest ce moment que la fondation fiscale est inaugure, la combinaison des lments constituant celle-ci a des consquences non ngligeables sur la bonne marche de lactivit, mieux encore, il y a des choix fiscaux qui peuvent rduire la barrire capitalistique pour pntrer le march en conomisant, de lordre dun cinquime, la dpense initiale dinvestissement, tels choix vont certainement renforcer le fond de roulement constituant le coussin de scurit de lactivit et accroitre la capacit dendettement de lentreprise. Dautres choix fiscaux peuvent allger le besoin en fond de roulement de la firme, tel est le cas, des choix excuts en matire de TVA (lassujettissement, fait gnrateur et le rgime de dclaration). Certes, un investissement doit dabord tre tranch sur la base des paramtres conomiques (VAN, TRI etc.). Nanmoins, cela nempche pas que la fiscalit doit tre prise en compte pour adapter le fiscal lconomique.De ce qui prcde, valuer limpact du paramtre fiscal sur la dcision dinvestissement prise par une TPE va aider certainement renforcer la prennit de la TPE. Litinraire dcrit ci-dessus, ma permis darrter la question centrale de recherche ci-aprs:La question centrale Quel est limpact du paramtre fiscal sur la dcision dinvestissement, cas des TPE marocaines?Les sous-questions de rechercheEtudier limpact du paramtre fiscal sur la dcision dinvestissement revient tudier limpact de celui-ci sur les donnes conomique de linvestissement savoir; la dpense initiale, les cash-flows prvisionnels et la valeur rsiduelle. La pnurie des travaux scientifiques traitant de limpact du paramtre fiscal sur les dcisions de gestion en gnrale et sur la dcision dinvestissement en particulier, nous a amener procder un entretien avec M, Ahmed BENYATO Expert en fiscalit des entreprises et Ex directeur rgional des impt EL JADIDA, pour arrter les principales dimensions fiscales sous-jacentes ayant des incidences sur les paramtres de la dcision dinvestissement pour le cas dune TPE. Les dimensions fiscales rpertories sont les suivantes: Lincident du choix de la forme juridique sur la dcision dinvestissement; Lincident de linscription dun lment au bilan ou le maintenir dans le Patrimoine priv; Lincident de la tva sur la dcision dinvestissement; Lincident du mode damortissement sur la dcision dinvestissement; Lincident fiscal du dsinvestissement sur la dcision dinvestissement.Lintrt thorique du thmeLe rasage thorique fait par nous mme de la littrature traitant de limpact de la fiscalit sur la dcision dinvestissement nous a permis davancer les observations suivantes: Linexistence des tudes traitant la gestion fiscale des TPE marocaines. Lensemble des tudes ralises, traitent le sujet dans un cadre macro conomique en proposant des modles conomtriques mettant en relation les incitations fiscales et lvolution de linvestissement.Limportance de la fiscalit dans la vie de lentreprise et la raret des tudes ayant intgr la variable fiscale dans les dcisions financires de lentreprise ont constitu une motivation pour effectuer cette recherche. ce titre, ce papier se veut une contribution modeste qui vise combler le vide thorique repr en valuant limpact du paramtre fiscal sur la dcision dinvestissement dune TPE marocaine. Lintrt managrial du thmeLe thme objet dtude vise trois objectifs managriaux: Proposer une plate forme optimisatrice de la fiscalit renforant la rentabilit prvisionnelle dune dcision dinvestissement prise par une TPE marocaine. Mettre la disposition des fiduciaires un outil de travail rpertoriant les voies dintgration de la variable fiscal dans les dcisions financires, pour renforcer leur rle en matire du conseil fiscal. Renforcer le tissue conomique marocain dont la part de lion revient aux TPE, en les sensibilisant de la ncessit dun encadrement fiscal prs et post investissement.Plan de la recherchePour rsoudre la problmatique de cette recherche, nous allons adopter le plan de recherche suivant: Dans un premier chapitre nous allons dfinir le cadre conceptuel du thme savoir la TPE, la dcision dinvestissement et la gestion fiscale, Dans un deuxime chapitre nous allons tudier limpact de la fiscalit sur la dcision dinvestissement et. Dans un dernier chapitre nous allons exposer les principaux choix fiscaux affectant la rentabilit dune TPE avec des cas simulatifs, en essayant de rpondre lensemble des sous-questions de recherches. En guise dintroduction, nous tenons rappeler que lultime objectif poursuivi travers cette tude consiste essentiellement prospecter les voies dintgration du systme fiscal dans la dcision dinvestissement prise par les TPE en incitant leurs dirigeants adopter un comportement plus dynamique vis--vis de la variable fiscale.
.Cadre conceptuel: la TPE, la gestion fiscale et la dcision dinvestissementLes trs petites entreprises (TPE) occupent la part lonine dans le tissu conomique national, en dpit de leur potentiel promouvoir la croissance conomique et gnrer l'emploi, les TPE font face des contraintes multiples dont la difficult de mettre en uvre une gestion fiscale de linvestissement constitue lune des contraintes majeures.Les TPE, faute de la comptence de leurs patrons et la de pnurie de leurs moyens financiers pour accder au conseil fiscal, se contentent de remplir les imprims administratifs, alors que les grandes entreprises disposent la possibilit de prvoir et de dominer l'impt et utilisent bon escient les moyens fournis par une fiscalit incitative qui offre des choix multiples.La variable fiscale est prsente tout au long de la vie de lentreprise depuis sa cration jusqu sa liquidation. La citation ci-aprs raffirme ce postulat S'il est une rglementation administrative qui a toujours atteint l'entreprise, c'est bien la rglementation financire et fiscale : chaque firme est atteinte dans sa structure, ses objectifs de faon directe ou de manire incidente [footnoteRef:2]. [2: ARMEL LIGER op. cit. p. 15.]
La dcision dinvestissement constitue la premire dcision prise dans un projet de cration et du dveloppement dune affaire quelconque, Toutefois, le paramtre fiscal nest pas en reste de cette scne. Pour dvelopper ces propos, nous allons diviser ce chapitre en trois (3) sections: La section (I) sera consacre la dfinition de la TPE dans le contexte international et marocain; La section (II) sera consacre la gestion fiscale, volution conceptuelle, intrt et contraintes; La section (III) sera consacre la dcision dinvestissement, dfinition du concept, typologie et paramtres de linvestissement.
La Trs Petite Entreprise et ses spcificitsDonner une dfinition pertinente la trs petite entreprise nest pas une rflexion facile mener, la seule piste pour se faire, est de connaitre ses spcificits par rapport aux autres types de structures. Nanmoins, lhtrognit qui caractrise cette classe dentreprise rend la mission de sa dfinition laborieuse accomplir. La citation suivante raffirme ce constat quelle affinit y a-t-il entre une personne licencie qui uvre un commerce dans son village, ou un tudiant qui, aprs avoir termin ses tudes, loue des machines photocopier pour offrir un tel service prs de sa facult, et louvrier spcialis qui, aprs avoir accumuler des annes de formation et dexprience dans une grande entreprise, dcide de partir son propre compte, ou encore lingnieur qui crer une start-up dans le secteur de haute technologie. Depuis les annes 1990, les chercheurs ont pris conscience du poids des TPE dans le tissu conomique des pays ce titre, nombreuses sont les travaux de recherche qui ont intgr la TPE dans la typologie des entreprises.Dans cette section nous allons essayer dinventorier lensemble de ces travaux, en appelant les trois critres ci-aprs: Le critre quantitatif caractrisant la TPE; Le critre qualitatif caractrisant la TPE; La dmographie de la TPE au Maroc.
Le critre quantitatifLes adeptes de lapproche quantitative, font appel aux grandeurs ci-aprs pour riger une typologie des entreprises: Leffectif des employs; Le chiffre daffaire Le total du bilan. A ce titre nous allons voir ensemble, la typologie propose linternational et celle dresser par le lgislateur marocain pour dfinir une TPE.La TPE linternationalLe projetles PME et la modernisation (1997) De lOCDE traitant des typologies des PME a pu mettre en lumire les disparits existantes entre les pays en matire de dfinition de la TPE.Pour chaque pays lexpression TPE recouvre des ralits diffrentes induisant des grandeurs distinctes. Nanmoins, Les dfinitions cites dans ce projet se sont convenues sur lide stipulant quune TPE compte moins de 20 employs quoiquune minorit des pays optent pour des seuils plus bas (10 ou 5 salaris). Ce seuil diffre galement selon quil sagisse dune entreprise de service ou dindustrie.Dans le but de normaliser la typologie des entreprises de lunion europenne, La premire recommandation de lUnion Europenne du 03 avril 1996[footnoteRef:3] dfinit la micro, petite et moyenne entreprise en appelant trois critres savoir leffectif des salaris, le chiffre daffaires et le total du bilan. [3: Les deux recommandations sont disponibles sur le portail de lunion europenne]
Le 06 mai 2003, la commission europenne effectue quelques modifications et complte le vide existant. Les principaux changements touchent principalement les plafonds du chiffre daffaires et le total bilan et lintroduction de ces seuils pour la micro-entreprise.Le tableau ci-aprs illustre la typologie des entreprises dresse par la commission europenne:Type dentreprise Effectif des salarisChiffre daffaireTotal du bilan
Moyenne entreprise 50-249