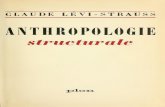ROBERT LION L' ETAT PASSION PLON
-
Upload
nguyenliem -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of ROBERT LION L' ETAT PASSION PLON
PRÉFACE
Après trente ans de service public, ce livre pour- rait être un rapport, un compte rendu de mission. Je l'ai voulu compte rendu de passion.
Le secteur public m'a mordu, si morsure signifie envoûtement, plaisir, blessures. J'ai vécu avec lui une longue affaire de coeur. Une de ces histoires brûlantes qui tissent la trame d'une vie.
Je voudrais tout autant que ces pages soient un message, et communiquent ma passion. Fonc- tionnaire, cela peut être le plus beau des métiers. Et demain plus souvent qu'aujourd'hui, pour le bonheur commun de la Nation et de ses servi- teurs.
Je le sais mieux que d'autres, l'État a mauvaise allure, son image est abîmée, son rendement est souvent misérable. Cela doit changer, tout le monde s'accorde à le dire. Le changement est à portée de main, au contraire de tout ce que le monde pense.
Je vais essayer de le montrer. Avec passion. En
9
m'appuyant sur trente ans de vie active, à des points charnières entre l'État et la société.
Ma rencontre avec l'État commence de manière ordinaire. Après une éducation bourgeoise, on a moins de mérite à réussir les concours et à « sor- tir » de l'École nationale d'administration dans l'inspection des finances. ,
Mon père m'avait élevé dans l'amour de l'État et beaucoup parlé de la Patrie, qu'au long des deux guerres il avait magnifiquement servie. J'avais moi-même assez longtemps porté l'uni- forme - trente mois, au temps amer de l'Algérie - et appris très jeune que le service de la nation peut tantôt abaisser, tantôt sublimer les hommes.
Mon premier métier dans l'État fut de vérifier les administrations, comme tout jeune inspecteur des finances. Ce métier apprend à de futurs man- darins (dans les années 1960, on ne parlait pas d'énarques) à connaître les rouages modestes et vitaux de l'État. Il est école de rigueur : si vous n'avez pas compris les travaux du percepteur que vous contrôlez, et si vous le blâmez à mauvais escient, vous récoltez le « claquage », c'est-à-dire le déshonneur.
J'ai traversé quelques « cabinets », auprès de Maurice Grimaud, préfet de Savoie, d'Edgard Pisani, ministre de l'Equipement, de Paul Delou- vrier, préfet de la région parisienne. Et j'ai dirigé un an, en 1981 et 1982, le cabinet de Pierre Mauroy, Premier ministre. Ces passages rapides m?ont appris que les modes de décision dans l'Etat sont d'autant plus irrationnels que l'on s'élève dans la pyramide.
10
Le directeur du cabinet du Premier ministre connaît une vie étrange. Il lui arrive de participer aux décisions qui se préparent, il joue souvent un rôle actif dans les nominations qui dépendent du gouvernement, il a prise sur certains événements quotidiens, mais il est avant tout un aiguilleur de dossiers et orchestre les travaux du gouvernement. Les urgences et l'imprévisible ne lui laissent ni le loisir ni le recul nécessaire - si toutefois son patron lui en reconnaît la vocation - pour susciter lui-même des réformes dans l'État. Il peut déjà être heureux si, comme cela m'est arrivé à propos des lois de décentralisation de Gaston Defferre au début de la législature, son rôle dans la fixation des calendriers et les ordres du jour lui permet de favoriser une politique d'envergure.
De 1969 à 1974, directeur de la construction au ministère de l'Équipement, je commandais les services qui tracent et mettent en oeuvre la poli- tique du logement. Ils formaient alors une admi- nistration puissante. Elle gérait des crédits consi- dérables, l'« aide à la pierre » qui finançait 130 000 HLM locatives chaque année, et aidait 200 000 autres logements. Elle s'occupait des loyers réglementés, des bidonvilles à résorber, des priorités d'accès des mal-logés aux HLM. Nous avons lancé l'animation et la rénovation des « grands ensembles » et stimulé l'innovation dans l'habitat. La direction de la construction exerçait en outre la tutelle des organismes d'HLM et des promoteurs; elle avait beaucoup à faire avec les architectes et le bâtiment.
11 l
C'était une administration centrale bien huilée et solidement encadrée. Elle le devait à Raoul Dautry et Eugène Claudius-Petit qui, vingt ans plus tôt, avaient donné aux services des dom- mages de guerre et de la reconstruction une impulsion décisive et recruté des grands commis hors pair, largement issus du Conseil d'État. Comme c'est encore le cas, elle était relayée par le réseau des directions départementales de l'équipe- ment, à vrai dire plus branchées à l'époque sur les routes que sur le logement.
Ce bel outil demeurait cependant rigide et jaco- bin et terriblement tutélaire dans ses rapports avec son environnement. J'ai essayé de le décoin- cer et de le moderniser.
J'étonnai beaucoup de monde, à commencer par Olivier Guichard, mon ministre, en quittant cette position de pouvoir pour devenir, en 1974, le délégué général de l'Union des HLM. Certains inspecteurs des finances me reprochèrent de « déroger » !
Je répondais à l'appel du président du Mouve- ment HLM, Albert Denvers, député et président du conseil général du Nord, homme de coeur et de foi. Élu sans autre interruption que la guerre depuis le Front populaire, il fut, trente ans durant, l'apôtre du logement social, au service des plus modestes, ceux qu'avec grandeur il nommait « les petits ».
L'Union des fédérations HLM est un syndicat professionnel. Ses adhérents ont tantôt des racines politiques, du parti communiste à la droite tradi-
12
tionnelle; ils sont tantôt d'origine patronale ou caritative. Le délégué général de cette Union est nommé par un comité directeur, lui-même élu par la base du mouvement. Il est donc le mandataire de cette base. Mais je n'ai pas conçu ce mandat comme passif : il m'a semblé naturel de l'utiliser pour faire évoluer les HLM, quitte à déranger souvent. Semaine après semaine, j'ai connu la France des élus et les banlieues à problèmes. Le mouvement HLM a changé et pris du poids, durant ces années. Plus vif, attentif aux nouvelles tensions sociales dans les villes, mieux géré, il est apparu comme le grand groupe de pression dans l'habitat.
Je n'étais plus au service de l'État. Je n'avais pas pour autant quitté le service public : l'État n'en a pas le monopole, et la cause du logement social, que nous défendions, était bien une par- celle de l'intérêt général.
J'ai appris, pendant mes sept ans aux HLM, à gérer une entreprise de droit privé : les services techniques, juridiques, financiers de l'Union, ceux en charge de l'image et de la communication des HLM, ou encore de la formation, représentaient cinq cents personnes. J'ai appris à jouer du pou- voir d'un grand « lobby », dans une joute quoti- dienne avec l'État. J'ai mieux compris comment on entraîne un grand corps social à changer un peu ses réflexes et ses comportements. Ce fut la plus rude étape de mon parcours et la plus belle école pour moi.
Avec la Caisse des dépôts et consignations, je
13
me rapprochai à nouveau de l'État. Nommé directeur général, à ma surprise, en 1982, je me trouvai à la tête d'une formidable machine, que j'avais côtoyée comme pourvoyeuse du logement social et dont j'appréciais vivement les patrons précédents, François Bloch-Lainé et Maurice Pérouse, tous deux venus directement du Trésor, ce qui donnait à mon arrivée rue de Lille, au sor- tir de Matignon, un tour inédit. Je mesurais mal la puissance de la Caisse dans la sphère finan- cière, dans l'assurance, dans le domaine des retraites, pour ne pas parler de ses innombrables filiales techniques.
J'ai découvert progressivement cette com- plexité. Mais aussi les racines de cette maison. J'ai compris la logique d'un statut original et d'une autonomie hors du commun : en 1816, dans un pays ruiné et défait, où le crédit était mort, il fallait avant tout restaurer la confiance, afin de ressusciter l'épargne et de réamorcer la finance et l'économie. Un législateur éclairé fit fond, à cette fin, sur le crédit que pouvaient inspirer deux éta- blissements jumeaux, la nouvelle Caisse des dépôts et consignations et la nouvelle Caisse d'amortissement. Pour que, suivant la vieille devise de la « foi publique », ce crédit soit assuré, il fallait garantir aux épargnants et aux rentiers que les sommes confiées à ces deux établissements ne pouvaient être détournées par l'État, comme lors des tentatives antérieures, en particulier à la fin des guerres napoléoniennes. D'où l'indépen- dance conférée au directeur général de ces deux
14
Caisses : suivant les textes fondateurs, il est nommé « par le Roi » mais ne subit pas la tutelle du pouvoir exécutif. Sa fonction étant de sauve- garder les sommes déposées, il a le pouvoir de dire non. Ainsi l'épargne en France a-t-elle été protégée, la confiance rétablie. Et les caisses d'épargne naissantes batailleront vingt ans pour être autorisées, en 1837, à remettre leurs fonds à la Caisse des dépôts et non plus dans les mains du Trésor.
La loi fondatrice a placé le directeur général « sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ». Le Parlement protège la Caisse, ou plutôt les deniers, exclusivement privés, qu'elle gère. D'où la Commission de surveillance, émana- tion du Parlement, sous le contrôle de laquelle j'ai travaillé dix ans.
L'histoire de la Caisse des dépôts est celle d'une extension raisonnée de ses responsabilités, au cours des xix` et xx` siècles. Aujourd'hui, elle exerce quatre activités principales :
0 Dans le domaine de l'épargne et de la pré- voyance, elle constitue la clé de voûte du dispositif français de collecte de l'épargne populaire, en particulier les caisses d'épargne et les services financiers de la Poste; sa filiale la CNP est la première compagnie d'assurance-vie du pays.
0 Elle est un acteur majeur sur les marchés financiers. Les portefeuilles mobiliers considé- rables qu'elle gère font d'elle le premier investis- seur institutionnel français.
. Elle joue un grand rôle dans le développe-
15
ment local : elle finance le logement social; sa filiale Crédit local de France est le banquier de . référence du secteur; ses filiales techniques, spé- cialisées notamment dans le logement et l'amé- nagement urbain, interviennent souvent à travers un vaste réseau de sociétés d'économie mixte où la Caisse des dépôts est associée à des collectivités locales.
e La Caisse des dépôts gère, à la demande de l'État, de multiples établissements financiers et d'importantes caisses de retraites.
Cet ensemble est puissant, on le sait. Il est de plus en plus international. Il intervient souvent comme auxiliaire de l'État, par exemple lorsqu'il s'agit de moderniser la gestion de la dette du Tré- sor ou de lancer des nouveaux produits d'épargne. Il dispose d'une réelle autonomie, sous le contrôle de sa Commission de surveillance, pour conduire des actions spécifiques dans le tourisme, la communication, le développement social des quar- tiers en difficulté, le mécénat culturel ou l'envi- ronnement. Aussi quand la Caisse participa en 1988, à un « raid » sur une banque privée, cela devint une affaire d'État... Quand elle lancera, demain, des fonds de pension, cela ne passera pas inaperçu.
Voici donc campé le décor de la métamorphose d'un ensemble administratif, monolithique et opaque, en groupe d'entreprises déployées métier par métier.
J'essaierai de montrer à quel point cette expé- rience, qui a prolongé pour moi celle de la direc-
16
tion de la construction et celle des HLM, peut inspirer la réforme de l'État. Elle n'est pas le seul modèle : d'autres modernisations actives sont en cours dans le secteur public français. Et je ne pro- pose pas de potion magique qui règle tous les problèmes.
La Caisse des dépôts aura été la grande page de ma vie professionnelle. Qu'on me pardonne, au long de ces pages écrites dans le feu de l'action, en 1991 et 1992, de parler d'elle au présent, alors que cela n'aura plus lieu d'être quand ce livre sortira. Quand je dis « nous », c'est l'oeuvre conjointe de la Caisse des dépôts et de son groupe, de ses personnels, de ses directeurs, hommes et femmes, réunis dans son conseil exécutif, que je veux évoquer.
Ce parcours en trois longues étapes, cinq, sept et dix ans n'a pas seulement inspiré une passion. Il a forgé mon expérience et mes quelques certi- tudes.
Ce livre est nourri, en effet, d'expérience, pas du tout des traités sur l'État et sur la gestion moderne. Il est le contraire d'une étude scienti- fique sur le management. Ce sont des leçons per- sonnelles que je propose.
Je veux surtout faire partager deux convic- tions :
e Se doter d'un État performant devrait être la grande affaire des années 90, parallèlement au rôle majeur de la France dans la construction de l'Europe.
17
e Cette modernisation de l'État est possible. Et, plus que jamais, cela vaut la peine de servir en France dans les rangs de l'Etat, des collectivités locales ou du secteur public.
J'ai d'abord écrit ce livre à l'intention d'un élève de l'ENA que je connais bien. Je l'ai vu «galérer» » au sein de l'Éducation nationale, comme professeur de sciences économiques dans l'enseignement secondaire. Il a cravaché pour entrer à l'ENA. Il m'est apparu indécis au cours de sa scolarité, rue de l'Université. Tant de ses prédécesseurs ont dernièrement jeté l'éponge, aussitôt diplômés, pour passer au secteur privé, plus stimulant et plus valorisant à leurs yeux, pas seulement mieux payé! Lui-même, habité par le secteur public, s'interroge : peut-on véri- tablement en France, en 1992, faire bouger l'État ?
Je lui ai dit : « oui ! » Il m'a répondu : « Il faut que ceux qui ont là-dessus quelque chose à dire nous le prouvent. » J'ai tenté de le faire ici.
Au sein de l'État et de la sphère publique, c'est tout le monde qu'il faut convaincre, à tous les niveaux. Mesdames et messieurs les fonction- naires, le mouvement est possible. Chaque fois, il procédera d'impulsions venues d'en haut mais aussi d'aspirations et d'initiatives décentralisées, c'est-à-dire de vous-mêmes. Chacun doit s'y mettre. ,
Au-delà de l'État, mon espoir est que l'ensemble des Français se sente concerné, qu'ils veuillent, les premiers, un État performant. En
18
ces temps où le moral est bas, voici un grand pro- jet pour notre pays, que nous devons, bien entendu, nous proposer dans la perspective de l'Union européenne. Voici un combat, digne de passion, qu'il est temps de livrer, et que nous pouvons gagner.
Paris, septembre 1992
INTRODUCTION
Un dimanche soir de septembre 1984, la « Fête de la forme », dont la Caisse des dépôts est le mécène, s'achève à Versailles. Une femme m'aborde. Elle est adjointe au maire et porteuse d'une petite doléance : le prêt que la ville royale attend de la Caisse tarde à venir. Comme pour s'excuser, elle soupire, avec une énorme gen- tillesse : « Je sais bien que c'est l'administration... »
Le trait me pique au vif. D'abord, la Caisse des dépôts, autonome à l'égard de l'État, n'est jamais heureuse d'être confondue avec l'adminis- tration. Mais surtout, je n'aime pas, moi qui en suis le patron, qu'on la tienne pour si peu per- formante. Fier d'être issu de la fonction publique, je déteste qu'on excuse une faiblesse par ce triste constat : « c'est l'administration ». Le plus grave, dans ce propos anodin et assassin, c'était le sourire résigné, ce « je sais bien »... La cause est entendue : l'administration, par défini- tion, marche mal.
21
L'incident de Versailles n'est pas le seul du genre : j'ai entendu bien des critiques, connu bien des désillusions, des revers, dans mon par- cours au travers du service public. Cela a suscité chez moi deux réactions. La Caisse des dépôts, d'abord, on va la changer! J'avais essayé de changer, voire de bousculer, d'autres entreprises ou services dont j'avais eu la charge. Bien ou mal, le changement a eu lieu, la Caisse des dépôts a pris un nouveau visage.
Deuxième réaction : l'État, comme tout le sec- teur public, et en particulier les collectivités locales, doit devenir moderne et tonique. Mais on est loin du compte. Et je veux démontrer que le renouveau est jouable, qu'il ne faut pas se rési- gner.
L'État marche mal? La conviction est géné- rale, et se double d'une méchante critique des fonctionnaires. « Privilégiés », « nantis », trop nombreux, ils nous coûtent cher. Quant au résul- tat, on n'en a pas pour son argent. Mais aussi- tôt, on baisse les bras. Cette élue de Versailles était tout indulgence, et non pas révoltée... La crise de l'État ? Un mauvais rhumatisme qu' « on fait aller », parce que c'est ainsi. Et le mal est sans remède... ,
Il se déverse des flots de littérature sur l'État. Ce livre doit être le dixième essai depuis le début de l'année! Mais la question ne déclenche pas les passions. L'État n'est qu'un sujet mollement à la mode. Un sujet triste, au fond. Peut-être parce que l'État est couleur de grisaille. Parce que sa
22
réforme a l'allure d'une impasse. Qui a jamais proposé des pistes claires pour tirer l'État du bourbier? D'autres causes sont offertes à ceux qui ont le goût de se battre, loin de la chose publique, plus stimulantes, plus claires. Et pas des causes perdues...
Je récuse le soupir gentil et résigné. Je veux me battre, au contraire, sur ce terrain. Et d'abord contre ce désenchantement. Un : le sujet est capital. Deux : la cause n'est pas perdue.
Un sujet capital : le mot est fort, mais j'ai la passion de l'Etat. En cette rude année 1992, voici que notre vieux pays fonce, de manière à la fois programmée et floue, vers son avenir euro- péen. Et cette Europe pour laquelle il a voté du bout des lèvres, il n'est pas sûr d'en comprendre le sens. Dans cette union indéfinissable, va-t-il se perdre ou se dépasser? Quelle France pouvons- nous espérer, et dans quelle Europe ?
Pour cette navigation décisive, incertaine, c'est l'État qui nous manque le plus. Il fut au coeur de notre histoire, il en fut l'initiateur, il réunit les provinces, construisit la Nation. Il y a un siècle, il fut le grand artisan de la République : elle s'est enracinée parce qu'il s'arc-boutait pour l'établir, inspiré au sommet par des hommes éclairés, et s'incarnant, du grand commis à l'ins- tituteur, dans des hussards noirs militants. Alors, l'État pilotait le pays. Aujourd'hui, plus lourdes encore sont les enchères : jouer à fond l'Union européenne sans diminuer la France; trouver la
23
juste réponse quand, à travers le monde, l'indif- férence et la barbarie sèment la mort et ravagent le droit; tenir le cap dans un contexte écono- mique impitoyable et chaotique. Nous ne pou- vons, moins que jamais, nous passer d'un pilote qui éclaire la route, propose un destin, main- tienne la cohésion de la collectivité nationale.
Comme hier, la France a besoin de l'État. Encore faut-il qu'il se trouve reconnu. Et c'est ici que le bât blesse. Du fond des provinces au coeur de Paris, les Français ne croient plus en l'État. Ils doutent de son efficacité, de son inté- grité, de sa légitimité. Ce doute, en retour, affai- blit l'État. La crise se nourrit d'elle-même. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle tombe mal. La colonne vertébrale de la nation flanche au mauvais moment.
La cause n'est pas perdue. Le changement de pied, comme disent les cavaliers, est à mes yeux possible. Avant la fin de ce siècle, la France, qui alors sera, sans retour, européenne, aura, tel est mon pari, rénové l'appareil de l'État. Il faut certes qu'elle le veuille. Ce pays va-t-il se donner les cartes du futur pour continuer d'exister demain, tout en s'affichant bon citoyen de l'Europe unie ?
Ce n'est pas gagné. Ce sera un combat. Il est le propos de ce livre.
J'apporte à ce combat ce que je sais et ce que je suis. La position carrefour de la Caisse des dépôts permet une analyse de ce qui se passe au sein de l'État, mais aussi au-dehors, ce grand
24
large que les fonctionnaires français ignorent trop souvent : les bouleversements que l'entre- prise a, depuis quinze ans, traversés, le jeu des forces économiques dans les pays anglo-saxons et au Japon, les nouveaux registres orchestrés par les médias, performance, communication, etc. sur lesquels se mobilisent les générations montantes. J'ai vécu trente années-passion dans le service public, et trois responsabilités : de 1969 à 1974, la direction de la construction, une administra- tion centrale; de 1974 à 1981, l'Union des HLM, un syndicat professionnel animé par l'esprit de service public; depuis 1982, la Caisse des dépôts, au départ une administration, aujourd'hui un groupe d'entreprises aux fron- tières de l'État. Je parlerai moins de mes épi- sodes antérieurs et de mon passage à Matignon, en 1981, comme directeur de cabinet de Pierre Mauroy, qui ne dura qu'un an, où je ne commandais ni administration ni entreprise et n'étais directement le patron de rien.
J'apporte une conviction, qui est pour moi religion : tout homme au travail doit être motivé, et la motivation naît de la responsabilité trans- férée, de l'initiative encouragée.
J'apporte une ambition. J'ai choisi l'État. J'annonce ma couleur : je suis ambitieux pour lui. J'attends de lui la chose la plus difficile, qu'il devienne tonique et performant.
L'État est votre Etat. Il est votre affaire. Ne soyez ni indulgents, ni résignés à son égard. Montrez-vous d'autant plus exigeants qu'il peut
25
- soyez-en persuadés - changer de peau, de style, d'allure. Il peut, avant longtemps, être tel que vous redeveniez, comme vos aïeux, fiers de lui. Je voudrais aussi interpeller les fonction- naires désabusés, rattraper par la manche les plus jeunes, qui tournent casaque avant même d'avoir tenté de rénover l'État. Si vous avez du tempérament, c'est avec vous, et non par de grandes lois, que ce pays peut se donner l'État qu'il lui faut'.
1. Je recommande à tous égards la lecture du Rapport de Bernard Brunhes et Nathalie Veil sur la modernisation du service public dans cinq pays Europe occidentale. (Rapport établi à la demande de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, ainsi que de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de tra- vail.)
CHAPITRE 1
LA FRANCE BOUGE, L'ÉTAT PATINE
Notre communauté nationale, loin de se souder, se délite.
Elle a perdu ses repères éthiques. Il devient aventureux d'en appeler aux vertus républicaines. La moralité publique est ébréchée. Les institutions et les sphères dirigeantes, même si les fauteurs sont infiniment minoritaires, se trouvent déconsidérées. Les valeurs qui liaient la nation paraissent hors d'âge.
La société est menacée de dislocation. Il n'y a plus de raison collective de se mobiliser : ni chan- tier, ni projet, ni même utopie. Et chacun sent bien que le marché, s'il stimule les énergies, n'offre nulle relève idéologique; beaucoup perçoivent les dérives et les désordres auxquels, quand il se débride, il conduit avec fracas. Ils ont raison : l'argent souve- rain concourt à décomposer la société; son règne sans partage réinstalle des relations de pouvoir absolu entre le fort et le faible; il tue l'esprit répu- blicain, aussi bien que les réflexes solidaires.
27
Les temps sont davantage aux parcours et aux replis individuels qu'aux comportements commu- nautaires. Le réseau des relations sociales est en miettes. Ce grand vide général constitue une trahi- son à l'égard du citoyen, qui est d'abord un animal social, et qui attend de la collectivité dans laquelle il vit qu'elle fasse appel à lui. Dès lors, la société elle-même est en question. Et la démocratie mise en péril : des boulevards s'ouvrent devant ceux qui veulent, dans cette mauvaise passe, la jeter par- dessus bord.
De ces dérives qui pourraient être mortelles, l'État est en partie responsable. Il n'est plus pôle, ni môle, ni pilote. Il ne sait plus cimenter la nation. Il ne sait plus la mettre en mouvement. Il ne sait plus même séduire : il devrait inspirer le respect, incarner l'autorité. Il passe pour l'homme malade d'une nation elle-même mal en point. On parle de lui dans un chuchotement triste.
LA FRANCE QUI BOUGE
La condition de l'État est d'autant plus misé- rable, elle accuse d'autant plus le décalage qui frappe les institutions que, dans ses profondeurs, notre pays bouge et de manière heureuse. Si la communauté nationale tend à se défaire, il vibre ailleurs d'un sang riche et nouveau, en ces lieux intermédiaires entre l'individu et la collectivité qui forment la trame vive d'aujourd'hui : l'entreprise, dont l'image est devenue positive, où la vie profes-
28
sionnelle est souvent extrêmement tonique; les mouvements associatifs, qui mobilisent des mil- lions de Français; les collectivités locales, qui agissent au plus près des citoyens. Là se trouvent l'initiative et la responsabilité, la motivation, souvent la solidarité; ici, on continue de savoir vivre en société. Ces vertus sont ranimées dans le monde occidental. En France, la dernière décennie a été celle de la décentralisation politique et du retour en grâce, inattendu, de l'entreprise.
L'entreprise sort gagnante des années 1980. Loin que les « cent dix propositions » du candidat Mitterrand aient inclus sa promotion, elle était, pour les socialistes arrivant aux commandes, le terrain de luttes historiques et un rouage suspect de l'économie. Or, voici qu'on aime maintenant l'entreprise pour elle-même, pour son tonus, ses succès et ses médailles, et qu'on chante ses profits et souvent ses patrons. Étrange virement de bord, étranges Français!
Quittons le registre sentimental. L'entreprise n'est pas un paradis. Le quotidien y est fait souvent de relations dures entre la hiérarchie et les personnels, d'attitudes sans respect ni pitié. Mais l'entreprise stimule la vie sociale. Et sur ce plan, ce qui patine à l'échelon de la nation marche ici plu- tôt bien.
L'entreprise est traditionnellement lieu de revendications et de négociations collectives; bref une expression vivante de la société. Elle devient lieu de mobilisation : au rebours de l'entreprise
29
taylorienne d'hier, elle substitue désormais la res- ponsabilité à l'obéissance, elle fait davantage confiance à l'homme, en appelle à son imagination, cherche à mobiliser son intelligence, et non seule- ment sa force de travail. L'entreprise lance à ses collaborateurs ce message : « Nous ne pouvons gagner, c'est-à-dire exister, sans l'implication de tous, sans votre valeur humaine ajoutée. » Elle sus- cite un échange, généreux pour l'individu, fécond pour l'entreprise.
Une entreprise porte et propose des projets; elle fixe des objectifs; elle imprime une dynamique. Elle demande à ses personnels des engagements : compétence, méthode, efforts, résultats. Ceux-ci jouent le jeu, à condition que se noue, dans la communauté du travail, une forme de démocratie opérationnelle ; c'est à quoi tend la bonne « gestion des ressources humaines ». S'il en va ainsi, les sala- riés seront habités par un civisme d'entreprise, qui est en somme l'expression collective de pulsions positives : appartenance, solidarité, communauté d'intérêts.
L'entreprise n'est jamais décalée par rapport au monde. Sa chance est de ne pas en avoir le droit. Le marché la sanctionne radicalement. L'action politique ou l'inaction administrative ne connais- sent pas de pareils verdicts. L'État peut flotter à côté du réel, et cependant survivre. L'entreprise, pliée au principe de réalité, ne le peut pas.
Son dialogue avec le marché est concret, réel, exigeant. L'entreprise est un tonique pour la société.
30
L'entreprise d'aujourd'hui devient, curieuse- ment, agent de moralité. Contrainte à la déontolo- gie, saisie par l'éthique, héraut, fréquent désor- mais, de l'écologie, tenant la vedette dans l'ima- ginaire collectif, ayant ravi au politique le crédit qui fut le sien, elle rêve de prendre sa relève sur le registre des valeurs.
Au total, voici un rouage de la société en phase avec son temps. Elle n'ignore ni les turpitudes, ni les excès. Mais elle contribue, dans un monde ato- misé, à faire vivre les hommes en société. Elle contribue ainsi à soutenir la démocratie, fonction majeure de l'État, que celui-ci a laissé glisser entre ses doigts.
Il en va de même des rouages intermédiaires entre le citoyen et l'État, que la décentralisation a multipliés. Tant celle-ci rend innombrables les porteurs de responsabilité.
Au premier rang, les collectivités locales : nos communes, villes ou villages, départements, régions, qui furent jadis nos provinces. Comme les entreprises, ces rouages du pays ont également marqué des points dans les années 1980. Faut-il pavoiser ? Avec les lois décentralisatrices de Gas- ton Defferre, la France s'est seulement alignée, et plutôt vers le bas, sur ses voisins occidentaux. Et pourtant, fondées sur une base saine - on ne célé- brera jamais assez la loi municipale de 1884 -, les réformes de 1982 ont représenté la plus grande avancée institutionnelle en France depuis la constitution de 1958, et avant Maastricht!
31
Communes, départements et régions ne se portent pas toujours bien. Gestions médiocres, voire comportements malhonnêtes, existent ici ou là. La Caisse des dépôts sait d'expérience que des villes en France sont mal administrées; il y a un an éclatait au grand jour le scandale d'Angoulême. Mais quelques arbres ne doivent pas cacher la forêt, et la décentralisation est un succès.
La vie locale conforte la vie en société. Un maire est responsable d'actions visibles; il est normale- ment réélu ou récusé pour avoir mené à bien des projets concrets, ou ne pas avoir fait tels gestes incontestables. La vie locale mobilise les hommes : ils appartiennent à une ville ou à une province; ils en sont solidaires. Il y a longtemps qu'on le chante, « je suis fier d'être bourguignon! » Demain, on sera européen et breton, ou européen et montpelliérain, comme d'autres seront euro- péens et catalans, ou bavarois, ou flamands... la citoyenneté a ici un sens.
D'autres réseaux, innombrables et vivants, constituent la France décentralisée et sont autant d'artisans quotidiens de vie en société. Nos civilisa- tions occidentales ont cette capacité de susciter, en dehors des institutions publiques et du marché, et souvent pour pallier leurs carences, une floraison d'initiatives. Ce que développent à l'infini fonda- tions, associations culturelles, sociales, humani- taires, sportives, ne marche pas toujours; les esprits chagrins y trouveront redondances et inco- hérences. Mais cette éclosion permanente d'inten- tions et de projets est trois fois riche : elle irrigue
32
les interstices de la société et multiplie, à partir d'engagements individuels, des micro-communau- tés agissantes; elle ouvre aux hommes des plages d'expression, exactement ce que leur refusait la société planifiée des Soviétiques, et ce par quoi celle-ci a péri ; la vie associative met les hommes à même de découvrir l'efficacité de l'action collective.
Cette société civique aux mille canaux est la force vive du pays. La décentralisation, exclusive- ment institutionnelle, de 1982 l'a trop oubliée; elle a négligé ce qu'Hubert Dubedout avait si bien
appuyé à Grenoble, où la responsabilité des asso- ciations et des citoyens avait été promue, à part entière, élément constitutif de la cité; les lois de décentralisation n'ont pas su reconnaître des rôles à la base. Mais la nature a imposé ses propres lois et stimulé un va-et-vient organique, tantôt conflic- tuel et tantôt confiant, plus qu'on ne l'a jamais vu dans le passé de la France, entre institutions éta- blies et réseaux informels.
Ayant dirigé une administration, un syndicat professionnel, un établissement public, j'ai souvent cherché, voire suscité des partenaires issus de la base, à qui transférer des responsabilités. Direc- teur de la construction, j'ai créé les commissions
propriétaires-locataires, chargées, à partir de 1973, de dire la bonne règle en matière locative. Aux HLM, nous avons imaginé les comités d'usa-
gers et ces médiateurs que furent les commissions mixtes, qui contribuèrent à établir un peu de démocratie dans l'habitat social et à réduire les tensions au coeur des banlieues. La Caisse des
33
dépôts, qui s'était organisée en 1983 pour « accompagner la décentralisation », a effectué, ce faisant, un choix véritablement politique : l'appui aux collectivités publiques, mais aussi le soutien de
micro-projets locaux, ceux des jeunes notamment. Parmi bien des initiatives, le Bon Plan, que l'on doit à Pierre Lebaillif, a récompensé des initiatives créant localement des emplois ; les projets Oxygène Campus de 1991 épaulent des réalisations d'étu- diants pour faire sortir l'Université de ses murs; notre soutien aux « entreprises d'insertion » aide les jeunes chômeurs à prendre pied dans la vie active.
Face à l'exceptionnel, la France se montre tou-
jours solidaire. Ce pays n'est pas seulement celui
qui, avec les French doctors, envoie au loin les cohortes médicales les plus nombreuses. Il sait aussi, quand le drame s'abat à domicile, déployer dévouements et talents. On a vu à Vaison-la- Romaine, aux côtés de services publics exem-
plaires, une mobilisation spectaculaire de la société civile. Un tel élan de solidarité n'est pas anodin : à certaines heures, le lien social demeure vivace.
Le sens de la fête, enfin, n'a pas sombré. Cer- tains jours, l'homme d'Occident quitte ses replis et redevient communautaire. Héritage, bien entendu, du fond des temps, que scandaient les célébrations et les rites, les foires et les jeux. En cette année
d'Olympiades et d'Exposition universelle, la convi- vialité cosmopolite a illuminé ces rencontres.
L'époque vibre aux exploits sportifs. Et la fête est redescendue dans la rue - on doit à Jack Lang une
34
des plus heureuses idées de la décennie : la Fête de la musique. Les médias eux-mêmes, ces tueurs de convivialité publique, font parfois bouger la pla- nète au gré de grands concerts. Et la vague écolo- gique a des accents soixante-huitards de bon aloi, tant c'est une bonne manière de traiter des choses sérieuses sur un mode ludique. Oui, nous savons toujours danser et chanter, et la vie en société n'est pas morte.
Je n'ai survolé les eaux vives du monde social que pour souligner combien l'État et la sphère publique apparaissent décalés. Ils devraient adhé- rer à la société, en même temps que la surplomber. Ils flottent plutôt à ses côtés, sans prise sérieuse sur la vie, acteurs à la fois rituels et anachro- niques.
L'ÉTAT RIGIDE ET MOU
J'ai vécu l'État du dedans, je l'ai beaucoup pra- tiqué à ses marches. J'ai rompu avec lui des lances sans nombre. J'ai avec lui de beaux souvenirs. Et je mesure ses faiblesses d'autant mieux que, sans jamais le quitter des yeux, ni en vérité du coeur, j'ai appris à connaître d'autres univers.
A la veille de l'Europe, la France se trouve encombrée d'un État problème. Il la sert, bien entendu, ou s'efforce de la servir. Il contribue à orienter sa marche dans la bonne direction. Mais il est au total un handicap plutôt qu'un atout.
Certes, l'État tel qu'il marche, ou ne marche
35
pas, chez nos voisins, n'est pas davantage un modèle. Mais l'administration française, vilipen- dée par les Français eux-mêmes, pour son arro- gance technocratique et ses lourdeurs bureaucra- tiques, n'offre pas un antidote convaincant au despotisme des eurocrates, morceau de bravoure des tenants du « non à Maastricht ».
Le poids de la France dans l'Europe ne se mesure pas seulement à ses brillants polytech- niciens, ses juristes éminents, ses économistes dis- tingués et ses jeunes énarques. Il appelle un sérieux lifting de son appareil d'État, avant que ses traits accusés et ses rides ne le rendent intolé- rable à nos partenaires.
Changer l'État : vieille rengaine. Pour parler vrai et utile, que faut-il changer ?
Le bon sens répond. Ce qu'il faut changer, c'est l'inefficacité de l'État. Son coût. Son image. Son autorité. Tout cela se tient. Voyez l'entreprise : elle se préoccupe de lier ses résultats, sa compétiti- vité, son image. La démarche est moderne. L'État en France, lui, n'est pas moderne. Ses vastes équi- pements informatiques n'y font pas plus que les flottes d'hélicoptères de la douane. Car cela se joue d'abord dans les têtes et les comportements.
Comment fait-on aujourd'hui bouger les sys- tèmes complexes ? Plus comme à la parade, ordres aboyés et en colonne par trois. Mais par un jeu mobile de définition d'objectifs, d'adaptation au terrain et de manoeuvres ; par la mobilisation, la persuasion et non plus le commandement. Il faut donc être au diapason des acteurs concernés; il
36
faut avoir le goût de la pédagogie et l'art de la négociation; et jouer en souplesse, sans abaisser son autorité.
L'État est radicalement malhabile à adopter ces comportements modernes. Le plouc, diraient nos enfants! Dans ses profondeurs, il affiche une rigi- dité archaïque. Il cultive la lettre et non pas l'esprit. Déroger à une circulaire est d'autant moins imaginable qu'on descend dans la hiérar- chie. Or quand ils rencontrent l'État, les Français ont à faire aux agents de base. Et le métier de ces fonctionnaires-là, tel qu'on le leur a prescrit, est d'appliquer l'incommensurable collection de règle- ments au moyen desquels notre pays, maniaque de perfectionnisme, a l'ambition, louable dans ses fondements mais ridicule dans ses effets, de traiter tous les cas que la vie invente. Enseveli sous les textes, le fonctionnaire au contact du public applique des millions de virgules.
Pareille relation entre l'État, incarné par un homme ou une femme au bas de la hiérarchie, et le citoyen, est absurde. L'agent public ne la vit pas avec bonheur. Mais à ce niveau il n'a pas le choix. Il ne lui est pas permis d'apporter sa valeur ajou- tée. Et il s'enferme dans la désinvolture ou l'arro- gance. Il a en théorie l'autorité pour lui, le droit, et si besoin la force. Souvent, il le fera sentir sur un ton qui n'est plus de mise.
Toute entreprise, toute institution dans le siècle cherche désormais à plaire. Nous sommes à l'heure du service personnalisé. On sait enfin en France, derrière le guichet d'une banque, sourire, remer-
37
cier le client, se montrer courtois au téléphone, se faire convivial. N'en détonne que davantage la brutalité qui sévit encore du côté des services publics, le dialogue rogue entre l' « assujetti H et le bureau dont il dépend, le sadisme de ces corres- pondances retournées parce qu'une case est incomplète, comme pour rappeler à l' « adminis- tré ? sa condition subordonnée, l'anonymat des courriers ou celui de ces jurys de concours devant lesquels des architectes planchent sans savoir ni le nom ni la qualité de ceux qui les interrogent, ou encore la sécheresse avec laquelle on est souvent - sauf à être un puissant - interpellé par le fac- tionnaire. Tout cela déteint sur l'Etat. Quand le mépris rime avec l'autorité, il fabrique le discrédit. Comment peut-on respecter l'État s'il est aussi décalé par rapport au monde qui bat à ses portes ?
Il règne dans nos bureaux un parfum de sous- développement. Plusieurs États voisins en Europe, où la tradition administrative est moins solide et l'ossature moins ferme, nous distancent sur l'accueil, le sourire, l'attention. Handicap pour la France. Handicap trop sérieux pour le brocarder à la Courteline. Il faut donc y regarder de plus près.
POURQUOI L'ÉTAT PATINE
Le fonctionnaire peut-il être courtois quand il est lui-même privé de considération ? Ce mot fort, dont je fais plus loin un article de foi, a jailli dans l'actualité française à propos des infirmières, des
38
gardiens de prison ou des enseignants. Tout autant, le défaut de considération explique pour une bonne part l'agressivité récente de certains magistrats.
Directeur de la construction, j'ai vécu cinq ans dans les baraques du quai de Passy. Imaginez dix bâtiments de chantier, glacials l'hiver et torrides l'été, aux murs de carton-pâte dans lesquels la poussière semble incrustée, aux corridors craque- lés et sinistres. Ils avaient été bâtis à la hâte en 1945, pour durer dix ans; nous étions en 1970 et ces cabanons rafistolés étaient toujours le siège de puissantes administrations. Ils devaient servir deux décennies encore!
Je blaguais avec mes visiteurs sur le cordonnier mal chaussé. Encore me trouvais-je en position de me faire livrer un mobilier design et quelques oeuvres d'art. Mais je connaissais les bureaux de mes collègues à Londres et à Washington : des immeubles de pierre et de marbre, des bureaux respirant le prestige, un côté « nickel », un accueil et un cadre inimaginables, alors, dans notre pays. Quand ils venaient à Paris, j'éprouvais de la honte. Moi, leur homologue français, j'étais mal consi- déré par mon employeur, c'est-à-dire l'État. Mes collaborateurs davantage encore. Leur travail en souffrait.
J'éprouve de la gêne souvent en parcourant nos ambassades. J'ai frémi dans le bureau de plus d'un conseiller commercial, à qui la République enjoint de vendre l'industrie française. On y voit côte à côte des sièges de générations différentes, la
39
rituelle corbeille en plastique verdâtre, le cendrier Ricard pour la touche de couleur... J'ai blêmi de nos prétoires délabrés ou de tel commissariat de police qui déshonorent ceux qui y servent. Et pourtant, même logée dans des locaux modernes, l'administration se néglige. Elle retourne vite aux moquettes râpées et à la poussière mal essuyée. « Le fonctionnement ne suit pas », explique-t-on... Mauvaise réponse : avec le temps, la spirale de la médiocrité a tué le goût de cirer les meubles et d'astiquer les cuivres. Elle ternit la dignité de l'État.
Oui, l'autorité est aussi affaire de moquette. Les locaux importent autant que les salaires. Et, sur les premiers comme sur les seconds, les petits arbi- trages budgétaires contribuent, au fil des ans, à affaiblir l'Etat. Les courtes vues du Budget - tou-
jours impeccablement argumentées sur de courts horizons - ont fabriqué une administration grise, amère et peu productive. Sur la longue période, la contre-performance est énorme.
Je montrerai dans un prochain chapitre que l'obstacle budgétaire peut être surmonté, sans bourse délier pour l'Etat.
Mais le défaut de considération, qui provoque l'amertume innombrable des fonctionnaires, a d'autres racines.
L'État est mauvais patron. Il ne sait presque jamais motiver. Pire, il lui arrive souvent de bles- ser ceux qui le servent. Un ministre des PTT dit un jour des postiers qu'ils faisaient un travail idiot.
40
Qui était l'idiot ? Le Premier ministre Raymond Barre eut heureusement l'idée de révoquer le ministre... ce qui eut au moins pour effet de désa- morcer une grève! Quant au gouvernement de 1981, il fit sur ce plan deux erreurs. Les nouveaux ministres, inconscients ou bêtement méfiants, igno- rèrent presque tous leurs services, se privant du savoir, l'enthousiasme, d'hommes et de femmes qui avaient en général voté pour eux, se barricadant derrière des cabinets inexperts et brutaux pour concevoir leurs réformes. Seconde erreur, l'accent mis sur les congés, le moindre effort demandé, la surprotection statutaire, eurent pour effet de dégrader encore le tonus de la fonction publique et d'innocenter la nonchalance. « Je ne reconnais pas l'administration », me disait cinq ans après un haut fonctionnaire de retour aux commandes.
Blessure encore, l'annonce en décembre 1991 de la délocalisation de l'ENA. Le principe est accep- table : je ne défends ni l'ENA, dont je suggère plus loin la réforme, ni les « énarques ». Idée intéres- sante, à l'heure où la France se décentralise, que de transférer, pour partie, cette école en province. Mais la manière fut inadmissible : avec un beau courage, le gouvernement de l'époque ne consulta personne, pas les élèves bien sûr, cette piétaille, pas davantage le directeur de l'école, pas même le conseil d'administration, que préside le plus haut fonctionnaire de la République,, Marceau Long, vice-président du Conseil d'Etat. Non, en procla- mant sa décision sans préavis, Édith Cresson comptait qu'il serait populaire d'abaisser ces
41
énarques que le pays n'aime pas. Pire que le mépris, ce fut l'erreur. En ces temps où nombre de jeunes fonctionnaires désertent au plus tôt le ser- vice de l'État, est-il intelligent de sa part de flagel- ler ses serviteurs en place de Grève, à la plus grande joie du public?
L'épisode à vrai dire n'était pas nouveau. Après les grèves de 1989, on a entendu Raymond Barre, dont nul ne contestera le sens de l'Etat, traiter les fonctionnaires de « nantis ». Qu'il fasse meilleur servir dans la fonction publique qu'être au chô- mage n'est pas discutable, mais les avanies quoti- diennes qui sont, moquette comprise, le lot de beaucoup de fonctionnaires rendent leur vie pro- fessionnelle plus amère que « privilégiée ». Bien plus, les propos dévalorisant l'administration et l'idée que, n'étant plus dans le sens de l'histoire, celle-ci s'inscrirait au panthéon d'un passé révolu, se révèlent désastreuses. Elles constituent autant d'atteintes à l'État. Comme le disait l'an passé une organisation syndicale, « on ne peut laisser se déve- lopper des thèses xénophobes sur le fonctionnaire paresseux, vénal, soumis aux caprices du pouvoir politique, on ne peut mettre en cause des services publics indispensables à la collectivité (hôpitaux, poste, transports, impôts...), sans engendrer une formidable frustration et le sentiment, quand on a le choix, d'avoir fait une erreur en choisissant le service de l'État' ». A ce compte, on nourrit en effet chez les fonctionnaires, qu'ils soient gardiens de prison, instituteurs ou énarques, l'envie de quit-
1. Syndicat CFDT de l'inspection des finances, février 1991.
42
ter une galère qui fait eau sous les lazzi que lui décoche la nation.
J'ai lu l'autre jour cette petite annonce : « J. F. bien sous tous rapports, fort potentiel, cherche épa- nouissement dans liberté partagée, relation franche; perspectives lointaines souhaitées; ouvert (e) à toutes propositions sérieuses, secteur public s'abstenir. »
Ce que l'annonce ne dit pas : J. F., le jeune fonctionnaire français, ou plutôt la jeune fonction- naire, puisque l'État compte une majorité de femmes dans ses rangs, étouffe dans son service. Elle est mal occupée à des besognes privées de sens. Nul ne lui fixe d'objectifs. Nul n'évalue son travail. Son « fort potentiel » - expression portée d'une plume rituelle sur des feuilles de notation secrètes - n'intéresse pas en réalité ses supérieurs, qui ne lui parlent jamais de son activité, ne lui proposent pas d'entretiens face à face, et ne lui ouvrent aucune perspective de carrière. Elle contemple sans plaisir dans la glace son image ter- nie par ce statut sans éclat, ce métier qui n'en est pas un, dont elle n'a rien à dire à ses amis. Ses talents se rouillent. Va-t-elle manquer sa vie pro- fessionnelle ?
Prestige, pouvoir, sécurité : c'est ce que son père avait cherché, et trouvé à l'époque, au service de l'État. Son père est aujourd'hui un retraité modeste et satisfait. Mais elle ne vibre pas à ces valeurs-là : elle a soif d'initiative et de responsabi- lité ; elle est dans l'air du temps, qui est au risque : elle voit briller dans les médias le cadre engagé
43
dans l'aventure de son entreprise et le patron à succès... Elle va rendre son tablier.
Il est révoltant de laisser ses talents en veilleuse, de manquer sa vie professionnelle, de ne pas lui donner ce que nous offre à foison la civilisation moderne : ces mobiles qui nous stimulent, nous exposent, nous font bien dans notre peau au tra- vail. Lui refuser cette carte, c'est lui gâcher sa vie. On comprend qu'elle quitte un jour le cocon pour aller travailler sans filet.
Pareille saignée déséquilibre la fonction publique. S'agissant des jeunes hauts fonction- naires, la perte de substance est irréparable, l'admi- nistration étant statutairement empêchée de recru- ter sur le marché des cadres supérieurs. Plus généralement, ceux qui la quittent, quel que soit leur rang, sont parmi les plus entreprenants, ceux dont elle aurait précisément besoin! Du coup, le poids des mous se fait plus grand dans l'État. Spi- rale redoutable.
Ceux qui restent s'enferment souvent dans leur frustration. Que d'enseignants, que de magistrats, partis dans la carrière avec la vocation, qui se recroquevillent, qui se défoulent, pour le plus grand dommage des élèves ou des justiciables!
De l'histoire, qui lui donna longtemps mission d'assujettir des vassaux insoumis, l'État a hérité la méfiance. Elle l'habite. Cloisons et luttes internes font l'ordinaire des ministères. Selon un rapport rédigé à la demande de Pierre Bérégovoy après les grèves de 1989, la méfiance est « le principe direc- teur de l'administration des Finances... les services
44
centraux se méfient des services extérieurs, la hié- rarchie se méfie des syndicats, les agents se méfient des administrés; chaque direction se méfie bien entendu de toutes les autres. » La méfiance est tout autant la loi des négociations interministérielles. Le haut fonctionnaire d'un ministère « dépensier »
passe le plus clair de son temps à manoeuvrer pour que ses projets échappent aux chausse-trappes que lui tendent les Finances. Directeur de la construc- tion, j'avais auparavant travaillé rue de Rivoli. Je dialoguais avec les directeurs du Trésor et du Bud- get. Plusieurs de mes successeurs à la direction de la construction, dont le cursus administratif était différent, et l'audace un peu maigre, n'ont eu accès qu'aux chefs de bureau, soit deux à trois étages sous le directeur... A ce niveau, la politique géné- rale n'est jamais prise en compte. Seul est pesé le prix des mesures envisagées. « Aucune réforme n'est indispensable, mais tout changement coûte, me disait en 1975 le chef du bureau chargé du logement à la direction du Trésor. Alors notre rôle est de placer le bon grain de sable au bon endroit pour que, quelle que soit la décision politique, il ne se passe rien... ' » »
Avocat constant des gardiens des équilibres, j'applaudis la politique de « désinflation compéti- tive » à laquelle Pierre Bérégovoy aura attaché son nom. Mais je dénonce les échecs et les gâchis nés de cette lutte fratricide au sein de l'État, où de petits rouages saccagent de grands projets. Plai- dons pour d'autres approches : à coûts déterminés
1. Rapport de Jean Choussat.
45
r et suivant une relation contractuelle et de longue durée, les responsables de politiques sectorielles doivent avoir les coudées franches pour atteindre leurs objectifs.
L'État est un manager balbutiant. Ce n'est pas faute d'avoir essayé : depuis vingt ans, il a enrichi des générations de consultants pour acclimater, suivant des modes éphémères, la RCB (« rationali- sation des choix budgétaires »), le PPBS (« projet planning and budgeting system », s'exprimer en anglais, cela constituait déjà un progrès !) et d'autres recettes miracles. Peine à peu près per- due.
Beaucoup de cadres de l'État, du haut en bas de l'échelle, sont des fauteurs de démotivation. De grands ou petits chefs ont l'art de décourager des tonnes de bonne volonté, d'ardeur potentielle au travail, de capacités latentes : ils n'écoutent pas leurs collaborateurs, récusent leurs initiatives, se complaisent dans les vieilles méthodes de comman- dement, préfèrent le mépris à la considération. Combien d'enseignants se trouvent entravés dans leurs intentions pédagogiques, dans leur souci de faire bouger leur établissement, par l'opposition, ou simplement l'inertie d'un proviseur!
La mauvaise gestion tient aussi à ce fait plus général : l'administration déteste déléguer, à rebours de toute l'évolution contemporaine. En contradiction, tout autant, avec ses pratiques d'antan : un intendant de province, sous Louis XVI, avait toute délégation; il gouvernait
46
avec une dizaine de personnes, cocher compris. Les premiers préposés de la Caisse des dépôts, en 1816, étaient aussi démunis de moyens que libres de leur action, efficaces et respectés. Mais la machine n'a cessé de s'alourdir, la hiérarchie de s'appesantir.
D'où ce statisme hiérarchique et bureaucra- tique, que fige encore davantage le poids désor- donné de l'administration centrale, c'est-à-dire des bureaux parisiens, qui forment la substance des ministères. Pour nombre de services, les questions les plus ordinaires, telles que l'affectation des enseignants dans l'Éducation nationale, sont déci- dées, comme on dit, « par la rue de Grenelle ». A l'image de ce qui se passait dans l'entreprise taylo- rienne d'hier, l'ordre vient d'en haut, la circulaire est rédigée sans l'avis des services qui l'applique- ront, et ceux-ci demeurent dans une révérence figée à l'égard du centre. Lorsque Paris appelle, beaucoup se lèvent pour répondre au téléphone.
L'État ne sait définir à ses troupes ni priori- tés, ni objectifs; il ne sait pas évaluer leurs résul- tats. A vrai dire, il n'en a cure. Visitant un ser- vice ou une filiale de la Caisse des dépôts, je demande d'emblée : quels sont vos objectifs pour l'exercice? Où en êtes-vous de leur réalisation? Dans une administration ordinaire, la question provoquerait la stupéfaction.
Manager, c'est bien préparer, bien prendre et bien mettre en oeuvre les décisions. Dans l'État, les processus de décision sont précautionneux et lourds. Ils débouchent souvent sur des compromis
47
bricolés, esquissés par des hommes qui n'ont pas été investis de responsabilités claires. Pour des broutilles parfois fort techniques on remonte, par le réflexe dit du parapluie, « à l'arbitrage », qui tranchera entre deux services ou deux ministères. Cet arbitrage sera souvent prononcé, en médiocre connaissance de cause, par un ministre débordé ou un comité interministériel hésitant.
Tout cela coûte cher. Dirigeant le cabinet du Premier ministre, à l'automne 1981, j'ai interdit l'accès de tels comités aux ministères représentés par plus de deux personnes. Révolution : c'était diviser ces comités par trois ou quatre. J'avais fait calculer le coût pour le contribuable d'une réunion précédente de deux heures; il y avait là vingt-huit membres de cabinets ou de services. 34 000 francs : le chiffre avait semé la stupeur et personne ne m'avait compris ! Ayant dirigé l'Union des HLM, une entreprise de plusieurs centaines de personnes, j'avais en tête le prix d'un homme-jour. Mais ces efforts de compression au sommet de l'État se sont évanouis en quelques mois.
Je développerai plus loin des voies suivant les- quelles il est facile avec un peu de temps, de méthode et d'opiniâtreté, d'établir, partout dans l'administration, des comptes d'exploitation par service et, plus généralement, de mettre en oeuvre un management moderne.
L'État est lourd et lent. On voit des ministres agir vite, manoeuvrer sabre au clair. Mais la machine suit mal, univers méticuleux ignorant la
48
compétition. Il est hors de sa nature de réagir vivement; elle est rebelle à l'imprévu. Trop d'administrations sont désynchronisées : dans un monde en perpétuel mouvement, où les coups se jouent vite, où le temps vaut argent, elles vivent hors des rythmes communs. Elles plient à leurs mornes cadences le temps de leurs interlocuteurs, ce qui est à la fois odieux et onéreux. Elles se complaisent dans ce décalage, étrangères au tumulte qui bat à leurs portes. Leur royaume est-il bien de ce monde ?
L'État discrédité par ses propres faiblesses, c'est un mal de société. Ce grand corps décalé dans son temps, qui ne sait ni régler ses pro- blèmes d'employeur, ni motiver ses personnels, ni bien satisfaire les citoyens, quels titres a-t-il pour intervenir dans le jeu social, dans le grand jeu de l'économie? Est-il à la hauteur face aux forces qui le défient? Quand ses représentants défen- dent l'intérêt national, l'identité culturelle du pays, le droit de la concurrence ou l'égalité devant le service public, ne sont-ils pas, pour avoir abîmé leur crédit, ravalés au rang de simples négociateurs dans la mêlée?
Je pleure ce discrédit. Il explique, comme par un effet de boule de neige, l'atonie des appareils d'État et la mélancolie des agents. Je n'en prends pas mon parti. La situation est dégradée, elle peut être redressée.
Cela nous concerne tous, que nous servions l'État, d'autres institutions publiques, ou que
49
nous soyons simples citoyens. Gardons-nous de jeter l'Etat avec l'eau du bain.
Pas de procès manichéen, d'abord. Tout n'est pas noir, l'État sait parfois être vif et fécond.
Pas d'hypocrisie, non plus. Nous sommes en France aussi prompts à vitupérer l'État, et du coup à l'affaiblir, qu'à l'accabler de tâches sup- plémentaires. Ajoutons que nous n'aimons pas, de ces actions nouvelles, payer le prix : qui a oublié l'impôt-sécheresse ? Nous ne contribuerons pas à réhabiliter l'État en lui en demandant « toujours plus » et en faisant mine de croire qu'une tirelire magique est cachée dans ses poches.
Pas de complaisance. Ne nous résignons pas à le voir, dans ses profondeurs, rigide et mou, puissant et impotent, pyramide de méfiance au coeur de la cité, en télescopage avec la société vive qui est aujourd'hui la nôtre. Ne nous accommodons pas du mauvais poids dont, à l'heure de l'Europe unie, il pèse sur la France.
Et en retour, faisons-lui confiance. Il ne se redressera pas sous les huées. Je voudrais voir les Français convaincus que l'État peut, absolu- ment et rapidement, rattraper son retard, que son relèvement est à portée de main. Je les vou- drais ardents à le désirer.
CHAPITRE II
L'ÉTAT VIF EXISTE
L'EXPLOIT AU RENDEZ-VOUS.
Feu d'artifice. Il est minuit, ce soir du 14 juil- let 1989; l'incroyable défilé Goude se disperse dans les Tuileries; un million de personnes enva- hissent dans l'allégresse les Champs-Élysées. Trente-cinq chefs d'État, dont certains sont des monuments de problèmes pour la sécurité, vont, malgré les foules, rejoindre leurs résidences. La veille, des cortèges les avaient amenés à raison d'un toutes les trente secondes et suivant un pro- tocole savant, à l'Opéra. Même scénario le matin pour le défilé des armées. Les catastrophes annoncées n'ont pas eu lieu. Paris a connu un sans-faute.
En termes d'organisation, cela s'appelle un exploit. Quelle firme, quel consultant - et à quel prix ? - aurait tenu le choc ? Qui doit-on félici- ter ? Pierre Verbrugghe, préfet de police au sou- rire bonhomme, quelques dizaines de fonction-
51
naires sur le terrain, quelques milliers de policiers et de gendarmes. Une belle mécanique.
On pense à l'autre exploit d'un autre préfet de police, ou comment le charisme ferme et tran- quille de Maurice Grimaud évita le bain de sang en mai 68. De manière plus ordinaire, la capa- cité de certains préfets, seuls devant leurs respon- sabilités, à « répondre aux événements », force l'admiration. Y a-t-il beaucoup de chefs d'entre- prise qui auraient su, en juin 1992, comme Paul Bernard à Lyon et Jean-Claude Aurousseau à Lille, faire face avec doigté et fermeté aux mou- vements conjugués des routiers et des agri- culteurs ?
Pour de telles performances, le génie d'un patron ne suffit pas. Il lui faut aussi l'autorité, l'art de commander, l'esprit d'organisation. Il faut aussi que des corps motivés et loyaux soient en bon ordre de marche. Ni les uns ni les autres n'ont, que je sache, suivi des cours de manage- ment, mais ils font fonctionner, de manière satis- faisante et quelquefois éclatante, des systèmes complexes. L'entreprise privée trouve ici son rival.
Dans les enceintes financières internationales, chacun s'incline devant l'autorité du directeur français du Trésor, Jean-Claude Trichet. Paral- lèlement à la force du franc, dont il est à la fois avocat et artisan, il suscite, de Francfort à Tokyo, un éloge universel qui rejaillit sur son pays. A Bruxelles, la force de frappe compétente et mordante des négociateurs français est considé-
52
rée avec un respect mêlé de crainte'. Quand sur le foulard islamique, la classe politique bafouille, à Creil un proviseur défend des positions lim- pides et les applique avec rigueur. On se rap- pelle des coups de mains du GIGN, préparés dans la minutie et menés à bien avec profession- nalisme et sang-froid.
Dans l'ombre, et souvent dans l'ingratitude, des centaines de milliers d'enseignants remplissent avec amour leur mission. Le dévouement et la rigueur de nos gendarmes sont en général exem- plaires et font de ce corps un pilier de la Répu- blique. Dans les services de l'État, beaucoup de techniciens, de comptables publics, d'agents du fisc, d'employés - qui souffrent de ces misères et de ces carences que j'ai pointées du doigt - appliquent à leur travail un sens élevé du service public.
Même chose du côté des collectivités locales. Des milliers de secrétaires de mairie font tourner leur commune, dans un dénuement parfois extrême. Il existe pareillement dans les services publics des îlots de dynamisme et une fierté de bon aloi, qui rendent ces outils, à bien des égards, performants : pensons à la Banque de France, à Electricité de France, à France Télécom, à la Poste, etc.
Je suis fier de l'adaptation fulgurante de très nombreuses équipes de la Caisse des dépôts à la concurrence sur des métiers qu'elles pratiquaient
1. Depuis vingt ans, et bien mieux que d'autres capitales, Paris a organisé la coordination des positions nationales. C'est la tâche du secrétariat général pour la coordination interministérielle, le SGCI, qui relève du Premier ministre. Élisabeth Guigou, après d'autres fonc- tionnaires de premier rang, l'a longtemps dirigé.
53
récemment encore en monopole. Heureux aussi que des agents adonnés à des tâches simples aient su relever le défi technologique qui gouverne maintenant les marchés financiers. Dans une vidéo interne, sur le thème « moderniser la Caisse des dépôts », une employée de catégorie B devenue hautement professionnelle, exprimait, il y a six ans, sa fierté d'être « banquier et fonctionnaire, et même ici, sous un statut de droit public, à la hau- teur sur des activités de pointe ».
On voit fréquemment, dans le secteur public, des comportements inspirés par le sens de l'hon- neur. L'honneur, ça existe; c'est la forme supé- rieure de la conscience professionnelle. Il m'arrive d'en parler à mes collaborateurs. De même que la fierté de servir. Le mot « servir » n'est pas mort. Je l'utilise de manière courante. Il y a toujours dans l'État des comportements individuels, un dévoue- ment, un soin apporté au travail bien fait, qui valent compliment. On observe enfin dans l'admi- nistration française, de manière quasi universelle, une intégrité sans faille. Disons-le à voix haute, les fonctionnaires en France sont d'une honnêteté exemplaire.
L'exemple des chefs importe. Pas seulement les plus gradés. Pierrette Depaigne est, en 1984, atta- chée principale à la Caisse des dépôts, en charge d'une unité gérant les titres, c'est-à-dire les mil- lions d'actions et d'obligations, souvent hautes en couleur (nous détenions encore des titres des fameux emprunts russes!), déposées entre nos
54
mains. Elle contribue ainsi à la « conservation des valeurs », une des fonctions nobles, parce qu'elle inspire la confiance, à laquelle notre maison s'est dédiée depuis à sa fondation, en 1816.
Arrive la « dématérialisation », réforme qui aligne Paris sur les places financières les plus avancées en supprimant les titres-papiers. Ils sont remplacés par des comptes informatisés. Pour cela, il faut récupérer physiquement les titres en cir- culation, souvent conservés dans des bas de laine, les annuler et les convertir en comptes-titres.
La Caisse des dépôts va effectuer cette opération pour deux des réseaux bancaires qui lui sont asso- ciés, les caisses d'épargne Ecureuil et les comptables du Trésor. A cette fin, elle crée l'Unité du service-titres-réseaux (USTR) - une quasi- entreprise, ce qui est déjà un changement - et la confie à Pierrette Depaigne. L'aventure commence : au lieu de 200 000 titres attendus, les clients de ces réseaux en font, en deux mois, remonter plus de 600 000. Mal hébergée dans un local exigu, à la tête d'une toute petite équipe venant de la Caisse et des deux réseaux, et qu'il faut amalgamer pour la rendre efficace, Pierrette Depaigne fait face, nuit et jour à une mission impossible. Par camions entiers, affluent des sacs au contenu précieux; il faut organiser une garde armée : ils valent autant que des billets de banque; il faut les inventorier, les trier, les analyser, les enregistrer sur les comptes créés ex nihilo. Les caisses d'épargne et les trésoreries générales hurlent parce que notre travail n'est pas parfait
55
(les banques à réseaux, également surprises par le choc, connaissent les mêmes difficultés). Seul le sang-froid du chef d'équipe, son ardeur au travail, sa capacité à improviser, comme à stimuler ses col- laborateurs, évitent le naufrage. Peu à peu, la tem- pête se calme et la gestion se régularise.
Deux ans plus tard, l'activité connaît un nou- veau bond, avec les privatisations, qui doublent le nombre des petits actionnaires, clients des caisses d'épargne. L'activité de l'USTR explose pour la seconde fois. Le personnel recruté dans l'intervalle, très jeune, peu expérimenté, est près de perdre pied. Pierrette Depaigne est à nouveau sur le pont, et nous permet de faire face.
Son rôle ne s'arrête pas là. Elle a compris que, pour stimuler les équipes, il faut un projet d'entre- prise, une culture d'entreprise; il faut faire en somme de l'USTR une entreprise tout à la fois professionnelle et adossée à des valeurs, à une déontologie, à une mission. Avec ceux qui super- visent son action, elle rédige en 1989 le projet; elle en imagine la devise : « un métier, une équipe, un défi » ; elle en conçoit l'image : une montgolfière s'élève dans le ciel. En 1990, elle sera aux avant- postes pour transformer l'USTR en une société anonyme, dont le capital va s'ouvrir à des parte- naires privés, qui offrira ses services à la clientèle et qui volera de ses propres ailes.
Cette métamorphose, après une naissance en catastrophe, est l'oeuvre de quelques cadres fonc- tionnaires. Au premier rang, Pierrette Depaigne a tout simplement su donner au service public la
56
vigueur qui souvent lui fait défaut, et affronter avec panache des situations de crise.
J'ai eu pour patrons, et d'autres ont guidé mes pas, ces « grands commis de l'État » dont la race se fait rare : Henri Bourdeau de Fontenay, Louis Armand, François Bloch-Lainé, Claude Gruson, Roger Goetze, Pierre Massé, Jacques Delors quand il était au Plan, Maurice Grimaud, Mau- rice Doublet, Adrien Spinetta, Jean Millier, Paul Delouvrier... Ils avaient pris une belle part à la construction de la France moderne, dans le sillage des Raoul Dautry ou des Jean Monnet. Ils avaient donné le meilleur d'eux-mêmes au long de ces fan- tastiques années 1950, où l'administration eut les coudées franches et en fit bon usage; puis dans les années 1960, où la même administration se trouva stimulée et ennoblie parce que de Gaulle avait relevé l'État. Plusieurs avaient été pionniers de l'Europe, sur les traces de Robert Schuman.
J'ai la chance de côtoyer Jacques de Larosière. Directeur du Fonds monétaire international, puis gouverneur de la Banque de France, il a pris une stature mondiale, pour sa compétence financière, mais surtout pour sa hauteur de vues et pour l'éthique qui inspire son action; j'ajoute : pour un cocktail heureux d'humour et de fermeté. Le crédit de la France lui doit beaucoup.
L'un de ces grands anciens, grand parmi les grands, m'inspire chaque jour encore: Paul Delouvrier, avec qui je travaillai quelques années, rue Barbet de Jouy, à la Région parisienne et que j'irai chercher plus tard pour présider le Plan-
57
construction et en faire ainsi mon deuxième patron à la direction de la construction - l'autre étant mon ministre.
Paul Delouvrier est l'État incarné. Chair et os, nerfs et muscles, sang chaud et sang-froid. Par la stature et le maintien, il irradie le respect, il est l'autorité. Par la vivacité, il foudroie l'adversaire du bien public. Par la chaleur, par le timbre de la voix, tantôt séducteur, tantôt métallique et jupité- rien, par le rire qu'il fait déferler, il soulève des montagnes quand elles contrarient ses projets. Amoureux de la langue, maniaque de la virgule et de la mise en page, il cisèle des dossiers qui envoûtent l'interlocuteur; cette perfection est à ses yeux celle qu'on doit à la République. Derrière cette fougue hors du commun, une passion conduit Delouvrier : il sert la France.
Irrespectueux des procédures pusillanimes et des circuits longs, il incarne une puissance publique de choc, qui joue de l'audace et accepte le grand risque, dès lors qu'il s'agit d'une grande cause. Ainsi la conception, l'accouchement, la rédaction, la proclamation et le lancement du Schéma directeur de la région parisienne en 1965. A chaque étape, l'aventure. Plusieurs passages en force. Au résultat, une oeuvre historique qui res- tera dans la mémoire à la mesure de celle d'Hauss- mann. : Avec des chefs d'administration de ce tempéra-
ment, qui galvanisent leur troupe et lui proposent un pont d'Arcole chaque jour, la motivation des hommes coule de source. Si le patron était toujours
58
de cette trempe, il ne serait plus besoin des « res- sorts » que je propose plus loin.
Riche de ses cohortes modestes et fort à ses heures de cadres émérites comme de hauts fonc- tionnaires hors pair, l'État en France force parfois l'admiration. Il mérite qu'on le serve. Désolant et misérable par tant de ses faces, il mérite qu'on l'aime.
Mais cet amour suppose deux conditions. Que ceux qui le rejoignent, à quelque échelon que ce soit, éprouvent pour lui, comme pour eux-mêmes, de l'ambition. Qu'ils soient habités par l'envie du mouvement. L'Etat leur offrira de belles pages de vie.
Cela m'est arrivé.
SERVICE PUBLIC, SERVICE TONIQUE
C'est une chance que de diriger un morceau d'État. Quand, à trente-quatre ans, je suis nommé directeur de la construction, j'ai d'emblée l'impres- sion de passer aux choses sérieuses. Derrière moi, trois années d'état-major, cabinet ou équivalent. On y dépense beaucoup d'énergie à conseiller, à rédiger des notes que leurs destinataires lisent rarement, à préparer des discours dont ils s'écartent régulièrement. On plane, loin du concret.
Je quitte les boiseries du VIF arrondissement pour les baraques du quai de Passy. Peu importe.
59
Dans ces couloirs lugubres, je découvre dès le pre- mier jour au regard des hommes que je suis le chef. Ce que j'ordonnerai, ils le feront.
Et ces fonctionnaires sont l'administration. La direction de la construction est sûrement meilleure
que nombre d'administrations d'aujourd'hui, peut- être parce qu'elle est plus rude et moins dorlotée. Parce que l'Etat est encore, aux alentours de 1970, considéré avec un immense respect.
C'est pourtant l'administration avec toutes ses faiblesses. Celle, en particulier, de prendre trop souvent le moyen pour la fin : le but est atteint
quand une circulaire, ou un arrêté, a été signé; ce
qui se passe après, sur le terrain, c'est l'affaire des « services extérieurs »... ; « ah ! Monsieur, si je devais en plus m'occuper de cela ! » me répond le chef du bureau des loyers, gardien pathétique de la loi de 1948, quand je lui demande comment le texte relatif au nouvel article 54 quinquies, qu'il avait élaboré un an durant, était compris et mis en oeuvre... Faiblesse que ce repli sur soi, cette satis- faction supérieure de trop de serviteurs de l'État vastement ignorants de ce qui n'est pas leur terri-
. toire, étrangers à l'univers des entreprises. Faiblesses mais force, aussi. On peut, d'un
ministère, changer un peu la face du monde. Des hommes et des femmes intelligents appliqueront avec coeur et dévouement les décisions, pour autant
qu'elles soient claires et que le climat soit tonique. De telles prémisses ? Personne, et surtout pas
l'ENA, ne m'avait à ce sujet enseigné quoi que ce soit.
60
Nous n'en avons pas moins fait oeuvre concrète. Achever la résorption des bidonvilles n'était pas simple : il était infiniment délicat de disperser des communautés ethniques, que leur regroupement rendait solidaires, et d'imposer le logement « en dur » de ces populations aux municipalités. De même, lancer le Plan-construction. Ce grand pro- gramme chargé de stimuler l'innovation dans l'architecture et la technique, alors que la construction était figée aux mains d'architectes mandarins et d'entreprises organisées pour répéter indéfiniment les mêmes « tours et barres », eut à briser les interdits.
Le Plan-construction, qui bouscula les bastilles en place, fit accéder à la commande une nouvelle génération d'architectes. Il continue vingt ans après. Il n'a pas procédé d'une loi, mais d'une simple lettre de mission que, jeune directeur de la construction, je fis signer à Jacques Chaban- Delmas, Premier ministre. Tout cela, et bien d'autres choses encore, s'explique par un cocktail improvisé de quelques coups de chance et de quel- ques recettes.
La chance, on sait bien qu'elle n'est pas le fruit du hasard : elle se gagne. Quant aux recettes, elles me semblent toujours actuelles. Les voici, regrou- pées en cinq rubriques.
D'abord, la continuité. En cinq ans, on peut travailler dans la durée. Je trouvai un instru- ment formidable de commandement dans la « cir- culaire-programmation »; c'était la directive
61
annuelle donnée aux directions départementales de l'Équipement pour la répartition des aides à la pierre (financements HLM, etc.). Document arithmétique, il répartissait les « enveloppes » de crédits HLM, Crédit foncier, etc., pour chaque région. J'en fis un cadre politique : « Messieurs les directeurs départementaux, en attribuant des cré- dits, vous pouvez - et voici comment - stimuler le progrès en qualité et appliquer des priorités sociales. » Quand on rédige, plusieurs années de suite, une telle directive - et qu'on survit aux ministres successifs -, la continuité coule de source; elle s'impose naturellement aux destina- taires ; elle permet de donner corps à une politique du logement.
Autres éléments que la répétition renforce : des rendez-vous périodiques avec les échelons territo- riaux de l'État, avec les professions concernées. Un dialogue se noue, les relations se font plus per- sonnelles, plus efficaces, les messages - à double flux, bien entendu - passent facilement.
L'État doit être incarné : il marche mieux s'il a un visage, et il faut qu'un patron d'administration soit connu. L'administration, même « centrale », doit être « au contact ». Et cela ne va pas sans la durée.
Aux HLM, je restai sept ans dans la fonction de délégué général. J'étais hors les murs de l'État - et parfois en petite rébellion avec les gouvernants du moment; je n'avais pas pour autant quitté le ser- vice public.
Sept ans. Sept congrès annuels - ces grand-
62
messes où l'on peut faire passer un souffle, d'où les dirigeants des offices et des sociétés d'HLM repartent, quand la célébration est réussie, avec des messages et des objectifs; avec l'esprit ranimé, les temps seraient-ils durs et les vents contraires. Sept congrès dont la préparation, qui nous tenait des mois, obligeait à clarifier la marche, à riposter à la conjoncture sans se départir d'un même cap.
Et voici que je termine un bail de dix ans à la Caisse des dépôts. Rien d'incongru à une telle durée, dans ces murs. Cette maison a pour horizon le long terme; le long terme est l'une des trois « valeurs » qui inspirent notre action'. La durée est ici, mieux que nulle part ailleurs du côté de l'État, assurée : mes prédécesseurs ont en moyenne exercé leurs fonctions douze ans et demi. Juste avant moi, François Bloch-Lainé et Maurice Pérouse ont occupé quinze ans chacun le siège qui est le mien.
Certains crient au scandale. Mais ceux qui connaissent notre établissement savent que cette longévité répond à un souci majeur du législateur de 1816 : il voulait que le gardien des épargnes fût assez fort pour s'opposer aux mainmises qu'avait plus tôt commis l'Etat. D'où un statut hors du commun.
Ce statut permettait le meilleur : la durée. Le temps long autorise l'action profonde. Il en fait même un devoir pour celui qui en bénéficie : si
1. Le « projet » de la Caisse des dépôts, revu en 1989, est adossé à trois valeurs, que le groupe de la Caisse s'attache à décliner : le sens du long terme; la qualité du service rendu; la considération, témoignée aux clients comme aux collaborateurs.
63
nous n'avions rien fait bouger en dix ans, je ne serais pas très fier ! Aussi avons-nous, en équipe - plusieurs de mes proches collaborateurs, que j'ai appelés peu après mon arrivée, sont aux mêmes commandes depuis sept, huit, dix ans - conduit cette « réforme continue » de la Caisse des dépôts. J'ai eu la chance d'avoir le temps pour moi.
Mesdames et messieurs les ministres, choisissez sans pitié vos directeurs et vos préfets. Mais lais- sez-les ensuite travailler avec le bénéfice du temps. Donnez la bonne durée aux bons patrons de l'administration. De même que les entreprises se gardent, sauf exceptions malencontreuses, de chan- ger inconsidérément les dirigeants qualifiés dont elles se dotent le plus souvent, cessez de muter ceux qui viennent de prendre tout juste la mesure de leurs fonctions. Halte à la virevolte!
Seconde recette : une équipe. A peine débarqué à la Construction, je décide de choisir mes collabo- rateurs. Certains le sont encore vingt-trois ans plus tard. C'est ce dont je suis le plus fier. J'ai souvent pris appui sur des hommes et des femmes en place, dont le dynamisme, comme l'attachement aux causes que je leur proposai, fut exemplaire, et qui étaient - sans quoi je ne les aurais pas fait mes coéquipiers - reconnus par la maison, ainsi Michel Després et Edmée Crivelli à la direction de la construction, Roland Pignol aux HLM. J'ai, plus souvent encore fait équipe avec des hommes recrutés au-dehors. Jamais, quai de Passy, je n'aurais lutté avec succès contre l'habitat insalubre
64
sans Guy Houist, ni lancé le Plan-construction sans Raymond Sajus; ni rénové la politique tech- nique sans Pierre Chemillier et Pierre Cubaud; ni secoué les HLM sans Jean-François Poupinel; ni lancé Habitat et vie sociale, ces premières actions en faveur des quartiers d'HLM, sans André Trin- tignac, Annette Fleury et Pierre Saragoussi. Si nous avons alors gagné des combats, je le dois bien plus à ces coéquipiers qu'à l'impulsion politique, aux directives ou même au soutien du gouverne- ment.
Même chose aux HLM; la belle équipe du CREPAH - notre centre d'études sur l'habitat - animée par André Barthélemy et Yves Dauge, est née de notre Livre blanc de 1975 : quelques hommes, dont ces deux-là, sont venus me proposer de travailler avec moi, parce qu'ils avaient eu l'écho de ce Livre blanc par la presse, et qu'ils aimaient notre ambition. Nous devions faire longue route ensemble.
Même chose à la Caisse des dépôts. Le jour où il fut question que j'y sois nommé, Pierre Richard força ma porte à Matignon. Je l'avais jadis « poussé » en le proposant à Christian Bonnet, nouveau secrétaire d'État au Logement, qui demandait au directeur de la construction que j'étais de l'aider à former son cabinet. Quand je devins délégué général des HLM, Pierre Richard, conseiller de Valéry Giscard d'Estaing, comprit qu'avec nous le dialogue était préférable au mépris : il organisa des audiences présidentielles à l'Élysée qui médusaient mes troupes et m'aidaient,
65
en vérité, à en faire à l'occasion de farouches oppo- sants à certaines initiatives gouvernementales! Ce jour-là - nous étions en 1982 -, Pierre Richard, alors directeur général des collectivités locales, vint me proposer son concours pour transformer la Caisse, outil plus efficace à ses yeux que l'adminis- tration, en un grand auxiliaire de la décentralisa- tion. Dix ans plus tard, nous faisons toujours équipe.
Ainsi se forgent ces longs compagnonnages, propres à tout patron digne de ce nom, et qui vont de votre bras droit à la secrétaire et au chauffeur. Ainsi se forment ces équipes irremplaçables, nouées par l'expérience et l'amitié.
Mais une équipe ne se met pas en place sans un peu de courage. Il faut, pour y parvenir, faire du vide. Pas de chef, pas de patron qui ne sache limo- ger. De beaucoup de dirigeants qui patinent, on dit qu'ils ont eu le tort de garder auprès d'eux les hommes en place. Rien ne justifie le maintien de collaborateurs médiocres. Tout fait devoir de se séparer de ceux qui restent prisonniers de poli- tiques ou d'attitudes révolues. Inexcusable est le péché de gentillesse à l'égard de ceux qui compro- mettent le service ou la mission. Inexcusable, je le dis bien, alors qu'on en voit tant d'exemples dans l'administration de l'État, dans les collectivités locales - partout, en somme!
Le 1" juin 1982, directeur de cabinet de Pierre Mauroy, je suis nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. A coup sûr, cette nomination « politique » signifiait que des
66
têtes allaient rouler, et les socialistes de la maison prendre le haut du pavé!
Venu avec une collaboratrice et une secrétaire, je maintiens en place chaque « hiérarque » - c'est le vocabulaire de la vieille Caisse des dépôts et consignations! - jusqu'à ce que quelques étapes soient franchies :
e Un « Projet pour la Caisse des dépôts », dont l'élaboration mobilise deux mille cinq cents per- sonnes pendant quatre mois.
0 Un organigramme nouveau, correspondant aux priorités de ce projet d'entreprise.
a L'appel à des hommes et des femmes neufs, certains promus, d'autres recrutés au-dehors, que j'investis de responsabilités définies par notre pro- jet. Bien entendu, dans ces recrutements, la poli- tique n'eut aucune part : seules comptaient les compétences, les tempéraments, la capacité à jouer en équipe.
Alors seulement, six mois après mon arrivée, je limoge ou rétrograde la plupart des fameux « hié- rarques ». Ceux, par exemple, qui, durant ces quelques mois de statu quo, lorsque je lançais une idée neuve, me répondaient, au choix : « la tradi- tion veut que... » ou « on a déjà essayé il y a onze ans, et cela n'a pas marché... » Signifier un congé, c'est l'ordalie du chef. Il m'est arrivé, après avoir reconduit le dirigeant limogé, de m'appuyer, jambes coupées, contre la porte qui venait, sur lui, de se refermer pour de bon.
C'est le prix de l'équipe. Sans équipe, il ne se fait rien.
67
. Troisième recette : un projet. Une troupe se bat si elle sait pourquoi. Enfant, l'hiver 1944-1945, j'ai vu ce film : Pour quoi nous combattons. J'ai bien compris le message. Comme j'ai bien compris que l'adjudant-chef qui, en Algérie, avait pour slo- gan favori « faut pas chercher à comprendre », devait d'urgence être affecté ailleurs. Il en va de même bien sûr dans la société civile : on ne peut bien travailler si on ne sait pas pourquoi.
En vingt ans, j'ai bâti six « projets » : e 1970: un pamphlet-programme « pour un
habitat de qualité ». Il plaidait pour la qualité, alors que le mot même m'était interdit par le cabi- net du ministre Chalandon, où l'objectif était de casser les prix. Il introduisait donc, dans l'univers de la construction, un autre ordre de valeurs. Je le diffusai largement, malgré la désapprobation de mon ministre.
0 1972 : le préambule-manifeste du Plan- construction, rédigé en quelques nuits avec Paul Delouvrier, rendit espoir à des centaines d'archi- tectes, jusque-là exclus de la commande. Face à un univers verrouillé par les corporatismes, il affichait pour devise « rendre possible », c'est-à-dire auto- risait la commande de toute innovation technique ou architecturale, dès lors qu'un maître d'ouvrage, promoteur ou organisme d'HLM, voulait, avec l'aide financière de l'État, réaliser le projet. Ce Plan-construction s'accompagnait d'un cortège d'incitations et de financements assez crédibles pour changer le climat. Et cela a formidablement marché !
68
e 1975 : le Livre blanc des HLM, élaboré dans la fièvre par trois cents personnes venues du dehors et du sein du mouvement HLM, préconi- sait... qu'on cessât de construire des HLM. Idée force : il faut déraciner l'équation suivant laquelle logement social = logement pauvre, exilé hors les murs de la cité. Il faut construire au contraire avec la même qualité pour tous, les allocations de loge- ment venant aider les plus modestes à payer leurs loyers ou rembourser leurs emprunts. C'était ren- verser les colonnes du temple pour les militants HLM, mais en même temps les sortir de leur ghetto, relever leur image, leur ouvrir un nouvel avenir! Je fis voter ce Livre blanc, par un congrès houleux à Grenoble, grâce à l'appui d'Albert Den- vers, président de l'Union des HLM.
e 1979 : le « Projet HLM » répondait à une offensive gouvernementale, qui voulait mettre à bas les organismes d'HLM. La riposte avait été « pure et dure » ; donnons-nous un corpus déonto- logique exigeant l'autocontrôle de nos comptes, et renforçons notre gestion sociale, en faisant une vraie place aux locataires dans nos décisions. Le congrès HLM de 1979, à Marseille approuva ce document, après des débats homériques, à 60 % des mandats au lieu des 90 habituels. J'en étais fier : ce n'était pas un vote soviétique!
e 1982 : Le « Projet pour la Caisse des dépôts ». Vingt ans après François Bloch-Lainé, qui avait écrit la plus belle page de son histoire, il redonnait une identité claire à la Caisse des dépôts, dont la prolifération avait brouillé l'image, y compris pour
69
les agents du groupe. Il axait son développement autour de quelques thèmes forts : l'épargne et la prévoyance, l'appui à la décentralisation. Il réor- ganisait la Caisse des dépôts et ses filiales, en fonc- tion de ces axes clarifiés.
e Fin 1989 : une « vision » renouvelée venait sti- muler la dynamique de ce qui était devenu le groupe Caisse des dépôts. Elle nous proposait trois « valeurs » (voir note, p. 63), qui ouvraient la notion de service public à la modernité et à la concurrence. Elle recentrait le groupe sur quatre métiers.
Au départ - je reviens à 1970 -, on ne parlait ni de « projet d'entreprise » ni de « vision » à l'améri- caine. Mais ces documents forts, dûment orches- trés au-dedans et à l'extérieur, ont fait rêver des milliers d'hommes et de femmes. Ils ont été des moteurs, mieux : des leviers de mobilisation. Les fonctionnaires ne sont pas différents des collabora- teurs d'une entreprise. Eux aussi aiment qu'on leur dise où l'on va. Ils apprécient que leur travail quotidien soit référé à des valeurs fortes et à de vastes horizons. Rien ne leur paraît plus sérieux que la grandeur proclamée des causes qu'ils servent, même si le vocabulaire prête à sourire du côté des imbéciles. Ils sont heureux quand leur chef s'identifie à un combat, quand on parle de lui en bien, quand à leur tour ils peuvent se reconnaître en lui.
Un projet, des valeurs, un horizon forment le socle sur lequel on mobilisera une administration ou une institution publique, comme ailleurs on
70
mobilise une entreprise. J'ai vécu cela sans équi- voque.
Quatrième recette : toujours de l'audace ! Jeune directeur de la construction, j'ai tenté l'audace sur deux registres : sortir des sentiers battus adminis- tratifs, communiquer.
Pour un patron d'administration centrale, les bons moyens, y compris quelque indiscipline, sont justifiés par la fin. La fin, c'est le « projet ». A mes « projets », j'ai cru comme un fou. A la direction de la construction, face à des interlocuteurs hostiles ou rigolards (je pense à certains bureaux des Finances), face à des supérieurs sceptiques (je pense à tel ministre préoccupé de résultats rapides et indifférent au long terme), j'ai joué le Premier ministre - en l'occurrence Jacques Chaban- Delmas, un chef de gouvernement qui suscitait courage et panache chez les fonctionnaires qui le côtoyaient.
Le Plan-construction amorçait une démarche aux retombées nécessairement lointaines, bien au- delà des prochaines échéances électorales et ne passionnait guère mon ministre de l'Équipement, Albin Chalandon. Je lui ai cherché d'autres par- rains ; je l'ai fait doter - généreusement - par le délégué général à la recherche, Pierre Aigrain, patronner par Simon Nora à Matignon, et j'ai trouvé moi-même un président pour l'incarner : Paul Delouvrier, à cette époque président d'EDF. En vérité, Chalandon avait nommé, pour s'en défaire comme pour me calmer, un autre mon-
71
sieur, lui en bout de course, pour présider mon joujou. C'était l'enterrement. A ce président éphé- mère, j'avais aussitôt présenté des projets si vigou- reux qu'il avait jeté le manche ! Mais avec Delou- vrier, je me suis donné un second patron, le plus pugnace qui fût, et une belle marge de manoeuvre.
Grâce à quoi, nous avons commencé de tracer en profondeur un long sillon. Je m'étais inspiré d'un grand projet américain, Operation Breakthrough (la brèche) qui déversait des centaines de millions de dollars; j'avais visité des chantiers ébouriffants! Un an plus tard, Breakthrough était abandonné et les chantiers arrêtés pour toujours. En cette année 1992, on célèbre le vingtième anniversaire du Plan-construction, toujours actif, et désormais européen! L'audace initiale n'a pas produit un feu de paille...
Retour en 1970 : la résorption de l'habitat insa- lubre marquait le pas. Un secrétaire d'État, Robert-André Vivien, voulait y attacher son nom et tentait de contrôler tout ce qui se faisait en ce sens. Impossible : beaucoup dépendait d'autres ministères, tels les Affaires sociales, que leur patriotisme de clocher conduisait à contester tout ce que souhaitait ce Vivien, roitelet d'une autre planète. Je suggérai à Matignon, c'est-à-dire à Jacques Delors, collaborateur de Jacques Chaban- Delmas, de me confier la mise sur pied d'un « groupe interministériel permanent », le GIP, chargé de la résorption de l'habitat insalubre. Ins- tallé par Jacques Chaban-Delmas, doté de moyens et d'une équipe dont la gestion m'était confiée, ce
72
GIP échut à un « délégué général » nommé par le Premier ministre mais rattaché au directeur de la construction.
Dans les deux cas, nous avons inventé une pro- cédure qui s'éloignait des habitudes. Elle marquait en effet une grande différence avec les missions ou délégations interministérielles qui fleurissent constamment : celles-ci sont en l'air, sans assise ni moyens; mendiants locaux, budgets et personnels, leur crédibilité est abîmée. Au contraire, je dirigeai le Plan-construction et le GIP avec une pleine autorité interministérielle, mon branchement sur le Premier ministre me donnant prise sur les ser- vices d'autres ministères. En même temps, les deux projets tiraient leur force de leur ancrage sur ma direction de la construction, administration puis- sante, établie, gérant de gros crédits, dotée d'un personnel abondant et de relais sur le terrain.
De la même manière, aux belles heures de la politique de sécurité routière, vers 1975, Christian Gérondeau sut tirer une même force de sa double casquette : délégué interministériel, plus directeur au ministère de l'Intérieur. Sans cette position exceptionnelle dans l'État, il n'aurait introduit ni l'obligation du port de la ceinture de sécurité ni les limitations de vitesse ni les contrôles du taux d'alcoolémie. Des dizaines de milliers d'entre nous devons la vie à la ténacité de Gérondeau et à l'ori- ginalité d'un dispositif interministériel.
Il est fréquent qu'on découpe les dossiers au mauvais gré des « compétences », c'est-à-dire des attributions ministérielles, que déterminent des
73
décisions hâtives, voire catastrophiques, quand un nouveau gouvernement est formé. C'est l'inverse qu'il faut pratiquer, mouler les structures sur les dossiers ; établir des dispositifs transversaux. Dans notre monde complexe, où il n'est pas de bon management sans traitement horizontal des pro- blèmes, les questions que l'État doit régler ignorent les cloisons artificielles qui séparent ser- vices et ministères. Il faut jouer d'astuce avec l'appareil d'État pour sortir des sentiers rigides et des prés carrés.
Cinquième recette : communiquer, il y a vingt ans, c'était tout sauf à la mode. Comment faire bouger les choses, comment, suivant le slogan du Plan-construction, « rendre possible » l'innovation, si l'opinion n'appuyait pas les actions entreprises ? En outre, c'était une question d'honnêteté : une administration qui gère des milliards de francs de crédits annuels pouvait-elle en affecter une frac- tion à stimuler le renouveau architectural et tech- nologique si elle ne cherchait pas la complicité de l'opinion ? Communiquer, c'est une forme de rem- part contre la technocratie.
C'est aussi un levier : il fallait qu'on sache qu'un « label acoustique » avait été décerné à un programme de logements à Lyon pour que le consommateur contraigne - bien lentement il est vrai - le promoteur à soigner la « qualité cachée ».
Comme ailleurs, innovation et communication riment ici volontiers. Des fonctionnaires savent « jouer les médias » pour décoincer un dossier, ou
74
simplement pour mettre leur ministre en mouve- ment ! Albin Chalandon, ministre de l'Équipe- ment, avait interdit d'intervenir sur l'architecture et la protection des sites dans l'octroi des permis de construire. Si le promoteur estimait que ses immeubles se vendraient, la philosophie libérale du moment devait interdire à l'Etat, ou à la ville, de corriger ses projets, fussent-ils honteux. Com- ment le directeur de la construction que j'étais pouvait-il amener son ministre à réagir contre les horreurs conçues par des promoteurs, assistés d'architectes indignes, du côté de la porte de Choisy ? En convainquant un journaliste intel- ligent qui en fit un titre à la veille d'une confé- rence du ministre. Celui-ci assez beau joueur pour écouter la voix de la presse, exigea que la copie fut réécrite. Ce que vous voyez aujourd'hui dans ce quartier n'est pas joli, mais c'est superbe en regard du projet d'origine!
En 1972, créant un service de relations publiques à la direction de la construction, j'étais proche de la subversion. Nous avons pourtant, et sans problème, fait des choses passionnantes. En montant au Grand Palais, en 1974, l'exposition Habitat et innovation, où devaient se succéder au grand jour colloques et discussions pendant tout un hiver, nous avons mis notre politique sur le devant de la scène et amorcé, autour du renouvellement de la construction, un débat public. Cela a contribué à ouvrir l'accès à la commande d'une génération de jeunes architectes, jusque-là interdite de travail par les prix de Rome en place et le conformisme ambiant.
75
Aujourd'hui, de telles initiatives sont devenues naturelles, quasiment une mode. J'ai appris que communiquer au-dehors ne sert pas seulement à se faire plaisir - ce qui est le mobile le plus répandu ! - ni même faire passer quelques messages. La communication a deux buts : expliquer, construire une image.
Expliquer, parce qu'en démocratie il n'est pas d'action publique, pas de politique - voir Maas- tricht - qui passe la rampe dans l'incompréhen- sion. Construire une image parce qu'un organisme en charge de responsabilités générales ne peut les exercer que s'il est lui-même perçu positivement, et parce qu'une image forte, pour autant qu'elle soit justifiée, mobilise les troupes. Aux HLM, il s'agissait de promouvoir l'image... des HLM, immensément négative! A la Caisse des dépôts, le défi était plus complexe : rendre enfin lisible un grand monolithe, faire comprendre notre utilité et nos performances. Avec les professionnels de la maison, j'ai donné beaucoup de soins et de temps à ces entreprises, au départ inédites dans le secteur public. J'ai pu mesurer qu'une image s'édifie dans le long terme et qu'on ne triche pas avec elle : on ne vend pas ce qu'on souhaite mais ce qui est; il ne suffit pas de proclamer qu'on « bouge » ou que tout est « possible » pour que la maison soit soudain transfigurée. Dans le secteur public français, des campagnes ont dû être arrêtées du jour au lende- main, et de beaux slogans rengainés, parce qu'ils apparaissaient aux personnels en décalage insolent avec les réalités internes...
76
Le reste n'est pas évident pour autant, je l'ai éprouvé au fil des années. La communication, c'est aussi porter une ambition, donner à voir des résul- tats, des performances, des savoir-faire. C'est soi- gner son allure : bureaux, logos, architecture. Le « look » de l'État, comme de toute entreprise, est artisan de son image.
L'audace a donc sa place au coeur de l'État. Certes, il n'aime pas cela. Sa nature le pousse au réformisme mou, vite enseveli dans l'immobilisme endémique. Mais une poignée de fonctionnaires vifs et pertinents peuvent, presque toujours, forcer cette nature.
On croit l'audace dans la sphère publique réser- vée aux politiques. Suivant le cri fameux de Dan- ton, elle serait leur apanage - à plus ou moins bon escient - de manière parfois radicale, parfois pure- ment verbale et médiatique. Faux : elle doit impré- gner aussi, et plus sérieusement, l'appareil d'État et le secteur public. Administrer avec imagination, dans l'irrespect des coutumes et des pesanteurs, c'est possible. Et aujourd'hui, plus souvent qu'hier, quelques poignées de cadres trouvent les ressorts et les leviers qui feront d'un appareil administratif un moteur nerveux. En janvier 1990, le « devoir d'audace » était le thème de mes voeux à la Caisse des dépôts. Je le liais à notre réussite, promettant, en début de la décennie, et à la condi- tion que nous n'ayons pas froid aux yeux, « dix ans d'audace et de succès ».
La gestion vive va de pair avec le risque. Mais oui, on peut dans l'État, vivre dangereusement,
77
prendre des risques pour séduire l'opinion, lancer une idée, pousser un projet, avancer le pion de son
pays dans la négociation ou la compétition inter- nationale ! On peut, on doit être continuellement dans la guerre de mouvement. Et c'est aujourd'hui monnaie un peu plus courante.
Ce que j'ai vécu, ce que je vois autour de moi, me dicte ce message : il faut administrer avec audace; il y a dans l'Etat devoir d'audace. On peut se tromper; on a le droit à l'erreur; on est toujours - oui, toujours - révocable. Mais c'est dans l'audace qu'on remplit bien sa mission. L'existence alors n'est pas très calme, mais comme elle est riche !
Service public, service tonique. Vive, dans cet
esprit, le séjour dans l'État !
Redescendons sur terre. Hélas, la vie dans l'État n'en va pas généralement ainsi. Alors, il faut que les choses bougent. Elles le peuvent. Et je vais en ce sens suggérer quelques pistes.
CHAPITRE III
L'ÉTAT EN TÊTE
Comment rendre l'État performant? La démarche «managériale» n'a aucun sens si elle n'est pas inscrite dans une visée politique. Essayons d'être clair d'abord sur les finalités de l'État. Sur ses missions : à quoi doit-il servir aujourd'hui ? Sur son périmètre : quels sont ses champs d'action ? Sur ses comportements : com- ment doit-il opérer? Il faut s'interroger encore sur ceci : ce nouveau profil pour l'Etat est-il compatible avec l'Europe de demain?
L'avenir est à un État léger, dans son champ d'action comme dans ses modes d'intervention. Mais nullement à un État au rabais : ses missions sont les plus hautes. Pour les assumer, il doit être non pas lourd mais grand : je préconise l'État- plus. Je ne le veux ni modeste ni faible, mais au contraire musclé, tonique, moderne. Je le vois enfin artisan de l'Europe, bon citoyen de la Communauté.
L'Europe met radicalement en question l'État
79
national. Que peut-il être, lui qui s'est historique- ment identifié à un territoire, quand les frontières tombent? La réponse intéressante n'est pas d'égrener les mutilations de compétences, suppo- sées faire de lui un rouage croupion, une super- collectivité locale. Ce ne sera nullement le cas, même si, comme je le souhaite, la marche s'affirme vers une véritable Europe fédérale. Je vois un État artisan de l'Europe, en même temps que profondément renouvelé par cette construc- tion.
Que la France aborde ces lendemains euro- péens avec détermination, semble aller de soi : plus que ses partenaires, elle a été fondateur, et devrait demeurer, après le happening du référen- dum sur Maastricht, moteur et acteur de la Communauté.
Pourtant, à mesure que le processus avance, on va voir apparaître un décalage entre nos institu- tions et ce que l'Europe acceptera.
Traditionnellement en position de supériorité face à ses interlocuteurs nationaux, notre admi- nistration doit se placer désormais, pour l'exercice de nombreuses compétences, en position de demandeur : il lui faut maintenant plaider et négocier ses propres dossiers à Bruxelles, alors que cela était le lot des seuls dossiers inter- nationaux. Enfant gâté d'un vieux système où elle fixait elle-même la règle qu'elle appliquait, où elle n'était jugée que par des juges issus de ses rangs et parlant son langage, voici l'administra- tion française contrainte de composer avec
80
d'autres règles, conçues par des esprits formés dans d'autres moules, et à voir les différends tran- chés à Luxembourg par la Cour de justice euro- péenne, formée de magistrats qui parlent une langue juridique étrangère. Nos politiques colber- tistes n'avaient de sens que dans le cadre national. Or celui-ci perd sa pertinence. La France va souf- frir plus que d'autres pays, aux traditions éta- tiques moins régaliennes.
Mais surtout, notre modèle jacobin, dont nous avons survolé les caractères et les excès, va très vite apparaître intenable. Il est décalé par rapport aux réalités et aux sensibilités dominantes chez nos partenaires. Nous n'imposerons pas ce modèle-là, dont à vrai dire nous avons de bonnes raisons de douter, comme Napoléon avait exporté nos codes. Le voudrions-nous que nous foncerions dans une impasse historique.
L'Europe va bousculer l'État. En France plus qu'ailleurs. Il le sent. Il résiste dans ses profon- deurs ; des fonctionnaires se crispent; ouvriers et gardiens de beaux édifices législatifs et régle- mentaires, ils acceptent mal les lézardes, les ver- rues, la destruction d'une aile, la déviance que provoque à leurs yeux Bruxelles. Attitude désas- treuse : c'est au contraire avec confiance et l'esprit souple que nos institutions publiques doivent aborder l'Europe. ,
Elle exigera de l'État infiniment plus que des transferts d'attributions : une révolution. Mais celle-ci aurait dû se faire, Europe ou pas. L'Europe, de manière heureuse, vient le placer dos au mur.
81
L'ÉTAT LÉGER
Dans l'économie, l'État dirigiste et omni- présent, c'est fini. Il doit en faire moins. Mais mieux. Chacun s'accorde là-dessus, d'un bout à l'autre de la planète : il faut désétatiser.
La chose est plus facile à dire qu'à faire. Sur- tout en France, pays de vieille tradition inter- ventionniste. Les Français adorent l'État brancar- dier : pluies trop fortes ou neige trop rare, ils l'implorent de les déclarer sinistrés et de déclen- cher primes et subsides. Nous sommes d'incorri- gibles enfants gâtés du « toujours plus d'État ».
Peu de pays ont à ce point cultivé la « politique industrielle ». Qu'on se rappelle le Plan-calcul ou l'étatisation de la sidérurgie, il y a quinze ans ; les grandes manoeuvres, sur l'informatique de nou- veau, en 1982 et 1983; les « meccanos » auxquels s'est essayée Édith Cresson. Plus largement, les deux vagues de nationalisations qui ont suivi la Libération et la venue des socialistes au pouvoir en 1981 s'inscrivent dans une lignée qui remonte aux manufactures de l'Ancien Régime.
A beaucoup d'égards, ces vastes opérations ont été bénéfiques au pays : entreprises renforcées, gestion rénovée, grandes activités stratégiques
. développées, comme l'énergie atomique. Mais si l'on veut alléger l'État, il doit passer la main sur nombre de ces registres. La possession d'entre- prises concurrentielles n'est plus dans sa vocation. Il est souvent un actionnaire malhabile. Il est tou- jours un actionnaire chiche, alors que ces entre-
82
prises vivent et luttent dans le marché, où chaque acteur doit être à armes égales avec ceux qu'il affronte. L'interdiction de participations croisées constitue une pénalisation pour ces entreprises, empêchées ainsi de bien coopérer avec leurs
homologues étrangers. Les banques, compagnies d'assurances et socié-
tés industrielles qui n'ont pas à ce jour été priva- tisées doivent quitter le domaine de l'État. Il lui faut remettre sur le marché la BNP comme le Crédit lyonnais, l'UAP comme les AGF, Péchiney aussi bien que Renault. L'État se trou- vera allégé. Son commandement sur l'économie
n'y perdra rien tant il est rare, en effet, qu'il oriente ces entreprises vers quelque « politique industrielle » que ce soit.
Demain, déchargé de ces satellites, l'État trou- vera d'autres leviers sur lesquels jouer. Il conser- vera bien sûr dans sa main, ou proches de lui, quelques établissements financiers, au premier rang desquels la Caisse des dépôts. En Grande-
Bretagne, il n'y a pas de Caisse des dépôts, mais le rôle de la Banque d'Angleterre dépasse de
beaucoup celui d'un simple institut d'émission. A
chaque pays ses armes financières! Dans le domaine industriel, l'État pratiquera davantage par contrats avec les entreprises privées, comme il le fait de longue date pour l'aménagement du ter- ritoire.
On exclura de la désétatisation quelques sec- teurs sensibles : les entreprises qui touchent à la
culture, en particulier l'audiovisuel; les industries
83
liées à la défense nationale où à des intérêts stra- tégiques tels que l'énergie nucléaire.
De grandes sociétés nationales, quasiment des services publics, gèrent des monopoles; EDF, Gaz de France, la SNCF, France Télécom, la Poste. La dérégulation que provoquera l'Union euro- péenne touchera ces secteurs. Elle est déjà amor- cée pour le courrier; l'avion concurrence le fer et réciproquement. Ces activités, peuvent donc être rentables, sous réserve que l'Etat finance les ser- vitudes d'intérêt général (desserte du milieu rural, couverture hertzienne des zones montagneuses...). Dès lors, le capital peut être ouvert.
La désétatisation des grands services publics empruntera des modes variables. Tantôt, une fraction du capital sera proposée aux fournisseurs d'amont et aux distributeurs en aval (on peut son- ger ici à Gaz de France); l'État devra conserver une participation, même modeste, qui fasse de lui l'actionnaire arbitre. Tantôt la désétatisation se traduira par une « nationalisation » : on vendra à la Nation, c'est-à-dire au public, des titres de pro- priété, assortis d'un droit de vote limité, d'une garantie de revenu liée à la production de l'entre- prise (par exemple, le prix du kWh), voire de bons permettant l'achat d'unités de production (lots-kilomètres, kWh...). Parallèlement, le capital sera ouvert à des homologues étrangers : EDF semble appelée à s'associer avec ses grands parte- naires d'Allemagne ou d'Espagne. Enfin, le dis- positif pourra être bouclé par un contrat avec l'État codifiant les activités et prévoyant les modes de fixation des tarifs.
84
Toute entreprise publique peut suivre cette voie. Celles qui sont déficitaires doivent atteindre au moins le « petit équilibre », c'est-à-dire la cou- verture des dépenses de fonctionnement par les recettes. L'amortissement des investissements sera supporté par l'État ou les collectivités locales; ainsi pour les régies de transports publics.
Ce sujet est complexe, et les solutions uni- formes concoctées à Bercy ou ailleurs sont impro- pres. Une volonté politique de désétatisation devrait commencer par la commande, à chaque entreprise concernée, de son propre projet en ce sens, à partir de sa propre situation!
Il y a d'autres modes de privatisation qui allègent l'État. Les Français se sont construit une Providence sur terre, qui couvre presque parfaite- ment les risques de la vie : maladie, chômage, vieillesse... Grande conquête de ce siècle! Il ne faut pas abattre l'édifice. Mais il appelle deux interrogations.
Est-on sûr que l'égalité soit ici de mise ? Est-il pertinent, alors que tout cela coûte très cher et pénalise l'économie, de verser autant aux riches qu'aux pauvres ? La contribution sociale générali- sée, la CSG, a introduit en 1989 l'idée d'une par- ticipation au budget social de la nation, propor- tionnelle au revenu. La même voie devra être explorée du côté des prestations; la sauvegarde de notre protection sociale suppose que les avantages décroissent avec le revenu.
Ne peut-on organiser la couverture de certains
85
risques sur un mode facultatif. L'avenir des retraites ne sera pas assuré sans qu'au moins, à titre complémentaire, le plus grand nombre de Français - à l'exclusion des plus pauvres - soit tenu de capitaliser pour sa retraite. Oui, capitali- ser, par un effort continu d'épargne, encouragé par un régime fiscal favorable. Assurance, pré- voyance, effort individuel pour se prémunir contre les aléas de l'existence : autant de disciplines salu- taires.
Un certain sens du risque s'est trouvé gommé par des protections quasi universelles. Le risque doit retrouver une plus large part dans la société. Elle s'en trouvera plus tonique, face à un État plus léger.
L'État léger appelle ensuite plus de déconcen- tration et surtout plus de décentralisation.
D'abord déconcentrer. C'est-à-dire alléger la tête de l'État. Dans l'administration, c'est-à-dire dans les ministères, mais aussi bien dans les éta- blissements publics, dans les services municipaux ou régionaux, descendons les responsabilités des directeurs vers les unités. Je propose, au chapitre suivant, une forte accélération de ce mouvement : autonomie budgétaire des cellules de base; main- tien dans ces unités des crédits qu'elles auront économisés grâce à leurs propres gains de produc- tivité. Aux services locaux de l'Etat, c'est-à-dire à une direction départementale de l'action sociale, ou de l'agriculture, à un rectorat, qui sont plus proches du terrain, donnons davantage d'attribu- tions.
86
Et que le centre maigrisse. Imaginons des ministères ultra-légers, en forme d'administra- tions de mission, comme l'a été la délégation à l'aménagement du territoire, la DATAR, fondée il y a trente ans par Olivier Guichard. Ils n'auront plus à tout régir, mais à définir des objectifs, à poser quelques normes générales et à s'assurer, audits à l'appui, que les services déconcentrés ont bien mis en oeuvre les politiques que le centre a tracées.
Sur le terrain, le préfet doit être le grand ges- tionnaire de l'an 2000, en particulier le préfet de région, dont la responsabilité est à la bonne échelle géographique. Il met en ligne l'ensemble des services de l'Etat - eux-mêmes déchargés par les transferts aux collectivités locales. Il les fait jouer en équipe, les mobilise sur des dossiers transversaux, tels que l'emploi, la formation, la ville, le développement rural. Pour ces actions globales, il a les coudées franches. Il est rassem- bleur et meneur de jeu. Il est l'« État-plus » en action.
Et qu'à Paris les ministères fassent le ménage! Il est inacceptable que des bureaux continuent d'occuper - si l'on peut dire! - des effectifs immuables à des tâches qui leur ont été retirées depuis longtemps!
La déconcentration peut s'opérer aussi des ministères vers les établissements publics, offices et agences. Ils sont l'État : celui-ci les détient. Mais ils sont plus souples que l'administration : ils ont, eux, un bilan et un compte d'exploitation.
87
Il est facile de leur fixer des objectifs contractuels et de les juger aux résultats. Ils peuvent dévelop- per une identité et une culture propres, sans que l'esprit de service public soit remis en cause. Ils offrent un mode de gestion plus rentable, plus efficace et plus souple. De nombreuses tâches à la charge des ministères techniques doivent leur être transférées. L'exemple éprouvé des agences de bassin, qui ont amélioré la gestion et la qualité de l'eau, l'exemple plus récent de la Poste et de France Télécom, deux grands services de l'État
que la loi a transformés en établissements publics industriels et commerciaux - en attendant que ceux-ci deviennent sociétés anonymes, constituent des références.
Déconcentrer. Puis, décentraliser. La décentra- lisation, d'abord au profit des collectivités locales, appelle une vive relance. Elle doit toucher de nouveaux domaines. Ainsi les universités, que les régions se disent prêtes à prendre en charge, et
que l'État, essoufflé, ne parvient plus à animer ni à rénover ; leur gestion décentralisée facilitera leur
rapprochement avec les forces vives de l'économie; elle cassera le modèle napoléonien tout en mainte- nant l'équivalence des diplômes; elle facilitera l'établissement d'un réseau universitaire euro- péen. Ainsi du logement social, qui appelle des financements diversifiés se substituant à des prêts au barême uniforme; les collectivités veulent intervenir dans le logement social selon leurs
propres priorités : l'une mettra l'accent sur la rénovation du patrimoine ancien, l'autre sur
88
l'hébergement des personnes âgées, une autre encore sur la construction neuve ou l'animation des HLM. Il faut élargir ici leurs responsabilités financières. Cela débouchera sur un financement différent, d'une ville à l'autre, du logement social, mieux adapté aux objectifs locaux. Ainsi de l'urbanisation : l'État en fait trop; il ne doit certes pas lever le pied, mais les progrès de l'inter- communalité lui offriront des relais capables de prendre en charge, avec la justesse de vues néces- saires, une partie de ses interventions.
L'Europe nous adresse ici un message sans équivoque. Elle accuse un anachronisme français : notre armature territoriale n'est pas compétitive. Elle est même ridicule avec ses cinq ou six éche- lons, de la commune à l'État. Elle est source de déperditions. La décentralisation de 1982 a rendu, paradoxalement, les opérations plus complexes en maintenant tous ces étages en même temps qu'elle renforçait heureusement la région. Pas de projet local qui ne fasse appel au départe- ment, à la région, souvent à la commune et aux groupements de communes. Pour que s'addi- tionnent de petits morceaux de financements, il faut aujourd'hui conjuguer un à un tous ces niveaux; or ils se trouvent fréquemment en conflit, parce que les couleurs politiques diffèrent ou que les ambitions se télescopent. C'est lourd et lent.
Oui, bien sûr, à la subsidiarité, que ravive Maastricht. « Priorité d'action à l'unité la plus restreinte », ainsi la définit Jacques Delors. Mais
89
l'application successive de ce principe aux six échelons de la cascade institutionnelle française nous ramène à Courteline. L'édifice doit être sim- plifié, suivant trois pistes :
e La commune doit peu à peu s'éclipser der- rière les groupements intercommunaux, aux formes multiples, qui prendront le relais pour tout projet d'équipement.
0 Le département est en surnombre. Certes, il fait souvent oeuvre utile; je vois l'action dyna- mique des conseils généraux de la Vienne, des Hauts-de-Seine, des Bouches-du-Rhône. Mais cette collectivité, parfois très riche, qui se construit des hôtels somptueux depuis qu'elle a quitté celui de la préfecture, complique, sans lui être indispensable, la vie locale. Pour alléger la pyramide française, il faut un courage chirurgi- cal : le département ne devrait pas passer le tour- nant du siècle.
0 C'est la région qu'il faut renforcer par des pouvoirs accrus. En outre, des fusions sont sou- haitables. Plusieurs de nos régions n'ont pas la taille critique si on les compare à leurs homo- logues de la Communauté.
Mais la décentralisation ne doit pas toucher seulement les collectivités locales. Ce fut la fai- blesse des lois de 1982 de penser seulement à transférer des attributions aux institutions locales. Il existe bien d'autres rouages de la société sur lesquels décentraliser l'État. Certaines municipa- lités ont très bien joué en ce sens en reconnaissant à des associations des responsabilités dans la vie
90
sociale, suivant l'exemple de Grenoble dans les années 1970. Il doit en aller de même au plan national : en contractant avec des associations qui portent de bons projets dans les domaines tels que la santé ou la culture, l'État charge des parte- naires motivés de faire - mieux qu'il ne peut le faire lui-même - ce que, dans une vision bureau- cratique, il assumait directement.
Viennent ensuite les corps intermédiaires, tels les organes professionnels. A condition de veiller à ce que le corporatisme n'en soit pas conforté, mais au contraire la poursuite de l'intérêt général assu- rée, c'est une bonne solution que de les mission- ner pour des tâches bien cernées. L'État n'a pas le monopole du service public : la Société des bourses françaises relaie opportunément le Trésor et la Commission des opérations de bourse pour surveiller le marché financier. L'Union des HLM serait tout aussi qualifiée que la direction de la construction si elle était mandatée par l'État pour élever la qualité des logements sociaux.
La construction de l'Europe n'avancera pas seulement par des accords entre États, ni entre régions limitrophes. Ce n'est pas la seule affaire des institutions publiques. Elle se fera aussi par la base. La société civile européenne doit s'inter- pénétrer. La subsidiarité se joue aussi vers le bas, c'est-à-dire des États, des régions, des villes vers les réseaux multiples qui constituent la trame de chaque pays. Ce propos s'applique particulière- ment à la France, dont la puissance publique, plus repliée sur elle-même qu'elle ne l'est ailleurs,
91
ne joue pas assez le formidable tissu social de l'Hexagone, dans l'élaboration des décisions et dans la vie courante.
Privatiser, déconcentrer, décentraliser, rendre des rôles à la société civile, autant de défis stimu- lants pour l'État. L'État léger, c'est la responsabi- lité mieux diffusée, le jeu local vivifié, c'est à nou- veau la société tonifiée. S'il joue intelligemment la subsidiarité à laquelle l'Europe l'invite, l'État confortera la démocratie au quotidien. Il contri- buera à ce que se tisse une Europe plus citoyenne.
Less is more, disait au début de ce siècle l'architecte Frank Lloyd Wright. L'État léger sera une grande avancée pour l'Etat. Surtout si ce transfert va de pair avec l'adoption, par la puis- sance publique, d'autres modes d'intervention.
L'ÉTAT PARTENAIRE
L'État doit en France mettre un frein à sa démarche de toujours, qui est de poser la règle et d'établir la norme, de veiller ensuite, plus ou moins bien, à leur stricte application et enfin, de compléter et retoucher perpétuellement cette règle et cette norme. Non, cela n'a jamais de fin : ni la règle ni la norme n'ont tout prévu, et pareille logique veut qu'on les précise, démultiplie, modi- fie sans cesse, dans un dialogue ésotérique et interminable entre administrations ou avec les professions et organismes que ce jeu concerne. Rompons-la! Halte au perfectionnisme normatif!
92
Certes, la règle s'impose pour organiser l'État de droit. Pierre Rosanvallon a raison de modérer nos ardeurs : « La bureaucratie, écrit-il, est l'effet - pervers - du progrès de la démocratie. » Mais, au moins dans le champ économique et social, l'État qui incite doit chasser l'État qui décrète.
S'il s'agit de remettre à flot un quartier défavo- risé, l'État intelligent ne procédera pas par arrê- tés - ou pire, par la loi. Il mobilisera ses services et appellera sur ce chantier collectivités et parte- naires. Depuis Olivier Guichard et Jérôme Monod, l'aménagement du territoire joue d'incita- tions financières bien plus que de décrets. Michel Rocard a heureusement multiplié les « contrats de plan » qui lient les régions à l'État et organisent des efforts conjoints. La pratique s'étend à de grandes entreprises nationales : EDF a été la pre- mière ; la Poste, en ce moment, boucle son contrat de plan.
J'ai proposé au Premier ministre, en 1989, que la Caisse des dépôts s'engage par contrat à rem- plir des objectifs qu'après négociation il lui aurait fixés. J'aurais été jugé aux résultats, avec à la clé ma révocation - nonobstant le statut protégé qui est le mien - si les résultats n'étaient pas atteints. Pourquoi le gouvernement ne m'a-t-il pas suivi ? Sans doute parce que le groupe que je dirige est devenu un enjeu multiple. Quand elle s'occupe des retraites ou du logement, d'infrastructures ou de tourisme, quand elle appuie les collectivités locales, la Caisse des dépôts échappe au regard du ministre des Finances. Or celui-ci n'accepte pas
93
de bon gré qu'un autre que lui - à l'évidence, pour moi, cela devait être le Premier ministre - soit le signataire du contrat proposé... J'ai donc échoué.
Voici un autre de mes débats récents avec l'État. La Caisse des dépôts est devenue un groupe; des unités longtemps noyées dans la masse opaque de la maison sont désormais plus indépendantes. Ainsi la Caisse nationale de pré- voyance, la CNP, qui est notre compagnie d'assu- rances : hier, elle était un morceau de la Caisse des dépôts, sans statut clair ni personnalité morale. Nous l'avons progressivement individuali- sée depuis 1987. La dernière étape, en cette année 1992, est sa transformation en société anonyme. Son capital est ouvert. Je souhaite, et cela arri- vera vite, qu'elle soit introduite en Bourse; l'exemple du Crédit local de France, le CLF, lui aussi émancipé par étapes ces dernières années, a montré combien la cotation du titre et l'obligation de rendre des comptes aux actionnaires et aux analystes financiers étaient une discipline salu- taire - nullement incompatible avec une gestion soucieuse de l'intérêt général.
Alors, comment constituer le capital de la nou- velle CNP ? Elle est un élément fort de notre groupe, de même que le CLF. Il s'agit ici d'un de nos problèmes majeurs : garder la cohésion du groupe de la Caisse des dépôts, tout en laissant à chacune des grandes unités qui le composent une identité et une autonomie sans lesquelles elles ne seront pas performantes. Cette cohésion passe par
94
les valeurs du groupe que décline chaque entre- prise, par un pilotage central, mais aussi, désor- mais, par des liens en capital. Je veux donc, pour la pérennité de ce groupe, que la Caisse des dépôts soit le premier actionnaire; il nous faut la minorité de blocage, 34 %. Le gouvernement accepte mal, à ce jour, ce jeu de l'Etat partenaire que je lui recommande. Il est, au départ, proprié- taire de la CNP, c'est-à-dire son actionnaire, à 100 %, puisqu'elle était établissement public. Et il veut rester au premier rang des actionnaires. Réplique de ma part, à Pierre Bérégovoy, à Michel Sapin, à Jean-Claude Trichet, directeur du Trésor : un, l'Etat est un mauvais actionnaire, il ne sait guère définir des objectifs aux entre- prises qui sont ses filiales, et ses représentants dans les conseils sont moins porteurs d'impulsions que d'interrogations, de demandes de délais de réflexion, de refus. Deux, quel sens aujourd'hui a la présence de l'État en première ligne dans une banque de plus (le CLF) ou une compagnie d'assurances de plus (la CNP), au risque de se faire pincer les doigts quand ces entreprises sont exposées, ce qui fut le cas avec le CLF sur l'affaire d'Angoulême? Trois, soyez modernes. Laissez-nous - vendez-nous - votre part. Et, faites de la Caisse des dépôts le premier action- naire. Et par une convention, faites d'elle notre mandataire.
Cela s'est fait pour le CEPME ' : on nous
1. Le Crédit d'équipement est en France la banque des petites et moyennes entreprises.
95
demande en 1991 de souscrire 500 millions de francs supplémentaires à son capital; la Caisse deviendrait ainsi son premier actionnaire, passant de 30 % environ à quelque 38 % du capital. Je déclare : « Nous n'investirons pas idiot. » D'accord pour monter dans le capital, si nous avons la res- ponsabilité de l'actionnaire leader, en vue notam- ment de rendre cette banque plus rentable et de donner à notre investissement un meilleur « retour ». L'État accepte; en même temps qu'il devient second actionnaire, je signe un pacte avec le directeur du Trésor, qui nous confie la pour- suite d'objectifs, déterminés conjointement.
L'État qui contracte avec des partenaires, c'est l'État qui en fait moins. Le résultat sera meilleur.
Malgré quelques insuccès provisoires - la Caisse des dépôts aura un jour gain de cause ! - je demeure avocat de la relation contractuelle. Elle est un acte de confiance de l'État envers la société. C'est un comportement moderne que de faire faire, que d'investir des tiers de responsabilités, que de sous-traiter. La négociation et le contrat bien piloté favorisent également le dialogue et la connaissance de l'entreprise par l'État et donc, en son sein, de saines évolutions.
L'association de l'État avec un tiers constitue une forme dynamique d'allègement de la puis- sance publique. Qu'on parle de joint ventures ou d'économie mixte, peu importe le vocable ou le statut, l'idée et sa mise en oeuvre sont fécondes.
L'économie mixte au quotidien est bien connue
96
de la Caisse des dépôts, qui est actionnaire de
plus de cinq cents sociétés d'économie mixte (SEM). Le partenaire veille à ce que son inves- tissement dégage une rentabilité satisfaisante; la
présence de la collectivité publique assure que l'intérêt général sera pris en compte.
Au lieu que ce soit un établissement comme
pour les autres grands projets parisiens, la SEM Tête-Défense, qui associait des investisseurs
publics et privés à l'État minoritaire, et que j'ai eu la chance de présider, a construit et vendu l'Arche de la Défense. Le mouvement est lancé en France, qui veut que métros, autoroutes urbaines et autres ouvrages à péage, peut-être demain les TGV, soient plus souvent réalisés et exploités par des groupements mixtes.
A contrario, la construction du tunnel sous la Manche, confiée au seul capital privé, rencontre les plus grandes difficultés. Un tel ouvrage, dont l'intérêt public est aveuglant, appelait évidem- ment un financement partiel par les États, c'est-à- dire une formule d'économie mixte. Mais l'hyper- libéralisme de Margaret Thatcher et de Laurent Fabius - qui consentait au même moment des concours publics importants aux promoteurs d'Eurodisney! - en a, suivant la mode de
l'époque, décidé autrement... Dans une société moins jacobine qu'aujour-
d'hui, l'économie mixte n'impliquera pas toujours l'État ni les collectivités locales. Les associations entre l'enseignement, les universités, les instituts de recherche et de formation, les syndicats et, bien
97
entendu, les entreprises sont plus nombreuses et vivantes en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les pays anglo-saxons que chez nous. Exemple à suivre. Létal doit accepter de plus radicales décentralisations, par exemple, les possibilités de coopération accordée aux universités. L'Europe se fera par de tels partenariats multiples. Les acteurs français doivent avoir plus de liberté de mouvement. Sinon, gare au hors-jeu.
Association, partenariat, passerelles et contrats : ces solutions s'appliquent bien aux multiples mis- sions non régaliennes dont l'État s'est chargé au fils des temps ou à ces services publics, Poste et autres, qui évoluent aujourd'hui en pleine concur- rence.
Aucune de ces formules n'évite le risque d'échec, ni le risque de pertes d'exploitation, ni le conflit. Mais toutes ont d'égales vertus, qui sont le propre d'une civilisation évoluée, ayant su se garder du « plus d'État » : alléger la puissance publique de tâches et d'effectifs qui n'ont plus leur place sous sa bannière, et donc réduire la pression fiscale; assurer une réalisation plus per- formante des tâches; ouvrir l'État au monde exté- rieur, lui interdire le travail à fenêtres fermées, substituer la confiance à l'injonction dans les rela- tions entre les institutions et la société.
Quand la société a commencé à demander des comptes à l'État, elle l'a fait naturellement par le biais des Parlements : c'est la grande innovation que le xixe siècle a à peu près généralisée en Europe. Au xxe siècle, la société a créé des orga-
98
nismes ad hoc de cogestion avec l'État, souvent démocratiques dans leur structure; la Sécurité sociale, ou l'UNEDIC pour la gestion des alloca- tions de chômage, tous organismes gérés paritaire- ment par les syndicats et le patronat, sous le contrôle de létal, illustrent cette démarche. Le partage des responsabilités et la gestion mixte constituent une modalité montante. Translations et associations sont une clé de l'avenir.
Par de tels désengagements et de tels recen- trages, par la réduction de son coût, par cette capacité à dialoguer et à s'associer, l'État retrou- vera le respect et la confiance qu'avaient entamés le poids de l'impôt et les abus de l'inter- ventionnisme.
L'ÉTAT-PLUS .
Confiance encore, et autorité : pour l'exercice de ses missions essentielles, l'État doit inspirer l'une et incarner l'autre. Il a ici, en effet, le devoir d'être grand, d'être fort, de s'assumer sans faiblesse. Pour qu'il soit à la mesure de sa tâche, je veux qu'il ait du muscle.
Je ne suis pas partisan de « l'État modeste », qui raserait les murs pour « libérer » les citoyens et pour que le marché prospère sans entraves. Le grand discours dérégulateur et l'appel incanta- toire au « moins d'Etat » du milieu des années 1980, et qui pourraient bien revenir en France, n'avaient d'autre but que de donner plus de jeu
99
au marché et plus de pouvoir aux forts, au risque de creuser les fractures de la société, au risque de battre en brèche la démocratie.
Bien au contraire, dans ces temps où le monde se déchire à nos portes, où l'économisme tente d'imposer sans partage ses lois, où nos sociétés se font moins solidaires, où il nous faut mener à bien la construction de l'Europe, la sauvegarde des équilibres écologiques et quelques autres pro- jets planétaires, l'heure n'est pas au relâchement. Il faut à nos nations occidentales un État qui tienne le coup, un « État-plus ».
L'Europe ne change rien à ce besoin d'État. Les attributions glisseront progressivement de l'État national aux instances communautaires. Mais il demeurera, bien sûr, un État en charge des grandes missions au degré national.
Pourquoi un État fort ? D'abord pour l'exer- cice des fonctions régaliennes qui sont les siennes dans la nation. L'Etat doit assurer à la nation la sauvegarde de son identité et de son indépen- dance. Il doit lui permettre d'être présente sur les autres théâtres du monde, en particulier, auprès des peuples moins développés ou lorsqu'il s'agit de défendre ou bien de rétablir le droit. Action économique et stratégique, actions de guerre, défense et diplomatie sont des armes que seul l'État est fondé à utiliser à ces fins.
Seconde mission : l'État a la sauvegarde de notre société démocratique et solidaire. Or cet édi- fice est chaque jour menacé, et appelle une auto- rité vigilante et ferme. Aujourd'hui, plus que
100
jamais, il revient à l'État républicain de faire vivre les hommes ensemble, en assurant le respect des valeurs sur lesquelles la nation s'est bâtie.
Le maintien de la cohésion sociale est une affaire capitale, qui ne s'accommode pas du recul de l'É4at. Certains pays ont négligé les services publics qui tissent la solidarité, entre les généra- tions (retraites, ou gratuité de l'enseignement), entre toutes les parties du territoire (service public en milieu rural, soutien des banlieues défa- vorisées), entre les différents groupes sociaux (Sécurité sociale, indemnisation du chômage, lutte contre les exclusions). Ces pays-là sont en péril social. Il n'est pas besoin de s'étendre sur les méfaits du « moins d'État » aux États-Unis. L'idéologie dérégulatrice et la faiblesse - hommes et structures - des institutions ont mis ce grand peuple dans un mauvais pas : quand Los Angeles se déchire dans le sang et le feu, s'agit-il encore d'un peuple ?
Suivant un mot récent du président de la République, cette cohésion sociale est chaque jour à « inventer ». L'État n'a pas le droit ici de s'effa- cer ; il lui faut, au contraire, être le plus intel- ligent des stratèges sociaux.
Troisième mission : l'État ordonne la réponse à quelques grands défis de l'époque. Tout le monde est d'accord pour lui demander, avec plus ou moins d'intensité, de réguler l'économie, d'assurer un sol favorable aux acteurs privés, de préparer le long terme, qu'il s'agisse de la recherche, de la formation, des grands programmes et des grands équipements collectifs.
101
On se tourne plus souvent vers lui, sans qu'aucun libéral proteste, quand les technologies, ou bien encore la santé publique, posent des pro- blèmes d'éthique inédits. Je ne vise pas seulement la bioéthique ou la procréation assistée. La lutte contre le sida, qui éveille de si grandes angoisses, risque d'amener les États à déplacer, au nom de la défense de la communauté, la frontière entre le domaine public et la vie privée.
L'État va devoir monter en ligne sur l'écologie. Il est le seul - ou plutôt, c'est l'affaire universelle de tous les États - à pouvoir énoncer et imposer les règles du jeu qui préserveront, autant que faire se peut, la nature. Quand les ministres fran- çais et allemand bloquent la vadrouille des déchets, nul ne reproche à l'État de se porter au créneau. On lui ferait grief, bien davantage, d'avoir trop attendu. L'État est le seul à pouvoir proposer, suivant le vocabulaire anglo-saxon, un modèle de développement durable, prenant le contrepied de la croissance aveugle. Il est ici le gardien des équilibres à très long terme, et, sachons-le, il entrera en conflit, sur de nouveaux terrains, avec le marché. C'est très bien ainsi. Il faudra qu'il ait, le plus souvent, le dernier mot.
Ainsi l'État que nous voulons plus léger n'est pas uniment appelé à reculer. Sur des sujets de premier rang, qui vont être le lot des prochaines générations, l'Etat est d'ores et déjà invité à en faire davantage. Il nous faut des repères. Il nous faut pour cela un État vigie et fort. Il a pris du champ - un peu trop, dans certains pays - sur le
102
terrain de l'économie, au long des années 1980. Il va, au cours de la nouvelle décennie, revenir en force dans la sphère politique et sociale, et entrer en piste sur des terrains inédits.
L'État a donc beaucoup de pain sur la planche. Ce ne sera pas souvent du pain blanc, mais il proposera à ceux qui le serviront des tâches pas- sionnantes.
Avec ces missions devant lui, avec ses péri- mètres réajustés, à la fois moteur et partenaire, l'État devra, plus que jamais, se montrer moderne et performant. Il devra, bien plus qu'hier, être compétitif. L'ouverture des frontières rapprochera le coût des institutions publiques entre pays. Elle interdira d'entretenir des appareils pesants. L'opinion, moins indulgente et innocente qu'hier, contestera les charges inutiles, les mauvais fonc- tionnements et l'inefficacité. Même si elle est dif- ficile à mesurer, la productivité des administra- tions devra faire un bond.
Nous allons donc nécessairement vers un État qui, en s'allégeant, aura perdu sa graisse. Je le vois musclé, c'est-à-dire tonique, mordant, retrou- vant l'esprit des administrations de mission. Je le vois rapide, à l'image de ses sanctions tombant huit jours après l'effondrement du stade de Furiani, quarante-huit heures après l'affaire des déchets allemands. Le gouvernement riposte par- fois vite, ayant compris que l'opinion n'accepte plus la tergiversation, les commissions dilatoires, la botte en touche. Ce que je propose au chapitre
103
suivant n'a d'autre ambition que de forcer l'allure.
Notre pays ne tolérera bientôt plus autre chose. Ce qui va amener les fonctionnaires et leurs syn- dicats à bouger sérieusement. Leur statut, j'y reviendrai, ne passera pas la fin du siècle.
C'est une bonne évolution que j'annonce. Le rejet dont souffrent l'État et ceux qui le servent va passer de mode. On ne méprise plus une admi- nistration « en phase », qui a bonne figure, qui soutient la comparaison avec les pôles vedette de
. la société civile. Et il fait meilleur y vivre.
VERS L'EUROPE, L'ÉTAT EN TÊTE
L'État doit être bon citoyen de l'Europe unie. Le premier Européen en France. Même s'il lui en coûte, il lui faut ici ouvrir la marche. Nul ne doit davantage, au lendemain de Maastricht, prê- cher l'exemple, et se mettre en quatre pour la construction de l'Europe communautaire.
Que l'avenir politique de l'Europe ne soit pas clairement fixé ne saurait l'arrêter, non plus que l'enchevêtrement des compétences et le rôle mou- vant des « piliers » de la Communauté, Conseil des ministres, Parlement, Commission, non plus encore que le flou de la subsidiarité, sur laquelle les docteurs vont indéfiniment gloser, mais que la Cour de Luxembourg précisera progressivement, comme elle a su faire depuis un quart de siècle. Les zones d'ombre ne peuvent servir d'alibi à un Etat nostalgique de son pré carré.
104
L'État doit tirer le pays, ses institutions, son
opinion, ses forces vives, vers l'avant, vers l'Union européenne. Il lui faudra résister aux pressions incessantes venant de son propre sein, et tendant à obtenir freinages, dérogations, échappatoires. Vers l'Europe, et si la France veut gagner la par- tie, il lui faut l'État en tête.
Pas question, bien entendu, que l'État perde ce
que notre histoire lui a légué en propre : esprit républicain, défense de la laïcité, lois sociales, universalité de la France. Mais, quand bien même certaines avancées seraient douloureuses sur la route de l'Europe, l'État doit être loyal.
Déjà, par les hommes qu'elle a dépêchés à Bruxelles, du fonctionnaire le plus modeste au
président de la Commission, la France a contri- bué à ce que l'exécutif tourne, comme elle a
épaulé tous les autres rouages depuis la CECA, c'est-à-dire depuis quarante-cinq ans. Il s'agit aujourd'hui de construire une puissance publique européenne avisée qui, plutôt que de bloquer Air- bus, soutienne de grandes réalisations privées et
publiques, renforce le droit communautaire, et sache se faire plus démocratique et moins « euro-
cratique ». Cette oeuvre sera d'autant mieux menée que les États appuieront les institutions de la Communauté. Le nôtre le premier, riche de son expérience institutionnelle et administrative millénaire et de sa force. Il lui faut à cette fin une belle volonté, un zeste d'abnégation et une grande ouverture d'esprit.
Invitons nos administrations, nationales et
105
locales, comme nos services publics, à accueillir les ressortissants de la Communauté. Un arrêt de la Cour de justice européenne de juin 1987 a pré- cisé que seuls sont réservés aux nationaux les emplois publics participant à « l'exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des inté- rêts généraux de l'État »; enseignants, chercheurs, médecins, ingénieurs, administrateurs peuvent a contrario être recrutés parmi les professionnels des autres pays membres. De même, nos concours publics devront s'ouvrir à eux. L'administration française y gagnera en expertise et méthodes nou- velles, comme déjà nombre d'entreprises fran- çaises. Pourquoi ne se proposerait-elle pas d'être la plus européenne par son recrutement ? a
Il faut encore que l'Etat se fasse ici pédagogue, qu'il devienne le grand décodeur de l'Europe. Cela passe d'abord par nos ancêtres... les Vikings et les Romains, c'est-à-dire par une inflexion européenne des programmes d'enseignement. Cela appelle ensuite un État qui nous rende l'Europe de Maastricht visible et lisible. Partage des rôles, application des règles de subsidiarité, reconnais- sance à d'autres rouages du pays du rôle qui leur revient dans le concert européen, recours à l'Écu, autant de sujets sur lesquels l'État doit faire école. Le gouvernement et l'administration sauront aussi impliquer davantage le Parlement français dans le processus communautaire, en l'amenant à déli- bérer plus souvent sur l'application des direc- tives - demain des lois - qui nous viennent de Bruxelles et de Strasbourg. Ainsi se comblera,
106
pour ce qui concerne notre pays, une part du fameux déficit démocratique.
Le plus dur sera ceci : l'Europe appelle l'État à se renouveler. Il doit se faire moins colbertiste et plus ouvert. Il doit jouer le jeu de ce pluralisme social qui inspirera l'Europe de demain, suivant des traditions venues tant du Nord que de la Méditerranée, où la vie locale et l'initiative décen- tralisée ont cours, plus que chez nous, depuis le fond des âges. Créée par l'État, organisée autour de l'État, et cela depuis des siècles, la France, si elle veut jouer franc jeu dans la construction de l'Europe unie, doit relever un beau défi : inventer les voies d'une composition intelligente avec des nations où l'État n'a jamais pesé du même poids. Le nôtre devra se gendarmer pour reconnaître ce que nous avons nommé la subsidiarité vers le bas, régions, villes, associations. Il lui faut s'apprêter à vivre dans un monde où les sources du droit seront multiples : collectivités locales aussi bien que pouvoirs et juridictions communautaires. Il devra accepter les décisions de la Banque centrale européenne, des déontologies financières d'inspi- ration anglo-saxonne, la reconnaissance mutuelle des normes et des diplômes. Il devra s'abstenir de créer des rigidités nationales supplémentaires, par exemple, en matière de statuts de personnels, et rendre le secteur public compatible avec ses homologues européens.
Tout cela est en route. Ces lois multiples vont devenir notre loi. S'il est vrai que pour la France, le point de départ est cet État centralisé, domina-
107
teur, sûr de lui, l'Europe conduit notre pays à une quasi-révolution. Elle sera heureuse. Elle ne sera pas facile.
Je voudrais un État qui appelle ce grand chambardement, et perçoive qu'il sera fécond. Ainsi, pour l'éducation : après tant de réformes aux si faibles impacts, ne peut-on espérer que le retour dans le siècle de nos enseignants et de notre système d'enseignement viendra moins de directives que d'une européanisation par la base ? Échanges de professeurs et d'élèves, jumelages d'universités, de collèges, d'écoles de formation des enseignants, équivalence de diplômes et cursus européens, tout ceci peut produire, par métissage, ce que notre pays attend depuis des décennies : la chute de cette Bastille au coeur de la nation qu'est devenue l' « Éducation nationale ». En somme, le salut par l'Europe.
Et voilà pourquoi il nous faut un État souple, ouvert, intelligent. Un État cool, face à l'Europe.
Souple et cool, mais pas faible. L'Europe ne sonnera pas l'heure de la démission de l'État. Elle ne sera pas thatchérienne. Pas question pour la France d'abdiquer des prérogatives et des ambi- tions qui ne seraient pas reprises en charge par les institutions communautaires. Et il ne faudra jamais perdre de vue qu'aux termes du traité de Maastricht, si la Commission ou le Parlement européen définissent des objectifs, les autorités nationales ont le choix des moyens.
Au regard de l'histoire à venir, l'État en France aura une autre fonction vitale. L'Europe réserve
108
quelques surprises violentes aux Français. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus le sel de la terre, que la terre tourne sans eux et que, curieusement, passé l'aéroport de Roissy, on ne parle pas beau- coup leur langue. Dans ses profondeurs, le pays va tomber de haut. Alors, l'État devra être un môle solide, en charge non seulement de la cohésion de la nation, mais tout simplement de son moral. Ce sera pour lui un nouveau défi à relever.
L'État solide et léger doit être un État de pointe. L'avenir s'annonce lourd de tensions. Pas question, dans ces conditions, de ranger l'État au musée : quand la mer est forte, on se tourne vers le capitaine. Pas question de s'accommoder de son poids excessif ni de ses faiblesses : quand les temps sont durs, l'indulgence serait coupable.
Mon pronostic est favorable. L'État va devenir plus fort et moins pesant, plus musclé et moins crispé. Je le vois plus souvent en tête. Mais ce projet, qui est politique, resterait déclamatoire s'il n'était accompagné d'une démarche de moderni- sation. Pour en proposer les voies, descendons sur le terrain du fonctionnement de l'État.
CHAPITRE IV
SEPT RESSORTS POUR UN ÉTAT PERFORMANT
Je ne plaide pas pour la révolution. On pour- rait faire ici la révolution de diverses manières : en abolissant sans autre forme de procès le statut des fonctionnaires; en démantelant l'État, au nom d'une idéologie de dérégulation à tout va; plus vicieusement, en le laissant s'étioler, au point de le mettre irrémédiablement sur la touche. Ce serait le contraire même de cet État allégé mais investi de grandes missions, à la hauteur de ces missions, ouvrier de l'Europe, pour lequel je plaide. C'est par la réforme, et non par la révolu- tion, que je propose le passage de l'Etat rigide et mou à cet Etat-plus qu'il nous faut.
Ce ne sera pas une réforme douce, mais une réforme choc. Elle ne sera pas sélective, elle tou- chera l'ensemble du secteur public.
Pourquoi le choc? D'abord, parce qu'il y a urgence; quand on est sur une mauvaise pente, le glissement s'accélère; et puis l'Europe, qui ne va pas être tendre pour nos pouvoirs publics,
111
n'attendra pas courtoisement que la France ait remis ses administrations à niveau.
Moderniser l'État est autrement plus complexe que pour les entreprises. Il est pétri, par tradi- tion, du sentiment de sa supériorité et se drape volontiers dans le statu quo. Il va s'arc-bouter sur ses habitudes, se crisper sur ses malaises pour en faire autant de motifs d'immobilisme. Il est qua- drillé de règles : droit administratif, comptabilité publique, fonction publique. Il est sclérosé - voir l'Éducation nationale - par un énorme conserva- tisme syndical. Face à cela, il ne faut pas de mesures dispersées ni de retouches en demi-teinte, mais une thérapie de choc, à la fois globale et cli- niquement tolérable. ,
Objectif: l'État performant. C'est l'État à la main heureuse. Renouant avec son époque, il est en phase avec l'économie comme avec la société. Il inscrit ses politiques et ses actions dans des straté- gies claires et connues. Il mesure sa productivité et affiche ses résultats. Bien entendu, il s'appuie sur des troupes motivées.
Postulat : pas d'efficacité sans motivation. Tout ce qui motive - puis-je dire que c'est mon leit- motiv ? - est deux fois bon. Premier effet, la moti- vation crée des salariés bien dans leur peau. Deuxième effet, cela même, produit de bons résultats. Enfoncerais-je, aux yeux de beaucoup, des portes ouvertes, j'énonce là des vérités igno- rées de larges strates de hiérarques, grands et petits chefs, du secteur public.
Question : la motivation, comment ? N'est-il
112
pas plus difficile de réveiller l'administration française, atone et sceptique, que d'équiper en dix ans la France en téléphones? C'est un problème « culturel », raconte-t-on aujourd'hui. Autrement dit : mission impossible.
Pas du tout! On motive ici comme on motive ailleurs. Je ne fais pas de l'entreprise le modèle absolu; je ne suggère pas qu'on proclame « l'entreprise-État »; je ne propose pas qu'on découpe le service public en agences plus ou moins privatisées. Des modes de gestion ont fait leurs preuves dans l'entreprise. Ils sont transpo- sables dans l'administration : ceux qu'il s'agit de motiver sont des hommes et des femmes faits de la même chair et habités par les mêmes attentes que les gens du privé. L'Etat remplit des missions extra-ordinaires ? Cela justifie des règles dif- férentes, cela nécessite des sauvegardes parti- culières. Mais cela n'appelle pas d'autres ressorts que partout ailleurs pour l'organisation, la ges- tion, le dialogue social, en fin de compte pour la motivation.
Ces ressorts sont à la portée de l'État. Il est parfaitement à même de les déclencher en son sein. Il peut être l'acteur de sa propre méta- morphose.
Il faut bien sûr qu'il le veuille. Car le choix de la performance est moins évident pour ces grands animaux protégés que sont les administrations, les services publics, les collectivités locales, tout cet univers abrité de la concurrence, que pour les entreprises. A celles-ci, il n'est offert d'autre
113
alternative que la compétitivité ou la mort. Pour l'État, le coup de reins appelle d'abord un grand acte politique.
Ce sera, ensuite, possible, par une démarche d'ensemble, suffisamment orchestrée et ordonnée pour éviter l'addition de « coups » dispersés. Suffi- samment astucieuse pour laisser du jeu aux
rouages, des marges à l'initiative, de la souplesse un peu partout. La réforme de l'État ne se conduira pas suivant le modèle étatique rigide qu'il s'agit précisément de bousculer!
La question n'est pas simple. Découpons-la suivant divers angles d'attaque. Ils reflètent mon
expérience, mes convictions. Je vais dérouler cette démarche avec une idée
en tête : tout ce qui suit n'est pas seulement appli- cable à la Caisse des dépôts, que les administra- tions jalousent souvent pour son autonomie et
pour son train de vie. Tout ce qui suit n'est pas réservé aux entreprises publiques, Électricité de France, SNCF, Air France, etc., plus proches dans leur fonctionnement de l'entreprise privée que de l'État. Tout ce qui suit peut être appliqué au coeur de l'État, aux administrations centrales comme aux « services extérieurs », préfectures, rectorats, collèges, directions départementales de
l'agriculture, de l'action sociale ou de l'équipe- ment, dont certaines offrent déjà des exemples remarquables de modernisation. Mon propos vise aussi des unités au profil plus particulier : un régiment dans l'armée (des expériences de décen- tralisation ont de longue date été conduites sur
114
cette cible), une ambassade, une CRS, une bri- gade de gendarmerie, un commissariat de police, et peut-être même un établissement pénitentiaire. Bien entendu, mes « ressorts s'appliquent plei- nement aux grands services publics - pensons à l'Agence nationale pour l'emploi, que son ministre actuel s'attache à motiver et à moderni- ser, à la RATP, que son président rénove à grandes guides, à l'Assistance publique ou à ses homologues de province qui ont amorcé ces der- niers temps des avancées notables. La démarche que je présente concerne intégralement, enfin, les collectivités locales, leurs services administratifs ou techniques, régies municipales, etc.
Les seules limites sont affaire de taille et d'autonomie. Ma direction de la construction comptait quatre cents collaborateurs; à cet éche- lon, il est assez facile de définir une démarche, et de la démultiplier dans les unités. Cela a moins de sens pour un poste consulaire de dix agents. L'autonomie a davantage encore d'importance : chacune de nos directions régionales de la Caisse des dépôts, dont l'effectif moyen est de vingt per- sonnes, a ses propres objectifs et s'est mise en ordre de bataille pour les atteindre. Donc le consulat après tout pourrait bien, lui aussi, se prêter à nos réformes, pour peu que monsieur le consul le veuille. Car l'autonomie n'est pas une donnée fixe : elle se gagne et se négocie; elle devrait concerner de haut en bas toute unité grande ou petite.
C'est donc bien d'une réforme globale de l'État
115
entier que je vais parler. Et, au-delà de l'État, de tout le secteur public de notre pays.
Je propose sept ressorts pour un État perfor- mant :
e Des chefs : tout commence par de vrais patrons,
a Des contrats : objectifs clairs et coudées franches,
Des credo : un, projet pour chaque service, Des clients : l'Etat est au service du citoyen, Des carrières : un parcours stimulant pour la
vie au travail, e Les cordons de la bourse : pas besoin de les
délier pour moderniser l'État, 0 De la considération : le coeur à l'ouvrage. Tout cela a été entrepris, de manière plus ou
moins cohérente, par de multiples pionniers du secteur public. Tout cela appelle un chef d'orchestre; c'est pourquoi au chapitre suivant, je me tournerai vers le politique. Je compte inter- peller le gouvernement, qui est dans l'État le grand chef des fonctionnaires - ou qui devrait l'être : le ministre est souvent un patron qui s'ignore. Je m'adresserai à ce patron qui s'ignore.
DES PATRONS ET DES HOMMES
L'encadrement de tête est le premier point faible de l'administration française, avec, on l'a dit, de superbes exceptions. Comme il est normal, la modernisation se joue d'abord en haut.
116
Propos au douanier-chauffeur qui me transpor- tait, jeune inspecteur des finances, lors de la véri- fication de la direction des douanes à Nice, en 1963: « Ils sont nickel, vos équipements !» » Réponse : « Monsieur l'inspecteur des finances, nous sommes la Douane de monsieur de Mont- rémy ! » De même que cet agent se réclamait, bombant le torse, de son lointain directeur géné- ral, de même hommes et femmes au travail aiment se reconnaître dans leur patron, quand il, ou elle, a du lustre et de l'autorité. Il est un fac- teur de motivation, et nos temps médiatiques ont valorisé son poids.
Or, l'administration choisit mal ses dirigeants. Dans l'entreprise privée, la sélection est attentive; elle se prépare de longue date, à l'aide de plans de carrière et de formation. Des professionnels assistent souvent le responsable du choix quand diverses candidatures sont en balance. On appré- cie leur cursus, leur tempérament, leurs compé- tences ; l'élément décisif est, en général, l'expé- rience acquise ailleurs : comment a-t-il réagi dans une situation difficile, de quels collaborateurs s'est-il entouré, a-t-il associé, stimulé, réformé s'il le fallait, l'unité dont il avait la charge, quelle image y a-t-il laissée ? Fréquemment, on amène le candidat à rencontrer ceux avec qui il serait amené à travailler, afin de vérifier les compatibi- lités, etc.
Rien de tel dans l'État. Un préfet est affecté le mardi soir, au terme d'arbitrages subtils et préci- pités ; la chose est actée le lendemain en Conseil
117
des ministres. L'aptitude au poste, la réaction de l'intéressé (il n'est pas de mise, à vrai dire, qu'il réagisse!), le fait qu'on déplace un homme attelé à des chantiers en cours, ne sont pas pris en compte. Une superbe introduction de la démarche de « qualité totale » engagée dans ses services par un préfet de région à Montpellier fut ainsi, il y a trois ou quatre ans, décapitée, puis rangée au pla- card, parce que l'intéressé, cueilli en plein vol et contre son gré, avait été nommé ailleurs pour boucher un trou. L'histoire ne dit pas si, dans la préfecture suivante, ce fonctionnaire aussi nomade que clairvoyant eut le courage de repartir de zéro sur la même voie. Mais les dégâts étaient grands.
La politique commande bien des désignations. Que d'erreurs commises en son nom! Ami, compagnon, militant, sont des vertus étrangères à l'art de gérer les hommes et de conduire une action solide. La plupart des « parachutages » venant des cabinets sont mauvais. On rira : ce fut mon cas en venant de Matignon à la Caisse des dépôts! Mais je persiste et signe.
Ce qui scandalise est la rusticité du mode de choix. Il est vrai que l'exemple vient de haut : combien de ministres, et de tout temps, se sont vu, à leur surprise, attribuer un portefeuille pour lequel ils n'avaient nulle vocation! Combien de directeurs, voire de présidents d'entreprises publiques, ont dû leur nomination au fait qu'il fallait les « caser » ou les « recaser », sans que l'adéquation de l'homme à la responsabilité soit évaluée, souvent même sans que l'intéressé soit
118
consulté. Jamais dans une entreprise performante on n'agirait avec tant de légèreté!
Il y a toujours dans les « hautes sphères » de l'État trois ou quatre hommes en charge de trou- ver des points de chute à des amis du pouvoir, à des cadres en rade, à des responsables qu'on vou- drait dégager pour faire place à des candidats mieux vus du gouvernement. J'ai eu cette charge et ce souci pendant mon passage auprès de Pierre Mauroy. En 1986 et 1987, je ne pouvais ren- contrer Jacques Friedmann, conseiller de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur, sans qu'il sorte sa « liste » de son tiroir. Il était dans son rôle, qu'il jouait ici avec tact, et je me prêtais à la litanie...
La bonne solution prévaut parfois. Nous fûmes deux ou trois, en janvier 1982, à proposer et à soutenir bec et ongles Michel Camdessus contre un candidat sympathique, aussi « appuyé » qu'inapproprié, pour prendre la direction du Tré- sor. Opération réussie. Et ce fut un merveilleux choix! Camdessus n'est-il pas devenu gouverneur de la Banque de France, nommé par Pierre Béré- govoy, puis directeur général du Fonds monétaire international, avec le soutien d'Édouard Balla- dur ? a
Je me suis constamment efforcé - j'y suis presque toujours arrivé - de ne pas imposer un coéquipier à un de mes directeurs. J'ai moi- même, depuis trente ans, toujours réussi à choisir mes collaborateurs immédiats. A la Caisse des dépôts, cela n'a pas été sans quelques problèmes. Les cinq ou six dirigeants de la maison qui for-
119
ment avec moi l'équipe de direction générale sont, selon la loi de 1816, nommés, sur ma proposition, par le gouvernement. On a voulu, une ou deux fois, me forcer la main et, en 1989, m'imposer un membre d'un éminent cabinet ministériel pour être mon adjoint, à la direction financière de la Caisse, alors que j'entendais recruter Hélène Ploix, à cette époque représentant de la France auprès de la Banque mondiale. J'ai dû mettre ma démission dans la balance pour avoir gain de cause. Comment demander que la Caisse des dépôts soit performante, et ne pas laisser son patron constituer son équipe ? Bien à plaindre sont ces chefs d'établissements, collèges ou lycées, porteurs d'un projet pédagogique, que l'affecta- tion d'un adjoint désabusé ou de professeurs ina- déquats vient ruiner ! Je suis outré de ces compor- tements ; j'y vois beaucoup d'archaïsme et de médiocrité. Ceux qui les décident ignorent ce qu'est la gestion, affichent leur désinvolture et leur mépris pour des efforts qu'il faudrait au contraire encourager.
Cela ne vaut pas seulement pour les sommets des pyramides. Dans l'État comme ailleurs, un responsable, quel que soit son rang, ne saurait se voir imposer ses collaborateurs. Il faut lui en lais- ser le choix. Ou alors, qu'on ne lui donne pas d'autonomie, qu'on ne l'invite pas à être respon- sable, qu'on ne lui impartisse pas d'objectifs ambitieux ! Et qu'on renonce à moderniser l'Etat !
Conduire les hommes n'est pas donné à tous. J'ai périodiquement dit aux cadres de ma mai-
120
son : « Il est bon que vous ayez de la compétence dans votre domaine, et j'attends de vous un regard aigu sur votre activité, une bonne sensibilité au marché ou plus généralement à votre environne- ment, une capacité à anticiper. Mais je n'attends pas de vous que vous soyez le meilleur dans les métiers qu'on exerce chez vous. Vous êtes entouré de collaborateurs plus professionnels que vous. Si ce n'est pas le cas, faites ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Votre vraie responsabilité, qui fera la différence aux yeux de votre équipe, c'est un petit nombre de vertus, d'un autre type, que vous devez cultiver :
0 Décidez ; fixez des objectifs clairs à chaque collaborateur direct;
0 Déléguez; contractualisez vos relations avec eux; soyez artisans de décentralisation;
e Commandez, tranchez, sanctionnez s'il le faut; ne redoutez pas le face-à-face avec vos coé- quipiers ; voyez-les régulièrement, évaluez avec eux leur travail et leurs perspectives; s'ils sont mauvais, dites-le-leur, tirez-en les conséquences, cela fait partie de votre métier.
0 Recrutez bien, motivez bien, formez bien, faites bien les plans de carrière de vos collabora- teurs ; regardez-les avec fermeté, mais aussi avec chaleur ;
. Communiquez; vous devez être compris; mais vous devez d'abord écouter et surtout entendre;
e Animez votre service ou votre entreprise; soyez artisans de convivialité; trouvez les bons
121
ressorts qui amèneront vos troupes à s'adapter, à se prendre par la main. Ces ressorts veulent de la méthode; ils veulent aussi du coeur ;
a Soyez honnêtes, enfin, vis-à-vis de votre mis- sion et de votre entreprise. Parce que vous servez ici le bien public. Parce que transiger, déroger, si vous vous y prêtiez, n'échapperait pas à vos colla- borateurs et saperait votre autorité.
Et j'ajoute, quand je reçois un dirigeant nouvel- lement nommé : « Amusez-vous, prenez plaisir à votre travail, et faites un peu plus heureux ceux que vous allez commander ! »
D'autres patrons tiendront des propos diffé- rents. Mais une chose est sûre : il faut à l'État une nouvelle génération de chefs, pas nécessaire- ment des experts, surtout pas des copains ni des partisans, mais des patrons. Des hommes et des femmes qui aient les qualités que je viens de requérir, et donc nécessairement du tempérament; et qui possèdent encore ce mélange d'audace et de raison, de goût du risque comme d'attention aux boulons bien serrés, de charisme et de réserve, d'analyse et d'anticipation, qui est la marque des vrais dirigeants. Il leur faudra en plus, car il s'agit du service de l'État, de solides vertus répu- blicaines, et le goût de la chose publique.
En venir là n'est pas une mince affaire, tant on part de loin. Le recrutement des cadres supérieurs doit être bouleversé. Et ici, l'on s'inspirera sans état d'âme de ce que font les entreprises.
Le recrutement dans l'État appelle l'ouverture.
122
S'il s'agit des responsables de premier rang, et même des échelons qui suivent, il faut s'affranchir des règles administratives' et les chercher aussi bien dans «le privé » que dans la fonction publique. Je ne suggère pas que les fonction- naires soient placés en second choix. Mais qu'à un poste défini - cette définition doit être expli- citement rédigée - on cherche l'homme ou la femme qui correspondra le mieux. Ce qui compte, ce ne sont pas les brillants diplômes, ce ne sont pas les cycles de formation proposés par l'ENA (en quinze jours!) à la « gestion des ressources humaines ». Le seul critère est l'expérience. Il faut des chefs qui aient été des patrons et qui aient, au charbon, fait leurs preuves. Je veux dire des chefs d'entreprise, ou des responsables qui aient dirigé un morceau d'entreprise, que celle-ci soit publique ou privée.
Avoir eu cette responsabilité, tenu un budget et ferraillé pour produire des résultats, combattu pour gagner des parts de marché, géré des hommes, licencié (rude et forte expérience), recruté, redéployé des forces, négocié, innové, communiqué, s'être frotté aux réalités inter- nationales est la seule école qui vaille. Les chefs de grande carrure qu'il faut à la tête des services publics sont les diplômés de cette seule école-là.
Un homme ou une femme de cette trempe, me dira-t-on, ne viendra jamais diriger une adminis-
1. C'est déjà le cas, en principe : un directeur d'administration cen- trale peut être choisi hors du sérail, comme un cardinal hors de la hié- rarchie de l'Église. Mais les exemples sont, dans l'un et l'autre cas, rares en ce siècle.
123
tration, et probablement pas une entreprise publique. Ce n'est pas « de son niveau ». « Il faut être réaliste, ajoute-t-on, on ne divise pas son salaire par trois ou quatre ! »
Pas d'accord ! Et voici comment cela peut chan- ger :
0 Si le service public est irremplaçable, met- tons-y des hommes de poids. Le directeur de la construction importe-t-il moins à la République que le président d'une grande entreprise de bâti- ment ? Cessons de placer ici un jouvenceau sans expérience (mon cas, il y a vingt ans...) alors que règnent, en face, des patrons de premier rang, dont certains auraient toutes les vertus requises pour servir l'État. Permutons-les! et si l'Etat se rénove comme je le suggère au long de ces pages, le président-directeur général ne s'ennuiera pas un instant, il fera oeuvre utile, et contribuera au changement de la chose publique!
< Le salaire ne doit pas être un problème. Je ne suggère pas l'abnégation, comme l'ont prati- quée Roger Fauroux à l'ENA ou Jacques Mai- sonrouge à la direction générale de l'Industrie. Je plaide pour que l'État ne joue pas, face aux rémunérations qui ont cours et qu'il connaît bien, les vierges effarouchées. Oui, s'il le faut, payons à leur valeur - transigeons : un peu en dessous, parce qu'on attend d'eux un geste qui marque le prix qu'ils attachent au prestige de la fonction - les hommes de premier plan dont l'État a besoin. Je dirai plus loin comment, sans bourse délier davantage, ces solutions aujourd'hui hérétiques deviendront bientôt jouables.
124
e Sur ces bases, assurons le va-et-vient, et non pas l'exode à sens unique, entre le secteur public et les entreprises. On cite souvent l'exemple amé- ricain ; mais ces chefs d'entreprise ou ces universi- taires qui choisissent pour un temps, par fidélité à un président ou par goût du pouvoir, de servir l'administration fédérale, sont souvent très poli- tiques et fort amateurs. Ils filent comme des météores. Je suggère une sorte de contrat, par lequel l'entreprise accepterait que tel cadre parte ou reparte, quelques années, dans le service public. Il y serait comme détaché; il pourrait, à son retour, reprendre sans dommage sa carrière dans le groupe « prêteur ».
Revenons à l'ENA. Elle n'est ni le nombril de la France ni un rouage irremplaçable dans l'État! Elle a moins d'importance que l'ensemble des filières de formation et de recrutement des fonc- tionnaires de tous rangs et de toutes spécialités : « grandes écoles » ou écoles toutes simples, qu'elles soient scientifiques, techniques, adminis- tratives, qu'elles soient nationales ou locales, insti- tuts régionaux d'administration, centres de forma- tion des personnels communaux ou hospitaliers, facultés ou écoles, écoles militaires, écoles nor- males, écoles de police aussi bien que des impôts ou du Trésor, organismes de préparation aux concours administratifs, etc. Les lignes qui suivent visent l'ENA, parce qu'elle est un symbole, souvent sous les feux de la rampe, et parce que j'ai pris pour cible amicale de ce livre le jeune énarque qui veut tourner casaque aussitôt son
125
diplôme-en-poche. Mais ce que je dis de l'ENA peut, à divers degrés, s'appliquer aux multiples filières d'accès au service public.
L'ENA doit changer radicalement. D'abord sur le plan de l'enseignement. Il ne faut pas y dispen- ser des savoirs, mais des expériences centrées sur la gestion des ressources humaines et la conduite de projets. C'est cela que les futurs cadres, futurs managers, doivent par priorité apprendre. Ce nouveau cap ferait écho à la réforme récente de la formation des maîtres et enseignants, désormais consacrée davantage à la pédagogie. Les matières de cette école, comme dans les autres écoles pour fonctionnaires que je viens d'évoquer, s'apprennent hors les murs, dans l'entreprise, en France et à l'étranger, et, bien sûr, au sein de l'État, où existent des îlots d'exemplarité. Durant leur passage à la tête de l'ENA, Roger Fauroux et René Lenoir ont déjà infléchi les choses en ce sens.
L'ENA doit s'ouvrir. Elle doit être école commune aux futurs cadres de l'État, du secteur public et surtout des collectivités locales. Elle doit contribuer à la démocratisation de la haute admi- nistration, par un plus large appel à des hommes et des femmes non-fonctionnaires ayant déjà exercé une activité professionnelle hors adminis- tration. Elle devra se faire européenne, accueillir davantage d'élèves étrangers appelés à travailler ensuite dans le secteur public français, proposer de manière symétrique ses élèves à d'autres admi- nistrations de la Communauté, être un maillon
126
d'un réseau de centres de formation s'imprégnant de leurs différences, sans chercher à exporter le modèle français tout sec.
A la sortie de l'ENA, le plus important reste à faire si l'on veut juger les élèves pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils savent. Je suggère que durant trois ans, ils soient affectés, par tirage au sort, dans l'administration centrale ou locale; on les mettra en position d'encadrement - ce sont ces aptitudes-là qu'il faut juger - et non d'état-major. Ils seront évalués, par leur service comme par l'école, pour leur capacité à animer une équipe et à atteindre des résultats. Ensuite, l'ENA les dis- tribuera, à la faveur d'un classement ou d'un accord entre les élèves, entre les métiers qui leur conviennent le mieux. Mais on saura qui a la trempe des managers qu'il faut à l'État.
Dernière touche pour l'ENA : cet enseignement devrait être irrigué par la recherche en sciences administratives et en sciences de la gestion. Une fondation consacrée à ces sujets pourrait être cou- plée à l'école. L'ensemble devrait alors être, bien davantage, un centre de formation continue dans le cours des carrières, une sorte d'École de guerre axée sur la gestion de pointe, ouverte à des sta- giaires du privé comme du public.
Quelques notations encore sur le choix des patrons dans l'État.
Soyons extrêmement attentifs aux cadres inter- médiaires, ceux qu'on appelle les « petits chefs ». S'ils bloquent parfois le changement, c'est que le
127
blocage est au fond d'eux-mêmes. Il faut les accompagner, les aider, par de bonnes formations, par des stages au-dehors et à l'étranger, à ouvrir les yeux sur la révolution qui a, partout dans le monde, bousculé la gestion, les pouvoirs et les rôles. Il faut leur présenter le système nouveau comme une chance, et leur donner cette chance. Et ne les écarter que si le pas leur est impossible à franchir.
Je plaide enfin pour la durée. Le métier de patron est difficile. Il concerne les hommes et les organisations. Il faut parfois s'attaquer aux comportements, aux réflexes, à toute une culture. C'est une affaire de longue haleine : à moins de cinq ans, on ne fait rien de sérieux. Trois ans pour remonter Antenne 2, avec la précarité au bout du chemin, c'était pour Hervé Bourges un handicap majeur. Il a heureusement été reconduit, mais la règle du terme court constitue une stupide épée de Damoclès qui nuit à l'auto- rité des patrons. Il faut, dans le secteur public, des mandats longs. Pourquoi pas dix ans ? Etant entendu qu'une révocation par l'actionnaire, c'est- à-dire par l'État, est toujours possible. Il vaut mieux un mandat long et unique, que de brefs mandats reconductibles. La reconduction présente un grand désavantage : certains, avant le terme, cherchent trop à plaire au pouvoir...
De toutes manières, il est aussi important de donner aux dirigeants la chance de la continuité que de bien les choisir.
Ainsi, peut-être, l'État se dotera-t-il d'un enca-
128
drement de haute volée, à la mesure de ses res- ponsabilités.
J'ai eu sous les yeux la lettre d'un jeune cadre du secteur public quittant ses fonctions : « Grâce aux impulsions reçues de mon patron, j'ai pu exprimer dans mon travail ce à quoi je crois, j'ai pu expérimenter la force de la pensée traduite en actions et l'énergie subversive du modernisme dans le secteur public... »
Le choix des dirigeants dans l'État et la liberté qui leur sera laissée constituent la première condition pour motiver les agents. Si elle est rem- plie, le reste suivra.
DES CONTRATS : t OBJECTIFS CLAIRS ET COUDÉES FRANCHES
Tout patron, tout cadre, toute unité doit avoir des objectifs. Il faut lui donner des armes pour les atteindre : effectifs, encadrements, équipements, informatiques, locaux, etc. Il est légitime qu'il y ait là-dessus dialogue : « Je peux obtenir ces résultats si mes moyens sont suffisants. » Ce dia- logue doit se nouer explicitement. Il y a alors contrat.
Ensuite, l'échelon supérieur devra laisser une grande liberté de marche pour conduire les tâches et pour toucher au but. En fin de période, on ira aux résultats; leur degré de réalisation sera éva- lué de manière chiffrée; cela suppose que le
129
contrat ait prévu des instruments de mesure et des indicateurs. Sur cette base, une appréciation sera dite. Il y aura sanction, positive ou négative.
Ce système est classique dans toute organisa- tion moderne. Il faut le généraliser dans l'État. En le décrivant, j'ai fait l'apologie de la décentra- lisation. Plus précisément, de la gestion décentra- lisée par objectifs négociés.
Au sein des administrations, la pratique du contrat conduit à une petite révolution : une chaîne contractuelle succède à la cascade hiérar- chique. A chaque échelon, au lieu d'attendre des directives sans appel, qu'il fallait exécuter sans initiative, on s'engagera à atteindre des résultats, dès lors que la capacité en aura été donnée.
Pour remplir son contrat, le service aura le choix des moyens. Le responsable du service aura les coudées franches pour l'utilisation des crédits, la gestion du personnel, l'organisation du travail. Ainsi s'agissant des crédits, le service disposera d'un budget global pour à la fois l'investissement, le fonctionnement et le personnel. Il sera autorisé - nous y reviendrons - à réinvestir les surplus tirés de ses gains de productivité. S'agissant du personnel, le chef de service pourra choisir ses collaborateurs, et ajuster leur salaire à leurs qua- lités professionnelles. Quant au mode de travail, la plus grande liberté, allant jusqu'à la sous- traitance, sera de mise, sous réserve du respect des garde-fous déontologiques nécessaires.
Rendez-vous aux résultats. Les objectifs auront été chiffrés; dans cette démarche, il y a des
130
chiffres partout. L'esprit de « mesure » aura péné- tré le service; l'évaluation, rationalisée, quanti- fiée, du degré de réalisation des objectifs, aura succédé au feu croisé de critiques subjectives et passionnelles qu'échangeaient depuis toujours, en y dépensant beaucoup d'agressivité et d'énergie, deux unités placées sans le savoir en « relation- client-fournisseur ' ». Les résultats tomberont. Et les sanctions aussi : positives, tel l'intéressement financier pour l'unité concernée ou l'avancement pour son chef; négatives, tel le déplacement ou la révocation du responsable; dynamiques, telle l'ouverture d'un chantier : comment remodeler ce service pour qu'il soit à même de tenir ses enga- gements ?
La démarche de « qualité totale », dont l'origine est japonaise, a été largement décalquée depuis quinze ans par les entreprises américaines et européennes, et même en France dans l'adminis- tration, à l'initiative notamment d'Édouard Balla- dur en 1986. Nous la poursuivons à la Caisse des dépôts depuis 1985. Elle nous a appris la « mesure ».
Sur cette notion, assez bien acclimatée mainte- nant, repose notre système d'intéressement. Il est très décentralisé : on compte aujourd'hui à la
1. La « qualité totale » repose notamment sur la relation client- ' fournisseur. Toute unité se situe dans une chaîne de services rendus, client d'une unité d'amont et fournisseur d'une unité d'aval - ou de plusieurs, bien entendu. Cette relation se quantifie, se traduit en objec- tifs. A la Caisse des dépôts, nous l'avons souvent traduite en contrats. Elle motive les échelons éloignés du front de vente et du « client » externe en illustrant pour chaque unité combien elle est utile, et com- ment elle peut l'être davantage, au service rendu par la maison.
131
seule Caisse des dépôts et sans inclure ses grandes filiales, quatre cent soixante centres élémentaires de responsabilité (CER), que j'aime appeler centres d'évaluation des résultats. Chacun d'eux se voit fixer ses objectifs pour l'exercice, après une négociation qui, dans les meilleurs cas (cela ne marche pas partout parfaitement !), implique tout le personnel. Au moins deux objectifs qualitatifs; par exemple, dans notre petit CER de la direction générale, qui comprend quatre cadres, dont moi- même, des secrétaires, des chauffeurs, des huis- siers : l'amélioration de l'accueil - que nous mesurons avec un évaluateur externe -, ou la ponctualité des réunions. Au moins deux objectifs quantitatifs; par exemple, dans une direction régionale du Crédit local de France, telle part de marché pour le prêt aux collectivités locales; ail- leurs, un nombre de dossiers par jour, une réduc- tion des délais de réponse ou des jours de valeur, une contribution au résultat brut de la Caisse des dépôts, etc. L'intéressement, qui a représenté en
: 1991, près de 3 % de la masse salariale brute, est calculé, pour chaque unité, suivant le degré de réalisation ou de dépassement des objectifs ini- tiaux.
Qui dit mesure dit aussi évaluation. Évaluer, c'est apprécier à quel point des objectifs sont atteints; cela appelle le pointage des résultats, mais aussi des jugements qualitatifs. L'important est que toute action soit pesée, dans ses résultats directs, comme dans son impact sur les parte- naires ou son environnement. Les procès-verbaux
132
ou comptes rendus de mission que pratiquent la police, la gendarmerie, les pompiers, constituent des applications, fort anciennes, de ce principe. Mais on ne voit en général rien de tel dans l'administration proprement dite. Les rapports annuels, quand ils existent, sont des documents à usage externe, où il est dit qu'on a travaillé sans bavure et comme des héros! Un chantier confié à une administration, la mise au point d'un projet d'impôt nouveau, la modernisation d'un système informatique, l'élaboration de nouvelles règles administratives, ne font presque jamais l'objet d'une évaluation. On n'y pense même pas.
Depuis quelques années, il ne s'est plus lancé un projet ou un programme à la Caisse des dépôts, sans qu'une fraction du budget soit consa- crée à son évaluation. Elle oblige à être clair sur les objectifs et à établir des indicateurs. Elle requiert surtout une stricte définition des rôles : pour notre « programme développement solida- rité », au titre duquel, depuis 1989, la Caisse des dépôts a consacré plusieurs centaines de millions de francs à appuyer la réanimation de banlieues à la dérive, il a été pris soin de repérer explicite- ment, pour chaque opération, le maître d'ouvrage, les intervenants et les partenaires. Des conven- tions ont été passées, entre eux, sur un mode décentralisé, mais suivant une méthode centrale invitant à réserver des moyens à la « conduite du programme », à vérifier la concordance entre la hiérarchie des objectifs et la répartition des finan- cements, à créer des comités de pilotage et de
133
suivi locaux, etc. L'évaluation y a été conçue comme un moyen de mesurer si les dépenses ont été bien adaptées aux résultats. Elle est aussi un mode d'information utile pour définir de meil- leures procédures pour l'avenir, cette réflexion étant conduite de manière ouverte, évaluations mises sur la table, avec les partenaires (associa- tions sociales, administrations, organismes d'HLM, et surtout collectivités locales) que nous associons à nos opérations.
Mes discours de voeux constituent, à la Caisse des dépôts, au début de chaque année, un exercice essentiel de communication. Notre service de communication interne les évalue dès le lende- main, et me donne un « retour » précis de l'écho qu'ils ont reçu : qu'a-t-on compris, apprécié, regretté, quelles idées-force ont été retenues, quel a été l'impact de la mise en scène choisie ? C'est évidemment un élément précieux pour faire pas- ser les messages futurs.
Mais l'élément fort du contrat est en amont : les objectifs. Pas d'administration moderne sans objectifs clairs.
A Grenoble, un procureur de la République soucieux de l'efficacité de la justice a organisé le travail en fonction de la capacité des tribunaux à écluser les dossiers, de sorte que les affaires soient traitées dans des délais rapides. Il donne à la police et à la gendarmerie deux indications : pour telle période, priorité à tels délits, en particulier, les infractions au code de la route ; limitation du
134
nombre de dossiers que chaque unité est autorisée à porter devant les juridictions compétentes. Ainsi, moins de contrevenants, certes, seront jugés, mais plus vite et mieux. La justice y gagne en crédit, les services de base se trouvent motivés, sachant que leurs procès-verbaux seront suivis d'effet, et non pas, comme à l'ordinaire, ensevelis dans des prétoires surchargés.
Chaque salarié doit, dans sa vie profes- sionnelle, connaître précisément ce qu'il a à faire; évidence dans une usine et, en général, dans le secteur tertiaire. Propos révolutionnaire dans l'administration, où l'on vit d'à-peu-près, dans l'attente incertaine d'une succession d'ordres invi- tant, sans commentaire, à effectuer des tâches décousues et parfois incompatibles en termes de cohérence ou de plan de charge : un service sub- mergé ne peut pas recevoir inconsidérément des tâches supplémentaires. Et pourtant cela se pra- tique tous les jours!
Chacun doit donc poursuivre un ou plusieurs objectifs connus et clairs. Chacun doit dès lors s'engager, c'est l'esprit du contrat, sur un ou plu- sieurs résultats chiffrés. Chacun doit être apprécié sur la réalisation de ces résultats et devrait pou- voir évoluer dans sa vie professionnelle en fonc- tion d'eux, aussi bien que de ses talents et de ses compétences.
Ceci doit s'appliquer dans le service public comme dans l'entreprise, dans les petites équipes comme dans les grands ensembles, dans les ser- vices fonctionnels internes à une administration comme dans les unités au contact de l'extérieur.
135
Un principe guide cette démarche : la décentra- lisation. Décentraliser constitue l'alpha et sans doute l'oméga de la gestion moderne : j'ai décou- vert cela sans jamais ouvrir un manuel de mana- gement. Quand je dois résumer d'un mot la trans- formation imprimée depuis dix ans à la Caisse des dépôts, ma réponse ne varie pas : décentralisa- tion...
C'est autour de la décentralisation qu'on peut organiser une gestion par objectifs; il s'agira évi- demment des objectifs que l'on a décidé de contractualiser. C'est à partir d'elle que l'on peut bâtir un contrôle de gestion, une batterie d'indica- teurs, des tableaux de bord. C'est par la décentra- lisation qu'on introduit la responsabilité, qu'on légitime l'initiative, qu'on fait passer cette vertu nouvelle, qui va revivifier l'administration : la confiance. Si je passe contrat avec toi, je te fais confiance pour trouver, avec les moyens que je te donne, les bonnes solutions pour atteindre les résultats que je te fixe.
Le contrat vient naturellement charpenter la décentralisation.
Mais il n'est pas facile de décentraliser. A le faire, on prend des risques, on suscite des levées de boucliers. Il y faut, d'expérience, deux ou trois fois plus de temps qu'on n'imagine au départ...
Risques de dérapage. On commencera par décentraliser des pouvoirs budgétaires, le droit de glisser des crédits d'une ligne à l'autre, l'auto- risation d'acheter des matériels sans passer par les services centraux. Puis on sera habilité à sous-
136
traiter, voire à embaucher du personnel sous contrat. Un jour, l'échelon décentralisé recevra des crédits de personnel et assurera sa propre ges- tion des hommes. Tout cela se verrouille mal tant qu'il n'y a pas contrat Tant qu'il n'y a pas constat des résultats et sanctions, le système n'est pas sécurisé.
Or il faut d'abord décentraliser avant de contractualiser. Le contrat n'a, en effet, pas de sens s'il n'existe pas d'unités autonomes. On navi- guera donc un temps en zone à risques.
Risque d'une levée de boucliers. Comme on l'a vu pour la décentralisation poli-
tique, surgissent, au sein de l'État de multiples résistances. L'échelon supérieur répugne à se des- saisir, invoquant le désordre, l'incapacité des niveaux subalternes ou locaux, expliquant en somme qu'il est irremplaçable. Il y avait eu des lois de décentralisation en 1964. Directeur de la construction, j'ai eu la plus grande peine à les appliquer. Le service en charge des permis de construire pour les opérations HLM s'estimait seul au monde à savoir dans quel sens doit s'ouvrir une porte de WC. Il a constamment saboté le transfert de cette haute mission aux « incapables » des directions départementales de l'équipement.
De même, on verra souvent les rouages vers lesquels on fait glisser de nouveaux pouvoirs fuir ces responsabilités : ils craignent d'être soudain en première ligne, d'avoir à rendre compte, sans recours désormais, ni parapluie.
137
Risque de blocage social. Il viendra d'une frac- tion de l'encadrement intermédiaire; pour des hommes et des femmes formés dans d'autres moules, la dépossession du pouvoir sans partage, la fin du commandement qu'on ne justifie pas, la négociation (mot choc, en l'occurrence) avec les échelons inférieurs, le dialogue, le face-à-face, dessinent un autre monde. Attardons-nous sur les mots : on a toujours ordonné; il faut maintenant justifier, faire admettre, prendre l'avis des éche- lons inférieurs, négocier avec eux! Certes, en fin de compte, le chef tranche. Mais c'est pour cer- tains la Terre qui ne tourne plus dans le même sens!
J'ai vu beaucoup de cadres, souvent anciens, plonger avec courage et succès, parfois avec un enthousiasme merveilleux: leurs équipes les portent aux nues. D'autres ont calé, qu'il a fallu relever.
Cette voie royale de la décentralisation n'est pas de tout repos. Le mouvement doit être conduit par des chefs qui eux-mêmes donnent l'exemple, c'est-à-dire font confiance avec le sourire, et délèguent sans barguigner. Et qui persévèrent, des années durant, même s'il y a des ratés dans la machine.
La gestion décentralisée par objectifs contrac- tuels va rendre l'État plus performant. Quel pro- grès par rapport à l'exécution toute militaire de directives venues de sommets inaccessibles! Cet ordre-là était souvent facteur de perturbations,
138
car il se montrait insoucieux des moyens. L'inten- dance, c'est bien connu, était faite pour suivre, et la bonne réponse aux protestations de la base était celle de l'adjudant déjà cité, qui « ne veut pas le savoir ». Cet ordre engendrait aussi la démoti- vation, car on se contentait d'ordinaire de donner des instructions par circulaire à une « base » réduite ainsi à l'exégèse de la pensée d'en haut. On ne vérifiait pas sérieusement la réalisation des instructions; on évaluait encore moins la qualité du service, sinon par des contrôles sporadiques, plus attachés à la virgule qu'à l'esprit.
La gestion décentralisée va permettre aussi
d'alléger les échelons supérieurs. Dans l'adminis- tration et dans la plupart des services publics tra- ditionnels, le degré d'initiative et de liberté du
responsable local est si faible que tout « remonte ». Au contraire, quand rien ne va plus dans un atelier ou un bureau d'une entreprise décentralisée, quand un malaise s'exprime ou une revendication éclate, le responsable local a les
moyens d'y répondre. C'est ce que provoquera la décentralisation, dans l'État comme ailleurs.
De même, tout service ou toute entreprise doit, au sommet en tout cas, garder du recul. La décen- tralisation libère. Elle rend moins chimérique notre État léger.
Et puis, le contrat garantit mieux la continuité. Une grande administration, elle-même liée par contrat à son ministre et à ses « clients », organi- sée suivant une pyramide de relations contrac- tuelles cohérentes et souples, dont l'horizon est
139
souvent à plusieurs années, constituera une belle machine, attelée à son projet. Le dispositif admi- nistratif traditionnel, que sa logique hiérarchique met au garde-à-vous devant toute injonction, même s'il n'est pas préparé à l'appliquer, même si les moyens disponibles n'existent pas, est facile à perturber par les foucades d'un ministre ou d'un directeur. L'administration fonctionnant sur le mode des contrats sera mieux protégée.
L'État sera plus clair. La grande décentralisa- tion conduite à la Caisse des dépôts a désimbriqué le Léviathan, c'est-à-dire rendu plus compréhen- sible l'énorme boîte noire qu'était cette institution. J'ai mis un terme à l'idée, que beaucoup affec- tionnaient quand j'y suis arrivé, selon laquelle rien ne valait le rideau de fumée. Pour vivre heu- reuse, pensaient-ils, notre grande maison devait vivre cachée. J'ai estimé, au contraire, qu'un ensemble moins bétonné pouvait se présenter au- dehors, comme vis-à-vis de ses propres forces, sous un jour transparent.
En quelques années, nous avons décentralisé la Caisse et formé un groupe.
Cinquante filiales techniques, spécialisées dans la promotion immobilière ou la gestion de loge- ments sociaux, l'aménagement urbain ou les études économiques, l'informatique communale ou l'action sociale, le développement agricole en Afrique ou le tourisme social, étaient, de manière confuse, rattachées à la direction générale de la Caisse des dépôts, qui les contrôlait mal et comblait, une fois les déficits de gestion constatés,
140
les pertes quasi générales de ces sociétés. Dès 1983, j'ai créé une société holding, Caisse des dépôts-développement (C3D), chargée de contrô- ler, dans une logique d'actionnaire, et donc d'assainir, cet univers diffus. C3D a réussi à recentrer et à rééquilibrer financièrement nos filiales, sans leur ôter le goût du bien public.
La Caisse des dépôts, en prise directe et centra- lisée, n'y serait pas parvenue.
Autres décentralisations, au fil des années. La Caisse d'équipement des collectivités locales était un établissement public administratif, paralysé par les règles de la comptabilité publique et mal différencié de la Caisse des dépôts elle-même. Nous l'avons transmutée en Crédit local de France; celui-ci est maintenant une banque au capital ouvert, cotée en Bourse, et gérée avec le souci de défendre le cours de son titre, sans perdre de vue l'intérêt général. La Caisse nationale de prévoyance elle aussi était noyée dans la Caisse des dépôts; la voici, à son tour, société anonyme au capital diversifié. Son statut renouvelé lui a donné un tonus qui lui a permis d'augmenter de 50 % sa part de marché et de devenir la première compagnie d'assurance-vie du pays.
Nous ne cessons de nous « désimbriquer ». Ce qui était jadis un monolithe opaque devient un groupe d'entreprises mobiles, adaptées à leurs marchés et missions propres. La décentralisation a rendu « la vieille maison » plus ingambe en même temps que plus lisible.
141
La décentralisation, c'est surtout l'initiative et la responsabilité. « Je voulais entrer dans un monde où les responsabilités opérationnelles seraient plus importantes et la sanction des actions plus immédiate », expliquait récemment un jeune énarque passé au privé. L'État dont je propose la maquette lui aurait donné son comptant de satisfaction.
Qui dit responsabilité, qui dit initiative, dit capacité pour chacun de s'exprimer et de se valo- riser dans son travail. Frustrations, mélancolies, seront largement évacuées. Vient le temps de la créativité. J'ai vu le goût du travail, assorti d'une fierté non dissimulée, s'épanouir dans des unités où les cercles de qualité et la gestion par objectifs négociés avaient changé la vie professionnelle.
Scotchées au mur, les réalisations du mois, dépassant de quelques points les objectifs de l'unité pour la période en cours, m'étaient l'autre jour montrées par une équipe de notre back-office bancaire. Elle avait donc ses objectifs, échelonnés dans l'année, et elle était en train de battre ses prévisions. Sachant que le résultat était entre ses mains, elle me disait avec passion comment, ini- tiatives à l'appui, elle entendait creuser l'écart en fin d'exercice. Il faut avoir vu la fierté des agents vous vantant alors leur travail.
Dans l'établissement de la Caisse des dépôts à Bordeaux, d'où est partie notre démarche « qua- lité totale », un « cercle d'initiative et de progrès » (c'était notre vocabulaire pour désigner les cercles de qualité) se penche, en 1988, sur les relations
142
entre des cadres qui rédigent des lettres et le pool dactylographe qui les tape. Première découverte : cadres et dactylos ne se connaissent pas. Le pool suscite des rencontres (eh oui!); il écrit une « lettre de convivialité » aux cadres pour leur sug- gérer quelques astuces permettant une meilleure qualité de travail. Les intéressés m'ont exposé leur démarche et les résultats qui en étaient sortis, non sans un brin d'orgueil!
Autre exemple, la fin des « bons verts ». La Caisse des dépôts, comme toute administration, . avait un service des fournitures de bureau, rece- vant des commandes de toute la maison; elles venaient d'unités dépourvues à l'époque de budget propre. Ces unités, naturellement, forçaient la dose. Le service, qui ne rencontrait jamais ses clients, distribuait les « bons verts » donnant droit aux fournitures, suivant d'impénétrables priorités. Il engendrait de grandes irritations. Dans le vent de la décentralisation, et de son propre chef, ce service a décidé trois choses : être mis en concur- rence avec des fournisseurs extérieurs; plutôt que des fournitures, offrir un service conseil et des catalogues, avec en outre le souci de promouvoir de jeunes designers de mobiliers contemporains; constituer une « PME dans la Caisse », rémuné- rée par la vente de ses conseils et par des commis- sions sur les achats qu'il recommande. Cette « entreprise » s'est dotée d'un logo et d'un nom : ce n'est plus SET M, mais Ambiance-Buro. Le résultat est fameux : meilleurs équipements, prix plus étudiés, délais raccourcis et surtout satis-
143
faction générale, puisque chaque acquéreur a le choix entre les fournitures d'Ambiance-Buro et l'appel à des vendeurs externes. Avec certains fournisseurs, Ambiance-Buro a conclu des contrats sur plusieurs années, rabais à la clé. L'équipe se défonce : elle surveille sa « part de marché » et ses résultats.
A l'évidence, ces trois expériences sont éminem- ment transposables dans n'importe quelle admi- nistration.
Un peu partout dans la Caisse des dépôts et ses filiales, l'esprit de décentralisation a ouvert la voie aux initiatives. Des groupes, parfois éphémères, parfois malheureux dans leur démarche, mais toujours toniques et souvent facteurs de vrais pro- grès, se sont constitués, en particulier, parmi les personnels d'exécution. Un esprit plus critique est apparu; cela dérange, mais cela stimule aussi : la base n'accepte plus les pratiques ineptes ou les procédures lourdes sans protester ni, parfois, prendre elle-même le taureau par les cornes. Tout n'est pas parfait, et de loin! Il reste des îlots de mauvaise gestion et des zones inertes. Mais une sorte de libération a donné voix au chapitre à ceux qui veulent la prendre. L'initiative et la res- ponsabilité ont désormais droit de cité.
Il fallait évidemment un grand courant de décentralisation, un encouragement au contrat, une « culture-client », pour que les comportements bougent ainsi.
Il en va de même pour l'État. Les expériences, les plus simples soient-elles, ne s'acclimateront
144
que quand le souffle de la décentralisation et l'esprit de contrat auront saisi toute l'administra- tion.
« POUR QUOI NOUS COMBATTONS »
Belle image que le « poids des mots ». Ce poids est grand, lorsqu'il s'agit de communiquer ou de mobiliser. Dès lors qu'on ne les lance pas dans le vide, mais qu'ils recouvrent un contenu riche et portent un message, les mots qui motivent doivent être forts, insolites, au seuil de la provocation.
Ainsi du projet d'entreprise. J'ai raconté mes choix successifs : un « manifeste », un « Livre blanc », deux « projets ». En 1989, j'ai proposé au groupe de la Caisse des dépôts une « vision ». Nous avons hésité sur le mot. Largement utilisé aux États-Unis, il prête à sourire : « Nous voici dirigés par un visionnaire!... » Mais proclamer une « vision » m'avait semblé plus tonique que de revenir, sept ans après 1982, au « projet », plus éloquent que la « stratégie » ou les « orientations », plus neuf que le « plan ». Et qu'on fût intrigué ne me déplaisait pas.
Le but de la démarche est d'abord interne à l'entreprise ou au service; répondre à quelques questions existentielles, toujours présentes, même si, routine aidant, elles sont généralement refou- lées. Brève revue de ces questions :
a Que sommes-nous? quelle est l'identité de qui nous emploie? a
145
0 A quoi servons-nous ? pour quoi et pour quel public travaillons-nous ?
e Quelle vue volontariste - quelle « vision » - avons-nous de notre avenir ? quelles sont nos ambitions ? pour quels progrès devons-nous nous mobiliser ?
e Comment se situe mon activité dans cette ambition collective ?
En second lieu, le projet d'entreprise est l'outil majeur de la communication vers l'extérieur. Ce qui se conçoit bien s'exporte clairement.
Pareille exportation d'idées claires est une nécessité. L'image est devenue un élément de la gestion. Sans identité établie, une institution publique, aussi bien qu'une entreprise, se trouve aujourd'hui, en cas de coup dur, déstabilisée. Par ricochet, une image ébréchée nuira à la motiva- tion des personnels et à l'efficacité même de l'entreprise, plongeant celle-ci dans un cercle vicieux.
Innombrables seraient les exemples récents. Je me borne à évoquer deux situations de ce type que j'ai connues à la Caisse des dépôts. La hausse désordonnée des loyers de nos immeubles de rap- port, décidée abruptement en 1987 par notre société de gestion immobilière « au titre de la loi Méhaignerie », comme le mentionnaient astu- cieusement nos avis aux locataires, a déclenché le tumulte, suivi d'offensives politiques. La décision n'était pas mienne - ce sont les risques de la décentralisation! - mais le directeur général que j'étais a dû assumer et s'est vu affaibli durant
146
plusieurs mois. Notre participation en 1988 à une offensive contre le capital de la Société générale, à laquelle, cette fois, j'avais moi-même décidé d'associer la Caisse des dépôts, a, plus sérieuse- ment encore, brouillé notre image une année durant.
On communique bien si on est en mesure de diffuser une vue claire de son entreprise. Parte- naires, clients, médias, tout l'environnement doivent percevoir sans équivoque votre identité, vos ambitions. Ils doivent, s'il s'agit d'une institu- tion publique, en apprécier l'utilité pour la collec- tivité. A la Caisse des dépôts, mon travail de rajeunissement de la maison a été facilité quand nous avons, à la fin de 1982, rendu public notre « Projet ». La presse a parlé avec sympathie du « lifting de la vieille dame » ; elle a semblé adhérer à notre démarche. Elle a surtout commencé à nous connaître, à nous comprendre et à nous considérer un peu. Elle devait ensuite suivre avec attention les étapes de la longue réforme que nous avons conduite.
Ministères, organismes publics, services admi- nistratifs ont entrepris ces dernières années de « communiquer ». Parfois par pur effet de mode. Leurs messages ne sont pas toujours convain- cants : logos affriolants et formules ronflantes ne comblent pas le vide conceptuel ou l'absence de politique claire qui marque certaines de ces cam- pagnes fort coûteuses. C'est le projet qui leur manque.
L'image ne se construit pas dans le vide. Mais
147
quand elle est adossée à une vision convaincante, à des résultats probants, elle s'établit sans peine. En retour, l'image extérieure bénéficie au tonus interne de la maison. A condition que les deux messages, vers l'extérieur et internes, soient en harmonie. Le projet est par lui-même agent de motivation; il l'est une seconde fois quand il embellit l'image de l'entreprise.
Motivation interne, image publique, je vois au projet d'entreprise un troisième usage. Une admi- nistration dotée d'une « vision » qu'elle se sera vraiment appropriée sera moins malmenée d'en haut. Adossé à mon projet, qui aura donné à mon service sa culture d'entreprise, je résisterai mieux, non aux inflexions politiques, auxquelles je devrai loyalement me plier, mais aux idées superficielles, perturbatrices qui tombent souvent d'un cabinet ministériel. Gilbert Trigano a raison de dire aux « GO » du Club Méditerranée qu'ils sont, par leur adhésion à l'entreprise, la meilleure « pilule empoisonnée », c'est-à-dire le plus ferme rempart contre des prédateurs extérieurs. De même, le patron d'un service public est plus fort pour conduire sa politique si l'ensemble de ses collabo- rateurs se reconnaît, et serre les rangs, autour du projet d'entreprise.
Comment se fabrique un projet? De manière collective. Il est l'oeuvre de beaucoup, et se négo- cie avec quelques-uns. L'appel aux troupes est un témoignage inestimable de considération. Tous, y compris les agents d'exécution, de même bien sûr
148
que les syndicats, auront voix au chapitre. Les idées qui fuseront frapperont souvent par leur richesse. Le « projet pour la Caisse des dépôts de 1982, qui a, on s'en souvient, mobilisé quatre mois durant 2 500 personnes, aura été le fruit de ce grand remue-méninges. Je n'en avais au départ en tête ni les grands axes, ni les mots clés : ils sont sortis de la consultation et des groupes de travail. La fabrication collective du projet est enfin un exorcisme : il y a dans chaque corps social des revendications inexprimées; certaines sont des fantasmes; en amenant à les expliciter, en les livrant au débat, on dégonflera bien des baudruches empoisonnées.
Faut-il négocier un projet avec les échelons supérieurs? Je plaide pour un peu d'audace.
Reportez cette négociation à la fin de l'élaboration du projet. Si votre patron n'est alors pas d'accord, tirez-en les conséquences; les ambiguïtés auront été levées. Si j'étais aujourd'hui directeur de la construction, j'aurais sur la politique du logement quelques vues personnelles; je les mettrais en forme après un dialogue avec tous mes collabora- teurs ; et je présenterais ensuite à mon ministre ce document, assorti de projets précis et de proposi- tions d'engagements sur des objectifs. Et je tâche- rais de le convaincre d'entériner, fût-ce en l'inflé- chissant, notre projet. Si j'échouais, je partirais.
Un autre cas de figure est préférable. Un ministre à la hauteur m'aura fixé des orienta- tions, peut-être des objectifs; c'est la « lettre de mission », que des décisions gouvernementales de
149
1990 rendent obligatoire lors de la nomination d'un directeur. Très bien, à condition - c'est du moins celle que je poserais - que j'aie pu en connaître l'inspiration et en débattre les termes avant ma nomination. La lettre de mission esquisse alors le projet d'entreprise pour la direc- tion. Elle ne dispense pas de l'établir.
Malheureusement, cette belle idée de la lettre de mission est dès l'automne 1991 tombée à la trappe... Quand on gouverne sur le mode fréné- tique, on oublie bien des choses essentielles!
Vision ou projet, le document doit sonner clair, et susciter l'enthousiasme, à tout le moins l'adhé- sion. Comme une proclamation, avant la bataille, sur le front des troupes, il doit porter la marque du chef. Si celui-ci n'a ni le talent ni le courage d'orchestrer ce texte essentiel, dont dépend la marche en avant de ses services, qu'il soit au plus tôt relevé de ses fonctions!
J'attends de la vision, j'attends du projet, des articles de foi. Les chefs d'entreprise ont bien compris cela, qui proposent souvent, sans peur du ridicule, une éthique d'entreprise et des « commandements », sur un mode biblique. Nous touchons là un ressort de l'action humaine : oui, l'homme ou la femme au travail aime que ce tra- vail ait un sens; non il ne rit pas quand sa tâche est, à bon escient, sublimée. Il est naturel qu'on nourrisse vis-à-vis de sa vie professionnelle, espé- rance et ambition. Si la vision est claire, elle doit inspirer la fierté. En ce sens, quelques mots très forts, une devise toujours, une charte parfois sont des recettes simples.
150
La force d'un projet, je l'ai mesurée le jour où, de passage à Clermont-Ferrand, dépanné par le directeur de l'office d'HLM du Puy-de-Dôme, j'ouvris la boîte à gants de sa voiture et découvris un exemplaire malmené de notre « Livre blanc HLM ». « J'en relis une page, m'avoua-t-il, avant chaque réunion avec mes administrateurs ou avec mes locataires. »
La Caisse des dépôts a rajeuni en 1989 son « Projet de 1982. Flirtant avec l'idée de charte, nous nous sommes donné un corps de « valeurs » : la prise en compte du long terme, la qualité du service rendu, la considération témoignée aux clients, partenaires et collaborateurs. Remplaçant l'incantation au « service public », ces trois valeurs sont connues et déclinées dans l'ensemble du groupe. Les propos des dirigeants et les docu- ments internes d'orientation s'y réfèrent, constamment. Ainsi se forgent une culture de groupe, une cohésion, une dynamique.
Je vois un projet d'entreprise, pour l'adminis- tration comme pour d'autres entités, ainsi arti- culé : une analyse sans complaisance du contexte présent et de l'avenir; une définition, en forme de credo, des vocations, missions et métiers de l'unité concernée; leur déclinaison en objectifs et en règles de conduite - c'est ici que l'éthique a sa place; des indications convaincantes, découlant de ce qui précède, sur l'organisation - comment allons-nous déployer nos forces pour mettre en oeuvre ces objectifs - et sur la gestion des hommes
151
- comment chacun aura sa part dans cette mise en oeuvre. Ce document doit parler à chaque col- laborateur : pas de jargon, pas d'hésitations ampoulées, pas de non-dits.
Un projet devrait ensuite se décliner. D'abord suivant les différentes parties de l'entreprise ou du service. Il s'est monté à la Caisse des dépôts une vingtaine de projets de branches, c'est-à-dire de directions ou grandes filiales. Les projets d'entreprise du Crédit local de France et de la CNP, notre banque des collectivités locales et notre compagnie d'assurances, ou bien ceux de nos grandes filiales comme la SCIC et la SCET, le promoteur et l'aménageur du groupe, ont fait l'objet de longues maturations et de présentations spectaculaires : réunion de tout le personnel, venu parfois de très loin, communication des thèmes et des axes sur un mode médiatique, voire ludique, tonique toujours; remise de vidéo-cassettes et de pin's, etc. J'ai vu repartir des hommes et des femmes convaincus, « regonflés » m'ont dit cer- tains.
En outre, des petites unités - directions régio- nales, service du marché des actions, filiales financières, Ambiance-Buro, on s'en souvient, tout récemment notre service immobilier, se sont, de leur propre initiative, dotées d'un projet. Les effets mobilisateurs de ces actions sont immenses. Ce credo rapproché permet à chacun de se mieux situer dans son unité et dans le grand ensemble. Rien ne vaut de comprendre à quoi l'on sert au sein d'une vaste maison!
152
La déclinaison se fait aussi dans le temps. Un projet d'entreprise peut, dans le monde mouvant que nous connaissons, vivre de cinq à dix ans. Il faut ensuite le renouveler; IBM le sait bien, dont la « charte » aux accents religieux résiste mal aux intempéries actuelles, et ne propose plus un cap clair à ses personnels.
Dans l'intervalle, les objectifs doivent être réé- valués : nous avons, à la Caisse des dépôts, opté pour un « plan triennal », dont l'inflexion annuelle et une remise à plat tous les trois ans ont constitué des exercices salubres. Ce plan, lui- même redécliné par grandes branches, est aussi un instrument de communication interne : chaque chef d'unité a été invité à l'expliquer, chaque année, à son équipe, belle occasion de parler à nouveau des objectifs de la maison tout entière, de ceux de la branche, de ceux de l'unité elle-même, et d'ouvrir là-dessus le débat.
« Un projet peut soulever des montagnes », disais-je début 1990 dans un discours interne. Je continuais ainsi : « L'avenir ne sera pas aux hommes frileux, ni aux entreprises que n'habite pas l'esprit de conquête. Cela va de soi pour le privé, ce sera la loi désormais du secteur public. » Le but, dans l'État comme dans les entreprises, est bien de soulever des montagnes.
Avec la vision, ou bien le projet, voici le socle posé pour notre reconstruction d'un État perfor- mant. Mais à côté des mille et un projets propres à chaque entreprise, à chaque service, à chaque
153
institution, il faut à l'État un grand projet pour lui-même. J'appelle dans ma conclusion à un « projet » pour le service public tout entier.
SERVICE DU PUBLIC, SERVICE DU CLIENT
Le citoyen, client de l'État. Il faut acclimater dans l'État ce mot provocateur de client. Pas de projet, dans l'administration comme ailleurs, qui ne vise au service rendu.
L'État n'est pas sa propre fin. Moins encore les unités qui en sont le bras : ils sont d'abord au ser- vice de la collectivité nationale. Service public, de même que l'ensemble des services publics natio- naux et locaux, ils sont au service du public. Ils servent des citoyens.
« Mes patrons sont les parents », me disait une directrice d'école lors de la visite d'une ville nou- velle près de Londres. Dans une société de ser- vices et de consommation, il faut réaffirmer les droits des citoyens sur leur administration. Ne parlons plus d'assujetti ni d'administré, ni même d'usagers; parlons du citoyen-client, client de l'État et titulaire de droits sur lui.
Cicéron, Rousseau, mille autres l'ont dit : dans une république, le citoyen est roi. Des méca- nismes rappelant constamment aux fonctionnaires pour qui ils travaillent doivent organiser cette relation.
Client ne signifie pas clientèle. L'État doit pré- server l'égalité devant le service public, et ne pas
154
se prosterner devant les puissants, les groupes de pression ou les forts en gueule. Mais la prise en compte du client amènera les bureaux à descendre de leur piédestal, à quitter l'anonymat trop commode, à battre en brèche le mépris.
Il faut d'abord repérer le « client » : consomma- teur, professionnel, contribuable, épargnant, étu- diant, habitant du quartier, demandeur de papiers d'identité, usager ou abonné privé de choix parce que le service payant est rendu en monopole. Même dans les matières régaliennes, qui visent d'abord au bon service de l'État, ainsi le recouvrement de l'impôt, il existe un client, en l'occurrence le contribuable, personne physique ou personne morale. Il mérite égards et considération.
Il faut ensuite le connaître et l'écouter. Les enquêtes de satisfaction se multiplient. Mais elles partent trop souvent de l'idée que s'en fait l'admi- nistration. Celle-ci vit dans un monde ésotérique (le client est censé comprendre son jargon), per- fectionniste et hors du temps (le client devra se plier aux molles cadences administratives). L'écoute est nécessaire, ne serait-ce que pour que l'écho des exaspérations nées de ces pratiques désinvoltes parvienne à l'oreille de l'État!
Il faut encore que l'administration commu- nique. Elle ne doit pas seulement répondre au courrier, elle doit aller au-devant du client, lui expliquer ce que fait le service, soigner les délais, la clarté des documents, l'accueil du public, affi- cher dans les lieux ouverts à ce public les objectifs
155
du service pour l'année en cours. Les panneaux de chantier expliquant la nature et le calendrier des ouvrages vont en ce sens. Les « baromètres de satisfaction » mis au point par la branche de la Caisse des dépôts qui gère des caisses de retraites ont été riches d'enseignements; plusieurs ma- nières de travailler et de correspondre avec les clients ont été transformées.
Pour tout ceci, on doit trouver les inter- locuteurs. Le citoyen-client mérite une place dans l'appareil d'État. De la même façon que les conseils de parents d'élèves ont du poids sur la vie des lycées ou collèges - il arrive que l'Éducation nationale donne l'exemple! -, il faut généraliser des panels de clients, des « services clients » dans chaque ministère, dans chaque préfecture, dans chaque direction départementale de l'équipement ou de l'action sociale, etc. Ils seraient articulés au niveau national avec un « Conseil des citoyens », lui-même doté d'un minimum de moyens per- manents et présentant chaque année un rapport public.
Ces bonnes dispositions ne suffiront pas, on s'en doute, à imprimer à l'État de vrais comporte- ments de « service du client ». Soit un chef de ser- vice saisi d'une plainte : son agent, au contact du public, s'est mal comporté. Par insouciance, ou parce qu'il pourfend les rouspéteurs, le chef ne donne aucune suite. C'est une insulte au public de ne pas répondre au courrier ; toute lettre adres- sée à un service public, à une administration
156
appelle une réponse. Le citoyen qui écrit à l'État ou à un service public a un droit quasi constitu- tionnel à savoir que sa requête, sa critique ou son avis a été reçu. Seconde hypothèse, le chef de ser- vice charge celle ou celui dont le « client » se sera plaint de répondre; le courrier en retour, que le supérieur va signer au plus grand plaisir de l'agent, serait-il fautif, sera un plaidoyer pro domo à moins même que le plaignant ne se voie renvoyé brutalement dans ses buts.
Admettons que le chef de service étudie le cas, et s'il y a lieu, semonce son collaborateur. Mais ensuite, que se passe-t-il ? Qui pensera qu'une admonestation suffise à rénover le service rendu, si le système n'est pas tourné vers le client ? Cela suppose un projet qui identifie celui qu'on sert et le place au premier rang, et qui soit donc axé sur la qualité, des objectifs contractualisés d'améliora- tion du service au client, assortis d'indicateurs dont le suivi est organisé, une évaluation des résultats ayant un impact sur la rémunération des agents concernés et sur l'avancement du respon- sable. Cela suppose une culture d'entreprise ten- due vers l' « excellence ».
L'administration devrait aller plus loin, et pas- ser contrat avec ses « clients ». Elle n'acceptera bien sûr pas toutes leurs critiques et volontés. Elle aura le dernier mot sur les finalités. Mais elle négociera des engagements avec le Conseil des citoyens, son interlocuteur : pour telle période à venir, telle réforme sera poussée, telles améliora- tions seront mises en oeuvre - tels délais réduits
157
par exemple, tels dispositifs d'accueil expéri- mentés ou généralisés, tels imprimés rénovés -, telles études seront effectuées, dont les résultats seront communiqués au partenaire-client. Des engagements peu nombreux, clairs, réalistes.
Ils seront assortis d'objectifs chiffrés, d'indica- teurs et d'une méthode de mesure acceptés des deux parties. L'ensemble sera mis en forme simple et souple (surtout pas de contrat type!), signé par le chef de service concerné et le repré- sentant des clients. Le contrat sera rendu public.
Pendant sa mise en oeuvre, un point périodique ou deux permettront, s'il y a lieu, de réévaluer les objectifs et d'éclairer les travaux en cours, prépa- rant le contrat suivant. En fin de période, on ira aux résultats. Un compte rendu public sera pré- senté, sur un mode contradictoire, au Conseil des citoyens. Les médias pourront assister à l'audience - on dirait en anglais au « hearing ».
L'administration trouvera dans cette démarche une part de ses orientations; elle s'efforcera de privilégier, dans la négociation, ce qui correspond à son propre projet. Projet et contrat seront ainsi en phase, le premier étant de ce fait, s'il le fallait, ramené sur terre, et le second se trouvant inspiré par les vues à long terme qui doivent guider l'action publique et constituer, pour l'État, l'hori- zon.
Ce contrat, comme ceux que tout service aura conclus avec l'échelon supérieur et dont on a parlé plus haut, offrira à l'administration un rempart contre les humeurs politiques. Le chef de service
158
ou le directeur sera serviteur de deux maîtres : son propre patron et les citoyens-clients à l'égard desquels il se sera engagé. Le ministre qui voudra lui demander de virer de bord, ou charger sa barque au point de compromettre des opérations en cours, devra défendre devant le panel, ou faire défendre par le chef de service, la remise en cause ou la réorientation des engagements. Si la poli- tique nouvelle répond aux attentes du public, on trouvera facilement les bases d'un avenant au contrat. S'il n'en va pas ainsi, de deux choses l'une : le ministre passe outre - car l'État a ses propres raisons, supérieures, notamment s'il y a conflit avec des intérêts particuliers; ou il modifie ses projets.
Il ne s'agit pas seulement de changer l'image de l'administration; de susciter enfin un État sou- riant et attentif, un accueil prévenant et courtois; de mettre en ligne des services, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui cessent de se retran- cher derrière le règlement, et cherchant au contraire, à leur niveau, de leur propre initiative comment adapter leur travail, corriger le tir, mieux coller aux attentes du public. Il ne s'agit pas de rendre l'État gentil.
Il s'agit du service public, auquel les syndicats de fonctionnaires sont si attachés, et à juste titre. Le service public, rénové par la culture-client, prendra un tour moderne. Moins rigide, moins anonyme, moins octroyé, il fera de l'État un organe à nouveau compatible avec le monde tel qu'il est, avec notre société d'efficacité et de célé- rité, de séduction et de service personnalisé.
159
L'État, notre « État-plus », ne se départira pas pour autant de ses prérogatives ni de son autorité; à lui, en fin de compte, la décision, dont le pre- mier critère n'est pas de plaire mais l'égalité de tous et l'intérêt général. Mais il lui faut être à nouveau en phase avec son temps, faute de quoi il décroche et perd son crédit. La découverte du citoyen-client va lui sauver la mise.
Contrats et clients, ces notions modernes vont soumettre l'État à de nouvelles régulations. Un réseau de contrôles internes va accompagner la définition des objectifs et la démarche contrac- tuelle ; ils se recouperont avec le contrôle de ges- tion qu'appellent évidemment la décentralisation et la comptabilité analytique. Plus décapante et féconde encore sera la contrainte du compte rendu public, établi à l'intention des partenaires ou « clients » avec lesquels, par contrat, l'administra- tion se sera engagée. Elle s'obligera ainsi à sortir de ses tanières secrètes, auxquelles le citoyen n'avait nul accès, pour se livrer au regard de tous. Bien maîtrisé, ce corpus de contrôles axés sur les résultats plutôt que sur les moyens, sur la média- tion et la conciliation plus que sur la sanction, sera stimulant.
Ces exigences nouvelles accusent a contrario l'obsolescence de certains contrôles auxquels l'administration et les services publics sont sou- mis, et qui constituent un des volets les plus archaïques de l'État. Je pense à ces investigations à courte vue, à cette chasse aux fautes vénielles, à
160
l'épluchage des gestions pour repérer l'entorse à la lettre des textes. Leurs auteurs oublient souvent de voir tout simplement si la mission du service a été remplie; si ses résultats sont bons; si son coût est acceptable. Ils passent à côté de l'essentiel. Combien de rapports de la Cour des comptes ressemblent plus à des bêtisiers anec- dotiques qu'à des audits intelligents! Il est vrai que le public adore cela : des petites erreurs, dûment orchestrées, présentées par MM. les cen- seurs comme illustrant la nature profonde d'un service ou d'une entreprise publique, sont assu- rées d'un succès médiatique! La galerie applau- dit quand on tape sur les doigts du bureaucrate. Mais est-ce une bonne manière de servir la République que de se livrer à ces petits jeux? Ne contribue-t-on pas au discrédit de l'État en proclamant seulement, comme des trophées de chasse, ses faiblesses et ses défaillances sans jamais le louer pour ses succès, sans même réta- blir la balance entre l'exception et la pratique courante? Il y a là du crime dans l'air.
Certes, quand il s'agit de l'État et du secteur public, les négligences graves et les mal- honnêtetés doivent être débusquées sans pitié. Il n'est pas question de se borner à des contrôles généralistes et éthérés. Il faut dénoncer, organi- ser le redressement des fautes et leur sanction effective, ce qui ne passe pas nécessairement par leur livraison en pâture à l'opinion.
Mais un État moins soucieux de la virgule, davantage attaché à la performance et à la qua-
161
lité dans la réalisation de missions et d'objectifs définis sans équivoque, un État plus intelligent, appelle aussi, appelle surtout, une évaluation de sa gestion qui soit en ligne avec sa démarche: les objectifs étaient-ils pertinents, ont-ils été atteints, et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Voilà ce que disent les bons audits auxquels les entreprises ont recours. Les contrôleurs dans l'État n'en sont pas toujours là. Leur compor- tement le plus répandu n'est pas seulement per- nicieux, il n'est pas moderne. Si l'on veut un État tonique, il est indispensable de reconnaître le droit à l'erreur; seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Il faut en revanche juger les résultats. Gestion moderne, contrôles mo- dernes.
A travers quelques analyses lumineuses, excep- tions qui confirment la règle, des corps de contrôle ou d'inspection font parfois évoluer en ce sens l'univers administratif. Mais le progrès vien- dra moins de ce côté que des contraintes nouvelles de l'État de demain : la pratique du contrat, épreuve de vérité, et le regard des citoyens-clients, empirique, réaliste et sans pitié. Ces nouvelles régulations, si elles ne sont pas suffisantes, sont nécessaires. Elles contribueront à rendre l'État performant.
162
CARRIÈRES : QUELS PARCOURS
POUR LES FONCTIONNAIRES ? a
Vaste sujet. Je ne vais pas l'épuiser. Je partirai de ce que nous avons fait, ces dernières années, à la Caisse des dépôts, dont six mille agents ont, à la surprise fréquente de l'observateur extérieur, le statut de fonctionnaires d'administration centrale. Ces collaborateurs cohabitent avec des personnels de droit privé, recrutés pour remplir des tâches de haute qualification, en particulier sur les métiers de la finance. Plus de la moitié de nos cadres sont
aujourd'hui sous statut privé, ceci ne concernant
que la Caisse elle-même, et non ses filiales, toutes de droit privé.
Les fonctionnaires tiennent à leur statut. Il est
synonyme de sécurité : on est fonctionnaire à vie. Par ailleurs l'attachement aux valeurs, garantes de l'indépendance et de la neutralité, contribue à l'égalité des citoyens devant le service public; il n'y a pas en France de clientélisme dans l'État.
J'ai assisté, en dix ans, à un absolutisme syndical sur ce registre. J'avais promis de défendre le sta- tut, et il n'a pas été entamé. Mais les assouplisse- ments introduits, tels que l'avancement modulé que nous avons progressivement substitué à l'ancienneté, ou le lien entre les primes - dont j'ai refusé l'automaticité - et la notation, ont suscité
guérillas sur guérillas. L'inquiétude circule quand nous décentralisons le groupe, et rapprochons le fonctionnement de certains services de celui d'une
entreprise privée. Je parle de désimbrication ? Les
163
syndicats entendent privatisation, redoutent la perte des statuts de fonctionnaire. Ces angoisses sont dans l'ordre des choses; elles doivent être prises en considération.
Mais tout autant, une contestation sourde du statut monte depuis cinq ans des rangs mêmes de ceux qui en bénéficient. Beaucoup vivent mal sa rigidité : il bloque les évolutions de carrière, ne
, permet pas d'ajuster la rémunération aux compé- ' > tences parfois très pointues acquises à la suite d'un effort intense de formation, conduit à traiter de la même manière ceux qui se dépassent et ceux qui mesurent leurs efforts. Il frustre les plus ardents et les plus compétents, les prive de la car- rière qu'ils mériteraient au titre de leur qualifica- tion, de leur tempérament, de leur légitime ambi- tion. Jadis vécu comme un privilège, le statut des fonctionnaires commence à être ressenti comme un empêchement.
Certains syndicats ont compris que la désaffec- tion dont ils souffrent n'est pas sans lien avec les positions malthusiennes sur lesquelles ils avaient longtemps campé. Ceux-là ont abordé avec cou- rage et lucidité des thèmes nouveaux, moins statu- taires et plus dynamiques, tels précisément que le déroulement des carrières.
Depuis 1986, la Caisse des dépôts, avec l'aide d'un consultant, établit, tous les deux ans, un « baromètre de management social » extrêmement approfondi. Elle applique les principes de l'éva-
. luation quantifiée, dont j'ai souligné l'utilité, à ce sujet complexe. Le propos est « une mesure régu-
164
lière des dynamiques internes » par sondage d'un employé sur deux; le taux de retour, satisfaisant, est de 50 %.
1988 a fait apparaître que s'investir davantage dans son travail est la principale aspiration des agents. Le désir d'initiative, de fonctions adaptées aux qualifications, suivaient les perspectives de carrière; le niveau de la rémunération et la sécurité de l'emploi n'apparaissaient pas, en revanche, comme des questions prioritaires.
En 1990, les conclusions étaient : « Nous vou- lons consacrer plus d'énergie à de nouveaux déve- loppements dans notre travail » ; mais « nous nous sentons bloqués par la lourdeur et la bureaucratie de l'entreprise, ainsi que par les règles d'avance- ment et de promotion »; ceci s'accompagne du désir fréquent de changer de travail et de métier et «travailler plus souvent en équipe ». L'enquê- teur ajoute : « La majorité veut pouvoir progres- ser, et avancer. »
Ainsi se manifeste, dans la fraction de la fonc- tion publique que je connais le mieux, un appétit, aussi naturel que répandu dans nos sociétés, de responsabilité et de perspectives. Cela rejoint mon thème général : la motivation est le ressort radical de la vie professionnelle. Mais comment être motivé si des règles et des grilles viennent boucher l'horizon ?
Il est possible d'assouplir vivement la pratique du statut général des fonctionnaires, et de la rendre compatible avec ces aspirations.
165
La notation était de longue date une procédure anonyme et génératrice de grandes frustrations. Elle est aujourd'hui un objet, parmi d'autres, de l'entretien d'appréciation que tous les cadres de la Caisse des dépôts doivent proposer, au moins une fois l'an, à leurs collaborateurs. Cet exercice, rude
pour certains cadres - et sur la qualité duquel ils sont eux-mêmes évalués - introduit le face à face, le dialogue, et oblige à un examen, généralement sincère et parfois radical. Bien évidemment, il est l'occasion d'évoquer les perspectives d'avance- ment. On esquisse ici des plans de carrière.
Autres exemples. La systématisation de critères différents de l'ancienneté pour les promotions d'un échelon à l'autre - ce que l'on nomme l'avancement modulé; le recours fréquent à des agents de grade ou de catégorie inférieure à ce qui était requis auparavant, pour pourvoir certaines fonctions : ainsi la nomination d'attachés, et non
plus seulement d'administrateurs civils, comme directeurs régionaux de la Caisse des dépôts; en pareil cas, nous accompagnons l'opération par des
primes qui complètent le traitement. Exemple encore : encouragement donné aux fonctionnaires les moins frileux à quitter le statut pour devenir salarié de droit privé; plusieurs dizaines de femmes et d'hommes ont ainsi plongé sans filet, moyennant l'accès au salaire du marché pour leur métier; avec des perspectives de carrière plus ouvertes. Ou encore l'aide à ceux qui veulent évo- luer au-dehors, ce qu'on nomme « placement externe », ou créer une entreprise.
166
Notre principal acquis concerne les carrières. Un dispositif moderne, apprécié des personnels, a été mis en place à l'initiative du secrétaire général de la Caisse, Jean-Pierre Brunel. Dans le jargon maison : démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi, la « GPE ». Son but est d'enrichir l'administration traditionnelle des ressources humaines, par l'anticipation. Nous voudrions anticiper tous les besoins en termes d'emploi d'une part, d'évolution des qualifications d'autre part. Nous nous efforçons ensuite, sans trop nous embarrasser de considérations statutaires, d'orien- ter les personnels vers les formations et les emplois de demain. Une logique de métiers vient ainsi compléter la logique du statut.
Il nous a fallu deux ans - 1988 et 1989 - pour identifier nos métiers et leur contenu. Des profes- sionnels de ces sujets et des dizaines d'opération- nels du groupe ont élaboré une nomenclature des emplois actuels. Après validation, il en a été fait une représentation graphique : la « carte des métiers ». Une ample communication interne lui a été consacrée. Elle constitue déjà, pour nos éche- lons de gestion des ressources humaines, un outil de pilotage.
Mais ce travail ne pouvait être statique. Nous avons projeté dans le moyen terme, à deux ans seulement pour le moment, la carte actuelle des métiers, suivant des critères liés à la stratégie du groupe (d'où l'utilité du Projet et du Plan), à la démographie des personnels, aux évolutions pré- visibles de l'environnement et des technologies.
167
Sur cette anticipation, nous avons fondé notre ges- tion prévisionnelle de l'emploi.
Comment se déroule-t-elle ? Par l'application d'un contrat ambitieux conclu, à la fin de 1990, avec les syndicats : l'accord de groupe sur l'emploi, la formation et la mobilité. Il fixe pour trois ans les priorités en matière d'emploi, de manière à donner à chacun, et spécialement à chaque fonctionnaire, les meilleures chances d'être demain attelé à des activités profes- sionnelles stimulantes et non précaires; de manière aussi à éviter à la Caisse des dépôts de devoir recruter au-dehors en laissant hors des tâches vives des cohortes de fonctionnaires aux compétences obsolètes, ce qui serait à la fois rui- neux pour nos résultats et dramatique en termes sociaux.
Un observatoire paritaire de l'emploi identifie les emplois sensibles, c'est-à-dire ceux appelés à disparaître; ils exigent des reconversions, que nous parvenons à maîtriser à temps. Ceux au contraire promis à un fort développement, et pour lesquels des formations sont proposées. L'en- semble de ces opérations est ordonné en plans d'actions de groupe, dont la gestion est décentrali- sée dans les principales directions et filiales.
Un fort accent est porté aussi sur la mobilité. Des « règles communautaires de mobilités » s'imposent à toutes les composantes de notre groupe, avec un guide de la mobilité, et une bourse télématique diffusant en permanence des postes vacants. La mobilité externe est encouragée
168 .
dans certains cas, une petite équipe épaulant les candidats et des concours leur étant accordés pour la création d'entreprises.
La gestion des carrières est suivie de près pour les deux cents cadres dirigeants. Au sein de la « direction du management et de l'innovation sociale », formation légère placée auprès du secré- taire général du groupe, un professionnel de haut niveau rencontre régulièrement ces cadres, et se trouve constamment consulté par les directeurs ou les présidents de filiales; par moi-même aussi. Beaucoup de cadres dirigeants ont eu en 1992 un plan de carrière. Nous étendrons le système. Dans cinq ans peut-être, de tels parcours professionnels seront envisageables pour chacun.
Le reste ne sera pas décrit ici : entretien profes- sionnel ; organisation de la gestion des ressources au plus près des hommes suivant un principe de subsidiarité (ne remonte plus que ce qui ne peut être fait en bas), et également par appel à des professionnels qualifiés; analyse des innovations sociales au-dehors; formation intensive au mana- gement et stages collectifs à l'étranger; réforme radicale des procédures de mutation; intéresse- ment très décentralisé; gestion active, mais à vrai dire combien difficile!, d'un large éventail d'emplois recouvrant divers statuts.
Tel est le schéma, mis sur pied en quelques années, de pair avec la décentralisation. Il est loin de fonctionner sans faiblesses ni sans loupés. Mais la démarche est l'objet, entre la direction et les syndicats, d'une dialectique permanente et
169
d'une critique active, à la mesure de l'intérêt
qu'elle suscite.
L'ensemble serait donc compatible avec le sta- tut général des fonctionnaires et applicable dans tous les secteurs de l'État ? La réponse est oui, au moins pour la fonction publique civile, y compris l'Éducation nationale. L'innovation principale dans notre dispositif consiste à dissocier le système des grades et la réalité de l'emploi occupé, lequel est assorti d'une rémunération adaptée. Elle réside aussi dans l'introduction progressive d'une logique de métiers ; on ne dit plus « je suis chef de groupe de deuxième catégorie », mais « je suis
négociateur sur la table des marchés de taux » ; on possède un métier, on est payé en conséquence, et cela commence à importer davantage que le grade statutaire.
L'extension de ces avancées à une administra- tion ordinaire posera trois problèmes. Il faut pour conduire un tel mouvement des professionnels compétents et mordus par les défis. Rien n'est plus urgent que de rénover à la tête les vieilles directions du personnel de certains ministères et de leur permettre de recruter des collaborateurs capables de changer la gestion des femmes et des hommes.
La gestion des ressources humaines doit être, elle aussi, décentralisée; les énormes machines monolithiques, impersonnelles et inhumaines ne collent pas avec les évolutions nécessaires; on devra les casser en les régionalisant.
170
Troisième problème : la Caisse des dépôts est riche, dira-t-on, elle peut offrir des primes et mettre en place un système d'intéressement. Sur ce plan, que le lecteur veuille bien tourner quel- ques pages : parlant plus loin des « capacités d'autofinancement », je montrerai que, sans cré- dits supplémentaires, de telles dépenses peuvent être financées, à une seule condition : que les moeurs budgétaires évoluent un peu.
Tout cela, qui est véritablement capital pour l'avenir de l'Etat, est d'abord affaire de volonté. Hélas! combien de ministres ont le temps de s'y intéresser ? Et combien d'autres sont, en fait de politique sociale, condamnés à ferrailler avec des syndicats plus soucieux de conserver des « acquis »
qui contribuent à précipiter la mort du système, que de le faire bouger!
Garderons-nous longtemps ce statut de la fonc- tion publique, propre à notre pays ? Il fait de l'État français un État remarquable par l'indé- pendance qui couvre ses agents, par la neutralité qu'il peut afficher à l'égard des forces d'argent, par la rigueur et le sens du service qui l'inspirent. Mais il rigidifie ce même État, il contribue à le rendre moins mobile et anachronique. Il est un péril pour l'État.
Le système est partout condamné. Il faut, sur d'autres bases, conserver ses vertus en passant à un schéma nouveau. Notre République devrait anticiper en ce sens des changements qae l'Europe lui imposera. La démarche pourrait tenir en deux points :
171
Conservons le statut pour les fonctionnaires en place, titulaires de droits, en l'assouplissant à l'extrême, suivant les pistes que j'ai moi-même empruntées, et d'autres qui sont à imaginer. Mais il sera bien entendu que le statut des fonction- naires, s'il assure la sécurité de l'emploi, ne peut plus servir d'alibi à la routine et à l'indolence. Les incapables, ceux qui refusent l'effort ou manquent les objectifs fixés, appellent la sanction ou la révocation. Le statut doit être vécu comme une exigence dérangeante.
Le recrutement, en revanche, devra sortir des statuts actuels, qu'il s'agisse de l'État, des collecti- vités locales ou des établissements publics. L'ave- nir est trop incertain pour qu'on garantisse qua- rante ans d'emploi aux entrants. Et pourtant il faut éviter l'arrêt des recrutements, qui déforme les pyramides des âges et prive de sang neuf. La sauvegarde de l'indépendance et de la neutralité, appellera des contrats de longue durée : dix ans peut-être; mais sans reconduction assurée. La réforme devra commencer par le haut de l'échelle, la « catégorie A », c'est-à-dire les cadres supé- rieurs, puis descendre progressivement les éche- lons.
Ces nouveaux fonctionnaires, à l'avenir plus précaire, devront être mieux qualifiés encore. Les concours, irremplaçables pour éviter la coopta- tion, auront un tour plus décentralisé et plus pro- fessionnel : il s'agit de recruter sur des métiers. Les rémunérations seront comparables à celles du marché. Les carrières se verront organisées et
172
pilotées de manière active, avec des sorties bien préparées pour ceux qui ne feraient qu'un temps dans le secteur public.
La réforme des statuts est incontournable. Elle n'est évidemment pas un préalable. Mais il faut la lancer sans tarder.
PAS BESOIN DE DÉLIER LES CORDONS DE LA BOURSE
Ce qui précède va coûter un peu d'argent. J'entends déjà les clameurs : « Trop facile de charger le Budget ! ». « Ce qu'on raconte ici a pu coller à la Caisse des dépôts, à la fois riche et peu contrôlée dans son fonctionnement interne. Pour les administrations publiques, les vraies, ce pano- rama irénique serait une pure manoeuvre pour décrocher des crédits ! »
Je veux montrer ici, et je suggère en ce sens des expérimentations, que le schéma tout entier peut s'autofinancer. A condition que notre révolution culturelle saisisse aussi nos amis les budgétaires, et qu'ils acceptent - ou que le gouvernement décide - quelques novations marquées du sceau de l'audace et de la confiance.
L'administration dont j'ai proposé le nouveau dessin vivra non pas luxueusement mais confor- tablement. Le confort est indispensable pour que les personnels, mieux considérés, se sentent mieux motivés. Servant l'État léger, elle sera parfois moins nombreuse, mais plus qualifiée. Elle rému- nérera quelques cadres hors des barèmes publics
173
- cela est déjà monnaie courante. Elle se dotera d'outils de gestion auxquels à ce jour elle peut rarement accéder. En retour, au gré du système des contrats, et pour atteindre mieux les objectifs fixés, motivée, elle accroîtra sa productivité. Pour un même résultat, elle suscitera des économies.
Aujourd'hui, l'administration d'État n'a aucun intérêt à être productive. La logique budgétaire ' veut que tout gain - quand il est mesuré ! - retombe dans la masse et ne soit pas récupérable par le service qui l'a engendré, ni même repor- table sur le prochain exercice. Cette logique tra- vaille à l'encontre de notre schéma; elle incite les responsables dont la charge décline à garder à tout prix des effectifs excessifs, car il y va de leur prestige, et peut-être de leur avancement; elle pousse au conservatisme, à l'immobilisme, nulle- ment à la productivité.
A charges constantes pour l'État, je propose deux approches pour faire du budget un moteur et non un frein.
Soit un segment d'État, administration centrale, direction régionale, établissement d'enseignement, régiment... doté de l'autonomie telle qu'on l'a pré- sentée ici : projet d'entreprise, contrat avec le niveau supérieur, objectifs affichés, comptabilité analytique, etc. Cette autonomie s'étend au bud- get : notre entité a son budget d'investissement et son budget de moyens; elle gère même intégrale- ment les crédits de personnel correspondant aux effectifs qu'elle emploie, et que régit, s'il s'agit de fonctionnaires, le cadre général du statut de la fonction publique.
174
Elle a le droit de rendre fongibles les dif- férentes enveloppes, élargissant les directives d'un séminaire gouvernemental de juin 1990 au terme duquel Michel Rocard a décidé de « déconcentrer les crédits d'intervention et de globaliser les cré- dits d'intervention et d'investissement ». J'y ajoute, ce qui n'est pas mince, les crédits de fonc- tionnement, y compris de personnel.
Dotons cette administration d'un compte d'exploitation. Qu'y lit-on?
e En charges, toutes les dépenses, classées par grandes rubriques ; entre ces rubriques et à condi- tion de respecter certaines règles de transparence, des glissements pourront être opérés. Oui, des glissements entre dépenses de fonctionnement, personnel compris, d'intervention et d'investisse- ment, dont je sais bien qu'elles émargent à des « titres » différents du budget de l'État. Mais on a proposé ici suffisamment de novations pour qu'on puisse demander que ces Tables de la loi-là bougent un peu, à leur tour.
0 En recettes, les sommes nécessaires pour financer ces dépenses. Mais aussi une ligne « divers », qui accueillera des crédits extérieurs, comme on va le dire.
Nous allons modifier à la marge ce compte d'exploitation. En cinq ans il sera dépensé, en francs constants et toutes choses égales par ail- leurs, 15 % de plus sur quelques rubriques. Pour que ce soit possible, il faut d'abord 15 % de cré- dits supplémentaires. Ils viendront d'une part de diverses économies, des surplus, que le service
175
dégagera par sa meilleure gestion et qu'il compta- bilisera, d'autre part de ressources nouvelles, sus- citées à l'initiative du service, et procurées par des apports extérieures à l'État. Principale innova- tion : les économies dégagées grâce à une meil- leure productivité auront été laissées dans la main du service, et non reprises par le Budget. Les gains de productivité auront financé, sans qu'il en coûte à l'Etat, le surcroît de dépenses.
On esquissera ici une balance inspirée par l'expérience d'une direction régionale de la Caisse des dépôts. Elle présente les modifications en charges, économies et produits annuels', sur cinq ans, exprimées en pourcentage du compte global du service, voir ci-après :
L'opération est blanche. Les surplus dégagés par une meilleure productivité sont restés dans le service. Ils ont financé une étape du changement. La productivité étant accrue, et l'élan imprimé, d'autres étapes suivront.
1. Ces produits viendront des nouvelles relations de l'État et des entreprises : celles-ci pourront confier à ce service des études, deman- der à ses cadres d'animer des sessions de formation, etc. Cette voie implique des ressources complémentaires, mais surtout une ouverture au monde extérieur, à mettre en musique. De manière évidemment transparente, avec les garde-fous déontologiques et les contrôles néces- saires.
176
Économies (-) ou produits Dépenses nouvelles nouveaux (+)
- moindre contri- - gestion des fonc- bution aux frais tions nouvelles : de structure cen- budget, person- traux' 1 - 2 % nel... 2 %
- allégement - investissements d'équipes de productivité 3 % lourdes (infor- - accroissement matique...) et de confort et
sous-traitance actions diverses de fonctions logis- (relations exté- tiques - 4 % rieures, commu- - autres gains de nication...) 4 %
productivité, - embauche de non-remplace- cadres et experts ment de person- de haut niveau 3 % nels - 4 % - primes d'inté-
- partenariat avec ressement 3 % entreprises : - * contrats avec des 15 If¡ entreprises
2 + 3 % 15%
* transferts de fonctions ; 3 - 2 %
15% ___
1. La décentralisation aura réduit le coût des services centraux. 2. Dans l'esprit du partenariat, amplement évoqué au chapitre III,
l'État cesse de faire toutes choses, et en charge des partenaires tels que les organisations professionnelles.
3. Voir note page 176.
177
L'approche peut être plus ambitieuse. Cela sup- pose alors un ministère du Budget qui ne se borne
pas, en bousculant quelques principes séculaires, à
permettre l'opération. Il l'appuie. Comme le feraient les organes centraux d'un
grand groupe, direction de la stratégie et direction financière, ou un actionnaire vis-à-vis de filiales en mutation, le ministère du Budget accompagne les
changements en les finançant, à tout le moins en les préfinançant. Il peut s'agir d'un investissement sec ; un contrat aura prévu le retour sur investisse- ment grâce aux gains de productivité, c'est-à-dire à des économies à terme. Il peut s'agir d'une « avance d'associé », que le service engagé dans la modernisation, « associé » à l'État-Budget dans la démarche de progrès, remboursera le moment venu. Cela se fait pour les entreprises, avec les « avances remboursables en cas de succès » ; accli- matons la pratique dans l'État. ,
Il n'existe pas de malédiction condamnant l'État à vivre toujours au petit pied dans des conditions
qui dégradent son image et démobilisent ses
agents. De même qu'il doit être accueillant vis-à- vis de ses clients, souple et mobile dans son fonc- tionnement, rapide et vigoureux dans la démarche, de même il a droit à sortir de la grisaille. Tout mon propos appelle à un coup de reins. Il faut
l'appliquer en particulier, et vigoureusement, à ce
qui détermine à la fois l'image et la dignité. C'est à ce titre que j'ai parlé de la nécessité du confort. Ce confort, lui aussi, est à portée de la main. Sans bourse délier.
178
De même que l'appel à de bons professionnels, ou l'équipement en bons matériels constituent des investissements utiles pour l'Etat, puisque condi- tions de travail, motivation et productivité vont de pair, l'objectif confort mériterait un effort sur cinq ou dix ans, une sorte de loi-programme constituant la face budgétaire du grand élan politique que je propose à la fin de ce livre. Ima inons, les yeux fermés : au seuil de l'an 2000, l'État en France a partout belle figure; la qualité des lieux inspire celle des travaux; elle a rendu les services accueil- lants ; l'État est mieux considéré; son autorité comme son efficacité ont fait des progrès. Et tout ceci, suivant mon schéma, n'a pas coûté beaucoup plus cher. ,
J'ai délibérément limité ce propos à l'État. Son application aux services publics, à plus forte raison à une entreprise publique, va de soi. Il concerne aussi les services des collectivités locales; elles sont soucieuses, en général, d'une gestion économe et d'un service bien rendu; il faudra seulement que les règles et les contrôles auxquels elles sont tenues soient adaptés comme il faut.
Plus haut j'ai parlé de la soif de contrôles intelli- gents dont souffre l'État. Les pratiques nouvelles que ce chapitre suggère les rend nécessaires. C'est :oute une philosophie nouvelle que ce volet de la nodernisation appelle : corsets assouplis, évalua- .ions d'autant plus pertinentes que la marge de jeu des gestionnaires aura été augmentée; et sanctions, bien entendu, s'il le faut, car la liberté plus grande n'autorise aucun relâchement déontologique, aucun fléchissement de l'intégrité.
179
Politique volontariste, ou simple maintien des
surplus là où ils ont été dégagés, l'une et l'autre formule déclencheront l'apoplexie chez les bud-
gétaires. Un gouvernement déterminé ne pliera pas devant leur indignation. Il demandera au contraire à nos gardiens du Temple de jouer le jeu et de bousculer, eux aussi, leurs tabous. Et de se
dépouiller, comme les autres, de quelques rigidités mentales.
Alors, l'État, plus performant, sera, bel et bien, moins coûteux pour la nation.
LE Czar À L'OUVRAGE
L'objectif était l'État performant. La motivation est son levier. Un patron, qui entraîne ses services; un projet auquel on adhère; le contrat, qui trace des objectifs et donne des outils pour les atteindre; des carrières, qui prennent en compte les qualifi- cations et ouvrent des perspectives d'avenir; le confort au travail, qui inspire la dignité. Ces élé- ments, tous complémentaires, sont les clés pour la motivation.
Un pas de plus est nécessaire. Les collabora- teurs veulent être considérés. Frustré, regardé comme un pion, voire ignoré par ses chefs proches ou lointains, mal informé sur le but de son activité, privé du droit de dire son mot sur les dossiers qu'il traite, jamais consulté, contrarié par des décisions
supérieures qui commandent l'organisation maté- rielle de son travail, pas même associé au choix des
180
matériels, le fonctionnaire va très vite baisser les bras. Il s'investira ailleurs : loisirs, sports, vie familiale, enrichissement culturel; il ne donnera à sa vie professionnelle qu'un service minimum.
Tout le schéma qui précède vise à éliminer ces aberrations. Or ce programme capotera si le patron, petit ou grand, dans l'État comme ailleurs, manque de considération envers ses collaborateurs.
Chaque salarié du secteur public doit avoir voix au chapitre. On lui proposera d'être associé à l'éla- boration du projet d'entreprise; cette consultation sera assortie d'un recueil d'idées, que le service aura à coeur d'examiner, et auxquelles il répondra. A travers des cercles de qualité, ou toute autre pro- cédure de ce genre (à la Caisse des dépôts, « cercles d'initiative et de progrès », « groupes d'améliora- tion de la qualité », « groupes de résolution de pro- blèmes », etc.), il sera, s'il l'accepte, l'artisan col- lectif d'une amélioration de ses propres méthodes et conditions de travail, de la relation de son unité avec celles qui l'entourent, de la simplification des imprimés, de la mise au point de nouveaux outils, du choix des équipements... Je n'ai pas connu dans mes fonctions actuelles de moment plus heureux que les exposés de collaborateurs de modeste niveau sur la manière dont ils avaient, eux-mêmes, en cercles de qualité, renouvelé l'exercice de leurs tâches. Ceux-là s'approprient, avec d'autant plus de conviction qu'ils entendent en prouver la per- tinence, les nouveaux dispositfs qu'ils ont élaborés et qu'ils ne cessent de perfectionner. Il ne s'agit plus de considération, mais bel et bien d'enthou- siasme !
181
Comment distribuer, et où placer, une dizaine de photocopieurs dans un service réparti sur quatre étages ? Le chef de service a son idée. En d'autres temps, sans regarder aux coûts, on ferait appel à un consultant. A la Caisse, les intéressés, les secrétaires vont traiter le sujet. Un « cercle » se crée. Après plusieurs séances, il propose un schéma inattendu. Sa mise en oeuvre est deux fois gagnante : le fonctionnement est bon, meilleure la motivation de celles qui l'ont conçu.
Dans la procédure contractuelle, on négocie vers le bas comme avec les échelons supérieurs; les col- laborateurs sont associés aux choix des objectifs et à la discussion des moyens, à la fixation des résul- tats à atteindre, qui sont connus et affichés. Ils contribuent à leur mesure à la réalisation de ces objectifs et savent que la confirmation de la bonne marche ou le redressement de la situation dépend en partie d'eux. L'évaluation de fin de période les implique. Lorsqu'il y a intéressement, la procé- dure de répartition des primes les mobilise. Quand nous en serons à l'affectation des « surplus », ils seront également dans le coup.
J'ai vu, dans le service public, des hommes et des femmes épanouis dans un travail qu'on leur avait donné la chance de définir et de modeler à leur façon. La considération, qui prend ici le tour de la participation, donne du coeur à l'ouvrage.
J'en faisais récemment le thème d'une allo- cution : « La considération de l'un pour l'autre, le souci d'informer et d'écouter, le respect d'autrui dans le travail, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas la
182
cerise sur le gâteau. Ce sont des conditions radi- cales pour avancer. Ainsi marche aujourd'hui toute organisation que l'on veut efficace et où l'effort soit général. Sans quoi, on manque ses ren- dez-vous avec l'avenir. »
Il m'est arrivé d'en demander un peu plus à tous nos personnels : « J'ai besoin de vous. » Je l'ai fait en janvier 1990 à propos de la décentralisa- tion, potion magique pour le renouveau : « Chacun doit être demandeur (j'insiste, c'est un droit) de décentralisation, qui va de pair avec la responsabi- lité et la considération. Chacun doit être acteur (j'insiste, c'est un devoir) de décentralisation, qui ouvre la porte à l'initiative et enrichit la vie au tra- vail. » Sans ses troupes, le chef ne peut rien. Pour- quoi ne pas le proclamer ? Ce message, lancé à bon escient, contribue à mobiliser un corps social.
Considérer, c'est aussi communiquer. La communication d'entreprise est un art difficile. Le discours ne doit pas être trop « patronal » et il faut laisser place à la contradiction; le langage ne doit pas être trop technique, et il faut cependant expo- ser ce qui se passe.
Publications, « messageries », « vidéos » internes, autant d'exercices de communication. C'est d'abord valoriser des équipes, en décrivant, images et témoignages à l'appui, leurs activités et leur vie au travail. Les collaborateurs sont fiers qu'on parle d'eux. Au surplus, pour le responsable, qui ne sait pas toujours ce qui se fait dans sa maison, c'est une occasion d'apprendre, de réagir, d'encou- rager.
183
C'est ensuite expliquer les dossiers du moment; aider le personnel d'un service à en savoir un peu plus sur son entreprise ou son administration que ce que ses parents ou ses amis qui l'interrogent tiennent de la presse ou de la radio. Ceci appelle quelques grands exercices d'information, au bon moment. Chaque année, nos personnels sont conviés, dans une grande salle de Paris, d'où le message est relayé vers la province, à prendre connaissance de nos résultats, le jour même où ils sont communiqués à la presse. Plus régulièrement au long de l'année, ce devoir d'informer passe par des commentaires, et donc des supports, modulés, ce qui est dit aux cadres n'étant pas toujours acces- sible à des collaborateurs moins avertis du détail des dossiers. Cela suppose de la rapidité. Notre
principal hebdo interne, « bouclé » le jeudi à midi, est diffusé le vendredi.
Cela veut aussi de la lucidité et de l'honnêteté. Il faut motiver sans dorer la pilule. C'est une marque de considération que dire, le cas échéant, ce qui va mal, comme de parler, à ceux qui n'osent pas interroger, des sujets sensibles. Il n'y a pas de considération sans courage. Et il est alors plus facile, comme je l'ai également voulu et tenté, d'inviter les fonctionnaires à l'audace.
La communication implique d'abord le patron, que ses services sont en général heureux d'écouter et de rencontrer de temps à autre. Il n'est pas d'exercice annuel que je soigne autant que le « dis- cours de voeux ». Jadis confidentiel - mon pré- décesseur parlait dans son bureau à une poignée
184
de hiérarques -, il est adressé maintenant, par relais télévisé, à des milliers de collaborateurs. Sa préparation, à laquelle s'associent notre comité exécutif et divers panels internes, prend plusieurs semaines. Les thèmes et les messages, le choix des mots et des images sont étudiés avec soin; l'ambiance, les supports visuels, parfois les films d'accompagnement, sont analysés longuement avec le service de la communication interne. L'enjeu vaut la peine : en m'adressant à tous, comme à autant d'interlocuteurs, j'ai la grande ambition de les mobiliser, de donner le « la » pour un nouvel an.
A tous les échelons de notre groupe, jusqu'aux unités de vingt ou trente personnes, l'exemple est maintenant suivi. La prise de parole est devenue naturelle. Certains chefs réussissent à faire passer un véritable courant, et des exercices de communi- cation interne donnent, à l'heure où le moral vacille, ou quand l'horizon se brouille, le ressort nécessaire pour repartir d'un meilleur pied.
Le dialogue doit s'instaurer comme un acte régulier de la vie sociale. Il requiert une vertu : l'écoute. Difficile pour le grand patron, qu'isolent la surcharge et le respect, plus facile pour le res- ponsable de niveau intermédiaire, elle doit être un réflexe. Le devoir d'écoute, c'est savoir au bon moment que tel résultat a été atteint par telle équipe et lui en faire aussitôt compliment. C'est visiter les services, briser la glace à toute occasion avec des collaborateurs lointains, chercher des indicateurs ou simplement être vigilant aux indica-
185 .
tions de climat. Le directeur général évitera de laisser remonter à lui les doléances qu'il appartient à d'autres de régler; il ne s'essaiera jamais à briser les syndicats ni à désavouer les échelons inter- médiaires ; bien entendu, il fuira toute démagogie. Chacun jouera sur ce registre suivant son tempéra- ment. Mais nul n'a le droit, s'il veut commander et animer, de refuser la conversation. Un chef ne vit pas calfeutré.
Communication et considération sont dues à tous. Elles ne doivent pas oublier les relais. Un patron « communiquant » évitera de court-circui- ter, au point de les affaiblir en termes d'image et d'autorité, les échelons intermédiaires ou les rouages internes à une maison.
Ainsi les syndicats. A la Caisse des dépôts, leur affaiblissement va de pair avec la dispersion de leurs faibles troupes entre cinq ou six familles. Largués par la rapidité des évolutions, plusieurs d'entre eux - mais pas tous cependant - oscillent entre la revendication pointilliste et l'atonie, semblent en peine de formuler de vrais messages et de définir une attitude en phase avec les événe- ments. Il y a dix ans, leur force de proposition et de concertation contribuait plus activement à la vie de l'institution. Ce recul représente une perte pour un groupe tel que le nôtre, où le dialogue social est, comme ailleurs, vital. Il faut éviter de réduire la communication à un faux dialogue entre une direction générale et des milliers d'individus ato- misés.
Redonner plus de poids aux syndicats, c'est
186
aussi l'affaire du chef. Il doit les rencontrer, hors des instances formelles, les écouter s'ils ont des choses importantes à dire, leur parler des orienta- tions du groupe, des problèmes qu'il rencontre, des interrogations sur l'avenir. Il ne s'agit pas d'en faire des complices, de les inviter à être d'accord avec lui ou à se « mettre à sa place ». Mais de leur témoigner simplement de la considération et de prendre en compte analyses, aspirations et sugges- tions. Nous nous y employons, plus ou moins bien. Les résultats, soyons honnêtes, demeurent modestes.
Ainsi les cadres. S'il leur arrive de bloquer la décentralisation et refuser la nouvelle donne, c'est en général parce qu'on ne les a pas suffisamment appuyés pour le rôle nouveau qu'on leur demande de jouer. Cet appui peut venir de la formation : le management moderne s'apprend; il est aujour- d'hui un thème majeur de la formation à la Caisse des dépôts. L'appui vient aussi du regard que les supérieurs portent sur les cadres intermédiaires ou ceux qu'on appelle les petits chefs. Il est rare que la considération démarre à ce niveau; elle vient du sommet; elle touchera l'ensemble de la maison si les échelons moyens en ont eux-mêmes bénéficié, de la part de ceux qui sont au-dessus. Rappel : il faut des patrons de grande carrure.
Ceci est très difficile. Moi qui en parle beau- coup, ici comme chaque jour dans mon travail, il m'arrive... de ne point y arriver. L'excuse, la mau- vaise excuse est cette maladie des chefs, que si peu savent traiter : l'infernale surcharge et le temps qui fait défaut.
187
Est-il besoin de le dire, la considération ne ruine pas l'autorité. Elle établit, au contraire, une rela- tion plus humaine sans laquelle, de nos jours, le patron n'ira pas loin.
« Chaleur et rigueur », avais-je recommandé, à mon arrivée, à l'encadrement de la Caisse des dépôts. A l'époque, prêcher la chaleur n'avait pas un très grand sens : la communication interne était pauvre, le dialogue fluet, la décentralisation dans les limbes, la participation aux décisions n'était qu'un voeu imprécis; sur la motivation, enfin, nous tâtonnions... A présent qu'un dispositif existe, qu'une démarche longue se démultiplie, qu'un tonus est créé, que l'initiative a droit de cité, que le
dialogue multiple entre dans les moeurs, la main tendue que je préconise trouve un sens.
Ce cocktail - chaleur et rigueur - produit un résultat que l'État tout entier doit se fixer pour objectif : des services où il fait bon travailler; des hommes et des femmes reconnus, écoutés, bien dans leur peau dans leur vie professionnelle. Sui- vant mon expérience, ceci est loin d'être généralisé. Il y a des zones d'ombre, des îlots d'amertume et de déception. Et l'ouvrage est chaque jour à remettre sur le métier, car la pente humaine ne va pas forcément vers la confiance et la délégation, vers le sourire et la considération...
La Caisse des dépôts, dont la gestion était hier classique et grise, a néanmoins changé de visage. Et j'ai vu de pareils changements passer sur le mouvement HLM, s'amorcer à la direction de la
188
construction. Bien d'autres rénovations dans le sec- teur public, auxquelles je n'ai pris aucune part, nourrissent ma conviction : l'État performant est à portée de la main. A condition d'y appliquer un peu de méthode et beaucoup de passion.
La réforme choc n'est pas une utopie. Rien n'est facile, mais tout est jouable. Et l'ensemble avan- cera d'autant mieux qu'on évoluera d'un pas égal sur les diverses rubriques. C'est ainsi qu'on modi- fiera ce qui est le plus important : la culture et les comportements. C'est ainsi qu'on passera de la mentalité administrative à l'esprit de développe- ment. Que d'autres réflexes se noueront. Que la puissance publique, sans déroger ni faiblir, devien- dra moderne.
L'État performant constitue un objectif raison- nable. Parce qu'il est riche de talents endormis que l'air nouveau va ranimer, parce que d'autres reviendront vers lui, parce qu'il est fort d'une tra- dition qui, désencombrée des rigidités, constitue un atout, l'État en France peut à nouveau nous sur- prendre. Dans ce pays, comme à l'échelle de l'Europe, il peut figurer demain au premier rang des grands agents efficaces et des moteurs du pro- grès.
CHAPITRE V
POUR DÉCOINCER L'ÉTAT
LETTRE À UN PATRON QUI S'IGNORE
J'avais annoncé une adresse au ministre, respon- sable à mes yeux de bien des travers de l'État. Or la chose s'est ébruitée, en dépit de l'impénétrable secret qui entoure dans notre pays les questions touchant à l'État. Et j'ai reçu une lettre un peu sèche de ce fameux ministre. J'ai cru devoir la subs- tituer aux « méchancetés » que je lui avais écrites.
Voici donc ce message ministériel. A vrai dire, il me paraît excellent. Je souhaite qu'il retienne l'attention du lecteur... et des collègues de mon cor- respondant. J'ajoute que la mariée est bien belle : si tous nos gouvernants en étaient là, le présent livre serait, j'en ai peur, inutile...
Le ministre :
« Voilà un moment que vous me promettez une admonestation. Je serais en effet " le patron qui
191 1
s'ignore ". Je n'aurais pas conscience des services que je dirige; je considérerais l'administration comme un réservoir sans fond de capacités d'exé- cution. Je n'aurais d'autre calcul que de lui donner de nouvelles tâches, sans jamais lui en retirer d'anciennes, ni vérifier qu'elle a quelques " capaci- tés de production
" inemployées. J'abuserais à
cette fin de l'inconscience des directeurs, mêlée à leur goût détestable de ne jamais contrarier leur ministre, qui les amène à toujours se mettre au garde-à-vous quand je leur passe commande, fût- elle incohérente avec ce qu'ils font déjà sur le sujet, et même s'ils n'ont plus aucune marge de jeu pour absorber de nouveaux travaux. Mais le savent-ils ? Je vous le demande : ont-ils même l'idée que cela se mesure?
Je serais un homme à foucades, pour qui tou- jours l'intendance suivra. Je n'accorderais à celle-ci, qui ne serait pas mienne mais constitue- rait un ensemble de "
moyens " à ma disposition, qu'une attention dérisoire. Je ne m'en soucierais à vrai dire que pour mettre en phase avec moi, c'est- à-dire en concordance avec mes vues politiques, les quelques directeurs que j'ai à voir de temps à autre, laissant à mon cabinet bien-aimé le soin, si besoin, de contacts plus amples avec les cadres, voire avec quelques-uns de ces milliers d'agents dont, tant qu'ils ne bougent pas, je ne sais ni le nombre ni les conditions de travail!
« Je prends les devants. Car tel n'est pas mon cas.
« Il est vrai que j'ai appris mon métier sur le tas,
192
à l'occasion de deux ou trois responsabilités gou- vernementales successives. Mais justement, j'ai éprouvé l'importance d'une bonne relation entre mes équipes, celles du ministère à Paris et celles des services extérieurs d'une part, et leur chef, c'est-à-dire leur ministre, d'autre part. J'ai vu combien il était payant de les considérer, de leur raconter pourquoi je décide telle politique ou telle réforme. Je m'efforce de l'expliquer à l'opinion, il est légitime que je leur en parle en premier, même si avec eux l'exercice est plus difficile parce qu'ils savent, bien mieux que moi, de quoi je traite. J'ai même commencé à les consulter, bien plus : à les écouter. Et j'en suis au point où je ne lance plus de projet que je n'aie débattu avec mon administra- tion - ce qui ne signifie pas que je lui donne tou- jours raison.
« J'ai même décidé de vérifier deux choses avant toute nouvelle initiative : d'abord, qu'elle ne signi- fie pas un changement de ligne difficile à expli- quer aux partenaires de mes services (certains directeurs parlent maintenant de leurs « clients »... je crois qu'ils ont raison) ; ensuite, qu'elle est compatible avec les capacités des services. Je sais en effet que lancer des fonctionnaires centraux saturés de tâches ou des préfets accablés de cir- culaires quotidiennes, sur un nouveau chantier sera, si je ne leur donne pas la respiration néces- saire, et si je ne les ai pas convaincus au préalable du bien-fondé de l'action, un coup d'épée dans l'eau.
« Pour illustrer mon propos, voici des extraits de
193
mon allocution à mon administration, lors de ma dernière prise de fonctions. J'avais tenu à m'adres- ser aux directeurs et autres grands responsables du ministère, avant - préséance essentielle à mes yeux - de parler à la presse et aux professions. Le propos était retransmis, simultanément, à tous les agents du ministère. »
Discours du ministre : [...] ] « Nous allons faire avancer les grands chantiers
de ce ministère. Sur certains points, nous accélére- rons ce que vous avez déjà mis sur les rails; sur d'autres sujets, nous innoverons tout à fait, parfois en changeant de cap; sur tel ou tel chantier, je vous inviterai au contraire à refermer le dossier, qui ne me semble - sauf, bien sûr, à vous entendre là- dessus - ni opportun, ni prioritaire.
« Mais avant de traiter de cela, mon premier message est pour vous : j'apprécie d'avoir à travail- ler avec vous. Je vous commanderai, mais je vous aurai d'abord écouté.
« J'ai de la considération pour ce que vous faites. Vous ne servez pas seulement l'État. A tra- vers lui, et sur des sujets importants pour chaque Français, vous servez la communauté nationale. Vous avez, dans vos mains, des questions décisives pour la vie quotidienne de nos compatriotes. Vous appliquez aux questions de votre compétence votre sens élevé du service public, parfois avec une opi- niâtreté qui mérite l'éloge. Bien des progrès dans ce pays sont à votre actif ou à celui de vos pré-
194
décesseurs. Bien des choix, bien des lois, n'auraient ni été conçus ni connu d'application sans vous. Je sais aussi que vous êtes tous sur quelques chantiers de longue haleine, dont l'abou- tissement nécessite encore des mois ou semestres de travail. Je respecte ces entreprises de fond, de même que le lourd investissement qui a, sur de tels dossiers, été le vôtre.
« Je ne vous proposerai donc pas une idée neuve chaque matin. J'essaierai de ne pas être un fréné- tique de la réforme. " Moins mais mieux " pour- rait être sur ce plan mon programme. Ainsi exprimé, il est ambitieux, et j'ai besoin de vous !
« Vous allez d'abord, et en peu de semaines, m'aider à comprendre et à mesurer :
- les enjeux qui dépendent de ce ministère et les grands choix qui, en conséquence, constituent votre vision et vos priorités;
- les objectifs que chaque direction ou service s'est fixé, ou bien ceux que vous aviez arrêtés, pour cette année, avec mon prédécesseur; je vous demanderai aussi quelle publicité a été donnée à ces objectifs, dans vos administrations comme chez vos clients ou vos partenaires;
- où vous en êtes de la mise en oeuvre de ces objectifs;
- quelles sont vos marges de manoeuvre pour de nouveaux chantiers.
« Je vous prie donc de me présenter chacun, sous huit jours, un rapport en dix pages au plus; j'admettrai quelques annexes, et j'apprécierai que figurent parmi ces annexes le " projet " de votre
195
direction ou de votre service, ainsi que votre der- nier tableau de bord. Je lirai moi-même ces docu- ments, qu'ensuite vous me commenterez dans votre propre bureau. Lecture faite, je dois être au clair sur le pourquoi de votre activité, sur vos clients, vos objectifs, tant annuels qu'à plus long terme. Sachez qu'il y a pour moi le " faire tourner " : ce sont les progrès dans la gestion de vos attributions, de vos crédits, de votre relation à l'extérieur; et le " faire bouger " : ce sont les réformes, les améliora- tions dans le domaine dont vous avez la charge, qui éventuellement se trouvent sur le métier. Je serai également au clair, vous ayant lus, sur vos échanges avec votre environnement, sur les asso- ciations que vous lui proposez, sur l'appui qu'il vous apporte et sur la forme qu'il prend, de même que sur les conflits ouverts ou latents que suscitent vos interventions ou vos abstentions. Je connaîtrai vos idées sur ce qu'il convient de faire pour amé- liorer le domaine qui est le vôtre.
« Vous m'éclairerez aussi sur la réalisation de vos objectifs. Dites-moi comment vous suivez cette réalisation, quels sont vos outils de mesure et de quelle manière vous les exploitez. Je dois pouvoir évaluer, à vous lire puis à vous entendre, les obs- tacles, contraintes et blocages que vous rencontrez, qu'ils soient externes ou qu'ils viennent de vos propres services. Je serai attentif à vos suggestions pour les réduire ou pour mieux composer avec eux; vous voudrez bien distinguer ce qui dépend de vous - en me disant alors comment les choses sont engagées, ou peuvent l'être demain - et ce qui
196
est de mon ressort, voire de celui du gouvernement ou de la loi. Mais moins vous proposerez de grandes lois et plus j'apprécierai votre document !
« Je dois mesurer ensuite, en prenant connais- sance de votre dossier, les marges de jeu dont vous disposez pour de nouveaux chantiers, qu'ils soient ouverts à votre initiative et, bien sûr, avec mon accord, ou qu'il s'agisse d'appliquer la politique qu'après vous avoir entendu, je déciderai. Je sou- haite que vous ayez du mou. Sinon, vous me dési- gnerez vous-mêmes les travaux moins utiles que vous proposez de laisser tomber, ou les réorganisa- tions, génératrices d'économies dans les moyens, auxquelles vous pensez qu'on peut procéder; vous balancerez, pour chaque suggestion, les avantages et les risques. Mais ne commencez pas par me demander des moyens supplémentaires! les ral- longes ne sont pas à mes yeux la potion magique pour l'État.
«J'attends donc de vous que vous ayez des objectifs clairs, et que vous sachiez où vous en êtes de leur poursuite. Si tel n'était pas le cas, vous pouvez essayer de rationaliser ce que vous faites et de bâtir en huit jours le schéma que je vous demande. Mais je ne m'y tromperai guère, et l'avantage sera à ceux qui ont dès à présent une bonne vision, explicitée, connue de leurs troupes, pour cadrer leur action, et qui ont aussi de bons indicateurs pour évaluer la route faite.
« Vous attendrez de moi, en retour, que je valide ces objectifs, ou que je les remette en cause, ou encore que je les complète - mieux : que je les
197
mette en perspective dans une démarche d'ensemble. Je ferai cela après avoir conduit avec vous un débat approfondi; après avoir écouté ce qu'on dit au-dehors de vos projets et de vos inter- ventions, et ce qu'on suggère; après avoir rapporté les orientations que vous suivez, de même que les chantiers auxquels vous êtes attelés, à la politique du gouvernement et aux grands choix qui sont les miens.
« Au terme de ces travaux, qui ne prendront pas plus de six semaines, notre cadre d'action sera bâti. Il sera ma décision, mais vous y aurez beaucoup contribué. Si elle ne vous convient pas, nous nous séparerons, de votre fait - cela serait à votre hon- neur - ou du mien. Si elle rencontre vos vues propres, j'attendrai de vous une pleine mobilisa- tion. J'attendrai de vous la pleine adhésion, que vous devez savoir susciter, si vous êtes convaincus, de vos services. Je vous jugerai également à cette mobilisation.
« Nous nous entendrons sur des objectifs chiffrés, sur des indicateurs et sur des délais de réalisation. Éventuellement, mais le cas sera exceptionnel, sur les moyens que vous me deman- deriez pour mener à bien tel nouveau projet. Dans certaines situations, sur des préalables qui ne sont pas de votre ressort, ni parfois du mien, et qu'il faudra lever pour entreprendre telle action.
« Cet accord entre vous et moi sera précis. Je le négocierai avec vous; je répète : nous négocierons; nous signerons vous et moi un contrat. Si vous topez, vous vous engagez. Nous ferons le point
198
périodiquement. Vous savez bien que les données du jeu ne seront jamais stables, mais je m'efforce- rai de vous assurer les conditions nécessaires à la réalisation de vos engagements. Et, à cette réalisa- tion, j'évaluerai vos capacités. Avec toutes les
conséquences qui, très normalement, pourront en découler.
« Mon propos est donc celui de la confiance.
Je vous écouterai, je vous associerai aux choix, mais ensuite comptez sur moi pour être exigeant. Confiance et exigence, c'est aussi ce que vous devez manifester à vos collaborateurs. Au travail, Mes- dames et Messieurs ! Rendez-vous à huitaine. »
POUR LANCER LE MOUVEMENT
Mille initiatives dispersées constituent aujour- d'hui l'amorce du grand bouleversement que je suggère. Depuis Matignon, Michel Rocard a donné, le premier, un signal général. Il a changé, un peu, le climat dans l'État; l'innovation y est devenue tolérable.
Mais de telles impulsions s'effacent vite de la mémoire si elles ne sont pas entretenues. Or, sur ces sujets, je ne vois rien, depuis bientôt deux ans, qui ait du souffle. Les urgences sont ailleurs.
Comment alors relancer le mouvement général, et le faire en bon ordre ? Pour le déclencher, quel- ques touches, plus ponctuelles que rationnelles, peuvent, avec un effet rapide, créer de petits chocs et ébranler des certitudes immobiles.
199
« L'État moins 10 % » pourrait être une pre- mière voie. Attention, il ne s'agit pas de réinventer ces « commissions de la hache » qui devaient, sous la IVe République, réduire partout uniformément les effectifs. Ces idées simplistes n'ont en général qu'un temps, et ces haches-là ont été enterrées avant d'avoir coupé une seule tête!
Mais on peut fixer, à un département ministé- riel ou à une administration locale, un objectif à trois ans : réduire les coûts globaux de 10 %, tout en améliorant la performance. Les coûts, cela invite à un exercice plus intelligent que compri- mer les effectifs : si on sous-traite certaines tâches - ce qui est souvent une bonne idée -, on allège la charge du service et on peut en théorie se passer de certains personnels; mais le coût de la sous-traitance figurera dans le budget. Il en va de même avec l'informatisation, qui peut allé- ger les besoins de personnel, mais dont le coût est parfois plus élevé.
Plus importante est l'association de la réduction des coûts à la progression de la performance. On retrouve ici l'idée de contrat entre, d'un côté, le gouvernement, représenté par exemple par le Pre- mier ministre, avec le ministre du Budget et celui de la Fonction publique, et de l'autre, le ministre en charge d'un secteur de l'État, à qui on donne trois ans pour atteindre l'ensemble des objectifs; en lui laissant la plus grande marge de jeu. Ou entre un ministre et tel de ses directeurs. Ou entre un maire et le patron de ses services techniques, etc.
200
Cette approche globale coûts/performance et ce délai raisonnable font obligation de repenser l'organisation.
Il y a des astuces à ajouter. Les Américains ont inventé les « weight watchers » : les gendarmes du poids. Avec de bons indicateurs, des clignotants s'allument quand le coût (encore une fois le coût global, et non pas les seuls effectifs) progresse plus vite que prévu, ou ne recule pas au rythme décidé.
Je suggère ensuite la question préalable : avant toute création d'un service nouveau, avant même le lancement d'un projet, il faut s'interroger. Est-ce bien nécessaire ? Que supprime-t-on à la place ?
Suivant une procédure souple, cette question sera rendue obligatoire. Au sein d'un ministère, tout ministre dispose de « conseils supérieurs » qui peuvent, en quarante-huit heures, sur un projet qui devra alors être bien défini, lui donner un avis. La procédure pourra s'appliquer aux échelons déconcentrés. Au niveau du gouvernement, je sug- gère une « instance discrète », composée de deux ou trois sages, qui soit automatiquement consultée, par exemple sur l'institution de nouveaux rouages interministériels, et qui rende un avis par retour du courrier.
J'ai sur ce thème une idée fixe, dont l'énoncé ne me fera pas que des amis. Pourquoi a-t-on, au long des années 1980, créé tant de « machins » interministériels, tous dotés de services, de locaux et de budgets, pour s'occuper de la ville : Commis- sion des quartiers, Commission pour la prévention
201
de la délinquance, Mission Banlieues 89, Mission grands projets, Délégation interministérielle à la ville, etc. ? N'était-ce pas du ressort d'un ministère de l'Équipement audacieux?
Avec le réflexe de la « question préalable » on aurait pu au contraire procéder ainsi : l'organe discret que je viens de suggérer aurait donné son sentiment. Par exemple dans les termes suivants : Monsieur le Premier ministre, si vous voulez jouer un coup politique, c'est votre affaire, mais en termes de bonne gestion, l'innovation à laquelle vous songez est inepte. D'une part, tel service peut remplir cet office, sous l'autorité de tel ministre. D'autre part, vous allez semer la pagaille en démotivant certaines unités et en compliquant les circuits. Au surplus, votre nouveau rouage ne pourra pas bien marcher : pas d'argent, pas de locaux, pas de services extérieurs, hostilité des ministères, etc. Ne créez rien de la sorte. Renfor- cez le ministère compétent - en l'occurrence l'Équipement. J'ajouterai : si le ministre compé- tent n'en prend pas l'initiative, et qu'il ne sent pas l'importance du problème, est-il le bon ministre ?
On peut innover vite à modeste échelle, mais avec un impact symbolique.
Je suggère des ratios rustiques, pour mesurer les gains des services en productivité et en qualité. Le but à terme, ce sont des comptes d'exploitation, des objectifs précis et des indicateurs élaborés (sans perfectionnisme inutile, s'il vous plaît!). Mais pour en venir là, il faut un apprentissage de la ges-
202
tion décentralisée par objectifs. L'expérience de la Caisse des dépôts m'a appris que cela requiert trois ou quatre ans. C'est bien long, là où rien n'existe sur ce plan, pour attendre le coup de fouet que donnent la poursuite d'objectifs chiffrés et la mesure du résultat.
Alors, en phase d'approche, imaginons des indi- cateurs simplistes : rapport entre les dépenses de fonctionnement et les crédits gérés, mesure par enquête de la satisfaction des « clients », délais de réponse au courrier, etc. Ce sera imparfait, notam- ment parce qu'on ne peut s'engager sur des résul- tats si on ne dispose pas, suivant la logique du contrat, des moyens nécessaires. Mais la séquence, c'est-à-dire la succession dans le temps de ces mesures, même rustiques, fera ressortir des zones de défaillance et stimulera les équipes. Cela peut s'appliquer, en période de montée en régime, aux unités dotées de ces projets de service dont le lance- ment a été décidé en 1990.
Je suggère encore le repérage des points noirs : goulots d'étranglement, lieux de tensions dues à de mauvais fonctionnements, poches d'oisiveté, qui entraînent dépression morale et déperdition des forces. Des chevau-légers issus des services et non pas, suivant nos mauvaises habitudes, des consul- tants payés à prix d'or, pourront les circonscrire, et
proposer leur résorption. J'ai géré des cas de crise de ce type, dus à la
défaillance de projets informatiques. Une forte mobilisation des échelons supérieurs et un disposi- tif par lequel on met le paquet pour sortir d'un
203
mauvais pas, produisent un effet quasi magique : des personnels, que j'avais vu désespérés au point de plonger dans la déprime et la maladie, redeve- naient artisans du redressement, parce qu'ils ne se sentaient pas livrés à leurs difficultés, mais l'objet d'une solidarité d'entreprise.
De telles situations existent pourtant dans le secteur public. Elles ne sont en général ni repérées précisément, ni analysées avec rigueur. Elles peuvent durer quasi éternellement, puisque dans les administrations telles qu'elles sont aujourd'hui, à la différence de l'entreprise, à la différence aussi de l'État performant dont j'ai tenté ici de définir les contours, l'improductivité n'est pas sanction- née. Non plus que la démotivation qu'engendrent le dysfonctionnement des travaux et la sous- occupation des équipes. Une détection et un décor- tiquage des points noirs n'est pas difficile; il suffit que le patron le veuille. Une fois le repérage effec- tué, la résorption est assez simple à concevoir et à mener à bien. C'est l'approche qu'il faut systéma- tiser : elle n'accepte pas que les choses, même ponctuellement, marchent mal; elle s'inscrit dans une démarche énergique de réforme.
Je suggère également des zones franches, libé- rées de certaines règles et contraintes. Tout le monde a fait de telles expériences, limitées dans leur rayon. Quand le Crédit local de France, le CLF, a commencé ses prêts sans enquête, délivrés sur appel téléphonique et mis en place en qua- rante-huit heures, au bénéfice des petites communes rurales, il a pris un risque. Pierre
204
Richard, le patron du CLF, a alors affranchi deux directions régionales des règles bancaires qui leur étaient imparties. L'expérience a permis de corri- ger les premiers tirs. Elle a ensuite, rectifiée, été généralisée.
Tel est l'esprit de la zone franche : si on ferme les yeux sur certaines sécurités, on aura un taux d'erreur un peu plus élevé, mais un taux général de productivité et de satisfaction beaucoup plus fort. Il ne faut pas faire n'importe quoi, et le projet doit être bordé, mais la démarche sera riche par son impact, car elle signifie un acte de confiance, aussi bien que la remise en question du perfection- nisme réglementaire français. C'est une invitation à l'initiative, une petite aventure riche de rebon- dissements psychologiques.
Mon dernier train de suggestions touche les recrutements.
D'abord l'ENA. Ce qui est imaginé plus haut n'est pas en rupture avec les initiatives de René Lenoir, non plus qu'avec les belles expériences de l'actuel directeur de l'École quand il était préfet de région. Je pense qu'on peut, sans tarder, centrer l'enseignement sur les deux rubriques dont j'ai souligné la nature prioritaire : gestion des res- sources humaines et conduite de projets. Et ainsi de suite.
Il est possible aussi d'unifier assez vite les recru- tements dans les fonctions publiques nationale et territoriale. Cette dernière, à laquelle s'appliquent également toutes mes recommandations, cesserait ainsi d'être le parent pauvre.
205
Je suggère enfin une opération « cinquante patrons pour l'administration ». Le ministère de la Fonction publique, dans cette vue, contractera avec des entreprises privées ou publiques, peut-être internationales, qui lui prêteront, pour cinq ans, des cadres de très haut niveau ayant fait leurs
preuves professionnelles, et connus pour leur caractère comme pour leur hauteur de vues. Ils seront, suivant leur tempérament, nommés à la tête d'une administration centrale ou d'une préfec- ture, d'une agence ou d'un établissement public, sans qu'il soit recherché de relation entre leurs compétences professionnelles antérieures et cette activité. C'est au manager qu'il s'agit de faire
appel, et non pas au spécialiste de telle technique. Ils conserveront leur rémunération, et seront assu- rés d'être repris, dans de bonnes conditions, par leur groupe d'origine, au terme du mandat. Ils auront la possibilité de recruter quelques collabo- rateurs hors du service qu'ils dirigeront; point trop cependant, car il s'agit de stimuler, non pas de coloniser. Ils seront soumis bien entendu à la
déontologie de la haute fonction publique. Ils pas- seront contrat avec le ministre qui les nommera. Bon exercice pour celui-ci, qui devra fixer des
objectifs et convenir de moyens. Une négociation préalable à l'acceptation du marché sera donc légi- time.
Et que les résultats s'ensuivent ! Il y aura quel- ques échecs. Mais, si les patrons sont bien choisis, en particulier pour leur capacité à animer des
équipes dans le respect des hommes et des femmes,
206
on verra se former des pôles de rénovation dans l'administration. Ils contribueront à amorcer, à approfondir, la réforme choc que j'ai préconisée. Ils montreront surtout que l'Etat tonique et per- formant, c'est possible.
J'attends, plus largement, un gouvernement qui prenne la question à bras-le-corps. Suivant une méthode expérimentée ces dernières années, il pourrait créer un choc et secouer aussi bien le scepticisme que la léthargie, en lançant des « assises » ou un « débat de grande ampleur, voire des « états généraux » dont la réforme de l'État serait l'objet. Suivant quelques thèmes, lancés par le gouvernement, la fonction publique tout entière, nationale et territoriale, ministères et établisse- ments publics, sera invitée à réfléchir; à réagir aussi, sur des images et des références qui lui seront renvoyées, illustrant ce qui se passe hors de l'État et hors de nos frontières. On associera à une telle réflexion les syndicats de fonctionnaires, moyennant quelques garde-fous qu'ils sauront négocier. Je suis certain que des cadres et des diri- geants du secteur privé accepteront de participer à la démarche. Je la vois brève : six mois, après une solide préparation. Le choc ébranlera la banquise.
Il faut mettre l'opinion dans le coup. Le « débat ou les « États généraux ne suffiront pas. Une opération plus vaste pourrait commencer par une campagne de communication. Elle aurait pour objet de rendre l'état plus familier. L'Armée, a su, de longue date, procéder à des opérations « portes
207
ouvertes » ; elles se sont diffusées à d'autres ser- vices. Allons plus loin : ne montrons pas seulement au public des matériels et des locaux, parlons-lui des dossiers et des chantiers auxquels un service est attelé, des objectifs qu'il poursuit et, pourquoi pas, des problèmes qu'il rencontre. Les suggestions faites plus haut, tendant à multiplier les « conseils de citoyens » et à publier les rapports qui leur sont remis, de même qu'à afficher dans tout bureau ouvert au public les objectifs de ce bureau et leur
degré de réalisation, ces suggestions pourraient être assez vite systématisées.
Elles devraient être accompagnées de la présen- tation, à granche échelle, avec l'appui critique des médias, d'expériences en cours pour rendre le sec- teur public performant. Ainsi l'État apparaîtrait plus familier, dans le même temps où sa moderni- sation ne relèverait plus des expériences en labora- toire, ni du projet utopique.
Il ne s'agit pas d'appeler les Français à la res- cousse. Mais d'utiliser les méthodes contem-
poraines de communication pour faire de l'État une question qui les intéresse, à la manière de ce
qui s'est passé, dans les années 1980 pour l'entre-
prise. Que la réforme de l'État devienne une ambi- tion collective! Et qu'on rompe enfin avec cette résignation molle que j'évoquai au début de ce livre.
La réforme de l'État doit entrer en politique. Comme la construction de l'Europe ou la protec- tion de l'environnement, comme la sécurité ou les
208
retraites, comme l'emploi ou l'inflation, elle peut devenir un grand sujet national. Mettre l'Etat sur la place publique, tout commence par là. Le reste, dans son immense complexité, sera chose facile.
CONCLUSION
Nous sommes à la veille en France d'un boule- versement dans l'État. Il est déjà, ici ou là, amorcé. Ce sera, espérons-le, un grand sujet des années 1990, comme la décentralisation l'a été pour les années 1980. La réforme-choc que je suggère fera d'ailleurs écho, sans qu'il soit besoin cette fois d'une grande loi, à celle conduite à la hussarde, en 1982, par Gaston Defferre, père de la décentrali- sation française.
J'ai montré ici que ce n'est pas seulement indis- pensable, mais aussi jouable.
Restent deux conditions à remplir. Que les cadres de la fonction publique ne jettent
pas l'éponge. Aux jeunes qui en éprouveraient la tentation à la sortie de l'ENA, je dis : « Si votre objectif est l'argent, alors partez tout de suite, vous trouverez meilleur compte sous d'autres cieux... pour autant que vous vous débrouilliez bien, car l'Etat, demain, n'aurait été avare ni en traitements
211 1
ni en satisfactions. Si, en revanche, vous tournez casaque parce que le « privé » vous paraît le terri- toire exclusif de l'initiative et de la performance, vous faites fausse route. Dans le service public, on livre de vraies batailles, on prend de vrais risques, on peut être un patron, jugé à ses résultats. Et l'on pourra, de plus en plus, éprouver de grandes joies à piloter de grandes actions.
« Plus votre tempérament vous pousse à regar- der ailleurs, et plus votre place est ici. Plus vous saurez secouer la machine, et plus vous obtiendrez des gratifications à la mesure de votre ambition!
« C'est vrai, le réveil de l'État sera moins facile si vous abandonnez la partie avant même de l'avoir commencée. Cette grande entreprise à laquelle j'appelle se trouve entre vos mains ! »
La seconde condition est entre les mains de la nation. Il faut que les Français y croient. Il faut qu'ils sachent que l'État commence à bouger, que la vieille banquise est en train de craquer.
Il faut que la réforme de l'État devienne l'enjeu de tous les citoyens. Les gouvernements de demain doivent faire de l'État léger, de l'État musclé, un grand projet pour leur action. Comme pour les administrations dont nous avons parlé, il faut ici un Projet, une vue élevée, une ambition nationale, une politique affichée.
Ceci est à la portée du gouvernement qui voudra demain, parce qu'il en aura perçu l'urgence et qu'il en aura le courage, mobiliser les Français sur le renouveau de l'Etat.
212
Oui, un grand souffle apportera à ce renouveau l'élan qui fut imprimé, aux lendemains de la guerre, à la modernisation du pays et, plus récem- ment, à la décentralisation de nos institutions.
Si ce souffle est profond, les Français se met- tront de la partie. Alors, l'État retrouvera sa place en tête de la marche du pays, aussi bien qu'au coeur de la nation. Et celle-ci, comme jadis, nour- rira pour lui confiance et affection. Et cette reconnaissance, en retour, stimulera son propre redressement. La partie sera bien engagée.
Il reste à la lancer. La balle est dans la main du politique.
Préface ...:............................... 9 Introduction ............................... 21
CHAPITRE I La France bouge, l'État patine .. 27 La France qui bouge................. 28 L'État rigide et mou ................. 35
Pourquoi l'État patine ................ 38 CHAPITRE Il L'État vif eziste............... 51
L'exploit au rendez-vous............... 51 Service public, service tonique.......... 59
CHAPITRE III L'État en tête ................ 79 L'État léger ......................... 82 L'État partenaire..................... 92
L'État-plus........................ 99 Vers l'Europe, l'État en tête.......... 104
CHAPITRE IV Sept ressorts pour un État perfor- mant..................................... 111
Des patrons et des hommes............ 116 Des contrats : objectifs clairs et coudées
franches.............................. 129 Pour quoi nous combattons? ........... 145 Service du public, service du client..... 154 Carrières : quel parcours pour les fonction- naires ? ............................. 163 Pas besoin de délier les cordons de la bourse 173 Le coeur à l'ouvrage ................. 180
CHAPITRE V Pour décoincer l'État .......... 191 Lettre à un patron qui s'ignore........ 191 Pour lancer le mouvement............. 199
Conclusion ................................ 209
Cet ouvrage a été réalisé par la SOCIÉTÉ NOUVELLE FIRMIN-DIDOT
Mesnil-sur-l'Estrée pour le compte des Éditions Plon
le 6 novembre 1992
L'État en France se porte mal.
Pléthorique, coûteux, lent, archaïque, inefficace, déconsidéré. Et bientôt dépossédé de son pré carré national par la législation européenne. Or sa nécessité, face aux défis de l'an 2000, n'a jamais été plus impérieuse. Il nous.faut non pas moins d'État, mais un État-plus. Plus moderne, plus léger, plus souple, plus performant.
Robert Lion, brillant serviteur de l'État depuis trente ans, propose une véritable révolution culturelle à l'admi- nistration française et à nos services publics.
Aller jusqu'au bout de la désétatisation : GDF, EDF, Air France, SNCF, Crédit lyonnais, BNP.
Ouvrir la fonction publique aux acteurs du privé. Ren- dre l'État et les services publics compétitifs en leur appli- quant les modes de management de l'entreprise. Une
compagnie de CRS, un prétoire de justice doivent être
gérés selon un authentique projet d'entreprise. Contrat, soucis du client, intéressement, responsa-
bilisation de tous, productivité sont les clés de l'État-
plus. Oui, l'État peut redevenir le grand acteur de pro- grès qu'il fut au siècle dernier et l'ami des Français.
Robert Lion a été directeur de la construction au ministère du Logement, délégué général de l'Union nationale des HLM, directeur de cabinet de Pierre
>on et, enfin, directeur général de la
ou
et consignations.
MGO 2 94178.1 1
ISBN 2-259-02658-3
ÎÎ Î ÎÎ Î Î Î Î 9 782259 026581
Mic';!)1t"ne 92 F