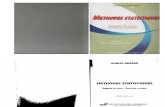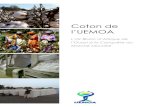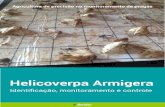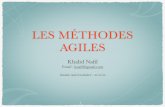PROJET COTON METHODES ALTERNATIVES DE … · L’étude du comportement de H. armigera par rapport...
Transcript of PROJET COTON METHODES ALTERNATIVES DE … · L’étude du comportement de H. armigera par rapport...
PROJET COTON
METHODES ALTERNATIVES DE LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DU COTONNIER AU BENIN
RAPPORT TROISIEME ANNEE : 2009-2010
Avril 2010
2
SOMMAIRE
Sommaire …………………………………………………………………………………………2
Personnel du projet ………………………………………………………………………………3
Institutions partenaires ……………………………………………………………………………4
Etudiants stagiaires ……………………………………………………………………………….5
Abréviations ……………………………………………………………………………...……….6
Résumé ……………………………………………………………………………………………7
Introduction ……………………………………………………………………………………...10
Rapport technique ……………………………………………………………………………….11
Activité 1 : Analyse comparative et choix des méthodes de lutte biologique efficaces ………...11
Activité 2 : Production de Masse pour une diffusion des biopesticides
et la lutte biologique : les travaux de laboratoire ………………………………………………..18
Activité 3 : Plate-forme Echange Information: Formation, Diffusion à large échelle
et Adoption des nouvelles techniques de lutte contre les ravageurs du cotonnier ………………19
3
PERSONNEL DU PROJET (IITA-Bénin)
Dr Manuele Tamò, Entomologiste, Coordonnateur du Projet: Institut International
d’Agriculture Tropicale, 08 B.P. 0932, Cotonou, Rép. du Bénin, tél. +229 350
188, fax +229 350 556, e-mail : [email protected]
Dr Ousmane Coulibaly, Agroéconomiste, Institut International d’Agriculture Tropicale, 08 B.P.
0932, Cotonou, Bénin, tél. +229 21350188, fax +229 21350556, e-mail :
Cathelijne van Melle, Agroéconomiste, Institut International d’Agriculture Tropicale, 08 B.P.
0932, Cotonou, Bénin, tél. +229 21350188, fax +229 21350556, e-mail :
Denis Assouan Djegui, Entomologiste, Spécialiste de la production des entomopathogènes.
Institut International d’Agriculture Tropicale, 08 B.P. 0932, Cotonou, Bénin,
Tél. +229 21350188, fax +229 21350556, e-mail : [email protected].
Ouorou Kobi Douro Kpindou, Entomologiste, Spécialiste de l’application des biopesticides sur
le terrain. Institut International d’Agriculture Tropicale, 08 B.P. 0932,
Cotonou, Bénin, Tél. +229 21350188, fax +229 21350556, e-mail :
Sylvain Anato, Assistant de Projet. Institut International d’Agriculture Tropicale, 08 B.P. 0932,
Cotonou, Bénin, Tél. +229 21350188, fax +229 21350556, e-mail :
Firmin Obognon, Technicien de Recherche. Institut International d’Agriculture Tropicale, 08
B.P. 0932, Cotonou, Bénin, Tél. +229 21350188, fax +229 21350556, e-mail :
Venance Ahomangnon, Technicien de Recherche. Institut International d’Agriculture
Tropicale, 08 B.P. 0932, Cotonou, Bénin, Tél. +229 21350188, fax +229
21350556, e-mail : [email protected]
Robert Ahomangnon. Consultant. Institut International d’Agriculture Tropicale, 08 B.P. 0932,
Cotonou, Bénin, Tél. +229 21350188, fax +229 21350556,
Isidore Kpossoukpè. Chauffeur. Institut International d’Agriculture Tropicale, 08 B.P. 0932,
Cotonou, Bénin, Tél. +229 21350188, fax +229 21350556
4
INSTITUTIONS COLLABORATRICES
OBEPAB: Dr Simplice D.Vodouhè, Socio Anthropologie et Communication. Directeur de l’Organisation
Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique (OBEPAB), 02 B.P.
8033, Cotonou, Bénin, Tél. +229 351 497, fax +229 21360122, e-mail :
INRAB (CRA-CF) : M. Samuel Vodounon, Entomologiste, CRA-CF (INRAB), 01 B.P. 715, Cotonou, Bénin, Tél.
+229 21388086, fax +229 21388396, e-mail : [email protected]
UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI (UAC) : Dr Antonio Sinzogan, Entomologiste, Enseignant-Chercheur ; 01 B.P. 526,
Tél. +229 90 669804, Cotonou, email : [email protected]
UNIVERSITÉ DE LOMÉ, TOGO : Prof. Isabelle Adolé Glitho, Entomologiste, Directrice du Laboratoire d’Entomologie
Appliquée, Département de Zoologie, Faculté des Sciences, B.P. 1515, Lomé,
Togo, Tél. +228 225 50 94 / 910 20 59 – e-mail : [email protected] /
5
ETUDIANTS (STAGIAIRES) :
Serge Maffon Stagiaire. Faculté d’Agronomie, Université de Parakou. B.P. 123, Parakou
e-mail [email protected]
Laura Estelle Loko, Stagiaire, Faculté des Sciences et Techniques, Université d’Abomey
Calavi, 01 B.P. 526 e-mail : [email protected]
Charles Agoï, Stagiaire, Faculté d’Agronomie, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest.
04 B.P. 0330, Cotonou, e-mail : [email protected]
Judicaël, Tchibozo Stagiaire, Faculté des Sciences et Techniques, Université d’Abomey Calavi,
01 B.P. 526, e-mail : [email protected]
Jéronime Ouachinou Stagiaire Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-
Calavi, 01 B.P. 526, e-mail : [email protected]
Laurelle E. Lawson, Université Africaine de Technologie et de Management (UATM) GASA-
FORMATION. B.P. 1373, Abomey-Calavi
e-mail : [email protected]
6
LISTE DES ABREVIATIONS
AFVA : Association des Femmes Vaillantes et Actives de Banikoara
CB : Coton Biologique
CC : Coton Conventionnel
CL : Coton LEC
CRA-CF: Centre de Recherches Agricoles Coton et Fibres
EPAC: Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi
FAST : Faculté des Sciences et Techniques
IITA: Institut International d’Agriculture Tropicale
INRAB: Institut National des Recherches Agricoles du Bénin
LEC : Lutte Etagée Ciblée
OBEPAB: Office Béninois pour la Promotion de l’Agriculture Biologique
PAN-UK: Pesticide Action Net work United Kingdom
SENBIOTECH : Sénégal Biotechnologie
UAC: Université d’Abomey-Calavi, République du BENIN
UL: Université de Lomé TOGO
7
RESUME
Pour cette campagne 2008-2009, les essais avec les plantes pièges ont été reconduits. Les
biopesticides testés avec succès en milieux paysans lors de la campagne 2008-2009, ont été
testés à nouveau en milieux contrôlés et paysans. Les études sur la résistance de Helicoverpa
armigera ont été effectuées dans les départements du Couffo et des Collines. Pour bien cerner le
comportement du ravageur par rapport aux plantes pièges et au cotonnier, des études ont été
menées au laboratoire. Des études sur certains paramètres biologiques du parasitoïde
Habrobracon brevicornis de H. armigera découvert lors de la campagne 2007-2008 ont été
poursuivies en laboratoire et en milieu semi-contrôlé. Plusieurs activités ont été menées dans le
cadre de la plate-forme d’échange d’information.
Tout comme lors de la campagne précédente, la pression parasitaire a été plus faible dans le
Borgou (Okpara) que dans l’Alibori (Angaradébou). Dans le Borgou, aucun seuil n’a été atteint
et aucune différence significative n’a été enregistrée entre les différents traitements.
Comparativement à l’année passée, les traitements ont mieux contrôlé les ravageurs. Les
rendements obtenus ont varié entre 380 kg/ha (cotonnier + rosier d’inde) et 983 kg/ha (coton
conventionnel).
A Angaradébou, les nombres moyens des larves de H. armigera ont été significativement
différents entre le coton conventionnel et le cotonnier traité à l’huile de neem, le cotonnier +
tournesol et le cotonnier traité avec M. anisopliae. Le parasitisme a été similaire pour le coton
conventionnel, le cotonnier + rosier d’inde et le cotonnier traité avec B. bassiana. Les
rendements obtenus sont plus élevés que ceux enregistrés à l’Okpara, malgré une pression
parasitaire plus importante. Le coton conventionnel a eu le rendement le plus élevé avec 1258
kg/ha.
En ce qui concerne l’essai de date de semis, les deuxièmes dates de semis pour les deux plantes
pièges ont attiré le mieux le ravageur. Les nombres moyens cumulés étaient de 1,40 ± 0,15 et de
1,25 ± 0,18 pour respectivement le rosier d’inde 2e semaine et le tournesol 2e semaine. Le rosier
d’inde 1ère semaine a attiré le moins de larves avec un nombre moyen cumulé de 0,80 ± 0,07. Les
rendements étaient de : 765 ± 114 kg/ha (conventionnel), 326 ± 88 kg/ha (cotonnier + tournesol
1ère semaine), 337 ± 69 kg/ha (cotonnier + tournesol 2e semaine), 307 ± 44 kg/ha (cotonnier +
rosier d’inde 1ère semaine) et 214 ± 33 kg/ha (cotonnier + rosier d’inde 2e semaine).
A Kassakou, les nombres moyens de H. armigera ont varié de 0,022 ± 0,001 (coton
conventionnel) à 0,047 ± 0,004 (cotonnier + rosier d’inde). Par ailleurs, aucun seuil n’a été
atteint. Il n’y a eu aucune différence significative entre les différentes pratiques et les rendements
obtenus étaient de 1632 kg/ha, 1199 kg/ha, 1259 kg/ha et 1432 kg/ha pour respectivement le
8
coton conventionnel, le cotonnier traité à l’huile de neem, le cotonnier + tournesol et le cotonnier
+ rosier d’inde.
Le seuil n’a été atteint pour aucun des traitements à Banikoara. Par ailleurs, aucune différence
significative n’a été observée au niveau des organes fructifères pour l’ensemble des traitements
et les rendements ont été globalement les plus élevés. Ils ont varié de 594 ± 71 kg/ha (M.
anisopliae à Goumonri) à 3066 kg ± 99 kg/ha (B. bassiana à Kokey). A Goumonri, le coton
conventionnel et le cotonnier traité au M. anisopliae ont eu les rendements les plus bas avec
respectivement 737 ± 149 kg/ha et 594 ± 71 kg/ha.
Quant à l’étude de la résistance de H. armigera aux pesticides chimiques, la deltaméthrine et la
cyperméthrine ont été retenues. Pour la deltaméthrine, à la dose de 5 µg/flacon, 100% les larves
de H. armigera ont survécu dans le Couffo contre 33,33% dans les Collines. A la dose de
30µg/flacon 33,33% les larves ont survécu dans les deux départements. Aux doses de 7µg/flacon
et de 45 µg/flacon de cyperméthrine, 33,33% des larves collectées dans le Couffo ont survécu,
tandis que celles collectées dans les Collines sont toutes mortes.
L’étude du comportement de H. armigera par rapport aux plantes pièges révèle que les femelles
de H. armigera ont pondu plus sur le tournesol que sur les autres plantes quelque soit la situation
(cas de choix et de non-choix). Dans le cas de choix, le nombre d’œufs pondus a été
significativement faible sur le rosier d’inde au seuil de 5%. Dans le cas de non-choix, les adultes
de H. armigera n’ont pas survécu sur le rosier d’inde.
L’étude des paramètres biologiques de H. brevicornis au laboratoire a révélé que le 3e stade
larvaire de H. armigera est le plus propice pour la production en masse du parasitoïde avec 4,12
± 0,51, 3,81 ± 0,49, 3,67 ± 0,42, 2,50 ± 0,33 et 1,21 ± 0,25 pour respectivement le nombre
moyen de larves du parasitoïde par chenille, le nombre moyen de cocons d’adultes émergés, de
mâles et de femelles. La durée moyenne de développement de H. brevicornis de l’œuf à l’adulte
a été de 7,84 ± 0,97 jours et les périodes pré-ovipositionnellelle, ovipositionnelle et post-
ovipositionnelle ont été respectivement de 2,17±1,03 jours, 21,17±3,71 jours et 2,25±1,86 jours.
L’étude sur l’évaluation de l’impact économique et environnemental des méthodes alternatives
de gestion des ravageurs sur la production et l’environnement pour une meilleure adoption et
diffusion des techniques de lutte a été faite. Cette étude a permis de ressortir que les producteurs
sont conscients de la contribution de l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques à la
dégradation de l’environnement (faune et flore) et à des pertes en vies humaines.
Les producteurs suggèrent des stratégies pour une utilisation durable de l’huile de neem :
plantation d’arbre de neem pour la délimitation des superficies emblavées par exemple.
9
Sur le plan de la formation, les techniciens et les paysans continuent de bénéficier d’une
formation en renforcement des capacités. Les contacts se poursuivent avec l’unité de production
de pesticides biologiques au Sénégal (SENBIOTECH) pour la production des biopesticides
prometteurs. Sous la supervision du Prof. Isabelle Adolé Glitho de l’Université de Lomé, les
deux Associés de Recherche, MM Denis Assouan Djegui et Ouorou Kobi Douro Kpindou
poursuivent les travaux de leur Thèse. Quatre étudiants en fin de cycle d’étude ont fait leur stage
pratique dans le projet : un en licence professionnelle, un en cycle d’ingénieur agronome et deux
en master en entomologie agricole.
La collaboration entre le projet Coton de l’IITA et le projet Coton Alafia de Helvetas se poursuit.
Ainsi, un essai conjoint (IITA-INRAB-Coton Alafia) a été mis en place à Pountchitéga,
arrondissement de Dassari dans commune de Tanguiéta. Par ailleurs, l’appui à l’Association des
Femmes Vaillantes de Banikoara (AFVA) dans le cadre de l’utilisation de l’huile de neem se
poursuit également.
10
INTRODUCTION
Sur la base des résultats satisfaisants obtenus lors de la campagne 2008-2009 dans le cadre de
l’utilisation des plantes pièges, des expérimentations de validation ont été mises en place.
Par ailleurs, après l’atelier de restitution, les cotonculteurs ont suggéré de traiter l’entièreté des
parcelles cotonnier + plantes pièges avec l’huile de neem au lieu d’utiliser les produits chimiques
pour les plantes pièges et l’huile de neem pour l’intérieur des parcelles abritant le cotonnier. En
conséquence, toutes les parcelles mixtes cotonnier-plantes pièges ont été traitées uniquement
avec l’huile de neem.
Etant donné que les biopesticides utilisés en milieux paysans la campagne précédente ont fait
leur preuve, il s’avère nécessaire de voir leur comportement en milieux contrôlés.
Puisque, les résultats précédents n’ont pas explicitement montré le comportement du ravageur H.
armigera par rapport aux plantes pièges et au cotonnier, des expérimentations ont été mises en
place au laboratoire.
Dans l’optique d’une utilisation judicieuse du parasitoïde découvert lors de la campagne 2007-
2008, les études de ses paramètres biologiques commencées l’année précédente, ont été
poursuivies.
Les études sur la résistance de H. armigera aux pesticides chimiques de synthèse, débutées la
campagne précédente dans les départements du Borgou, de l’Alibori et de l’Atacora ont été
poursuivies dans les départements du Couffo et des Collines.
Le présent rapport résume les différents résultats obtenus des différentes expérimentations
conduites en milieux contrôlés et non contrôlés (milieux paysans) et au laboratoire.
11
Rapport Technique
La troisième année du projet a été consacrée aux activités ci-après:
Activité 1: Analyse comparative et choix des méthodes de lutte biologique efficaces.
Activité 2: Production de masse pour une diffusion des biopesticides et la lutte biologique : les
travaux de laboratoire.
Activité 3: Plate-forme Echange Information: Formation, Diffusion à large échelle et Adoption
des nouvelles techniques de lutte contre les ravageurs du cotonnier : (a) étude d'épidémiologie et
de l'écologie des pathogènes (Thèses d'étudiants) ; (b) analyse financière et économique ; (c)
développement de partenariat avec les entreprises privées ; (d) séminaire de restitution aux
différents partenaires (public, privé, ONG, organisations paysannes).
Résultats obtenus
Activité 1: Analyse comparative et choix des méthodes de lutte biologique efficaces.
Tirant leçon des contraintes relevées lors de la campagne 2008-2009, des essais avec les plantes
pièges ont été reconduits dans l’optique de la validation des résultats précédemment obtenus.
Par ailleurs, les biopesticides à base de champignons entomopathogènes (Metarhizium anisopliae
et Beauveria bassiana) testés avec succès en milieu paysan lors de la campagne 2008-2009, ont
été testés à nouveau aussi bien en milieux contrôlés que paysans.
Puisque le degré de résistance de H. armigera par rapport aux insecticides de synthèse varie
selon l’utilisation de ces derniers, les essais précédemment conduits dans les départements de
l’Atacora, du Borgou et de l’Alibori, ont été reconduits dans les départements du Couffo et des
Collines.
Milieux contrôlés
Pour ces milieux, six traitements ont été mis en place comme suit : coton conventionnel,
cotonnier traité avec l’huile de neem, cotonnier + rosier d’inde, cotonnier + tournesol, cotonnier
traité avec M. anisopliae et cotonnier traité avec B. bassiana. Ces traitements ont été répétés 4
fois. Les superficies parcellaires étaient de 352 m² (20 m x 17,6 m). Les doses d’application, sur
seuil, étaient de 0,5 litre/ha pour l’huile de neem et 50 g/ha pour les biopesticides. Les parcelles
de cotonnier avec les plantes pièges ont été traitées à l’huile de neem. Les paramètres suivants
ont été mesurés : la présence des chenilles carpophages, principalement H. armigera, les dégâts
12
des organes fructifères ainsi que la présence de ces carpophages dans ces organes et enfin le
rendement.
Okpara-Parakou
La présence des ravageurs a été faible pour tous les traitements. Le seuil (5 H. armigera pour 40
plantes de cotonnier) recommandé par le CRA-CF en Lutte Etagée Ciblée (LEC) n’a pas été
atteint.
Le nombre moyen de larves de H. armigera a été de 0,003 ± 0,002, 0,002 ± 0,002, 0,005 ±
0,003, 0,004 ± 0,004, 0,003 ± 0,002, 0,009 ± 0,002 pour respectivement le coton conventionnel,
le cotonnier traité à l’huile de neem, le cotonnier + tournesol, le cotonnier + rosier d’inde, le
cotonnier traité avec B. bassiana et le cotonnier traité avec M. anisopliae. Aucune différence
significative n’a été observée entre les traitements au seuil de 5% (F5,15 = 0,74 ; P = 0,6036). De
la même manière, le nombre moyen des autres carpophages a été faible et aucun traitement n’a
atteint le seuil de 10 larves par 40 plantes de cotonnier.
Le tournesol a attiré les ravageurs plus tôt que le rosier d’inde, dû au fait que le tournesol a
connu une maturité précoce. Ceci explique le faible dégât enregistré au niveau des boutons
floraux des parcelles de cotonnier avec le tournesol.
Les dégâts ont été plus importants pour les capsules que pour les boutons floraux du fait du
nombre plus important de carpophages dans les capsules. Le coton conventionnel et le cotonnier
traité avec le biopesticide Metarhizium ont eu des dégâts similaires au niveau des boutons
floraux. Les dégâts au niveau des capsules ont été presque les mêmes pour le coton
conventionnel et le cotonnier traité à l’huile de neem.
Les rendements ont varié entre 380 kg/ha (cotonnier + rosier d’inde) et 983 kg/ha (coton
conventionnel). Le rendement du coton conventionnel a dépassé de loin les rendements au
niveau des autres traitements (F5,15 = 7,52 ; P = 0,0010).
Angaradébou - Kandi
La densité parasitaire a été plus importante à Angaradébou (Kandi) qu’à l’Okpara (Parakou). Le
nombre moyen de larves de H. armigera a été de 0,056 ± 0,030, 0,176 ± 0,078, 0,127 ± 0,056,
0,199 ± 0,087, 0,131 ± 0,062, 0,188 ± 0,076 pour respectivement, le coton conventionnel, le
cotonnier traité à l’huile de neem, le cotonnier + tournesol, le cotonnier + rosier d’inde, le
cotonnier traité avec B. bassiana et le cotonnier traité avec M. anisopliae. Ces nombres moyens
de H. armigera ont été significativement différents entre le coton conventionnel et le cotonnier
traité à l’huile de neem, le cotonnier + tournesol et enfin le cotonnier traité avec M. anisopliae
13
(F5,15 = 4,75 ; P = 0,0084). Le seuil a été dépassé pour tous les traitements, sauf pour le
conventionnel. Ceci est dû au retard accusé dans le traitement des autres parcelles. Aucune
différence significative n’a été observée ni pour Earias spp, ni pour Diparopsis watersi (F5,15 =
0,43 ; P = 0,8228 et F5,15 = 0,28 ; P = 0,9151).
Le rosier d’inde a attiré plus les ravageurs que le tournesol qui est d’ailleurs arrivé plus tôt à
maturation.
Tout comme à l’Okpara, les dégâts au niveau des capsules ont été plus élevés qu’au niveau des
boutons floraux. Pour tous ces organes fructifères, le coton conventionnel a enregistré moins de
dégâts. Les taux de dégâts ont été similaires au niveau des autres traitements.
Quant à la présence des carpophages dans les organes fructifères, la tendance a été la même que
pour les observations directes sur les plantes.
Les rendements obtenus au niveau de ce site sont plus élevés que ceux obtenus à l’Okpara,
malgré une pression parasitaire plus importante observée. Ceci serait probablement dû à des
facteurs autres que les ravageurs. Le coton conventionnel a eu le rendement le plus élevé avec
1258 kg/ha (F5,15 = 5,70 ; P = 0,0039) (Annexe 1).
La différence enregistrée au niveau des dégâts des capsules et des rendements entre le coton
conventionnel et les autres traitements dans les deux sites serait due, d’une part, à la nature des
pesticides utilisés et d’autre part, à l’approche utilisée dans l’application de l’huile de neem et
des biopesticides. En effet, non seulement les pesticides chimiques utilisés sont systémiques et
ont un large spectre, mais leur volume d’application, qui est de 10 litres à l’hectare, permet une
bonne couverture végétale. Quant aux biopesticides, ils sont, non seulement, non-systémiques
mais leur volume d’application a été faible ( ne pouvant pas ainsi bien couvrir la végétation),
surtout durant la période d’apparition des capsules, moment où la marche dans le champ est
difficile. De plus, les biopesticides sont spécifiques. D’ailleurs, à Angaradébou, on a observé,
une augmentation du nombre d’araignées, de coccinelles et de fourmis dans les parcelles traitées
au M. anisopliae et au B. bassiana contrairement aux parcelles du coton conventionnel.
Néanmoins, on a constaté une diminution de la densité de population des ravageurs ciblés, à
chaque fois que les biopesticides ont été appliqués. Pour ce faire, des approches dans
l’application des biopesticides doivent être mieux étudiées, surtout que nous ne sommes qu’au
début : il s’agira alors de revoir la dose, le volume et les moments d’application.
A l’Okpara, le rendement a été faible par rapport à celui de la campagne 2008-2009. Ceci serait
dû à la pauvreté du sol. En effet, l’endroit qui nous a été attribué a été occupé, plusieurs fois de
suite, par des champs de maïs sans fumure organique ni chimique.
14
Pour le site d’Angaradébou, comparativement à l’année précédente, le rendement a été meilleur,
car c’est le champ qui a bénéficié de la fumure chimique la campagne précédente qui a été utilisé
cette année.
Etude des dates de semis des plantes pièges
Tout comme la campagne 2008-2009, une expérimentation sur les dates de semis des plantes
pièges a été mise en place à Angaradébou en vue de cerner les dates appropriées pour une
meilleure attraction de H. armigera. Ainsi, deux dates ont été retenues : une semaine et deux
semaines après le semis du cotonnier.
Les superficies parcellaires de 352 m² chacune ont abrité 5 traitements qui sont : le coton
conventionnel, le cotonnier + tournesol 1ère semaine, le cotonnier + tournesol 2e semaine, le
cotonnier + rosier d’inde 1ère semaine, le cotonnier + rosier d’inde 2e semaine. Ces traitements
ont été répétés 4 fois. Les parcelles à plantes piège ont été traitées à l’huile de neem à la dose de
0,5 litre par ha. Les paramètres mesurés sont identiques à ceux observés pour les autres
expérimentations.
Le nombre moyen de larves de H. armigera observées par cotonnier étaient de 0,036 ± 0,004,
0,069 ± 0,009, 0,081 ± 0,012, 0,082 ± 0,011, 0,092 ± 0,005 pour respectivement le coton
conventionnel, le cotonnier + tournesol 1ère semaine, le cotonnier + tournesol 2e semaine, le
cotonnier + rosier d’inde 1ère semaine, le cotonnier + rosier d’inde 2e semaine. Le coton
conventionnel a eu le moins de larves du principal ravageur. Le seuil n’a été atteint pour aucun
des carpophages, et ceci pour tous les traitements.
Les deuxièmes dates de semis pour les deux plantes pièges ont attiré le mieux le ravageur. Les
nombres moyens cumulés étaient de 1,40 ± 0,15 et de 1,25 ± 0,18 pour respectivement le rosier
d’inde 2e semaine et le tournesol 2e semaine. Le rosier d’inde 1ère semaine a attiré le moins de
larves avec un nombre moyen cumulé de 0,80 ± 0,07.
Les taux de dégâts enregistrés au niveau des capsules ont été plus élevés qu’au niveau des
boutons floraux. Comparativement aux pratiques, le conventionnel a eu un taux de dégât
significativement moins élevé au niveau des capsules (F4,12 = 6,13 ; P = 0,0063).
H. armigera, Earias spp., D. watersi, sont les carpophages observés dans les organes fructifères.
On note une variabilité dans le parasitisme de ces organes. Ainsi, la présence de H armigera a
été similaire dans les boutons floraux pour le coton conventionnel et le cotonnier + rosier d’inde
1ère semaine, tandis qu’au niveau des capsules, cette présence a été significativement moindre
pour le conventionnel.
Les rendements obtenus ont été de 765 ± 114 kg/ha (coton conventionnel), 326 ± 88 kg/ha
(cotonnier + tournesol 1ère semaine), 337 ± 69 kg/ha (cotonnier + tournesol 2e semaine), 307 ± 44
15
kg/ha (cotonnier + rosier d’inde 1ère semaine) et 214 ± 33 kg/ha (cotonnier + rosier d’inde 2e
semaine).
Il a été observé que le tournesol attire pour les deux dates, mais à la première date, il arrive
rapidement à la fanaison, surtout à un moment où H. armigera fait son apparition.
Quant au rosier d’inde, il attire dès les premières éclosions de H. armigera, lorsqu’il est semé
une semaine après le semis du cotonnier. A la deuxième date, le rosier d’inde attire également,
mais pas suffisamment pour protéger le cotonnier. Ceci s’explique par le fait que les adultes du
ravageur préfèrent pondre sur le cotonnier avant que les larves, après éclosion, ne migrent vers le
rosier (voir étude au laboratoire ci-dessous). Ces observations traduisent les rendements obtenus
(Annexe 2).
Deux semaines après le semis du cotonnier est alors la date à laquelle il faut semer les plantes
pièges pour mieux attirer le principal ravageur H. armigera. Cependant, il est nécessaire
d’appliquer tout le champ à bonnes dates pour éviter la migration du ravageur des plantes pièges
vers le cotonnier.
Milieux non-contrôlés
Ici, deux types d’expérimentations ont été mises en place. A Kassakou (Kandi), le système de
plantes pièges a été comparé au traitement à l’huile de neem et au coton conventionnel. Par
contre, à Banikoara, ce sont les biopesticides à base de champignons entomopathogènes (M.
anisopliae et B. bassiana) qui ont été comparés au traitement à l’huile de neem et au coton
conventionnel.
Kassakou - Kandi
Trois paysans ont abrité l’expérimentation. Chacune des pratiques a été représentée chez chaque
paysan. Les superficies parcellaires étaient d’un quart d’ha chacune. L’huile de neem a été
appliquée, sur seuil, à la dose de 0,5 litre par hectare. Les observations faites sont identiques à
celles des milieux contrôlés. Les champs des paysans étant très rapprochés, les analyses ont été
regroupées.
Le nombre moyen de larves de carpophages observées par cotonnier a été moins élevé à
Kassakou qu’à Angaradébou. Pour H. armigera, ce nombre a varié entre 0,022 ± 0,001 (coton
conventionnel) et 0,047 ± 0,004 (cotonnier + rosier d’inde). Malgré la différence significative
(F3,6 = 22,40; P = 0,012) enregistrée entre le coton conventionnel et les autres pratiques, le seuil
n’a été atteint pour aucune d’entre elles. Quant aux autres carpophages, aucune différence
16
significative n’a été observée (F3,6 = 2,00; P = 0,2156, F3,6 = 1,41; P = 0,3280, F3,6 = 0,23; P =
0,8718).
Comme en milieu contrôlé, le rosier d’inde a beaucoup plus attiré les larves de H. armigera que
le tournesol.
Les taux moyens de dégâts sur les organes fructifères (boutons floraux et capsules) sont plus
faibles à Kassakou que dans les milieux contrôlés. Au niveau de chacun des organes, ces dégâts
sont presque les mêmes pour toutes les pratiques.
La présence de chacun des carpophages a été similaire pour tous les traitements.
Les rendements sont de 1632 kg/ha, 1199 kg/ha, 1259 kg/ha et 1432 kg/ha pour respectivement
le coton conventionnel, le cotonnier traité à l’huile de neem, le cotonnier + tournesol et le
cotonnier + rosier d’inde. Il n’y a eu aucune différence significative entre les différentes
pratiques (F3,6 = 3,96, P = 0,0715) (Annexe 3).
Les rendements sont passés d’un minimum de 432 kg/ha (2008-2009) à un minimum de 1199
kg/ha et d’un maximum de 681 kg/ha (2008-2009) à un maximum de 1632 kg/ha. On doit cette
augmentation des rendements à l’adoption qu’en ont faite, les producteurs après deux années
consécutives d’expériences.
Banikoara
Les essais ont été mis en place chez six paysans. Tout comme à Kassakou, chacun d’eux a abrité
toutes les pratiques à savoir : le coton conventionnel, le cotonnier traité à l’huile de neem, le
cotonnier traité au M. anisopliae et le cotonnier traité au B. bassiana. Les superficies parcellaires
étaient d’un quart d’ha par traitement. Les biopesticides étaient des formulations huileuses
(70:30, pétrole: huile) appliquées à un volume de 2 litres par hectare. L’huile de neem a été
appliquée à un volume de 0,5 litre/ha. La présence des chenilles carpophages sur le cotonnier et
sur ses organes fructifères, les dégâts sur les organes fructifères et les rendements étaient les
paramètres mesurés. Compte tenu de la disparité des champs des paysans, les analyses ont été
faites séparément.
D’une manière générale, le seuil n’a été atteint pour aucun des traitements à Banikoara.
Cependant, à Founougo, le nombre de H. armigera a été significativement supérieur pour le
coton conventionnel en comparaison avec les autres pratiques (F3,6 =5,08, P = 0,0438).
En dehors du site de Founougo, les taux de dégâts ont été plus élevés pour les capsules que pour
les boutons floraux. Ces taux ont varié de 0,8% (Huile de neem à Kokey) à 21% (B. bassiana à
Founougo) pour les boutons floraux et de 3% (huile de neem à Founougo) à 18% (coton
conventionnel à Godou) pour les capsules.
17
Pour l’ensemble des traitements, aucune différence significative n’a été constatée quant à la
présence des chenilles dans les organes fructifères (capsules et boutons floraux).
Malgré la disparité des champs des paysans, les rendements ont été globalement les plus élevés.
Ils ont varié de 594 ± 71 kg/ha (M. anisopliae à Goumonri) à 3066 kg ± 99 kg/ha (B. bassiana à
Kokey). Pour chaque site pris séparément, les rendements ont été similaires pour toutes les
pratiques. Cependant, à Goumonri, le coton conventionnel et le cotonnier traité au M. anisopliae
ont eu les rendements les plus bas avec respectivement 737 ± 149 kg/ha et 594 ± 71 kg/ha
(Annexe 4).
Ici, à Banikoara, les deux producteurs qui ont eu les meilleurs rendements (Godou et Kokey), ont
procédé à un parcage des bœufs pour renforcer la fumure chimique. Ceci s’est manifesté par une
vigueur des plantes. Etant des producteurs expérimentés, les semis et les applications des
pesticides ont été faits à bonnes dates.
Etude de la résistance de H. armigera aux pesticides chimiques
Une enquête au niveau paysan nous a permis de retenir deux insecticides de synthèse utilisés
pour la gestion de H. armigera. Il s’agit de la cyperméthrine et de la deltamethrine utilisées pour
étudier la sensibilité du ravageur. Les travaux en laboratoire nous ont permis de retenir deux
doses à tester sur le terrain : 7 µg/flacon et 45 µg/flacon pour la cyperméthrine, 5 µg/flacon et 30
µg/flacon pour la deltaméthrine.
Pour la deltaméthrine, à la dose de 5 µg/flacon, 100% des larves de H. armigera ont survécu
dans le Couffo contre 33,33% dans les Collines. A la dose de 30µg/flacon 33,33% des larves ont
survécu dans les deux départements.
Quant à la cypermethrine, aux doses de 7µg/flacon et de 45 µg/flacon, 33,33% des larves
collectées dans le Couffo ont survécu, tandis que celles collectées dans les Collines sont toutes
mortes (Annexe 5).
La zone dans laquelle l’étude a été effectuée dans le Couffo, est une zone de grande production
de tomate où les producteurs utilisent des quantités importantes de pyréthrinoides, raison pour
laquelle la Société de distribution des intercontinentale (SDI) a introduit un autre pesticide
chimique, le pacha (Lambdacyhalothrine 15 g/l + Acetamipride 10 g/l). La résistance observée
dans ce milieu est plus élevée que celle observée dans les zones cotonnières du Bénin
septentrional.
Dans le département des Collines, l’étude a été effectuée dans la zone cotonnière. Le coton étant
de plus en plus abandonné, les insectes sont devenus de plus en plus sensibles. Ainsi, la
18
résistance observée dans cette zone est moins élevée par rapport à celle observée dans les zones
cotonnières du Nord-Bénin.
Activité 2: Production de masse pour une diffusion des biopesticides et la lutte biologique : les
travaux de laboratoire.
Comportement de H. armigera par rapport aux plantes pièges
Le comportement du ravageur par rapport aux plantes pièges (rosier d’inde et tournesol) et même
au cotonnier, n’étant pas bien cerné, des études ont été conduites pour la maîtrise de leur
utilisation.
Ainsi, la préférence pour l’oviposition de H. armigera, dans un système de choix et de non-
choix, a été étudiée sur trois plantes. En effet, le rosier d’inde et le tournesol ont été utilisés
comme plantes pièges pour la gestion du ravageur. Les plantes de cotonnier, de tournesol et de
rosier d’inde contenues dans des cages en serre ont été infestées avec un jeune couple de H.
armigera par cage : soit les plantes sont placées ensemble (cas de choix), soit séparément (cas de
non-choix). Les cages ont été disposées dans un dispositif expérimental de bloc complètement
aléatoire avec 3 répétitions. Les observations ont porté sur le nombre d’œufs pondus toutes les
72 heures. En général, les femelles de H. armigera ont plus pondu sur le tournesol que sur les
autres plantes quelque soit la situation. Pour le cas de choix, le nombre total moyen d’œufs
pondus par H. armigera était de 141,7 ± 79,3 sur le cotonnier, 145,3 ± 50,4 sur le tournesol, et de
18,7 ± 3,4 sur le rosier d’inde. Le nombre d’œufs pondus a été significativement très faible sur le
rosier d’inde au seuil de 5%. Quant au non-choix, le nombre total moyen d’œufs pondus par H.
armigera était de 211,7 ± 108,4 et 383,3 ± 116,0 sur le cotonnier et sur le tournesol
respectivement. Les femelles de H. armigera n’ont pas pu survivre sur le rosier d’inde dans le
cas de non-choix. Les résultats obtenus au cours de la présente étude montrent que H. armigera
préfère pondre sur le tournesol suivi du cotonnier quelque soit le système mis en place (choix ou
non-choix). Quant au rosier d’inde, il ne favorise pas la survie des adultes du ravageur. Les
résultats de cette étude montrent également que dans un système cotonnier + rosier d’inde, les
adultes du ravageur pondent d’abord sur le cotonnier et ce sont les larves qui, après éclosion,
migrent vers le rosier d’inde. Ceci pourrait expliquer le fait que, malgré la forte présence des
larves dans le rosier d’inde, le cotonnier continue d’abriter un nombre important de larves dans
le système cotonnier + rosier d’inde que dans celui du cotonnier + tournesol (Annexe 6).
19
Etude de certains paramètres biologiques du parasitoïde Habrobracon brevicornis
Lors de nos prospections durant la campagne 2007-2008, un parasitoïde de H. armigera,
Habrobracon brevicornis, a été découvert et a fait l’objet d’études de certains paramètres
biologiques en laboratoire en vue de son utilisation sur le terrain. Ces études ont été poursuivies
cette année, toujours en vue de son utilisation sur le terrain.
Différents paramètres biologiques du parasitoïde ont été étudiés en conditions de laboratoire et
en serre: le taux de son parasitisme sur les différents stades larvaires de H. armigera afin d’en
dégager le meilleur pour une production de masse, son parasitisme en fonction de la densité
larvaire, son parasitisme dans les conditions de serre en fonction des ses stades larvaires
préférentielles et enfin son cycle biologique. Cette étude des potentialités biologiques de H.
brevicornis au laboratoire a révélé une différence significative du parasitisme en fonction des
stades larvaires de H. armigera. Le 3e stade larvaire de H. armigera étant le meilleur pour la
production en masse du parasitoïde avec 4,12 ± 0,51, 3,81 ± 0,49, 3,67 ± 0,42, 2,50 ± 0,33 et
1,21 ± 0,25 pour respectivement le nombre moyen de larves du parasitoïde par chenille, le
nombre moyen de cocons d’adultes émergés, de mâles et de femelles. Les femelles du
parasitoïde ont vécu plus longtemps en présence des hôtes plus petits (stade L1) avec une durée
de vie moyenne de 28,3±2,8 jours. De même, une diminution significative du parasitisme en
fonction de la densité à été observée. Deux larves de l’hôte fournies toutes les 24 heures à une
femelle ont donné de meilleurs résultats pour la production de masse. Cependant, le sex-ratio a
été significatif en faveur des mâles. Les résultats ont fait ressortir que la durée moyenne de
développement de H. brevicornis de l’œuf à l’adulte a été de 7,84 ± 0,97 jours. Concernant la vie
reproductive de la femelle, la période pré-ovipositionnellelle, ovipositionnelle et post-
ovipositionnelle ont été respectivement de 2,17±1,03 jours, 21,17±3,71 jours et 2,25±1,86 jours
(Annexe 7).
La durée de développement beaucoup plus courte que celle de son hôte, la facilité d’être élevé en
captivité et la constance de sa vigueur dans des élevages en continu sont les principaux avantages
de ce parasitoïde en lutte biologique.
Activité 3: Plate-forme Echange Information: Formation, Diffusion à large échelle et Adoption
des nouvelles techniques de lutte contre les ravageurs du cotonnier : (a) étude d'épidémiologie et
de l'écologie des pathogènes (Thèses d'étudiants) ; (b) analyse financière et économique: impact
environnemental et économique des méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs du
20
cotonnier au Bénin; (c) développement de partenariat avec les entreprises privées ; (d) séminaire
de restitution aux différents partenaires (public, privé, ONG organisations paysannes).
Analyse financière et économique : Impact environnemental et économique des méthodes
alternatives de lutte contre les ravageurs du cotonnier au Bénin
L’objectif général de la présente étude est d’évaluer l’impact économique et environnemental
des méthodes alternatives de gestion des ravageurs sur la production et l’environnement pour une
meilleure adoption et diffusion des techniques de lutte.
Les objectifs spécifiques sont :
• Etudier la rentabilité économique des méthodes alternatives de gestion des ravageurs du
cotonnier ;
• Evaluer les impacts environnementaux des méthodes alternatives de gestion des
ravageurs du cotonnier.
Un échantillon de 64 producteurs a été retenu dans les villages de Kassakou et Padé (commune
de Kandi), de Founougo, Goumonri, Godou Goussirou, Sompérékou et Ounet (commune de
Banikoara) et de Alafiarou (commune de Parakou).
Le choix des exploitations agricoles a été fait de façon raisonnée et les critères retenus étaient la
superficie emblavée en coton, le niveau d’équipement des exploitations, la technique culturale et
le type de protection phytosanitaire. Le transect et le focus groupe ont permis d’évaluer l’impact
environnemental avec un échantillon de 15 personnes par localité composé de producteurs, de
responsables d’organisation de producteurs, d’agents de vulgarisation agricole, de sages, de
responsables politico-administratifs locaux, de responsables d’association de femmes.
La production de coton au Bénin se fait suivant trois itinéraires techniques qui déterminent les
trois grands systèmes de production : le coton conventionnel (CC), l’approche lutte étagée ciblée
(CL) et le coton biologique (CB).
Le coton conventionnel (CC) utilise de grandes quantités d’intrants chimiques (engrais,
insecticides et herbicides). Dans ce système, la gestion des ravageurs est de type calendaire.
Le coton LEC (CL) utilise également les produits chimiques. Il se distingue du coton
conventionnel par son mode de gestion des ravageurs qui se fait sur seuil.
Quant au coton biologique (CB), il n’utilise pas de produits chimiques, mais des intrants
organiques (engrais, extraits aqueux des végétaux, huiles végétales, biocides, plantes pièges,
ennemis naturels).
La grande pression observée sur les ressources forestières est due aux activités anthropiques
(agriculture et urbanisme). Par exemple à Simperou (Banikoara), on est passé de plus de 8 km²
de forêt en 1999 à moins de 4 km² en 2009, soit une régression de 4 km² en 10 ans (résultats de
21
l’enquête). La culture cotonnière est essentiellement à la base de cette déforestation (22 km² de
champs de coton sur les 28 km² occupés par toutes les cultures à Alafiarou en 1999).
Selon les producteurs, la disparition des animaux est due à plusieurs facteurs tels que : les feux
de brousse, la chasse abusive, le déboisement (activités agricoles, bois de chauffe, bois d’œuvre),
utilisation abusive des pesticides chimiques, etc.
Les résultats montrent que les producteurs utilisateurs ou non des pesticides chimiques ont une
bonne connaissance des méfaits de l’usage de ces produits sur l’environnement. Ces producteurs
imputent la baisse de la fertilité des sols aux pesticides chimiques utilisés pour la production de
coton. En effet, ils détruisent la flore microbienne du sol. Par ailleurs, les écosystèmes
aquatiques sont pollués par les produits chimiques du coton.
Les utilisateurs desdits produits développent souvent des malaises de santé dont les principaux
symptômes sont : maux de ventre, démangeaisons, rhume, brûlures du corps, vertige, nausées,
asthénie, etc.
L’impact économique montre que les producteurs du système CC (grands ou petits exploitants)
dépensent plus d’argent (environ 7000 FCFA) pour recevoir des soins dans les formations
sanitaires.
Les producteurs des systèmes CC et LEC sont bien informés des nombreux cas de morts
d’hommes et d’animaux domestiques suite aux intoxications dues aux insecticides chimiques de
coton.
Quant aux méthodes alternatives de gestion, les producteurs déclarent que l’utilisation des
intrants organiques occasionne moins de dépenses pour leur acquisition et moins de dépenses
pour la santé. Par ailleurs, le coton est acheté au comptant. Avec cette méthode, la flore
microbienne, la faune terrestre et aquatiques sont sauvegardées.
La promotion de l’huile de neem favorise l’accroissement du peuplement de l’arbre de neem
(reboisement des plantes de neem). L’huile de neem est utilisée à des fins médicinales,
phytosanitaires, cosmétique, etc. Le Tournesol, plante piège, en dehors de sa fonction de
protection des plantes de cotonniers contre les ravageurs, est utilisé dans l’alimentation et en
médecine. Le système CB, utilisant les méthodes alternatives, présente peu d’externalités
négatives pour la santé et l’environnement.
L’analyse économique montre que la politique n’offre des mesures incitatives qu’aux
producteurs du système CC. Il convient de recommander la diffusion à grande échelle des
méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs de cotonnier par la prise des mesures
incitatives et l’intéressement des opérateurs économiques dans la production, la distribution et la
promotion des méthodes alternatives.
22
En somme, les producteurs affirment que l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques
contribue à la dégradation de l’environnement (faune et flore) et à des pertes en vies humaines.
Les producteurs suggèrent des stratégies pour une utilisation durable de l’huile de neem :
plantation d’arbre de neem pour la délimitation des superficies emblavées. C’est dans cette
logique que depuis deux ans, le village de Simperou (Banikoara) bénéficie de l’appui de
l’Association des Femmes Vaillantes et Actives (AFVA) pour le reboisement des arbres de neem
selon le slogan «chaque producteur un arbre de neem» (Annexe 8).
Développement de partenariat avec les entreprises privées
Poursuite des contacts avec l’Unité de production de pesticides biologiques au Sénégal
(SENBIOTECH) pour la production des souches prometteuses de Metarhizium et de Beauveria.
Séminaire de Restitution aux producteurs
Deux ateliers de restitution des résultats ont été organisés à Kandi et Banikoara, respectivement
le 24 et le 25 mars 2010. Les deux ateliers qui ont débuté, l’un à 9h30mn et l’autre à 10h et qui
ont pris fin entre 11h et 12h avaient pour objectif de présenter aux producteurs les résultats
obtenus, de recenser les difficultés rencontrées et les doléances. Ces ateliers ont permis
également de notifier aux producteurs la fin de la première phase du projet et de recueillir leurs
impressions sur les perspectives pour une deuxième phase (Annexe 9 & 10).
Etude d'épidémiologie et de l'écologie des pathogènes (Thèses d'étudiants)
Sous la supervision du Prof. Isabelle Adolé Glitho, les deux Associés de Recherche, MM Denis
Assouan Djegui et Ouorou Kobi Douro Kpindou poursuivent les travaux de leur Thèse à la
Faculté des Sciences de l’Université de Lomé, Option Entomologie d’Intérêt Agricole.
Cette année, quatre étudiants en fin de cycle d’étude ont fait leur stage pratique dans le projet :
un en licence professionnelle, un en cycle d’ingénieur agronome et deux en master en
entomologie agricole.
Les techniciens et les paysans continuent de bénéficier d’une formation continue en
renforcement de capacité.
Collaboration
La collaboration entre le projet Coton de l’IITA et le projet Coton Alafia de Helvetas se poursuit.
C’est ainsi qu’un essai conjoint (IITA-INRAB-Coton Alafia) a été mis en place à Pountchitéga,
arrondissement de Dassari dans commune de Tanguiéta (Annexe 11). Par ailleurs, l’appui à