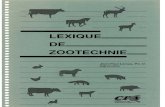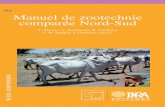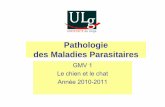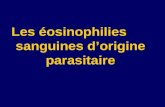PRODUCTION OVINE ET MISE SOUS ASSURANCE …oatao.univ-toulouse.fr/135/1/wawrzyniak_135.pdf · Mlle...
Transcript of PRODUCTION OVINE ET MISE SOUS ASSURANCE …oatao.univ-toulouse.fr/135/1/wawrzyniak_135.pdf · Mlle...

ANNEE 2001 THESE : 01 – TOU 3 - 4018
__________________________________________________________________________________________
PRODUCTION OVINE ET MISE SOUS ASSURANCE QUALITE :
L’EXEMPLE DE L’AGNEAU DE L’ADRET__________________
THESEpour obtenir le grade de
DOCTEUR VETERINAIRE
DIPLOME D’ETAT
présentée et soutenue publiquement en 2001devant l’Université Paul-Sabatier de Toulouse
par
Sidonie, Françoise LEFEBVREnée le 28 décembre 1973 à CAMBRAI
___________________
Directeur de thèse : M. le Docteur SANS
____________________
JURY
PRESIDENT : M..DABERNAT Professeur à l’Université Paul Sabatier de TOULOUSE
MEMBRES :M.SANS Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSEM.BRUGERE Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE

A notre président de thèse
Monsieur le Professeur Henri DABERNAT
Professeur des Universités
Praticien hospitalier
Bactériologie,Virologie
A notre jury de thèse
Monsieur le Docteur Pierre SANS
Maître de conférences de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
Productions animales
Qui nous a soutenu dans la réalisation de ce travail.
En remerciement pour sa collaboration.
Monsieur le Docteur Hubert BRUGERE
Maître de conférences de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d’Origine Animale
Qui a bien voulu accepter de faire partie de notre jury de thèse.
2

En remerciement pour son enseignement.
A Céline, sans qui cette étude n’aurait jamais vu le jour.
A Muriel, dont les compétences professionnelles sont à la hauteur de sa gentillesse et de son humour en toutes circonstances.
A Jérôme, sans qui je ne serais toujours qu’une étudiante pas finie.
A mes parents, pour leur soutien permanent parfois trop discret.
A celui qui a le courage de partager le quotidien souvent houleux d’une thésarde nantie d’une activité professionnelle.
A Gérard, qui m’a appris le terrain, et à Annie, for ever.
A Anne, dont la gentillesse n’a d’égale que son énergie.
A tous ceux qui m’ont fait aimer le mouton.
A tous ceux qui m’ont soutenue dans ma double tâche professionnelle et estudiantine.
3

A Stanislas, Christian, Philippe, Vincent, Didier, Michel, en souvenir des journées de terrain et des contrôles abattoirs....
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE
Directeur par intérim : M. G. BONNESDirecteurs honoraires……. : M. R. FLORIO
M. R. LAUTIE M. J. FERNEY M. G. VAN HAVERBEKE
Professeurs honoraires…..: M. A. BRIZARD M. L. FALIU M. C. LABIE M. C. PAVAUX M. F. LESCURE M. A. RICO
PROFESSEURS CLASSE EXCEPTIONNELLE
M. CABANIE Paul, Histologie, Anatomie pathologiqueM. CAZIEUX André, (sur nombre) Pathologie chirurgicaleM. DORCHIES Philippe, Parasitologie et Maladies ParasitairesM. GUELFI Jean-François, Pathologie médicale des Equidés et Carnivores
PROFESSEURS 1ère CLASSE
M. AUTEFAGE André, Pathologie chirurgicaleM. BENARD Patrick, Physique et Chimie biologiques et médicalesM. BODIN ROZAT DE MANDRES NEGRE Guy, Pathologie générale, Microbiologie, ImmunologieM. BRAUN Jean-Pierre, Physique et Chimie biologiques et médicalesM. CHANTAL Jean, Pathologie infectieuseM. DARRE Roland, Productions animalesM. DELVERDIER Maxence, Histologie, Anatomie pathologiqueM. EECKHOUTTE Michel, Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine AnimaleM. EUZEBY Jean, Pathologie générale, Microbiologie, ImmunologieM. FRANC Michel, Parasitologie et Maladies ParasitairesM. GRIESS Daniel, AlimentationM. MILON Alain, Pathologie générale, Microbiologie, ImmunologieM. PETIT Claude, Pharmacie et ToxicologieM. REGNIER Alain, Physiopathologie oculaire
4

M. SAUTET Jean, AnatomieM. TOUTAIN Pierre-Louis, Physiologie et Thérapeutique
PROFESSEURS 2e CLASSE
Mme BENARD Geneviève, Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine AnimaleM. BERTHELOT Xavier, Pathologie de la ReproductionM. CORPET Denis, Science de l'Aliment et Technologies dans les industries agro-alimentairesM. DUCOS DE LAHITTE Jacques, Parasitologie et Maladies parasitairesM. ENJALBERT Francis, AlimentationM. LIGNEREUX Yves, AnatomieM. MARTINEAU Guy, Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de basse-courM. PICAVET Dominique, Pathologie infectieuseM. SCHELCHER François, Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de basse-cour
PROFESSEUR CERTIFIE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Mme MICHAUD Françoise, Professeur d'AnglaisM. SEVERAC Benoît, Professeur d'Anglais
2 MAITRES DE CONFERENCES HORS CLASSE
M. JOUGLAR Jean-Yves, Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de basse-cour
MAITRES DE CONFERENCES 1ère CLASSE
M. ASIMUS Erick, Pathologie chirurgicaleMme BENNIS- BRET Lydie, Physique et Chimie biologiques et médicalesM. BERGONIER Dominique, Pathologie de la ReproductionM. BERTAGNOLI Stéphane, Pathologie infectieuseMme BOUCRAUT-BARALON Corine, Pathologie infectieuseMme BOURGES-ABELLA Nathalie, Histologie, Anatomie pathologiqueM. BOUSQUET-MELOU Alain, Physiologie et ThérapeutiqueM. BRUGERE Hubert, Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine AnimaleM. CONCORDET Didier, Mathématiques, Statistiques, ModélisationMlle DIQUELOU Armelle, Pathologie médicale des Equidés et des CarnivoresM. DUCOS Alain, ZootechnieM. DOSSIN Olivier, Pathologie médicale des Equidés et des CarnivoresMlle GAYRARD Véronique, Physiologie de la Reproduction, EndocrinologieM. GUERRE Philippe, Pharmacie et ToxicologieM. LEFEBVRE Hervé, Physiologie et ThérapeutiqueM. LYAZRHI Faouzi, Statistiques biologiques et Mathématiques
5

M. MATHON Didier, Pathologie chirurgicaleMme MESSUD-PETIT Frédérique, Pathologie infectieuseMme PRIYMENKO Nathalie, AlimentationM. SANS Pierre, Productions animalesM. VALARCHER Jean-François, Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de basse-cour
MAITRES DE CONFERENCES 2e CLASSE
M. BAILLY Jean-Denis, Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine AnimaleMlle BOULLIER Séverine, Immunologie générale et médicaleMlle CAMUS Christelle, Biologie cellulaire et moléculaireM. FOUCRAS Gilles, Pathologie du BétailMme HAGEN-PICARD Nicole, Pathologie de la ReproductionMlle HAY Magali, ZootechnieM. JACQUIET Philippe, Parasitologie et Maladies ParasitairesM. JAEG Jean-Philippe, Pharmacie et ToxicologieMme LETRON-RAYMOND Isabelle, Anatomie pathologiqueM. MEYER Gilles, Pathologie des ruminantsMlle TRUMEL Catherine, Pathologie médicale des Equidés et CarnivoresM. VERWAERDE Patrick, Anesthésie, Réanimation
ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS
M. GUERIN Jean-Luc, Productions animalesM. MARENDA Marc, Pathologie de la ReproductionMlle MEYNADIER Annabelle, AlimentationMme MEYNAUD-COLLARD Patricia, Pathologie chirurgicaleM. MONNEREAU Laurent, Anatomie, Embryologie
6

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
I. LA FILIERE VIANDE OVINE FRANCAISE
A. ETUDE STRUCTURELLE
1. LES ELEVAGES
1.1 Le cheptel
1.2 Diversité des systèmes d’élevage
1.2.1 Les ovins laitiers
1.2.2 Les ovins « viande »
1.3 Analyses régionales
1.4 Une évolution de la production régulée par les aides de l’Etat
2 2. LA PRODUCTION ET LES ABATTAGES3
3 2.1 Etat actuel de la production de viande ovine
2.1.1 Place de la France dans l’Union européenne
2.1.2 La production contrôlée
2.1.3 La collecte des animaux en vif
2.1.4 Abattage et découpe
a)Vers une concentration croissante des abattages
b)Typologie des opérateurs de l’industrie de transformation
2.2 Le pôle Sud-Est
2.2.1 L’organisation de la filière régionale
2.2.2 Les différentes productions locales
2.2.3 Structuration des abattages
7

4 2.2.4 Un marché de la découpe encore mal maîtrisé
3. LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION
3.1 Bilan en rapport avec l’évolution de la consommation de viande ovine
3.2 Les circuits de commercialisation de la viande ovine
3.2.1 Les GMS
3.2.2 Les boucheries de détail
3.2.3 La demande en viande « hallal »
4. LES ECHANGES INTERNATIONAUX
4.1 Les échanges intra-communautaires
4.1.1 Un marché perturbé par les crises
4.1.2 Reprise des échanges intra-communautaires
4.1.3 Les pays exportateurs
4.1.4 Les pays importateurs
4.2 Les importations françaises
4.2.1 Animaux vifs
4.2.2 Viandes56 4.3 Les exportations françaises
4.3.1 Animaux vifs 4.3.2 Viandes
4.4 Bilan pour la France
5. LES PRIX
5.1 Les prix à la consommation
5.2 Les prix à la production
5.3 Le cinquième quartier8

5.4 La recette finale
B. COMMENT DIFFERENCIER LA VIANDE OVINE FRANCAISE ?
1. UNE SEGMENTATION ENGENDREE PAR LE CONTEXTE ECONOMIQUE
1.1 Différenciation sur l’âge
1.2 La provenance géographique
1.3 Les contraintes liées à ces deux critères
2. LES OUTILS DE LA DEMARCATION
2.1 La traçabilité, élément de la démarcation
2.2 Le sigle « Viande Ovine Française »
2.3 Les garanties officielles de qualité et d’origine française
2.3.1 Le label agricole
2.3.2 La certification de conformité
2.3.3 L’agriculture biologique
2.3.4 L’A.O.C (Appellation d’Origine Contrôlée)
2.4 Les marques collectives interprofessionnelles
3. LES EFFETS DE LA DIFFERENCIATION QUALITATIVE
3.1 Sur le consommateur
3.2 Sur la concurrence
3.3 Sur l’économie de la filière
II. ETUDE D’UN CAS PARTICULIER : L’AGNEAU DE L’ADRET
A. PRESENTATION DE LA FILIERE « AGNEAU DE L’ADRET »
1. ORIGINE DE LA DEMARCHE D’IDENTIFICATION
2. FONDEMENTS TECHNIQUES : LE CAHIER DES CHARGES
9

2.1 Présentation des caractéristiques essentielles du produit
2.2 Exigences techniques
2.2.1 Caractéristiques du produit
2.2.2 Conditions d’agrément des élevages
2.2.3 Conditions d’élevage
2.2.4 Enlèvement des animaux
3. IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION
4. STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION
5. LES DEBOUCHES DE LA CERTIFICATION AGNEAU DE L’ADRET
5.1 Pour l’éleveur
5.2 Pour l’Association : évolution de la certification et des ventes
5.3 Pour le groupement Coopérative Die Grillon
6. LA DOUBLE VALORISATION SOFRAG
6.1 Présentation et avantages
6.2 Les exigences de la démarche qualité SOFRAG
B. LA CERTIFICATION DU PRODUIT
7 1. LES BASES DU SYSTEME QUALITE
1.1 Définition et authentification de la qualité
1.2 La méthode HACCP
1.3 Elaboration du manuel qualité
2. LA QUALITE AU NIVEAU DU GROUPEMENT
2.1 Les bases
2.2 Le manuel qualité
2.3 Les procédures-type
3. L’AUDIT INTERNE
3.1 Définitions
3.2 Buts
10

3.3 Instructions pour l’auditeur
3.4 Le questionnaire-type
3.5 L’exemple des exigences de la démarche SOFRAG
3.6 Procédure de référencement des élevages : l’audit qualité SOFRAGCONCLUSION
ANNEXES
ANNEXE I : PREMIERE PARTIE DE L’AUDIT
ANNEXE II : DEUXIEME PARTIE DE L’AUDIT
ANNEXE III : TROISIEME PARTIE DE L’AUDIT
BIBLIOGRAPHIE
11

TABLE DES ILLUSTRATIONS
CARTES
Représentation des races ovines françaises en fonction de leur origine et de leur localisation ; figure n°2 ; p.18.
Effectifs des brebis d’après les données PCO 1999 ; figure n°3 ; p.19.
Répartition des éleveurs par région en 1999 ; figure n°4 ; p.24.
Chiffre-clef de la production ovine en 1998 ; figure n°5 ; p.27.
Production et consommation de l’Union Européenne en 1999 (en milliers de tonnes) ; figure n°8 ; p.42.
Principaux flux de viande ovine en 1997 (1 000 tec) ; figure n°9 ; p.45.
Répartition géographique des producteurs d’agneaux de l’Adret en 1999 ; figure n°10 ; p.67.
DIAGRAMMES
Part de chaque région dans les abattages contrôlés en 1999 ; figure n°6 ; p.30.
GRAPHIQUES
La filière française de viande ovine en 1999 ; figure n°1 ; p.17.
Nombre d’éleveurs et de brebis en Adret par groupement de producteurs ovins en 1999; figure n°11 ; p.69.
Lieux de commercialisation de l’Agneau de l’Adret en 1999 ; figure n°12 ; p.72.
La pyramide du système documentaire ; figure n°13 ; p.83.
Le schéma des 5 M ou pyramide HACCP ; figure n°14 ; p.84.
TABLEAUX
Nombre de reproductrices françaises ; tableau n°1 ; p.20.
12

Evolution de la taille des troupeaux ovins en 1999 ; tableau n°2 ; p.21.
Foires ovines de la région Auvergne et des départements limitrophes ; tableau n°3 ; p.28.
Abattages contrôlés régionaux. Année 1999 ; tableau n°4 ; p.31.
Gamme de poids des agneaux à l’abattage ; tableau n°5 ; p.33.
Principaux types d’agneaux commercialisés en France en 1999 ; figure n°7 ; p.38.
Importance relative des différents débouchés de la viande ovine en France en 1997 ; tableau n°6 ; p.44.
Synthèse annuelle de l’Union à 15 dans le secteur ovin ; tableau n°7 ; p.49.
Bilan d’approvisionnement du marché français en 1999 ; tableau n°8 ; p.50.
Prix officiels dans quelques pays depuis 1990 (en euro/100 kg de carcasse) ; tableau n°9 ; p.52.
Evolution du prix des carcasses d’agneaux de la PCO et effet sur la recette théorique par kg ; tableau n°10 ; p.53.
Nombre d’éleveurs et de brebis en certification de conformité produit Agneau de l’Adret par région en 1999 ; tableau n°11 ; p.68.
Evolution du nombre d’éleveurs engagés dans la démarche de certification Agneau de l’Adret au sein de la Coopérative Die Grillon ; tableau n°12 ; p.68.
Nombre d’agneaux certifiés par groupement en 1999 ; tableau n°13 ; p.70.
Mise en marché des agneaux de l’Adret en 1999 ; tableau n°14 ; p.70.
Evolution du nombre d’agneaux certifiés « Agneau de l’Adret » depuis 1995 ; tableau n°15 ; p.72.
Bilan de l’activité Adret au sein de la Coopérative Die Grillon ; tableau n°16 ; p.73.
Détail des activités d’achats au cours d’une filière de production ovine ; tableau n°17 ; p.79.
Activités de ventes au cours d’une filière de production ovine ; tableau n°18 ; p.80.
Exemple de mise en oeuvre du système qualité au sein du groupement ; tableau n°19 ; p.83.
Procédure-type de l’identification et de la traçabilité des animaux ; tableau n°20 ; p.87.
Schéma de vie des agneaux de type boucherie du groupe SOFRAG ; tableau n°21 ; pp.90-91.
13

LEXIQUE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES
ABF : Agneau de Boucherie Français
AFNOR : Agence Française de Normalisation
AFQB : Agneau Français de Qualité Bouchère
CEE : Communauté Economique Européenne
CNC : Conseil National de la Consommation
CQC : Critères Qualité Certifiés
CTE : Contrats Territoriaux d’Exploitation
DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DLC : Date Limite de Consommation
F/kg : Franc par kilogramme
FNO : Fédération Nationale Ovine
GEB : Groupement d’Economie du Bétail
GEPO : Groupement des Eleveurs Poitevins Ovins
GIE : Groupement d’Intérêts Economiques
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
ICHN : Indemnité Compensatrice des Handicaps Naturels
MLRC : Maladie Réputée Légalement Contagieuse
OCM : Organisation Commune du Marché
OFIVAL : OFfice national Interprofessionnel des Viandes, de l’élevage et de l’Aviculture
14

PAC : Politique Agricole Commune
PACA : Provence Alpes Côte d’Azur
PAD : Prêt A Découper
PCO : Prime Compensatrice Ovine
SCEES : Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques
SICA : Société d’Intérêt Collectif Agricole
SOFRAG : Société Française de l’Agneau
TEC : tonne équivalent carcasse
UVCI : Unité de Vente aux Consommateurs fabriquée Industriellement
15

INTRODUCTION
Traçabilité : aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un article (intrant chez l’adhérent ou produit livré), ou d’une activité, au moyen d’une identification enregistrée.Audit qualité : examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies, si ces dispositions sont mises en œuvre de façon efficace et si elles sont aptes à atteindre les objectifs déterminés (Norme NF X 50-120, Septembre 1987).
Ces deux notions apparaissent actuellement comme les maîtres mots des filières agro-alimentaires. Une production quelle qu’elle soit se doit aujourd’hui de respecter des normes en vue de pouvoir s’écouler sans heurts sur le marché qui lui correspond. Ce souci majeur trouve sa source à la fois dans un changement de contexte sociologique et dans une restructuration économique des productions en général, animales pour ce qui nous concerne.
En effet , en l’espace d’une trentaine d’années, la situation des marchés alimentaires des pays développés a considérablement changé. Sous l’effet des politiques agricoles productivistes, notamment en ce qui concerne l’Europe de la première Politique Agricole Commune (PAC), on est passé d’une situation de pénurie à une surabondance de l’offre. Cette saturation des marchés solvables s’est accompagnée parfois d’une inadaptation des produits issus de l’agriculture aux besoins des opérateurs situés en aval. Cette situation a conduit à une remise en cause partielle des méthodes de production et à l’émergence d’un nouveau credo : la qualité. Certes, il serait inexact de considérer que la prise en compte de cette variable ne date que de la fin de notre siècle : dès 1905, le législateur s’est préoccupé de l’information du consommateur ( loi de 1905 sur la répression des fraudes )(CODE RURAL)(22), puis de la protection de la santé (CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)(23). Mais, en ce début de millénaire, la qualité est devenue une variable essentielle de la stratégie des entreprises et fait l’objet d’un intérêt renouvelé de la part des pouvoirs publics nationaux et communautaires.Cette étude sera donc consacrée aux changements s’opérant actuellement au sein de la filière viande ovine française et plus particulièrement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Face aux exigences des acheteurs de leur production, les producteurs et les membres des groupements ovins de cette région ont décidé de s’imposer des normes d’élevage afin de valoriser leurs méthodes de travail. Ce fut d’abord un premier cahier des charges « Agneau de l’Adret », en passe de devenir une certification de conformité produit, auquel se rajoute maintenant un deuxième cahier des charges SOFRAG, certification de garantie alimentaire.
Cette étude présente en première partie l’état actuel de la filière, sa structure et son évolution vers la différenciation officielle de la viande ovine française ; puis, en deuxième partie, cette étude traite le cas particulier de l’Agneau de l’Adret, en présentant d’abord la production, ensuite les outils de référence pour élaborer cette certification de conformité produit, et enfin son aboutissement économique soutenu par la démarche associée développée par la société SOFRAG.
16

I. LA FILIERE VIANDE OVINE FRANCAISE
A. ETUDE STRUCTURELLE
Avant de voir en détail les différentes facettes de la filière et leur évolution, la figure 1 présente les principaux chiffres de la filière française de viande ovine.
Figure n°1 : La filière française de viande ovine en 1999 :
Cheptel
7 378 000 femelles reproductrices, dont :-1 297 000 brebis laitières-5 144 000 brebis nourrices-937 000 agnelles saillies
Importations
Animaux vivants720 000 têtes8 500 tec
Production
6 640 000 têtes113 000 tec
Exportations
Animaux vivants980 000 têtes9 800 tec
Viandes168 000 tec
Viandes11 000 tec
Restauration
53 740 tec(20%)
Transformation
13 435 tec(5%)
Achats des ménages
201 525 tec(75%)
17

Consommation
268 700 tecsoit 4,9 kg/hab/an
Source : (36) 1. LES ELEVAGES
1.1 Le cheptel
La France peut affirmer avec fierté avoir l’une des productions ovines les plus diversifiées en termes de régions et de types de production, avec plus de 30 races répertoriées (38) et réparties sur le territoire selon la figure n°2.
Figure n°2 : Représentation des races ovines françaises en fonction de leur origine et de leur localisation :
18

Source : (3)Les moutons sont élevés partout en France, soit en grand troupeaux de plusieurs centaines de brebis, soit en complément d’autres productions. Cette présence des ovins est très souvent justifiée par la nécessité d’utiliser les parcelles et les ressources fourragères les plus pauvres ou seulement valorisables en prairies. Ainsi 80% de la production ovine est réalisée dans des zones sèches, défavorisées ou encore de montagne et de haute montagne. Les données apportées par les nombres des Primes Compensatrices Ovines (PCO) en 1999 ont permis une cartographie des effectifs de brebis en figure n°3.
Figure n°3 : Effectifs de brebis d’après les données PCO 1999 :
19

Source : (29)
Les races ovines peuvent être classées en 6 types différents (16):♠ les races précoces, sélectionnées pour leur potentiel de croissance élevé, et leur grande
aptitude de reproduction : Ile de France, Berrichon du Cher, South Down, Suffolk...♠ les races d’herbage, situées dans les grandes zones d’élevage placées sous l’influence
océanique : Charollais, Bleu du Maine, Rouge de l’Ouest, Vendéen, Charmoise, Texel, Avranchin, Cotentin…
♠ les races rustiques, exploitées dans les zones difficiles de moyenne et de haute montagnes : Blanc du Massif Central, Préalpes du Sud, Limousine, Lacaune viande...
♠ les races Mérinos, sélectionnées à l’origine pour leur laine, mais orientées aujourd’hui vers la production de viande.
♠ les races prolifiques, développées principalement en vue d’accroître la productivité numérique du cheptel français : Romanov.
♠ les races laitières, élevées pour la production de lait et de fromages : Lacaune, Manech, Basco-béarnaise...
Le nombre de femelles reproductrices (brebis + agnelles saillies) présentes à la fin de l’année 1998 et donc susceptibles de produire des agneaux dans le courant de 1999 était une nouvelle fois en baisse annuelle sensible. Dans son enquête de novembre 1998, le SCEES (Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques du Ministère de l’Agriculture) avait estimé à 7
20

502 000 brebis et agnelles saillies le cheptel présent dans les exploitations françaises, soit 1% de moins qu’à l’issue de l’enquête Structures de décembre 1997. Alors que le nombre de reproductrices du troupeau laitier avait augmenté de 3% en un an pour passer à 1 636 000 têtes, celui des nourrices, uniquement consacrées à la production de viande, avait encore baissé de plus de 2%, pour atteindre 5 866 000 têtes (30).En fait, avec quelques petites oscillations, le cheptel français de reproductrices recule régulièrement depuis 17 ans, d’environ 1,5% par an en moyenne. La baisse a précisément débuté à la fin de l’année 1981, suite à la mise en œuvre de l’Organisation Commune de Marché pour la viande ovine au niveau européen. Auparavant, au contraire, les effectifs avaient considérablement augmenté tout au long des années 70 pour culminer à 9 737 000 têtes en 1981. Depuis 1993, le nombre de brebis a diminué de 5,4% ( - 387 700 brebis) et le nombre d’éleveurs s’est réduit de 22,5% ( - 14 910 éleveurs)(29). Dans le nouveau cadre communautaire, qui s’est avéré très bénéfique dans beaucoup d’autres pays, l’élevage ovin français a manifestement souffert de la concurrence instaurée sur le marché et de l’ajustement communautaire des garanties. Cette tendance au déclin n’a pas pu être enrayée jusqu’ici. Ni la mise en œuvre des quotas de Prime Compensatrice Ovine (PCO) sur le plan communautaire, ni les efforts nationaux pour restructurer l’élevage ou mieux valoriser ses productions n’ont été jusqu’ici suffisants. D’ailleurs, les résultats provisoires de l’enquête de novembre 1998, à la veille de la campagne 1999, font apparaître un nouveau recul de 1,7%.
Tableau n°1 : Nombre de reproductrices françaises :
Cheptel ovin français (1000 têtes)
Novembre 1998 Novembre 99 Evolution 98/99
Troupeau viande :- brebis- agnelles saillies- total femelles saillies
5 232634
5 866
5 144613
5 757
- 1,7%- 3,3%- 1,9%
Troupeau laitier :- brebis- agnelles saillies- total femelles saillies
1 314322
1 636
1 297323
1 620
- 1,3%+ 0,3%- 1,0%
Ensemble des femelles saillies 7 502 7 377 - 1,7%Agnelles non saillies 357 350 - 2,0%
Total des ovins 9 553 9 492 - 0,6%Source : (36)
Ces évolutions sont confirmées par les éléments contenus dans les fichiers des bénéficiaires de la PCO (Prime Compensatrice Ovine) enregistrés par l'OFIVAL. Des PCO n’ont été demandées que pour 6 740 000 femelles, soit 2,6% de moins qu’en 1998 et le nombre de demandeurs a baissé de 4,8% dans l’année, pour passer à 53 550. Au total, ce sont 51 430 éleveurs qui ont réellement perçu la PCO, concernant 6 739 500 brebis. En 1993, ils étaient 15 000 de plus pour 7 130 000 brebis (7).Sur les 53 550 éleveurs ayant réclamé la PCO, 91% ont déclaré uniquement des brebis, les autres des brebis et des chèvres. La taille moyenne des élevages, avec 131 brebis par troupeau, a augmenté de 4 têtes dans l’année. Les évolutions constatées ces dernières années se confirment, comme le montre le tableau n°2. La classe charnière des 200-350 brebis voit néanmoins son effectif baisser pour la première fois et ce, de 1,8%, depuis la mise en place des quotas de primes. 65% du cheptel reproducteur est détenu par 92% des éleveurs.
21

Tableau n°2 : Evolutions de la taille des troupeaux ovins en 1999:
Taille des troupeaux <250 brebis Entre 250 et 350 brebis
>350 brebis
Répartition en pourcentage du
cheptel total
34% 30% 36%
Evolution en 1999 - 6% - 1,8% + 2%
Source : (37)
Sur le plan géographique, la répartition du cheptel reste déséquilibrée. Six régions, toutes situées au sud de la Loire, se partagent plus de 70% des reproductrices primées. La première, Midi-Pyrénées, détient à elle seule 24% des effectifs, alors que les régions Poitou-Charentes, PACA, Aquitaine, Limousin et Auvergne détiennent chacune entre 8 et 10% du cheptel national. Néanmoins, en perdant 16 700 têtes, la région Midi-Pyrénées enregistre pour la première fois une baisse de 1% de son effectif et une diminution de 3,3% du nombre de ses éleveurs. La région PACA souffre également d’une chute de 0,6% de son cheptel et de 4,5% de ses éleveurs.
1.2 Diversité des systèmes d’élevage (30)
1.2.1 Les ovins laitiers
N’étant naturellement pas voués à la production de viande ovine, mais offrant quand même sur le marché leur « sous-produit » sous la forme d’agneaux de boucherie, ils seront exposés dans cette partie afin de n’ignorer aucune facette de la filière.L’exploitation des brebis pour la production de lait est une caractéristique des élevages du bassin méditerranéen. Ce type d’élevage concerne environ 1 000 000 de brebis en France avec deux orientations différentes : le système aveyronnais dans lequel les brebis agnellent en décembre et produisent environ 60% de leur lait en bâtiment au cours de l’hiver avec des
22

fourrages conservés et des aliments concentrés et les systèmes basque ou corse davantage orientés vers une production laitière au pâturage.Dans tous les cas, la production d’agneaux, sevrés entre 4 et 6 semaines, est un élément important du revenu avec ici encore des orientations différentes. Dans le bassin de Roquefort (Aveyron et départements voisins), les agneaux de race Lacaune à très fort potentiel de croissance sont vendus à des engraisseurs qui les élèvent en bandes de plusieurs centaines voire plusieurs milliers. Dans les autres régions, le potentiel de croissance limité des races interdit une telle pratique et les agneaux sont abattus après le sevrage.
1.2.2 Les ovins « viande »
Ils constituent l’essentiel du troupeau, avec deux grands modes d’élevage qui se différencient d’abord par les périodes d’agnelage, au printemps (période normale de mise bas) ou en hiver (agnelage « désaisonné ») .Dans le premier cas, les brebis agnellent au pâturage, lorsque la disponibilité en herbe est importante, ou en bâtiment, en fin d’hiver, de manière à sortir les troupeaux lorsque les agneaux âgés de 2 à 4 semaines sont capables de supporter de brèves périodes de froid . Lorsque les conditions d’élevage sont bien maîtrisées, les agneaux peuvent atteindre le poids d’abattage avant l’été et n’ont consommé que le lait de la mère et de l’herbe. En fait, dans la majorité des cas, ils sont complémentés avec des aliments concentrés mis à leur disposition à partir de mai ou juin. Ceux qui, malgré cet apport complémentaire, ne sont pas abattus avant l’automne, sont rentrés en bergerie et nourris avec des fourrages conservés et des aliments concentrés. Ce type d'élevage est le plus fréquent dans le Centre-Ouest ou le Massif Central nord. L’alimentation est basée essentiellement sur des fourrages conservés et des résidus de culture (céréales, pulpes de betterave…), les surfaces en herbe étant réduites au minimum.Les agnelages « à contre-saison » sont le fait d’éleveurs qui ne disposent pas de ressources en herbe importantes soit parce que le troupeau ovin valorise des résidus de culture (troupeaux des fermes céréalières du Bassin Parisien ou du Centre, en forte diminution) soit du fait du climat (Provence) . Dans ce cas, les troupeaux transhument et les agnelages ont lieu à la descente de montagne à partir du mois d’octobre. Les brebis exploitent la végétation spontanée (parcours, estives…), les pâturages de qualité et les apports d’aliments concentrés sont réduits aux périodes de besoins élevés (lactation). Les agneaux sortent avec leurs mères tant que les ressources fourragères sont suffisantes. Ils peuvent ensuite être rentrés en bâtiment et nourris avec des rations à base d’aliments concentrés.Un certain nombre d’éleveurs pratiquent des systèmes intermédiaires entre les deux grands types cités plus haut. C’est le cas en particulier des élevages du Massif Central où les brebis agnellent plus d’une fois par an; selon que l’agnelage se produit au printemps ou en automne-hiver, le mode d’élevage pratiqué se rapproche de l’une ou de l’autre des méthodes rapportées plus haut.
1.3 Analyse régionale
Globalement on peut découper le territoire français en 7 zones « moutonnières » (30), parmi lesquelles les deux premières citées dans la liste ci-dessous restent les plus importantes :
♠ le grand Sud-Est regroupe les grands pôles de Camargue et de Crau (4), la montagne alpine des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes (5)(6), la moyenne Durance, les plateaux Ardéchois. Nous avons intégré à cet ensemble les garrigues languedociennes et le Roussillon, ainsi que les départements du massif alpin du nord (Savoie notamment) et de
23

l’Ain qui sont drainés par les mêmes types d’opérateurs. Cet ensemble regroupe 7 700 éleveurs qui détenaient 1 000 000 en 1994 (données PCO)
♠ la grande zone Nord de la France où 12 600 éleveurs élèvent un peu plus de 900 000 brebis entre le bassin Ouest (Vendée, Maine et Loire, Loire Atlantique) et l’Est (Vosges, Haute Marne, Moselle) reliés entre eux par un croissant Nord quasi continu qui s’étend de la Haute Normandie à l’Aisne et aux Ardennes. Les opérateurs d’aval de ces deux grandes zones ont souvent développé des politiques d’entreprise indépendantes de la production locale qui a connu, surtout dans la moitié Nord, une décroissante forte durant la dernière décennie.
♠ le bassin laitier de Roquefort concentre à peu près un million de brebis pour 5 300 éleveurs. Sa production y est très marquée par des agnelages cyclés dans les troupeaux laitiers. La production des agneaux sous la mère y est assez dure à organiser.
♠ le croissant herbager qui s’étend des Deux-Sèvres à la zone bourbonnaise rassemble quatre grands pôles : le pôle Montmorillonnais (3 600 éleveurs pour 720 000 brebis), le Haut Bocage et la Gâtine des Deux-Sèvres (2 900 éleveurs et 320 000 brebis), le Haut Limousin (250 000 brebis dans 2 800 élevages) et enfin la zone bourbonnaise avec son extension bourguignonne (4 800 brebis et 5 200 élevages). Ce croissant herbager représente donc un volume global de 1 760 000 brebis et 14 500 élevages.
♠ le Quercy essentiellement centré sur les Causses du Lot, regroupe près de 330 000 brebis dans 2 500 élevages. Il constitue un pôle très dense ayant permis récemment la mise en place d’un outil d’abattage moderne.
♠ les montagnes d’Auvergne et du Limousin, les plateaux de Millevaches, de Haute Loire et de Margeride représentent un potentiel de 600 000 brebis dans 7 200 élevages.
♠ les montagnes Pyrénéennes détiennent un cheptel de 535 000 brebis chez 3 800 éleveurs dans leur partie Basco-Béarnaise dominée par la production laitière. Nous y avons joint la zone des Pyrénées centrales et ses côteaux de Piémont où 2 200 éleveurs gardent 200 000 brebis.
Il est à noter que pour ces 5 derniers bassins, le fonctionnement de la filière est axé sur une logique d’expédition, avec des relations très étroites entre les grossistes d’amont, les opérateurs d’aval et la production.
En ce qui concerne la production des agneaux de l’Adret, la répartition des éleveurs se fait conformément à la figure n°4 :
Figure n°4: Répartition des éleveurs par région en 1999:
24

Régions Départements concernés
Nombre d’éleveurs
% d’éleveurs en groupement
% d’éleveurs non adhérents
Auvergne (1) 03-63-15-43 4 639 28,7 71,3
Rhône-Alpes (2) 01-69-42-07-26-38-73-74
4 702 14,9 85,1
PACA (3) 05-04-06-83-84-13
2 200 25 75
Source : (27)
1.4 Une évolution de la production régulée par les aides de l’Etat
« L’an 2000 sera une année charnière. S’il n’y a pas une prise de conscience rapide du gouvernement français ou de l’Union européenne, l’élevage ovin part à la catastrophe. » Cette remarque de Philippe de Launay, président de Campal, groupement de producteurs ovins en Haute-Vienne, fait suite au rapport sur la situation de la filière viande ovine française rendu public le 16 novembre 1999 par Jean Launay et Michel Thomas à la demande du ministère de l’Agriculture. Les auteurs y font état de la baisse d’un million de brebis en 10 ans. En effet, dès 1993, le marché affiche un très net déséquilibre : l’agneau français est remplacé par les agneaux britannique, irlandais et néo-zélandais, la pénétration du marché étant rendue
25

possible par l’abaissement des protections aux frontières de l’Union européenne. Pour Michel Collonge, « il faudrait obtenir de l’Organisation Mondiale du Commerce la reconnaissance de la préférence communautaire », alors que le gouvernement français se préoccupe plutôt de l’avenir de la PCO (alors qu’elle est malheureusement parfois la seule motivation à l’élevage ovin de certains éleveurs). L’Etat prévoit d’accorder de nouvelles aides, les primes-CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation). Cependant, la filière ploie sous les forts coûts de main d’œuvre et les revenus des éleveurs demeurent les plus bas du monde agricole. Actuellement la seule solution pour les éleveurs réside dans l’accroissement de la taille des troupeaux et l’extensification des surfaces pâturées (12)(13).Ce tableau pessimiste trouve sa source selon certains (10)(15) dans l’inadaptation des mesures gouvernementales en ce qui concerne le système de production de viande ovine en France. La dernière réforme de la PAC (Politique Agricole Commune) a relancé la concurrence entre le mouton et les autres productions. Le différentiel de primes entre surface en herbe et céréales s’accroît, la diminution des prix en viande bovine affecte les autres viandes rouges, et le calcul du chargement utilisé pour le complément extensif inclut maintenant les ovins. La nouvelle PAC a donc entraîné le déclin d’un grand nombre d’ateliers complémentaires ovins (26). Une réforme de l’OCM ovine est inéluctable, car, après les accords de Berlin, elle reste la seule OCM fondée sur un soutien direct à la production, très décrié par l’Organisation mondiale du commerce. En ovin, les aides représentent près de 70% du revenu net avant impôt, ce qui laisse très peu de place à la vente des agneaux et aux prestations liées à l’environnement. Dans les derniers contrats de plan Etat-région, l'accent a été mis sur la génétique, les bâtiments et l'organisation en filières pour améliorer la technicité des élevages. Cependant, ces objectifs semblent utopiques; il ne s’agit pas d’élevage hors sol , et, comme le constate Pierre Villeneuve, « il est très difficile de donner une recette qui marchera à tous les coups, les résultats dépendent fortement des bâtiments, de la nature des prairies et du parasitisme » (7).L’extensification et/ou l’attribution de la PCO à la brebis et non à l’agneau n’ont pas encouragé les performances techniques. Cependant, la situation de certaines régions n’est pas aussi catastrophique que ce bilan peut laisser sous-entendre (24)(36)(39)(35). Certains bassins ont essayé de tirer les prix vers le haut en mettant en place une démarche qualité ; par exemple en Deux-Sèvres, les éleveurs de Vasles, réunis dans le GEPO, ont été parmi les premiers, il y a 10 ans, à se lancer dans la maîtrise de toute le filière. Aujourd’hui, ils passent à la vitesse supérieure avec un projet d’unité de transformation pour commercialiser des plats cuisinés. Le GEPO fait maintenant abattre 250 à 300 agneaux par semaine et ce chiffre doit doubler. En région PACA, le mouton a joué la carte environnementale, et cela lui a plutôt réussi. Dans cette région, le cheptel de brebis primées s’est maintenu autour de 650 000 brebis têtes depuis 1993. Les troupeaux se sont concentrés avec une moyenne de 306 brebis par éleveur. Un fort accent a été mis sur le pastoralisme et la valorisation des parcours et des alpages. Un tiers des éleveurs est déjà engagé dans des relations contractuelles de l’entretien de l’espace. Pour les encourager, l’Etat délivre des primes-CTE, qui doivent cependant demeurer un complément au revenu et non se substituer à d’autres aides. Le danger vient également de la course à l’hectare que cela peut engendrer, ce que souligne René Tramier, président de la coopérative du Mérinos dans le Sud-Est, aussitôt contredit par Jean-Pierre Arcoutel, secrétaire général adjoint de la FNO : « l’enveloppe allouée ne permettra pas de créer un CTE pour chaque exploitation » (34).Dans ce contexte, les 50 millions de francs attribués par le gouvernement français à la filière ovine lors de la conférence du 21 octobre 1999 apparaissent bien dérisoires. 5 millions seront réservés à l’ICHN (Indemnité Compensatoire des Handicaps Naturels), en espérant que la Commission européenne abondera du même montant. 45 millions serviront à un plan d’adaptation dont les modalités sont à définir. Le mot de la fin sera celui de Jean-Pierre Arcoutel : « On ne va pas adapter grand-chose avec l’équivalent de 7 francs par brebis ».Parmi les autres mesures proposées, il convient de citer les 5 voies d’orientation citées dans le rapport Thomas-Launay (jugées peu novatrices car déjà appliquées en partie)(7) :
26

♦ se préparer à des adaptations de la politique agricole commune♦ redéfinir une nouvelle politique ovine en fonction des attentes de la société au travers
du contrat territorial d’exploitation♦ installer davantage de jeunes et consolider les exploitations existantes♦ travailler à la constitution de filières régionales ou inter-régionales en renforçant
l’organisation économique par bassin de production et en développant la contractualisation avec l’aval
♦ valoriser la production par une segmentation du marché.
2. LA PRODUCTION ET LES ABATTAGES
2.1 Etat actuel de la production
2.1.1 La France dans l’Union européenne (42)(29)
En 1998 la France est le troisième pays producteur d’ovins de l’Union Européenne, avec une production indigène brute de viande ovine et caprine de 145 000 tec (tonnes équivalent carcasse). La figure n°5 permet de situer la France dans son environnement européen.
En 1999, la France maintient cette position mais sa production chute à 113 400 tec. En comparaison, la production brute de viande ovine et caprine de l’Union européenne est de l’ordre de 1,15 million de tec. A lui seul le Royaume-Uni assure le 1/3 de cette production et, en incluant l’Irlande, ce sont 40% de la production de la production européenne qui proviennent d’outre-Manche. L’autre gros pôle de production est constitué par les pays du Sud. La Grèce, l’Espagne, l’Italie et le Portugal assurent eux aussi ensemble 40% du total européen. Les 8 autres pays ont un rôle plus marginal, puisqu’ils n’assurent ensemble que 7% de la production de l’Union (8).Il est à remarquer que les utilisations du cheptel ovin varient en fonction du pays européen concerné (40). Ainsi, en Italie, les agneaux sont des sous-produits de la production laitière sacrifiés très jeunes à un faible poids de carcasse, alors que les agneaux des pays du nord de l’Europe sont engraissés à l’herbe jusqu’à un âge proche d’un an, les « hoggets », atteignant ainsi des poids à l’abattage supérieurs à 40 kg sur pied. En terme de production unitaire, la classification des pays est donc bien différente : l’Italie produit en moyenne 6 kg de carcasse par femelle reproductrice, contre plus de 20 kg outre-Manche et dans les pays du nord de l’Union et contre 18 kg en France.
Figure n°5 : Chiffre-clef de la production ovine en 1998 :
27

Source : (12)
2.1.2 La production contrôlée
Après la forte diminution observée en 1998 (- 3,3%), la production a enregistré en 1999 une nouvelle baisse d’une ampleur presque équivalente. Proche de 6 640 000 têtes et 113 000 tec, elle a été en repli respectivement de 135 000 têtes (- 2%) et de 3 000 tec (- 2,6%)(OFIVAL).La production ovine se distingue par sa saisonnalité. Elle est maximale dans les semaines précédant Pâques et la position variable de cette fête religieuse amène des variations d’une année sur l’autre. Cependant le recul de la production a été très important au premier semestre, notamment au printemps (- 6% en mars-avril-mai) où elle n’a pas connu un pic aussi prononcé qu’en 1998. Les bas prix de 1998 à cette période ont pu décourager certains éleveurs à continuer de pratiquer l’agnelage de contre-saison et expliquent la sensible diminution de la production au printemps 1999. Il existe un second pic de production en décembre, destiné à approvisionner les différents circuits de distribution, mais aussi et surtout les débouchés à l’exportation pour les fêtes de fin d’année. Au deuxième semestre 1999, la baisse a été plus faible (- 1,5%) et semble en rapport avec l’affaiblissement du potentiel de production indiqué par l’enquête de cheptel ou le recul du nombre de brebis déclarées à la PCO. Il semblerait que , comme les autres années, de plus en plus de brebis échappent aux abattages contrôlés et ne sont donc pas comptabilisées dans la production. Les plus faibles productions restent celles enregistrées en début d’année, avec janvier à 15% en dessous de la moyenne mensuelle, puis à l’automne, avec septembre, octobre et novembre à moins 25% (principaux mois d’agnelage pour la majorité des élevages d’ovins de boucherie) (30)(26).
28

2.1.3 La collecte des animaux en vif (45)
En France, les marchés ovins demeurent très présents car ancrés dans les traditions de l’élevage. Ils représentent à la fois le maintien de la vie économique, de la vie rurale et la mise en valeur du patrimoine d’une ou de plusieurs race(s) locale(s). Lieu de rencontre et d’échanges privilégié pour les autochtones , ils constituent également un atout majeur par le côté touristique que possèdent les foires et marchés agricoles. Initié en Haute-Loire sur le marché de Saugues, la pratique de ce service se généralise : on le retrouve sur différents marchés dont celui de Parthenay, Les Hérolles, Assier, Saugues et Corbigny. Cependant, tous ces marchés n’évoluent pas de la même façon, comme le montre le tableau n°3 concernant la région Auvergne :
Tableau n°3 : Foires ovines de la région Auvergne et des départements limitrophes :
Nombre d'ovins vendus Département 1990 1995 1996 1997 Evolution 97/90
MOULINS AVERMES 3 46 100 24 490 23 523 16 700 -64%
CHAROLLES 71 18 000 9 050 9 722 9 800 -45%MOULINS ENGILBERT 71 39 540 38 470 33 427 nd -15%SANCOINS 18 216 000 156 800 156 580 140 400 -35%
SAUGUES 43 35 000 87 100 92 600 99 882 185%
LAISSAC 12 113 700 112 400 109 600 98 400 -13%
Bassin herbager
Départements limitrophes
Bassin rustique
Départements limitrophes
Source : (45)
Les foires du bassin herbager sont en forte baisse d’activité de 1990 à 1997 contrairement au bassin rustique où le marché de Saugues a progressé grâce à l’augmentation des expéditions vers le Languedoc-Roussillon et l’Espagne.Au niveau régional, les deux foires ovines d’Auvergne totalisent 5% de la production régionale à Moulins et 19% à Saugues, soit un total de 115 700 ovins sur 666 000 ovins commercialisés dans la région en 1997.Ces résultats montrent plutôt une concentration des flux d’animaux vers certaines foires, avec un recul de celles qui sont moins réputées, même si la tendance générale est à la baisse. Ce déclin est lié à la baisse d’activité des négociants, principaux acheteurs sur ces foires. Sur le bassin herbager de la région Auvergne, avec près de 165 000 ovins commercialisés, le négoce en vif représente 48% de la première mise en marché des animaux, ce qui constitue 75% des brebis et 43% des agneaux. Les achats se font à 40% en foires et à 40% en achat direct à la ferme, les 20% complémentaires étant assuré par les adhérents des groupements. Sur le marché de Saugues, deux négociants importants réalisent 40% des débouchés du marché de Saugues et 45% de leurs approvisionnements avec des agneaux d’Auvergne. Le négoce trie et livre ensuite à l’Espagne en général. Ce débouché est perçu comme globalement en baisse pour plusieurs raisons qui sont :
29

♠ une augmentation des disponibilités espagnoles♠ une baisse tendancielle des écarts de prix entre les marchés français et espagnols♠ la réglementation que les pouvoirs publics espagnols imposent aux agneaux
français : incinération des têtes qui coûte 5 francs par agneau et qui atteste de l’origine étrangère de la viande
♠ le différentiel sur la valorisation des peaux qui va de 20 à 25 francs entre une peau de Mérinos espagnol et une peau d’agneau français Lacaune ou BMC (en 1998).
Cette activité traditionnelle, malheureusement menacée, demeure quand même un espoir pour l’économie de certaines régions rurales se vidant de leurs habitants.
2.1.4 Abattage et découpe
a. Vers une concentration croissante des abattages
D’après l’OFIVAL, en 1999, les abattages contrôlés d’ovins et de caprins se sont élevés à 111 700 tec, en repli de 3 400 tec sur ceux de 1998 (- 3%). Cette baisse trouverait son explication par l’application plus stricte des consignes légales relatives à l’abattage.
La loi du 8 juillet 1965 relative à la modernisation du marché de la viande est un des piliers de la transformation des structures d’abattage (9). L’objectif poursuivi par les pouvoirs publics est l’amélioration des conditions sanitaires dans lesquelles se déroulent les conditions d’abattage. Son application passe par une profonde restructuration des lieux d’abattage, qui doivent présenter des installations aux normes européennes spécialisées pour les petits ruminants. Une certaine concentration technique s’est ainsi imposée avec une évolution progressive vers des structures de taille sans cesse croissante.
A ce mouvement s’ajoute une concentration géographique des abattoirs spécialisés en ovin-caprin dans les trois principales zones de production ovine française : le Centre-Ouest, le Sud-Est et le Sud-Ouest, comme en témoigne les parts respectives des régions dans les abattages contrôlés sur la figure n°6.
Figure n°6 : Part de chaque région dans les abattages contrôlés en 1999 :
30

Source : (29)
Ces trois zones principales concentraient 79% de la production française et 83% des abattages en 1996. Ainsi se poursuit la concentration des abattages dans des abattoirs spécialisés attachés aux bassins de production, la majorité des abattoirs ovins se situant sur un axe Rennes-Marseille, exception faite du pôle sisteronnais. En 1992, sur les 441 établissements recensés par le SCEES, 379 ont eu une activité « ovin-caprin » alors qu’ils étaient 1 553 en 1963. A la différence des autres espèces, les abattoirs privés ne dominent pas : on en dénombre 93 (38%) qui ne réalisent que 30% des abattages. La concentration des abattages, même si elle prend de l’ampleur, demeure moins accentuée que pour les autres espèces : 48 abattoirs de plus de 500 tonnes réalisent 72% des abattages nationaux. On ne dénombre que 14 abattoirs de plus de 2 000 tonnes. Parmi les abattoirs de plus de 500 tonnes, les abattoirs spécialisés sont peu nombreux : 9 sur 48, soit 20%, et sont plutôt de grande taille car 50% des abattoirs de plus de 2 000 tonnes sont spécialisés.La concentration est donc très largement engagée, à l’exception de la Corse toutefois.Le tableau n°4 montre la suprématie des trois grandes régions françaises d’abattage ovin .
Tableau n°4 : Abattages contrôlés régionaux. Année 1999 :
31

(en nombre de têtes) AGNEAUX OVINS DE RÉFORME
ENSEMBLE OVINS
Sud-Ouest 1 838 946 247 648 2 086 594
Sud-Est 1 334 527 55 573 1 390 100
Centre-Ouest 1 027 313 239 661 1 266 974Bretagne 152 242 23 535 175 777Pays de la Loire 161 271 2 272 163 543Auvergne 149 324 2 410 151 734Bourgogne 66 698 1 130 67 828Ile-de-France 77 904 36 177 114 081Basse-Normandie 111 457 4 511 115 968Lorraine 78 904 3 800 82 704Centre 56 485 7 961 64 446Franche-Comté 55 131 2 813 57 944Champagne-Ardenne 53 857 2 194 56 051Haute-Normandie 51 209 2 487 53 696Picardie 49 407 2 509 51 916Nord-Pas-de-Calais 41 890 707 42 597Alsace 21 983 5 887 27 870Corse 9 157 105 9 262France 1999France 1998
5 337 7055 428 765
641 380676 672
5 979 0856 105 437
Evolution (%) - 1,7 - 5,2 - 2,1
Source : (37)
D’après RIEUTORT (41), la distribution géographique inégale contribue à accentuer les oppositions entre les établissements d’abattages ; il existerait ainsi trois grands types de pôles en concurrence plutôt qu’en complémentarité :
♠ les petits établissements traitant quelques dizaines de tonnes de viande ovine, situés dans des régions où l’élevage est bien implanté ; ils témoignent souvent d’une insuffisante concentration liée à la volonté de quelques élus locaux sensibles aux pressions des milieux professionnels et redoutant une fermeture synonyme de suppressions d’emplois . Ils se maintiennent grâce à des circuits courts, ceux des bouchers des petites bourgades ( dans le cas des installations publiques), ou ceux d’un modeste chevillard se ravitaillant sur les marchés campagnards pour abattre dans l’entreprise familiale avant de distribuer dans les aires de consommation. Sous cette forme, les petites unités sont condamnées à disparaître.
♠ les établissements de taille supérieure, traitant de 150 à 1 000 tonnes, qui sont soit des établissements spécialisés dans les ovins mais mal situés et peu dynamiques, soit de grands abattoirs bovins ou porcins implantés hors des régions moutonnières. Dans ce second cas, le commerce de viande de mouton n'intervient que pour compléter vis-à-vis des clients
32

les livraisons en viande d’autres espèces animales (porc, veau, bœuf). Cette polyvalence ou la localisation géographique défavorable expliquent leur faible développement et un approvisionnement difficile. La qualité de l’équipement et une situation financière relativement saine autorisent cependant le maintien des équipements au moins dans une logique d’intérêt général. Le respect des normes sanitaires, la prévention des abattages clandestins (surtout dans les régions méditerranéennes) imposent un maillage minimum des établissements. Ces abattoirs sont, en outre, le pivot de filières locales qui risquent de disparaître avec eux, contribuant à la diminution du nombre d’éleveurs et de bouchers. Comment imaginer la filière normande de moutons de pré-salé, actuellement à la recherche d’une reconnaissance, sans véritables outils d’abattage ? De même, dans les montagnes ou les campagnes dites « défavorisées », le maintien des abattoirs modernisés s’impose en terme d’aménagement du territoire, même si la logique purement économique et industrielle condamne ce type d’établissements (44).
♠ au-delà de 2 000 tonnes, l’unité d’abattage plus spécialisée et « industrielle », accède au marché national. Les entreprises privées ont généralement pour origine de puissants chevillards ou des Sociétés d’Intérêts Collectifs Agricoles (SICA) nées de l’association de nombreux éleveurs (en particulier dans le Sud-Est), mais les abattoirs publics sont souvent animés par les mêmes opérateurs (expéditeurs, coopératives). Les principaux groupes industriels spécialisés dans la branche ovine et interlocuteurs de la grande distribution, s’appuient sur de telles unités, amorçant l’activité de seconde transformation (découpe) afin de dégager des marges plus confortables. Toutes ces entreprises ont toutefois un point commun : la faible rentabilité de la première transformation les rend particulièrement fragiles . L’abattage se caractérise par une faible valeur ajoutée qui explique de nombreuses faillites retentissantes (par exemple celle de Mejescazes dans le Lot alors que l’unité traitait 5 000 tonnes en 1981). Si, par ailleurs, les industriels contrôlent mal l’approvisionnement et l’aval, leur situation devient vite très difficile, quelle que soit l’efficacité de l’outil technique. Certes, l’essor des hypermarchés et des centrales d’achat redistribue les cartes, mais la force des marchés d’aval et l’antériorité de l’implantation joue toujours pleinement. S’ajoute à ces problèmes généraux la question de la valorisation du « cinquième quartier ».
Les volumes découpés ont tendance à croître à la demande des GMS qui par ailleurs achètent certains morceaux en catégoriel * et non pas l’ensemble de la carcasse reconstituée, rendant cette activité difficile à équilibrer. Elle serait de ce fait réalisée pour partie avec de la viande importée, donc, à moindre coût. En ce qui concerne les produits commercialisés, le terme « agneau » recouvre une gamme de produits et de poids étendue : y sont regroupés l’agneau de lait (5 à 10 kg de carcasse), le laiton (7 à 13 kg), l’agneau de boucherie (12 à 25 kg).
*catégoriel :muscles débités à partir de la carcasse et choisis à l’unité par l’acheteur
Sur le plan national, la gamme de poids des agneaux abattus se répartit comme suit :
Tableau n°5 : Gamme de poids des agneaux à l’abattage :
33

poids <12 kg 12 à 16 kg 16 à 19 kg 19 à 22 kg >22 kg% agneaux 5 25 40 20 5
Source : (33)
Pour la conformation et l’état d’engraissement, on peut estimer que 50% des agneaux sont classés R2/R3, ce qui correspond à la fois à la demande des GMS (R,O) et à celle des bouchers détaillants (E,U,R). Cependant, ces moyennes marquent une grande hétérogénéité régionale : les opérateurs du Sud-Est sont à la recherche d’un agneau léger de 15 à 18 kg, peu conformé avec une couleur claire; les agneaux recherchés par les entreprises du Centre-Ouest sont des animaux de 16 à 20 kg, bien conformés, plutôt de type U2, U3 ou R2. Les opérateurs du Sud-Ouest, première zone productrice d’agneaux label en France, préfèrent un agneau clair de bonne conformation, plutôt R2 ou R3, de 17 à 19 kg de carcasse. A cette segmentation de l’offre et de la demande s’ajoutent quelques niches : les agneaux de lait, les laitons et les brebis. Ces dernières représentent 19% des abattages nationaux en 1995. Elles servent à alimenter les industriels des plats cuisinés et pour partie la filière hallal qui représente près de 40% des débouchés dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, plus un marché très spécifique dans la région de Bordeaux où elles sont vendues sous forme de pièces de découpe.La politique d’identification des trois pôles d’abattage principaux est sensiblement différente. Dans le Centre-Ouest, elle est axée autour de la marque collective Agneau de Poitou-Charente utilisée par 5 entreprises, distribuée dans toute la France, et de la certification de conformité produit « le Baronnet » (obtenue fin 1994) utilisée par 2 entreprises. Dans le Sud-Est, ce sont les marques d’entreprises qui sont majoritaires (6 marques dénombrées). Dans le Sud-Ouest, le taux identifié sous label est important comparé au taux national (1% des abattages en 1994). Cependant les démarches sont assez dispersées, et le problème majeur demeure la régularité de ce type de production. La démarche ABF/AFQB (Agneau Boucher Français / Agneau Français de Qualité Bouchère) véritablement démarrée en 1995 semble bien perçue. Plus de 50% des opérateurs y participaient déjà en 1997 et environ 13% des agneaux produits ont ainsi été commercialisés (32).
b. Typologie des opérateurs de l’industrie de transformation (28)
♦ Les importateurs découpeurs
C’ est par eux que transite une bonne part des importations dont le volume dépasse la production nationale. Installés à proximité des ports et dans la région parisienne, ils maintiennent tous un minimum d’activité française (5 à 10% de leur tonnage traité). Cette part peut atteindre 30% en mars et avril du fait du traitement des agneaux sevrés aveyronnais. Tous ces opérateurs jouent sur le calendrier de la production : en mars et en avril, ils traitent de la production aveyronnaise et espagnole, ainsi que le début de la production irlandaise et britannique ; de mai à septembre, ils s’occupent de la production des Midlands britanniques à laquelle succède celle d’Irlande du Nord et d’Ecosse d’octobre à février. Ces opérateurs ont désormais un comportement d’arbitrage permanent sur les prix entre les sources d’approvisionnement (Irlande et Grande-Bretagne) et leurs fournisseurs français. 95% des viandes fraîches et réfrigérées qui sont importées en France le sont sous forme de carcasses entières.Au plan des qualités, les carcasses d’importation recherchées pèsent de 16 à 21 kg pour celles des zones sud des îles britanniques et de 17 à 18 kg pour les zones nord moins précoces. Les conformations sont R et U ; les R correspondent aux carcasses les plus recherchées pour la découpe ; les U sont souvent distribuées en carcasse entière, vers des grossistes approvisionnant des bouchers détaillants. Les approvisionnements en catégoriel de Nouvelle-
34

Zélande concernent l'ensemble de ces opérateurs. Ceux-ci, du fait de leur taille, peuvent facilement maîtriser la distribution des containers de 6 à 10 tonnes. Pour ces produits, ils servent de grossistes pour des opérateurs de moindre envergure.
Sur le plan de la découpe, la demande s’est stabilisée entre 70 et 80% de compensé* et 20 à 30% de catégoriel. Les opérateurs ont structuré leurs débouchés en fonction de cet équilibre en développant l'approvisionnement des filières de restauration hors foyer, soit directement, soit par l’intermédiaire de grossistes spécialisés. Le développement de la demande en catégoriel ressentie par la plupart d’entre eux les obligera à la recherche de nouveaux équilibres. A l’heure actuelle, ces opérateurs ne ressentent pas le risque d’une concurrence liée à un arrivage direct de découpes des îles britanniques, les aspects logistiques freinant ces mouvements, les camions étant obligés de remonter les caddies vides une fois les livraisons effectuées sur le continent (30).Toutefois, dans le long terme, ils risquent d’être inquiétés par le renouvellement des techniques de conditionnement. Celles-ci permettraient d’obtenir une DLC (Date Limite de Consommation) plus longue (9 jours environ) pour un produit fragile qui supporte difficilement des délais au-delà de 3 jours entre la commande et la livraison, et de s’affranchir des retours des caddies si les techniques de suremballage sous atmosphère CO2 ou sous vide se développaient. A l’heure actuelle, les fournisseurs d’outre-Manche ont vu leur part de marché croître suffisamment, à partir de la seule expansion de la consommation continentale, et ils n’ont pas eu besoin de se livrer à une concurrence forte sur les services, excepté sur la qualité, l’homogénéité des lots et la présentation des carcasses. Le recours à des techniques nouvelles, coûteuses, n’était donc pas de mise jusqu’à présent. Dans un contexte de resserrement du marché, lié au ralentissement de la demande et au repli de la production, la donne sera peut-être modifiée. Les exportateurs rechercheront vraisemblablement à s’implanter sur le continent soit en s’associant avec des groupes français soit directement avec des plates-formes logistiques de grandes enseignes.
Sur le plan des débouchés, les importateurs découpeurs sont majoritairement tournés vers la grande distribution, qui représente de 75 à 95% de leur activité. La demande semble évoluer selon eux dans deux directions contradictoires : l’une correspond à la baisse de la demande des hypermarchés en UVCI (Unité de Vente aux Consommateurs fabriquée Industriellement), ces magasins reprenant à leur compte une activité de découpe qu’ils avaient reportée massivement sur les découpeurs. Ces derniers ont alors à supporter des à-coups de demande, le volume de découpes demandé variant du simple au double en fin de semaine. L’autre correspond à l’augmentation de la demande en UVCI des supermarchés et supérettes ne disposant pas de personnel spécialisé pouvant gérer un rayon en libre service à côté d’une activité en rayon traditionnel. Ces deux mouvements semblent se compenser mais le développement de l’approvisionnement des supermarchés et supérettes penche vers le catégoriel, ce qui oblige les opérateurs découpeurs à rechercher des marchés pour les morceaux inutilisés. Les grossistes représentent 10 à 25 % de l’activité ; il s’agit pour une part de grossistes locaux mais surtout des grands groupes leaders nationaux.
* en compensé : la carcasse est reconstituée après la découpe et l’acheteur ne choisit pas les muscles.
♦ Les groupes multiviandes travaillant avec la grande distribution
Leur comportement ressemble à celui des importateurs découpeurs, avec une différence essentielle : la plus grande importance de la part d’approvisionnement en production nationale
35

en vif, qui représente de 5 à 35% des volumes. L’essentiel des approvisionnements étrangers est réalisé en viande foraine et l’activité d’abattage est souvent résiduelle. La gestion du calendrier des apports est la même que pour les opérateurs découpeurs ; cependant, les achats diffèrent. Du laiton autochtone de 15 à 17 kg U et R, aux agneaux d’herbe plus lourds (17 à 20 kg), en passant par les agneaux sevrés Lacaune de 16 à 18 kg R et O, et les agneaux d’importation de 17 à 19 kg O à U, venant d’Irlande et de Grande-Bretagne, les marchandises travaillées se répartissent sur un éventail assez serré de poids et de qualité pour les groupes du nord de la France où l’on recherche plutôt les carcasses de 18 à 24 kg de moyenne . Les approvisionnements diffèrent dans le sud, où ils sont centrés sur des carcasses de 16 à 18 kg.Contrairement aux importateurs découpeurs, les groupes multiviandes ont recours aux expéditions sur les grands marchés de consommation (Rungis) pour valoriser les carcasses ne répondant pas aux exigences des enseignes auxquelles ils sont liés. Comme les importateurs découpeurs, ils arbitrent la provenance de leurs achats presque uniquement sur les prix. Ils envisagent la mise en place d’approvisionnement en UVCI à partir de l’Irlande ou de la Grande-Bretagne.Concernant les débouchés de ces groupes multiviandes, on peut noter plusieurs options. Un opérateur approvisionne en majorité des supermarchés avec rayon traditionnel. Il expédie donc des carcasses entières, les approvisionnements en catégoriel se situant sur les pointes de demande, Noël et Pâques ainsi que sur les périodes de promotions. Un autre approvisionne une chaîne d’enseignes composées d’hypermarchés et de supermarchés. Les produits livrés sont des carcasses, pour 60% des tonnages, et des découpes sur le reste (20% en PAD(prêt à découper), 10% en UVCI, 10% en catégoriel). Le troisième travaille avec une chaîne d’enseignes qui jouent la valorisation de produits identifiés. La gestion de ces approvisionnements n’est pas centralisée, elle reste du ressort des responsables locaux des magasins. Lors de l’entretien, le tonnage de viande identifiée était annoncé de l’ordre de 30% pour les magasins concernés. Comme chez les importateurs découpeurs, certains opérateurs ont fait des essais à partir de découpes provenant des lieux de production (Ecosse notamment). Ces tentatives ont été infructueuses, d’une part à cause de la tenue du produit, et d’autre part à cause des pratiques de découpe (coupe à la scie à ruban) qui ne donnent pas satisfaction aux consommateurs continentaux.Ces opérateurs constituent pour les chaînes auxquelles ils sont associés de véritables plates-formes logistiques et commerciales spécialisées. Ils pourront vraisemblablement le rester pour la zone nord. Pour la zone sud du pays, on assiste à une évolution des flux en direction des plates-formes régionales des chaînes de distribution. Ceci risque à terme de faire encore baisser l’activité ovine locale de ces entreprises au bénéfice d’importations directes.
♦ Les opérateurs multiviandes indépendants nationaux
Leur profil d’activité semble commandé essentiellement par leur position géographique. Situés en zone d’expédition, ils travaillent proportionnellement davantage de production autochtone locale et ne recourent aux importations que pour 10 à 30% de leur tonnage. Ces opérateurs sont souvent liés historiquement aux groupes de production locaux et ont gardé des rapports privilégiés avec eux. Leurs débouchés sont des GMS pour 15 à 50% de leur vente. La part des boucheries de détail locales est souvent significative (10 à 45%). Pour le reste ils sont souvent liés à des grossistes (20 à 80% du tonnage) qui leur assurent une bonne partie de la logistique d’expédition et de distribution sur les lieux de consommation. Ces grossistes sont d’ailleurs souvent des fournisseurs de boucherie de détail. La majorité des opérateurs est favorable à une identification à caractère géographique des produits, parallèlement à l’utilisation plus modérée d’une identification spécifique à l’entreprise. A l’inverse, les opérateurs situés dans les zones déficitaires ont plus largement recours à l’importation (de 50 à 70% de leurs approvisionnements) et aux GMS dans leurs débouchés (de 60 à 100%).
36

En terme de demande de produits, les entreprises concentrent leur choix sur des agneaux U et R de 15 à 18 kg pour le sud de la France et de 18 à 22 kg pour le nord. Pour livrer les boucheries de détail, la moitié des entreprises se fournissent en Hollande en carcasse U de 15 à 19 kg. Les exportations sont absentes de l’activité de ces entreprises sauf pour celles de la zone herbagère du Centre-Ouest qui expédient des agneaux légers vers l’Italie en accompagnement des carcasses de jeunes bovins. Ces tonnages peuvent alors être significatifs en atteignant parfois 15 à 30% de leur activité ovine.
♦ Les abatteurs multiviandes indépendants régionaux
Leur approvisionnement ovin se fait quasiment à 100% en vif. Ces entreprises maintiennent une part de transactions vers les boucheries de détail de 15 à 30%. Celles situées en zone d’expédition jouent le maintien dans cette filière à travers un réseau de grossistes leur permettant de diminuer les frais logistiques d’approvisionnement sur des lots de quelques carcasses. Ces entreprises expéditrices ont donc un comportement très proche des abatteurs spécialisés et jouent un rôle important dans la dynamique de la production locale en adhérant aux différents programmes, souvent collectifs, d’identification que leur proposent les groupes de production. Cette politique confirme l’importance pour elles de maintenir une activité ovine d’abattage.
♦ Les abatteurs spécialisés
Ces entreprises sont en partie situées dans les zones d’expédition, notamment dans la zone du croissant herbager du Centre-Ouest et traitent exclusivement du vif. Quand elles ont recours à l’importation, elles le font de façon limitée, en vif également et pour 5 à 15% de leur activité. Les grossistes constituent une part prépondérante de leurs débouchés (de 70 à 100%). Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement des boucheries de détail et des magasins de taille moyenne. S’agissant des importations, la part de la provenance hollandaise est significative (5%) et se fait en animaux vivants. L’objectif pour les opérateurs est de compléter leurs lots en carcasses de 17 à 18 kg de conformation U2, U3 destinés aux boucheries de détail. Le développement de la découpe ne fait pas partie de la stratégie de ces opérateurs.
♦ Les grossistes d’amont
Leur stratégie est influencée et conditionnée par 6 types de facteurs principaux : l’homogénéité de leur zone d’action, la tendance d’évolution de la production locale, la stratégie de leurs partenaires d’aval, la force des liens qui les relient à ces partenaires, l’appartenance à une zone déficitaire ou excédentaire et leur volume d’activité. Les logiques de travail de ces opérateurs sont donc soumises à de fortes contraintes sur lesquelles ils ne peuvent pas toujours peser suffisamment. Ils sont tous orientés en la faveur de l’identification des produits. Dans les zones expéditrices, on rencontre deux types de stratégies : soit l’opérateur approvisionne un ou des abattoirs locaux et ses produits sont alors majoritairement expédiés en viande foraine, soit l’opérateur combine expédition en vif et approvisionnement d’une filière d’abattage local. Dans les zones déficitaires, les grossistes d’amont s’insèrent dans les filières locales d’abattage. Certains se positionnent accessoirement sur une fonction
37

d’engraissement des agneaux maigres extérieurs à leur zone. D’autres essaient de développer une relation directe avec les distributeurs finaux des produits et ne font intervenir les abatteurs locaux que comme simples prestataires de service. Les grossistes d’amont sont généralement de faible taille, ce qui limite leur impact dans la filière, notamment celui des politiques d’identification qui s’y trouve morcelé (30).
2.2 Le pôle Sud-Est
Important par l’ampleur de sa production, il l’est également pour cette étude car c’est le centre de la production de l’Agneau de l’Adret, application pratique de cette étude. Un chapitre lui sera donc consacré, afin de mieux situer la production ovine dans ce vaste secteur géographique.
2.2.1 L’organisation de la filière régionale (33)
Les outils d’abattage drainent 3 zones de collecte principales :
♣ le pôle Sud-Est lui-même, s’occupant des agneaux locaux, essentiellement de bergerie, représentant 20 à25% de l’activité des abatteurs enquêtés
♣ le bassin laitier aveyronnais, source d’approvisionnement pour l’ensemble des opérateurs, qui y effectuent 10 à 15% de leurs achats sous la forme d’agneaux sevrés engraissés en atelier. Deux abatteurs s’y fournissent également en agneaux sous la mère.
♣ La zone du bocage bourbonnais et son extension herbagère bourguignonne, fournissant au pôle sisteronnais des agneaux laitons de bergerie et des agneaux d’herbe.
♣ Il existe une quatrième zone concernant deux abatteurs s’approvisionnant en agneaux de bergerie et d’herbe pour le premier dans l’ Eure et l’Aisne, pour le second en Haute Marne et en Lorraine. 3 abatteurs collectent des agneaux dans la montagne auvergnate directement ou par l’intermédiaire de coopératives d’amont ( pour une part plus faible des approvisionnements).
En ce qui concerne les échanges extérieurs, la production locale ne couvrant pas le quart des activités des opérateurs de la région, tous traitent de la production britannique de façon continue dans l’année, surtout en vif et pour une plus faible part en viande foraine sous forme de carcasses entières. Les trois abatteurs ayant gardé une forte activité en direction des bouchers détaillants, ils maintiennent un flux d’approvisionnement en provenance des Pays-Bas et d’Irlande régulièrement au cours de l’année. Elles concernent principalement du vif, et un peu de viande foraine. Un seul abatteur travaille du catégoriel* néo-zélandais en « chilled »** .
*catégoriel :muscles débités à partir de la carcasse et choisis par l’acheteur**chilled : gigots ou carrés conservés sous régime du froid positifLe volume des approvisionnements hors du territoire français varie de 50 à 60% suivant les opérateurs et selon les estimations du GEB. Il est plus fort en viande foraine quand l’activité de découpe est importante. La Grande-Bretagne est la source la plus importante de ces importations, avec des carcasses de plus de 17 kg, suivie par les Pays-Bas, avec des agneaux de 18 à 20 kg en notation R+ et U (cette classification sera détaillée dans la partie
38

commercialisation de cette étude), puis par l’Irlande et enfin par l’Espagne qui fournissent en mars, avril et début mai des carcasses semblables aux agneaux Lacaune des ateliers d’engraissement.
2.2.2 Les différentes productions locales
Quelle que soit sa forme, la production locale reste une production très saisonnière, centrée sur les premiers mois de l’année : les 2/3 des abattages sont réalisés en janvier et février. Elle baisse à partir de mars jusqu’au mois de juin pour passer de 45 à 40% des abattages totaux réalisés sur la région, puis, à partir de juillet, elle reste aux alentours de 35% de moyenne pour augmenter légèrement en décembre. La région PACA est fortement déficitaire : près de 4 agneaux consommés sur 5 proviennent de l’extérieur alors que 93% des agneaux produits dans le Sud-Est sont abattus sur place ( soit seulement 7% de la production exportée en vif vers l’Italie et l’Espagne). Ces agneaux sont pour 93% des agneaux de bergerie (70% intégralement et 23% sont des agneaux d’herbe finis en bergerie) et pour les 7% restant il s’agit d’agneaux d’herbe. Cette production est issue de races locales rustiques : Préalpes pure ou croisée, Commune des Alpes, Mérinos d’Arles et Mourérous pure ou croisée, qui donnent des carcasses de conformation R pour les 2/3 et O pour le reste.La figure n°7 résume les principaux types de viandes d’agneaux détaillées ci-après :
Figure n°7 : Principaux types d’agneaux commercialisés en France en 1999 :
Type d’agneau Caractéristiques Débouchés
Agneaux exportés en vif20 000 à 40 00010 à 13 kg carcasse Fêtes de Noël
Italie
Agneaux de lait>40 00010 à 13 kg carcasse GMS
Espagne
Agneaux sevrés précocement2 0009 à 12 kg carcasse Belgique
Italie
Agneaux de boucherie « classique »
>40 00015 à 18 kg carcasse GMS
Boucheries de détail
Agneaux sevrés aveyronnais
20 000 à 30 00014-15 kg carcasse15-17 kg carcasse17-18 et 18-19 kg carcasse
ChevillardsBouchers détaillantsDécoupe
Agneaux de boucherie Adret9 80015 à 18 kg Diffusion régionale par un
opérateur quasi-exclusif
Source : (33)On rencontre sur le marché les différents types de viande ovine suivants :
♣ les agneaux exportés en vif : ils ne représentent qu’un débouché restreint, environ 20 000 à 40 000 agneaux vendus de fin novembre à fin janvier. Cette activité est largement
39

centrée sur les fêtes de Noël. Cependant, depuis 1995, quelques opérateurs de Sisteron démarrent une activité d’exportation de carcasses très légères (10 à 13 kg) vers l’Italie, avec des transactions un peu trop faibles pour que l’on puisse déjà les qualifier de marché à part entière (500 à 1000 agneaux en 1994).
♣ Les agneaux de lait : d’un poids carcasse de 10 à 13 kg, ils fournissent une demande très importante, estimée à plus de 40 000 carcasses, dont la plus grosse part revient aux GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et un peu aux bouchers détaillants. Cette production oblige à passer par un atelier de découpe industriel afin de préparer des barquettes ou des caissettes. A l’heure actuelle seule la SOFRAG (Société Française de l’Agneau) s’est engagée de façon volontaire dans la promotion de ce produit, sa démarcation (le Grillonnet) et la recherche d’une relation contractuelle avec les producteurs afin de s’assurer un approvisionnement stable. La saisonnalité de la production (recherche d’agnelages en juin, juillet pour obtenir des agneaux à partir de fin août) et l’exportation en vif vers l’Espagne vont un peu à l’encontre de cette régularité. Ces agneaux sont majoritairement des femelles rustiques pures ou croisées viande, bien démarrées sous des mères bonnes laitières et abattues à un jeune âge pour éviter un engraissement excessif, pénalisé aussitôt en abattoir par une mauvaise classification et donc peu valorisé sur le marché. Cette production semble se développer compte tenu de la très forte demande, et il semble qu’elle doive s’étendre à d’autres régions afin de pouvoir satisfaire la demande de tous les acheteurs.
♣ Les agneaux sevrés précocement : contrairement aux agneaux de lait, élevés sous la mère, ceux-ci sont élevés au lait reconstitué et donnent des carcasses de 9 à 12 kg, l’optimum étant de 9 kg, ce qui correspond à des poids vifs de 18 à 20 kg. Les carcasses sont déclassées au-delà de 12 kg. Les agneaux encore plus légers (6 kg de carcasse) sont commercialisés dans les filières chevreaux. Le rendement est de 60% pour les carcasses avec fressure (abats rouges) sans la tête. Les agneaux sont âgés de 6 semaines minimum à l’abattage avec un maximum de 70 jours. Certains agneaux atteignent 400 g de gain moyen quotidien, ce qui peut provoquer des problèmes de couleur sur les carcasses. La production s’étale de début novembre à fin mai. Ce produit fait l’objet d’un cahier des charges qui codifie l’usage de la poudre de lait et le logement ( case de plus de 2 m², moins de 8 agneaux par case en dessous de 1 mois d’âge, moins de 5 agneaux par case au-delà de 1 mois). Pour ce type d’agneau il existe un fort créneau à l’export vers la Belgique et l’Italie, la vente en France n’intéressant en fait qu’une clientèle réduite de restaurateurs. Des démarches sont d’ailleurs en cours avec une centrale d’approvisionnement de restaurateurs, afin de développer les marchés et de limiter les frais de transport et de livraison. Ayant démarré avec 100 agneaux par semaine soit 3 000 par campagne, ce marché est en pleine expansion et se cale sur celui des agneaux de lait à Noël et à Pâques. Cette démarche de segmentation s’accompagne de diverses actions de promotion, notamment auprès de la restauration locale. Au démarrage de cette production, ces agneaux correspondaient à une volonté des éleveurs de races prolifiques de trouver une valorisation spécifique, ces races produisant en effet le plus souvent des agneaux d’un poids faible à la naissance, avec une conformation limitée entraînant souvent une finition difficile. Ce mode de production s’est avéré également adapté aux autres types génétiques pour lesquels il représente une bonne opportunité de tri selon des critères portant sur les agneaux eux-mêmes ou sur les mères : agneaux petits à la naissance, issus d’agnelles ou de brebis âgées, jumeaux ou triplés… L’objectif de production est de bien finir l’agneau en allaitement surtout sur les agnelages tardifs vers le 15 mai. Ce produit nouveau constitue une alternative aux mauvais agneaux gris et aux mauvais agneaux de report de fin de période. Il améliore la proportion de bons agneaux de lait dans les lots de production plus conventionnelle cependant, il ne résout pas les actuels problèmes de déficit budgétaire des éleveurs ovins.
♣ Les agneaux sevrés aveyronnais achetés par les opérateurs du pôle de Sisteron se répartissent en 4 classes de poids : 14-15 kg, 15-17 kg, 17-18 kg, 18-19 kg. Chacune
40

correspond au type de débouché : les agneaux les plus légers sont demandés par les chevillards travaillant avec une forte proportion de bouchers détaillants, les plus lourds par ceux qui réalisent la plus forte proportion de découpe. Cette variabilité dans la demande permet aux gestionnaires de l’engraissement de réaliser des tris et l’allotement nécessaire à la bonne finition des agneaux.
♣ Les agneaux de boucherie « classiques » : ils donnent des carcasses de 15 à 18 kg, essentiellement de bergerie, et de classement R3. Leurs caractéristiques essentielles sont : une viande claire, des carcasses pas trop lourdes, pas d’odeurs désagréables, pas de goût de suin rejeté par le consommateur. Leur présence est assurée dans tous les secteurs de la distribution : GMS et boucheries de détail. C’est sur ce produit que la concurrence des îles britanniques est la plus forte depuis 1991, sous la forme de carcasses de 18 à 20 kg d’agneaux d’herbe de bonne qualité. Ils viennent se positionner souvent en milieu de gamme de prix dans les linéaires des GMS et les boucheries de détail, souvent aussi en remplacement de la viande de mouton.
♣ L’agneau de boucherie « Adret » est une marque implantée sur le marché en 1993 et gérée par le GIE ovin de la région Rhône-Alpes. En 1995, la commercialisation identifiée a atteint 9 800 agneaux pour un total de 15 800 certifiés. Elle repose sur une conformité à un cahier des charges agréé (17). Les carcasses doivent peser entre 15 et18 kg maximum (poids optimum de 17 kg), avoir un état d’engraissement de 2 à 3 et être de conformation E, U ou R. L’âge maximum de 185 jours pour les agneaux abattus entre le 15 juillet et le 14 novembre doit s’abaisser à 150 jours dans la période du 15 novembre au 14 juillet pour les agneaux de bergerie. Jusqu’ici, les agneaux ont été commercialisés pour 40% dans les boucheries de détail, et pour 60% dans les filières GMS. La production d’un agneau croisé est largement encouragée (bélier Charolais ou Berrichon du Cher) sur les races maternelles courantes dans la zone de production : Préalpes du Sud, Blanche du Massif Central, Noire du Velay, INRA 401, Mourérous, Grivette. La zone concernée est potentiellement large, puisqu’elle peut englober les régions Rhône-Alpes, PACA et Auvergne, mais elle est limitée de fait aux régions Rhône-Alpes et Auvergne et au département des Hautes Alpes. La diffusion de la marque est essentiellement régionale autour de l’agglomération lyonnaise par le fait d’un opérateur quasi-exclusif.
♣ Le mouton représente une demande estimée à environ 15 à 20% du marché régional de viande ovine. Cette viande de couleur rouge foncée, à odeur souvent marquée, issue le plus souvent de jeunes brebis, est recherchée par des consommateurs ayant un faible niveau de revenu, essentiellement urbains, en raison de son prix peu élevé.
2.2.3 Structuration des abattages
Les entreprises de la zone Sud-Est sont en moyenne de taille plus importante que les entreprises des autres gros pôles d’abattage que sont le Centre-Ouest et le Sud-Ouest, et plus spécialisées en ovin. En terme d’approvisionnement, en 1997, seule la zone Centre-Ouest, à faible saisonnalité, ne fait quasiment pas appel à des achats hors zone mais complète ses achats vifs par de l’import viande foraine. Les deux autres régions qui possèdent des outils d’abattage spécialisés et de forte capacité font appel à des achats hors zone.Pour les débouchés, le taux de vente aux GMS est très important dans le Sud-Est où 83% des entreprises visitées par l’OFIVAL en 1995 et 1996 (32) réalisaient plus de 50% de leur vente avec les GMS. Dans le Centre-Ouest, seules 30% des entreprises avaient de fortes relations
41

avec les GMS et, dans le Sud-Ouest, une seule entreprise. Enfin, des entreprises du Sud-Est et certaines entreprises multiviandes du Centre-Ouest travaillent avec les GMS en découpe. Les volumes découpés représentent dans les mêmes entreprises que précédemment respectivement 14% des volumes traités dans le Sud-Est et 6% dans le Centre-Ouest, contre seulement 1% dans le Sud-Ouest. En ce qui concerne les abatteurs spécialisés situés dans le Sud-Est, confrontés à un déficit de la production locale, ils combinent diverses sources d’approvisionnement : agneaux sevrés aveyronnais, agneaux de la montagne d’Auvergne, agneaux de la zone bourbonnaise et de son extension bourguignonne et importations en provenance des îles britanniques de mai-juin à octobre-novembre. Parmi ce groupe, on peut relever deux stratégies différentes : l’une basée sur une activité de découpe importante (60 à 70% du tonnage travaillé) avec des relations fortes avec les GMS, l’autre plutôt axée sur des débouchés de type grossistes et boucheries de détail, n’abordant la découpe que pour tenir leur marché. Contrairement aux abatteurs spécialisés des zones expéditrices, les abatteurs de cette région Sud-Est ont recours de façon plus significative aux importations en viande foraine et en vif.Ces entreprises sont confrontées à un double problème : d’une part, elles doivent supporter les aléas d’un seul secteur d’activité sans compensation sur un autre produit, et sans possibilité de diluer leurs charges de structure ; d’autre part, elles ne peuvent afficher dans leur offre commerciale la palette de produits que demandent en général les acheteurs. Ces contraintes les obligent à maintenir leur demande en qualité et homogénéité des produits assez haute vis à vis des fournisseurs et à garder une grande rigueur dans les services à la clientèle.
2.2.4 Un marché de la découpe encore mal maîtrisé
La grande majorité des opérateurs demeure attachée à une vente de carcasses au lieu de se tourner vers la découpe. Une seule entreprise sur les 6 ayant participé à une étude réalisée par l’Institut de l’élevage (33) dans cette zone, affiche depuis longtemps une stratégie affirmée de développement de la découpe, et fait de cette orientation l’instrument majeur de sa progression. Mais on peut constater à l’heure actuelle sur le pôle sisteronnais un changement de perception de la découpe. Sous la pression croissante des GMS, certains abatteurs sisteronnais sont en effet obligés, et ce, afin de conserver leur marché, de fournir une prestation de découpe à façon. Toutefois, une différence de stratégie reste apparente. Si pour la première entreprise, depuis longtemps en liaison commerciale avec les GMS, la découpe reste le moteur du développement, pour les autres, elle conserve son statut de « mal nécessaire » que l’on aborde avec pragmatisme. Cette résistance à l’évolution vers la découpe reposait jusqu’à présent sur une assise forte de boucheries de détail et GMS disposant d’un rayon de boucherie traditionnel, où le chef boucher, s’il est souvent un interlocuteur difficile et exigeant commercialement, reste néanmoins un praticien apte à valoriser des carcasses entières. Ainsi le pôle sisteronnais semble en train d’intégrer le groupe des abatteurs-découpeurs. Les années à venir nous diront si cet état est pérenne. Soulignons cependant la nette progression de la boucherie de détail et de demi-gros « hallal » dont nous étudierons ultérieurement les impacts commerciaux, ce qui marque à la fois l’institutionnalisation de plus en plus marquée de ce type de distribution et les chances de maintien d’une demande en carcasses entières au moins dans un avenir proche. Du fait de leur volume d’activité, les opérateurs rencontrés sont tous des « importateurs » nets au regard de la production locale.
3. LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION
3.1 Bilan en rapport avec l’évolution de la consommation de viande ovine
42

La figure n°8 cartographie la situation de la France en 1999.
Figure n°8 : Production et consommation de l’UE en 1999 (en milliers de tonnes) :
Avertissement : pour simplifier les graphiques, certains regroupements de pays anciennement retenus pour le fonctionnement de l’OCM ont été conservés. L’Espagne est par exemple traitée avec le Portugal, la Grèce avec l’Italie. La zone « Nord Continent » regroupe maintenant 8 pays. Elle comprend les Landers de l’ex-RDA depuis 1989 ainsi que les 3 nouveaux pays membres à partir de 1993.
Source : (29)
En 1998, la France est le deuxième consommateur européen de viande ovine (36)(19)(28). Les ménages réalisent 72,5% de leurs achats en viande ovine dans les super et hypermarchés. La viande ovine représente 5,3% de la consommation totale de viande en France et 4,2% dans l’Union européenne. En 1999, la consommation indigène contrôlée d’ovins-caprins, mesurée par bilan, s’est établie à 268 700 tec, soit 1 700 tec de plus que celle de 1998 (+ 0,6%), retrouvant ainsi son niveau de 1997. Cependant, la consommation de viande d’agneau ne parvient pas à retrouver le rythme de croissance qu’elle avait connu avant 1995. Le panel SECODIP a constaté la même évolution au travers des achats des ménages qui ont augmenté de 0,5%. Il relève aussi un
43

déplacement de la clientèle : des bouchers qui perdent 2 points de part de marché vers les hyper et les supermarchés qui en gagnent chacun un et demi.
3.2 Les circuits de commercialisation de la viande ovine (11)
3.2.1 Les GMS (20)
Une différence notable de comportement existe entre les hyper- et les supermarchés. En période de forte disponibilité des importations, à partir de mai et jusqu’en décembre, l’approvisionnement des hypermarchés bascule presque à 100% en viande foraine d’importation. Les supers maintiennent plus fréquemment un équilibre entre la production française et les importations (proche de 50/50). Mais cet équilibre est fragile : l’année 1995 a vu totalement basculer les approvisionnements vers les importations.Les magasins de moyenne surface tendent à développer à la fois un rayon traditionnel et un rayon de libre service, ce qui fait osciller leur demande entre des carcasses entières d’origine française parfois haut de gamme (magasins des centres villes) et des approvisionnements importants en UVCI pour les rayons libre service gérés par du personnel peu qualifié. Avec la viande porcine, la viande ovine est la plus promotionnée du rayon viande. L’effet de ces promotions est tel qu’il a amenuisé l’intérêt des grandes fêtes (Pâques et Noël). Avec l’usage du catégoriel, néo-zélandais en « chilled », irlandais et britannique en frais, les pics traditionnels de montée des prix se sont érodés.Enfin, on rencontre quelques opérations liant la production locale à des grands magasins des périphéries urbaines régionales. La mise en place des plates-formes logistiques risque de fragiliser ces démarches intéressantes, surtout lorsque les pôles de production ne peuvent pas compter sur des abatteurs locaux pour relayer leur dynamisme.Une évolution a également lieu dans le domaine de la découpe industrielle. Certains opérateurs sont obligés de l’adopter afin de pouvoir rester référencés auprès de chaînes de GMS (par exemple le pôle sisteronnais). Cependant, beaucoup d’hypermarchés sont actuellement en train d’effectuer un retour en arrière sur l’activité de découpe, la reprenant à leur compte alors qu’ils l’avaient longtemps délaissée. Ils peuvent alors mieux gérer l’affectation de leur personnel en reportant sur les opérateurs d’amont une activité moindre mais beaucoup plus variable. En début de semaine il s’agit surtout d’une demande en carcasses ; en fin de semaine, le volume de découpe double ou triple. Les ateliers de découpe industrielle ont alors à gérer les à-coups de la demande. Ces pratiques favorisent les flux d’importations, plus importants, plus disponibles et moins chers que la production nationale.Un équilibre général, qui paraît stable, semble s’instaurer entre la découpe en compensé et en catégoriel : il est de l’ordre de 70 à 80% pour le compensé et 20 à 30% pour le catégoriel. Au niveau national, les importations de catégoriel en provenance de Nouvelle-Zélande sont restées stables en 1995 après une forte augmentation en 1994. L’accélération des importations de découpe semble se faire directement vers la restauration ou vers les plates formes de distribution, ce qui limite momentanément le développement de cette activité sur le continent.
3.2.2 Les boucheries de détail
Ce secteur reste rémunérateur. Dans le court terme, il impose des coûts logistiques de distribution importants mais affranchit les entreprises d’opérations de découpe toujours
44

coûteuses. A long terme, on peut penser que leur part de marché va rester stable. Les artisans bouchers restent des prescripteurs qui comptent.
3.2.3 La demande en viande « hallal »
Elle a accru sa place sur le marché français. La population maghrébine reste très consommatrice de viande ovine fraîche : pour cette catégorie de produit, son indice de consommation est trois fois supérieur à celui de la population non maghrébine, soit 80 000 tonnes de consommation totale sur 300 000 tonnes, essentiellement en Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA, Pas-de-Calais. Cette forte demande constitue un débouché important dans une conjoncture générale de stagnation. La filière maghrébine se structure et s’institutionnalise de plus en plus, assurant notamment dans certains cas le relais des boucheries de détail lors de la cessation d’activité des bouchers non spécialisés en viande « hallal ». La demande de viande « hallal » paraît s’uniformiser sur le créneau classique d’agneaux R2/R3 au lieu de rester cantonnée autour de la fête de « l’aïd », et n’est plus uniquement acheteuse d’animaux de qualité médiocre comme c’était le cas il y a quelques années.
Le tableau suivant résume la distribution de la viande réalisée par les trois grands pôles d’abattage français :
Tableau n°6 : Importance relative des différents débouchés de la viande ovine en France en 1997:
En % des ventes % GMS % GROSSISTES % BOUCHERS % HALLAL
Centre-OuestSud-EstSud-Ouest
256229
561349
132117
?810
Moyenne 39 39 17 ?
Source : (33)
4. LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Les principaux échanges ont lieu selon le schéma suivant (figure n°9 ) :
45

Figure n°9 : Principaux flux de viande ovine en 1997 (1 000 tec) :
Source : (29)
4.1 Les échanges intra-communautaires
4.1.1 Un marché perturbé par les crises
L’histoire de l’organisation commune du marché de la viande ovine est particulièrement mouvementée (11). Lorsque la CEE ne comportait que 6 Etats membres, le France dominait le secteur ovin tant par le niveau de sa production que par celui de sa consommation. Un mécanisme de protection du marché et de soutien des cours avait été mis en place avec la perception de restitutions ou même la fermeture des frontières aux pays tiers. Cette politique protectionniste, qui permet la protection de l’élevage français dans les années 1960-1980, bénéficie également à nos partenaires en tirant les prix vers le haut. Avec l’élargissement de 1972, la position française dans l’Europe ovine est moins dominante mais le système antérieur est maintenu pour une période transitoire prévue jusqu’en 1977. Lorsque cette phase s’achève, si un compromis - concédant la libre circulation – est rapidement trouvé avec le Danemark, puis avec l’Irlande, on continue de traiter le Royaume-Uni comme un pays tiers. Les choses s’enveniment rapidement entre Londres et Paris et une pénible « guerre du mouton »,
46

véritable bataille juridico-politique s’engage, émaillée de procès, de communiqués, de réunions-marathons et de manifestations. En 1979, la France est condamnée par la Cour européenne de justice « à accepter immédiatement la libre circulation intra-communautaire, avec ou sans règlement ovin ». Le dossier n’est pas simple, il faut concilier les intérêts des Britanniques ( qui ont une politique d’importation très libérale) et ceux des Français (qui protègent leurs producteurs et se lancent dans l’extensification). Dans ces négociations, la France n'est pas en position de force, la filière ovine n’étant pas assez concentrée pour constituer un groupe de pression puissant. Finalement, on aboutit à un compromis très particulier en mai 1980 et le 20 octobre 1980 le marché commun de la viande ovine entre en application (règlement CEE n°1837/80).A partir du moment où l’Organisation Commune du Marché pour le secteur ovin viande a été mise en place, en 1980, la CEE a été confrontée à un important développement de son élevage et des coûts de soutien du revenu. Avec une recette garantie par la communauté, les cheptels ovins de la plupart des Etats se sont forcément développés. Seule la France a fait exception. Cette expansion a duré 12 ans et n’a été cassée que par l’instauration des quotas individuels de PCO, à partir de 1993. Ces quotas, en limitant le nombre de primes attribuables, ont à peu près figé les divers élevages nationaux au niveau auquel ils étaient parvenus au début des années 1990. Quel que soit le pays et le système de production, les PCO avaient pris une telle importance dans le revenu des éleveurs qu’il devenait antiéconomique de garder des brebis non primées. D’où, pendant la période 1993-1996, un alignement rapide des effectifs nationaux sur les références accordées. Le repli des effectifs s’est avéré particulièrement sensible outre-Manche, où Royaume-Uni et Irlande auront perdu 860 000 femelles reproductrices en trois ans. Et le cheptel européen pouvait sembler à peu près stabilisé quand a éclaté la crise bovine.L’affaire de la « vache folle » qui a surgi au printemps 1996 a perturbé l’équilibre qui était en train de s’instaurer dans le secteur ovin (17). Elle a provoqué d’importants transferts de demande et des augmentations de prix de la viande ovine qui ont été suffisants pour inverser le comportement de beaucoup d’éleveurs outre-Manche. Avec la hausse générale des prix du marché, synonyme d’une baisse des PCO, certains ont pu à nouveau caresser l’espoir de relancer la production même avec une partie du troupeau ne touchant pas la prime. Cela s’est traduit par la rétention de plus de 400 000 femelles supplémentaires en 2 ans au Royaume-Uni. Mais, surtout, cela a immédiatement entraîné une forte relance de l’engraissement. Une spéculation d’autant plus tentante que le nombre de maigres disponibles était important en raison du fort recul des exportations d’agneaux très légers chez les partenaires du Sud de l’Union. Cependant la conjoncture s’est complètement inversée avant la fin de l ‘année 1997. Les experts de l’Office britannique des viandes (MLC) ont estimé que les transferts d’agneaux de 1997 sur la campagne 1998 ont porté sur 3.8 millions de têtes, 20% de plus qu’entre 1996 et 1997. L’abattage précipité de ces nombreux « hoggets » a provoqué l’effondrement du cours britannique du début de l’année 1998. Puis, alors que les naissances de printemps avaient été plus importantes, la crise sur le marché mondial des peaux a entraîné les cours de l’automne à des niveaux encore plus bas. En fait, les prix payés aux éleveurs à la fin de l’année 1998 étaient devenus tellement bas que beaucoup ont choisi de différer encore les mises en marché. Ils ont retardé la réforme de vieilles brebis et reporté encore plus de jeunes agneaux en faisant souvent saillir les femelles... Tant et si bien que la situation de l’année 1999 s’est trouvée hypothéquée.
4.1.2 Reprise des échanges intra-communautaires
47

Face à l’augmentation de la production outre-Manche, le recul de production le plus important est celui observé en France (un peu moins de 3 000 tonnes), mais on note aussi des évolutions négatives aux Pays-Bas, au Portugal et surtout en Espagne. La chute de l’offre a rapidement suscité une reprise des importations espagnoles d’ovins vivants, qui étaient tombées à un très bas niveau, suite à la multiplication des problèmes sanitaires. Cela a donné un coup de fouet aux échanges intra-communautaires de vifs, en profitant d’abord à la France. En revanche, la baisse des disponibilités a porté un mauvais coup aux exportations que l’Espagne s’efforçait de développer, tout particulièrement vers la France.
4.1.3 Les pays exportateurs
En 1999, les principaux pays exportateurs de l’Union Européenne sont le Royaume-Uni, l’Irlande et les Pays-Bas.La France a développé ses ventes en animaux vivants à l’Espagne (+ 13%) et les a maintenues avec l’Italie. En viandes, elle a également accru ses ventes de + 16%.
4.1.4 Les pays importateurs
En 1999, la France est toujours, pour ses partenaires européens, la principale destination des produits ovins. Elle a à la fois augmenté ses achats en animaux vivants (+ 3,4%) et en viandes (+ 4,2%).L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne figurent parmi les pays les plus fortement importateurs de l’Union Européenne tant en viandes qu’en animaux vivants.
4.2 Les importations françaises
4.2.1 Animaux vifs
En 1999, le niveau des importations d’animaux vivants a été légèrement plus élevé (+3.4% soit 24 000 têtes) que celui de 1998. Les importations d’ovins-caprins ont atteint 720 000 têtes dont 574 000 agneaux (+5.5%), 135 000 brebis (-4%) et 11 000 caprins (=).Comme les années précédentes, les importations se sont limitées aux pays de l’Union, peu d’achats ayant été réalisés aux pays tiers. La répartition des volumes importés entre les différents fournisseurs communautaires a évolué sensiblement par rapport à 1998. Les Pays-Bas demeurent le premier d’entre eux. Ils ont conforté leur position devant le Royaume-Uni et l’Espagne dont les ventes à la France ont diminué.La baisse des introductions de brebis a été due au recul des expéditions anglaises, espagnoles et irlandaises non compensées par la progression de celles des Pays-Bas. Les entrées d’agneaux anglais ont augmenté de 25 000 unités et celles des Pays-Bas de 28 000 têtes alors que celles d’Irlande et d’Espagne ont diminué.
4.2.2 Viandes
48

En 1999, les importations de viandes ont progressé de 6 700 tec (+ 4%) et atteint 168 000 tec. Cette augmentation provient à la fois d’une progression des expéditions des pays tiers (+ 2 500 tec soit + 8,6%) et de celles de l’Union (+ 4 200 tec soit + 3,2%).Les ventes du Royaume-Uni à la France, après avoir stagné au premier semestre, se sont accrues au deuxième L’Irlande a également augmenté le niveau de ses exportations vers la France (+ 3,5%) qui se sont élevées à 44 000 tec. Ses exportateurs éprouvent davantage de difficultés à pénétrer le marché français face à la concurrence anglaise et à la segmentation croissante du marché français.Les importateurs français ont davantage fait appel en 1999 aux viandes d’origine néo-zélandaises. Leurs achats ont progressé de 3 700 tec (+ 14,.6%) et ont atteint 29 000 tec. Les expéditions de viande « chilled » ont augmenté même plus fortement, passant de 3 900 tonnes en 1998 à 5 500 tonnes (+ 41%). Avant 1999, elles étaient concentrées sur 2 périodes : avant Pâques et avant Noël. Cette année, les niveaux de Pâques et de Noël ont certes été en légère hausse mais des tonnages importants ont aussi été introduits au cours de l’été.
4.3 Les exportations françaises
4.3.1 Animaux vifs
En 1999, les exportations d’animaux vivants ont retrouvé un bon niveau, s’établissant à 980 000 têtes, soit près de 50 000 têtes de plus qu’en 1998 (+ 5,1%). Elles avaient pourtant été inférieures à celles de 1998 jusqu'au mois d'août. Ce n’est qu’à partir de fin septembre que les ventes d’agneaux légers à l’Espagne se sont considérablement développées grâce aux prix élevés pratiqués par le marché espagnol. L’Espagne redevient le premier client de la France devant l’Italie qui répète sa performance de 1998. La Grèce a réalisé une percée en 1999 en achetant 30 000 animaux, soit deux fois plus que l’an passé.Les 980 000 animaux exportés sont répartis comme suit : 767 000 agneaux (+ 26 000 têtes soit + 3,5%), 160 000 brebis (+ 11 000 têtes soit + 7,4%), et 53 000 caprins.Les brebis ont été dirigées vers l’Italie dont les importations ont augmenté de 82% et qui représentent 57% des ventes françaises. Par contre, les Pays-Bas, deuxième client, ont diminué leurs achats de 50%. L’Espagne a également réduit les siens de même que la Belgique . L’Allemagne a cessé ses achats qui étaient de 8 000 têtes en 1998.Les 3 principales destinations (95% des ventes) des 767 000 agneaux vendus ont été l’Espagne l’Italie et les Pays-Bas . La Grèce, pratiquement absente en 1998 (500 têtes), a importé 11 000 agneaux en 1999.
4.3.2 Viandes
En 1999, les exportations de viandes d’ovins-caprins ont dépassé de 1 500 tec celles de 1998 (+ 16%) poursuivant ainsi un développement interrompu en 1997.L’Italie, la Belgique et le Royaume-Uni sont restés les 3 principaux clients, augmentant même en 1999 leur part de marché qui est passée de 72 à 88%.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des valeurs économiques principales dans l’Europe des 15 (d’après l’OFIVAL):
49

Tableau n°7 : Synthèse annuelle de l’Union à 15 dans le secteur ovin :
Production des 15 pays de l’Union (1)
1996 1997 1998 1999*
Production indigène brute 1 129 1 095 1 128 1 134
Abattages redressés 1 143 1 107 1 139 1 146
Variations de stocks 0 4 12 6
Consommation indigène brute
1 391 1 355 1 379 1 385
Auto-approvisionnement (%)
81.2 80.8 81.7 81.9
Consommation individuelle (kg/habitant/an)
3.8 3.7 3.7 3.7
Prix (écu vert/100 kg jusqu’en 1998 puis euro)
362.879 375.293 325.500 330.520
(1) : cumul des productions des 15 pays de l’Union* : estimations
Source : (29)
4.4 Bilan pour la France
En terme de bilan pour la France, 1999 a été marquée par une hausse du volume des échanges, pour les importations comme pour les exportations, et aussi bien pour les échanges d’animaux vivants que pour ceux de viandes.Le bilan financier reste alarmant. Le déficit du commerce extérieur en valeur s’est à peine réduit en 1999 s’établissant à 2,78 milliards de francs contre 2,804 milliards en 1998. Cette modeste amélioration est due aux exportations dont la valeur totale s’est élevée à 580 millions de francs (+ 30 millions soit + 5%), alors que le montant des importations (3,36 milliards de francs) s’est accru de 6 millions de francs (+ 0,2%). L’augmentation des importations en volume (+ 4%) ne s’est pas traduite par une progression de leur valeur. En effet, le prix moyen des marchandises introduites a été plus faible, aussi bien pour les animaux vivants que pour les viandes. Les animaux importés se sont échangés à 16,30 F/kg vif (- 0,75 F/kg vif soit – 4,5% par rapport à 1998) et les viandes à 18,45 F/kg (- 0,60 F/kg soit - 3% par rapport à 1998). La valeur moyenne des carcasses fraîches importées du Royaume-Uni a été de 19 F/kg contre 19,60 F/kg en 1998.
Tableau n°8 : Bilan d’approvisionnement du marché français en 1999:
50

Bilan 1999 Ovins seuls (1000 TEC) Evolution par rapport à 1998
Abattages contrôlés 107,9 -2,4%
Abattages totaux 131,9 - 2,5%
Importations de vifs 8,5 + 2,2%
Exportations de vifs 9,5 + 10,6%
PRODUCTION (PIB) 132,9 - 1,9%
+importations de viande 169,7 + 5,7%
-exportations de viande 9,1 + 23,1%
CONSOMMATION (CIB) 292,7 + 1,4%
Taux d’auto-approvisionnement 45%
Source : Douanes Françaises (29)
On constate le faible taux d’auto-approvisionnement, inférieur à 50 %, ce qui place la France dans une situation de forte dépendance vis-à-vis des pays exportateurs mondiaux et européens. La production française ne couvre pas la moitié de la consommation nationale.
5. LES PRIX
51

5.1 Les prix à la consommation
Le SNM, service du ministère de l’Agriculture, qui relève toutes les semaines les prix de différents types de viande dans 150 grandes surfaces, a mis en évidence une différence de l’ordre de 6 à 13 F/kg entre le prix des gigots identifiés comme « français » et celui des gigots déclarés d’origine « Union européenne ». Dès le premier semestre, le prix des gigots français avait bénéficié d’une progression annuelle de 4%.D’ailleurs, depuis deux ans, l’écart entre le prix des produits français et celui des produits concurrents, en particulier ceux d’outre-Manche, a eu tendance à se creuser. Cela a pu être constaté au stade de gros, sur le marché de Rungis par exemple. Mais ceci s’est traduit par l’évolution comparée des cotations nationales établies au stade de la production. L’écart qui s ‘est creusé entre la cotation officielle française et celle de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande, pour dépasser 8 F/kg pendant l’essentiel de l’année, illustre bien un nouveau comportement des consommateurs qui privilégient les produits identifiés d’origine nationale.
5.2 Les prix à la production
Pour les éleveurs français, l’évolution du prix de vente des animaux est loin d’avoir été aussi satisfaisante que celle du prix des viandes au détail.Après deux années de hausses exceptionnelles en 1996 et 1997, le prix des ovins à la production a subi un sévère repli. La cotation moyenne établie par l’OFIVAL pour 1999 tombe à 24,40 F/kg d’équivalent carcasse, en enregistrant une nouvelle baisse annuelle de 2,1% ( soit 0,52 F/kg) qui suit de près celle de 8,7% observée entre 1997 et 1998. Tout en se maintenant au dessus de leur niveau de 1995, les prix à la production semblent avoir perdu l’essentiel du gain induit par l’effet « vache folle », quand ils avaient soudainement bénéficié d’un transfert de demande et d’un recul des importations. En fait, le nouveau recul enregistré en 1999 est exclusivement dû à la dévalorisation du cinquième quartier qui était déjà intervenue dans le courant de 1998. Pour la seule viande ovine, la tendance était plutôt à la hausse. Ainsi, le prix de gros des carcasses d’agneaux français, qui est relevé sur le marché de Rungis et qui entre pour 25% dans le calcul de la cotation, aura progressé de 5% dans l’année. Mais cela n’a pas empêché le recul du prix moyen officiel.Les deux composantes de la cotation nationale ont connu des évolutions très contrastées. La cotation régionale a baissé de 4,4% alors que la cotation de Rungis a progressé de 4,9%. Alors que pendant les neuf premiers mois de l’année, les cours en régions ont été nettement en dessous de ceux de 1998, ils ont été bien mieux orientés au quatrième trimestre où ils ont été supérieurs de près de 10% à ceux de 1998. La baisse générale des prix de janvier à août dans les principaux pays européens, le peu de dynamisme de la consommation française au premier semestre, la pression des viandes importées à un prix plus faible que l’an dernier sont les principaux facteurs qui expliquent l’évolution des prix en régions pendant les trois premiers quarts de l’année 1999. En revanche, la cotation à Rungis a connu des variations de prix plus fréquentes et de plus grande amplitude. Ce marché de gros est beaucoup plus sensible aux variations instantanées de la demande et aux prix des viandes étrangères importées.
Tableau n°9 : Prix officiels dans quelques pays depuis 1990 (en euro/100 kg carcasse) :
52

Campagnes Royaume-Uni France Espagne Moyenne de l’Union(*)
1995 282.1 328.5 340.2 313.7
1996 334.8 381.2 415.4 363.4
1997 348.9 410.0 400.2 375.2
1998 278.5 376.9 359.2 325.3
1999 272.0 375.3 400.5 330.6
(*) Union à 15 depuis 1995
Source : Commission de l’U.E.-DG6 (29)
5.3 Le cinquième quartier
Le prix des abats d’ovins au détail a poursuivi sa remontée amorcée en 1998, avec une progression de + 2,2%.Sur le marché mondial, selon l’indice calculé par le « Market News Service » à partir d’informations issues d’une cinquantaine d’entreprises, le prix moyen des peaux brutes d’ovin aurait légèrement augmenté en 1999, pour se situer en fin d’année aux environs d’un tiers en dessous du niveau observé avant l’effondrement des cours en août 1998.En France, le prix moyen à l’exportation des peaux brutes d’ovins a plafonné en 1999 à un niveau inférieur de plus de la moitié à celui d’avant la crise économique russe survenue pendant l’été 1998, pays qui était devenu le principal acheteur de peaux d’ovins lainées, et la reprise des exportations vers la Turquie ne s ‘est pas accompagnée d’un raffermissement significatif des prix, malgré un timide amorce en début d’année qui ne s’est pas confirmée par la suite.
5.4 La recette finale
La recette des producteurs sur le marché est systématiquement complétée par les Primes Compensatrices Ovines, attribuées aux brebis et destinées à ramener les recettes moyennes au niveau du « Prix de Base Stabilisé ». Mais le calcul de la PCO est fait sur le plan communautaire. Or, si la cotation française a baissé en 1999, le prix moyen de l’Union, bien qu’établi lui aussi au niveau « sortie abattoir », apparaît finalement en hausse annuelle. En conséquence, le montant définitif de la PCO calculé pour 1999 s’est établi à l’équivalent de 142,20 F par brebis productrice d’agneau lourd. Ce montant est inférieur de 5,35 F par tête à celui de 1998. La hausse des PCO en 1999 n’aura donc pas compensé la baisse des prix à la production.
53

Tableau n°10 : Evolution du prix des carcasses d’agneaux de la PCO et effet sur la recette théorique par kg :
cotation supplément par brebis incidence par kg recette(**)année nationale
(F/kg carc) P.C.O. "monde rural"
P.C.O.(*) "monde rural"
théorique(F/kg carc)
1990 21,9 184,5 10,2 32,21991 23,2 161,2 31,6 8,9 1,4 33,51992 22,4 147.0 55,3 8,2 2,4 33,01993 21,8 166,8 43,9 9,3 1,9 33,01994 22,8 142.0 43,9 7,9 1,9 32,61995 21,7 164,0 43,9 9,1 1,9 3291996 25,1 111,5 43,9 6,2 1,9 33,21997 27,2 100,1 44,4 5,5 1,9 34,81998 24,9 147,5 43,5 8,2 1,9 35,01999 24,4 142,2 43,5 7,9 1,9 34,2
(*) sur la base de 18 kg de carcasses d’agneaux produits par brebis(**)estimation de la recette théorique à partir du prix à la production, auquel ont été rajoutées l’incidence de la PCO (ramenée à 18 kg) et l’incidence (par kg) de la prime « monde rural »
Source : (29)
La filière française de viande ovine est donc sérieusement menacée par la concurrence étrangère : la France ne satisfait que 45% des besoins de sa population par sa production. Face à cette viande de qualité et d’homogénéité constante, la production française a de plus en plus de mal à s’imposer. Seule la différenciation peut lui faire regagner des parts de marché.Devant tant de choix de provenance, de qualité, de prix, le consommateur a manifesté son besoin d’informations sur la viande qu’il désire acheter. Plusieurs catégories se présentant sur le marché, il est devenu urgent de satisfaire cette exigence par la mise en place d’un système d’identification inspiré directement de celui instauré dans la filière de viande bovine.
B.COMMENT DIFFERENCIER LA VIANDE OVINE FRANCAISE
1. UNE SEGMENTATION ENGENDRÉE PAR LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
La crise de l’ESB qui a secoué le marché de la viande bovine depuis 1996 a non seulement modifié sensiblement le comportement des opérateurs de cette filière, mais d’une façon globale a entraîné une évolution très nette de la segmentation du marché des viandes, ovines en particulier. Les opérateurs de la filière bovine ont très rapidement réagi en adoptant une politique de reconquête de la confiance du consommateur ; par contre, les opérateurs de la
54

filière ovine n’ont pas eu cette rapidité de réaction, ce qui fait que la démarche d’identification officielle de viande ovine française est en cours d’élaboration et non effective, à l’inverse du logo viande bovine française.La perte des parts de marché subie par la filière ovine (liée à la chute de la consommation mais aussi à la baisse des importations) a obligé très vite les professionnels à définir et mettre en œuvre une stratégie analogue à celle mise en place pour la viande bovine basée pour l’essentiel sur une reconquête de la confiance des consommateurs en répondant à trois grands besoins exprimés dans l’avis du Conseil National de la Consommation (CNC) :- un besoin d’information par l’accord interprofessionnel sur l’étiquetage de la viande ovine- un besoin de réassurance, à la fois sur l’origine avec le sigle Viande Ovine Française, mais aussi sur les conditions d’élevage avec la mise en place du guide de bonnes pratiques et de la qualification des élevages- un besoin de promotion de la viande sous signe officiel de qualité avec la démarche Critères Qualité Certifiés (CQC) cofinancée par la Commission européenne, dont le sigle est le suivant :
Ainsi, pouvoir repérer l’origine des viandes devient un des premiers critères d’achat pour le consommateur, d’où la justification d’une telle démarche pourtant lourde de procédures et assez coûteuse. La filière s’inscrit dans une démarche de traçabilité, permettant un suivi « du pré à l’assiette ». Ce système, généralisé par l’Interprofession Bétail et Viandes dès 1990, autorisera le transfert ininterrompu de l’élevage à la distribution, d’informations de nature réglementaire ou volontaire à destination du consommateur, pour assurer sa sécurité alimentaire et l’informer. La procédure de traçabilité s’appuiera sur le système d’identification, dotant les animaux d’une véritable carte d’identité individuelle sans laquelle ils ne pourront circuler, comme c’est déjà le cas pour les bovins. Un essai d’identification par puce électronique est actuellement réalisé dans certains troupeaux ovins, ce qui permettrait un suivi informatique individuel de la production depuis l’élevage jusqu’à l’abattoir.
Pour pouvoir repérer les viandes, il est nécessaire de les trier par catégories, donc de les différencier. La différenciation du marché de la viande ovine française se réalise selon les critères exposés ci-après.
1.1 Différenciation sur l’âge
55

Le marché de la viande ovine est approvisionné par une large gamme de produits issus d’animaux d’âges très différents. Il y a donc une première segmentation possible, portant sur l’âge à l’abattage des animaux .
Pour l’essentiel (80% du tonnage), il s’agit de la viande d’agneaux sacrifiés avant d’avoir un an et spécialement élevés dans ce but. Pourtant, environ 15% des animaux sont abattus sensiblement plus âgés et, en poids, assurent facilement 20% de la production de viande ovine. Il s’agit surtout d’animaux de réforme, pour l’essentiel des brebis de 4 à 8 ans parvenues à la fin de leur carrière de reproductrices.Ces animaux de réforme entrent dans les circuits commerciaux et participent tout autant que les agneaux aux échanges internationaux. Si une part des carcasses entre dans les circuits particuliers des viandes de fabrication (béliers, brebis de réforme…), la viande des animaux en bon état est destinée à la commercialisation directe, sous le qualificatif de viande de mouton. Les plus jeunes de ces animaux, comparables aux « hoggets », ces vieux agneaux retardés ou autres antenais issus des élevages d’herbe britanniques, concourent fortement à l’approvisionnement des ateliers de découpe industrielle. Toutefois, les animaux de réforme passent souvent par des filières spécialisées et leur viande est surtout consommée dans les grandes villes du sud de la France ainsi que dans la région parisienne.
Plus de 90% des agneaux rencontrés sur le marché français ont entre 2 et 10 mois d’âge pour un poids carcasse compris entre 11 et 22 kg. Toutes les carcasses font l’objet d’un classement. En dehors de la classe de poids, ces carcasses sont caractérisées par leur conformation et leur état d’engraissement. Par référence à des standards photographiques, le niveau de conformation est noté, dans l’ordre décroissant, par les lettres S, E, U, R, O, et P. Il s’agit d’une caractéristique très influencée par la génétique. En fait, les carcasses de conformation supérieure, même jusqu’à U, sont relativement rares : pratiquement, près des 2/3 des animaux produits ou importés sont classés en R et le 1/3 restant, correspondant à des agneaux purs de race rustique, est même classé O. L’état d’engraissement est noté entre 1 et 5. La classe 1 correspond à des animaux très maigres, à la limite de la saisie. A l’opposé, les carcasses 5 (très gras) mais aussi 4 (gras), peu appréciées des consommateurs, subissent une importante décote et les éleveurs, en triant à temps les animaux, s’efforcent d’en limiter le nombre.
Les opérateurs de la filière ne se contentent pas de cette grille officielle. Ils s’appuient également, en vif, sur des caractéristiques raciales et, pour les carcasses, sur d’autres éléments comme l’homogénéité de la carcasse, la couleur de la viande, la couleur et la consistance du gras. Ceci permet de réaliser une segmentation parmi tous ces produits et donc de cibler un marché pour leurs propres produits, préalablement soigneusement identifiés, si cela leur est possible, par un cahier des charges ou des caractéristiques régionales.
1.2 La provenance géographique
Pour les opérateurs d’agneaux français en vif et la plupart des abatteurs qui travaillent avec eux, l’identification du produit semble désormais un axe privilégié de défense de la production géographique sur le marché national. On rencontre plusieurs stratégies d’identification :
♦ celle des bassins de production excédentaires où les expéditeurs jouent sur une identification de la zone d’origine ( par exemple Poitou-Charentes)
56

♦ celle des opérateurs importants des zones déficitaires qui repose le plus souvent sur une identification des entreprises
♦ celle des opérateurs de plus petite taille dans des régions déficitaires et moins denses qui jouent également une appellation géographique d’origine destinée principalement au marché local.
Ces différentes stratégies se doublent progressivement d’une tendance générale à la segmentation. Telle région qui avait lancé une identification géographique collective lance comme un service supplémentaire un label haut de gamme, et introduit en outre un produit nouveau (agneau léger) ; telle autre orientée à l’origine sur une marque géographique limitée à des agneaux hauts de gamme la complète par une certification sur les autres agneaux. On assiste ainsi à la constitution de gamme de produits, composée d’une part d’un produit générique (U/R de 16 à 20 kg) complétée par des produits particuliers plus légers dans la fourchette de 9 à 16 kg, et d’autre part, par une identification de qualité haut de gamme sur une partie des carcasses de 16 à 20 kg. Les conditions pour la mise en place coordonnée des identifications ABF/AFQB (Agneau de Boucherie Français/ Agneau Français de Qualité Bouchère) comme support d’une gamme de produits sont en place. Cette segmentation requalifie partiellement la production nationale de chacun des bassins en la débanalisant.
1.3 Les contraintes liées à ces deux critères
On distingue d’abord les contraintes d’organisation, notamment pour les opérateurs des zones qui ont choisi une identification géographique, où l’évolution pousse à la gestion collective de l’identification choisie. A un stade ultérieur, les opérateurs pourront collaborer, l’entente étant facilitée par le cahier des charges commun. La tendance qu’ont certaines chaînes de distribution à développer leur propre certification fragilise les politiques plus globales défendues par la production.
Puis viennent des contraintes d’entente, ou de coordination minimum entre les zones d’expédition et les zones déficitaires. Un premier échelon de coordination existe actuellement avec le simple tri en vif des agneaux expédiés, mais cette coordination devra se développer pour éviter des concurrences malheureuses sur les types de produits.
S’ensuivent des contraintes de développement, d’abord parce que le but de ces démarches est de prendre des parts de marché et de revaloriser les prix, mais aussi parce qu’il faut amortir les coûts de certification. Cet aspect risque de renforcer la concurrence entre opérateurs et bassins de production.
Le dernier type de contraintes sont celles liées au désaisonnement de la production : en effet, les produits identifiés n’ont pas encore atteints leur seuil de saturation en part de marché et les commerciaux rencontrés assurent pouvoir en augmenter la diffusion si la disponibilité du produit était plus importante (amélioration qualitative et quantitative) et plus régulière dans le temps.
Sans aller jusqu’à envisager d’annuler les effets de la grande vague de désaisonnement que la France a connu cette dernière quinzaine d’années, un travail au cas par cas est à entreprendre. Il est vraisemblable qu’il faudra agir sur tous les leviers : schéma génétique finalisé de sélection ou de croisement pour tirer les carcasses vers le R et le U, spécialisation d’éleveurs en production décalée par rapport à la production régionale, engraissement à façon, maîtrise du report des agneaux d’herbe (castration), remise dans quelques pâturages de races
57

d’herbage à croissance lente…La recherche des solutions portera également sur la conduite d’agneaux de bergerie en période estivale pour combler le trou de septembre à novembre.
Sur la plan de la qualité des produits, la mise en place d’un cahier des charges (qu’il s’agisse ou non d’un label) renforce notablement l’exigence des acheteurs. La conformation, mais encore plus souvent l’homogénéité restent des facteurs importants de différenciation des carcasses, en particulier en terme de concurrence entre les différents bassins de production, zones Nord et Centre-Ouest vis à vis de la grande zone rustique du Sud. Cependant, cette concurrence est vouée à s’atténuer dans la mesure où la production se recentre sur les classes U et R. Cette différence de demande demeurera sensible entre les boucheries de détail et les GMS, les premiers demandent plutôt U alors que les seconds exigent R . La différenciation des carcasses joue également dans le choix d’un débouché : boucherie de détail ou GMS. Mais, parallèlement à la conformation, la couleur de la viande devient un critère très important sur lequel la production française peut se démarquer des importations, notamment sur les agneaux de bergerie de novembre à mars. Enfin la couleur et la tenue du gras interviennent également. Ces trois derniers éléments ne sont pas codifiés, ce qui gêne à la fois la négociation commerciale et le dialogue technique avec la production.Enfin, si les relations sont de plus en plus étroites entre les opérateurs en vif et les abatteurs, les collaborations entre les abatteurs ne sont pas encore de mise, tout au moins au niveau où elles s’imposeraient afin de former des complémentarités de production et de produits.
2. Les outils de la démarcation
2.1 La traçabilité, élément de la démarcation
Lors de son arrivée à l’abattoir, l’animal doit obligatoirement être accompagné de son passeport, indiquant son numéro d’identité, et ce, quelle que soit sa provenance. En correspondance avec ce numéro d’identité, un numéro d’abattage est apposé à l’encre sur la carcasse, puis reporté sur les pièces de découpe. L’abattoir doit être capable à tout moment de retrouver le numéro d’identité de l’animal à partir de ce numéro d’abattage.La carcasse dirigée vers le boucher continue d’être identifiée par report de ce numéro sur les factures. De même, celle qui est livrée à des entreprises de transformation, est identifiée à chaque étape par son numéro d’abattage, puis par un numéro de lot, reporté sur la facture destinée au point de vente.Cette procédure de traçabilité permet à tous les stades de la filière d’attester de l’origine du produit. Des contrôles officiels sont menés par les services vétérinaires du Ministère de l’Agriculture et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Par ailleurs, les professionnels de la filière ont confié à des organismes indépendants la réalisation de contrôles complémentaires sur leurs produits.
2.2 Le sigle « Viande Ovine Française »
58

A l’instar du secteur bovin, les professionnels de la filière ovine se sont dotés des outils d’identification nécessaires pour apporter au consommateur une information sur l’origine de la viande ovine. En absence d’un accord de l’Union européenne pour rendre obligatoire la mention d’origine dans le secteur ovin, les professionnels français de ce secteur ont décidé de mettre en place une démarche volontaire d’identification des ovins : les agneaux sont identifiés par un n° de travail à 4 chiffres et un n° de cheptel à 8 chiffres composant le n° individuel porté sur une boucle fixée à l’oreille gauche de l’animal. Cette démarche permet aux opérateurs de la filière de faire figurer le sigle VOF sur la viande ovine issue d’animaux nés, élevés et abattus en France. Cet accord interprofessionnel, signé le 15 septembre 1998 et entré en vigueur le premier juillet 1999 (6), porte également sur l’étiquetage de la viande ovine française. En plus des obligations réglementaires en vigueur en matière d’étiquetage, qui sont la mention du nom du morceau, son poids, son prix, sa date d’emballage et sa DLC (Date Limite de Consommation), peuvent figurer deux mentions supplémentaires sur l’étiquetage individuel et sur l’affichage des morceaux à la découpe :
♠ l’origine de l’animal dont est issue la viande : La mention « origine : nom du pays » indique que la viande est issue d’un animal né, élevé et abattu dans ce pays.Pour les ovins nés, élevés et abattus en France, l’étiquetage doit obligatoirement porter la mention : « origine : France ».L’indication « Union européenne » ne peut concerner que la viande d’un animal né, élevé et abattu dans l’Union européenne.
♠ la catégorie de l’animalLe consommateur peut trouver deux catégories différentes : Agneau ou Mouton.
2.3 Les garanties officielles de qualité et d’origine françaises
Depuis l’adoption de la loi du 3 janvier 1994 et de son décret d’application du 12 mars 1996 sur la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, il existe plusieurs garanties officielles de qualité et d’origine au niveau français, obligeant chacune à un certain type de production :
2.3.1 Le label agricole
59

Il atteste qu’un produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité supérieur, le distinguant des produits similaires. Un produit sous label doit donc respecter un cahier des charges et offrir des qualités gustatives supérieures. Les volailles de Loué, l’agneau du Quercy et l’Emmental Grand Cru en sont quelques exemples .
2.3.2 La certification de conformité
Elle atteste qu’un produit est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement établies portant selon les cas sur la fabrication, la transformation et depuis la loi du 3 janvier 1994 sur l’origine.
Les caractéristiques spécifiques doivent être objectives, mesurables, traçables, significatives et consignées soit dans un cahier des charges, soit dans une norme élaborée par un organisme reconnu (AFNOR en France) et à caractère non obligatoire. Les veaux « Les vitelliers », l’agneau Baronet du Limousin font partie de cette catégorie.
2.3.3 L’agriculture biologique
60

Un produit bio (30 900 brebis allaitantes en 1999) est un produit résultant d’un mode de production exempt de produits chimiques de synthèse, impliquant des méthodes de travail fondées sur le recyclage des matières organiques naturelles et sur la rotation des cultures, respectant un plan moyen de reconversion des terres et utilisant des moyens de lutte biologique en limitant l’emploi d’intrants (pas plus de deux interventions thérapeutiques vétérinaires avec des médicaments de synthèse au cours du cycle annuel de production dans le cahier des charges français).
2.3.4 L’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)
C’est la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, d’où l’impossibilité de le produire ailleurs qu’au sein de ce terroir (notion de non reproductibilité).La seule AOC ovine à ce jour est en cours d’instruction, il s’agit de l’appellation « Mouton de Barèges Gavarnie ».
3.4 Les marques collectives interprofessionnelles
Au sens juridique du terme, la marque est un signe qui distingue l’offre d’une entreprise et en certifie l’origine. La marque n’aura de réelle valeur économique pour une entreprise que dans la mesure où elle a une signification précise et positive pour le consommateur. La logique de marque est donc clairement une logique de différenciation; il s’agit pour l’entreprise de construire, par une combinaison de caractéristiques, une image distincte de celle des produits concurrents, image que le cosommateur est capable de percevoir. La marque est donc un contrat qui garantit implicitement aux consommateurs les caractéristiques qualitatives et de prix du produit.
La marque Agneau de Tradition Bouchère et la marque Agneau de Nos Bergers sont apposées sur des agneaux dont l’éleveur a respecté un cahier des charges qui est à peu près similaire pour les deux marques. Celui de l’Agneau de Tradition Bouchère est plus strict car le client est différent : alors que la majorité de la production Agneau de Nos Bergers est achetée par des GMS, l’Agneau de Tradition Bouchère finit en quasi-totalité sur les étals des bouchers détaillants.
3. Les effets de la différenciation qualitative
3.1 Sur le consommateur61

On note une évolution de la consommation de viande en France depuis quelques années. L’orientation se fait vers la qualité, qui reste cependant encore trop souvent inaccessible à la majorité des classes socio-professionnelles du fait de son prix élevé. La tendreté et la saveur sont désormais des critères de sélection importants. Pour répondre à ces attentes, des marques collectives ont été créées, affichant les logos correspondants à la garantie officielle qu’elles proposent.
Dans le climat de suspicion qui règne actuellement dans le domaine alimentaire (crise de l’ESB sur la viande bovine, résidus de dioxine dans les viandes de volailles…), les garanties officielles permettent également de restaurer la confiance du consommateur en lui fournissant des informations sur les modes de production de la denrée qu’il achète et en certifiant la véracité de ces informations. En effet, le développement des informations obligatoires et des démarches de qualité volontaires a conduit à un renforcement des contrôles afin de garantir aux consommateurs la transparence et la véracité des informations fournies. Les informations qui sont obligatoires sont contrôlées par les pouvoirs publics principalement par deux instances : le Ministère de l’Agriculture et la DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) qui dépend du Ministère de l’Economie et des Finances. Les démarches qualitatives volontaires sont, en plus des contrôles publics, contrôlées pour certaines d’entre elles, par des organismes indépendants eux-mêmes soumis à des procédures définies par les pouvoirs publics. Pour la viande, il est facile de repérer les marques de qualité contrôlées par des organismes tiers indépendants, lorsqu’elles utilisent principalement des sigles Label Rouge, Agrobio, Atout Qualité Certifié ou Critères Qualité Certifiés.Ainsi, en choisissant une viande d’agneau ADRET, le consommateur est sûr de ne pas consommer un agneau élevé au lait artificiel ou ayant pâturé dans une prairie recouverte de boues d’épuration.De plus, en privilégiant les viandes identifiées, les consommateurs contribuent à améliorer leur information, la transparence des marchés et les contrôles des produits.
3.2 Sur la concurrence
Pour l’entreprise qui adopte cette stratégie commerciale, c’est une façon de se soustraire à la concurrence. Un agneau certifiable, ADRET ou SOFRAG par exemple, offre une double garantie alimentaire par opposition à un agneau standard, ce qui permet un élargissement du marché déjà occupé par la SICA de GRILLON (abattoir de la coopérative Die-Grillon). Cet agneau sera certifié soit ADRET soit SOFRAG, sa viande sera donc commercialisée dans une catégorie supérieure à celle d’un agneau standard, puisque sa certification atteste qu’il a été élevé conformément à ces deux cahiers des charges.
3.3 Sur l’économie de la filière
62

Alors qu’en 1995, la viande commercialisée sous signe officiel de qualité représentait à peine 3% de part de marché, la situation a évolué de façon radicale dès 1996. Ainsi, si l’on examine la part de marché représentée par les démarches collectives interprofessionnelles « Agneau de nos bergers » et « Agneau de tradition bouchère » qui fédèrent à elles deux, 55 marques associées, ce sont 1 500 000 agneaux sur 14 400 000 agneaux commercialisés en France qui ont été commercialisés. Cette situation trouve son explication dans le fait que le marché de la viande ovine reste en France très majoritairement dominé par les importations. Aujourd’hui, en effet, seul un agneau consommé sur 3 est d’origine française. Les productions labels rouges ont commercialisé 2 355 tonnes en 1997 (+ 40% par rapport à 1995) à partir de 70 entreprises et 655 points de vente ( 72% de boucheries artisanales). Les certificats de conformité produit représentent 1 376 tonnes, soit + 75% par rapport à 1996, pour 4 cahiers des charges mis en œuvre par 17 entreprises dont 10 PME et 3 entreprises de taille nationale présentes sur 7 sites.Les spécifications de qualité ont également contribué à la protection des terroirs. Ce sont maintenant de réels vecteurs du développement économique et de l’aménagement du territoire en permettant le maintien et/ou l’installation d’agriculteurs et d’unités de transformation dans des zones souffrant de handicaps climatiques ou géographiques. On assiste à un déclin de l’activité ovine : les producteurs sont de moins en moins nombreux. Dans des régions comme les environs de Bourdeaux (Drôme), le nombre d’éleveurs a chuté de 19 à 2 en l’espace de 20 ans. Or, le potentiel régional en terme de pacage est resté quasi identique (peu de nouvelles constructions). Une revalorisation de la production ovine pourra encourager de jeunes éleveurs afin de ne pas perdre ce potentiel fourrager, en utilisant la certification de qualité de production en zone de montagne.
La filière viande ovine française rencontre ainsi de nombreuses difficultés économiques. Les éleveurs sont victimes d’un manque de dynamisme de la part des autres opérateurs de la filière, qui ont pris un retard considérable face à la phobie de la viande rouge engendrée par la crise de l’ESB. L’orientation prise actuellement grâce notamment au CIV (Centre d’Information des Viandes) s’effectue vers la différenciation, afin de reconquérir des parts de marché et indirectement d’offrir une plus-value au premier maillon de la filière, l’éleveur. Dans ce contexte, la certification de conformité produit « Agneau de l’Adret » se présente comme une tentative de réponse aux demandes actuelles des différents acteurs de la filière viande ovine française. Elle fera donc l’objet de la seconde partie de cette étude.
II. ETUDE D’UN CAS PARTICULIER : L’AGNEAU DE L’ADRET
L’Agneau de l’Adret a été choisi pour ce qu’il représente au niveau de la « communauté ovine » de la région PACA : cette certification concrétise la voie évolutive dans laquelle se dirigent plus ou moins rapidement les différents acteurs de la filière ovine dans cette région. Cette démarche est d’autant plus significative pour toute la filière française que la région PACA est un important bassin de production de viande ovine en France. La certification constitue en effet une voie d’avenir pour la production ovine, et l’exemple donné par une région dont le poids économique est conséquent en production ovine ne peut qu’encourager d’autres démarches parallèles à se mettre en place.
63

L’Agneau de l’Adret a également été choisi comme exemple « de terrain » de l’évolution de la filière ovine pour des raisons professionnelles. L’auteur de cette étude participe au suivi vétérinaire des élevages concernés par cette certification. Cette activité est réalisée auprès du groupement de producteurs ovins nommé « Coopérative Die Grillon », rayonnant sur plusieurs départements et drainant la majeure partie de la production de l’Agneau de l’Adret. Cette production sera présentée ci-après, s’ensuivra un exposé des moyens déployés pour l’obtention de la certification de conformité produit ainsi que les audits réalisés ; en fin de chapitre figureront les intérêts économiques d’une telle démarche, par le biais de la valorisation des produits sur le marché de la viande ovine en particulier.
A. PRÉSENTATION DE LA FILIERE « AGNEAU DE L’ADRET »
1. ORIGINE DE LA DÉMARCHE D’IDENTIFICATION
Il y a bientôt dix ans, tous les professionnels du milieu ovin de la région Sud-Est de la France avaient la même volonté : s’engager à produire une viande d’agneau de qualité irréprochable. Cet engagement de la profession, appuyé par tous, était une réponse à ce que souhaitaient les consommateurs. Cependant, produire un agneau de qualité ne suffisait pas. Il fallait le faire savoir, c’est-à-dire donner à cet agneau attendu un nom qui serait le dernier maillon entre les producteurs et les consommateurs. Ces mêmes consommateurs, qui apprécient la viande d’agneau, connaissent cette région pour sa production ovine et savent que toutes les conditions y sont rassemblées pour garantir la qualité : le climat, le soleil, les sols… tout ce qui peut s’opposer à la production de viande « hors-sol ». Réunis et questionnés, ils ont été quasi unanimes : cette viande est un symbole de la nature, de bon goût, de soleil, avec l’image d’un troupeau sur le flanc d’une colline ensoleillée ; c’est pourquoi l’appellation « Agneau de l’Adret » a été retenue, Adret signifiant d’après le PETIT ROBERT : (vieux mot dialectal du Sud-Est) Variante de « adroit ». Endroit, bon côté. Versant exposé au soleil, en pays montagneux (2). Le lancement de l’Agneau de l’Adret en 1993 est l’aboutissement d’une longue réflexion de l’ensemble de la filière après un an d’étude et d’enquêtes pour vérifier les attentes des consommateurs et des distributeurs. Des groupements de producteurs de Rhône-Alpes et d’Auvergne gèrent ensemble cette démarche volontaire, avec pour seul but de garantir une qualité irréprochable à l’Agneau de l’Adret. Dans cette logique, tous s’engagent : les éleveurs, les abattoirs, les sociétés commerciales et les vétérinaires .En février 1994, l’Agneau de l’Adret a obtenu un Certificat de Conformité Produit. L’engagement de tous les professionnels est ainsi sanctionné par un organisme certificateur indépendant, AFAQ-ASCERT, agréé par les pouvoirs publics. Cet organisme contrôle le respect du cahier des charges à tous les niveaux : dans les élevages d’origine, dans les groupements de producteurs, auprès des transporteurs et dans les abattoirs, dans les structures commerciales comme dans les points de vente.
2. FONDEMENTS TECHNIQUES : LE CAHIER DES CHARGES
64

L’agneau de l’Adret est défini par des caractéristiques certifiées figurant dans le cahier des charges correspondant à cette production et respecté par tous les partenaires de la filière. L’agneau est identifié dès sa naissance, puis il est sélectionné à chaque étape : dans son élevage d’origine, par les techniciens des groupements, par les responsables qualité des abattoirs et par les commerciaux. Son alimentation est garantie naturelle et équilibrée, basée sur l’apport essentiel du lait maternel. Son âge à l’abattage, ses conditions de transport et d’abattage, ainsi que son parfait état sanitaire sont également garantis.
L’éleveur dispose d’un classeur de couleur verte fourni par le groupement où il doit conserver tous les documents concernant la certification et qu’il doit présenter lors des contrôles réalisés dans le cadre de la certification. Si toutes les conditions sont conformes à la description qui suit, la viande se voit certifiée par le logo suivant :
Le cahier des charges étant étoffé, seuls les éléments nécessaires à la suite de cette étude seront rapportés ici.
2.1 Présentation des caractéristiques essentielles du produit
Le produit « Agneau de l’Adret » est une viande fraîche, non congelée, d’agneau né en France, élevé sous la mère dans son exploitation d’origine.Les critères d’appréciation des carcasses sont :- une conformation E, U ou R (grille EUROP)- un état d’engraissement 2 ou 3- une couleur claire, blanche ou légèrement rosée, d’aspect non huileux- un poids inférieur ou égal à 18 kg- une tenue ferme
Les critères d’âge à l’abattage sont :- âge inférieur ou égal à 150 jours entre le premier janvier et le 14 juillet
65

- âge inférieur ou égal à 195 jours entre le 15 juillet et le 31 décembreCette dichotomie provient du fait que la période qui s’étend du 15 juillet au 31 décembre est la période creuse de la production.
Les principaux critères d’alimentation et de conduite d’élevage sont :- un agneau nourri exclusivement au lait maternel- une alimentation complémentaire choisie dans une liste d’aliments agréés
2.2 Exigences techniques
2.2.1 Caractéristiques du produit
L’Agneau de l’Adret peut être commercialisé en boucherie artisanale ou en grande surface. Les caractéristiques certifiables figurant sur l’étiquette sont :
*agneau élevé au lait maternel et avec une alimentation traditionnelle*agneau né en France, élevé dans son exploitation d’origine, et contrôlé de l’éleveur
au distributeur.
2.2.2 Conditions d’agrément des élevages
Pour être agréé producteur d’agneaux certifiables « Agneau de l’Adret », l’éleveur doit en faire la demande à son groupement de producteurs, et signer un contrat l’engageant à respecter les conditions d’élevage stipulées dans le présent cahier des charges.
2.2.3 Conditions d’élevage
a ) Concernant les locaux d’élevage, et afin d’assurer aux animaux le meilleur confort et les conditions sanitaires les plus favorables, un paillage régulier est effectué en bergerie. Les locaux d’élevage sont curés et désinfectés au moins une fois par an. Cette intervention, sa date et les produits utilisés sont notés sur le carnet d’agnelage et de santé. b) Les brebis sont identifiées par tatouage ou bouclage. Les agneaux sont identifiés à la naissance au moyen de marques d’oreille portant les indications suivantes : n° d’agneau et identification de l’éleveur (n°EDE ou n°TVA ou n° d’adhérent au groupement). Si le n° d’éleveur n’a pas été posé dès la naissance, il devra l’être au plus tard au moment de l’enlèvement. Les boucles sont fournies par le groupement. Les n° d’agneaux sont à inscrire sur le carnet d’agnelage. En cas de perte de marque d’oreille en cours d’élevage :
♦ si l’origine de l’agneau peut être retrouvée (par exemple s’il tête encore sa mère),la boucle peut être remplacée en indiquant le changement de n° sur le carnet d’agnelage ;
♦ sinon, les agneaux ne pourront en aucun cas prétendre à la certification.En fin de période d’agnelage, les déclarations de naissance sont adressées au groupement de producteurs sous forme d’un récapitulatif des naissances de cette période.
c) L’alimentation est du type traditionnel de la région de production. Les agneaux sont nourris au lait de la mère - naturelle ou adoptive - tout autre lait que le lait de brebis étant exclu, et avec du fourrage complété éventuellement par du concentré à base de céréales. Les agneaux peuvent donc être sevrés. Les concentrés du commerce ne doivent en aucun cas
66

contenir de protéines d’origine animale. Les aliments médicamenteux comportant des activateurs de croissance ou des antibiotiques sont interdits. Les anticoccidiens, s’ils ne comportent pas d’antibiotiques, sont tolérés.
d) Un plan sanitaire d’élevage, établi avec le technicien d’élevage et/ou le vétérinaire traitant doit être disponible dans l ‘élevage. Tout traitement vétérinaire, soit collectif, soit individuel, est consigné sur le carnet d’agnelage et de santé et comporte les indications suivantes : n° des agneaux concernés, date de début et fin de traitement, motif de la médication, nature du produit distribué. Les éventuelles ordonnances correspondantes y sont jointes, et doivent pouvoir être présentées à tout contrôle. Conformément à la réglementation en vigueur, les délais d’utilisation des produits sanitaires avant abattage doivent impérativement être respectés. Les traitements vétérinaires sont administrés dans le respect de la législation en vigueur.
e) Sur le carnet d’agnelage et de santé, les enregistrements suivants doivent être réalisés :♠ fiche détaillée d’enregistrement des naissances (information par agneau) : n°
d’agneau, date de naissance, sexe, n° de la mère, mode d’allaitement, traitements sanitaires individuels, problèmes divers. En fin de période d’agnelage, les déclarations de naissance sont adressées au groupement de producteurs avec un « récapitulatif des naissances » de cette période.
♠ récapitulatif santé (informations par lot ou troupeau entier) : traitements sanitaires collectifs, curage et désinfection des bâtiments (date et produits).
♠ récapitulatif de visites : à faire signer lors du passage ou du contrôle des différents intervenants (technicien, vétérinaire, association, organisme certificateur).
2.2.4 Enlèvement des animaux
Avant le passage du ramasseur, l’éleveur effectue le tri de ses agneaux et appose une boucle jaune gravée « ADRET » aux agneaux présentables à la certification. A ce stade, les critères d ‘exclusion de la certification sont les suivants :
♣ âge supérieur à 150 jours dans la période du 01/01 au 14/07, supérieur à 195 jours dans la période du 15/07 au 31/12
♣ traitements sanitaires dont les délais d’attente n’ont pas été respectés♣ agneau nourri au biberon, et ayant consommé de l’aliment médicamenteux
contenant des antibiotiques ou des activateurs de croissance.Sur le bordereau d’enlèvement, l’éleveur renseigne les informations suivantes :
♣ le groupement de producteurs♣ l’identification de l’éleveur♣ la date et l’heure de l’enlèvement♣ les numéros des agneaux présentables à la certification♣ le nombre des autres agneaux.
L’éleveur et le ramasseur signent le bon d’enlèvement.
3. IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION
1999 est une année marquée par la progression du nombre d’éleveurs engagés dans la certification « Agneau de l’Adret ».
67

Ils sont 788, principalement dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne, mais aussi PACA et Centre, à produire des agneaux selon les préconisations de ce cahier des charges. Au total, cela représente 230 782 brebis mères, réparties sur 20 départements selon la figure n°10 :
Figure n°10 : Répartition géographique des producteurs d’agneaux de l’Adret en 1999 :
Source : (2)
La répartition des éleveurs en fonction des régions montre la nette prédominance de la région Rhône-Alpes.
Tableau n°11 : Nombre d’éleveurs et de brebis en certification de conformité produit Agneau de l'Adret par région en 1999 :
Région Nombre d’éleveurs Nombre de brebis Nombre de GPO
68

AUVERGNE 287 108 534 3CENTRE 22 5 556 1PACA 72 25 614 1RHONE ALPES 407 91 078 5
TOTAL 788 230 782 10
Source : (1)
Depuis le mois de février 1994, date d’obtention de la Certification de Conformité Produit pour l’Agneau de l’Adret, le nombre des éleveurs adhérents a quasiment doublé. En prenant l’exemple de l’évolution du nombre de contrats d’engagement dans la démarche « Agneau de l’Adret » réalisés au sein de la coopérative de producteurs ovins précitée (Coopérative Die Grillon), les chiffres sont impressionnants, ainsi que le démontre le tableau suivant :
Tableau n°12 : Evolution du nombre d’éleveurs engagés dans la démarche de certification « Agneau de l’Adret » au sein de la COOP Die Grillon:
Année Nombre de contrats réalisés Nombre d’agneaux certifiés1994 104 3 8481995 140 5 8461996 164 8 9541997 187 10 9751998 188 11 4981999 223 11 747
Source : (1)
4. STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION
La production d’agneaux de l’Adret est de 43 818 agneaux en 1999, soit un peu plus de 23,7% de la production en région PACA. Au total, ce sont dix groupements qui produisent l’Agneau de l’Adret, avec des différences notables quant aux cheptel reproducteur (voir figure n°11 ) et à la quantité d’agneaux certifiés produits. Deux groupements sont nettement prédominants, il s’agit de COPAGNO et de la COOPERATIVE DIE-GRILLON, dont
69

l’activité sera un peu plus détaillée dans cette étude. Le tableau n°XII en dresse la liste complète .
Figure n°11 : Nombre d’éleveurs et de brebis en Adret par GPO en 1999 :
Source : (1)
Tableau n°13 : Nombre d’agneaux certifiés par groupement en 1999 :
Nom du GPO Nombre d’agneaux certifiés
COPAGNO 14 374 32.8%OVI-COOP ALLIER 2 077 4.7%
70
OVICOOP16320 brebis51 éleveurs GPO 01
5640 brebis17 éleveurs
OVIMONTS6057 brebis13 éleveursOVICENTRE
5189 brebis24 éleveurs
COOP DIE GRILLON48633 brebis200 éleveurs
SICA "les Eleveurs des Préalpes du Sud"
24347 brebis85 éleveurs
COREL12350 brebis69 éleveurs
COOP DE SAVOIE5738 brebis28 éleveurs
COPAGNO49663 brebis166 éleveurs

OVIMONTS 2 781 6.4%OVICENTRE 1 437 3.2%COOP. L’AGNEAU DES HAUTES ALPES 1 240 2.9%COOP. DIE-GRILLON 11 747 26.8%COOP. L’AGNEAU DE SAVOIE 1 110 2.5%COREL 3 202 7.4%GPO DE L’AIN 37 0.1%SICA « Les Eleveurs des Préalpes du Sud » 5 813 13.3%
TOTAL 43 818 100%
Source : (1)
Ces dix groupements, dont la zone d’activité représente une vingtaine de départements du territoire français, réalisent la commercialisation de leur production par l’intermédiaire de cinq sociétés commerciales et la SICA de Grillon est nettement majoritaire, puisqu’elle est responsable de la vente de plus de la moitié de la totalité des agneaux certifiés « Agneau de l’Adret » en 1999. Le tableau souligne ces disparités.
Tableau n°14 : Mise en marché des agneaux de l’Adret en 1999 :
Société commerciale Nombre d’agneaux vendus en 1999
SICA « les Eleveurs des Préalpes du Sud » 4 493 13.2%SICA DE GRILLON 18 534 54.2%VLSE 634 1.8%FRANCE-AGNEAU CORBAS 6 716 19.6%FRANCE-AGNEAU CLERMONT 3 798 11.2%
TOTAL 34 175 100%
Source : (27)
La production et la commercialisation restent donc très localisées autour de deux pôles que sont la Coopérative Die-Grillon et la SICA de Grillon, leur coordination étant facilitée par la proximité géographique des deux sociétés ( séparation d’environ 500 mètres). Les coûts de transport se trouvent considérablement diminués, et les bergeries d’accueil situées sur le site du groupement permettent de maintenir des animaux en quantité toujours (ou presque) suffisante pour satisfaire aux flux d’abattage de la SICA.
5. LES DÉBOUCHÉS DE LA CERTIFICATION AGNEAU DE L’ADRET
71

5.1 Pour l’éleveur
Est payé à l’éleveur en tant qu’Adret un agneau pesant moins de 18 kg de carcasse, ayant moins de trois mois à l’abattage, ayant reçu une alimentation à base de lait maternel (allaitement naturel) et de grain ou aliment du commerce dont le fournisseur est agréé par le cahier des charge Adret, et dont la note de carcasse est E, U ou R avec2 ou 3 .
Est payé à l’éleveur en tant que Grillonnet un agneau pesant moins de 12 kg de carcasse (valorisation des agnelles), abattu à moins de 90 jours d’âge et ayant été élevé dans les mêmes conditions qu’un agneau payé Adret.Il existe donc une plus-value pour le producteur : l’éleveur qui adhère à la production Adret et Grillonnet voit ses agneaux payés 2 francs de plus par kg de carcasse, à condition que leur âge le jour de l’abattage soit de trois mois au maximum. L’éleveur qui adhère en plus à la démarche SOFRAG voit ses agneaux payés 1,5 francs de plus par kg de carcasse quel que soit leur âge à l’abattage dans la limite de 240 jours.Alors que le prix moyen de la viande ovine en France est de 24,40 F/kg de carcasse, l’éleveur fournissant des « Agneaux de l’Adret » touche en moyenne 26,40 F/kg de carcasse, ce qui constitue une plus-value en comptabilisant une moyenne de poids de carcasse de 18 kg. Le cahier des charges permet également de valoriser au mieux ses agnelles. En effet, les femelles engraissant plus vite que les mâles, il est intéressant de pouvoir les faire abattre plus jeunes, les carcasses grasses étant dévalorisées à l’abattoir. Les femelles abattues en tant que « Grillonnet », à 90 jours au lieu de 150 jours, elles n’ont en théorie pas le temps de faire du gras en quantité suffisante pour être déclassées. Cette amélioration de la production permet aux éleveurs de faire du gain, et ce, sans augmenter forcément leurs coûts de production. L’adhésion à la certification Adret est donc tentante, et de plus en plus d’éleveurs effectuent les démarches pour en faire partie.
Les efforts portent sur le désaisonnement, afin de réguler la production (carence en agneaux commercialisables à l’automne), ce qui accentue encore la dureté du cahier des charges : un contrat de désaisonnement oblige l’éleveur à respecter certains engagements, notamment par rapport au nombre d’agneaux estimé à naître pour cette période et l’effectif de brebis et agnelles amené au désaisonnement.
5.2 Pour l’Association : évolution de la certification et des ventes
Actuellement 135 magasins dont 52 boucheries et 76 grandes surfaces commercialisent l’Agneau de l’Adret, les points de vente se situant en région Rhône-Alpes (principalement l’agglomération lyonnaise et le département de la Drôme), en Auvergne et en région Provence Alpes Côte d’Azur, et tous tiennent le même discours en ce qui concerne le produit : qualité régulière, cahier des charges rigoureux. Les efforts déployés par les différents membres de l’Association de Promotion de l’Agneau de l’Adret sont donc récompensés.
Figure n°12 : Lieux de commercialisation de l’ Agneau de l’Adret en 1999 :
72

Source : (27)
La certification a connu une nette évolution de 1995 à 1997. Elle semble se stabiliser depuis aux alentours de 50% de la production totale, comme le montre le tableau n°15.
Tableau n°15 : Evolution du nombre d’agneaux certifiés Agneau de l’Adret depuis 1995 :
Année Agneaux certifiables Agneaux certifiés Taux de certfication
1995 38 057 15 555 41%
1996 53 547 27 001 50%
1997 70 037 35 979 51%
1998 77 612 37 125 48%
1999 86 942 43 818 50%
Source : (30)
Ainsi, malgré un nombre croissant d’agneaux présentés à la certification, le taux de certification semble se stabiliser autour de 50%. Plusieurs raisons peuvent être évoquées qui expliquent cette immobilisation : les agneaux présentés par les éleveurs ne répondent effectivement pas toujours aux critères imposés par le cahier des charges (le jugement d’un agneau sur pied est assez difficile et les erreurs d’estimation sont encore nombreuses), la classification à l’abattoir est très subjective (une seule personne décide de la qualité de la
73
boucheries17%autres
4%
super-marchés
23%
hyper-marchés56%
boucheriesautressupermarchéshypermarchés

carcasse) et le contexte économique influence les volumes d’abattage (la demande en viande certifiée évolue selon les périodes de l’année). L’objectif actuel est la commercialisation de 50 000 Agneaux de l’Adret par an par l’Association dans un futur le plus proche possible. Pour cela, l’Association assure la promotion de « l’Agneau de l’Adret » en participant à différentes manifestations, afin de mieux se faire connaître des producteurs et des consommateurs : Fête du Mouton à Die (42), Salon de l’Agriculture Dauphinoise (38), Foire de Die (26), Sommet de l’Elevage (63), le Mouton en Fête (69), Mouton Expo (84), etc…Elle est également présente sur des salons comme le Salon des Métiers de Bouche et le Salon de l’Agriculture, en concertation avec ses partenaires (Société commerciale, Organisme certificateur…)
5.3 Pour le groupement Coopérative Die Grillon
L’évolution de la vente des viandes est la conséquence d’un changement dans les habitudes des consommateurs ( désir d’avoir un produit de qualité, fortement influencé par la publicité et les révélations médiatiques concernant les modes de production animale) : la viande d’agneau certifiée représente plus de 14% des achats des ménages, alors qu’en 1995 elle n’était que de 3% ; ceci est directement visible au niveau des bilans d’activité du groupement dans le tableau n°16.
Tableau n°16 : Bilan de l’activité Adret au sein de la Coopérative Die Grillon :
ANNEE NOMBRE DE CONTRATS
NOMBRE DE BREBIS EN CONTRAT
NOMBRE D’AGNEAUX CERTIFIES
1994 104 22 427 3 8481995 140 29 908 5 8461996 164 37 116 8 9541997 187 45 722 10 9751998 188 43 824 11 4981999 223 53 187 11 747
Source : (18)
Quant à l’activité Grillonnet, elle concerne en 1999 7 043 agnelles, soit 5,2% d’augmentation par rapport à l’année 1998. La production semble donc à la hausse, d’où l’objectif de commercialisation de 50 000 agneaux par an défini par l’Association de Promotion de l’Agneau de l’Adret en ce début d’année 2000.Cependant, malgré la conquête de nouvelles parts de marché effectuée par les viandes ovines certifiées, il n’en reste pas moins que la filière ovine française est très déficitaire et les éleveurs les moins bien payés de tous les métiers agricoles. Leur revenu est en effet inférieur de 30 à 50% par rapport à la moyenne nationale. Les entreprises et les groupements ont eux aussi enregistré des baisses de chiffre d’affaires de plus de 1% sur 10 années, ce qui, rapporté au chiffre d’affaire moyen, constitue un résultat très faible, trop pour autoriser un réel développement. Les groupements bénéficient heureusement des aides de l’Etat, parfois juste
74

suffisantes pour les entretenir. Seule la grande distribution et les marchés parallèles ont su tirer profit de cette situation. La raison de cet effondrement est liée à la chute de la production française, qui a obligé les entreprises à une restructuration forcée. Or, dans d’autres pays de l’Union européenne, l’évolution a été inverse. Afin de visualiser les évolutions envisageables pour la production ovine française, certifiée ou non, il convient de regarder les résultats au sein de l’Union européenne également.
6. LA DOUBLE VALORISATION SOFRAG
6.1 Présentation et avantages
La SOFRAG, Société Française de l’Agneau, est un holding financier créé en 1989 qui regroupe 3 sociétés commerciales (France Agneau , SC SICA de Grillon, Alpes Provence Agneaux Sisteron) auxquels 8 coopératives (Agneau des Hautes Alpes, COBEVIM, Coopérative Die Grillon, COPAGNO, COREL, OVICOOP , OVICENTRE , OVIMONTS.) livrent leurs agneaux.La SOFRAG a été contactée par des acheteurs en 1992 (Casino, Auchan, Intermarché, Leclerc, des bouchers) désireux de bénéficier d’une garantie supplémentaire sur les agneaux achetés aux groupements.Suite à cette demande, la responsable qualité désignée par SOFRAG a élaboré un référentiel des actions à mener pour obtenir la certification de conformité produit « Agneau de l’Adret ». Une fois cette certification déposée auprès de la CNLC (Commission Nationale des Labels et Certifications), d’autres GMS (Carrefour, Continent) ont proposé des débouchés privilégiés pour une autre distinction de qualité . La SOFRAG a alors oeuvré pour mettre au point une « accréditation SOFRAG », qui est une marque d’entreprise. L’interaction des deux démarches SOFRAG et ADRET peut donc se résumer de la sorte : si un élevage est à la fois SOFRAG et ADRET, il y a application des cahiers des charges SOFRAG et ADRET. A l’enlèvement, les agneaux sont identifiés selon les règles du cahier des charges ADRET ; seuls, les agneaux de plus de 150 à 195 jours sont identifiés SOFRAG.L’éleveur appose une boucle SOFRAG bleue à l’oreille gauche de ces agneaux certifiables SOFRAG le jour de l’enlèvement et note sur le bordereau d’enlèvement le nombre d’agneaux certifiables enlevés ce jour-là.. A l’abattoir, les agneaux certifiables ADRET mais non certifiés peuvent être proposés à l’appellation SOFRAG si ils portent cette boucle (les oreilles restent sur les carcasses jusqu’à la pesée). Après vérification de la conformité au cahier des charges, la pesée sera le critère décisif pour la certification SOFRAG (un poids inférieur à 22 kg garantit la certification). Si les agneaux obtiennent la certification SOFRAG, l’éleveur bénéficie alors de la plus-value accordée par cette dernière sur le paiement des carcasses.
Cette dénomination est une garantie de qualité supplémentaire, elle permet à l’éleveur de faire abattre des agneaux élevés dans les conditions définies dans le cahier des charges de la certification Adret mais jusqu’à 240 jours d’âge (au lieu des 190 maximum autorisés en production Adret). Ces agneaux reçoivent alors la dénomination SOFRAG et sont payés à l'éleveur avec une plus-value de 1,50 F/kg de carcasse par rapport à une viande standard. Ainsi, la production de viande Adret est régularisée, ce qui permet d’approvisionner les GMS toute l’année avec un produit comportant toutes les qualités et garanties figurant sur un cahier des charges « Agneau de l’Adret » ou SOFRAG. Les éleveurs y trouvent aussi leurs comptes, ils peuvent continuer à engraisser des agneaux « queue de lot » qui n’étaient pas prêts à 150 ou 195 jours (selon la période de l’année) et les faire abattre à 240 jours à un poids correct ou presque en bénéficiant d’une majoration sur le prix qu’ils n’ont pas si ils ne se sont pas engagés dans la démarche qualité SOFRAG.
75

6.2 Les exigences de la démarche qualité SOFRAG
Cette dénomination est obtenue par le respect d’un cahier des charges semblable à celui de la certification Agneau de l’Adret, bien que la gamme d’acceptation des âges à l’abattage soit élargie. Nous traiterons donc ces exigences dans le chapitre consacré à l’audit de certification.
La mise en place et le fonctionnement d’une telle certification de conformité produit suppose l’élaboration et l’application d’un système qualité au sein des différentes structures, c’est-à-dire d’un ensemble construit de procédures régulièrement adaptées en fonction des dysfonctionnements observés.
B. LE SYSTEME QUALITE
La présente étude s’intéresse au système qualité mis en place par le groupement d’éleveurs nommé « Coopérative Die Grillon » qui bénéficie de la démarche de certification et pour lequel l’auteur de cette thèse travaille partiellement. C’est dans ce cadre que nous étudierons les démarches nécessaires et la procédure à respecter pour bénéficier de la certification de conformité produit, notamment en ce qui concerne son agrément.
1. LES BASES
1.1 Définition et authentification de la qualité
La qualité d’un produit alimentaire se compose de :
- la qualité hygiénique soit une absence de nocivité du produit
- la qualité nutritionnelle soit l’aptitude à satisfaire les besoins alimentaires de l’homme
- la qualité organoleptique soit l’aptitude à procurer du plaisir au consommateur
- la qualité d’usage soit la commodité d’emploi et l’aptitude à la conservation du produit- la qualité réglementaire soit la conformité du produit à la réglementation d’un état en
matière d’hygiène, de conditionnement (46).
Au niveau d’une entreprise, l’entrée dans une démarche certification de conformité produit suppose l’adoption d’un système qualité incluant la méthode HACCP que nous expliciterons ultérieurement. Ce système est ensuite vérifié par un organisme certificateur et des intervenants impliqués dans la production. En plus de ces contrôles réglementaires, un plan de
76

contrôle spécifique s’applique composé de contrôles internes réalisés par le groupement sous couvert de l’organisme certificateur (tels ceux réalisés par le vétérinaire du groupement).C’est pourquoi la certification ADRET/GRILLONNET et la dénomination SOFRAG* comportent questionnaires, visites d’élevage et audits réguliers. L’éleveur qui adhère à cette production remplit plusieurs cahiers des charges, et se doit de respecter les temps d’attente signalés sur les différents médicaments vétérinaires.
*L’appellation SOFRAG est une deuxième démarche qui vient se greffer à la démarche de certification ADRET. Nous y reviendrons ultérieurement.
Par la rigueur observée chez les éleveurs qui se responsabilisent par plusieurs engagements écrits dans les deux démarches qualité, on peut espérer que les denrées animales issues de ces élevages ne comportent pas de substances chimiques dangereuses pour la santé du consommateur telles que :- résidus de traitement antibiotique, antiparasitaire ou autre substance vétérinaire - substances frauduleuses (anabolisants)
Le rôle du technicien et du vétérinaire sera alors dans ce cas la vérification du remplissage correct de ces différents carnets, du choix de la date de ramassage et d’abattage des ovins pour la boucherie (calculée en fonction des délais d’attente des produits vétérinaires afin de garantir la salubrité de la viande), du respect de l’âge à l’abattage pour répondre aux cahiers des charges ADRET et SOFRAG. Au niveau de l’élevage, une des missions du vétérinaire est de s’assurer que les animaux ne sont pas alimentés au moyen de sources contaminées par des substances dangereuses pour l’homme. La qualité de la matière première détermine pour l’éleveur la possibilité d’accès à la certification, le vétérinaire doit donc intervenir à chaque étape pour garantir la salubrité des denrées animales : élevage, abattage, conditionnement, transport et commercialisation. Il doit donc mettre au point des outils pour l’aider dans sa conduite d’où l’intérêt de l’élaboration d’un manuel qualité qui établit les lignes de conduite de la qualité de la production ainsi qu’un protocole fiable de contrôle de ces différentes actions. Ce manuel d écoule de la méthode HACCP qui est actuellement la référence dans les industries agro-alimentaires.
Cependant, la qualité atteinte dans la certification se double de la qualité légale obligatoire dans le domaine des productions animales. Nous trouverons ci-après un bref rappel des étapes de la production soumises à un contrôle de la qualité.Au niveau de l’abattage, il y a un contrôle systématique de tous les maillons de la chaîne par les agents des services vétérinaires. Toutes les carcasses sont inspectées visuellement par le technicien des services vétérinaires puis déviées vers le local de saisie s’il le juge nécessaire, afin d’établir une inspection plus rapprochée. Le vétérinaire inspecteur vient ensuite effectuer un deuxième contrôle et prend la décision finale de saisie. Pour effectuer ces opérations, le technicien comme le vétérinaire ont reçu une formation spéciale au sein d’une école et s’appuient également sur des textes législatifs afin de permettre le suivi des informations et des mesures qui en découlent auprès des vétérinaires praticiens (découverte d’une MRLC par exemple)(Maladie Réputée Légalement Contagieuse).
Ainsi s’est mise en place une nouvelle approche en hygiène alimentaire : on demande l’établissement de moyens de contrôle permanents avec pour référence le système HACCP, dont la mauvaise traduction française est la suivante : « Analyse des dangers et Etude des Points Critiques pour leur maîtrise ».
1.2 La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
77

La Directive 93/43/CEE du 14 juin 1993 relative à l’hygiène des denrées animales et l’Arrêté Ministériel français du 09 mai 1995 rendent obligatoire la maîtrise des points critiques au sein des entreprises relevant du secteur alimentaire dont les activités comprennent l’abattage et la découpe des animaux. C’est donc à elles de mettre en place un système permettant de les analyser, de les maîtriser et de contrôler ces opérations dans un esprit de recherche de solution aux problèmes éventuellement rencontrés. Le système HACCP est une des méthodes d’analyse et de maîtrise des points critiques. La certification de conformité produit est une extension des procédures de type HACCP à l’élevage, le transport et autres activités d’un groupement de producteur par exemple, qui permet à l’organisme certificateur de s’assurer de la conformité au cahier des charges (but de la certification).
Toutes les étapes de la production de « l’Agneau de l’Adret » sont régies par ce système, qui a été adapté à la production ovine par une personne spécialisée dénommée « Responsable de l’Assurance Qualité », Céline RUNAVOT, responsable également du suivi de la certification au sein de la Coopérative Die Grillon.
Dans le cas précis de cette production, c’est la société SOFRAG qui est propriétaire de la certification de conformité produit « Agneau de l’Adret ». La Coopérative Die Grillon est un prestataire de la SOFRAG pour l’élevage et l’abattage des agneaux certifiés. Le groupement doit obéir à un cahier des charges défini par la SOFRAG, propriétaire de la certification et responsable de la commercialisation sous la dénomination « Agneau de l’Adret ». Un organisme certificateur privé dénommé QUALICERT-SGS-ICS a audité la SOFRAG pour accorder la certification et continue d’auditer régulièrement pour vérifier le respect de celle-ci. La SOFRAG audite la Coopérative Die Grillon pour vérifier si elle respecte le contrat lié à la certification. C’est donc au niveau de la SOFRAG que le système HACCP a été appliqué ; afin de parvenir à cette certification de conformité produit, la Responsable de l’Assurance Qualité a dû s’appuyer sur les principes fondamentaux de la démarche HACCP, dont les principales étapes figurent ci-dessous :
♠ Première étape (préalable) :
⊗ Description des matières premières et ingrédients⊗ Description du produit fini⊗ Identification de l’utilisation attendue⊗ Description du procédé : diagramme de fabrication, informations techniques,
paramètres.
♠ Analyse des dangers :
⊗ Identification des dangers : agents biologiques, chimiques, physiques⊗ Identification des conditions conduisant à la présence, la contamination et la
recontamination, le développement, la non-élimination de chaque danger dans chaque matière première, ingrédient et produit fini, ainsi qu’à chaque étape du procédé
⊗ Evaluation des dangers et des conditions, ainsi que de leur gravité, de leur fréquence et de leur probabilité. A cette étape on les classera en fonction de la force de leur impact.
♠ Mesures de maîtrise et déterminants critiques (les CCP, Critical Control Point):
⊗ Ayant un faible impact : mise en place d’une amélioration grâce aux BPF et BPH (Bonnes Pratiques de Fabrication, d’Hygiène)
⊗ Ayant un fort impact : mise en place d’une amélioration grâce aux BPF et BPH, puis identification des CCP et des options de maîtrise de chaque CCP.
78

♠ Dispositions d’assurance de la sécurité et vérification :
⊗ Pour chaque CCP : définition des limites critiques, élaboration de la surveillance (suivi du procédé) et des actions correctives. On éditera ensuite une documentation écrite mentionnant pour chaque CCP les procédures opérationnelles, les procédures pour la surveillance et le plan d’actions correctives.
⊗ Enregistrements de ces documents⊗ Vérification des procédures et des enregistrements, qui amènera à une amélioration,
une mise à jour ou un simple entretien selon le constat effectué.
Toutes ces étapes doivent être recensées précisément ; pour cela, la Responsable Qualité dispose de plusieurs outils : le manuel qualité (avec ses procédures) et l’audit qualité (interne et externe).
Le manuel qualité est un document qui décrit les dispositions générales des étapes de la production pour obtenir la certification de conformité « Agneau de l’Adret ». Il est au sommet du système pyramidal schématisant l’assurance qualité (32).Les procédures sont autant de documents décrivant une opération usuelle (vente des agneaux certifiables par exemple).
L’audit qualité est l’examen méthodique et indépendant des mesures de qualité.
1.3 Elaboration du manuel qualité (47)
Le manuel décrit les dispositions générales prises par les différents membres de la filière pour produire des agneaux conformes au référentiel de la certification de conformité (45).
Il est donc nécessaire de définir toutes les actions réalisées à chaque étape de la production. Pour aider à l’établissement de ce manuel qualité , la responsable qualité de la société s’est basée sur le protocole explicité dans le guide de rédaction du manuel d’Assurance Qualité édité par CERTI-ELEVAGE (33).
Dans ce document sont répertoriées sous forme de tableaux des listes (non exhaustives !) détaillées des principales actions sur lesquelles il faudra appliquer la méthode HACCP ; les deux tableaux ci-après donnent un exemple de ces listes, en ce qui concerne deux activités d’échanges ayant lieu au cours de la production de « l’Agneau de l’Adret » (achats et ventes) :
Tableau n°17 : Détail des activités d’achats au cours d’une filière de production ovine :
ACTIVITE INTERVENANTS ACTIONS
79

PRODUCTEURS (les éleveurs)
-PRODUITS : productions animales, reproducteurs
-SERVICES : stockage, engraissement d’animaux, location de locaux, testages, essais d’équipements…
ACTIVITES D’ACHATS
-FOURNISSEURS DIVERS
-PRESTATAIRES DE SERVICES DIVERS
-PRODUITS ou INTRANTS : animaux d’élevage, reproducteurs, aliment, matériel d’élevage, bâtiments, semences, produits phytosanitaires, médicamenteux, engrais…
-SERVICES : transport, commercialisation, services vétérinaires, services de contrôle en bâtiment, métreur, analyses alimentaires, analyses carcasses, évaluation de reproducteurs, publicité, conseils spécialisés (fédérations, GIE, fabricants de désinfectants), location de locaux, maintenance des logiciels…
Source : (14)
Tableau n°18 : Activités de ventes au cours d’une filière de production ovine :
ACTIVITE INTERVENANTS ACTIONS
-PRODUITS ou INTRANTS :
80

ACTIVITES DE VENTES
PRODUCTEURS (les éleveurs)
animaux d’élevage, reproducteurs, aliment, matériel d’élevage, bâtiments, semences, produits phytosanitaires, médicamenteux, engrais…
-SERVICES : commercialisation de la production , actions promotionnelles, suivis technique, sanitaire, économique, de gestion, génétique, inséminations, constats de gestation, établissement de programme d’alimentation (formulations), stockage, transports (ramassage, transfert, d’urgence), analyses des carcasses, analyses alimentaires, conseils vétérinaires, épidémio-surveillance, services relais avec l’administration, gestion de dossier de subvention, facturation, financements, assurances, études pour la création ou l’extension d’élevage, évaluation du cheptel, formations, informations…
-ENTREPRISES
-AUTRES GROUPEMENTS
-PRODUITS : productions animales, reproducteurs, logiciels…
-SERVICES : commercial, stockage…
Source : (14)Les interactions entre les différents intervenants apparaissent assez complexes et le manuel portera obligatoirement sur le rôle de chacun, ce qui représente un travail de longue haleine nécessitant la participation de tous (43)(44).
2. LA QUALITÉ AU NIVEAU DU GROUPEMENT
81

2.1 Les bases
Ainsi que nous l’avons explicité plus haut, le groupement étudié ne peut commercialiser le produit « Agneau de l’Adret » que dans la mesure où il possède l’agrément pour le faire. L’organisme certificateur a défini des objectifs et des moyens pour les réaliser rendant l’activité du groupement conforme à la production d’un produit certifié, qu’il vient régulièrement contrôler par des audits externes payants. Nous trouverons ci-après quelques unes des formalités nécessaires à l’obtention de cet agrément, figurant dans le manuel qualité de la demande d’agrément.
La Direction du groupement doit établir, dater et signer nominativement une déclaration d’engagement vis à vis de l’action d’Assurance Qualité. Cette déclaration, rédigée par la responsable qualité, sera archivée et pourra être remise en cause en cas de faute grave et/ou de retrait de l’agrément qualité.
La Direction doit également mettre au point une stratégie d’orientation correspondant à la politique qualité de la certification. Celle-ci doit concerner :- l’organisation de la production dans le souci de conformité par rapport au logo « Agneau de l’Adret » afin d’obtenir un pourcentage d’agneaux certifiables et certifiés en constante progression- l’organisation de la commercialisation dans le souci d’assurer auprès des éleveurs un service de ramassage des agneaux leur garantissant un maximum de débouchés certifiés à l’abattoir en fonction du délai d’élevage et de la demande en viande ovine certifiée du moment.
Cette politique qualité a pour buts :- la valorisation et l’optimisation des relations entre l’éleveur et le groupement, en instaurant un suivi régulier des élevages par les techniciens et le vétérinaire collaborant avec le groupement par exemple- la prise en considération des exigences de la société propriétaire de la certification (la SOFRAG), de l’environnement et des besoins du marché, en encourageant les éleveurs au désaisonnement afin de produire des agneaux de façon plus régulière et d’approvisionner ainsi le marché toute l’année en viande ovine Adret ( dans des périodes où le marché d’offre de viande ovine est déficitaire par rapport à la demande, en été par exemple)- la valorisation de l’image et de la réputation du groupement : dans une région où la concurrence est forte avec d’autres structures assurant le ramassage des agneaux, la certification de conformité produit Agneau de l’Adret atteste d’un réel sérieux de la part des membres du groupement, qui ont décidé de s’engager dans une démarche qualité afin de mettre sur le marché une viande ovine sanitairement et gustativement irréprochable
Pour abonder dans le sens de ces actions, la Direction doit prévoir ensuite de développer des objectifs qualité plus précis, quantifiés et datés afin d’en évaluer l’accomplissement. Parmi ces thèmes, ont été retenu par la responsable qualité SOFRAG :
*la définition claire des besoins du groupement, de ses adhérents et de ses clients*l’analyse des anomalies de service et des facteurs de risque ainsi que leur résolution*l’amélioration des temps de réalisation des prestations*l’optimisation des contrôles*les actions relatives à l’hygiène et aux pathologies des animaux*la capacité de crédibilité des différents intervenants dans cette démarche*le développement de partenariat et la création de parts de marché*l’investissement dans des équipements et du matériel
82

*les études économiques relatant de la santé du groupement et des corrélations avec le marché de la viande ovine
Pour que la politique qualité soit comprise et ses objectifs bien perçus par le personnel du groupement et les éleveurs, le groupement doit prévoir la diffusion de cette formalisation. Il se sert de réunions hebdomadaires internes animées par la responsable qualité. Les éleveurs sont tenus au courant grâce aux tournées sur le terrain dans leurs élevages en bi- ou trinôme : le technicien qui suit l’élevage accompagné de la responsable qualité et parfois aussi du vétérinaire. Les directives sont modifiées en fonction des propositions du personnel et des conclusions des audits.
2.2 Le manuel qualité
Les différents critères sur lesquels le manuel qualité du groupement sera détaillé dans cette étude concernent :
♣ les responsabilités :Il convient de faire ressortir les relations hiérarchiques et éventuellement fonctionnelles entre les différents services auxquels les salariés du groupement peuvent appartenir. Pour cela, la Direction doit prévoir de définir pour chacun ses responsabilités et la dénomination de sa fonction au moyen d’un organigramme.
♣ mise en œuvre du système et vérification :Le groupement doit démontrer qu’il est doté de tous les moyens nécessaires appropriés pour mettre en œuvre le système qualité selon la politique qualité qu’il s’est fixée, pour atteindre les objectifs qui en découlent et en final satisfaire aux besoins des clients. Parmi ces activités de vérification ont été relevés les suivis technico-économiques et sanitaires tout au long de la chaîne de production, les contrôles produits, les autocontrôles, la vérification des compétences et les audits.
L’action choisie en exemple dans la tableau n°19 est celle d’optimiser les ramassages.
Tableau n°19 : Exemple de mise en oeuvre du système qualité au sein du groupement :
OBJECTIF QUALITE MOYEN DE REALISATION MOYEN DE VERIFICATION
Optimiser les ramassages - Procédure d’organisation Logiciel de gestion des tournées
83

- Formation des chauffeurs- Motivation des adhérents
Source : (14)
♣ les revues de direction :Elles sont destinées à ce que la direction s’assure de l’efficacité de la politique, des objectifs et du système qualité mis en œuvre, en tenant compte des évolutions technologiques, sociales et économiques. Elles doivent permettre de détecter les améliorations possibles du système conçu. Elles ont lieu au minimum une fois par an.
♣ le système documentaire : Ce système suit une structure schématisée par un modèle-type qui est le suivant :
Figure n°13 : La pyramide du système documentaire :
Manuel d’Assurance Qualité
Procédures-type
Instructions de travail et de contrôle
Enregistrements
Exigences externes Définitions Spécifications
Source : (31)On désigne par exigences externes la législation nationale et européenne, le système de normalisation qui sert de référence au manuel qualité (exemple : ISO 9 000).Dans les définitions figurent les termes spécifiques utilisés et non compréhensibles par une tierce personne (exemple : tip-tag).Les spécifications regroupent les cahiers des charges clients.
84

Entre le produit initial, l’agneau nouveau-né, et le produit fini, l’agneau certifié, il existe des contraintes et des exigences (exemple : fournitures d’achats) pour lesquelles sont définis des contrats ainsi que l’explicite la figue suivante :
Figure n°14 : Le schéma des 5 M ou pyramide HACCP :
Moyens (5) Milieu (2) Main d’oeuvre (3)
Agneau nouveau-né Agneau certifié
Matières premières (1) Méthodes (4)
Source : (25)
♦ Les matières premières (1) :
Sous cette dénomination sont regroupés les prestataires et les achats faisant l’objet d’un contrat nécessairement vérifié par des revues de contrat.On définit les matières premières et les contrats liant aux fournisseurs assurant la régularité de la qualité (exemple : foin, grain).L’approvisionnement en produits et les achats de services font l’objet d’une planification dont la maîtrise et la vérification sont établies dans le système qualité. Il y a en effet vérification du produit acheté lorsque l’acheteur le demande (par exemple, un abatteur peut demander à visiter l’élevage auprès duquel il désire s’approvisionner), ceci devant se dérouler conformément aux procédures.
On définit les prestataires (exemple : abattoir) ainsi que les contrats établissant leurs modalités d’action.Le groupement doit fournir la production correspondant aux exigences des acheteurs (abattoirs, transformateurs et autres GMS). Cette garantie doit faire l’objet d’un contrat et doit s’accompagner pour chaque produit et service de documents descriptifs et de preuves concernant les caractéristiques avancées. Ces supports, tels que le cahier des charges, doivent contenir une définition satisfaisante, technique et commerciale, des produits ou services pour répondre aux besoins de l’acheteur en évitant toute ambigüité. Devront y figurer également une description complète et précise des caractéristiques du produit fourni par le
85

groupement et les critères d’acceptation prévus pour chaque caractéristique (par exemple, l’éleveur doit alimenter ses agneaux par allaitement maternel puis au moyen d’un aliment d’engraissement certifié figurant sur une liste incorporée dans le classeur Adret).La manutention, le stockage, le conditionnement et la livraison sont également définis dans cette partie. Ce critère s’applique aux intrants et aux produits de ramassage (agneaux vifs) jusqu’à leur mise à disposition auprès du destinataire prévu.
♦ Le milieu (2) :
Il fait référence à deux caractéristiques de la mise en place du système :♠ l’identification et la traçabilité :
Ces deux points concernent tous les produits et services qui contribuent à la qualité du produit final rendu à l’acheteur (Agneau de l’Adret par exemple). L’identification a plusieurs finalités :
*prouver l’origine des produits*fournir des garanties nécessaires concernant les techniques de production *connaître tous les éléments inhérents aux produits ou services concernés, notamment
ceux constituant un risque (l’accent est actuellement placé sur les aliments et les produits vétérinaires suite à la politique de consommation dubitative)
*éliminer le risque d’accepter un produit ou un service dont les caractéristiques ne correspondent pas au contrat, au cahier des charges ou aux spécifications
*limiter les risques de confusion*répondre à des besoins de traçabilité
La traçabilité est l’aptitude à retrouver l’historique et/ ou la destination d’un produit ou d’un service. Les exigences de cette traçabilité (réglementaires et contractuelles) doivent être décrites et respectées par le groupement.
♠ les enregistrements relatifs à la qualité : Ils ont pour objectifs :
*de prouver que la qualité requise est atteinte*de prouver que la mise en œuvre du système est efficace*de constituer un historique des résultats afin de faire évoluer ce système.
♦ La main d’oeuvre (3) :
Le personnel du groupement dit posséder la compétence requise pour réaliser toutes les tâches qui lui incombent et qui ont une incidence sur la qualité. Cela peut mener à un besoin de formation pour certains postes. Le groupement a également eu besoin d’embaucher une personne qualifiée pour la réalisation des audits et la formation des techniciens à la démarche SOFRAG.
♦ Les méthodes (4) :
Elles regroupent les procédures et les documents qualité, c’est-à-dire :♠ la maîtrise des procédés :
Les procédés concernés sont tous ceux liés aux activités permettant de réaliser le produit ou le service fourni aux acheteurs du groupement. Il s’agit notamment des activités de commercialisation des produits fournis aux adhérents (matériel d’élevage, aliment…), de suivi technico-économique (technicien), de suivi sanitaire (vétérinaire).
86

♠ les contrôles et essais : Programmés et documentés, ils doivent être mis en place afin d’évaluer de façon périodique la satisfaction des acheteurs par les produits et services fournis. Les contrôles portent sur les produits de commercialisation, les services et les intrants. Il faut préciser le type et la fréquence de ces contrôles, ainsi que les références utilisées. Il existe trois états d’avancement principaux des contrôles :
*produit en attente de contrôle ou non encore contrôlé (agneau certifiable Adret)*produit contrôlé conforme (agneau certifié Adret)*produit contrôlé non conforme (agneau non certifié Adret, qui entre alors dans la
catégorie standard sauf si l’éleveur a signé l’engagement qualité SOFRAG, auquel cas son agneau bénéficie d’une plus-value)Les résultats de ces contrôles sont enregistrés et conservés.
♠ La maîtrise du produit non conforme et les actions correctives : On cherche à éviter que ce genre de produits soient fournis à l’acheteur (contrôle et jugement à l’abattoir). Il s’agit également de s’assurer que toutes les non-conformités soient détectées et rapidement traitées (erreur de jugement de l’éleveur au cours du tri de ses agneaux : le technicien passera dans l’élevage pour aider l’éleveur à améliorer son jugé lors du prochain ramassage).
♦ Les moyens (5) :
Ils sont constitués par :♠ Les techniques statistiques :
Elles sont employées conformément aux textes réglementaires et normatifs. Elles permettent par exemple de connaître l’impact de la qualification sur l’ouverture du marché.
♠ Les audits qualités internes : Leur rôle est la vérification des activités relatives à la qualité et leur conformité par rapport aux dispositions prévues et leur efficacité. Ils permettent donc de déterminer la pertinence et la cohérence du système. Dans le cadre de la production de « l’Agneau de l’Adret », la SOFRAG organise des audits internes au rythme de deux par an et par structure ainsi que dans 5% des élevages pour diminuer la fréquence et le coût des audits externes réalisés par QUALISERT-SGS-ICS.
2.3. Les procédures-type
Documents décrivant des opérations usuelles, elles en donnent la ligne de conduite et sont consultées en cas de litige ou de modifications des clauses de fonctionnement du groupement. Pour expliciter ces formalisations, nous verrons en exemple la procédure-type concernant l’identification et la traçabilité des animaux.
Tableau n°20 : Procédure-type de l’identification et de la traçabilité des animaux :
DOCUMENTS ET ENREGISTREMENT
ENTRANTS
ACTION DOCUMENTS ET ENREGISTREMENT
SORTANT
RESPONSABLE
87

document généalogique - naissance- enregistrement des mise bas
- fiche carrière- inventaire du cheptel
éleveur
bordereau de livraison et documents extérieurs (ex. DAUB)
marquage de l’animal (boucle ou tatouage)
- cahier d’élevage- document d’accompagnement
éleveur
contrôle de l’identification en élevage
cahier d’élevage éleveur
conformité (*) auditeurbordereau d’enlèvement
contrôle d’identification à l’enlèvement
- client- groupement- services externes
marquage éventuel bordereau d’enlèvement éleveur- bordereau d’enlèvement- transport
établissement du bordereau de livraison chez le client
transporteur
Source :(14)
En cas de non conformité (* dans le tableau), la procédure fait suivre une action corrective auprès de l’éleveur qui la notera dans son cahier d’élevage. Il ne pourra reprendre son activité qu’après vérification par l’auditeur qu’il a réellement mené à terme ces actions correctives. Dans ce cas, il rentre dans la procédure au stade auquel il l’a momentanément quittée (la conformité dans ce cas précis).Ainsi, on peut se rendre compte que toute action est incluse dans les procédures, permettant une justification en cas de contrôle surprise par l’organisme certificateur.
3. L’AUDIT INTERNE
NB : Sera désigné ci-après par audit l’audit interne car l’audit externe est indépendant de la démarche qualité inhérente au groupement, et par conséquent « hors sujet ».
Il est élaboré à partir du guide de mise en place de la norme ISO 9002 appliquée aux groupements d’éleveurs pour les espèces bovines, ovines et porcines, du guide de la rédaction du manuel d’Assurance Qualité et des 32 procédures-type. Cependant, le meilleur guide d’audit est la procédure que l’on désire auditer – ce document présentant le déroulement et l’organisation des tâches, et introduisant les autres documents et les enregistrements suivants concernés. C’est le manuel d’Assurance Qualité qui doit organiser et planifier les audits. Un audit peut être réalisé en plusieurs étapes, l’objectif restant la validation de l’intégralité des procédures sur une période déterminée.
3.1 Définition
88

L’audit est « l’examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies par le système d’Assurance Qualité mis en place, et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon efficace et aptes à atteindre les objectifs fixés. » (47).
3.2 Buts
L’audit doit vérifier la conformité aux principes de l’Assurance Qualité et le respect de ce qui est réalisé par rapport aux procédures, instructions de travail et contrôles prévus.L’auditeur interroge toutes les personnes s’étant engagées dans la procédure qualité. L’audit permet aussi de s’assurer de la validité du système d’Assurance Qualité mis en place.
Les questions posées par l’auditeur sont ouvertes, formulées dans des termes généraux de façon à favoriser le dialogue et à optimiser l’efficacité de l’audit. A la fin de celui-ci, l’auditeur remplit un tableau de synthèse qui sera joint au rapport d’audit. Ce tableau permet de donner une vision globale et rapide de la situation de chaque activité du groupement en matière d’Assurance Qualité par rapport aux objectifs qui ont été déterminés au moment de la rédaction du processus d’Assurance Qualité. Toute proposition d’amélioration du système qualité formulée par l’audité ou l’auditeur doit être mentionnée dans le rapport d’audit. En vue de résoudre les cas de non-conformité constatés, l’auditeur envisage et décrit les actions correctives correspondantes à la fin du rapport. Ces actions seront ensuite discutées puis entérinées par le responsable du secteur audité.
3.3 Instructions pour l’auditeur
Tout au long de sa visite, l’auditeur doit recueillir les informations nécessaires, prises au niveau du siège du groupement ou auprès des éleveurs ou en consultant les documents, pour être capable de répondre aux questions présentées dans le questionnaire d’audit (43). A chaque question, il doit effectuer en parallèle toutes les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’application effective de ce qui est prévu.
L’auditeur doit ainsi s’assurer que :
♦ concernant les procédures :* il en existe une liste à jour * elles sont disponibles là où il est prévu qu’elles le soient,* elles sont à jour,* elles sont diffusées à toutes les personnes concernées,* elles sont connues de toutes ces personnes,* elles sont effectivement mises en œuvre.
♦ concernant les instructions de travail :* il en existe une liste à jour,* elles sont affichées ou présentes aux postes correspondants, et donc à disposition des
opérateurs,* elles sont à jour,* elles sont connues des opérateurs,* elles sont appliquées correctement par ces derniers.
89

♦ concernant les enregistrements :* ils sont raccordés à un document de référence,* ils sont lisibles et compréhensibles,* ils sont correctement diffusés,* ils sont correctement classés.
♦ concernant le personnel :* il connaît ses missions et responsabilités,* il est formé aux tâches relatives à la qualité spécifiées dans sa définition de fonction
ou de poste,* il est correctement qualifié lorsque cela est prévu,* il applique et fait appliquer ce dont il est responsable.
3.4 Le questionnaire-type
Il est rédigé et utilisé par le responsable qualité ou toute autre personne habilités à réaliser l’audit. Il comporte des questions-repère et des conseils. Au travers de ces éléments, la conformité à l’ensemble des exigences de la norme ISO 9002 est examinée critère par critère. Ces questions-repère sont répertoriées en une liste définie pour chaque activité et nommée critère (18 au total).
Dans le cadre des activités du groupement étudié, nous examinerons en tant qu’exemple le critère correspondant à la procédure « Suivi sanitaire des productions ».
L’interlocuteur est le responsable technique ou le vétérinaire.
Les questions-repère que l’auditeur doit poser sont parmi les suivantes :
- Existe-t-il une procédure relative à l’organisation du suivi sanitaire des élevages ?- Peut-on consulter l’historique des programmes de suivi sanitaire et où trouve-t-on la trace de cette approbation ?- Comment est prise la décision de suivi d’un élevage ?- Le suivi sanitaire d’un élevage donne-t-il lieu à des comptes rendus systématiques d’intervention ?- Peut-on consulter un ou deux dossiers d’éleveurs afin de s’assurer que tous les documents relatifs au suivi sanitaire y figurent conformément à ce qui est décrit dans la procédure (programme de suivi sanitaire personnalisé, engagement de l’éleveur, synthèse de suivi sanitaire) ?- Comment sont exploités les résultats ?- Comment est évaluée l’efficacité du suivi sanitaire ?
8 Peut-on consulter l’ensemble des instructions techniques relatives au déroulement du suivi sanitaire ?
3.5 L’exemple des exigences de la démarche SOFRAG :
Elles sont multiples et s’appliquent à toutes les étapes de la production. Nous les aborderons successivement par le biais du tableau n°XXI :
90

Tableau n°21 : Schéma de vie des agneaux type boucherie du groupe SOFRAG :
1) Etapes de la production
Sélection des élevages- élevages naisseurs-engraisseurs- élevages adhérents de la SOFRAG ou d’un groupement de la SOFRAG
Sélection des animaux reproducteurs- races de type bouchère ou adaptées au terroir- races référencées par les groupements du groupe SOFRAG
Reproduction- insémination artificielle- monte naturelle
Agnelage- tenue d’un carnet de bergerie- identification officielle- allaitement maternel
SevrageAge minimum de 60 jours (ou équivalent en poids)
EngraissementAlimentation à base de produits fermiers et/ou complémentation avec des aliments de fournisseurs référencés
Préparation à l’enlèvementTri selon l’état d’engraissement, le poids, l’identification officielle, le mode d’allaitement et l’âge
Enlèvement et transport- rédaction d’un bordereau d’enlèvement qui accompagne la livraison- durée du transport la plus courte possible
Transfert par un centre d’allotement- maîtrise de la traçabilité des lots- centres d’allotement référencés
2) Etapes de la transformation
Réception des animaux
- respect des règles de manipulation des animaux- identification et saisie informatique des
91

informations- bergerie d’attente : respect des bonnes pratiques d’élevage- respect des législations en vigueur
Abattage- abattoirs agréés CEE- respect de la marche en avant du produit- maîtrise de la traçabilité individuelle des carcasses
Pesée fiscale
- inspection vétérinaire- classement par un classificateur agréé par l’OFIVAL- marquage des carcasses- pesée- sélection des carcasses : poids de 14 à 22 kg, conformation E,U,R,O, état d’engraissement 2 ou 3, couleur de la viande rose clair, gras de couverture blanc, ferme, non huileux
Ressuage, stockage et découpe- température des carcasses < 7°C- maintien de la traçabilité
Transport de la viande au point de vente- transport réalisé par une société agréée par le groupe- maintien de la traçabilité
Mise en rayon- maintien de la traçabilité- affichage conforme au produit
Source : (43)
Pour obtenir l’appellation SOFRAG, l’éleveur doit également respecter les points suivants :
♠ Tenue d’un carnet de bergerie et de santé du troupeau : les informations obligatoires à noter sont les suivantes :
* n° des agneaux * n° de la mère* date de naissance* sexe* mode d’allaitement* observations (mortalité, n° du père, date de sevrage)* traitements individuels et collectifs réalisés sur les agneaux, en précisant les n° des
agneaux traités, la date du traitement, le produit utilisé et le délai d’attente avant abattage* nettoyage et désinfection de la bergerie en mentionnant la date du curage, la date de
la désinfection et le produit utilisé.
♠ Identification des animaux : dans les trois jours qui suivent la naissance, par la pose de la boucle officielle ou par une identification temporaire (peinture), la boucle officielle devant être posée dans le mois suivant la naissance.
♠ Alimentation des animaux : l’alimentation des ovins est à 100% d’origine végétale. L’aliment est fabriqué à la ferme ou acheté auprès d’un fournisseur référencé par la
92

SOFRAG. Pour un aliment fabriqué à la ferme, les matières premières autorisées parmi sont les suivantes : * céréales : orge, avoine, blé, triticale , maïs, soja, seigle
* protéagineux : pois, lupin, féveroles, pois chiches et soja* pulpes* compléments minéraux vitaminés* paille ou foin* luzerne déshydratée* mélasse utilisée comme liant.
Les bons de livraison et les étiquettes doivent être conservés pendant un an.
♠ Suivi sanitaire du troupeau ovin : l’éleveur doit respecter les préconisations du plan sanitaire d’élevage défini par le groupement dont il fait partie. Tous les produits vétérinaires utilisés sur l’exploitation doivent être accompagnés d’une ordonnance signée par un vétérinaire, document à conserver au moins un an et toute la durée des temps cumulés de traitement et de délai d’attente.
♠ Les agneaux certifiables doivent avoir moins de 10 mois. Les agneaux élevés au lait artificiel sont exclus de la certification et identifiés de façon spécifique à l’élevage. Les agneaux certifiables sont identifiés par la pose d’une boucle SOFRAG au moment du départ ou de la boucle Adret selon les âges des agneaux et si l’éleveur a signé un contrat Adret.
3.6 Procédure de référencement des élevages : l’audit qualité SOFRAG
Suite à la demande écrite formulée par l’éleveur, l’auditeur SOFRAG se déplace accompagné on non du technicien qui suit l’élevage et remplit l’audit de référencement. Ce document, en trois feuillets, est présenté dans cette étude en annexes I , II et III.
L’audit se fait selon un protocole décrit, qui précise les points suivants : ♦ les conditions d’audit : audit sanitaire avec les animaux, en présence de l’éleveur,
selon des modalités précises de déroulement de la visite (respect des flux d’animaux, tenue vestimentaire sanitaire à usage unique si possible...)
♦ l’intervenant : l’auditeur doit être qualifié, compétent ; il doit faire preuve d’impartialité et de rigueur.
♦ le rapport d’audit ou compte-rendu : sa transcription et la diffusion des informations sont codifiés.
♦ le traitement des écarts avec l’audité ( l’éleveur) par des actions correctives : tout ce qui concerne les propositions, les prises de décision, les dates de mise en place des actions correctives et la vérification de l’application des actions correctives est précisé dans le protocole.
Cet audit est un support de travail destiné à donner une image de l’élevage à l’instant t correspondant au passage de l’auditeur.
Suite à cette visite, l’auditeur va réaliser l’analyse de toutes les informations qu’il a récoltées.Ensuite, il effectuera le traitement des données en fonction des points qui ne correspondent pas aux objectifs demandés. A ce stade de la procédure, il prendra une décision parmi les quatre suivantes : ♦ soit l’élevage est conforme en tous points à ses attentes : dans ce cas, l’éleveur signe l’engagement pour la production d’agneaux SOFRAG et sera référencé dans les deux mois qui suivent la date de l’audit.
93

♦ soit il existe une (ou des) non-conformité(s) de niveau 1 :*pas de référencement immédiat : l’éleveur doit mettre son élevage en conformité au
moins sur les points de niveau 1*après la mise en conformité, l’éleveur le signale et l’officialise par un courrier de
levée de réserve, puis il signe l’engagement pour la production d’agneaux SOFRAG.*son référencement interviendra au plus tard deux mois après la date de réalisation de
l’audit de référencement.♦ soit il existe une (ou des) non-conformité(s) de niveau 2 :
*l’éleveur peut être référencé si il signe la lettre d’engagement à lever les non-conformités de niveau 2 et s’il signe l’engagement pour la production d’agneaux SOFRAG.♦ soit il existe une (ou des) non-conformité(s) de niveau 3 : les points de niveau 3 sont signalés dans le but de sensibiliser les éleveurs mais n’ont à ce jour aucun caractère obligatoire. La lettre d’engagement dont un spécimen figure en annexe IV témoigne du sérieux du contrat et du souci de traçabilité qui anime la démarche SOFRAG.
En cas de non-conformité, l’auditeur émettra des propositions pour améliorer ces points ou il imposera une mise en conformité par rapport aux exigences écrites par le biais d’actions correctives.
Enfin, il effectuera le suivi de l’élevage audité pour vérifier si l’application des actions correctives est réelle ou non afin de pouvoir décerner ou pas la certification à l’élevage concerné.
Toutes ces démarches de certification représentent pour les organismes demandeurs un coût important, elles trouvent donc leur justification dans la plus-value économique qu’elles confèrent sur un marché de plus en plus saturé par les importations. Le contexte actuel de la production ovine est très défavorable à l’engagement des éleveurs, parce que les mentalités sont difficiles à changer. L’évolution des producteurs ovins est longue car c’est une production victime de ses traditions : beaucoup de familles d’éleveurs élèvent des ovins depuis de nombreuses générations et leur savoir-faire peut être un frein à leur évolution ; la qualité est une démarche très récente, et les producteurs se perdent souvent dans les notions abstraites qui l’accompagnent. Les techniciens et les vétérinaires se doivent de les aider au mieux à changer certaines de leurs habitudes de travail , afin de préparer au mieux la filière ovine à une concurrence grandissante des importations d’une qualité peut-être inférieure, mais d’une homogénéité irréprochable, point fort de ces productions.
CONCLUSION
La filière ovine française travaille donc à l’amélioration de la qualité et à la segmentation du marché, bien consciente que l’agneau français de qualité doit pouvoir se démarquer des importations autrement que par son prix. La démarche qualité a pris uns réelle ampleur dans le domaine de l’alimentaire. Elle s’étend du producteur au consommateur, dans un souci de
94

suivi sanitaire, technique et également commercial. Après l’augmentation de la productivité, l’orientation s’est établie par rapport à la sécurité du consommateur final. La stratégie HACCP, après son apparition, et une époque dubitative quant à sa relative efficacité, s’est développée dans de nombreux domaines de la production animale. Elle représente une ouverture du marché et pour les groupements de producteurs adhérents à la démarche, un avantage certain par rapport à la concurrence développée dans les secteurs régional et national. Cette démarche nécessite un travail d’équipe : le technicien, le vétérinaire et l’auditeur contribuent en partenariat avec l’éleveur à l’évolution vers une production fiable économiquement parlant tout en étant sécurisante pour le consommateur. L’éleveur doit également recevoir les responsables qualité et marketing des différents groupes de distribution d’aval venant s’assurer que le contrat d’engagement est respecté. Toutes ces actions exigent beaucoup de disponibilité, point sensible dans la profession de l’élevage, elles sont donc souvent la source d’hésitation auprès des éleveurs. Cependant, le marché exigeant la traçabilité de la viande ovine, il est plus que nécessaire d’instaurer dans les habitudes d’élevage le respect des normes hygiéniques et sanitaires définies dans l’Assurance Qualité. Les avantages économiques permettent de motiver les éleveurs, une viande certifiée ADRET ou SOFRAG étant bien valorisée par rapport à une viande standard, point d’autant plus important que le contexte actuel de la production ovine est plutôt à la baisse des revenus des éleveurs. La certification qualité est une garantie alimentaire à laquelle le vétérinaire participe, et ce, à tous les échelons (élevage, abattage, distribution, restauration), d’où l’intérêt pour tout groupement de producteurs de coopérer avec ce dernier ; l’Assurance Qualité démontre le lien de complémentarité qui existe entre les différents volets de la profession vétérinaire.
95

96

ANNEXE I : PREMIERE PARTIE DE L’AUDIT SANITAIRE
CONNAISSANCE GENERALE DE L’ELEVAGE
Nom de l’élevage (raison sociale) :Nom de l’interlocuteur élevage :Adresse :N° EDE :Groupement :N° adhérent :Technicien :Vétérinaire :Autres productions : OUI NONSi oui, lesquelles :Nombre et races des brebis :Nombre et races des béliers :
L’élevage participe-t-il déjà à une ou plusieurs démarches qualité ? OUI NON Si oui, lesquelles :
Périodes d’agnelage :
J F M A M J J A S O N DNb brebisNb agneaux
L’éleveur dispose d’un contrat de désaisonnement ? OUI NON
Mode de conduite des agneaux : Plein-air semi-Plein-air bergerie
Mode de conduite des brebis : Plein-air semi-Plein-air bergerie
L’éleveur réalise un sevrage de ces agneaux : OUI NONSi oui, à quel âge ou poids ?
A quel âge sont vendus les agneaux de type « boucherie » ?<100 jours De 100 à 120 jours De 120 à 150 jours De 150 à 300 jours >300 jours
% % % % %
97

1)Alimentation
L’éleveur utilise des boues sur les pâtures destinées aux ovins : OUI NON
Type de ration des reproducteurs :
Nature Fabriqué à la ferme
Acheté Fournisseur et nom du produit
PâturageFourrages conservésAutres
Type de ration des agneaux :
Nature Fabriqué à la ferme
Acheté Fournisseur et nom du produit
PâturageFourrages conservésAutres
L’éleveur utilise du lait artificiel : OUI NON
L’éleveur conserve les bons de livraison et un exemplaire des étiquettes de ces aliments pendant un an : OUI NON
Aménagement d’un lieu de stockage spécifique des aliments ruminants : OUI NON
2)Suivi sanitaire et traitements vétérinaires
Curage et nettoyage de la bergerie : OUI NONFréquence :
Désinfection de la bergerie : OUI NONFréquence :Produit utilisé :
Lieu de stockage des produits vétérinaires :Présence de produits vétérinaires périmés :
L’éleveur note les traitements réalisés sur les agneaux : Individuels : OUI NON Collectifs : OUI NON
L’éleveur note les traitements réalisés sur les brebis :Individuels : OUI NON Collectifs : OUI NON
98

Les produits vétérinaires présents sont accompagnés d’une ordonnance : OUI NONL’éleveur conserve les ordonnances pendant au moins un an : OUI NONL’éleveur respecte les délais d’attente avant abattage : OUI NON
3)Respect des bonnes pratiques d’élevage
Densité dans les bâtiments + = -Ambiance générale dans les bâtiments (odeur, humidité…)Régularité et qualité du paillagePropreté de l’eau de boissonPropreté du matériel de distribution des alimentsManipulation des animaux sans bâton ou matériel pouvant entraîner des blessures corporelles sur les animauxQualité des abords de la fermeMise à disposition de matériel pour l’enlèvement des agneauxAppréciation générale de l’état corporel des animaux (en fonction de leur stade physiologique)Aménagement d’un lieu de stockage des animaux morts
4)Identification
L’éleveur tient un carnet d’agnelage : OUI NON
Les animaux sont identifiés selon les règles départementales en vigueur : OUI NON
A quel moment l’éleveur pose-t-il les boucles d’identification officielle des agneaux ?
Les agneaux ayant têté du lait artificiel sont identifiés de façon spécifique pour être écartés de la certification : OUI NONSi oui, de quelle façon ?
5)Environnement
L’épandage est réalisé selon les règles départementales en vigueur : OUI NON
99

ANNEXE II : DEUXIEME PARTIE DE L’AUDIT SANITAIRE
CONFORMITE DE L’ELEVAGE AVEC LE CAHIER DES CHARGES
Légende :C=ConformitéNC=Non Conformité
C NC
NIVEAU 1
Elevage adhérent d’un groupement de la SOFRAGElevage naisseur-engraisseurLes races utilisées sont de type bouchère ou adaptées au terroirL’éleveur tient un carnet de bergerieLes animaux sont identifiés selon les règles officielles en vigueur dans le départementLes agneaux sont identifiés dans les trois jours qui suivent la naissanceLes agneaux sont sevrés à plus de 60 joursL’alimentation de base est à 100% d’origine végétaleL’aliment et le fournisseur sont référencés par la SOFRAGL’éleveur n’épand pas de boues sur les pâtures destinées aux ovinsL’éleveur n’utilise pas d’antibiotiques ou anticoccidiens comme facteurs de croissance
NIVEAU 2
La conduite est de type PA, SPA ou de bergerieLe mode de reproduction utilisé est l’IA ou la monte naturelleLa litière utilisée en bergerie est d’origine végétaleL’éleveur enregistre les traitements collectifs des agneauxL’éleveur enregistre les traitements individuels des agneauxL’éleveur enregistre les dates de sevrage de ses agneauxL’éleveur conserve les bons de livraison et les étiquettes des aliments pendant au moins un anL’éleveur achète ses produits vétérinaires avec ordonnanceL’éleveur conserve les ordonnances pendant au moins un anRespect des bonnes pratiques d’élevageL’éleveur identifie les agneaux allaités artificiellement pour les exclure de la certification (+ notation sur le carnet)
NIVEAU 3
L’éleveur utilise des semences sans OGML’éleveur distribue un aliment garanti sans OGML’éleveur enregistre les traitements collectifs des brebisL’éleveur enregistre les traitements individuels des brebis
100

ANNEXE III : TROISIEME PARTIE DE L’AUDIT SANITAIRE
CONCLUSION DE L’AUDIT
Aucune non- conformité n’a été détectée lors de l’audit, l’élevage est donc en conformité avec les exigences du cahier des charges de la SOFRAG, les premiers agneaux issus de cet élevage pourront partir dans le cadre de la démarche SOFRAG dans un délai de 2 mois suivant la date de cette visite soit à partir du __/__/__
Les non-conformités détectées lors de cette visite imposent :- la mise en place d’actions correctives immédiates (non-conformité de niveau 1) :
- un engagement de la part de l’éleveur à (non-conformité de niveau 2) :
Les non-conformités détectées lors de l’audit ne permettent pas de référencer l’élevage. L’auditeur et le service qualité SOFRAG se tiennent à la disposition de l’éleveur pour l’aider à se mettre en conformité avec le cahier des charges.
Je soussigné,____________________ auditeur élevage pour la SOFRAG certifie que les informations notées ci-dessus sont conformes à mes observations et aux réponses de l’éleveur.
Je soussigné,____________________ propriétaire de l’élevage audité certifie que les informations données à l’auditeur et notées sur ce document sont justes et conformes à la réalité de mon élevage et à mes pratiques.
L’éleveur L’auditeur
101

ANNEXE IV : LETTRE D’ENGAGEMENT A LA DEMARCHE SOFRAG
Engagement de l’éleveur pour la production d’agneaux destinés à la démarche qualité SOFRAG :
Je soussigné, Mme, Mlle, M ___________________________________________Eleveur à : _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Adhérent du groupement de producteurs ovins : ____________________________________
souhaite participer à la démarche qualité proposée par le groupe SOFRAG.
Dans le cadre de cette démarche, l’éleveur s’engage à respecter les exigences des cahiers des charges de la SOFRAG ainsi que leurs modifications éventuelles.
L’éleveur s’engage à accepter les contrôles du technicien auditeur agréé par la SOFRAG ainsi qu’aux contrôles inopinés des personnes agissant pour l’organisme certificateur de la démarche qualité SOFRAG.
Le groupement s’engage à référencer l’éleveur ci-dessus en vue de la production d’agneaux certifiés, à apporter les conseils techniques, à fournir les informations nécessaires et les modifications éventuelles du cahier des charges et à tenir à disposition les bordereaux de livraison et les documents d’enregistrements nécessaires à la certification.
L’abatteur s’engage à assurer la traçabilité du produit au numéro individuel de l’agneau.
La durée de l’engagement est prévu pour un an renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée à tout moment par courrier par l’une ou l’autre partie.
En cas de non respect de l’engagement, l’élevage sera exclu de la démarche pour une période définie jusqu’à retour à la conformité. Toute infraction grave pour non respect des exigences des cahiers des charges de la SOFRAG pourra entraîner la dénonciation immédiate de cet engagement.
Fait à ____________________ , le______________________
L’éleveur (*) Pour le groupement
(*)signature précédée de la mention « lu et approuvé »
102

BIBLIOGRAPHIE
(1) Association de promotion « Agneau de l’Adret ». Bilan 1999. Janvier 2000. Document interne, 21 p.
(2) Association de promotion « Agneau de l’Adret ». Dossier de presse. Mars 2000. Document interne, 10 p.
(3) BABO D. Races ovines et caprines françaises. Edition France Agricole, p.12.
(4) BATICLE Y. L’élevage ovin dans les pays européens de la Méditerranée occidentale.1974. Paris, Les Belles Lettres, 600 p.
(5) BAZIN G. Quelles perspectives pour les agricultures montagnardes ? Exemple du Massif Central Nord et des Alpes du Sud. 1986. INRA,Grignon, 42 p.
(6) BAZIN G.,CHASSANY JP. Quelles perspectives pour l’élevage ovin dans les montagnes sèches ? 1986. Montpellier, INRA Economie et sociologie rurales, 121 p.
(7) BLANCHARD C.,GUILLEMAUD M.,SERAI R., Agneau français : éviter le point de non-retour, La France Agricole, 3 décembre 1999, pp.16-17.
(8) BLANCHEMAIN A. Intensification et extensification. Quel avenir pour la production ovine française ? 1988, Economie Rurale n°183, pp 26-34. (9) BOURBOUZE A. Les filières des produits animaux en France, viande ovine. 1982, INRA Paris-Grignon, CEREOPA, 82 p.
(10) BOUTONNET JP. Les revenus des éleveurs ovins. Colloque de la société française d’économie rurale : les revenus agricoles, 1993, Montpellier, 10 p.
(11) BOUTONNET JP. Marché des viandes : les clefs de l’évolution. Déméter 1999, éd. Armand COLIN, pp.58-245.
(12) BOUTONNET JP., ROMUSC JP., RIO Y. Evolution du marché international et européen de la viande ovine. Perspectives 1984-1990. 1981, INRA, ESR Montpellier, série études et recherches n°61,77 p.
(13) CARRERE G., VALLEIX Y., JUILLARD-LAUBEZ MC. Impact des aides sur les revenus en zones défavorisées. CEMAGREF, 1988, Grenoble, 137 p.
(14) CERTI- ELEVAGE . Guide pédagogique professionnel. 1999, document interne, 110 p.
(15) CHARVET JP. La France agricole en état de choc. 1994, éd. LIRIS, 224 p.
(16) CIV. Races ovines , consultation du site www.centre-info-viande.asso.fr.
(17) COLSON D. Qualité viande bovine; La grande distribution de la viande bovine. Décembre 1999/ Janvier 2000, bulletin des GTV n°5, pp. 5-12.
103

(18) Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2000 de la Coopérative Die-Grillon, document interne, 15 p.
(19) DGAL. Guide législatif et réglementaire. Hygiène des denrées animales et d’origine animale. 1999 (édition mise à jour), 703 p.
(20) FAO, base de données « FAOSTAT », consultation du site http://apps.fao.org.
(21) FOURNIER JP et PERIGORD M. Dictionnaire de la qualité. AFNOR, 1995, 425 p. (22) FRANCE. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.- Code Rural, livre IX, partie législative, annexe II à l’ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000.- pour la partie Santé publique vétérinaire et protection des végétaux, Lutte contre les maladies des animaux, Le contrôle sanitaire.- Journal Officiel n°143 du 22 juin 2000, p.47 à 265.
(23) FRANCE. Ministère de la Santé.- Code de la Santé Publique, 1° partie, Législative, Livre V : Pharmacie, Chapitre III : Pharmacie Vétérinaire ; annexe à l’ordonnance n°2000-548 du 22 juin 2000, cinquième partie.- pour la partie Produit de Santé, Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l’intérêt de la santé publique.- Journal Officiel n°143 du 22 juin 2000, 43 p.
(24) FRAYSSE JL, GUITARD JP. Produire des viandes, T2, Produire des viandes ovines. 1992, Paris, Tec. Doc. Lavoisier, 361 p.
(25) FROMAN B. Le manuel qualité, outil stratégique d’une démarche qualité. AFNOR.1995, 470 p.
(26) GEB, « Agenda 2000 Paquet Santer II », « Premières analyses de l’impact du projet de réforme et des effets probables sur l’évolution des systèmes d’élevage » in Le dossier Economie de l’élevage. Institut de l’élevage, avril 1998, Paris, 57 p.
(27) GIE ovin Rhône-Alpes. Cahier des charges « Agneau de l’Adret ». 1999/2000, document interne, 48 p.
(28) GIROUX J. Segmentation du marché et poids des viandes identifiées. Décembre 1998, Bétail et viandes n°32, pp.14-17.
(29) Institut de l ‘élevage. L’année économique ovine.n°290 B, avril 2000, 62 p.
(30) Institut de l’élevage. Dossiers du GEB. n°248, mai 1996, 28 p.
(31) JOUVE JL. La qualité microbiologique des aliments. Maîtrise et critères. CNERNA-CNRS, 1999, Edition Polytechnica, pp. 36-37 et 48-50.
(32) JUSTINE N. Propos recueillis d’E.COSTE, d’H. DESTREL et de LM LEPOUREAU. Novembre 1998, Bétail et viande n°31, pp. 22-26.
(33) LAPORTE R. Ovins 2001 : l’union européenne restera déficitaire. Novembre/décembre 1997, Bétail et viandes n°22, pp.18-19.
(34) LIENARD G., CORDONNIER P., BOUTONNET JP. Exploitations et systèmes de production d’herbivores. Importance, évolution, question, 1992, INRA Prod. Anim., pp. 59-85.
104

(35) MEYZENC Cl. Hautes-Alpes, Ubaye, Haut Drac, Préalpes drômoises, 1984, Gap, Orphrys, 954 p.
(36) MEYZENC Cl. L’élevage des agneaux gras dits de Sisteron à travers les Alpes du Sud (l’exemple des Hautes Alpes), 1975, RGA, 4, pp. 447-469.
(37) OFIVAL. Publications et statistiques, consultation du site www.ofival.fr.
(38) PERRET G. Races ovines. ITOVIC, 1986, 441 p.
(39) PLUVINAGE J., MOLENAT G. L’élevage ovin en Crau, un système pastoral articulé sur l’agriculture. Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, document interne, 16 p.
(40) REPARAZ A. La transhumance ovine provençale, évolution et problèmes actuels.1969, Recherches Méditerranéennes & Etudes et travaux de Méditerranée, Ed Orphrys,Gap, pp 223-231.
(41) RIEUTORT L. L’élevage ovin en France. 1995, éd. CERAMAC, 511 p.
(42) ROYANT P., LINOSSIER P. La filière ovine française face à ses concurrents. 1991, Filière viande et pêche, pp. 74-80.
(43) RUNAVOT C. Formation auditeur interne SOFRAG. 1999, document interne, 12 p.. (44) SIVIGNON M. La diffusion des modèles agricoles : essai d’interprétation de l’est et du sud de l’Europe. 1992-1993, RGPSO, n°2, pp. 133-154.
(45) SOUFFLET JF. Le rôle des marchés de bétail vif dans les filières ovine et bovine. 1993, BTI n°13, pp. 47-62.
(46) SPINDLER F. Un siècle et demi d’élevage en France. 1991, SCEES, collec.Etudes, n°8, 253 p.
(47) VANDEVILLE P. et GAMBIER C. Conduire un audit qualité. Méthodologie et techniques. 1994, AFNOR, 284 p.
105

Toulouse, 2001
NOM : LEFEBVRE PRENOM : Sidonie
TITRE : PRODUCTION OVINE ET MISE SOUS ASSURANCE QUALITE : L’EXEMPLE DE L’AGNEAU DE L’ADRET
RESUME :
Dans une première partie, l’auteur dresse le bilan de l’état actuel de la filière viande ovine française à tous ses échelons. Après avoir exposé la situation de la France sur le marché international, l’auteur explique la nécessité économique pour la production française de se différencier et les moyens qu’elle se donne pour y arriver.Dans une seconde partie, l’exemple de cette mutation du monde ovin est illustré par la certification de conformité produit « Agneau de l’Adret », démarche régionale développée par la société SOFRAG depuis 1993. La SOFRAG a mis en place un cahier des charges de certification « Agneau de l’Adret » qui concerne toute la filière de production et de commercialisation de la viande d’agneau. En sélectionnant des élevages et en garantissant des caractéristiques de production et de transformation, cette société a souhaité assurer la pérennité de la production des éleveurs adhérents des groupements de producteurs dont la Coopérative Die Grillon et également proposer au consommateur une autre image de la viande d’agneau.La certification répond à un système qualité basé sur la méthode HACCP, définissant les procédures d'obtention, de maintien et de contrôle de la conformité par rapport au cahier des charges et ce, à tous les niveaux de la filière de production « Agneau de l’Adret ». Des audits régulièrement réalisés à tous les stades de la production garantissent le respect de la certification et font évoluer le système de production en fonction des données qu’ils permettent de recueillir sur le terrain.
MOTS-CLEFS : Ovin ; Viande. Qualité ; France
ENGLISH TITLE : SHEEP PRODUCTION AND QUALITY ASSURANCE : THE EXAMPLE OF « L’AGNEAU DE L’ADRET »
ABSTRACT :
In first place, the author gives an assessment of the french mutton’s network and its current state concerning all its grades.After displaying the situation of France on the international market, the author explains the economic need for french production to differenciate and the ways France chooses to reach these objectives.Secondly, the example of the sheep society’s mutation is illustrated by the certification of likeness for the product « Agneau de l’Adret », that is a regional enterprise making by the SOFRAG society since 1993.SOFRAG has instituted a notebook that gives all the directives to get the certification « Agneau de l’Adret » and that concerns all the network for mutton’s production and marketing. By choosing breedings and guaranting production’s and transformation’s features, this society wishes.to secure the continuity of the breeders’ production, only for those who are members of breeders’groups like Coopérative Die Grillon ; SOFRAG wishes to propose another mutton’s picture to the consumer too.The certification obeys a quality system based on the HACCP’s methodology, specifying the proceedings to obtain, to keep and to control the likeness towards the dircetives’ notebook for all the grades of the production « Agneau de l’Adret ».Investigations are regularly realized concerning each grade of the production ; they secure certifcation’s respect and make production’s ways evolved thanks of the datums they allow to collect.
KEY-WORDS : Sheep ; Mutton ; Quality ; France
106