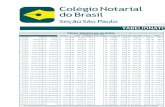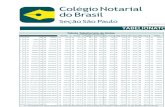Pr ef erences sociales Economie exp erimentale Les pr ef erences … · 2019. 7. 10. · Pr ef...
Transcript of Pr ef erences sociales Economie exp erimentale Les pr ef erences … · 2019. 7. 10. · Pr ef...
-
Préférences sociales
Économie expérimentaleLes préférences sociales
Delphine Boutin
Université de Bordeaux
Décembre 2018
-
Préférences sociales 2 / 57
Introduction
IntroductionI Économie comportementale: l’individu n’est pas forcément un
homo-oeconomicus maximisateur et égöısteI Biais cognitifsI Égöısme relatif: altruisme, sentiment d’équité, réciprocité,
convoitise, aversion aux inégalités ...
I Préférences sociales: aspect ”désintéressé” des êtres humainsI Une société peut également se montrer coopérative = conflit entre
l’intérêt individuel et collectifI Opposition à l’égöısme théorique de l’homo-oeconomicus
I Plusieurs jeux vont permettre alors de ”tester” les préférencessociales des individusI Jeu de l’ultimatumI Jeu du dictateurI Jeu de coopérationI Jeu de coordinationI Jeu de confiance
-
Préférences sociales 3 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
Jeu de l’ultimatum
-
Préférences sociales 4 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
Règles du jeu
2 joueurs
Jeu séquentiel (1 joueur joue, le second ensuite)
Règles du jeu:
I On donne 100$ à Simon, joueur n◦1, et rien à Nina, joueuse n◦2I Étape 1: Simon doit décider comment partager ces 100$ entre
lui et Nina
I Étape 2: Nina peut accepter ou refuser son offreI Si elle accepte, les deux joueurs se partage l’argent selon la règle
de partage conclueI Si elle refuse, les deux joueurs perdent tout
-
Préférences sociales 5 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
-
Préférences sociales 6 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
-
Préférences sociales 7 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
Résultats couramment observés
I Offre du joueur 1:I Équité:
I Jamais plus de 50% du montantI Mode et la médiane des offres est (presque) toujours entre [40%,
50%] de la somme totaleI La moyenne entre [30%, 45%]I Vraiment peu d’offres entre [0-10%]
I Pourquoi?I Position stratégique? peur du rejet? ou altruisme?
I Décision du joueur 2:I Hétérogénéité
I Taux de rejet entre 0% et 30%I Offres de plus de 40% sont rarement rejetéesI Offres de moins de 20% sont souvent rejetées
I Pourquoi?I Irrationnel? aversion contre la non-équité? réciprocité négative?
-
Préférences sociales 8 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
Dans d’autres cadres d’analyses?Pérou: offrent peu, rejettent jamaisParaguay, Indonésie: offrent plus de 50%; et des refusL’intégration du marché positivement corrélé avec des bonnes offres
-
Préférences sociales 9 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
Variantes
I Introduire de l’aléatoireI Incertitude sur la somme totale (UG)I seul l’offreur connâıt la sommeI le répondant accepte plus souvent, même des petites sommes
-
Préférences sociales 10 / 57
Jeu de l’ultimatum
Design simple
Introduire de la compétition (Prasnikar et Roth, 1995)
I Propose un jeu de l’ultimatum en introduisant un peu decompétition :
I 9 joueurs Offreur (A) et un seul joueur répondant B
I Règles:I Chaque joueur A propose simultanément une offre xI Le joueur B accepte (ou refuse) l’offre la plus élevéeI si accepté, le joueur B reçoit x, le joueur A qui a fait l’offre reçoit
10−x, les autres joueurs 0I si refusé, tous les joueurs reçoivent 0
I Solution théoriqueI le joueur B accepte n’importe quelle offre positiveI Tous les joueurs A devraient proposer 9.9 euros
I RésultatsI forte offre au début (en moyenne 8.9 euros)I forte convergence vers l’équilibre (10 euros) avec la
répétition/compétition
-
Préférences sociales 11 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Décortiquons le jeu
Arbre de décision, représentant la séquentialité des décisions:
Quelle est la solution théorique (c’est-à-dire telle que prévuedans la théorie économique)?
-
Préférences sociales 12 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Solution théorique
I HypothèsesI H1: Les deux joueurs connaissent les règles du jeuI H2: Les deux joueurs sont rationnels (i.e. forward looking) et
seulement intéressés par leurs gains monétairesI H3: Les deux joueurs savent que H2 est vraie
I Prédiction: inférence à rebours (backward induction)
I En période 2, le joueur n◦2 accepte n’importe quelle offrenon-négative
I Ainsi en période 1, le joueur n◦1 peut proposer une sommeminimale 6=0
I Solution théorique: 1 centime !!
-
Préférences sociales 12 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Solution théorique
I HypothèsesI H1: Les deux joueurs connaissent les règles du jeuI H2: Les deux joueurs sont rationnels (i.e. forward looking) et
seulement intéressés par leurs gains monétairesI H3: Les deux joueurs savent que H2 est vraie
I Prédiction: inférence à rebours (backward induction)I En période 2, le joueur n◦2 accepte n’importe quelle offre
non-négative
I Ainsi en période 1, le joueur n◦1 peut proposer une sommeminimale 6=0
I Solution théorique: 1 centime !!
-
Préférences sociales 12 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Solution théorique
I HypothèsesI H1: Les deux joueurs connaissent les règles du jeuI H2: Les deux joueurs sont rationnels (i.e. forward looking) et
seulement intéressés par leurs gains monétairesI H3: Les deux joueurs savent que H2 est vraie
I Prédiction: inférence à rebours (backward induction)I En période 2, le joueur n◦2 accepte n’importe quelle offre
non-négativeI Ainsi en période 1, le joueur n◦1 peut proposer une somme
minimale 6=0
I Solution théorique: 1 centime !!
-
Préférences sociales 12 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Solution théorique
I HypothèsesI H1: Les deux joueurs connaissent les règles du jeuI H2: Les deux joueurs sont rationnels (i.e. forward looking) et
seulement intéressés par leurs gains monétairesI H3: Les deux joueurs savent que H2 est vraie
I Prédiction: inférence à rebours (backward induction)I En période 2, le joueur n◦2 accepte n’importe quelle offre
non-négativeI Ainsi en période 1, le joueur n◦1 peut proposer une somme
minimale 6=0I Solution théorique: 1 centime !!
-
Préférences sociales 13 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Quel est l’équilibre?
I Équilibre de NashI Ensemble des choix faits par plusieurs joueurs, connaissant leurs
stratégies réciproques, qui sont devenu stables du fait qu’aucunne peut modifier seul sa stratégie sans affaiblir sa positionpersonnelle
I Si l’individu est rationnel, une offre minimale est toujourspréférable à une offre nulle Par anticipation, le joueur 1 a intérêtà lui offrir le minimum
I Équilibre parfait en sous-jeux (Subgame perfect equilibrium)I Séquentialité des décisions
I Le joueur 1 propose des montant minimumsI Le joueur 2 accepte n’importe quel montant
https://www.youtube.com/watch?v=5o6MFTJGwuchttps://www.youtube.com/watch?v=dTTFzBlpdKA
-
Préférences sociales 14 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Typologie des réactionsI Réciprocité:
I lorsque les personnes récompensent une action amicale etpunissent une action hostile, même si la récompense ou lapunition leur cause une nette réduction de leurs gains
I Aversion aux inégalitésI lorsque les personnes agissent en essayant de réduire les inégalités,
même si cela se traduit par une nette réduction de leur gains
I Altruisme réciproqueI lorsqu’un joueur agit favorablement envers un autre, en espérant
à terme une action favorable en sa faveur
I AltruismeI lorsqu’un joueur agit favorablement envers un autre, sans tenir
compte des action passées ou future d’un autre (≈ générositéinconditionnelle)
-
Préférences sociales 15 / 57
Jeu de l’ultimatum
Analyse
Apport de ce jeu à la théorie économiqueAnalyser avec précision les mécanismes théoriques de la prise dedécision
I part non négligeable, à côté de la rationalité, des phénomènesaffectifs associés aux intentions et aux anticipations des sujets
I Identifier la diversité des comportements des négociateurs et leuradaptation en fonction d’un contexte (communication, influencesociale) plus en rapport avec la réalité économique.
La théorie
I devrait expliquer pourquoi les joueurs rejettent des offrespositives
I devrait expliquer pourquoi les offres générées de manière aléatoiresont plus souvent acceptées
I devrait expliquer pourquoi un compétiteur donne tout à uneseule personne
-
Préférences sociales 16 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeu du dictateur
Présentation
I Variante du jeu de l’ultimatum
I Situation extrême dans laquelle l’un des partenaires (lebénéficiaire) dispose d’un pouvoir de négociation a priori trèsréduit tandis que l’autre (l’offreur) est en mesure d’imposer sesvues
I Les conditions de la négociation imposées au bénéficiaire sontplus sévères que dans le jeu de l’ultimatum
I Aucun pouvoir de veto: obligé d’accepter l’offre
-
Préférences sociales 17 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeu du dictateur
Comparaison avec l’UG
Avantage:
I en enlevant la possibilité au joueur 2 de refuser, on éliminel’explication ”peur du rejet”
I solution théorique: le joueur 1 (égöıste) donne 0 euro (équilibrede Nash)
I une offre positive est clairement le signe d’un sentiment d’équité
Résultats:
I Le dictateur donne 20% (mais beaucoup d’hétérogénéité)I seulement 20% des dictateurs donne 0 euros; 60% entre 0 et 50%
et 20% à 50%
I la plupart offre plus de 0 euro donc un certain sens de l’équitéI Les offres dans le DG sont inférieures à celle du UG: suggère que
les offres dans le UG étaient stratégiques
-
Préférences sociales 18 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeu du dictateur
Variantes
Plusieurs variantes qui rendent les dictateurs encore plus égöıstesdans le DG et l’UG
I Double-blind protocol (DG)I plus de 60% des dictateurs choisissent 0I pas d’effet dans l’UG (?)I donner dans le DG semblent être gouverné par des normesI mais pas rejeter
I Faire travailler l’offreur (UG DG)I test de QI, problème de mathsI la somme totale augmente avec les résultatsI combiné avec un double-blind protocol, élimine les offres positives
(Cherry et al., AER, 2002)I mais si c’est le receveur qui travaille: certains dictateurs offre plus
de 50
-
Préférences sociales 19 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeu du dictateur
Utilisation
I Jeu utilisé de nombreuses fois pour tester l’égöısme des agentsI sert souvent à profiler certains sujets pour d’autres expériences
plus complexes
I Les résultats du jeu du dictateur font l’objet de débats animés:I certains y voit une remise en cause de l’égöısme absolu (=une
preuve d’altruisme)I d’autre y voit un artefact du comportement altruisme largement
influencé par l’expérience (List, 2007)
-
Préférences sociales 20 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeux de confiance
Jeux de confianceIntuitivement la confiance facilite les relations économiques mais lathéorie ignore cet aspectI Premier jeu de confiance: Berg et al. (1995): le jeu de
l’investissement (ou trust game)I Deux joueurs, sans possibilité de communiquerI Chacun reçoit une dotation identique de 10 euros au début de
l’expérienceI Le joueur 1 doit décider du montant qu’il envoie au joueur 2
I s’il décide de ne rien donner du tout, chaque joueur repart avec lemontant initial (10 euros chacun)
I s’il décide d’envoyer quelque chose au joueur 2, le joueur 2 reçoittrois fois le montant envoyé par le joueur 1
I Le joueur 2 décide ensuite du montant qu’il redonne au joueur 1
I Vous êtes joueur 1: quels montants décidez-vous?I Vous êtes joueur 2. On suppose que le joueur 1 a envoyé 3 euros
(vous avez donc reçu 9 euros en plus de vos 10 euros, il lui reste 7euros). Quel montant décidez-vous de lui redonner?
-
Préférences sociales 21 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeux de confiance
Jeux de confiance
I Dans ce jeu, le joueur 2 est dans une position de dictateur
I mais uniquement sur la somme d’argent que veut bien lui prêterle joueur 1
I Pour le joueur 1, le problème revient à évaluer dans quelle mesureil peut faire confiance au fait que le joueur 2 lui renverra aumoins sa mise initialeI le montant envoyé est donc une mesure de confianceI le montant renvoyé par le joueur 2 est une mesure de son degré de
réciprocité (de loyauté)
-
Préférences sociales 22 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeux de confiance
Solutions et résultats
I Solution théorique:I Soit X le montant envoyé par le joueur 1 au joueur 2I Soit R le montant renvoyé par le joueur 2 au joueur 1 (sachant
qu’il a eu 3X )I Choix rationnel pour le joueur 2: tout garder R=0I Anticipant ce comportement, le joueur 1 ne devrait rien donner
X=0I Comporte également un dilemme social
I Résultats expérimentaux:I Joueur 1: en moyenne 5.16 dollarsI Joueur 2: en moyenne 4.66 dollarsI Si le jeu est répété: les montants augmentent jusqu’au dernier
tour où le joueur 2 ne renvoie quasi rien
-
Préférences sociales 23 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeux de confiance
Interprétations des résultats
I Pourquoi le joueur 1 envoie?I altruismeI anticipation d’une réaction loyale et espère ainsi gagner plus
I Pourquoi le joueur 2 renvoie?I volonté de maximiser son gain personnel = conduit à renvoyer 0I compenser l’effort ou la prise de risque de l’individu = conduit à
renvoyer le même montantI désir de réciprocité = renvoie plus que le montant XI sentiment d’équité = renvoie exactement deux tiers du montant
reçu
-
Préférences sociales 24 / 57
Jeu de l’ultimatum
Jeux de confiance
Des sanctions pour inciter?
I Possibilité au joueur 1 de sanctionner le joueur 2 si pas contentdu montantI le joueur 1 formule un souhaitI le joueur 2 est libre de respecter ou non ce souhait
I Résultats montre que les sanctions sont contreproductives:I Moins de confiance et moins de réciprocitéI Effet d’éviction: les incitations explicites évincent les incitations
personnelles et morales au cœur de toute relation de confianceI Ex du don de sang payant, des retards de crèches sanctionnésI Application sur la théorie du salaire d’efficience
-
Préférences sociales 25 / 57
Jeux de coopération
Jeux de coopération
-
Préférences sociales 26 / 57
Jeux de coopération
Jeux de coopération
Un grand nombre d’expériences ont mis en évidence descomportements coopératifs là où la théorie standard prédit descomportements égöıstes
Les expériences sur la coopération utilisent des jeux simples comme
I le dilemme du prisonnierI le jeu du bien public / jeu d’exploitation d’une ressource
commune
-
Préférences sociales 27 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Le dilemme du prisonnier
Le plus célèbre
Incarne le fait que la confrontation d’intérêt individuel ne débouchepas forcément sur l’intérêt collectif
Plusieurs types de jeux:
I Dilemme du prisonnier simultanéI Dilemme du prisonnier séquentiel
-
Préférences sociales 28 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Protocole
Protocole expérimental simplifié, joué une fois
I Deux joueursI Anonymes mais jouent en même temps (de manière simultanée)
I La matrice des gains est la suivante: les gains du joueur 1 sont engras
-
Préférences sociales 29 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
I A est une stratégie dominée (= B une stratégie dominante) pourle joueur 1 puisque quelque soit le choix du joueur 2, le joueur 1obtient un gain supérieur en jouant B.
I idem pour le joueur 2
I C’est la stratégie B qui est prédite si les joueurs sont rationnelset guidés par leur intérêts individuelsI (B, B) est le seul équilibre de NashI Situation sous-optimale
I Deux types de rationalité:I Rationalité individuelle: jouer BI Rationalité collective: jouer la stratégie coopérative A
I Résultats expérimentaux:I très nombreux (plus de 1000 expériences)I dépends des caractéristiques des sujets (âge, genre, etc..), des
paramètres et modalités du jeu (structure des gains,communication)
I Environ 60% des individus coopèrent
-
Préférences sociales 30 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Répétition infinie
I Répété un nombre fini (n) de foisI solution théorique:
I méthode de l’induction à rebours (backward induction): résoudred’abord le n-ième et dernier dilemme puis remonter le jeu
I (non-coopération, non-coopération) est le dernier dilemme joué audernier coup par les joueurs
I Équilibre non-coopératif à chaque jeu = stratégie de ”trahisonpermanente”I En contradiction avec l’intuition et les résultats expérimentauxI Tendance nette des joueurs à coopérer au début du jeu, puis à ne
plus le faire par la suiteI Effet de fin de jeu (modification des comportements à
l’approche de la fin du jeu)
-
Préférences sociales 30 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Répétition infinie
I Répété un nombre fini (n) de foisI solution théorique:I méthode de l’induction à rebours (backward induction): résoudre
d’abord le n-ième et dernier dilemme puis remonter le jeu
I (non-coopération, non-coopération) est le dernier dilemme joué audernier coup par les joueurs
I Équilibre non-coopératif à chaque jeu = stratégie de ”trahisonpermanente”I En contradiction avec l’intuition et les résultats expérimentauxI Tendance nette des joueurs à coopérer au début du jeu, puis à ne
plus le faire par la suiteI Effet de fin de jeu (modification des comportements à
l’approche de la fin du jeu)
-
Préférences sociales 30 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Répétition infinie
I Répété un nombre fini (n) de foisI solution théorique:I méthode de l’induction à rebours (backward induction): résoudre
d’abord le n-ième et dernier dilemme puis remonter le jeuI (non-coopération, non-coopération) est le dernier dilemme joué au
dernier coup par les joueurs
I Équilibre non-coopératif à chaque jeu = stratégie de ”trahisonpermanente”I En contradiction avec l’intuition et les résultats expérimentaux
I Tendance nette des joueurs à coopérer au début du jeu, puis à neplus le faire par la suite
I Effet de fin de jeu (modification des comportements àl’approche de la fin du jeu)
-
Préférences sociales 30 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Répétition infinie
I Répété un nombre fini (n) de foisI solution théorique:I méthode de l’induction à rebours (backward induction): résoudre
d’abord le n-ième et dernier dilemme puis remonter le jeuI (non-coopération, non-coopération) est le dernier dilemme joué au
dernier coup par les joueurs
I Équilibre non-coopératif à chaque jeu = stratégie de ”trahisonpermanente”I En contradiction avec l’intuition et les résultats expérimentauxI Tendance nette des joueurs à coopérer au début du jeu, puis à ne
plus le faire par la suiteI Effet de fin de jeu (modification des comportements à
l’approche de la fin du jeu)
-
Préférences sociales 31 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Répétition indéfinie
I Jeu sans fin = les joueurs ne peuvent plus appliquer la stratégiedu compte à rebours
I Solution théorique?
I Folk theorem: multiplicité des équilibres sans possibilité de lestrier
I aucune prédiction théorique ne peut être faiteI limite la portée de l’analyse théorique des jeux répétés
indéfinimentI parmi tous les équilibres possibles, l’un est de coopération
systématiqueI permet d’expliquer pourquoi certains individus opèrent une
coopération de long terme
-
Préférences sociales 31 / 57
Jeux de coopération
Dilemme du prisonnier
Répétition indéfinie
I Jeu sans fin = les joueurs ne peuvent plus appliquer la stratégiedu compte à rebours
I Solution théorique?
I Folk theorem: multiplicité des équilibres sans possibilité de lestrier
I aucune prédiction théorique ne peut être faiteI limite la portée de l’analyse théorique des jeux répétés
indéfinimentI parmi tous les équilibres possibles, l’un est de coopération
systématiqueI permet d’expliquer pourquoi certains individus opèrent une
coopération de long terme
-
Préférences sociales 32 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
I Exemple de l’introduction:I 4 joueurs ne pouvant pas communiquerI Chacun a 10 jetons et peut soit les conserver, soit contribuer à
une cagnotte communeI Gains: jetons gardés x 2 euros + nombre total de jetons dans la
cagnotte x 1 euros
I Généralisation du dilemme du prisonnierimplique un conflit entre la rationalité individuelle et collective
I Solution théorique:I personne ne contribue au bien public (seul équilibre de Nash)I passager clandestin: les individus tentent de profiter au maximum
du bien public, en évitant autant que possible de participer à sonfinancement, tout en espérant que les autres acteurs accepterontde le faire
I Solution empirique: Mise entre 40% et 60% de leur dotationinitiale
-
Préférences sociales 33 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Jeu de la ressource communeJeu symétrique à celui du bien publicI 4 joueurs ne pouvant pas communiquerI 40 jetons dans un pot communI chacun des 4 joueurs (dont ”vous”) peut retirer entre 0 et 10
jetons de ce pot communI Gain de chaque joueur: (2e × nb de jetons retirés) + (1 e × nb
total de jetons restant dans le pot commun)I Combien de jetons retirez-vous du pot commun?
Équilibre de Nash:I chaque joueur retire le maximum du pot commun (= les 10
jetons, chacun obtenant alors 20 euros)I comportement de passager clandestin aboutit à une situation
sous-optimale puisque l’optimum social est obtenu lorsque lesjoueurs ne retirent rien du pot commun (ils gagnent alors 40euros)
-
Préférences sociales 33 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Jeu de la ressource communeJeu symétrique à celui du bien publicI 4 joueurs ne pouvant pas communiquerI 40 jetons dans un pot communI chacun des 4 joueurs (dont ”vous”) peut retirer entre 0 et 10
jetons de ce pot communI Gain de chaque joueur: (2e × nb de jetons retirés) + (1 e × nb
total de jetons restant dans le pot commun)I Combien de jetons retirez-vous du pot commun?
Équilibre de Nash:I chaque joueur retire le maximum du pot commun (= les 10
jetons, chacun obtenant alors 20 euros)I comportement de passager clandestin aboutit à une situation
sous-optimale puisque l’optimum social est obtenu lorsque lesjoueurs ne retirent rien du pot commun (ils gagnent alors 40euros)
-
Préférences sociales 34 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Jeu de la ressource communePourquoi cette variante?
I faire explicitement apparâıtre la tendance des individus à lasur-exploitation à des fins personnelles des ressources communesau détriment de la collectivité (”la tragédie des ressourcescommunes”)
I Pollution, taxe carbone
Résultats:
I face à la version ultra-simplifiée présentée, les joueurs retirentque 50% des jetons
I stratégie de coopérationI les deux jeux sont similaires mais les individus peuvent les
percevoir différemmentI Jeu du bien public: externalités positives = les joueurs retirent
plusI Jeu de la ressource commune: externalités négatives
-
Préférences sociales 34 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Jeu de la ressource communePourquoi cette variante?
I faire explicitement apparâıtre la tendance des individus à lasur-exploitation à des fins personnelles des ressources communesau détriment de la collectivité (”la tragédie des ressourcescommunes”)
I Pollution, taxe carbone
Résultats:
I face à la version ultra-simplifiée présentée, les joueurs retirentque 50% des jetons
I stratégie de coopérationI les deux jeux sont similaires mais les individus peuvent les
percevoir différemmentI Jeu du bien public: externalités positives = les joueurs retirent
plusI Jeu de la ressource commune: externalités négatives
-
Préférences sociales 35 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Avec répétition
Apprentissage des sujets de la stratégie de passagerclandestin?
I Expériences en changeant systématiquement les équipesI Avec la même team: la coopération décline au fil des répétitionsI Avec une nouvelle team: les niveaux initiaux de contribution sont
restaurés à chaque début de séquences
I On parle de coopération conditionnelleI ajustement du niveau de contribution à la moyenne observée des
autres membres du groupeI 30% des individus sont des égöıstes absolusI puisque dans la population, certains ne coopèrent jamais, les
individus sont toujours déçus du niveau de contribution moyen dela cagnotte commune, et répondent en baissant leurs contributionle tour suivant
-
Préférences sociales 36 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Typologie des sujetsI Les contributeurs conditionnels:
I contribuent le même montant que le montant moyen des autresmembres du groupe
I principal motif est la réciprocitéI ”... we might all of us be willing to contribute to the relief of
poverty, provided everyone else did. We might not be willing tocontribute the same amount without such assurance.” MiltonFriedman, Capitalism and Freedom, 1962, p.191)
I Les free-ridersI contribuent toujours 0 quelque soit la contribution moyenne des
autres membres du groupe
I Les contributeurs triangulairesI leur contribution augmente avec la contribution moyenne
lorsqu’elle est faible, et diminue lorsqu’elle est élevé
I Les contributeurs inconditionnels ”warm glow”
-
Préférences sociales 37 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Jeu avec sanction
I L’un des objectifs des jeux de coopération est d’étudier lesmécanismes incitatifs permettant la coopération
I Exemple du jeu avec sanctions:I possibilité pour chaque membre du groupe d’infliger une sanction
aux autres membres du groupeI les contributions individuelles sont rendues publiquesI chaque joueur peut décider de pénaliser un ou plusieurs joueurs
I chaque point de sanction infligé réduit les gains du joueursanctionné de 10% de ses gains
I chaque point de sanction infligé réduit également les gains dujoueur qui inflige la sanction, de manière marginalement croissante
I le jeu peut être répété avec des groupes différents à chaque foisI pour éviter la stratégie conduisant à considérer la punition comme
un investissement destiné à accrôıtre la coopération des joueurspunis dans les périodes futurs
-
Préférences sociales 38 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
Jeu avec sanctionI Théoriquement, aucun joueur ne devrait sanctionner un passager
clandestinI la sanction est coûteuse pour celui qui l’infligeI elle ne rapporte aucune satisfaction matérielle en contrepartie
I Dépend de la crédibilité de la sanctionI si mécanisme de sanction étant peu crédible, la stratégie
d’équilibre reste la même que dans le jeu standard du bien public,à savoir aucune contribution
-
Préférences sociales 39 / 57
Jeux de coopération
Jeu du bien public
I En condition ”étranger”, la probabilité pour un joueur de seretrouver avec le même joueur au cours du jeu est quasi nulle
I La comparaison des sessions étranger et partenaire permetd’identifier l’importance de la durée des interactions dansl’augmentation des contributions avec sanctions monétairesI Les sujets sanctionnent les autres membres de leur groupe même
si cela est coûteux pour euxI La possibilité de sanctionner les autres sujets accrôıt la
coopération au sein des groupes
-
Préférences sociales 40 / 57
Jeux de coordination
Jeux de coordination
-
Préférences sociales 41 / 57
Jeux de coordination
Multitude d’équilibre de Nash
Multitude d’équilibre de Nash
I Problèmes de coordination: lorsque les parties pourraient réaliserdes gains mutuels, mais seulement en prenant des décisionsefficientes
I Souvent l’interaction entre les agents économiques peut donnerlieu à plusieurs équilibresI Exemple: le travail d’équipeI un bon: tous fournissent un effort important conduisant à une
forte productivitéI un mauvais: tous fournissent un effort minimum
I Lorsque plusieurs équilibres existent, le problème des agents estd’en choisir un = de se coordonner dans leurs choix stratégiques
-
Préférences sociales 42 / 57
Jeux de coordination
Multitude d’équilibre de Nash
I Pas de moyens théoriques de choisir entre plusieurs équilibres:I l’expérimentation permet alors d’éclairer le théoricien en
identifiant certaines issues plus probables que d’autres ou enmettant en évidence certaines régularités
I ou d’identifier les mécanismes conduisant à cette coordination
-
Préférences sociales 43 / 57
Jeux de coordination
Jeu du matching
Jeu du matching
I Deux équilibres de NashI Chaque joueur est indifférent entre ces deux équilibres mais
nécessité de se coordonner (10 s’ils choisissent la même action, 0si leurs actions diffèrent)
-
Préférences sociales 44 / 57
Jeux de coordination
Jeu de la chasse et du cerf
Jeu de la chasse et du cerf
I Supposons que deux chasseurs poursuivent un cerf qui ne peutêtre capturé que si les deux chasseurs s’entre-aidentI Le cerf a une grande valeur et les deux joueurs peuvent en
bénéficier que s’ils se coordonnentI Ils peuvent également chasser un lièvre de manière individuelle
-
Préférences sociales 45 / 57
Jeux de coordination
Jeu de la chasse et du cerf
I Deux équilibre de Nash:I un équilibre dominant en termes de paiementI un équilibre dominant en termes de risque
I La défaillance de coordination surgit lorsque l’un des chasseurschasse le cerf (action risquée) tandis que l’autre chasse le lièvre.
I Les problèmes de coordination sont nombreux dans la vie de tousles jours:I Comment se donner RDV lorsqu’il n’y a pas de réseau? [focal
point: Art of Strategy]I Comment les firmes coordonnent leurs investissements sans qu’il
soit nécessaire pour elles de parler de leurs options?
-
Préférences sociales 46 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
Tester si la communication améliore la coordination des membres d’une coopérative
agricole au Sénégal
Contexte:
I But de ces coopératives:I vendre collectivement la production des petits agriculteursI accéder ainsi à des marchés plus profitablesI dépasser certains coûts fixes: transport, stockage
I Chaque agriculteur fait face à une incertitude stratégiqueI Les gains qu’un individu retire de la vente à travers le groupe
sont incertains car dépendent des actions des autres agents, etnotamment du nombre d’entre-eux qui veulent participer
I la vente au trader assure en revanche un gain certain
I Problème de coordination observé: la moitié des coopérativessont incapables de commercialiser collectivement malgré leurintention de la faire
-
Préférences sociales 47 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
-
Préférences sociales 48 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
Aflagah, Bernard, Viceisza (2015), Communication and coordination: Experimental evidence
from farmer groups in Senegal
I Deux groupes:I Contrôle: Un jeu de chasse cerf-lièvre sans communicationI Traitement: Un jeu de chasse cerf-lièvre avec communication (i.e.:
discussion auparavant où chaque joueur révèle sa stratégie avantde jouer).
I les joueurs savent ce que certains joueurs pensent choisir commestratégie alternatives: la taille des groupes varient – 10 ou 20joueurs
I Pour assurer la causalité:I chaque joueur est désigné aléatoirement à un groupeI Pour assurer la ressemblance avec la réalité: chaque groupe est
composé de joueurs appartenant à la même coopérative agricole
-
Préférences sociales 49 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
Implémentation sur le terrain
Matériels
I papier, crayon
I salle de classe vacante dans le village
Protocole d’une session (2h30 à 3h):
I pré-questionnaire collectant les informations basiquesI Introduction présentant (1) l’IFPRI, (2) le but de la session, (3)
le fait que les participants seront payés selon les décisions prises
I Instructions détaillées
I 4 tours de décision-making avec aucun feedback
I débriefingI Un post-questionnaire collectant d’autres infosI Paiement (20$ en moyenne = 2 jours de travail)
-
Préférences sociales 50 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
Mise en place du jeu de coordination
I Chaque joueur a en sa possession 6 jetons.I Chaque jeton équivaut à 2000 FCFA
I Problème 1: windfall/house money effectsI windfall money: argent gagné de manière soudaine, sans effortI house money effect: les gens sont plus enclins à prendre des
risques lorsqu’ils viennent d’effectuer un investissement fructueuxI Sol: Les 12000 FCFA sont présentés comme un paiement pour la
pré-enquête effectuée, qu’ils peuvent perdre en fonction de laréalisation des actions communes. Autre moyen: les fairetravailler!
-
Préférences sociales 51 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
I La règle de partage:I Dépend si le groupe atteint un certain montant: si A¿T, chaque
jeton vaut 3000 FCFA; sinon 500 FCFA. Chaque joueur doitdécider combien de jetons il doit envoyer au groupe Ai et combienil garde pour lui (soit 6-Ai)
I Plusieurs variations:I taille des groupes: N=10 ou 20. Variations entre les sessionsI sur le seuil T: 40 ou 50 si un groupe de 10 personnes; 40, 50, 80
ou 100 si un groupe de 20 personnes.I Variation entre les rounds.I Prime de 3000 ou de 2500 FCFA par jeton. Variation entre les
rounds.I Addition d’une source d’incertitude extérieure: un chance sur
deux d’avoir 1500 FCFA (bad luck) ou bien 3000/2500 FCFA.Variation entre les rounds (lance une pièce de monnaie).
-
Préférences sociales 52 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
-
Préférences sociales 53 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
-
Préférences sociales 54 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
-
Préférences sociales 55 / 57
Jeux de coordination
Exemple d’application
-
Préférences sociales 1 / 1
ANNEXES
-
Préférences sociales 2 / 1
Expériences à réaliser
I Tester la discrimination ethnique
I Tester l’attitude envers les migrants
-
Préférences sociales 3 / 1
Exemple
Tester la discrimination ethniqueI Discrimination reflète un biais de groupe (chacun privilégiant son
groupe ethnique) ou une discrimination systématique?I Discrimination statistique ou basée sur les goûts (statistical or
taste-based)?
I Fershtman et Gneezy (2001): Test pour voir si des étudiantsd’Israël sont traités différemment selon leurs caractéristiquesd’origine
I ContexteI immigrés des pays européens (juifs Ashkenazic) et ceux immigrés
des pays arabes (juifs Sephardic, plus pauvres)I le nom de famille indique l’origine de la personne: fort signalI le prénom indique le genre
I Jeux:I Jeu de l’ultimatum et du dictateur (+ jeu de confiance)
-
Préférences sociales 3 / 1
Exemple
Tester la discrimination ethniqueI Discrimination reflète un biais de groupe (chacun privilégiant son
groupe ethnique) ou une discrimination systématique?I Discrimination statistique ou basée sur les goûts (statistical or
taste-based)?
I Fershtman et Gneezy (2001): Test pour voir si des étudiantsd’Israël sont traités différemment selon leurs caractéristiquesd’origine
I ContexteI immigrés des pays européens (juifs Ashkenazic) et ceux immigrés
des pays arabes (juifs Sephardic, plus pauvres)I le nom de famille indique l’origine de la personne: fort signalI le prénom indique le genre
I Jeux:I Jeu de l’ultimatum et du dictateur (+ jeu de confiance)
-
Préférences sociales 4 / 1
Exemple
I Première étape: sélection d’étudiants à l’University of Haifaet the Tel Aviv Academic College, possédant des noms de familleethniquement très marquésI 77 noms de familles qui peuvent être classifié dans 4 groupes (2
ethnies + genre)I 616 étudiants israéliens
I Deuxième étape: DG (Le joueur 2 étant passif, il est faciled’identifier une discrimination) puis UG avec les noms des duosoffreurs/ répondants dévoilésI s’il y a une discrimination statistique (”Sephardic hommes ont
plus de propension à rejeter des propositions non équitable”),alors DG¡UG pour ces hommes
I s’il y a une dicrimination taste-based, alors: DG=UG
I Les hommes (quelque soit leur groupe ethnique) discriminentenvers les hommes Ashkenazic
IntroductionJeu de l'ultimatumburntorangeDesign simpleburntorangeAnalyseburntorangeJeu du dictateurburntorangeJeux de confianceburntorangeExemple
Jeux de coopérationburntorangeDilemme du prisonnierburntorangeJeu du bien public
Jeux de coordinationburntorangeMultitude d'équilibre de NashburntorangeJeu du matchingburntorangeJeu de la chasse et du cerfburntorangeExemple d'application
AppendixAppendix