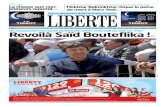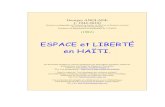Perspectives d'investissement international 2007 : Liberte d'investissement dans un monde en...
-
Upload
oecd-organisation-for-economic-co-operation-and-development -
Category
Documents
-
view
219 -
download
2
Transcript of Perspectives d'investissement international 2007 : Liberte d'investissement dans un monde en...
www.oecd.org/editions-:HSTCQE=UX\Z^Z:
Le texte complet de cet ouvrage est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.sourceocde.org/finance/9789264037595
Les utilisateurs ayant accès à tous les ouvrages en ligne de l’OCDE peuvent également y accéder via : www.sourceocde.org/9789264037595
SourceOCDE est une bibliothèque en ligne qui a reçu plusieurs récompenses. Elle contient les livres, périodiques et bases de données statistiques de l’OCDE. Pour plus d’informations sur ce service ou pour obtenir un accès temporaire gratuit, veuillez contacter votre bibliothécaire ou [email protected].
ISBN 978-92-64-03759-5 20 2007 05 2 P
Perspectives d’investissement international 2007LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT DANS UN MONDE EN CHANGEMENTLes conditions d’investissement direct étranger (IDE) au niveau mondial se sont améliorées en 2006, les flux d’investissement à destination des pays de l’OCDE ayant atteint 910 milliards USD, chiffre sans précédent depuis le montant record de l’année 2000. Les fusions et acquisitions transfrontalières, élément central de l’IDE, ont continué de progresser en 2007 et leur montant pourrait être finalement le plus élevé jamais enregistré. Ces évolutions ont suscité des inquiétudes dans certains milieux. Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’opinion publique se focalise depuis quelque temps sur le risque de perte d’emplois dû à la délocalisation de certains maillons de la chaîne de valeur d’entreprises nationales. En outre, les décideurs sont préoccupés aujourd’hui par le fait que des secteurs « stratégiques », englobant notamment des entreprises qui ont accès à des technologies ou ressources naturelles sensibles, passent aux mains d’investisseurs étrangers. Pourtant, l’internationalisation de l’activité économique, par l’intermédiaire de l’investissement et des échanges a été l’un des principaux facteurs qui ont contribué à la création de valeur dans l’économie mondiale au cours de la décennie écoulée. Preuve en est la croissance rapide et l’intégration plus complète des structures économiques internationales de plusieurs économies émergentes, qui sont devenues d’importantes sources d’investissement direct à l’étranger.
La présente édition des Perspectives d’investissement international se divise en deux grandes parties analytiques. La première traite de la recrudescence évidente, ces dernières années, des pratiques discriminatoires à l’égard des investissements transfrontaliers, phénomène qui s’explique par les craintes liées à la sécurité nationale et les préoccupations fondamentales connexes. Quatre chapitres résument les travaux menés par l’OCDE en prévision du Sommet du G8 de juin 2007, où cette question figurait parmi celles à examiner en priorité. Ces chapitres passent en revue les coûts associés à l’existence de restrictions excessives, examinent jusqu’à quel point les autorités peuvent définir elles-mêmes la notion de « sécurité », et proposent une méthodologie pour l’établissement de tableaux de bord concernant les restrictions réglementaires à l’investissement. La seconde partie porte essentiellement sur les nouveaux débouchés offerts par l’IDE et la nature évolutive du contexte économique international, dans lequel les investissements sont réalisés. Un des chapitres de cette partie est consacré aux liens entre l’IDE et les actifs intellectuels ; il s’attache en particulier à déterminer si les investissements internationaux peuvent favoriser (ou freiner) le développement des connaissances dans les pays hôtes. Un autre chapitre se penche sur l’importance des petites et moyennes entreprises pour l’IDE, compte tenu notamment de leurs liens avec les grandes entreprises.
Persp
ectives d’investissem
ent international 2007 LIB
ER
TÉ
D’IN
VE
ST
ISS
EM
EN
T D
AN
S U
N M
ON
DE
EN
CH
AN
GE
ME
NT
Perspectives d’investissement international 2007LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT DANS UN MONDE EN CHANGEMENT
Perspectives d’investissement
international 2007LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT DANS UN MONDE
EN CHANGEMENT
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de30 démocraties œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux etenvironnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l'avant-gardedes efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et lespréoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à dessituations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise,l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population.L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leursexpériences en matière de politiques, de chercher des réponses à des problèmescommuns, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination despolitiques nationales et internationales.
Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique,le Canada, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, laGrèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, laNorvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Républiqueslovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. LaCommission des Communautés européennes participe aux travaux de l’OCDE.
Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l'Organisation. Cesderniers comprennent les résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travauxde recherche menés sur des questions économiques, sociales et environnementales,ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles développés par lespays membres.
Publié en anglais sous le titre :
International Investment Perspectives 2007FREEDOM OF INVESTMENT IN A CHANGING WORLD
Les corrigenda des publications de l’OCDE sont disponibles sur : www.oecd.org/editions/corrigenda.
© OCDE 2007
Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvezinclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents,présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et ducopyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à [email protected]. Lesdemandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent êtreobtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) [email protected] ou du Centre français d'exploitation du droitde copie (CFC) [email protected].
Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général
de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent
pas nécessairement les vues de l’OCDE ou des gouvernements de ses
pays membres.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 3
AVANT PROPOS
Perspectives de l’investissement international est une publication annuelle. Chaque numéro fait le point sur l’évolution récente et les perspectives de l’investissement direct international et analyse les questions d’actualité concernant l’investissement. Cette publication a pour objet d’informer régulièrement les intervenants dans les politiques qui ont trait à l’investissement international, les milieux universitaires et tous ceux qui s’intéressent à l’investissement international.
Les articles se fondent essentiellement sur des contributions du Secrétariat de l’OCDE, préparées dans le cadre des programmes d’activité du Comité de l’investissement de l’OCDE et examinées par le Comité ou son Groupe de travail.
Perspectives de l’investissement international est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres. Pour toute question concernant le contenu de cette publication, on pourra s’adresser à la Division de l’investissement, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE (Pamela Duffin, Chargée de communication ; mél : [email protected]).
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 5
Table des matières
Chapitre 1. Investissement international – œuvrer ensemble à la prospérité de tous ................................................................ 11
Chapitre 2. Tendances et évolution récente de l’investissement direct étranger ................................................................................ 17
Annexe 2.A1. Statistiques d'investissement direct étranger .............. 51
Partie I Preserver la liberté d’investissement
Chapitre 3. Liberté d’investissement, sécurité nationale et secteurs « stratégiques » : rapport d’étape ...................................... 63
Annexe 3.A1.1. Panorama des pratiques discriminatoires mises en œuvre à l’encontre des investisseurs étrangers au nom de la sécurité nationale ................................ 69
Chapitre 4. Impact économique et autres effets des opérations transfrontières de fusion et acquisition dans les pays de l’OCDE ..................................................... 75
Chapitre 5. Intérêts essentiels de sécurité aux termes du droit international de l’investissement ...................................... 109
Annexe 5.A1.1. L’ordre public et les intérêts essentiels de la sécurité dans le cadre de l’instrument relatif au traitement national ............................................ 131
Annexe 5.A2. 2. Tableau récapitulatif des TBI et ALE (chapitres sur l’investissement) contenant des dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité ........... 133
Chapitre 6. Indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE dans les pays de l’OCDE : réexamen et extension à d’autres économies et secteurs ................. 163
6 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Annexe 6.A1. Méthodologie utilisée par l’OCDE pour calculer la restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE .................................................. 175
Annexe 6.A2. Restrictivité en matière d’IDE dans le secteur des pêcheries des pays de l’ OCDE ........................ 180
Partie II Le nouveau cadre de l’investissement direct international
Chapitre 7. Actifs intellectuels et investissement international : synthèse des observations .................................................... 185
Chapitre 8. Investissement international et PME : bilan des travaux .................................................................. 231
Annexe 8.A1. Liste des codes mnémoniques des variables pour l’analyse des corrélations ................................. 282
Encadrés
2.1. Statistiques de l’investissement direct étranger : principaux concepts ...................................................................... 24
2.2. Nouvelle publication de l’OCDE : les délocalisations et l’emploi : tendances et impacts ................................................. 47
4.1. Étude de cas : Renault (France) – Nissan (Japon) ......................... 954.2. Étude de cas : Vodafone (Royaume-Uni) – Mannesmann
(Allemagne) .................................................................................. 978.1. L’étude réalisée par l’OCDE en 1997 sur les PME
et la mondialisation ..................................................................... 2408.2. L’IDE effectué par les PME : les Pays-Bas ................................ 260
Tableaux
2.1. Flux d’investissement direct à destination et en provenance des pays de l’OCDE : 2001-2006 ............................................ 21
2.2. Flux cumulés d’IDE des pays de l’OCDE sur la période 1997-2006 ......................................................... 29
2.3. Nombre total d’opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées dans et par les pays de l’OCDE .......... 31
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 7
2.4. Dix premiers pays ciblés par les opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées par des entreprises non résidentes de l’OCDE (de 1990 à mai 2007) .................... 39
2.A1.1 Investissement direct à l'étranger des pays de l'OCDE : sorties .................................................................. 52
2.A1.2 Investissement direct de l'étranger dans les pays de l'OCDE : entrées .................................................................. 54
2.A1.3 Investissement direct à l'étranger des pays de l'OCDE : encours des sorties ............................................... 56
2.A1.4 Investissement direct de l’étranger dans les pays de l'OCDE : encours des entrées .............................................. 58
3.A1.1. Mesures générales ou transsectorielles en lien avec l’ordre public et les intérêts essentiels ............................. 71
3.A1.2. Mesures sectorielles motivées par des raisons d’ordre public et d’intérêts essentiels de sécurité .................... 72
4.1. Études empiriques montrant que les entreprises sous contrôle étranger réalisent de meilleurs résultats ............. 90
4.2. Études sur l’impact de l’investissement étranger sur la R&D nationale ............................................................. 100
6.1. Indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE, par pays et par secteur (1 = fermé, 0 = ouvert) ........ 170
6.A1.1. Coefficients concernant les restrictions à l’IDE (maximum : 1.0) .................................................................... 178
6.A1.2. Coefficients par secteur .......................................................... 1796.A2.1. Coefficients de pondération de la restrictivité
en matière d’IDE dans le secteur de la pêche ........................ 1807.1. Dépenses de R-D à l’étranger des entreprises américaines .... 1957.2. Dépenses de R-D à l’étranger des multinationales japonaises
par secteur et par région, 2004 ............................................... 1967.3. Détention d’inventions nationales par
des intérêts étrangers .............................................................. 1997.4. Implantation des activités de R-D d’après les indications
fournies par les données sur les brevets : 60 entreprises multinationales ayant leur siège aux États-Unis .................... 200
7.5. Implantation des activités de R-D d’après les indications fournies par les données sur les brevets : 63 entreprises multinationales ayant leur siège dans les pays de l’UE ......... 200
7.6. Implantation des activités de R-D d’après les indications fournies par les données sur les brevets : 61 entreprises multinationales ayant leur siège au Japon .............................. 201
7.7. Évolution des brevets détenus conjointement avec des co-inventeurs étrangers .................................................... 205
8.1. Modes d’internationalisation des PME .................................. 237
8 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
8.2. Vue d’ensemble des études portant sur les facteurs d’internationalisation des PME .............................................. 241
8.3. Vue d’ensemble des études concernant les facteurs d’internationalisation précoce des PME ................................ 249
8.4. IDE des PME, par secteur de l’industrie ................................ 2588.5. IDE des PME européennes, selon la taille de l’entreprise ..... 2588.6. IDE des PME japonaises, selon la taille de l’entreprise ........ 2588.7. IDE des PME, selon l’âge de l’entreprise .............................. 2598.8. Destination de l’IDE des PME de 18 pays de l’UE ............... 2618.9. Raisons qui motivent l’internationalisation des PME
par le biais de l’IDE ............................................................... 2638.10. Pour la majorité des PME, l’IDE a un impact positif
sur le chiffre d’affaires ........................................................... 2638.11. Obstacles auxquels se heurtent les PME
qui souhaitent recourir à l’IDE .............................................. 2648.12. L’IDE et les échanges des PME sont corrélés
mais non de manière significative. ......................................... 2658.13. La diffusion de technologie et l’IDE des PME
sont positivement associés ..................................................... 2678.14. Corrélation entre l’internationalisation des PME
et l’ouverture des marchés ..................................................... 271
Graphiques
2.1. Flux d’IDE à destination et en provenance de la zone OCDE ..................................................................... 23
2.2. Opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées par des entreprises non résidentes de la zone OCDE ............... 36
2.3. Opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées par des entreprises non résidentes de l’OCDE, par secteur cible (1990-mai 2007) ........................................... 43
2.4. Indice d’externalisation à l’étranger de quelques pays de l’OCDE, 2000 ..................................................................... 48
2.5. Indice d’externalisation à l’étranger des biens, 1995 et 2000 ............................................................................. 48
4.1. Opérations transfrontières de fusion et acquisition (milliards USD) ........................................................................ 77
6.1. Indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE dans neuf secteurs, par type de restriction ................ 168
6.2. Restrictivité de la réglementation par secteur, moyenne OCDE et hors OCDE ............................................. 169
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 9
6.A2.1. Restrictions à l’IDE dans le sous-secteur de la capture de la zone OCDE, par type .................................................... 181
6.A2.2. Restrictions à l’IDE dans le sous-secteur de la transformation de la zone OCDE (0= degré le moins restrictif ; 1= degré le plus restrictif) ...... 182
7.1. Dépenses de R-D à l’étranger de certains pays de l’OCDE, 1995 et 2003 (Pourcentage de la R-D nationale de certains pays) ..................................................................... 192
7.2. Part de la R-D sous contrôle étranger dans la R-D totale par pays, 1995 et 2003 ........................................................... 193
7.3. Implantation de nouvelles installations de R-D ..................... 1947.4. Fusions et acquisitions transnationales interrégionales
dans les secteurs de haute et moyenne technologie ............... 2037.5. Facteurs d’implantation des installations de R-D .................. 2098.1. Les liens entre EMN et PME favorisent
l’internationalisation des PME ............................................... 2368.2. Les investissements internationaux des PME
européennes sont très variables .............................................. 2538.3. De nombreuses PME sont associées avec une PME
étrangère dans le cadre d’une coopération ............................. 2558.4. L’IDE est le mode d’internationalisation des PME
le moins important ................................................................. 2568.5. Part des PME recourant à l’IDE comparativement
à la position des sorties d’IDE ............................................... 2668.6. Part des PME recourant à l’IDE au regard des licences
technologiques à l’étranger .................................................... 2688.7. Part des PME recourant à l’IDE au regard de l’utilisation
d’Internet ................................................................................ 2698.8. Part des PME recourant à l’IDE au regard de l’indice
de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE établi par l’OCDE ..................................................... 270
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 11
Chapitre 1.
INVESTISSEMENT INTERNATIONAL – ŒUVRER ENSEMBLE À LA PROSPÉRITÉ DE TOUS
Par Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE
L’investissement international et les politiques qui le sous-tendent sont à la croisée des chemins. Les responsables de l’action publique ont, à mes yeux, au moins trois grands défis à relever.
Premièrement, dans certains pays de l’OCDE, l’investissement international, en particulier l’acquisition d’entreprises nationales par des intérêts étrangers est un sujet de préoccupation de plus en plus important. Les responsables de l’action publique doivent trouver le moyen de répondre à ces préoccupations publiques sans céder aux tentations protectionnistes et sans remettre en cause les fruits de décennies d’efforts déployés pour créer un contexte ouvert et fondé sur des règles pour l’investissement international.
Deuxièmement, l’augmentation des investissements transfrontières s’inscrit dans le cadre plus large de la spécialisation internationale et de l’arrivée de nouveaux acteurs majeurs sur la scène économique mondiale, à l’origine, à tout le moins en partie, d’une période prolongée de croissance exceptionnelle et d’amélioration de la prospérité. Toutefois, pour que la population continue à être favorable aux marchés ouverts qui, en favorisant la transparence, l’instauration d’un environnement équitable et une coopération internationale efficace, ont permis d’obtenir ces bons résultats, une coopération entre les responsables de l’action publique des pays de l’OCDE et ceux des économies émergentes est nécessaire.
Troisièmement, mettre l’investissement international au service de la lutte contre la pauvreté doit rester un objectif prioritaire. En effet, si de plus en plus de pays en développement et d’économies émergentes ont tiré parti de l’intégration internationale, les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, sont nombreux à être restés à l’écart.
12 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Préserver et renforcer les acquis
Ces dernières décennies, les flux d’investissements internationaux à destination et en provenance des pays de l’OCDE ont connu une croissance spectaculaire, favorisée par de nombreux engagements de libéralisation. Ces 20 dernières années, les investissements directs étrangers (IDE) des pays de l’OCDE ont été multiplié par 12, alors que les exportations n’ont que quadruplé. La création du marché européen unique, la conclusion de nouveaux accords régionaux comme l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de très nombreux traités bilatéraux en matière d’investissement auxquels sont parties la majorité des pays du monde sont la manifestation tangible de ces engagements.
Parallèlement, les autorités nationales doivent répondre à un nombre croissant de préoccupations publiques : crainte d’une perte de contrôle sur les secteurs dits « stratégiques », inquiétudes relatives à l’accès aux matières premières et aux conséquences plus générales de la concurrence transfrontière dans une économie qui se mondialise. Récemment, plusieurs pays ont durci leur réglementation et, dans certains cas, les pouvoirs publics sont intervenus pour faire obstacle à des investissements étrangers. Il faut empêcher que cette nouvelle remise en cause de la liberté de l’investissement ne vienne ébranler la confiance des acteurs économiques et la détermination des pouvoirs publics à piloter l’économie mondiale dans l’intérêt de tous.
Il n’est pas trop tard pour réagir. Il faut, en premier lieu, démontrer à la population qu’un environnement ouvert à l’investissement international a des effets positifs : augmentation des possibilités d’emploi, hausse des revenus et de l’innovation dans tous les pays, instauration d’un environnement international plus stable et plus sûr. En second lieu, il faut créer et entretenir un climat de confiance et favoriser la coopération entre les États à travers un échange pragmatique sur les enjeux de politique publique et les valeurs et principes communs.
L’OCDE est à l’avant-garde des efforts déployés dans ce sens. Depuis sa création, il y a plus de 40 ans, l’Organisation a pour mission de promouvoir la croissance et le développement à travers un environnement transparent et ouvert aux investissements et aux échanges. Les pays membres ont réalisé d’importantes avancées en termes d’élimination des barrières à l’investissement et d’amélioration du traitement des investisseurs étrangers, grâce au dialogue sur les politiques publiques, aux revues par les pairs et à des instruments officiels de l’OCDE comme le Code de la libération des mouvements de capitaux et la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 13
multinationales. Par ailleurs, des pays membres de l’OCDE et d’autres acteurs de premier plan ont, dans le cadre d’un projet plus récent intitulé Liberté d’investissement, sécurité nationale et secteurs « stratégiques », entrepris un travail pour garantir la préservation des acquis dans un environnement international en constante évolution.
L’arrivée de nouveaux acteurs sur la scène économique mondiale
La décennie écoulée a été marquée par le rôle actif joué par une nouvelle catégorie d’investisseurs à l’étranger originaires de pays en développement et d’économies émergentes. Il y a tout lieu de se féliciter de cette évolution, qui atteste de la réussite économique d’un certain nombre de pays et a eu des retombées positives tangibles sur l’ensemble de l’économie mondiale. Toutefois, elle suscite également des inquiétudes en termes d’équité des règles du jeu à l’échelle planétaire, du fait que ces nouveaux investisseurs sont établis dans des juridictions où le cadre réglementaire manque de transparence et où les normes relatives au comportement des entreprises sont peu rigoureuses. Des problèmes récurrents se posent notamment concernant la qualité de la gouvernance d’entreprise, les normes destinées à favoriser un comportement responsable de la part des entreprises, en particulier en matière de conditions de travail, de droits de l’homme, d’environnement et de lutte contre la corruption, la protection des droits de propriété intellectuelle et la question plus générale de la réciprocité d’accès aux marchés.
La stratégie de l’OCDE consiste à engager, avec les économies non membres, un dialogue global portant à la fois sur la liberté de l’investissement et la nécessité de veiller à ce que l’environnement international soit concurrentiel et ouvert à tous les pays. L’OCDE a engagé des travaux avec les autorités du Brésil, de la Chine, de l’Inde, de la Fédération de Russie, de l’Afrique du Sud et d’autres pays pour promouvoir l’adoption de son approche consensuelle de la coopération internationale, notamment à travers l’adhésion aux instruments sur l’investissement et l’élargissement de l’Organisation.
Mettre l’investissement au service du développement
Si de plus en plus de pays en développement et d’économies émergentes ont tiré parti de l’intégration internationale, les pays les plus pauvres sont nombreux à être restés à l’écart. Le continent africain en est l’illustration. Actuellement, l’investissement privé est concentré dans un nombre limité de secteurs, qui garantissent des retours sur investissement élevés, et la majeure partie de la population africaine ne profite pas de ses retombées positives plus larges. La définition de cadres d’action pour l’investissement plus solides en Afrique se traduira par une baisse des primes de risque, incitera à investir plus
14 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
et dans une plus grande diversité de secteurs et permettra de diffuser plus largement les retombées positives de l’investissement.
Le Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE propose une approche pratique pour aider les pouvoirs publics à trouver les meilleurs moyens d’atteindre cet objectif, en se fondant sur l’expérience des pays membres de l’OCDE et de nombreux pays en développement partenaires. Pour favoriser l’application du Cadre dans le monde entier, l’OCDE coopère avec des organisations intergouvernementales comme le Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD) ou la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), et met en œuvre des actions régionales de renforcement des capacités d’investissement par exemple dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) ou en Europe du Sud-Est (ESE). La communauté du développement de l’OCDE a également, en partenariat avec les responsables de l’action publique chargés de la politique de l’investissement, défini, à l’intention des donneurs, des orientations sur les moyens d’utiliser l’aide publique au développement (APD) pour mobiliser l’investissement privé au service du développement.
Parallèlement, l’OCDE a répondu au récent appel lancé par les Nations Unies en faveur d’un investissement responsable dans les pays africains riches en ressources naturelles. L’Outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans des zones à déficit de gouvernance guide les entreprises qui opèrent dans des pays dont les dirigeants refusent ou ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités, notamment sur le plan réglementaire.
Les dirigeants des pays développés doivent tirer le meilleur parti de l’APD qu’ils versent, notamment en l’utilisant pour mobiliser l’investissement privé au service du développement. La nécessité d’attirer l’investissement privé dans le secteur de l’infrastructure est une illustration particulièrement édifiante de cet enjeu. Ainsi, pour atteindre les Objectifs du Millénaire du développement concernant l’approvisionnement en eau et l’assainissement, il faudrait doubler les investissements annuels dans les pays en développement par rapport à leur niveau actuel. Dans bien des cas, effectuer l’ensemble de ces investissements dans le domaine public aurait un coût prohibitif pour les finances publiques. En revanche, l’instauration d’un environnement ouvert à l’investissement, associée à une réglementation adéquate et à une protection adaptée des droits humains, notamment du droit de propriété, permettrait aux autorités publiques, aux entreprises et aux citoyens d’œuvrer ensemble à la satisfaction des besoins essentiels. Une récente recommandation de l’OCDE, intitulée Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures donne des orientations aux autorités publiques lorsqu’elles ont à prendre une décision
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 15
concernant la participation du secteur privé aux infrastructures et les aide à maximiser les retombées positives d’une telle participation pour les pays d’accueil.
L’OCDE au XXIe siècle
À bien des égards, le domaine de l’investissement est représentatif de l’approche plus générale de l’OCDE en matière de prise de décision et de coopération internationale entre les pouvoirs publics. Pour maximiser les bénéfices de la mondialisation et en récolter pleinement les fruits tout en garantissant qu’ils sont équitablement partagés, il est indispensable de mettre en œuvre des politiques publiques saines. La rigueur d’analyse de l’OCDE et la méthodologie d’apprentissage par les pairs concourent à la définition et à la mise en œuvre de telles politiques. L’OCDE est et doit rester la plaque tournante internationale du dialogue sur les questions qui ont trait à l’économie mondiale.
Remplir efficacement ce rôle suppose de s’adapter et de répondre aux nouveaux défis qui se posent. C’est pourquoi l’OCDE a lancé un processus d’élargissement et d’engagement renforcé en direction d’acteurs majeurs de la scène économique mondiale, qui se soldera par plus d’ouverture et par une meilleure représentation. En outre, à l’heure où les dirigeants nationaux « perdent le monopole des décisions sur les politiques publiques », pour reprendre les termes de l’allocution d’ouverture que j’ai prononcée lors de laRéunion du Conseil au niveau des Ministres, l’OCDE va s’engager plus activement dans une coopération avec une diversité d’acteurs. La demande qui lui a été faite, de servir d’enceinte pour le dialogue qui s’engage entre les pays du G8 et ceux de l’O5 (Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud et Mexique), n’est qu’une manifestation supplémentaire de la capacité de l’Organisation à participer à un effort plus structuré de renforcement de la coopération internationale entre les pouvoirs publics.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 17
Chapitre 2.
TENDANCES ET ÉVOLUTION RÉCENTE DE L’INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER*
L’environnement mondial de l’investissement direct étranger a continué de s’améliorer en 2006. La croissance macroéconomique s’est poursuivie, les prix des actions ont affiché une bonne tenue et la rentabilité des entreprises a progressé. En outre, de nouveaux acteurs ont fait sentir leur présence de manière plus marquée. Les entreprises multinationales établies dans les économies en développement ou émergentes ont joué un rôle plus actif en termes d’acquisition d’entreprises résidentes de la zone OCDE, tandis que de nouvelles catégories d’investisseurs, comme les sociétés de capital-investissement, ont consacré des sommes importantes à l’achat d’actifs productifs.
Ainsi, les flux d’IDE à destination et en provenance des pays de l’OCDE ont nettement augmenté en 2006 : les sorties ont progressé de 29 %, pour atteindre 1 120 milliards USD et les entrées ont crû de 22 %, jusqu’à 910 milliards USD. Il s’agit là du deuxième record de l’histoire de l’OCDE, ces chiffres n’ayant été dépassés qu’en 2000, année de l’envolée de l’investissement. Ils ont été tirés à la hausse par un petit nombre d’opérations transfrontières de fusion et acquisition de grande envergure, les cinq opérations les plus importantes ayant représenté près de 120 milliards USD.
Il est permis de s’inquiéter de l’impact que pourraient avoir, sur l’IDE, les inquiétudes de plus en plus vives de la population concernant les conséquences de la mondialisation. Les milieux d’affaires prétendent que l’hostilité rencontrée dans le pays d’accueil joue un rôle dissuasif sur l’investissement transfrontière. Toutefois, globalement, les résistances politiques n’ont jusqu’à présent pas entraîné de ralentissement des flux d’investissement direct.
* Cet article a été préparé par Hans Christiansen (Économiste principal, Division de l’investissement, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE), Andrea Goldstein (Économiste principal, Centre de développement de l’OCDE) et Ayse Bertrand (Responsable des Statistiques sur l’investissement international, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE). Nous remercions Thomas Hatzichronolgou, Direction de la science, de la technologie et de l'industrie et Isabelle Laroche, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE pour leur contribution sur le plan des statistiques et du texte.
18 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Introduction
L’investissement direct étranger (IDE) continue de bénéficier d’un environnement international dynamique. Les facteurs identifiés dans les précédents numéros de cette publication sont toujours à l’œuvre : la croissance macroéconomique est robuste dans la plupart des grandes économies, les bénéfices des entreprises sont élevés, le niveau général des taux d’intérêt est faible, le cours des actions est élevé en dépit de corrections récentes et les prix de l’immobilier également. Ces facteurs concourent à créer un climat international des affaires qui offre des perspectives de bénéfices et se caractérise par une relative abondance des liquidités. Les entreprises ont réagi à ce contexte en augmentant leurs investissements internationaux, en particulier les acquisitions de sociétés.
Il est possible que la faiblesse du dollar ait contribué à modifier les termes de l’équilibre entre les investisseurs transfrontières. À l’échelle mondiale, la faiblesse du dollar est favorable aux investisseurs qui envisagent de réaliser des investissements libellés dans d’autres monnaies, et entraîne un désavantage comparatif pour ceux qui investissent en dollars. En outre, le niveau actuel des taux de change étant perçu comme transitoire, les sociétés étrangères ont un intérêt stratégique à investir aux États-Unis et dans d’autres économies reposant sur le dollar.
D’autre part, l’apparition, parmi les investisseurs à l’étranger, d’entreprises implantées dans des pays en développement ou émergents contribue également à soutenir les flux mondiaux d’investissement direct. Jusqu’à une période relativement récente, cette tendance se manifestait surtout par des investissements « Sud-Sud » au sein des différentes régions du monde en développement ; toutefois, ces deux dernières années, des multinationales implantées dans les pays émergents (au Brésil et en Inde notamment) ont également été à l’origine de certaines des acquisitions transfrontières d’entreprises de la zone OCDE les plus médiatisées. De même, d’autres pays, comme la Chine, ont, en partie en réaction à des considérations économiques et stratégiques plus larges, mis en œuvre des stratégies d’internationalisation, encourageant les entreprises nationales à étendre leur activité à l’étranger.
Autre phénomène récent : la mise en œuvre de stratégies d’investissement mondiales de plus en plus volontaristes par une nouvelle catégorie d’investisseurs, comme les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-investissement. Ainsi, certaines des opérations de fusion et acquisition les plus médiatisées en 2006 et 2007 témoignent des efforts déployés par ces investisseurs pour rechercher des possibilités d’investissement dans le monde entier.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 19
L’évolution de l’environnement international a amené les décideurs de certains pays de l’OCDE à tenir compte des inquiétudes de plus en plus vives de la population à propos des conséquences de la mondialisation. Dans la plupart des pays, le rachat de fleurons de l’économie nationale est controversé. Ces opérations donnent souvent lieu à des allégations selon lesquelles les investisseurs étrangers ont l’intention de transférer des emplois ou du savoir-faire à l’extérieur du pays d’accueil, d’appliquer des normes sur le comportement des entreprises moins exigeantes que celles du pays d’accueil ou de mettre en œuvre des stratégies d’entreprise offensives au détriment de la cohésion sociale. En outre, la prise de conscience internationale de plus en plus forte de la nécessité de préserver la sécurité nationale a nourri les craintes suscitées par des rachats d’entreprises nationales susceptibles d’avoir un lien, aussi indirect soit-il, avec des enjeux stratégiques plus larges. Comme le démontreront certains articles dans la suite de cette publication, certains pays ont déjà durci leur politique vis-à-vis des investissements directs entrants pour des raisons de sécurité nationale et d’autres envisagent de leur emboîter le pas.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, alors que la mondialisation a suscité des inquiétudes vis-à-vis des investissements directs de l’étranger dans certaines régions, elle a également fait naître des craintes concernant un éventuel excès d’investissements directs à l’étranger. Ces dernières années, le débat public a porté sur « l’externalisation » des activités productives vers des pays à bas coûts de main d’œuvre, soupçonnée d’entraîner des pertes d’emploi. Tout bien considéré, il n’est pas prouvé que ces soupçons soient fondés. En général, comme l’évoque un article dans la suite de cette publication, les investissements à l’étranger ont des retombées positives sur le pays d’origine des investisseurs à l’étranger. Toutefois, ces effets positifs vont souvent de pair avec des opérations de restructuration à l’échelle nationale, dont il peut être nécessaire d’atténuer les coûts d’ajustement par des mesures de politique publique adaptées.
Dans l’ensemble, les résistances politiques n’ont pour l’instant pas entraîné de ralentissement des flux d’investissement direct. Bien au contraire, comme le montre la suite de cette publication, l’IDE est en forte expansion.
1. L’investissement direct étranger à destination et en provenance des pays de l’OCDE a poursuivi sa croissance en 2006
Les flux d’IDE à destination et en provenance des pays de l’OCDE ont enregistré une hausse significative en 2006 : les flux sortants ont progressé de 29 %, pour atteindre 1 120 milliards USD et les flux entrants de 22 %, pour atteindre 910 milliards USD (tableau 2.1). Depuis la création de l’OCDE, ces chiffres n’ont été dépassés qu’en 2000, année record pour l’investissement.
20 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
La hausse de l’IDE sortant observée en 2006 a été favorisée par un retour à la normale des investissements en provenance des États-Unis, qui ont crû de près de 240 milliards USD, après avoir chuté jusqu’à un niveau exceptionnellement bas en 2005. Toutefois, la hausse totale a été freinée par les chiffres enregistrés aux Pays-Bas, où les investissements sortants ont reflué de 120 milliards USD, le niveau atteint l’année précédente étant dû à une opération ponctuelle. Les comparaisons entre 2005 et 2006 sont d’autant plus difficiles que les restructurations d’entreprises qui ont eu lieu en 2005 en Australie ont été comptabilisées dans les statistiques globales sur l’investissement comme de forts désinvestissements affectant aussi bien les flux entrants que les flux sortants.
La hausse des entrées d’IDE observée en 2006 est essentiellement imputable à la croissance soutenue des entrées d’IDE au Canada et au Royaume-Uni et à une inversion de tendance en Australie, en Irlande et en Suisse, où les IDE entrants étaient auparavant en baisse. Cette hausse a été atténuée par les chiffres affichés par le Royaume-Uni, après le niveau exceptionnellement élevé atteint en 2005 du fait de restructurations internes au sein du conglomérat Shell/Royal Dutch.
La zone OCDE dans son ensemble a encore amélioré sa position d’investisseur net dans le reste du monde. Les flux sortants nets ont progressé de 70 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 210 milliards USD en 2006, ce qui place l’année 2006 en deuxième position après l’année 2004, où ce chiffre avait atteint un niveau historique (graphique 2.1).
1.1. Tendances notables dans quelques pays
Les États-Unis continuent d’occuper une position dominante en tant que pays d’origine et de destination des investissements étrangers (après une baisse ponctuelle des sorties d’IDE en 2005 liée à une réforme de l’impôt sur les sociétés). En 2006, les flux sortants se sont établis à 249 milliards USD – soit plus du double du chiffre affiché par la France, qui se positionne au deuxième rang. Ce montant correspond pour près de 50 % à des bénéfices réinvestis – ce qui est particulièrement frappant par rapport à l’année 2005, marquée par d’importants retraits de fonds. Alors que les opérations de fusion et acquisition ont connu une forte expansion à l’échelle mondiale en 2006, les entreprises multinationales implantées aux États-Unis ne se sont pas montrées particulièrement dynamiques en termes d’achats d’actifs productifs à l’étranger. Les prises de participation sont restées stables, à près de 40 milliards USD, ce qui est interprété comme le reflet d’une attitude prudente des entreprises face à la faiblesse du dollar.
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
ÉD
ITIO
N 2
007
– IS
BN
978
-92-
64-0
3758
-8 -
© O
CD
E 2
007
21
Tab
leau
2.1
Flu
x d
’inve
stis
sem
ent
dir
ect
à d
esti
nat
ion
et
en p
rove
nan
ce d
es p
ays
de
l’OC
DE
: 2
001-
2006
(mil
liard
s U
SD)
Sor
ties
Ent
rées
20
01
2002
20
03
2004
20
05p
2006
e 20
01
2002
20
03
2004
20
05 p
2006
e
Alle
mag
ne
39.7
19
.0
5.8
14.8
55
.5
79.5
26
.4
53.6
32
.4
-9.2
35
.8
42.9
Aus
tral
ie
12.0
7.
9 16
.2
10.8
-3
4.3
21.0
8.
3 17
.0
8.0
36.0
-3
5.0
24.5
Aut
riche
3.
1 5.
8 7.
1 8.
3 10
.0
4.1
5.9
0.4
7.2
3.9
9.0
0.2
Bel
giqu
e ..
12.7
36
.9
34.0
31
.8
62.6
..
15.6
32
.1
43.6
33
.9
71.5
Bel
giqu
e/Lu
xem
bour
g
100.
6 ..
....
....
84.7
..
....
....
Can
ada
36
.0
26.8
21
.5
43.2
34
.1
42.1
27
.7
22.1
7.
6 1.
5 33
.8
66.6
Cor
ée
2.4
2.6
3.4
4.7
4.3
7.1
3.5
2.4
3.5
9.2
6.3
3.6
Dan
emar
k 13
.4
5.7
1.1
-10.
4 15
.0
8.2
11.5
6.
6 2.
6 -1
0.7
13.1
7.
0
Esp
agne
33
.1
32.7
28
.7
60.6
41
.8
89.7
28
.3
39.2
25
.8
24.8
25
.0
20.0
Éta
ts-U
nis
14
2.3
154.
5 14
9.9
244.
1 9.
1 24
8.9
167.
0 84
.4
64.0
13
3.2
109.
8 18
3.6
Fin
land
e 8.
4 7.
4 -2
.3
-1.1
4.
5 ..
3.7
8.1
3.3
3.0
4.5
3.7
Fra
nce
86
.8
50.5
53
.2
56.8
12
0.9
115.
1 50
.5
49.1
42
.5
32.6
81
.0
81.1
Grè
ce
0.6
0.7
0.4
1.0
1.5
4.2
1.6
0.1
1.3
2.1
0.6
5.4
Hon
grie
0.
4 0.
3 1.
6 1.
1 2.
3 3.
0 3.
9 3.
0 2.
1 4.
5 7.
6 6.
1
Irla
nde
4.1
11.0
5.
6 18
.1
13.6
22
.1
9.7
29.4
22
.8
-10.
6 -3
1.1
12.8
Isla
nde
0.3
0.3
0.4
2.6
7.1
4.2
0.2
0.1
0.3
0.7
3.1
3.2
Italie
21
.5
17.1
9.
1 19
.3
41.8
42
.1
14.9
14
.6
16.4
16
.8
20.0
16
.6
Japo
n 38
.3
32.3
28
.8
31.0
45
.8
50.2
6.
2 9.
2 6.
3 7.
8 2.
8 -6
.5
Luxe
mbo
urg
..
125.
9 99
.9
84.1
12
4.0
81.6
..
115.
3 89
.3
79.1
11
6.3
97.0
Mex
ique
4.
4 0.
9 1.
3 4.
4 6.
5 5.
8 27
.2
18.3
14
.2
22.3
19
.6
19.0
22PE
RSP
EC
TIV
ES
D'IN
VE
STIS
SEM
EN
T I
NT
ER
NA
TIO
NA
L 2
007
– IS
BN
- 97
8-92
-64-
0375
8-8
© O
EC
D 2
007
(mil
liard
s U
SD)
Sor
ties
Ent
rées
20
01
2002
20
03
2004
20
05p
2006
e 20
01
2002
20
03
2004
20
05 p
2006
e
Nor
vège
0.
5 4.
6 2.
7 3.
5 21
.1
12.2
2.
2 0.
7 3.
7 2.
5 6.
4 1.
6
Nou
velle
-Zél
ande
0.
4 -1
.1
0.2
1.1
-0.3
-1
.6
4.6
-1.3
2.
0 2.
9 3.
1 1.
6
Pay
s-B
as
50.6
32
.0
44.1
26
.6
142.
8 22
.7
51.9
25
.1
21.1
2.
1 41
.4
4.4
Pol
ogne
-0
.1
0.2
0.3
0.8
3.1
4.1
5.7
4.1
4.9
12.5
9.
5 13
.9
Por
tuga
l
6.3
-0.1
8.
0 7.
8 2.
1 3.
5 6.
2 1.
8 8.
6 2.
3 4.
0 7.
4
Rép
ubliq
ue s
lova
que
0.1
.. ..
0.2
0.1
0.4
1.6
4.1
0.6
1.1
1.9
4.2
Rép
ubliq
ue tc
hèqu
e 0.
2 0.
2 0.
2 1.
0 0.
0 1.
3 5.
6 8.
5 2.
1 5.
0 11
.7
6.0
Roy
aum
e-U
ni
58.9
50
.3
62.4
91
.1
83.7
79
.5
52.7
24
.1
16.8
56
.0
193.
7 13
9.6
Suè
de
7.3
10.6
21
.1
20.8
26
.5
24.1
10
.9
12.2
5.
0 11
.7
10.2
27
.8
Sui
sse
18
.3
8.2
15.4
26
.3
54.2
81
.5
8.9
6.3
16.5
1.
4 -1
.3
25.1
Tur
quie
0.
5 0.
2 0.
5 0.
9 1.
1 0.
9 3.
4 1.
1 1.
8 2.
9 9.
8 20
.2
To
tal l
’OC
DE
69
0.5
619.
2 62
3.7
807.
4 86
9.4
1120
.1
635.
0 57
5.0
464.
9 49
0.9
746.
6 91
0.2
Not
es :
les
donn
ées
ont é
té c
onve
rtie
s en
dol
lars
des
Éta
ts-U
nis
sur
la b
ase
des
taux
de
chan
ge m
oyen
s ; p
: ch
iffre
s pr
élim
inai
res
; e :
estim
atio
ns
Sou
rce
: Bas
e de
don
nées
sur
l'in
vest
isse
men
t dire
ct in
tern
atio
nal d
e l'O
CD
E.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 23
Graphique 2.1. Flux d’IDE à destination et en provenance de la zone OCDE
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p 2006e
Mil
liar
ds
US
D
sorties totales d'IDE de la zone OCDE entrées totales d'IDE dans la zone OCDE
Sorties totales nettes de la zone OCDE
Source : Base de données de l’OCDE sur l’investissement direct international.
En 2006, les entrées d’IDE aux États-Unis se sont établies à 184 milliards USD, permettant au pays de retrouver la première place du classement après s’être fait brièvement devancer par le Royaume-Uni en 2005. Selon d’autres informations publiées par le Bureau of Economic Analysis, ce chiffre est à peu près identique à celui des « dépenses » engagées par des entreprises étrangères pour racheter ou créer des entreprises aux États-Unis. La majeure partie de cette somme a été affectée au rachat d’entreprises existantes, les investissements correspondant à la création d’entreprises nouvelles ayant été limités à 14 milliards USD. Environ les deux tiers de ces investissements ont été réalisés par des entreprises européennes et les investisseurs établis au Royaume-Uni, en Allemagne et en France ont représenté des proportions presque égales.
En 2006, les entrées d’IDE au Royaume-Uni ont diminué de 28 %, ce qui n’a pas empêché le pays de se positionner au deuxième rang des pays destinataires d’IDE avec des flux entrants de 140 milliards USD. Le Royaume-Uni est l’un des pays de l’OCDE où les entrées d’IDE ont été le plus affectées par les opérations transfrontières de fusion et acquisition. D’après les
24 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
estimations, les cinq plus grosses acquisitions, par des investisseurs étrangers, d’entreprises établies au Royaume-Uni auraient, à elles seules, représenté quelque 60 milliards USD (voir paragraphe 1.3.).
Encadré 2.1. Statistiques de l’investissement direct étranger : principaux concepts
L’investissement direct est une catégorie d’investissement qui recouvre les investissements qu’une entité résidente d’une économie (« l’investisseur direct ») effectue dans le but d'acquérir un « intérêt durable » dans une entité résidente d'une autre économie (« l’entreprise d’investissement direct »).
Il y a intérêt durable dès lors que l’investisseur direct détient 10 % des droits de vote de l’entreprise d’investissement direct.
Un investisseur direct étranger est une entité qui possède une entreprise d’investissement direct opérant dans un pays autre que son économie de résidence. Il peut s’agir d’une personne physique (ou d’un groupe de personnes physiques liées entre elles), d’une entreprise publique ou privée constituée en société ou non (ou d’un groupe d’entreprises liées entre elles), d’un gouvernement, d’une succession, d’un trust ou autre structure possédant une entreprise.
Une entreprise d’investissement direct est une entreprise constituée en société ou non (éventuellement une succursale) dans laquelle un investisseur non résident détient au moins 10 % des droits de vote dans le cas d’une entreprise constituée en société ou l’équivalent dans le cas d’une entreprise non constituée en société.
Les opérations d’investissement direct comportent trois composantes : capital social, bénéfices réinvestis et autres capitaux.
Le capital social comprend : (i) la participation au capital des succursales ; (ii) toutes les actions des filiales et des entreprises affiliées (sauf les actions privilégiées non participatives qui sont traitées comme des instruments de dette et enregistrées dans la catégorie autres capitaux) et (iii) les autres apports de capitaux.
Les bénéfices réinvestis d’une entreprise d’investissement direct correspondent aux revenus des capitaux propres perçus par l’investisseur direct ; ce sont des gains perçus par l’investisseur direct. Toutefois, ils ne sont pas réellement distribués à l’investisseur direct, puisqu’ils servent en fait à accroître son investissement dans son entreprise affiliée.
La catégorie autres capitaux (ou transactions liées aux dettes interentreprises) regroupe des emprunts et les prêts de fonds entre investisseurs directs et filiales, entreprises affiliées et succursales.
Les investissements directs venant d’entreprises établies au Royaume-Uni ont reculé d’environ 5 %, pour atteindre 80 milliards USD, ce qui place le Royaume-Uni non seulement derrière les États-Unis, mais aussi derrière l’Espagne, le Luxembourg et la Suisse. Les chiffres affichés par certains de ces pays sont toutefois influencés par le fait que les investissements transitent parfois par des sociétés holding financières et des entités à vocation spéciale, ce qui rend les comparaisons directes plus difficiles. Toutefois, ce facteur influe également sur les chiffres observés au Royaume-Uni du fait, par exemple, des flux financiers qui transitent par la City. Il n’en reste pas moins que le recul du
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 25
Royaume-Uni dans le classement s’explique également par certaines évolutions importantes. Ainsi, la cession, par des entreprises britanniques, d’actifs acquis antérieurement a été comptabilisée en 2006 ; en outre, alors que les opérations d’acquisition d’entreprises étrangères ont été nombreuses, leur montant est souvent resté limité.
Le montant élevé des investissements directs à l’étranger venant de la France en 2006, après des montants encore plus élevés en 2005, traduit dans une certaine mesure le dynamisme des acquisitions à l’étranger. Environ un tiers des flux sortants, estimés à 115 milliards USD, résultent des cinq plus grosses opérations de fusion et acquisition réalisées par des entreprises françaises, en particulier du rachat par Alcatel de l’entreprise américaine Lucent et de l’acquisition par AXA de la compagnie d’assurance suisse Wintherthur.
La stabilité, à 81 milliards USD, des flux d’investissement à destination de la France en 2006 ne semble pas imputable à un facteur unique. En l’absence de grosses opérations d’acquisition d’entreprises françaises (à l’exception partielle d’un investissement étranger dans une société d’autoroutes privatisée), les prêts interentreprises et les opérations d’augmentation du capital réalisées par des multinationales étrangères dans des filiales qu’elles détenaient déjà en France sont au nombre des principaux facteurs d’explication. Les investissements correspondant à la création de petites et moyennes entreprises (PME) ou de sites de production indépendants continuent d’avoir de l’importance au plan macroéconomique mais ont, en règle générale, porté sur des montants insuffisants pour être visibles dans les statistiques totales.
En 2006, l’investissement direct en provenance de l’Allemagne a atteint son plus haut niveau depuis les années 90, à 80 milliards USD. Cette hausse est en partie imputable à quelques acquisitions d’actifs productifs aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi au niveau historiquement élevé des bénéfices réinvestis. L’investissement direct entrant a progressé de 20 % par rapport à 2005, pour atteindre 43 milliards USD. Après plusieurs années marquées par la faiblesse des investissements entrants, l’Allemagne a retrouvé sa place parmi les grandes destinations d’IDE au sein de l’OCDE, même si elle accuse un retard par rapport à des économies européennes comparables, comme le Royaume-Uni et la France.
En 2006, les investissements directs accueillis par le Canada ont atteint 67 milliards USD – soit un montant deux fois supérieur à celui de 2005 et identique au précédent record, enregistré lors de l’envolée de l’investissement, en 2000. Deux acquisitions d’envergure effectuées dans le secteur minier représentent plus de la moitié du montant total. Comme les années précédentes, les opérations d’un montant « plus normal » sont le fait d’entreprises implantées
26 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
aux États-Unis, qui ont été nombreuses à investir au Canada. Les investisseurs établis au Royaume-Uni et en Europe continentale ont suivi la même voie, attirés, semble-t-il, par la faiblesse du dollar canadien vis-à-vis de la livre sterling et de l’euro. Les investissements canadiens à l’étranger ont également augmenté en 2006, de plus de 20 %, pour atteindre 42 milliards USD. Les entreprises canadiennes se sont montrées relativement dynamiques en termes d’acquisitions à l’étranger, mais une partie des flux sortants correspond apparemment à des opérations sur le capital effectuées dans des filiales existantes aux États-Unis.
En 2006, l’investissement direct en provenance du Japon – traditionnellement gros exportateur net de capitaux – a progressé de 10 % par rapport au niveau déjà élevé de 2005, pour atteindre 50 milliards USD, son plus haut niveau depuis 1990. Bien que les États-Unis et la Chine soient les premières destinations des IDE japonais, la hausse observée par rapport à 2005 est en grande partie liée à une progression des investissements aux Pays Bas et au Royaume-Uni. Les investissements entrants sont devenus négatifs en 2006, s’établissant à -6.5 milliards USD, certaines entreprises étrangères ayant cédé les actifs productifs qu’elles détenaient au Japon. Ce chiffre est interprété comme le résultat de tendances sous-jacentes contrastées : dans deux secteurs (l’automobile et la chimie), les entreprises étrangères ont augmenté leur participation de manière significative. Toutefois, dans les statistiques globales, cette tendance est masquée par le désengagement d’entreprises, en particulier d’une entreprise européenne (du secteur des télécommunications) et d’une entreprise nord-américaine, qui avaient auparavant investi de fortes sommes au Japon.
L’IDE venant de la Suisse, déjà élevé, à 54 milliards USD, en 2005, a augmenté pour atteindre un niveau sans précédent de 82 milliards USD en 2006. Une forte proportion de cette somme correspond à des opérations d’augmentation de capital réalisées dans des filiales étrangères en particulier par des institutions financières établies en Suisse. Toutefois la réalisation de nouvelles acquisitions à l’étranger, notamment par des sociétés financières ou des sociétés holding, des banques, des entreprises du secteur chimique ou du secteur manufacturier a également joué un rôle. En 2006, les flux entrants ont atteint 25 milliards USD, ce qui signe la fin d’une période de deux ans marquée par l’importance des cessions et rapatriements de fonds depuis la Suisse. La première opération par la taille est, de loin, l’acquisition, déjà évoquée, d’une compagnie d’assurance.
Pour les autres pays de l’OCDE figurant dans le tableau 2.1, les évolutions suivantes méritent d’être soulignées pour 2006 :
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 27
• Les entrées d’IDE de la Suède ont plus que doublé, pour atteindre 28 milliards USD. Cette hausse s’explique en grande partie par des acquisitions d’actifs productifs ; à noter qu’un petit nombre d’investissements réalisés par des investisseurs établis au Royaume-Uni représentent près de la moitié du montant total.
• Les entrées d’IDE de la Turquie, ont atteint un record historique de 20 milliards USD. La hausse par rapport au niveau déjà élevé de 2005 est en grande partie imputable à quelques acquisitions d’envergure dans le secteur financier et celui des télécommunications.
• Les entrées d’IDE de la Grèce ont encore atteint un record, qui s’explique essentiellement par deux acquisitions d’envergure dans le secteur financier.
• La Pologne et la République slovaque figurent parmi les autres pays qui ont enregistré des flux d’IDE entrants record en 2006. Dans le cas de la République slovaque, les chiffres ont été tirés à la hausse par une acquisition de grande envergure réalisée par une entreprise italienne dans le secteur de l’énergie, qui n’explique toutefois qu’un quart du total des flux. Dans le cas de la Pologne, les chiffres reflètent le montant historiquement élevé des bénéfices réinvestis.
1.2. Perspectives à plus long terme
Au cours de la décennie écoulée, l’OCDE est sans conteste apparue comme le premier fournisseur d’investissements directs du monde. Les sorties nettes d’IDE provenant des pays membres se sont élevés à 1 242 milliards USD ces dix dernières années (de 1997 à 2006, voir tableau 2.2). Durant cette période, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse, les Pays-Bas et l’Espagne ont été les premiers exportateurs nets d’IDE de la zone OCDE.
L’importance d’un pays en tant que fournisseur de capitaux au reste du monde dépend de facteurs macroéconomiques et structurels. Ainsi, une balance des paiements courants fortement excédentaire amène les pays à réinvestir leurs gains collectifs à l’étranger – même si ces investissements ne prennent pas toujours la forme d’IDE ou autres types d’investissements dans des actifs productifs. Ce facteur semble avoir joué un rôle important dans le cas du Japon et de la Suisse.
En outre, dans certains pays, les grandes entreprises ont délibérément mis en œuvre des stratégies de diversification internationale, parfois avec le soutien des pouvoirs publics. Tel semble avoir été le cas, dans certains pays de l’OCDE,
28 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
des entreprises du secteur des services d’utilité collective ; en outre, à l’extérieur de l’OCDE, en particulier dans les pays d’Asie de l’Est, les stratégies d’investissement à l’étranger bénéficiant du soutien des pouvoirs publics sont devenues fréquentes.
Les pays qui entretiennent traditionnellement des relations étroites avec certaines régions du monde, en particulier les anciennes puissances coloniales, ont, avec ces régions, des liens commerciaux qui ont souvent une incidence sur leurs flux d’IDE. En témoignent les caractéristiques de l’investissement direct de l’Espagne, de la France et du Royaume-Uni à destination de l’Amérique latine et de l’Afrique. Il est également probable que les pays privilégiés par les investisseurs pour la constitution de grandes sociétés, comme les Pays-Bas, servent, dans une certaine mesure de canal aux investissements directs vers le reste du monde.
An sein de la zone OCDE, ces dix dernières années, les principaux bénéficiaires nets d’IDE ont été le Mexique, la Pologne, les États-Unis, la République tchèque, l’Australie, la Turquie et la Corée. Les États-Unis et l’Australie se démarquent au sein de ce groupe, essentiellement composé de pays qui ont un revenu inférieur à la moyenne, ont connu récemment une expansion économique rapide ainsi qu’un processus d’ouverture des marchés et de privatisation. L’importance des États-Unis en tant que destination des IDE est peut-être à mettre en rapport avec le déficit courant élevé qu’ils accusent depuis longtemps, mais s’explique également par la persistance d’une forte croissance et par une tradition d’ouverture aux acquisitions étrangères.
En revanche, les entrées et sorties brutes d’IDE reflètent surtout le poids économique des pays. Ces dix dernières années, les États-Unis sont arrivés largement en tête des pays bénéficiaires et d’origine des investissements directs, suivis par des pays comme le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Canada. La présence de la Belgique et du Luxembourg en haut du classement peut surprendre : outre le fait que ces pays sont, par rapport à leur taille, en eux-mêmes attrayants pour les investissements, le fait qu’ils devancent la plupart des pays du G7 dans le tableau 2.2. traduit surtout le fait qu’ils constituent un lieu d’établissement privilégié pour les sociétés holding et autres entités à vocation spéciale.
Certaines économies majeures affichent des chiffres inférieurs aux attentes. Le Japon, par exemple, n’a attiré que 53 milliards USD d’investissements directs cumulés au cours des dix dernières années, ce qui le place à égalité avec les petits pays d’Europe occidentale. Cette situation reflète dans une certaine mesure son éloignement par rapport à la plupart des autres pays très développés (les sorties d’IDE du Japon, bien que supérieures aux entrées, sont inférieures à
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 29
ce qu’elles pourraient être dans une économie aussi développée). En outre, le Japon n’étant pas un pays à bas coûts de production, la plupart des entrées d’IDE devraient, en principe, correspondre à des investissements visant la conquête de marchés afin de servir la clientèle japonaise. Or, alors que le Japon applique une réglementation relativement souple en matière d’investissement par rapport à d’autres pays, il est notoirement difficile pour les entreprises étrangères de pénétrer le marché nippon.
L’Italie a attiré peu d’IDE comparativement aux autres pays européens ces dix dernières années. Le pays a accueilli 129 milliards USD d’investissements cumulés, ce qui représente entre un tiers et un cinquième des investissements attirés par les trois autres grandes économies européennes. Si plusieurs facteurs concourent à expliquer ce retard, notamment l’isolement géographique de régions entières de l’Italie par rapport aux principaux pôles économiques européens, les difficultés rencontrées pour mener à bien des acquisitions transfrontières d’entreprises établies en Italie jouent sans doute un rôle. Nombre de grandes entreprises sont des sociétés à capital fermé ou ont une structure de gouvernance défavorable aux offres d’achat inamicales et, selon la presse, certains projets d’investissement ont, dans le passé, été controversés sur le plan politique.
Tableau 2.2. Flux cumulés d’IDE des pays de l’OCDE sur la période 1997-2006
(milliards USD)
Entrées Sorties Sorties nettes
États-Unis 1637.2 États-Unis 1580.4 France 391.0
Belgique / Luxembourg 1188.7
Belgique / Luxembourg 1181.7
Japon 277.5
Royaume-Uni 797.2 Royaume-Uni 1045.3 Royaume-Uni 248.2
France 480.8 France 871.8 Suisse 215.0
Allemagne 473.2 Pays-Bas 513.1 Pays-Bas 214.0
Pays-Bas 299.1 Allemagne 510.2 Espagne 181.0
Canada 285.3 Espagne 420.8 Italie 69.4
Espagne 239.8 Japon 330.9 Canada 37.9
Suède 192.9 Canada 323.1 Allemagne 37.0
Mexique 178.4 Suisse 318.5 Norvège 27.5
Italie 128.8 Suède 210.4 Suède 17.5
Suisse 103.4 Italie 198.2 Finlande 17.4
Australie 89.7 Irlande 90.1 Islande 7.4
Irlande 88.5 Danemark 81.3 Autriche 6.7
Danemark 86.7 Finlande 71.5 Irlande 1.6
30 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Entrées Sorties Sorties nettes
Pologne 78.6 Norvège 67.0 Portugal 1.6
Corée 55.5 Autriche 52.3 Grèce -3.1
République tchèque 55.2
Australie 46.0
Danemark -5.4
Finlande 54.0
Portugal 45.0
Belgique / Luxembourg -7.0
Japon 53.4 Corée 42.9 Corée -12.6
Autriche 45.6
Mexique* 23.2
République slovaque -16.7
Portugal 43.5
Islande 15.5
Nouvelle-Zélande -19.9
Turquie 42.6 Grèce 10.7 Hongrie -30.5
Hongrie 40.9 Hongrie 10.4 Turquie -36.4
Norvège 39.4 Pologne 8.8 Australie -43.7
Nouvelle-Zélande 19.0
Turquie 6.2
République tchèque -51.9
République slovaque 17.3
République tchèque 3.2
États-Unis -56.9
Grèce 13.8
République slovaque 0.6
Pologne -69.7
Islande 8.1
Nouvelle-Zélande -0.9
Mexique* -97.4
Total OCDE 6836.3 Total OCDE 8078.1 Total OCDE ** 1241.8 * Mexique : les sorties et les sorties nettes correspondent à la période 2001-2006. ** Il est possible que la somme des sorties nettes ne corresponde pas au total OCDE.
Source : Base de données de l’OCDE sur l’investissement direct international.
1.3. Informations complémentaires basées sur les données relatives aux fusions et acquisitions : perspectives
Bien que les opérations de fusion et acquisition ne soient qu’une composante des flux totaux d’IDE, dans beaucoup de pays de l’OCDE, elles représentent plus la moitié de l’investissement direct total. Ceci est particulièrement vrai en période de dynamisme de l’investissement, car les fusions et acquisitions constituent la composante de l’IDE qui réagit le plus nettement ou le plus rapidement à l’évolution du climat des affaires, des conditions financières et de la situation macroéconomique.
Par conséquent, les statistiques globales sur les opérations transfrontières de fusion et acquisition pour 2006 et début 2007 peuvent offrir des indications supplémentaires sur les futures tendances de l’IDE. Une certaine prudence est
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 31
toutefois de mise : les données sur les fusions et acquisitions recueillies par les organismes privés tendent à intégrer davantage d’opérations que les statistiques officielles sur l’IDE. Ces dernières ne comptabilisent en effet que la valeur des actifs productifs effectivement transférés, tandis que les données publiées sur les fusions et acquisitions reposent sur la valeur marchande des entreprises acquises. En outre, dans les statistiques globales sur l’IDE, les cessions sont retranchées des totaux, tandis que les données sur les fusions et acquisitions utilisées dans cet article reflètent les flux transfrontières bruts.
Tableau 2.3. Nombre total d’opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées dans et par les pays de l’OCDE
Sorties Entrées
Date
Montant (millions
USD) Nombre
Taille moyenne
desopérations
Montant (millions
USD) Nombre
Taille moyenne
desopérations
1995 134 602 2 258 59.6 146 603 2 132 68.8
1996 171 528 2 692 63.7 175 598 2 498 70.3
1997 285 189 3 427 83.2 254 315 3 088 82.4
1998 526 089 5 173 101.7 486 157 4 451 109.2
1999 801 080 6 560 122.1 775 757 5 697 136.2
2000 1 166 386 7 799 149.6 1 136 093 7 082 160.4
2001 605 716 6 464 93.7 584 784 6 198 94.4
2002 376 217 5 169 72.8 409 844 5 050 81.2
2003 321 960 4 383 73.5 338 164 4 131 81.9
2004 422 761 5 061 83.5 443 800 4 661 95.2
2005 673 647 6 490 103.8 635 262 5 361 118.5
2006 847 999 6 655 127.4 818 480 5 244 156.1
Janvier-mai2007 428 517 2 457 174.4 430 474 2 006 214.6
Estima-tion2007 1 028 440 5 897 1 033 138 4 814 Source : Dealogic
Du fait de leur volatilité, les flux d’opérations de fusion et acquisition se sont, en toute logique, redressés plus vivement que l’investissement total après les points bas de 2002 et 2003. Depuis 2003, la valeur des opérations de fusion et acquisition réalisées dans ou par les pays de l’OCDE a presque triplé. Les opérations réalisées en 2006 par des investisseurs résidents de la zone OCDE
32 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
ont été évaluées à 848 milliards USD (tableau 2.3.). La valeur des « fusions et acquisitions entrantes » (dont la cible est établie dans un pays de l’OCDE) était légèrement inférieure, à 818 milliards USD. Ces deux chiffres représentent une hausse de plus de 25 % par rapport à l’année précédente.
Le tableau 2.3 permet de tirer une autre conclusion intéressante, à savoir que l’ampleur moyenne des opérations est en forte hausse. Cette tendance s’explique en partie par la faiblesse du dollar, qui augmente la valeur des acquisitions d’actifs productifs dans les pays où une autre monnaie a cours. Elle est également la conséquence d’une hausse de la valorisation des actifs productifs et de quelques opérations de plusieurs milliards de dollars, que l’on avait pas vues depuis 2000, année de l’envolée des investissements.
D’après les cinq premiers mois de 2007 (le tableau 2.3 prend en compte les opérations effectuées jusqu’à la première semaine de juin), la forte hausse des opérations internationales de fusion et acquisition se poursuit au même rythme. Au cours de cette période, leur valeur moyenne a atteint un record, tant pour les entrées que pour les sorties. Si ces cinq premiers mois sont représentatifs de l’ensemble de l’année 2007, le montant total des fusions et acquisitions transfrontières dépassera 1 000 milliards USD pour la deuxième fois de l’histoire.
Il est possible, d’effectuer une projection des flux d’IDE à partir de l’évolution de la covariation entre les opérations transfrontières de fusion et acquisition et l’IDE. Si la tendance des fusions et acquisitions reste globalement stable pendant le reste de l’année 2007, l’IDE à destination des pays de l’OCDE risque de croître de plus de 20 % par rapport à 2006, et d’atteindre environ 1 160 milliards USD pour l’ensemble de l’année. Quant à l’IDE provenant des pays de l’OCDE (plutôt élevé en 2006 comparativement aux fusions et acquisitions transfrontières), il pourrait augmenter plus modestement, de 5 à 10 %, pour atteindre environ 1 200 milliards USD.
1.4. Tendances sectorielles des fusions et acquisitions transfrontières
1.4.1 Grande diversité sectorielle
En 2006, les opérations transfrontières de fusion et acquisition se sont réparties de manière relativement égale entre plusieurs des principaux secteurs de l’économie marchande. Ainsi, les entreprises opérant essentiellement dans le secteur des matières premières, des télécommunications, de l’immobilier, des médias et du divertissement, des services financiers et de l’industrie manufacturière ont été la cible d’acquisitions transfrontières représentant, dans chaque secteur, plus de 40 milliards USD. Les données utilisées dans cette
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 33
partie proviennent de la base de données de Thomson Financial et ne tiennent compte que des opérations transfrontières de grande envergure, en l’occurrence d’une valeur supérieure à 500 millions USD. Les opérations ne se limitent pas à la zone OCDE.
C’est dans le secteur de l’extraction et du traitement de matières premières que la valeur des fusions et acquisitions transfrontières a été la plus élevée en 2006. Au total, d’après les estimations basées sur les marchés financiers, les « grandes » opérations réalisées dans ce secteur ont représenté 119 milliards USD. Plus d’un quart de cette somme correspond à une seule opération – le rachat très médiatisé d’Arcelor, entreprise sidérurgique établie au Luxembourg, par son concurrent néerlandais Mittal Steel, pour environ 32 milliards USD. Toujours dans le secteur de la sidérurgie, deux entreprises canadiennes ont été la cible d’opérations d’envergure : Falconbridge, producteur d’aluminium racheté par l’entreprise suisse Xstrata et Inco, producteur de nickel racheté par l’entreprise brésilienne Cia Vale do Rio Doce. Chacune de ces opérations a représenté 17 milliards USD. La prise de contrôle par le groupe luxembourgeois Arcelor, avant son rachat par Mittal Steel, de la troisième entreprise canadienne par la taille, en l’occurrence le producteur d’acier Dofasco, pour près de 5 milliards USD, figure également en bonne place parmi les opérations d’envergure.
Dans ce secteur, d’autres opérations, impliquant des entreprises britanniques et américaines, ont également été très médiatisées : l’acquisition du groupe BOC, spécialiste britannique du gaz industriel, par l’allemand Linde AG pour quelque 14 milliards USD ; le rachat de la société minière américaine Glamis Gold par sa rivale canadienne GoldCorp pour près de 9 milliards USD et du fabricant de matériaux américain Engelhard Corp par le groupe allemand BASF pour environ 5 milliards USD.
C’est le secteur des télécommunications qui arrive en deuxième position en termes de valeur des opérations, avec 94 milliards USD au total. Plusieurs grandes opérations visaient des entreprises de pays en développement, comme la République dominicaine, la Thaïlande, le Soudan, le Brésil et l’Inde ; toutefois, plus de la moitié de la valeur totale correspond à trois opérations d’envergure réalisées au sein de la zone OCDE. L’acquisition de l’entreprise O2 plc, implantée au Royaume-Uni, par l’opérateur espagnol Telefonica pour 31 milliards USD est, de loin, la plus grosse opération réalisée dans ce secteur. Vient ensuite le rachat (déjà évoqué) de l’américain Lucent Technologies par le français Alcatel pour près de 14 milliards USD. La troisième transaction est l’acquisition, pour 11 milliards USD de TDC, premier opérateur danois de télécommunication, par un consortium de sociétés de capital-investissement étrangères.
34 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Dans le secteur financier, la valeur totale des opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées en 2006 est estimée à 85 milliards USD. 14 opérations ont excédé 2 milliards USD, mais aucune opération ne se distingue nettement des autres par sa seule ampleur. Le rachat le plus important a été celui, déjà évoqué, de la compagnie d’assurance suisse Wintherthur par l’assureur français AXA pour 10 milliards USD. Le rachat par Old Mutual, société établie au Royaume-Uni, de l’assureur suédois Försäkrings AB Skandia pour 6 milliards USD arrive en deuxième position. Par ailleurs, deux opérations, largement relayées par les médias, ont visé le secteur bancaire italien : le rachat de Banca Nazionale del Lavoro par la banque française BNP Paribas pour 6 milliards USD et celui de Banca Antonveneta par la banque néerlandaise ABM Amro pour un peu plus de 4 milliards USD. Une autre opération d’envergure touchant le secteur bancaire a été réalisée en dehors de la zone OCDE : le rachat par la banque autrichienne Erste Bank der österreichischen Sparkassen de la banque roumaine Banca Comerciala Romana pour près de 5 milliards USD.
Dans le secteur des médias et du divertissement, dans sa définition large, qui couvre également la restauration et l’hôtellerie, l’opération la plus importante réalisée en 2006 est l’acquisition du groupe d’édition néerlandais VNU par un consortium de sociétés de capital-investissement pour près de 10 milliards USD. En deuxième lieu, la société de droit britannique Hilton Group plc, a vendu ses activités d’hôtellerie à Hilton Hotels Corporation, établie aux États-Unis, pour près de 6 milliards USD. Enfin, dans le secteur des jeux, la société américaine GTECH Holdings a été achetée par l’entreprise italienne Lottomatica pour 4.5 milliards USD.
En 2006, quelques fusions et acquisitions transfrontières de grande envergure non encore évoquées ont eu lieu dans des secteurs que l’on pourrait regrouper sous le terme secteurs de la haute technologie. Ainsi, la société néerlandaise Phillips Semiconductors a été achetée pour 9.5 milliards USD par un groupe d’investisseurs internationaux et l’entreprise Advanced Micro Devices, établie aux États-Unis, a acquis le fabricant canadien de processeurs ATI Technologies pour 5 milliards USD. Dans le secteur médical et pharmaceutique, Israeli Teva Pharma a acheté le laboratoire américain IVAX Corp pour plus de 7 milliards USD et la société suisse Novartis a acquis l’entreprise de biotechnologie américaine Chiron Corp pour 6 milliards USD.
1.4.2 Progression des fusions et acquisitions au premier semestre 2007 : le secteur de l’énergie et les autres secteurs
Au premier semestre 2007, l’activité en matière de fusions et acquisitions transfrontières est restée très dynamique. Du début de l’année jusqu’à la deuxième semaine de juin (dernière semaine prise en compte dans l’article), les
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 35
opérations dont la valeur individuelle a dépassé 500 millions USD ont représenté 395 milliards USD au total. Si ces premiers mois se révèlent représentatifs de l’année dans son ensemble, l’activité sera encore plus forte en 2007 (cet aspect est évoqué plus précisément dans les paragraphes suivants).
Les premiers mois de l’année 2007 mettent en évidence un élément intéressant, en l’occurrence la forte activité dans le secteur de l’énergie. Ainsi, 4 des 10 premières opérations par la taille – dont la transaction la plus importante – ont été réalisées dans ce secteur. L’acquisition de Scottish Power plc par l’entreprise espagnole Iberdrola pour 22 milliards USD a donné naissance à un groupe considéré comme la troisième entreprise de services d’utilité collective d’Europe. Après une série de rebondissements largement relayés par les médias, l’italien Enel a pris une participation stratégique dans le groupe énergétique espagnol Endesa pour un montant estimé à plus de 11 milliards USD. Au Canada, le rachat de Shell Canada par le groupe anglo-néerlandais Royal Dutch et l’investissement réalisé par ConocoPhillips dans un partenariat d’amont avec EnCana ont l’un et l’autre été estimés à environ 7.5 milliards USD.
Plusieurs autres opérations d’envergure réalisées au cours de la première partie de l’année 2007 ont été évaluées à plus de 10 milliards USD. L’acquisition du groupe britannique Corus Group par Tata Steel, bien qu’officiellement considérée comme une opération interne au Royaume-Uni, est évoquée dans la partie suivante. Le rachat du cigarettier et grossiste britannique Gallaher Group par Japan Tobacco a été évalué à près de 15 milliards USD. Dans le secteur financier, la plus grosse opération est le rachat de la place financière Euronext par la bourse américaine New York Stock Exchange pour 10 milliards USD. Enfin, en dehors de la zone euro, Vodafone, opérateur de télécommunication établi au Royaume-Uni, a payé plus de 12 milliards USD pour acquérir une participation de contrôle dans Hutchinson Essar, opérateur indien de téléphonie mobile.
2. La montée en puissance des entreprises multinationales établies dans les économies émergentes1
L’expansion internationale de grandes entreprises établies sur les marchés émergents (communément dénommées entreprises multinationales des économies émergentes) est une tendance nouvelle et dynamique de l’investissement international.2 Un petit nombre d’opérations particulièrement volumineuses ont été fortement médiatisées : l’acquisition de l’italien Wind par les propriétaires de la société égyptienne Orascom, qui, parallèlement, a constitué la plus grosse acquisition financée par endettement jamais réalisée en Europe ; l’acquisition par le sidérurgiste indien Tata Steel de l’entreprise anglo-
36 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
néerlandaise Corus, qui a donné naissance à la cinquième entreprise sidérurgique du monde ; le rachat de l’entreprise canadienne Inco par le brésilien CVRD, qui est ainsi devenu le deuxième groupe minier du monde et l’achat, par l’entreprise mexicaine Cemex, de l’australien Rinker pour 16.8 milliards USD. Le graphique 2.2. montre que 2006 a été une année record en ce qui concerne les opérations transfrontières de fusions et acquisitions réalisées par des entreprises établies dans des pays non membres de l’OCDE, leur valeur étant estimée à 115 milliards USD. Plus de la moitié de cette somme était destinée à des pays membres de l’OCDE.
À noter que ce phénomène ne concerne pas seulement quelques opérations de fusion et acquisition. La vigueur de la croissance économique, en particulier en Asie et dans les pays exportateurs de pétrole, le prix élevé des matières premières et la poursuite de la libéralisation de l’investissement dans certains pays sont autant de facteurs qui ont alimenté une envolée des investissements à l’étranger des économies émergentes. L’investissement dit « Sud-Sud », à destination d’autres économies en développement et émergentes, qui, contrairement à la majorité des investissements « Sud-Nord » prend plus souvent la forme de création d’entreprises nouvelles que de fusions et acquisitions, est une autre évolution marquante.
Graphique 2.2. Opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées par des entreprises non résidentes de la zone OCDE
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Ciblant des pays non membres Ciblant des pays membres
Source : Thomson OneBanker.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 37
2.1. La montée en puissance des entreprises multinationales des pays émergents dans l’économie mondiale
Du fait de la mondialisation des activités des entreprises et de la complexité de leurs stratégies, il est devenu plus difficile de définir et de surveiller les activités internationales des multinationales. Ce problème se pose avec une acuité particulière en ce qui concerne les sorties d’IDE des économies émergentes, dont les statistiques sont souvent lacunaires et relativement peu fiables. Des acteurs importants, comme la Malaisie et le Mexique, commencent tout juste à publier les statistiques sur leurs IDE sortants ces dernières années. En outre, pour plusieurs pays, les estimations d’IDE sortants sont très inférieures au niveau réel des flux mesuré d’après les normes internationales. Il est rare que les statistiques officielles incluent les composantes « financement » et « bénéfices réinvestis » des IDE sortants ainsi que les données sur les capitaux levés à l’étranger. De plus, elles ne tiennent généralement compte que des investissements d’ampleur et excluent les opérations de moyenne ou faible envergure.
De surcroît, dans les pays qui appliquent un contrôle strict des changes et des capitaux ou qui imposent lourdement les revenus des investissements, les investisseurs sont fortement incités à ne pas déclarer l’intégralité de leurs opérations. La surdéclaration des entrées d’IDE constitue un autre problème. On considère généralement que les statistiques sur les entrées d’IDE en Chine et en Russie par exemple sont gonflées par « l’aller et retour » de fonds nationaux transitant par des entreprises implantées à l’étranger. Du fait de l’existence de paradis fiscaux, il est difficile de mettre en rapport les statistiques sur les flux bilatéraux publiées par les autorités statistiques du pays d’accueil et celles publiées par les autorités statistiques du pays d’origine. Enfin, les critères retenus pour définir la nationalité des entreprises sont complexes : pour ne citer qu’un exemple, Mittal Steel, première entreprise sidérurgique du monde, est considérée par les médias comme une société indienne parce que son propriétaire et nombre de ses dirigeants sont indiens, alors qu’elle est immatriculée au Pays-Bas et a son siège à Londres.3
Tout en gardant ces réserves à l’esprit, il est possible d’effectuer une approximation relativement fiable à partir des données du FMI et de la CNUCED.4 En 2005, les pays en développement ont investi 133 milliards USD et ont été à l’origine de 17 % des sorties d’IDE environ. En excluant les IDE en provenance des centres financiers extraterritoriaux, les sorties d’IDE ont représenté 120 milliards USD au total, ce qui constitue un record historique. La valeur du stock d’IDE venant des économies émergentes (qui, ici, regroupent tous les pays dits « en développement » par les Nations Unies) a été estimée à 1.400 milliards USD en 2005, soit 13 % du stock mondial. Autre illustration de
38 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
cette tendance ascendante : alors qu’en 1990, seulement six économies émergentes affichaient un stock d’IDE sortants supérieur à 5 milliards USD, elles étaient 25 à dépasser ce seuil en 2005.
La proportion d’entreprises d’économies émergentes figurant dans les classements mondiaux des sociétés a également connu une hausse rapide, quelles que soient les données utilisées pour mesurer la taille des entreprises. Le nombre de sociétés du Fortune Global 500 dont le siège se situe en dehors de la Triade (économies de l’Atlantique Nord et Japon) et de l’Océanie est passé de 26 en 1988 à 61 en 2005. En avril 2006, le gazier russe Gazprom a devancé Microsoft et est devenu la troisième capitalisation boursière du monde. De même, la capitalisation boursière de China Mobile dépasse celle de la société de téléphonie mobile britannique Vodafone. En moins d’une décennie, Samsung est devenue l’une des 20 marques les plus valorisées du monde. Les multinationales des économies émergentes figurent en bonne place dans les classements sectoriels : Cemex et CVRD se sont respectivement classées au premier et quatrième rang des entreprises de leur secteur dans l’édition 2006 du Fortune Global 500. D’après les estimations, les multinationales des économies émergentes auraient réalisé un chiffre d’affaires total de 1 900 milliards USD en 2005 et employé quelque 6 millions de travailleurs. On trouve cinq multinationales d’économies émergentes (dont trois sont des entreprises publiques) parmi les 100 plus grandes entreprises du monde.
Toutefois, un écart important subsiste entre les multinationales des économies émergentes et les autres en termes de transnationalité, indice élaboré par la CNUCED pour évaluer l’ampleur et le degré des activités des multinationales à l’étranger. En 2004, les 100 premières multinationales des économies émergentes détenaient moins d’actifs à l’étranger que la société américaine General Electric à elle seule. Il ressort de la répartition géographique des activités des multinationales, qui constitue une autre dimension de la transnationalité, que les entreprises de pays en développement ont, en moyenne, des sociétés affiliées dans six pays, le plus souvent dans leur propre région. A contrario, les plus grandes entreprises multinationales des pays émergents ont, en moyenne, des sociétés affiliées dans 40 pays étrangers, situés dans diverses régions.
2.2. Tendances régionales : quelle est l’origine de la hausse de l’investissement ?
Dans beaucoup de régions, les flux d’IDE Sud-Sud sont particulièrement volumineux. Cette situation est la conséquence logique du fait que la plupart des stratégies adoptées par les entreprises pour leur expansion internationale sont en réalité régionales plutôt que mondiales à proprement parler. C’est pourquoi la
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 39
plupart des flux d’IDE bilatéraux concernent des pays proches géographiquement. Toutefois, les données sur l’IDE étant souvent de qualité médiocre et particulièrement lacunaires dans les pays en développement, le présent article se borne à décrire des grandes tendances et ne s’appuie pas sur des statistiques « précises » concernant les différents continents.
L’examen de la fraction des IDE sortants correspondant à des opérations transfrontières de fusion et acquisition offre un autre aperçu, certes incomplet, des tendances régionales. En retenant cette base de mesure, comme le montre le tableau 2.4., Singapour est le pays qui a le plus investi à l’étranger depuis 1990, tant en termes d’investissement Sud-Sud que d’investissement Sud-Nord. Le pays qui arrive en deuxième position (toujours du point de vue des fusions et acquisitions) est le Brésil, suivi par les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et Israël ; en règle générale, il ne s’agit donc pas de pays comme la Chine ou l’Inde, récemment décrits par le public et la presse comme « essayant de s’emparer » des actifs de valeur dans la zone OCDE. Après Singapour, les pays les plus dynamiques en termes d’investissement Sud-Sud sont la Chine, la Malaisie et l’Afrique du Sud.
Tableau 2.4. Dix premiers pays ciblés par les opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées par des entreprises non résidentes de l’OCDE
(de 1990 à mai 2007)
Rang Cible située dans la zone OCDE Cible située à l’extérieur de l’OCDE Pays
d’origine Montant des opérations (milliards
USD)
Part du groupe
(%)
Pays d’origine
Montant des opérations (milliards
USD)
Part du groupe
(%)
1 Singapour 36.0 14.5 Singapour 35.8 25.3 2 Brésil 32.1 13.0 Chine 18.3 12.9 3 Émirats
arabes unis 24.2 9.8 Malaisie 12.7 9.0
4 Afrique du Sud
20.1 8.1 Afrique du Sud
11.6 8.2
5 Israël 19.2 7.8 Émirats arabes unis
7.2 5.1
6 Égypte 18.1 7.3 Brésil 6.7 4.7 7 Arabie
saoudite 12.1 4.9 Chili 6.1 4.3
8 Russie 11.2 4.5 Inde 4.7 3.3 9 Malaisie 10.1 4.1 Qatar 4.7 3.3 10 Bahreïn 9.1 3.7 Russie 4.2 3.0 Note : seules les opérations évaluées à plus de 100 millions USD sont prises en compte.
Source : Thomson OneBanker.
40 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Les investisseurs des économies émergentes jouent un rôle particulièrement important en Afrique sub-saharienne, l’Afrique du Sud apparaissant depuis peu comme l’un des premiers pays d’origine de l’Afrique anglophone. La Chine et, dans une moindre mesure, le Brésil, l’Inde, la Malaisie et la Russie ont beaucoup investi dans le domaine des ressources naturelles, en particulier dans le Golfe de Guinée et au Soudan. Dans la région MENA, l’investissement des pays du Golfe dans le secteur des services a suivi une pente nettement ascendante. Ainsi, en Tunisie, Dubaï est devenu en 2006 le premier investisseur en termes de stock d’IDE en dehors du secteur de l’énergie, devant la France et l’Italie. Le rôle du Maroc au Sénégal mérite également d’être souligné.
Dans d’autres régions en développement qui ont attiré un volume considérable d’IDE de la part des pays de l’OCDE depuis le début des années 90, les flux Sud-Sud sont légèrement moins importants, tout en étant également en hausse. En Chine, en particulier, les quatre premiers investisseurs de l’Asieémergente (Hong Kong (Chine), Corée, Taipei chinois et Singapour) sont à l’origine de 41 % du montant des IDE réalisés en 2006, Hong Kong représentant, à elle seule, 29 %. À l’inverse, Hong Kong (Chine) et certains territoires comme les Îles Caïmanes ou les Îles Vierges britanniques ont été destinataires de 81 % du total des investissements sortants chinois (9.9 milliards USD), ce qui explique peut-être pourquoi ces destinations font, à leur tour, partie des principales sources d’investissement « étranger » revenant en Chine. À noter également que l’Amérique latine a pris la place de l’Asie en tant que premier bénéficiaire régional des investissements chinois.
D’après le ministère du commerce de la République populaire de Chine (MOFCOM), en excluant le secteur financier, les sorties d’IDE chinoises ont atteint 16.1 milliards USD en 2006, soit une hausse de 32 % par rapport à 2005. Fin 2006, les investissements directs à l’étranger de la Chine s’établissaient à 73.3 milliards USD en termes cumulés.5 En 2006, les opérations d’acquisition à l’étranger ont représenté environ 30 % des sorties d’IDE chinoises. Fin 2005, les investissements directs à l’étranger de la Chine avaient atteint 57.2 milliards USD en termes cumulés ; 81 % de cette somme provenait d’entreprises publiques directement gérées par la State Assets Supervision and Administration Commission. Les provinces côtières et frontalières ont été à l’origine de 62.5 % des sorties d’IDE chinoises. Toutefois, il est difficile d’effectuer des estimations exactes en raison de problèmes liés à la classification des flux à destination et en provenance de Hong Kong (Chine) et Macao.
Dans le reste de la région, les entrées d’IDE entre pays d’Asie représentent près de la moitié des entrées totales d’IDE de la région et sont particulièrement
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 41
importantes entre l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud-Est et au sein de ces deux régions.6 Certaines données montrent que l’IDE intra-ASEAN est en hausse. Près des trois cinquièmes des flux de l’Asie de l’Est vers l’Asie du Sud-Est étaient destinés aux économies ayant un revenu plus élevé que les autres, comme Singapour, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Singapour, en particulier, a attiré la moitié de l’IDE en provenance de l’Asie de l’Est et à destination de l’Asie du Sud-Est et les entreprises singapouriennes se distinguent en tant qu’investisseurs régionaux de premier plan. Le groupe thaïlandais Charoen Pokpand (CP) Group serait également le principal investisseur étranger en Chine.
En Europe centrale et orientale, trois tendances sous-jacentes se dégagent clairement. D’une part, les flux entre les nouveaux États membres de l’Union européenne (UE) ont augmenté à l’approche de l’adhésion et cette tendance s’accélère. Les entreprises d’économies émergentes non membres de l’UE, en particulier établies en Asie et en Amérique latine, ont également investi pour créer des entreprises nouvelles dans les pays d’Europe centrale et orientale afin d’accéder au marché européen. Deuxièmement, les flux d’IDE sont considérables entre les pays issus du démantèlement de l’Union soviétique et de la Yougoslavie. Dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), c’est la Russie qui est la première bénéficiaire des entrées d’IDE. Dans l’ex-République de Yougoslavie, certains secteurs se sont concentrés autour de multinationales slovènes, croates et serbes (la chaîne de commerce de détail Mercator en constitue une bonne illustration). Troisièmement, des entreprises russes ont réalisé d’importantes opérations dans des pays de l’OCDE, en particulier l’achat pour 2.3 milliards USD en numéraire de Oregon Steel Mills par Evraz. La Turquie a également beaucoup investi à l’échelle régionale, en particulier en Asie de l’Ouest et du Centre et en Russie.
En Amérique latine, les « translatinas », multinationales des économies émergentes qui réalisent des investissements directs à l’extérieur de leur pays d’origine, occupent une place de plus en plus importante, surtout depuis le milieu des années 90. Les investissements directs qu’elles réalisent représentent une part croissante du total de l’IDE en Amérique latine. En 2006, les sorties d’IDE des pays de la région ont représenté 40.6 milliards USD au total, un montant plus de deux fois supérieur à celui affiché en 2005.7 Le Brésil offre une excellente illustration de cette montée en puissance, ses sorties d’IDE (28 milliards USD en 2006) ayant dépassé ses entrées (18.8 milliards USD).
Néanmoins, l’intérêt médiatique que la montée en puissance de nouveaux géants originaires des pays émergents a suscité dans les pays de l’OCDE à haut revenu a été un peu disproportionné par rapport à l’ampleur réelle des flux en provenance de ces économies. Pour ne citer qu’un exemple, l’entreprise
42 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
néerlandaise Phillips emploie, à elle seule, plus de salariés américains que les entreprises originaires du Mexique (qui est, parmi les pays émergents, celui qui représente le plus grand nombre d’emplois aux États-Unis).8
Reste que cela ne doit pas faire oublier que ces nouveaux pays d’origine occupent une place de plus en plus importante. En France, d’après des estimations récentes, les investisseurs venant de Chine auraient été à l’origine de 17 projets et de la création de 1 388 emplois au cours de la période 2004-06, ce qui fait de la Chine le 12ième investisseur étranger de ce point de vue au cours de cette période.9 D’après un organisme londonien de promotion de l’investissement, l’Inde est aujourd’hui la deuxième source d’investissement direct étranger au Royaume-Uni, représentant 16 % des nouvelles entrées d’IDE entre 2003 et 2007. D’après les estimations du cabinet Jones Lang LaSalle, dans le secteur de l’hôtellerie, les investissements stratégiques réalisés par les investisseurs du Moyen-Orient ont représenté plus de 9 % de la valeur totale des transactions en Europe l’année dernière.
2.3. Tendances sectoriels : certains pans de l’économie sont-ils plus concernés que d’autres ?
Les multinationales des économies émergentes jouent un rôle actif dans la montée en puissance de l’IDE dans le secteur des services. En prenant les opérations transfrontières de fusion et acquisition comme indicateur des tendances de l’IDE en général, il apparaît, d’après le graphique 2.3 que depuis les années 90, au moins 44 % des IDE venant des économies émergentes (en ajoutant les statistiques des secteurs des télécommunications, des services financiers, de l’énergie et de l’électricité) avaient pour cibles des entreprises opérant dans le secteur des services. 19 % des IDE concernaient l’accès aux matières premières ou ciblaient des entreprises de traitement des matières premières. La suite de cette partie porte sur les données issues d’études sectorielles ciblées ou d’études spécifiques.
Dans le secteur des télécommunications, les IDE Sud-Sud occupent une place de plus en plus importante. Au cours de la période 2001-2003, ils ont représenté plus de 36 % du total des flux et près de 20 % du nombre total de projets contre seulement 23 % et 11 % respectivement au cours de la période 1990-1999.10
Concernant les services financiers, d’après les recherches de la Banque mondiale, 27 % des banques étrangères des pays en développement appartiennent à une banque établie dans un autre pays en développement, tandis que les banques des pays en développement possèdent 5 % des actifs étrangers.11 La présence des banques étrangères dans les pays en développement
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 43
est beaucoup plus importante (en termes tant de nombre de banques que de valeur des actifs) dans les pays à bas revenu ; en outre, les activités bancaires de ce type se caractérisent par une forte concentration régionale.
Graphique 2.3. Opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées par des entreprises non résidentes de l’OCDE, par secteur cible (1990-mai 2007)
Services et biensde consommation
9%
Énergie et électricité16%
Services financiers12%
Industrie et hautetechnologie
12%
Matières premières18%
Télécommunications16%
Autres17%
Source : Thomson OneBanker.
Le secteur des ressources naturelles suscite également un intérêt croissant car du fait du niveau record des prix mondiaux et de la forte liquidité des marchés financiers, des investissements dans des projets plus risqués que par le passé peuvent être viables. Dans le cas du pétrole, les recherches actuellement menées par le Centre de développement de l’OCDE et la Banque mondiale démontrent que les flux d’IDE ne sont pas seulement orientés Nord-Sud, mais aussi et de plus en plus, Sud-Nord et Sud-Sud.12
Enfin, dans le secteur manufacturier, les entreprises des économies émergentes occupent des positions de premier plan dans le secteur des biens industriels indifférenciés comme l’aluminium, les produits chimiques de base, le ciment, le papier et la pulpe et l’acier. Dans tous les cas, les IDE ont fortement facilité l’accès à de nouveaux marchés, soit parce qu’ils concernaient un produit difficile à transporter (comme le ciment) ou des marchés protégés par d’importantes barrières aux échanges (comme le marché de l’acier). Aujourd’hui, les multinationales des pays émergents ciblent également des secteurs plus complexes comme la construction automobile – ainsi, fin 2004, SAIC a pris une participation de 51 % dans le capital du constructeur automobile coréen SsangYong ; un an plus tard, Nanjing Autos a racheté MG Rover pour 53 millions GBP, et un magnat russe de l’aluminium passe une alliance avec l’entreprise canadienne Magna pour acheter le Groupe Chrysler,
44 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
en difficulté. Tenaris, entreprise argentine (bien qu’appartenant à une famille italienne et cotée à la bourse de New York) est, grâce à son avance technologique, le premier producteur mondial de tubes sans soudure.
2.4. Quels facteurs ont été à l’œuvre ?
La théorie selon laquelle l’investissement emprunte le chemin du développement (« investment development path » ou IDP) explique en partie l’internationalisation des entreprises des pays en développement : un pays n’entreprend d’investir à l’étranger qu’après avoir atteint un niveau de développement minimum. Selon l’IDP, les pays partent d’une première étape qui consiste à accueillir des investissements de l’étranger ; les entreprises locales finissent ainsi par posséder des actifs et autres avantages qui leur permettent de s’internationaliser, et dans une dernière étape, le pays devient un investisseur à l’étranger majeur.
Toutefois, certaines données prouvent que les entreprises multinationales des économies émergentes investissent à une étape antérieure de l’IDP, notamment parce qu’elles n’ont pas les moyens d’attendre, du fait que le renforcement de la mondialisation entraîne une concurrence intense dans leur pays et sur les marchés à l’exportation.13 Il arrive aussi que les pays émergents ou les entreprises de ces pays puissent également, dans certains secteurs, se forger des avantages comparatifs par rapport à d’autres pays ou entreprises – qu’il s’agisse d’un brevet, d’une marque reconnue, de la capacité d’accéder à certaines ressources, de la connaissance de la culture ou de la langue. Ainsi, pour leurs investissements régionaux, en particulier à destination d’autres pays en développement (IDE Sud-Sud), les multinationales des économies émergentes ont, dans le secteur des services, des avantages comparatifs vis-à-vis de leurs concurrentes de l’hémisphère nord du fait que dans ce secteur, une proximité entre le producteur et le consommateur ainsi que des similitudes linguistiques et culturelles sont souvent nécessaires. Ce phénomène explique que l’opérateur mexicain América Movil, l’opérateur Orascom et l’opérateur sud-africain MTN, qui sont tous les trois des géants des télécommunications de l’hémisphère sud, livrent, dans leurs régions, une concurrence sans merci aux opérateurs de l’hémisphère nord.
Dans le secteur manufacturier, la spécialisation de la production a créé des avantages comparatifs pour de nombreuses entreprises de pays en développement. Ainsi, Marcopolo, constructeur brésilien d’autobus, a mis au point un système de production flexible pour produire des autobus sur mesure, et l’a exporté dans d’autres pays d’Amérique latine et au Portugal. De même, la capacité de l’entreprise jordanienne Hikma à produire des produits pharmaceutiques peu onéreux, variés et de bonne qualité lui a permis d’étendre
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 45
ses activités à d’autres pays arabes et à d’autres régions. Dans le secteur primaire, l’accès aux ressources dont bénéficient les entreprises les a aidées à accéder au financement et à accroître leur échelle de production pour étendre leurs activités à l’étranger.
À défaut d’avantages comparatifs suffisants, l’internationalisation des entreprises peut également passer par l’acquisition d’actifs « stratégiques » (en général par le biais d’opérations de fusion et acquisition14), tels que technologie, marques et réseaux de distribution (augmentation des actifs). Dans un contexte marqué par l’intensification de la concurrence sur les marchés à l’intérieur et à l’extérieur des frontières en raison de la mondialisation et des avancées technologiques qui peuvent éroder les avantages comparatifs, les fusions et acquisitions transfrontières constituent une composante importante de la stratégie des entreprises aussi bien dans les pays développés que dans le monde en développement. Pour s’internationaliser, les entreprises des pays en développement associent ces deux stratégies. Ainsi, Orascom Telecom a investi massivement dans les pays voisins dans le cadre d’une stratégie d’exploitation des actifs et est devenu un opérateur de télécommunication de premier plan en Afrique et au Moyen-Orient, ce qui ne l’a pas empêché, en parallèle, d’augmenter ses actifs en acquérant l’entreprise italienne Wind.
3. Délocalisation, externalisation et mondialisation
La peur qu’éprouve la population d’économies plus matures à l’idée que la progression des échanges et de l’investissement international risque d’entraîner le transfert d’emplois nationaux vers des pays à bas coûts est un thème récurrent du débat sur la mondialisation. Jusqu’à une période récente, ce débat portait essentiellement sur les emplois non qualifiés, puisqu’il s’agissait du domaine dans lequel les pays en développement étaient censés être particulièrement compétitifs ; toutefois, la montée en puissance récente des activités à forte intensité de compétences dans les économies émergentes et en développement (phénomène évoqué plus précisément dans un autre article de cette publication) a élargi le débat aux secteurs à forte intensité technologique et à celui des services. Cette partie recense certains des indicateurs de l’évolution du rôle des filiales étrangères des multinationales dans la chaîne de valeur des entreprises.
Premièrement, le débat sur les activités des multinationales à l’étranger pâtit souvent de la confusion entre deux termes très utilisés : délocalisation et externalisation. L’externalisation n’a pas systématiquement une dimension internationale : elle implique simplement que les biens et services utilisés sont produits à l’extérieur de l’entreprise. Ainsi, la stratégie adoptée ces dernières décennies par beaucoup d’entreprises industrielles, qui rationalisent leurs chaînes de valeur en cessant de fournir en interne des services accessoires
46 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
(transport, information et communication, services), constitue un exemple d’externalisation nationale.
Il y a délocalisation lorsqu’une entreprise transfère une partie de sa chaîne de valeur à l’étranger. Les activités économiques peuvent être délocalisées au sein de filiales de l’entreprise ou d’unités de production sans lien avec l’entreprise (auquel cas, il y a à la fois externalisation et délocalisation). En réalité, certains investissements réalisés récemment dans le secteur de la haute technologie – y compris par le secteur des technologies de l’information et de la communication dans les pays émergents – étaient à la fois des opérations de délocalisation et d’internalisation, parce que les multinationales qui ont investi ont choisi de créer des filiales étrangères pour produire des services qu’elles achetaient auparavant auprès de prestataires indépendants. Une récente étude du Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreuneuriat de l’OCDE, sur laquelle est basée cette partie, fournit des données détaillées sur l’ampleur et les conséquences économiques des délocalisations (encadré 2)15.
L’un des aspects les plus intéressants de l’étude est le calcul d’indices de délocalisation, consistant en moyennes pondérées de la part de certaines catégories de biens intermédiaires achetée à des entreprises établies à l’étranger, dans certains secteurs. Les calculs sont effectués à partir de tableaux entrées-sorties. En conséquence, alors qu’il est en principe possible d’établir l’origine étrangère des biens intermédiaires achetés, il est, dans la pratique, très difficile de faire une distinction claire entre les fournisseurs liés à l’entreprise et ceux qui en sont indépendants.16 Le graphique 2.4 présente, par grandes familles de biens intermédiaires et pour le secteur manufacturier et celui des services, les indices de délocalisation affichés par un certain nombre de pays en 2000.
Le graphique montre, d’une part que la délocalisation de la production de biens manufacturés est fréquente. Dans le secteur manufacturier lui-même, la plupart des pays achètent plus d’un cinquième de biens manufacturés intermédiaires à l’étranger. Dans la majorité des pays, le secteur des services arrive en deuxième position en ce qui concerne l’achat à l’étranger de biens manufacturés. Font notamment exception à cette règle les Pays-Bas et l’Allemagne. Les chiffres révèlent également que la taille d’un pays a une forte incidence sur ses pratiques en matière d’externalisation : comme on pouvait s’y attendre, les entreprises de petits pays à l’économie ouverte, comme l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas, sont beaucoup plus susceptibles de se tourner vers des fournisseurs étrangers (à raison de 35 à 45 % dans le secteur manufacturier) que des pays comme les États-Unis et le Japon.
La délocalisation suit une courbe ascendante. Une comparaison de l’indice global d’externalisation à l’étranger en 2000 et en 1995 dans 13 pays de
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 47
l’OCDE plus la Chine révèle que tous les pays, sauf la France, tendent à avoir de plus en plus recours à l’externalisation à l’étranger (graphique 2.5). Cette hausse a été particulièrement marquée en Autriche, Allemagne et Espagne, pays qui ont subi d’importantes restructurations industrielles à la fin des années 90. À noter, que les entreprises chinoises sont déjà presque aussi nombreuses que leurs concurrentes japonaises et américaines à externaliser à l’étranger.
Encadré 2.2. Nouvelle publication de l’OCDE : les délocalisations et l’emploi : tendances et impacts
L’impact des délocalisations sur le marché du travail est devenu un sujet de préoccupation majeur pour les décideurs et l’opinion publique. Ce phénomène, qui n’est pas réellement nouveau, suscite des inquiétudes parce que désormais, il ne concerne plus seulement l’industrie manufacturière et les emplois peu qualifiés, mais touche aussi les services, en particulier les services aux entreprises. Récemment, des emplois plus qualifiés ont également été affectés par des délocalisations.
Dans ce contexte, quelle est l’ampleur du phénomène de délocalisation et combien d’emploi touche-t-il ?
Quels sont les principaux motifs de délocalisation et quelles sont les catégories d’emplois, les secteurs et les pays les plus touchés ?
Quelles sont les retombées positives des délocalisations et comment les évaluer ?
Quelles réponses et mesures pourrait-on proposer pour faciliter les ajustements et restaurer la confiance ?
C’est à ces questions que cette nouvelle publication tente de répondre. Elle décrit les principales motivations des délocalisations et présente les derniers développements théoriques sur les échanges, les délocalisations et l’emploi. Elle souligne ensuite les difficultés rencontrées pour quantifier les emplois touchés par les délocalisations et présente des résultats, afin, d’une part d’identifier des cas de délocalisation, puis d’en mesurer les effets sur l’emploi. Plusieurs retombées positives des délocalisations sont également quantifiées. Le dernier chapitre recense les politiques et mesures réglementaires en vigueur pour contrer les délocalisations et définit les mesures qui pourraient être prises pour réduire les coûts de l’ajustement et restaurer la confiance.
D’après le graphique 2.4., la délocalisation semble très limitée dans le secteur des services – en dépit de la forte médiatisation dont font l’objet les centres d’appel et le développement de logiciels en Afrique du Sud. Toutefois, si elle part d’un niveau bas, cette pratique monte rapidement en puissance et concerne de plus en plus des activités technologiques, de la haute à la moyenne technologie.
48 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Graphique 2.4. Indice d’externalisation à l’étranger de quelques pays de l’OCDE, 2000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Indice d'externalisation à l'étranger des biens par le secteur manufacturier
Indice d'externalisation à l'étranger des biens par le secteur des services
Indice d'externalisation à l'étranger des services par le secteur manufacturier
Indice d'externalisation à l'étranger des services par le secteur des services
Source : OCDE (2007) Les délocalisations et l’emploi : Tendances et impacts
Graphique 2.5. Indice d’externalisation à l’étranger des biens, 1995 et 2000
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Japon
Etats-Unis
Chine
Italie
Allemagne
France
Espagne
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Pays-Bas
Belgique
2000 1995
Source : OCDE (2007) Les délocalisations et l’emploi : Tendances et impacts.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 49
Notes
1. Cette partie a été rédigée à partir de Goldstein, A. (2007), Multinational Companies from Emerging Economies. Composition, Conceptualization and Direction in the Global Economywww.palgrave.com/products/Catalogue.aspx?is=023000704X, et de recherches complémentaires effectuées avec Dilek Aykut de la Banque mondiale.
2. Les marchés émergents regroupent à la fois des pays de l’OCDE, comme la République tchèque, la Hongrie, la Corée, le Mexique, la Pologne et la Turquie et des économies non membres, comme l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, l’Égypte, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, Israël, la Jordanie, la Malaisie, le Maroc, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, la Russie, l’Afrique du Sud, le Taipei chinois et la Thaïlande.
3. Bien que Bunge & Born (devenue Bunge) soit souvent citée comme l’une des premières sociétés argentines à investir à l’étranger, sa nationalité est difficile à déterminer. Depuis sa création, elle a changé de siège à plusieurs reprises. Fondée aux Pays-Bas en 1818, elle a rapidement été transférée en Belgique, puis en Argentine. C’est dans ce pays qu’elle a réellement connu son expansion et est devenue l’une des premières entreprises de commercialisation de produits agricoles du monde. Elle a aussi été l’une des premières entreprises établies en Argentine à investir à l’étranger. Dans les années soixante-dix, l’instabilité politique qui régnait dans le pays a motivé un nouveau transfert, cette fois au Brésil. 10 ans plus tard, Bunge & Born s’est diversifiée dans de nombreuses activités situées en amont et en aval de la chaîne de production alimentaire sur l’ensemble du continent américain. En 1999, après avoir subi une profonde restructuration et s’être recentrée sur son cœur de métier (agriculture), l’entreprise a de nouveau changé de « nationalité » : elle a installé son siège à New York, et y a été cotée en bourse en 2001. Il est donc difficile de déterminer si cette entreprise est toujours argentine et d’évaluer les implications locales potentielles de sa transnationalisation. (Source : Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (2007), Foreign Investment in Latin America and the Caribbean.)
4. CNUCED (2006), Rapport sur l’investissement dans le monde.
5. Les sorties totales d’IDE de la Chine ont atteint 12.3 millards USD, faisant un bond de 123 % par rapport à 2004 et franchissant pour la première la barre des 10 milliards USD par an.
6. Voir ICRIER International Workshop on Intra-Asian FDI Flows, Delhi, 25-26 avril 2007, http://www.icrier.org/conference/2007/26april07.html.
50 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
7. Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (2007), Foreign Investment in Latin America and the Caribbean.
8. Mira Wilkins (2005), « Dutch Multinational Enterprises in the United States: A Historical Summary », Business History Review, vol. 79, n° 2 et Bureau of Economic Analysis (2006), Foreign Direct Investment in the United States. Final Results from the 2002 Benchmark Survey.
9. Agence Francaise pour l’Investissement International (AFII).
10. Guislain, Pierre et Christine Zhen-Wei Qiang (2006), « Foreign Direct Investment in Telecommunications in Developing Countries », in Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies, Banque mondiale, Washington, DC.
11. Van Horen, Neeltje (2007), « Foreign Banking in Developing Countries: Origin Matters », Emerging Markets Review, vol. 8, n° 2: 81-105.
12. Aykut, Dilek et Andrea Goldstein (2007), “FDI in the Oil Sector”, à usage interne, Groupe des perspectives de développement de la Banque mondiale (DECPG) et Centre de développement de l’OCDE.
13. Bonaglia, Federico, Andrea Goldstein et John Mathews (2007), « Accelerated Internationalization by Emerging Multinationals: The Case of White Goods », Journal of World Business, à paraître.
14. Selon la CNUCED, entre 1987 et 2005, la part des économies émergentes dans les opérations transfrontières de fusion et acquisition est passée de 4 % à 13 % en valeur et de 5 % à 17 % en termes de nombre d’opérations.
15. OCDE (2007), Les délocalisations et l’emploi : Tendances et impacts, Paris.
16. L’étude en question utilise le terme « indice d’externalisation à l’étranger ». Toutefois, comme il n’est pas possible de distinguer formellement les fournisseurs liés à l’entreprise de ceux qui ne le sont pas, un terme plus général a été retenu dans le présent article.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 51
ANNEXE 2.A1
STATISTIQUES D'INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER
52PE
RSP
EC
TIV
ES
D'IN
VE
STIS
SEM
EN
T I
NT
ER
NA
TIO
NA
L 2
007
– IS
BN
- 97
8-92
-64-
0375
8-8
© O
EC
D 2
007
Tab
leau
2.A
1.1
Inve
stis
sem
ent
dir
ect
à l'é
tran
ger
des
pay
s d
e l'O
CD
E :
so
rtie
s
Mill
ions
de
dolla
rs E
U
1990
19
91
1992
19
93
1994
19
95
1996
19
97
1998
19
99
2000
20
01
2002
20
03
2004
20
05p
2006
e
Alle
mag
ne
2423
1.9
2294
7.0
1859
5.1
1719
6.1
1885
7.8
3905
1.6
5080
6.3
4179
4.1
8883
7.2
1086
91.6
5656
7.5
3969
1.1
1896
3.5
5827
.014
836.
755
480.
679
466.
4
Aus
tral
ie
992.
311
99.4
5266
.919
47.0
2816
.532
81.8
7087
.664
27.9
3344
.8-4
20.7
3158
.511
962.
078
52.1
1618
4.9
1079
9.7
-342
88.5
2098
7.1
Aut
rich
e 16
27.2
1285
.316
97.5
1190
.512
57.2
1130
.619
35.0
1988
.227
45.2
3300
.757
40.9
3137
.958
12.0
7143
.083
05.4
1001
7.4
4089
.4
Bel
giqu
e 0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
012
705.
436
932.
934
037.
831
761.
162
586.
9
Bel
giqu
e /
Lux
embo
urg
59
56.0
6066
.210
955.
938
50.5
1205
.411
728.
478
11.3
7884
.529
107.
813
2325
.821
8364
.410
0624
.70.
00.
00.
00.
00.
0
Can
ada
52
35.2
5832
.335
89.2
5699
.992
93.5
1146
2.3
1309
4.3
2305
9.2
3434
9.2
1725
0.1
4467
8.5
3603
7.2
2676
1.1
2152
6.0
4324
7.8
3408
4.3
4213
4.4
Cor
ée
1051
.614
88.6
1161
.513
40.0
2461
.135
52.0
4670
.144
49.4
4739
.541
97.8
4998
.924
20.1
2616
.534
25.5
4657
.942
98.1
7128
.7
Dan
emar
k 16
18.2
2051
.822
36.0
1260
.539
55.1
3063
.525
19.1
4206
.644
76.6
1643
3.9
2309
3.2
1337
6.1
5694
.911
23.9
-103
70.7
1502
6.4
8194
.5
Esp
agne
34
41.7
4424
.421
71.0
3173
.641
10.8
4157
.855
90.1
1254
6.8
1893
7.7
4438
3.5
5822
4.0
3311
2.6
3274
4.0
2874
4.9
6056
6.5
4180
4.5
8972
8.3
Eta
ts-U
nis
3718
3.0
3788
9.0
4826
6.0
8395
0.0
8016
7.0
9875
0.0
9188
5.0
1048
03.0
1426
44.0
2249
34.0
1592
12.0
1423
49.0
1544
60.0
1498
97.0
2441
28.0
9072
.024
8856
.0
Finl
ande
27
08.5
-124
.0-7
51.7
1407
.142
97.8
1497
.335
96.5
5291
.718
641.
566
15.5
2403
4.7
8372
.073
77.8
-228
1.6
-108
0.1
4474
.78.
9
Fran
ce
3622
8.4
2513
7.6
3040
7.1
1973
6.1
2437
2.3
1575
8.1
3041
9.5
3558
0.9
4861
2.7
1268
59.2
1774
81.6
8678
3.3
5048
6.1
5319
7.0
5676
2.3
1208
91.1
1151
01.0
Grè
ce
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-275
.655
2.1
2136
.561
6.1
655.
341
2.6
1029
.714
50.0
4169
.2
Hon
grie
0.
00.
00.
010
.648
.359
.1-3
.646
1.9
278.
325
0.1
620.
236
8.1
278.
116
44.0
1119
.423
27.4
3015
.4
Irla
nde
364.
719
2.6
214.
421
7.8
436.
381
9.8
727.
910
13.7
3902
.161
09.1
4629
.640
66.1
1103
5.2
5554
.718
079.
313
559.
522
113.
7
Isla
nde
11.5
28.6
6.3
14.3
23.7
24.8
63.4
56.0
74.1
123.
139
2.6
341.
832
0.0
373.
225
53.1
7063
.241
59.9
Ital
ie
7611
.773
25.9
5948
.572
30.6
5108
.857
31.4
6464
.912
244.
716
077.
667
21.7
1231
8.5
2147
5.9
1713
8.3
9079
.319
273.
241
794.
742
059.
7
Japo
n 50
772.
131
687.
017
301.
613
915.
318
117.
022
627.
823
419.
425
990.
924
154.
622
746.
531
538.
538
348.
732
280.
128
798.
530
963.
545
830.
250
244.
1
Lux
embo
urg
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
012
5945
.199
861.
484
088.
512
3955
.381
552.
3
Mex
ique
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
044
04.0
890.
812
53.5
4431
.964
74.0
5758
.5
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
ÉD
ITIO
N 2
007
– IS
BN
978
-92-
64-0
3758
-8 -
© O
CD
E 2
007
53
1990
19
91
1992
19
93
1994
19
95
1996
19
97
1998
19
99
2000
20
01
2002
20
03
2004
20
05p
2006
e
Nor
vège
14
31.5
1823
.639
4.2
933.
021
72.5
2856
.258
92.5
5015
.332
00.7
5503
.686
20.5
538.
646
22.1
2655
.235
26.0
2105
5.7
1222
9.4
Nou
velle
-Z
élan
de
2360
.714
72.4
391.
4-1
388.
720
08.2
1783
.5-1
239.
7-1
565.
540
1.4
1072
.560
8.7
407.
7-1
133.
019
5.0
1082
.8-3
15.3
-164
0.5
Pay
s-B
as
1366
0.6
1282
5.9
1269
7.1
1006
3.3
1755
3.8
2017
5.5
3209
8.1
2452
2.1
3647
5.1
5761
1.3
7564
8.7
5060
2.3
3204
6.0
4407
5.9
2658
5.9
1428
39.9
2270
4.9
Polo
gne
0.0
0.0
13.2
18.2
29.0
42.1
53.1
45.2
316.
231
.017
.0-8
8.8
228.
630
5.0
769.
730
69.6
4134
.0
Port
ugal
16
4.8
473.
668
4.2
107.
328
2.5
684.
672
8.8
2092
.040
28.5
3191
.481
33.6
6262
.7-1
49.2
8035
.278
49.7
2077
.235
09.5
Rép
ubliq
ue
slov
aque
0.
00.
00.
012
.817
.743
.062
.995
.114
6.6
-377
.228
.764
.511
.213
.315
2.1
146.
436
9.0
Rép
ubliq
ue
tchè
que
0.0
0.0
0.0
90.2
119.
636
.615
2.9
25.2
127.
189
.842
.816
5.4
206.
520
6.7
1014
.4-1
8.7
1344
.7
Roy
aum
e-U
ni
1795
3.8
1641
2.1
1774
0.9
2606
3.1
3220
5.7
4356
0.0
3405
5.9
6162
0.0
1228
61.2
2014
36.7
2334
87.7
5888
5.2
5034
6.5
6243
9.3
9108
2.8
8369
2.1
7947
0.0
Suè
de
1474
8.2
7057
.640
8.7
1357
.767
01.1
1121
4.3
5024
.812
647.
524
379.
421
928.
640
976.
473
28.2
1059
6.3
2112
0.7
2075
7.6
2654
3.9
2414
6.2
Suis
se
6708
.462
11.6
6049
.287
64.5
1079
7.2
1221
4.0
1615
0.4
1774
7.7
1876
8.8
3326
4.3
4469
8.0
1832
6.1
8212
.415
443.
426
287.
254
177.
981
547.
0
Tur
quie
-1
6.0
27.0
65.0
14.0
49.0
113.
011
0.0
251.
036
7.0
645.
087
0.0
497.
017
5.0
499.
085
9.0
1078
.093
4.0
Tot
al O
CD
E
2360
46.2
1937
35.4
1855
09.4
2081
75.3
2484
65.0
3154
19.1
3431
76.3
4102
95.2
6517
19.3
1045
470.
912
4032
2.1
6904
75.6
6191
78.5
6236
86.4
8073
96.8
8694
22.6
1120
102.
7
Not
es :
les
donn
ées
sont
con
vert
ies
en d
olla
rs s
ur la
bas
e du
taux
de
chan
ge m
oyen
. p :
chiff
res
prov
isoi
res
; e :
estim
atio
ns.
Sou
rce
: Bas
e de
don
nées
sur
l'in
vest
isse
men
t dire
ct in
tern
atio
nal d
e l'O
CD
E.
54PE
RSP
EC
TIV
ES
D'IN
VE
STIS
SEM
EN
T I
NT
ER
NA
TIO
NA
L 2
007
– IS
BN
- 97
8-92
-64-
0375
8-8
© O
EC
D 2
007
Tab
leau
2.A
1.2
Inve
stis
sem
ent
dir
ect
de
l'étr
ang
er d
ans
les
pay
s d
e l'O
CD
E :
en
trée
s
Mill
ion
s d
e d
olla
rs E
U
1990
19
91
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20
00
2001
2002
2003
2004
2005
p20
06e
Alle
mag
ne
2962
.0
4729
.3
-208
8.9
368.
371
33.9
1202
5.4
6572
.812
243.
424
596.
756
077.
3 19
8313
.026
419.
053
570.
832
398.
3-9
201.
335
844.
942
891.
4
Aus
tral
ie
8115
.8
4302
.1
5719
.842
81.7
5024
.611
963.
261
11.0
7633
.460
02.6
3268
.4
1394
9.9
8297
.116
996.
179
81.2
3596
3.4
-349
67.2
2454
6.8
Aut
rich
e 65
0.9
351.
3 14
32.7
1136
.521
02.9
1904
.244
28.6
2655
.645
34.1
2974
.6
8841
.759
20.5
357.
071
50.9
3892
.490
39.3
248.
5
Bel
giqu
e 0.
0 0.
0 0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
0 0.
00.
015
640.
532
127.
243
583.
133
949.
871
518.
8
Bel
giqu
e /
Luxe
mbo
urg
75
16.0
89
19.4
10
957.
310
467.
883
13.2
1089
4.2
1392
4.4
1651
0.1
3014
6.9
1425
12.3
22
0987
.884
717.
60.
00.
00.
00.
00.
0
Can
ada
75
80.3
28
80.0
47
21.6
4730
.382
04.1
9255
.496
32.6
1152
2.0
2280
2.8
2474
7.2
6679
5.5
2766
9.9
2214
5.9
7618
.515
33.2
3382
3.6
6660
5.0
Cor
ée
788.
5 11
79.8
72
8.3
588.
180
9.0
1775
.823
25.4
2844
.254
12.3
9333
.4
9283
.435
27.7
2392
.335
25.5
9246
.263
09.0
3645
.0
Dan
emar
k 12
06.7
14
59.9
10
14.7
1669
.048
97.6
4179
.876
8.0
2798
.677
25.7
1465
7.1
3130
5.8
1152
5.3
6633
.425
97.1
-107
21.4
1310
8.5
7033
.5
Esp
agne
13
838.
6 12
445.
2 13
350.
795
71.6
9275
.862
85.1
6820
.663
87.8
1179
8.4
1874
3.9
3958
2.4
2834
7.0
3924
8.7
2584
3.9
2477
4.5
2500
5.2
2002
6.9
Eta
ts-U
nis
4849
4.0
2317
1.0
1982
3.0
5136
2.0
4612
1.0
5777
6.0
8650
2.0
1056
03.0
1790
45.0
2894
44.0
32
1274
.016
7021
.084
372.
063
961.
013
3162
.010
9754
.018
3571
.0
Fin
land
e 78
7.5
-246
.6
406.
286
4.4
1577
.710
62.9
1109
.021
15.8
1214
0.7
4610
.2
8835
.637
32.2
8053
.233
22.1
3004
.945
03.9
3707
.5
Fra
nce
15
612.
6 15
170.
9 17
849.
216
442.
715
574.
023
679.
121
959.
523
171.
530
984.
546
545.
9 43
258.
450
485.
149
078.
742
538.
432
585.
481
006.
781
120.
9
Grè
ce
1688
.4
1718
.1
1588
.612
43.6
1166
.111
97.7
1196
.410
88.6
72.1
561.
5 11
08.1
1589
.450
.312
76.4
2102
.660
6.1
5366
.4
Hon
grie
31
2.1
1474
.4
1477
.224
46.2
1143
.551
01.9
3300
.441
70.9
3337
.133
13.1
27
63.0
3936
.029
93.6
2137
.545
08.2
7620
.960
97.4
Irla
nde
622.
6 13
60.8
14
58.1
1068
.585
6.2
1441
.526
15.7
2709
.688
56.3
1821
1.2
2578
4.2
9652
.729
350.
022
802.
8-1
0613
.7-3
1113
.612
817.
9
Isla
nde
22.0
18
.2
-12.
70.
4-1
.59.
283
.114
7.9
147.
866
.6
170.
517
2.6
90.9
327.
965
3.8
3074
.732
33.4
Italie
63
43.4
24
81.5
32
10.8
3751
.422
35.6
4816
.235
34.9
4962
.542
79.8
6911
.4
1337
7.3
1487
3.4
1455
8.2
1643
0.2
1682
4.5
1995
9.0
1658
7.2
Japo
n 18
05.9
12
86.2
27
55.2
210.
588
8.2
41.5
227.
932
24.0
3192
.812
743.
0 83
17.7
6243
.892
39.2
6324
.078
18.8
2778
.4-6
502.
8
Luxe
mbo
urg
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
011
5276
.189
290.
179
126.
111
6303
.797
013.
2
Mex
ique
26
33.0
47
61.5
43
93.0
4389
.015
069.
196
78.8
1008
6.7
1416
4.8
1240
8.6
1363
1.2
1758
7.8
2715
0.9
1827
4.7
1418
3.8
2230
0.9
1964
2.7
1903
7.4
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
ÉD
ITIO
N 2
007
– IS
BN
978
-92-
64-0
3758
-8 -
© O
CD
E 2
007
55
1990
19
91
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20
00
2001
2002
2003
2004
2005
p20
06e
Nor
vège
11
76.7
-4
8.9
810.
414
60.7
2777
.624
08.0
3168
.539
46.4
4353
.770
61.7
69
07.7
2232
.066
9.6
3701
.025
46.6
6392
.216
35.1
Nou
velle
-Z
élan
de
1683
.1
1695
.6
1089
.222
11.6
2615
.728
49.7
3922
.019
17.2
1825
.594
0.4
1344
.445
90.4
-125
1.3
2040
.628
50.7
3140
.515
70.4
Pay
s-B
as
1051
6.2
5778
.9
6169
.464
43.1
7158
.412
306.
816
660.
111
136.
536
924.
941
206.
1 63
865.
651
936.
825
060.
321
063.
021
24.5
4143
1.8
4373
.0
Pol
ogne
84
.0
359.
2 67
8.0
1715
.918
74.8
3658
.144
99.7
4913
.863
68.0
7275
.8
9446
.156
96.6
4121
.248
67.0
1248
4.0
9542
.413
859.
8
Por
tuga
l
2255
.4
2291
.6
1903
.815
16.2
1254
.666
0.1
1343
.823
61.7
3004
.711
56.8
66
36.5
6231
.818
00.8
8600
.923
28.2
3962
.573
74.7
Rép
ubliq
ue
slov
aque
0.
0 0.
0 0.
017
9.1
272.
924
1.4
395.
723
0.6
706.
842
8.5
2383
.115
84.1
4126
.559
3.8
1107
.519
07.2
4232
.1
Rép
ubliq
ue
tchè
que
0.0
0.0
0.0
653.
486
8.3
2561
.914
28.2
1301
.137
16.4
6326
.2
4980
.256
44.6
8483
.521
08.7
4975
.011
654.
459
63.1
Roy
aum
e-U
ni
3047
0.7
1484
9.2
1547
4.8
1482
1.3
9254
.619
968.
424
441.
333
244.
974
348.
987
972.
8 11
8823
.852
650.
224
051.
916
845.
956
002.
219
3657
.513
9565
.7
Suè
de
1971
.4
6355
.8
41.0
3845
.163
49.7
1444
6.9
5436
.610
967.
419
842.
760
963.
7 23
430.
510
905.
112
156.
649
90.1
1166
8.7
1017
0.1
2783
6.6
Sui
sse
5484
.6
2643
.3
411.
4-8
3.1
3367
.722
24.0
3078
.466
41.9
8942
.111
714.
4 19
266.
088
59.0
6283
.816
505.
313
72.7
-126
3.0
2510
1.4
Tur
quie
68
4.0
810.
0 84
4.0
636.
060
8.0
885.
072
2.0
805.
094
0.0
783.
0 98
2.0
3352
.011
37.0
1752
.028
83.0
9801
.020
165.
0
Tot
al O
CD
E
1753
06.5
1221
97.7
1162
06.7
1479
91.3
1667
93.1
2252
98.5
2462
95.4
3014
20.1
5284
57.9
8941
81.6
1289
602.
163
4963
.857
4961
.646
4905
.249
0886
.774
6646
.091
0242
.2
Not
es :
les
donn
ées
sont
con
vert
ies
en d
olla
rs s
ur la
bas
e du
taux
de
chan
ge m
oyen
. p :
chiff
res
prov
isoi
res
; e :
estim
atio
ns.
Sou
rce
: Bas
e de
don
nées
sur
l'in
vest
isse
men
t dire
ct in
tern
atio
nal d
e l'O
CD
E.
56PE
RSP
EC
TIV
ES
D'IN
VE
STIS
SEM
EN
T I
NT
ER
NA
TIO
NA
L 2
007
– IS
BN
- 97
8-92
-64-
0375
8-8
© O
EC
D 2
007
Tab
leau
2.A
1.3
Inve
stis
sem
ent
dir
ect
à l'é
tran
ger
des
pay
s d
e l'O
CD
E :
en
cou
rs d
es s
ort
ies
Mill
ions
de
dolla
rs E
U
19
90
1991
19
92
1993
19
94
1995
19
96
1997
19
98
1999
20
00
2001
20
02
2003
20
04
2005
p 20
06e
Alle
mag
ne
1307
60.3
1505
17.4
1547
41.3
1623
65.0
1945
23.4
2331
07.4
2486
34.1
2962
74.9
3651
95.7
4128
81.3
4867
49.8
5510
83.1
6027
80.0
7207
18.3
8106
21.7
8013
51.5
9403
63.0
Aus
tral
ie
3049
4.9
3089
7.0
3455
9.6
4050
3.6
4778
6.3
5300
9.0
6685
7.9
7196
8.4
7864
7.9
8958
3.6
8538
5.3
1096
88.2
1148
47.6
1618
86.8
2041
96.9
1783
35.2
2261
71.4
Aut
rich
e 47
46.9
5993
.665
84.5
7974
.295
14.1
1183
2.0
1305
9.8
1401
1.4
1746
8.4
1912
7.3
2481
9.9
2851
0.6
4248
3.2
5596
1.0
6778
5.0
6818
6.7
8033
7.0
Bel
giqu
e 0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
0
Bel
giqu
e /
Luxe
mbo
urg
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
0
Can
ada
84
812.
794
387.
487
867.
392
469.
110
4308
.011
8106
.113
2321
.915
2959
.317
1784
.720
1446
.823
7646
.925
0691
.027
5711
.331
8973
.537
3008
.539
4681
.044
9009
.4
Cor
ée
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1996
7.0
2073
4.5
2498
6.4
0.0
0.0
0.0
Dan
emar
k 0.
015
612.
016
305.
715
799.
219
613.
724
702.
527
601.
628
127.
738
836.
851
376.
073
074.
278
236.
286
696.
810
2586
.912
3146
.612
7101
.115
0110
.0
Esp
agne
0.
00.
022
046.
824
014.
330
044.
836
547.
341
999.
653
035.
274
109.
411
8042
.916
7717
.919
1648
.923
3937
.329
2464
.337
0931
.137
2943
.850
7970
.1
Eta
ts-U
nis
6166
55.0
6433
64.0
6638
30.0
7235
26.0
7865
65.0
8855
06.0
9898
10.0
1068
063.
011
9602
1.0
1414
355.
015
3160
7.0
1693
131.
018
6704
3.0
2059
850.
023
9922
4.0
2453
933.
00.
0
Fin
land
e 11
227.
310
845.
385
64.6
9178
.212
534.
014
993.
217
666.
020
297.
529
405.
933
850.
352
108.
752
224.
463
930.
776
049.
785
022.
581
368.
690
877.
5
Fra
nce
11
0120
.612
9900
.515
6326
.615
8750
.318
2331
.820
4430
.323
1112
.823
7248
.928
8035
.933
4102
.944
5087
.050
8842
.058
6306
.672
4445
.484
5450
.688
2287
.210
7591
7.9
Grè
ce
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2792
.232
17.9
5851
.770
20.4
9000
.612
337.
013
791.
313
601.
919
560.
1
Hon
grie
0.
00.
022
3.6
224.
629
1.2
278.
126
5.3
646.
678
5.1
924.
212
79.1
1554
.521
65.8
3509
.460
22.1
7992
.512
695.
8
Irla
nde
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2031
4.4
2523
2.1
2792
5.0
4081
8.7
5888
0.0
7449
0.5
1060
42.3
1028
65.1
0.0
Isla
nde
75.2
101.
198
.111
3.5
148.
517
7.2
240.
127
5.0
360.
545
1.8
662.
984
0.2
1255
.017
33.4
4024
.610
084.
812
990.
2
Italie
60
195.
370
419.
370
382.
381
086.
689
688.
310
6318
.611
7278
.013
9437
.217
6985
.218
1855
.518
0273
.618
2373
.319
4488
.323
8887
.628
0481
.129
3475
.237
5754
.6
Japo
n 20
1440
.023
1790
.024
8060
.025
9800
.027
5570
.023
8452
.025
8612
.427
1905
.727
0034
.024
8776
.027
8441
.530
0115
.730
4237
.533
5499
.537
0543
.638
6581
.344
9567
.4
Luxe
mbo
urg
0.
00.
00.
00.
00.
047
03.3
4695
.450
22.3
7982
.884
67.8
7927
.088
10.2
1813
9.5
2135
4.8
2788
3.0
3341
0.2
0.0
Mex
ique
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
012
077.
512
868.
716
587.
022
218.
828
040.
10.
0
Nor
vège
10
889.
212
149.
111
794.
412
717.
717
648.
022
520.
725
439.
127
494.
531
609.
442
452.
946
301.
555
403.
272
487.
382
787.
789
980.
10.
00.
0
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
ÉD
ITIO
N 2
007
– IS
BN
978
-92-
64-0
3758
-8 -
© O
CD
E 2
007
57
19
90
1991
19
92
1993
19
94
1995
19
96
1997
19
98
1999
20
00
2001
20
02
2003
20
04
2005
p 20
06e
Nou
velle
-Z
élan
de
0.0
0.0
5899
.044
30.7
5896
.276
75.6
9293
.156
46.0
5490
.870
06.2
6065
.188
07.8
9162
.211
458.
312
495.
112
592.
212
601.
7
Pay
s-B
as
1068
96.1
1172
62.8
1210
52.5
1201
16.2
1429
44.0
1726
75.1
1940
15.6
1985
39.0
2289
83.2
2637
61.3
3054
59.2
3321
51.2
3965
14.3
5232
06.6
5978
87.4
6299
41.0
7296
72.0
Pol
ogne
0.
00.
010
0.8
198.
246
1.2
539.
373
5.2
678.
111
64.7
1024
.410
18.5
1157
.214
56.5
2145
.632
23.6
6438
.90.
0
Por
tuga
l
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4195
.557
47.9
1022
5.9
1149
2.9
1979
2.5
2226
4.9
2132
4.5
3605
9.9
4611
3.9
4407
2.4
5485
0.4
Rép
ubliq
ue
slov
aque
0.
00.
00.
00.
016
6.4
138.
518
5.0
236.
440
8.2
346.
037
9.1
506.
648
5.6
633.
258
3.5
617.
211
76.1
Rép
ubliq
ue
tchè
que
0.0
0.0
0.0
181.
430
0.4
345.
549
8.0
548.
280
4.1
697.
973
7.9
1135
.614
73.1
2283
.537
58.9
3610
.450
58.2
Roy
aum
e-U
ni
2293
06.7
2321
40.8
2216
78.9
2456
28.9
2767
43.8
3048
64.9
3304
32.5
3607
96.3
4883
72.0
6864
20.4
8978
44.8
8697
00.5
9941
35.7
1187
045.
012
4719
0.3
1228
325.
614
8694
8.9
Suè
de
5071
9.5
5479
7.6
4884
4.6
4552
2.5
6030
9.0
7314
2.5
7218
7.8
7820
1.2
9353
3.7
1062
73.8
1232
34.0
1232
68.1
1465
09.8
1836
31.4
2148
26.0
2088
35.9
2629
52.4
Sui
sse
6608
6.5
7588
0.9
7441
1.8
9157
0.3
1125
88.0
1424
81.4
1415
86.8
1653
54.1
1842
37.3
1945
98.3
2321
75.8
2522
38.3
2922
10.1
3413
84.4
3992
97.3
4261
95.3
5454
20.3
Tur
quie
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
036
68.0
4581
.058
47.0
6138
.070
60.0
8315
.088
66.0
Tot
al O
CD
E
1714
426.
218
7605
8.6
1953
372.
420
9617
0.3
2369
976.
226
5654
6.5
2928
723.
632
0251
4.8
3783
589.
344
5776
5.5
5243
233.
957
0884
7.0
6437
112.
176
1909
5.1
8732
809.
788
0518
3.2
..
Not
es :
les
donn
ées
sont
con
vert
ies
en d
olla
rs s
ur la
bas
e du
taux
de
chan
ge m
oyen
. p :
chiff
res
prov
isoi
res
; e :
estim
atio
ns.
Sou
rce
: Bas
e de
don
nées
sur
l'in
vest
isse
men
t dire
ct in
tern
atio
nal d
e l'O
CD
E.
58PE
RSP
EC
TIV
ES
D'IN
VE
STIS
SEM
EN
T I
NT
ER
NA
TIO
NA
L 2
007
– IS
BN
- 97
8-92
-64-
0375
8-8
© O
EC
D 2
007
Tab
leau
2.A
1.4
Inve
stis
sem
ent
dir
ect
de
l’étr
ang
er d
ans
les
pay
s d
e l'O
CD
E :
en
cou
rs d
es e
ntr
ées
Mill
ions
de
dolla
rs E
U
19
90
1991
19
92
1993
19
94
1995
19
96
1997
19
98
1999
20
00
2001
20
02
2003
20
04
2005
p 20
06e
Alle
mag
ne
7406
6.8
7792
7.8
7473
0.1
7109
5.4
8733
8.1
1043
67.2
1046
58.1
1907
32.9
2523
92.5
2904
57.1
4625
29.1
4168
26.5
5293
22.6
6661
74.4
7094
32.5
6604
28.0
7611
06.2
Aus
tral
ie
7361
5.1
7707
7.7
7582
1.7
8287
7.7
9554
3.8
1040
74.3
1167
97.2
1010
89.0
1059
61.7
1206
25.7
1111
38.5
1118
26.7
1410
86.3
1984
20.0
2591
45.3
2063
48.0
2470
54.6
Aut
rich
e 10
971.
811
510.
112
040.
812
105.
514
636.
019
721.
019
629.
219
522.
223
564.
823
471.
630
430.
834
328.
043
506.
753
844.
262
336.
562
524.
170
064.
4
Bel
giqu
e 0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
0
Bel
giqu
e /
Luxe
mbo
urg
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
0
Can
ada
11
2850
.311
7031
.510
8500
.110
6869
.711
0210
.112
3182
.313
2970
.213
5935
.614
3348
.817
5000
.921
2722
.721
3755
.422
5902
.128
9157
.531
8610
.235
0030
.138
5165
.0
Cor
ée
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5320
7.5
6265
8.3
6606
9.7
0.0
0.0
0.0
Dan
emar
k 0.
014
747.
014
387.
314
617.
917
846.
323
800.
922
337.
022
267.
835
704.
847
725.
673
573.
075
382.
682
743.
210
0236
.311
5190
.411
5494
.713
8454
.4
Esp
agne
0.
00.
085
989.
480
295.
696
302.
311
0290
.511
1532
.210
5265
.612
6018
.512
5363
.615
6346
.817
7252
.025
7095
.433
9652
.039
5983
.637
1451
.444
3274
.4
Eta
ts-U
nis
5053
46.0
5334
04.0
5402
70.0
5933
13.0
6179
82.0
6800
66.0
7456
19.0
8241
36.0
9200
44.0
1101
709.
014
2101
7.0
1518
473.
014
9995
215
7698
317
2706
218
7426
30.
0
Fin
land
e 51
32.4
4220
.536
88.9
4216
.767
14.1
8464
.587
97.5
9529
.816
454.
818
320.
424
272.
324
069.
833
985.
750
256.
657
363.
154
308.
364
172.
4
Fra
nce
84
930.
997
450.
512
7881
.413
5077
.816
3451
.419
1433
.020
0095
.819
5913
.024
6215
.924
4672
.525
9773
.029
5308
.038
5186
.752
7624
.664
1807
.062
7930
.878
3025
.0
Grè
ce
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1308
4.0
1589
0.0
1411
3.0
1394
1.0
1556
0.0
2245
3.6
2848
1.5
2918
9.3
4131
6.9
Hon
grie
56
8.8
2106
.734
24.1
5575
.670
83.5
1130
3.5
1327
4.9
1795
3.6
2075
2.9
2325
9.7
2285
6.2
2737
7.5
3621
3.4
4834
4.9
6262
3.6
6188
6.0
8178
1.1
Irla
nde
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6245
3.1
7281
7.0
1270
87.6
1340
51.3
1828
90.1
2229
59.9
2096
75.0
1662
30.4
0.0
Isla
nde
147.
116
5.6
123.
811
6.5
127.
514
8.7
197.
433
1.9
468.
747
8.4
491.
467
6.5
797.
411
89.7
1998
.046
96.3
6993
.1
Italie
60
008.
561
592.
349
972.
753
961.
960
416.
065
347.
274
599.
985
401.
810
8835
.310
8640
.712
1168
.711
3433
.513
0813
.818
0890
.622
0720
.322
4079
.329
4790
.7
Japo
n 98
50.0
1229
0.0
1551
0.0
1689
0.0
1917
0.0
3350
7.7
2993
9.7
2707
9.8
2606
4.0
4611
5.3
5032
1.9
5031
9.0
7814
0.3
8972
9.2
9698
4.2
1008
98.5
1076
33.5
Luxe
mbo
urg
0.
00.
00.
00.
00.
018
503.
418
232.
717
279.
720
766.
120
362.
023
491.
726
346.
534
970.
241
729.
649
732.
943
721.
30.
0
Mex
ique
22
424.
430
790.
035
680.
040
600.
433
197.
741
129.
646
912.
055
810.
063
610.
478
060.
097
170.
214
0376
.015
8650
.717
2834
.519
1508
.820
9563
.60.
0
Nor
vège
12
403.
815
865.
213
644.
913
642.
517
018.
019
835.
920
623.
820
704.
426
081.
429
433.
030
261.
432
589.
642
649.
248
966.
976
109.
80.
00.
0
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
ÉD
ITIO
N 2
007
– IS
BN
978
-92-
64-0
3758
-8 -
© O
CD
E 2
007
59
19
90
1991
19
92
1993
19
94
1995
19
96
1997
19
98
1999
20
00
2001
20
02
2003
20
04
2005
p 20
06e
Nou
velle
-Z
élan
de
0.0
0.0
1177
9.5
1553
9.1
2206
2.2
2572
7.6
3474
3.7
3136
5.3
3316
9.9
3286
0.8
2806
9.8
2371
4.7
2950
1.9
3815
4.7
4951
7.9
4999
6.9
5511
1.0
Pay
s-B
as
6872
8.8
7247
9.6
7443
4.3
7447
4.2
9340
2.9
1160
51.2
1265
36.4
1221
83.1
1644
61.1
1925
91.9
2437
30.3
2828
79.2
3499
54.9
4266
11.1
4699
35.7
4471
20.5
4874
75.7
Pol
ogne
10
9.5
425.
313
69.9
2306
.937
89.1
7843
.511
463.
814
589.
422
479.
826
079.
134
232.
941
253.
747
900.
557
840.
585
506.
489
544.
10.
0
Por
tuga
l
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1897
3.4
2110
3.2
2241
3.7
3008
9.6
2691
0.8
3204
3.4
3602
2.7
4463
5.1
6220
0.2
6914
4.3
6559
8.4
8552
0.7
Rép
ubliq
ue
slov
aque
0.
00.
00.
00.
089
7.0
1297
.118
99.8
2103
.429
19.6
3227
.646
79.4
5729
.885
30.6
1128
3.9
1450
3.7
1579
5.5
2548
2.3
Rép
ubliq
ue
tchè
que
0.0
0.0
0.0
3422
.845
46.6
7349
.885
73.1
9233
.214
377.
117
549.
521
647.
027
092.
838
672.
345
286.
357
246.
160
662.
377
456.
8
Roy
aum
e-U
ni
2039
05.3
2083
45.5
1729
86.4
1792
32.6
1895
87.5
1997
71.8
2286
42.5
2529
58.6
3373
86.1
3851
46.1
4386
30.7
5066
85.6
5233
19.2
6061
57.3
7019
13.4
8313
57.2
1135
263.
8
Suè
de
1263
6.0
1808
5.0
1405
7.0
1312
6.9
2264
9.4
3108
9.3
3478
4.1
4151
2.7
5098
4.6
7331
2.5
9397
2.5
9195
8.9
1193
15.4
1570
83.9
1963
69.1
1717
68.2
2183
74.3
Sui
sse
3424
4.6
3574
7.2
3298
9.3
3871
3.3
4866
8.4
5706
3.7
5391
6.7
5951
5.2
7199
7.1
7600
0.2
8680
9.9
8876
6.3
1248
08.0
1622
38.3
1976
71.7
1689
88.5
2071
26.2
Tur
quie
0.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
019
209.
019
677.
018
795.
033
536.
038
519.
064
433.
00.
0
Tot
al O
CD
E
1291
940.
013
9126
1.4
1469
281.
715
5807
1.7
1732
639.
720
2034
3.3
2187
879.
623
8482
7.6
2939
686.
233
7608
1.0
4241
790.
145
8332
1.1
5247
556.
862
9790
9.5
7105
092.
171
2830
7.8
..
Not
es :
les
donn
ées
sont
con
vert
ies
en d
olla
rs s
ur la
bas
e du
taux
de
chan
ge m
oyen
. p :
chiff
res
prov
isoi
res
; e :
estim
atio
ns.
Sou
rce
: Bas
e de
don
nées
sur
l'in
vest
isse
men
t dire
ct in
tern
atio
nal d
e l'O
CD
E.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 61
PARTIE I
PRESERVER LA LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT
L’investissement international est un moteur essentiel de la croissance et du développement durable. Il est désormais prouvé qu’un environnement ouvert et non discriminatoire vis-à-vis de l’investissement international a de nombreux effets positifs, notamment en termes de création d’emplois, d’efficience de l’allocation des ressources et de progrès social et environnemental. La liberté d’investissement est une valeur fondamentale de l’OCDE, qui se mobilise depuis plus de 40 ans pour promouvoir uneplus grande libéralisation dans ce domaine.
Dans certains pays, membres et non membres de l’OCDE, l’investissement international, en particulier l’acquisition d’entreprises nationales par des sociétés étrangères, devient un sujet de préoccupation de plus en plus important. L’évolution du contexte international dont dépend la sécurité nationale a amené les pouvoirs publics à revoir leurs priorités. La protection de technologies jugées vitales pour la compétitivité et la souveraineté nationale est également devenue un enjeu majeur. En outre, l’essor des opérations transfrontières de fusion et acquisition observé ces dernières années suscite des inquiétudes de plus en plus vives concernant l’emploi.
La plupart des politiques d’investissement récemment mises en œuvre en réponse à ces préoccupations sont axées sur les investissements susceptibles de compromettre les intérêts nationaux. Dans un petit nombre de cas, très médiatisés, les cadres législatifs et réglementaires en place ont été utilisés pour contrer des investissements dans les secteurs de l’infrastructure et de l’énergie des pays de l’OCDE ainsi que des investissement projetés par des entreprises contrôlées par des États étrangers.
Cette partie regroupe les rapports suivants :
Chapitre 3. Liberté d’investissement, sécurité nationale et secteurs « stratégiques » : rapport provisoire.
Chapitre 4. Impact économique et autres effets des opérations transfrontières de fusion et acquisition dans les pays de l’OCDE.
Chapitre 5 Intérêts essentiels de sécurité aux termes du droit international de l’investissement.
Chapitre 6. Indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE dans les pays de l’OCDE : réexamen et extension à d’autres économies et secteurs.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 63
PARTIE I
Chapitre 3
LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT, SÉCURITÉ NATIONALE ET SECTEURS « STRATÉGIQUES » : RAPPORT D’ÉTAPE*
Introduction
L’investissement international est un moteur essentiel de la croissance et du développement durable. Il est désormais prouvé qu’un environnement ouvert et non discriminatoire vis-à-vis de l’investissement international a de nombreux effets bénéfiques, notamment en termes de création d’emplois, d’efficience de l’allocation des ressources et de progrès social et environnemental. La liberté d’investissement est une valeur fondamentale de l’OCDE, qui se mobilise depuis plus de 40 ans pour promouvoir une plus grande libéralisation dans ce domaine.
Dans certains pays, membres et non membres de l’OCDE, l’investissement international, en particulier l’acquisition d’entreprises nationales par des intérêts étrangers, devient un sujet de préoccupation de plus en plus important. L’évolution du contexte international dont dépend la sécurité nationale a amené les pouvoirs publics à revoir leurs priorités. La protection de technologies jugées vitales pour la compétitivité et la souveraineté nationale est également devenue un enjeu majeur. En outre, l’essor des opérations transfrontières de fusion et acquisition observé ces dernières années suscite des inquiétudes de plus en plus vives au sujet de l’emploi.
Les questions de l’accès à l’énergie et de la pénurie de matières premières suscitent également un regain d’attention. Du fait que le prix des hydrocarbures reste élevé et que l’industrialisation rapide d’un certain nombre de pays en
* Cet article reprend un rapport d’étape approuvé par le Comité de l’investissement de l’OCDE lors de la quatrième Table ronde de l’OCDE intitulée « Liberté de l’investissement, sécurité nationale et secteurs “stratégiques”», le 30 mars 2007.
64 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
développement alimente la demande de matières premières au niveau mondial, la détention directe d’entreprises productrices de minéraux est devenue un enjeu politique. Cette inquiétude a peut-être été encore amplifiée par les stratégies d’investissement que certains pays mettent en œuvre de façon apparemment délibérée pour s’assurer la maîtrise de ce type de ressources.
Les caractéristiques de l’investissement changent elles aussi au fur et à mesure de la montée en puissance d’une nouvelle catégorie d’investisseurs à l’étranger issus de pays en développement et d’économies émergentes. Lorsque les acteurs intervenant sur la scène mondiale n’ont pas leur siège dans des pays ou territoires dotés de normes adéquates en matière de politique de l’investissement et de comportement des entreprises, ou lorsque les acquéreurs potentiels d’entreprises nationales jouissent d’avantages indus sous forme d’aides financières accordées par d’autres pays, il est légitime de s’interroger sur l’équité des règles du jeu à l’échelle planétaire. Cependant, l’exercice d’une discrimination à l’égard des nouveaux venus selon des critères de nationalité ne pourra que porter atteinte au système multilatéral d’échanges et d’investissements et risque de mettre en péril les bénéfices attendus d’un engagement de longue date des pays membres de l’OCDE à libéraliser les règles du commerce et de l’investissement international.
Évolutions récentes
Les mesures prises en réponse à ces préoccupations dans le cadre de la politique de l’investissement ont jusqu’à présent surtout visé les investissements risquant de porter atteinte aux intérêts de la sécurité. Dans un petit nombre de cas, très médiatisés, les cadres réglementaires en place ont été utilisés pour contrer des investissements dans les secteurs de l’infrastructure et de l’énergie des pays de l’OCDE ainsi que des investissements projetés par des entreprises contrôlées par d’autres États.
De plus, ces dernières années, plusieurs pays ont durci leur réglementation et leurs pratiques administratives. La France et l’Allemagne ont l’une et l’autre adopté des « listes fermées » de secteurs et d’activités dans lesquels les prises de participation étrangères sont soumises à des restrictions pour des motifs de sécurité. Aux États-Unis, le Congrès envisage de rendre plus strictes les dispositions de l’amendement Exon-Florio à la législation sur la sécurité.
Le Canada étudie actuellement la possibilité d’introduire des dispositions relatives à la sécurité dans sa législation sur l’investissement. L’actualisation des réglementations visant l’investissement étranger en liaison avec la sécurité nationale est une question sur laquelle le Japon se penche lui aussi.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 65
En dehors de la zone de l’OCDE, la Russie a entrepris d’instituer un cadre régissant les aspects de sa politique de l’investissement liés à la sécurité nationale. La Chine a adopté de nouveaux critères d’autorisation des fusions et acquisitions par des investisseurs étrangers dans les « secteurs d’activité d’importance majeure » ayant des répercussions sur la « sécurité économique nationale ».
D’aucuns affirment également que la réglementation anti-trust, la surveillance financière et d’autres dispositifs réglementaires qui ne relèvent pas véritablement de la politique de l’investissement ont été utilisés pour protéger des entreprises « stratégiques ». Certains dispositifs anti-OPA mis en place par le secteur privé et autres pratiques anticoncurrentielles peuvent parfois aussi servir à décourager de manière sélective les transactions transfrontières. Des mécanismes impliquant les pouvoirs publics peuvent être utilisés à des fins similaires : en font par exemple partie les mesures prises par les banques à capitaux publics et la détention d’une action privilégiée dans des entreprises privatisées. Au fur et à mesure que les inquiétudes suscitées par la mondialisation progressaient dans l’ordre des priorités politiques, les élus se sont mis à s’interroger plus fréquemment en public sur l’opportunité des acquisitions d’entreprises nationales par des investisseurs étrangers. Même lorsque le pouvoir législatif n’est pas directement responsable de la réglementation sur l’investissement, la perspective d’avoir à affronter l’hostilité du pays d’accueil peut suffire à dissuader beaucoup d’investisseurs.
Nécessité de préserver l’ouverture à l’investissement
Les États souverains ont le droit, et même l’obligation, de prendre des mesures pour protéger l’intérêt général, y compris pour sauvegarder la sécurité nationale. Comme l’ont montré les sentences arbitrales rendues récemment au niveau international, la marge de manœuvre dont ils jouissent pour exercer cette prérogative vis-à-vis des investisseurs étrangers est délimitée de manière précise par le droit international coutumier.1 Les instruments multilatéraux relatifs à l’investissement, notamment le Code de la libération des mouvements de capitaux de l’OCDE et les accords régionaux et bilatéraux en matière d’investissement auxquels sont parties la plupart des pays, donnent aux pouvoirs publics une certaine latitude pour apprécier eux-mêmes les besoins du pays en matière de sécurité.
Il est dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de l’économie mondiale de limiter les restrictions à la liberté d’investissement aux cas où il est avéré que la sécurité et d’autres intérêts essentiels sont en jeu. Les pays qui deviendraient par trop restrictifs à l’égard des fusions et acquisitions transfrontières s’imposeraient à eux-mêmes et imposeraient à d’autres des coûts non
66 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
négligeables et risqueraient d’inciter d’autres pays à adopter des mesures similaires.
Des études récentes donnent à penser que les pays d’accueil peuvent retirer des bénéfices considérables des fusions et acquisitions transfrontières.2 Ces bénéfices étant dans une large mesure similaires à ceux des investissements de création, il n’y a guère de raisons de faire une différence entre les investissements « entièrement nouveaux » et les acquisitions d’entreprises existantes. Les retombées positives sur l’entreprise cible, notamment en termes de gains de productivité et d’augmentation des salaires, sont très bien démontrées. Les données prouvant que les acquisitions d’entreprises par des intérêts étrangers peuvent procurer des avantages plus larges à la société dans son ensemble sont elles aussi convaincantes, mais la concrétisation pleine et entière de ces avantages est conditionnée par la politique du pays d’accueil, notamment par l’aptitude des pouvoirs publics à engager à temps les réformes structurelles qui s’imposent.
Émergence d’une convergence de vues sur les défis à relever dans le domaine de la réglementation
Pour relever ces défis et aider tous les pays à récolter les fruits de l’interdépendance croissante de l’économie mondiale, l’OCDE a lancé un projet qui s’intitule « Liberté d’investissement, sécurité nationale et secteurs "stratégiques" ». Dans un premier temps, une phase exploratoire visant à établir une typologie des stratégies suivies en matière de réglementation pour protéger la sécurité et d’autres intérêts essentiels a été menée à bien avec la participation de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine et de la Fédération de Russie, ainsi que de plusieurs autres pays non membres de l’OCDE. Des professionnels venus du secteur privé ont été invités à faire part de leurs points de vue.3
D’après les échanges qui ont eu lieu jusqu’ici, il y a matière à conclure que si les pratiques retenues dans le domaine de la réglementation varient selon les pays, des principes communs peuvent toutefois être dégagés (voir en annexe pour une synthèse). Ainsi, après des décennies d’efforts déployés sous la houlette de l’OCDE pour libéraliser l’investissement, les pays membres qui continuent d’appliquer des procédures générales de filtrage et d’autorisation des investissements internationaux à caractère discriminatoire sont relativement peu nombreux. Néanmoins, une large majorité des pays participant au projet font effectivement de la protection de la sécurité et autres intérêts essentiels un axe prioritaire de leur politique de l’investissement et maintiennent à cet effet des restrictions sectorielles.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 67
Les pays qui ont pris part à l’étude sont d’accord sur le fait que pour être saine, une politique de l’investissement doit obéir aux principes de proportionnalité, de prévisibilité et de transparence de la réglementation.4 En premier lieu, les restrictions à l’investissement ne doivent pas être plus coûteuses ou plus discriminatoires que nécessaire pour atteindre l’objectif que représente la protection de l’intérêt général, et elles ne doivent pas faire double emploi avec des dispositifs qui sont, ou pourraient être, prévus par une autre réglementation. En deuxième lieu, s’il est de l’intérêt des investisseurs et des administrations nationales de préserver la confidentialité d’informations sensibles, les objectifs et pratiques réglementaires doivent être aussi transparents que possible de façon à accroître la prévisibilité des résultats et à éliminer les sources d’erreur d’interprétation. En troisième lieu, s’il convient d’éviter toute ingérence indue du pouvoir politique dans l’exercice normal des prérogatives des instances de réglementation, il y a tout de même lieu de prévoir des procédures de surveillance parlementaire ou de recours judiciaire pour garantir la transparence.
Depuis quelque temps, les instances de réglementation doivent faire face à l’apparition d’une multitude d’entité juridiques et structures de placement internationales.5 Comme le montrent les travaux d’autres organes de l’OCDE, ces nouveaux instruments peuvent rendre plus difficile l’identification des détenteurs effectifs de la propriété et du contrôle des entreprises, avec les conséquences qui peuvent en découler en ce qui concerne l’évaluation des risques pour la sécurité. Le recours à de tels dispositifs remet en outre en cause la pertinence de la nationalité en tant que principal critère d’évaluation. Un renforcement de la coopération internationale pourrait permettre de mieux comprendre la nature de la propriété et du contrôle, tout en évitant l’application de restrictions inutiles sur la base de critères de nationalité.
Défi à relever
Le défi que doivent relever les pouvoirs publics est double : prendre la mesure des coûts que l’adoption, au nom d’objectifs de sécurité nationale, de politiques inutilement restrictives risquerait d’avoir pour leur propre économie et pour l’économie mondiale et faire participer toutes les économies importantes à cette réflexion.
L’un des moyens pour y parvenir est d’instaurer un mécanisme renforcé de dialogue et d’examen régulier entre les instances nationales chargées de l’investissement en s’appuyant sur les travaux de la phase exploratoire, désormais achevée, du projet. Un tel mécanisme pourrait notamment avoir vocation à permettre :
68 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
• des échanges sur le cadre réglementaire des pays membres et non membres de l’OCDE et l’établissement de rapports réguliers, de façon à obtenir un niveau de transparence maximum sur les pratiques et réglementations des différents pays dans le domaine de l’investissement ;
• l’émergence d’une convergence de vues sur la manière de transposer dans la pratique les principes convenus auxquels devrait obéir une politique de l’investissement saine, en mettant à profit les conclusions des analyses produites par l’OCDE, ainsi que son expérience de longue date des questions relevant de la politique de l’investissement, attestée par l’existence des instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement et du Cadre d’action pour l’investissement.6
Notes
1. Voir, dans cette publication, l’article intitulé « Intérêts de sécurité essentiels aux termes du droit international de l’investissement ».
2. Voir, dans cette publication, l’article intitulé « Intérêts de sécurité essentiels aux termes du droit international de l’investissement ».
3. Les synthèses des tables rondes peuvent être consultées à l’adresse : www.oecd.org/investment.
4. Les participants ont débattu de ces principes sur la base du document du Secrétariat de l’OCDE intitulé « Investment regulation regarding security and other essential interests » (disponible pour usage officiel uniquement).
5. Les participants ont débattu de ces principes sur la base du document du Secrétariat de l’OCDE intitulé « Beneficial Ownership and Control of a Cross-Border Direct Investor » disponible pour usage officiel uniquement).
6. www.oecd.org/daf/investment/pfi.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 69
ANNEXE 3.A1.1.
PANORAMA DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES MISES EN ŒUVRE À L’ENCONTRE DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
AU NOM DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Cette annexe offre un panorama succinct des pratiques discriminatoires mises en œuvre par les autorités publiques au nom de la sécurité nationale et autres intérêts essentiels. Elle a été élaborée sur la base de documents de référence compilés et débattus par le Comité de l’investissement et les autres participants au projet intitulé « Liberté de l’investissement, sécurité nationale et secteurs “stratégiques” ». Parmi ces documents, figuraient notamment les réponses des pays à un questionnaire et des informations sur les positions des pays adhérents vis-à-vis de l’ordre public et des intérêts essentiels au regard des instruments1. de l’OCDE relatifs à l’investissement. Les principales conclusions sont les suivantes :
• Les considérations de sécurité nationale jouent un rôle important dans la politique de l’investissement de la plupart des pays, mais rares sont les pays qui précisent ou tentent de définir ce qu’ils entendent par « sécurité ». En particulier, les dix pays adhérents aux instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement (ainsi qu’un pays participant au projet, en l’occurrence la Chine) qui pratiquent une forme quelconque de filtrage des investissements au nom de la sécurité nationale procèdent pour l’essentiel au cas par cas (tableau 1).
• La moitié des pays concernés publient des « listes fermées » des activités visées par des restrictions à l’investissement étranger. 22 pays appliquent des restrictions sectorielles spécifiques au nom de la sécurité nationale. Près de la moitié de ces restrictions concernent uniquement la
1. Les instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement sont notamment : la Déclaration de l'OCDE et les Décisions sur l'investissement international et les entreprises multinationales, à laquelle adhèrent actuellement tous les pays de l’OCDE et neuf pays non membres (Argentine, Brésil, Chili, Estonie, Lettonie, Lituanie, Israël, Roumanie et Slovénie) et le Code de libération des mouvements de capitaux.
70 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
production ou la manipulation de matériel de défense. D’autres visent également le secteur du transport, la propriété foncière dans les zones sensibles, les services d’utilité collective, l’énergie nucléaire et le secteur aérospatial (tableau 2).
• La perception de ce que recouvrent les intérêts publics essentiels diffère beaucoup d’un pays à l’autre. En général, les pays qui pratiquent un filtrage de l’investissement appliquent, pour apprécier si la sécurité nationale ou un intérêt public essentiel est un jeu, des critères qui portent sur la sécurité mais ont aussi une dimension économique. Ainsi, en prenant pour référence les exceptions des pays au principe du Traitement national, la plupart des intérêts perçus comme des intérêts publics essentiels sont, en dehors des questions de sécurité, de nature plutôt « défensive ». Nombre d’exceptions ne concernent ni des secteurs stratégiques, ni des fleurons nationaux, mais semblent plutôt motivées par la volonté de préserver les sources de revenu traditionnelles.
• Il est indispensable d’éviter l’excès de réglementation. Rares sont les pays de l’OCDE qui ont adopté des dispositions juridiques à cet effet. Toutefois, beaucoup d’autorités chargées de la politique de l’investissement semblent, dans la mesure du possible, s’en remettre à des instances réglementaires spécialisées avant d’invoquer leurs propres prérogatives. Certaines d’entre elles assurent également une forte coordination entre instances pour éviter les chevauchements.
• Rares sont les pays adhérents qui pratiquent une discrimination légale à l’encontre d’entreprises contrôlées par des États étrangers. En revanche, les autorités chargées de la politique de l’investissement sont relativement nombreuses – surtout lorsqu’elles participent au processus de filtrage de l’investissement – à effectuer ou à avoir la possibilité d’effectuer un examen plus rigoureux lorsque l’investisseur est contrôlé par les autorités publiques d’un autre pays.
• En général, les pays affirment ne pas avoir mis en place d’obstacles informels aux acquisitions d’entreprises par des intérêts étrangers. Toutefois, certains d’entre eux reconnaissent que les élus ont parfois utilisé leur droit d’expression de manière à décourager les investisseurs potentiels.
• Des mesures visant à préserver l’intégrité des procédures sont en place. Les pays de l’OCDE estiment qu’ils respectent une stricte confidentialité vis-à-vis des informations sur les entreprises et font le maximum pour que leurs interventions réglementaires soient proportionnées à l’objectif d’intérêt public poursuivi. En ce qui
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 71
concerne la transparence, les pratiques diffèrent selon les pays : les pays qui ont adopté des « listes négatives » affirment faire preuve de plus de transparence puisqu’ils annoncent leur point de vue à l’avance ; ceux qui effectuent un filtrage de au cas par cas définissent la transparence en termes de clarté des procédures. Les pratiques varient également d’un pays à l’autre en matière de voies de recours. Certains pays permettent aux investisseurs éconduits de contester la décision devant les tribunaux ou les tribunaux administratifs. D’autres prévoient une procédure de consultations et de révision des propositions, mais n’offrent pas aux investisseurs la possibilité d’introduire un recours contre la décision finale.
Tableau 3.A1.1. Mesures générales ou transsectorielles en lien avec l’ordre public et les intérêts essentiels
Limitées à certains secteurs/ activités ?
Nature de l’évaluation
Critères retenus pour
accorder/ refuser
l’autorisation
Observations
Allemagne** Oui Sécurité Application d’une obligation de notification.
Australie Non* Générale Intérêt national Application d’une obligation de notification et d’un montant seuil.
Chine Oui Générale Sécurité économique nationale
Droit d’effectuer un filtrage lorsque le secteur est considéré comme un « secteur d’importance majeure » ou lorsqu’il y a risque de transfert de « marques célèbres ou traditionnelles ».
Corée Non Sécurité Intérêts publics essentiels
Possibilité d’intervention des pouvoirs publics en cas de « preuve évidente » de l’existence d’une menace.
États-Unis Non Sécurité Menace crédible vis-à-vis de la sécurité nationale
Le Président peut intervenir si les autres lois ne sont pas suffisantes.
France Oui Sécurité Ordre public, sécurité publique et intérêts de la défense nationale
Application d’une obligation de notification. L’ampleur de cette obligation et les secteurs auxquels elle s’applique varient selon que l’investissement a pour origine un État membre de l’UE ou un pays tiers.
Islande Non Générale Effet économique
Application d’une obligation de notification et d’un montant seuil.
72 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Limitées à certains secteurs/ activités ?
Nature de l’évaluation
Critères retenus pour
accorder/ refuser
l’autorisation
Observations
Israël Non Sécurité Intérêts de sécurité publique essentiels
Le gouvernement est autorisé à intervenir si les autres lois sont insuffisantes.
Japon Oui Sécurité Sécurité nationale, ordre public et sûreté publique
Obligation de notification ex-ante en cas de risque de problèmes de sécurité nationale, d’ordre national ou de sûreté nationale.
Mexique Oui Générale et sécurité
Application d’une obligation de notification et d’un montant seuil.
Nouvelle-Zélande
Non Générale Application d’une obligation de notification et d’un montant seuil.
Pour mémoire:Canada Non Générale Avantages
économiques Application d’un montant seuil
Notes : * Toutefois, la législation australienne relative à l’accord de libre échange entre les États-Unis et
l’Australie prévoit un traitement différencié pour les entreprises opérant dans certains secteurs jugés « sensibles » du point de vue de la sécurité nationale.
** En Allemagne le filtrage est limité à la production « d’armes de guerre » telles que définies par une législation spécifique, et peut, selon la définition, être considéré comme une restriction seulement sectorielle.
Source : OCDE (2005) Traitement national des entreprises sous contrôle étranger et mesures notifiées à des fins de transparence aux termes de l’instrument relatif au Traitement national, dont notifications nationales soumises au Secrétariat de l’OCDE en mars 2007 au plus tard.
Tableau 3.A1.2. Mesures sectorielles motivées par des raisons d’ordre public et d’intérêts essentiels de sécurité
Secteur ou domaine d’activité
Type de restriction
Observations
Argentine Armes et munitions Investissement Australie Défense Investissement Restriction de l’accès à
certains documents et équipements
Technologies militaires
Investissement Restriction de l’accès à certaines technologies.
Autriche Matériel de défense Investissement; organisation des sociétés
Brésil Immobilier Investissement Les restrictions concernent les régions frontalières, côtières et les zones classées « sécurité nationale ».
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 73
Secteur ou domaine d’activité
Type de restriction
Observations
Chili Défense et énergie nucléaire
Investissement
Transport maritime Investissement Immobilier Investissement Les restrictions concernent les
régions frontalières. Danemark Matériel de défense Investissement;
organisation des sociétés
À la discrétion du ministère de la Justice.
Finlande Matériel de défense Investissement France Construction
aérospatiale Investissement
Agences de presse Organisation des sociétés
Coopératives agricoles
Organisation des sociétés
Israël Défense Investissement, marchés publics
Les sociétés du secteur de la défense sont soumises à des règles de nationalité qui ont une incidence sur les achats, le contrôle effectif et le transfert de savoir-faire.
Privatisation Investissement À la discrétion d’un comité ministériel.
Infrastructure Organisation des sociétés
Restrictions concernant la composition des conseils d’administration d’un large éventail d’opérateurs de services d’utilité collective.
Japon Télécommunications Organisation des sociétés
Radio et télédiffusion Investissement Autre que la télévision par câble et la diffusion par télécommunication.
Corée Contrôle de la circulation aérienne
Investissement
Guidage radar et guidage de missiles
Investissement
Lituanie Sécurité de l’État et défense
Investissement
Mexique Finances Organisation des sociétés
Norvège Contrats impliquant des informations classées
Investissement
Pologne Immobilier Investissement Les restrictions concernent les régions frontalières.
Aéroports Investissement Portugal Transport maritime Investissement Les restrictions concernent le
cabotage dans, vers et à partir des Açores.
74 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Secteur ou domaine d’activité
Type de restriction
Observations
Slovénie Production et vente d’armes
Investissement
Espagne Production et vente d’armes et de matériel de guerre
Investissement
Suède Matériel de défense et munitions
Investissement
Turquie Pétrole Investissement Transport aérien et maritime
Investissement
Immobilier Investissement Concernent les zones où se posent des problèmes de sécurité nationale et les biens immobiliers excédant une certaine taille.
Royaume-Uni
Aérospatiale et défense
Investissement, organisation des sociétés
Énergie Investissement Soumis à un examen du secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie et du secrétaire d’État pour l’Écosse.
Transport maritime et transport de matériel militaire
Investissement
Industrie manufacturière
Investissement Le secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie peut bloquer les transferts de contrôle « contraires aux intérêts du Royaume-Uni ou d’une partie substantielle du Royaume-Uni ».*
Achats publics d’armements
Marchés publics Limitées aux cas où il y a des « raisons de sécurité impérieuses ».
États-Unis
Transport aérien et maritime
Investissement, organisation des sociétés
Application d’un certain nombre de règles très précises
Dragage maritime et sauvetage en mer
Investissement
Radio et télédiffusion et téléphonie
Investissement Concernent les licences délivrées aux entreprises de télécommunication et de diffusion
* Cette disposition juridique, introduite en 1975, n’a, à ce jour, jamais été utilisée.
Source : mesures notifiées à des fins de transparence aux termes de l’instrument relatif au Traitement national, dont notifications soumises au Secrétariat de l’OCDE en mars 2007 au plus tard.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 75
PARTIE I
Chapitre 4
IMPACT ÉCONOMIQUE ET AUTRES EFFETS DES OPÉRATIONS TRANSFRONTIÈRES DE FUSION ET ACQUISITION
DANS LES PAYS DE L’OCDE*
Les opérations transfrontières de fusion et acquisition connaissent une expansion rapide et transforment le paysage industriel des pays de l’OCDE. Comme il s’agit d’un domaine dans lequel l’activité est très cyclique, la vague actuelle va sans nul doute refluer en phase avec le cycle économique. Toutefois, à chaque vague, de nouveaux sommets sont atteints, le rôle des entreprises sous contrôle étranger établies dans la zone OCDE s’accroît et les activités internationales des entreprises nationales prennent de l’ampleur. Si les questions que soulèvent ces opérations et les réactions qu’elles suscitent n’ont rien d’une nouveauté, elles revêtent à l’évidence de plus en plus d’importance à mesure de la montée en puissance des fusions et acquisitions transfrontières. En outre, elles ont pris une nouvelle dimension du fait de l’entrée en scène d’entreprises multinationales établies dans des pays en développement, en particulier en Inde et en Chine.
Alors que les régimes d’investissement direct étranger (IDE) des pays de l’OCDE ont été progressivement libéralisés, l’essor des fusions et acquisitions transfrontières met les responsables de l’action publique face à un nouveau défi. Les acquéreurs étrangers sont parfois soupçonnés d’avoir des intentions cachées et de ne pas être suffisamment respectueux de la culture d’entreprise locale. On leur reproche également de remettre en cause les efforts déployés par les pouvoirs publics pour créer des champions nationaux. La difficulté que pose la distinction entre ce qui est étranger et ce qui est national dans le nouveau monde économique a des conséquences aussi bien pour la définition des politiques industrielles qu’en termes de sécurité nationale. Cet article propose une réflexion sur les risques perçus associés aux acquisitions transfrontières, ainsi
* Cet article est basé sur un article rédigé par Stephen Thomsen en sa qualité de consultant extérieur de la Division de l’investissement, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE.
76 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
que sur les effets positifs, entre autres sur le plan économique, que peuvent avoir, dans une économie très développée, les fusions et acquisitions pour les pays d’accueil.
Après une présentation générale des fusions et acquisitions, l’article s’interroge sur le point de savoir si les avantages habituellement associés à l’IDE sont les mêmes, que l’investissement prenne la forme d’une création d’entreprise ou de l’acquisition d’une entreprise existante. Il passe ensuite en revue des études empiriques qui examinent les effets des acquisitions sur l’emploi, les salaires, la productivité et l’innovation dans l’entreprise cible, et présente quelques études de cas portant sur certaines des grandes opérations de fusion et acquisition qui ont eu lieu au sein de la zone OCDE. Enfin, l’article se termine par une réflexion sur les implications des opérations transfrontières de fusion et acquisition en termes de politiques publiques.
1. Tendances en matière d’opérations transfrontières de fusion et acquisition
Les opérations transfrontières de fusion et acquisition connaissent une expansion rapide en termes absolus (graphique 1) ainsi qu’en pourcentage des fusions et acquisitions d’une part et de l’IDE d’autre part. En dépit de leur caractère très cyclique et de l’impact du 11 septembre 2001, elles ont atteint des records historiques au cours de la décennie écoulée. En Europe, le montant des fusions et acquisitions a dépassé 1 000 milliards USD en 2005, et près de la moitié de cette somme correspond à des opérations transfrontières. Si aucun choc majeur imprévu n’intervient, elles devraient retrouver, voire dépasser le niveau sans précédent atteint en 2000.
D’après les estimations, les opérations transfrontières et fusion et acquisition représentent 80 % du total des flux d’IDE entre les pays de l’OCDE et sont en augmentation en pourcentage du total des fusions et acquisitions, qu’il s’agisse des chiffres nationaux ou internationaux. Si les exemples d’investissements de création sont nombreux dans certains pays de l’OCDE (en Irlande ou au Mexique par exemple) et dans certains secteurs (IDE japonais dans le secteur automobile par exemple), globalement, les flux, en particulier les énormes flux transatlantiques, sont toujours tirés par les acquisitions.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 77
Graphique 4.1. Opérations transfrontières de fusion et acquisition (milliards USD)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Source : CNUCED et Secrétariat de l’OCDE.
Les acquisitions représentent également une part de plus en plus importante des flux d’IDE des pays en développement. Selon Calderon et al.(2004, p. 15), « [d]ans les pays en développement, alors que les opérations transfrontières de fusion et acquisition représentaient environ 10 % de l’IDE au milieu des années 80, elles en constituaient plus d’un tiers au début des années 2000 ». Cette hausse est essentiellement due à des privatisations dans les pays en développement ainsi qu’à l’ouverture aux investisseurs étrangers de certaines activités du secteur des services. »
Bien souvent, les fusions et acquisitions constituent le moyen privilégié utilisé par les entreprises qui veulent accéder à un marché étranger, en particulier aux marchés qui, pour quelque raison que ce soit, sont protégés par d’importantes barrières à l’entrée. Ces barrières ne sont pas les mêmes selon les secteurs et s’appliquent généralement à tous les nouveaux arrivants, étrangers ou non. Sur les marchés oligopolistiques, par exemple, elles peuvent être mises en place par les entreprises pour empêcher l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents ou apparaître du fait de la nature de l’activité elle-même, par exemple lorsque les canaux de distribution sont sélectifs et peu nombreux ou lorsque les consommateurs ont des goûts très spécifiques. Il arrive également que l’environnement réglementaire décourage les nouveaux entrants, soit par
78 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
son opacité, soit parce qu’il impose purement et simplement des restrictions à l’entrée, telles que l’interdiction temporaire de délivrer de nouvelles licences bancaires. Parfois, même en l’absence de telles barrières, les investisseurs préfèrent opter pour l’acquisition d’entreprises existantes parce que la rapidité d’entrée sur le marché est primordiale, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploiter un brevet ou une innovation qui risque d’être rapidement copié ou supplanté par un autre.
La déréglementation et la libéralisation des services ont ouvert des perspectives aux entreprises qui avaient l’ambition de conquérir de nouveaux marchés ; bien souvent, cette ambition est plus facile à satisfaire par l’acquisition d’une entreprise locale, disposant déjà d’une branche ou d’un réseau de distribution. Toutefois, les opérations transfrontières de fusion et acquisition ne sont pas exclusivement motivées par un objectif d’accès au marché : elles constituent souvent une réaction aux changements structurels qui s’opèrent au sein des économies, qu’il s’agisse de la construction du chemin de fer et de l’électrification aux États-Unis à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle ou, plus récemment, de l’intensification de la concurrence due à la mondialisation, des chocs sur l’offre ou de l’avènement des technologies de l’information. Les marchés devenant mondiaux, les restructurations doivent, elles aussi, avoir une dimension mondiale, ce qui suppose des fusions entre entreprises de différents pays. Les opérations transfrontières de fusion et acquisition répondent aussi à une autre préoccupation : la hausse des coûts de recherche et développement, en particulier dans le secteur pharmaceutique, qui incite les entreprises à mettre leurs ressources en commun.
2. Les effets bénéfiques de l’investissement direct de l’étranger
2.1. Effets macroéconomiques
Les effets bénéfiques potentiels de l’investissement direct de l’étranger ne dépendent pas de la forme de l’investissement. Toutefois, bien souvent, l’investissement de création est mieux perçu par les responsables de l’action publique et la population que l’acquisition d’entreprises par des intérêts étrangers. La principale raison en est que les investissements de création sont des investissements nouveaux et sont, de ce fait, considérés comme susceptibles d’avoir un impact positif sur l’emploi total et, si le projet entraîne des exportations, sur la balance commerciale. En termes économiques, comme l’ont démontré Graham et Krugman (1995) pour les États-Unis, l’IDE ne peut avoir qu’un impact indirect et limité sur l’emploi total et le solde commercial net.
Dans les domaines où l’IDE a un impact potentiel, la théorie économique n’opère généralement pas de distinction entre les deux méthodes d’accès au
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 79
marché. Cet impact positif peut se manifester plus rapidement dans un cas que dans l’autre, mais à terme, reste le même. La publication de l’OCDE (2002) intitulée L'investissement direct étranger au service du développement : Optimiser les avantages, minimiser les coûts résume ainsi ces effets bénéfiques :
Une large majorité d’études montrent que, avec des politiques adéquates dans les pays d’accueil, et un niveau minimum de développement, l’IDE a des retombées technologiques, contribue à la formation de capital humain, facilite l’intégration aux échanges internationaux, favorise la création d’un climat plus compétitif pour les entreprises et améliore le développement des entreprises.
À travers ces mécanismes, l’IDE favorise la croissance économique en augmentant la productivité totale des facteurs (PTF) et, plus généralement, en favorisant une utilisation plus efficiente des ressources dans l’économie d’accueil. Même si l’IDE a peu d’incidence sur l’emploi total, il peut en modifier la composition, par exemple en augmentant la demande de main-d’œuvre qualifiée, de techniciens ou de scientifiques. À l’instar des échanges, l’investissement direct de l’étranger peut influer sur l’ampleur et la nature des importations et des exportations d’un pays, même si la balance commerciale elle-même est déterminée par des facteurs macroéconomiques. En outre, l’IDE peut avoir, en termes de concurrence, des répercussions au-delà du seul secteur où l’investissement est réalisé voire, parfois, au-delà du pays d’accueil (pour un tour d’horizon de ces « effets dynamiques de la concurrence », voir DTI, 2006, et Bernard et al., 2005).
Les retombées technologiques sont vraisemblablement, parmi les effets bénéfiques potentiels de l’investissement direct de l’étranger, ceux qui suscitent le plus de débats. Bien que les pays en développement soient censés en être les premiers bénéficiaires, on pourrait également avancer que les pays développés sont en meilleure position pour en tirer profit parce que « l’écart de connaissance » entre l’investisseur et l’entreprise locale a des chances d’être moins important entre les pays de l’OCDE (voir par exemple OCDE, 2001, et Little, 2005). Les technologies transférées doivent s’entendre au sens large du terme, qui recouvre non seulement les technologies possédées en propre, mais aussi le savoir-faire, les techniques de gestion et autres domaines dans lesquels l’investisseur détient un avantage comparatif, par exemple la distribution et la logistique. Ces retombées peuvent être horizontales, entre entreprises concurrentes ou complémentaires, ou verticales, entre l’investisseur étranger et ses fournisseurs locaux. L’étude réalisée par l’OCDE (2001) aboutit également à la conclusion que les « liens verticaux en amont » créés par les entreprises
80 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
sous contrôle étranger ont de fortes chances d’avoir des retombées positives, du fait que les fournisseurs locaux doivent améliorer leurs modes de production, la qualité et leurs modes de commercialisation afin de répondre aux exigences d’un client pour qui la concurrence se joue à l’échelle internationale (voir également PA Cambridge Economic Consultants, 1995).
Sans doute peut-on avancer que les fusions et acquisitions ont peut-être des retombées supérieures à celles des investissements de création du fait que l’investisseur hérite d’un réseau existant de fournisseurs locaux. Toutefois, cet argument présuppose que les entreprises locales sont en mesure de satisfaire aux exigences plus strictes du nouveau propriétaire. S’il est vrai que bien souvent, les investisseurs qui créent des entreprises nouvelles finissent, à terme, par tisser le même type de réseau, certaines études montrent que les retombées plus positives des fusions persistent au fil du temps. En ce qui concerne les retombées verticales, d’après Andersson et al. (1996), les investisseurs qui créent de nouvelles entreprises continuent d’importer davantage de biens intermédiaires de leur pays d’origine que ne le font les entreprises locales achetées par des intérêts étrangers.
2.2. Sécurité nationale
L’IDE peut également avoir d’importants effets positifs sur la sécurité nationale, aussi bien pour le pays d’accueil que pour le pays d’origine. Actuellement, le débat international sur les fusions et acquisitions transfrontières met généralement l’accent sur les risques que ces opérations pourraient représenter pour la sécurité, par exemple en cas d’acquisition par des investisseurs étrangers d’entreprises considérées comme des fleurons ou de technologies sensibles. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que les liens entre l’investissement étranger et la sécurité nationale sont complexes et fonctionnent à double sens.
Premièrement, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu’une politique d’ouverture aux fusions et acquisitions transfrontières peut concourir à la sécurité nationale – directement, du fait de ses bénéfices macroéconomiques potentiels. Les atteintes à la sécurité et à l’ordre public sont beaucoup plus fréquentes dans les pays où les conditions de vie matérielles sont mauvaises, ou dans les régions où existent de forte disparités de revenus. Du fait qu’elle favorise le progrès économique et contribue à mieux en répartir les effets positifs, la liberté de l’investissement peut concourir de manière importante à promouvoir la sécurité et la stabilité.
Deuxièmement, un engagement en faveur d’une ouverture transfrontière dans certains secteurs pourrait constituer une des composantes des politiques de
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 81
stabilisation régionale ou internationale. À cet égard, l’expérience de l’Union européenne est souvent citée en exemple. À ses débuts, le projet européen reposait sur l’idée que l’intégration des marchés du charbon et de l’acier permettrait de créer, dans les industries lourdes « stratégiques », une dépendance mutuelle qui, bien que n’impliquant pas à l’origine une propriété transfrontière, inciterait à la coopération plutôt qu’à l’affrontement. Plus récemment, la création du marché unique a constitué un pas de plus vers l’intégration économique et a également exercé un effet stabilisateur sur les pays candidats à l’adhésion sur l’ensemble du continent européen.
Troisièmement, les prises de participation transfrontières peuvent faire partie intégrante d’une coopération prenant la forme de projets qui ont spécifiquement pour but de renforcer la sécurité nationale. La coopération européenne en matière de défense dans le cadre du consortium aérospatial EADS en constitue un exemple. Par ailleurs, plus récemment, l’Europe et la Chine ont lancé un projet conjoint dans le domaine de la sécurité portuaire, y compris à des fins de protection contre le terrorisme. Un projet pilote porte sur le transport par conteneurs maritimes entre les ports de Rotterdam aux Pays-Bas, Felixstowe au Royaume-Uni et Shenzhen, dans le sud de la Chine. La mise en œuvre de ce projet a été rendue possible notamment par le fait que les ports concernés ont été acquis par des entreprises internationales qui possèdent et mettent au point la technologie permettant de contrôler, suivre et garantir l’intégrité physique des scellés durant tout le trajet du conteneur, du point d’empotage à la destination finale.
Quatrièmement, la survie des entreprises jugées importantes pour la sécurité nationale pourrait bien dépendre d’alliances transfrontières. Dans beaucoup de pays relativement petits, de plus en plus de fournisseurs de la défense – en particulier dans les secteurs à forte intensité capitalistique ou bénéficiant d’importantes économies d’échelle – cherchent à assurer leur viabilité en établissant des partenariats avec des entreprises étrangères. Dans le secteur du transport aérien, jugé important en termes d’intérêts essentiels de sécurité et d’ordre public par nombre de pays adhérents aux instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement, les acquisitions transfrontières sont de plus en plus considérées comme une solution stratégique, y compris au sein de l’Union européenne.
3. Risques perçus associés aux opérations transfrontières de fusion et acquisition
Bien que la théorie économique soit neutre concernant la forme de l’IDE, les acquisitions d’entreprises par des intérêts étrangers continuent de susciter davantage de craintes parmi les pouvoirs publics des pays d’accueil et sont, par
82 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
conséquent, soumises à une réglementation plus restrictive, que ce soit de factoou de jure. D’après Evenett (2003), contrairement aux politiques relatives à l’IDE de création, les politiques qui portent sur les fusions et acquisitions sont devenues plus restrictives au cours des années 90. Alors que les autorités régionales et nationales ont mis en place des mécanismes incitatifs généreux en faveur des investisseurs qui créent des entreprises, la sécurité nationale est parfois invoquée pour bloquer ou empêcher d’une autre manière les opérations de fusion et acquisition au motif qu’elles concernent des secteurs « stratégiques ». Les pouvoirs publics invoquent également une éventuelle absence d’accès réciproque des entreprises locales au marché des prises de participation dans le pays qui investit.
Les acquisitions d’entreprises par des intérêts étrangers peuvent également déclencher l’hostilité de la population, opposée à la vente d’actifs publics à des étrangers dans le cas de privatisations, ou au contrôle de l’économie locale par des intérêts étrangers de manière plus générale. Dans le cas des offres d’achat inamicales, en particulier, l’investisseur étranger se voit parfois reprocher son indifférence vis-à-vis de contrats sociaux implicites ou son mépris des pratiques qui ont cours dans le pays. D’autres craintes ont trait à un éventuel démembrement des actifs par l’investisseur étranger. Les risques que les pays d’accueil associent aux acquisitions d’entreprises par des investisseurs étrangers sont présentés ci-après.
3.1. Perte de capacités technologiques
Une entreprise qui investit à l’étranger est notamment motivée par la volonté de s’approvisionner en technologie étrangère ; dans ce cas, l’investisseur étranger acquiert une entreprise locale spécifiquement pour ses capacités technologiques. Du fait que souvent, ce savoir-faire ne réside pas seulement dans les brevets et les marques mais fait partie intégrante de l’entreprise elle-même, ce type de commerce de technologie doit s’accompagner d’un contrôle, via un changement de propriété de l’entreprise locale. L’approvisionnement en technologie peut impliquer soit une acquisition, soit la création d’une entreprise nouvelle. Selon AlAzzawi (2004), pour les entreprises de pays développés « investir dans l’un des trois premiers innovateurs du monde (États-Unis, Japon, Allemagne) semble être le principal moyen de s’approvisionner en connaissance ».1
L’achat, par des entreprises publiques de pays en développement, d’entreprises établies dans des pays de l’OCDE est un des nombreux exemples de cette stratégie. Ainsi, dans les années 90, la société holding publique malaise Khazanah, propriétaire du constructeur automobile local Proton, a acquis l’entreprise britannique Lotus pour s’approprier son savoir-faire technologique
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 83
dans certains domaines de ce secteur. Le gouvernement malais a certes eu ainsi accès à des technologies en propre pour le constructeur automobile national, mais a aussi assuré un généreux rendement aux actionnaires et, par conséquent, contribué à améliorer les rendements de l’innovation au Royaume-Uni.
L’acquisition de capacités technologiques nationales par une entreprise étrangère qui veut les utiliser sur son propre marché n’entrave pas leur utilisation potentielle dans le pays d’accueil. Reste que des risques existent. Une fois le savoir-faire acheté et amorti, l’investisseur peut fort bien estimer qu’il n’est plus judicieux de maintenir l’entreprise acquise en activité. Or, il est tout à fait possible que les avantages compétitifs que possédait auparavant cette entreprise, ou l’économie du pays d’accueil en général, aient dépendu des technologies en question.
Même lorsque l’investissement n’a pas pour motivation l’approvisionnement en technologie, si les activités de R&D de l’entreprise acquise font double emploi avec celles d’autres sites de l’entreprise multinationale, l’investisseur peut décider de rationaliser ou de fermer des installations dans le pays d’accueil. On allègue souvent l’existence d’un « effet siège social », qui voudrait qu’une multinationale préfère installer ses activités de R&D à proximité de son siège social. Cette théorie est souvent évoquée par les responsables de l’action publique et poserait un problème particulier aux petits pays, qui ont une base technologique peu développée. Il est également possible, compte tenu de l’internationalisation et de la délocalisation croissantes de la R&D, que la société mère décide de développer les activités de R&D dans le pays d’accueil, aux dépens des installations du pays d’origine. Des données empiriques sont présentées ci-après.
3.2. Licenciements et fermetures d’installations
Toute fusion vise notamment à tirer parti d’une augmentation des économies d’échelle et de gamme. Les fusions et acquisitions sont donc un outil de restructuration économique, d’abord utilisé à l’échelle nationale et de plus en plus à l’échelle internationale. Les pouvoirs publics du pays d’accueil craignent qu’en cas d’arrêt de certaines activités, comme évoqué ci-dessus pour les activités de R&D, l’investisseur privilégie la production dans son pays d’origine au détriment de l’entreprise du pays d’accueil. La fusion d’entreprises d’un même secteur constitue un outil fréquemment utilisé pour éliminer les capacités excédentaires et se révèle souvent une stratégie plus efficiente et plus orientée vers le marché que celle qui consisterait à fermer, dans des proportions égales, les capacités de chaque entreprise dans le pays d’origine. Les coûts politiques et financiers des licenciements peuvent évidemment varier d’un pays à l’autre pour une multinationale donnée, surtout si elle est en partie publique. Ainsi, au
84 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Royaume-Uni, les syndicats d’un site de construction automobile qui doit être transféré en République slovaque se sont récemment plaints d’avoir été montrés du doigt suite aux réticences de la société mère à effectuer des licenciements dans son pays d’origine.
3.3. IDE à prix bradé
Les pays d’accueil craignent parfois que les investisseurs étrangers achètent les entreprises locales à prix bradé, en raison d’une sous-évaluation des taux de change dans le pays d’accueil, du sous-développement des marchés financiers locaux ou en encore d’une crise financière, qui, comme la crise asiatique de 1997, réduirait à néant les liquidités d’entreprises par ailleurs rentables. Bien souvent, la vente des actifs à un investisseur étranger est la dernière solution à laquelle peut recourir une entreprise pour éviter la faillite. Ces craintes existent également dans les pays de l’OCDE. Ainsi, Fukao et al.(2004, p. 1) font état des peurs dont la presse japonaise s’est fait l’écho concernant les fonds « vautour », soupçonnés d’engranger des bénéfices faciles en profitant des difficultés d’entreprises japonaises. De même, Rohatyn (1989) et d’autres ont avancé dans les années 80, qu’aux États-Unis, la sous-évaluation du dollar permettait aux entreprises étrangères d’acquérir des actifs américains à un prix excessivement bas.
3.4. Absence de réciprocité
L’argument du risque de vente à prix bradé en a un autre pour corollaire : celui de la concurrence déloyale que pourrait entraîner l’absence d’accès réciproque aux entreprises établies dans le pays qui investit. Selon cet argument, qui n’est pas sans rappeler la théorie stratégique du commerce international, les entreprises qui sont elles-mêmes protégées des acquisitions étrangères sont susceptibles d’avoir un avantage comparatif par rapport aux entreprises locales. Cette absence de réciprocité peut être due à la mise en œuvre, par les entreprises, de pratiques qui empêchent les acquisitions étrangères sur le marché concerné, ou encore au fait que l’investisseur est une entreprise publique dans son pays d’origine ou, comme dans le cas de Volkswagen en Allemagne, à l’existence d’une disposition juridique qui limite la prise de participation dans une entreprise nationale stratégique. Ainsi, il en va de la politique des fusions et acquisitions comme de celle des échanges, où l’accès au marché est souvent conditionné à la réciprocité d’accès au marché étranger : les responsables de l’action publique peuvent être tentés d’imposer des restrictions aux acquisitions par des intérêts étrangers en cas d’absence de réciprocité. Or, bien que la théorie stratégique du commerce offre un fondement à l’argument de la réciprocité fondé sur la concurrence oligopolistique déloyale, aucun des effets positifs de l’IDE énumérés ci-dessus n’est tributaire d’une réciprocité d’accès. Un pays
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 85
d’accueil peut tirer parti des entrées d’IDE, même si ses propres entreprises n’investissent pas à l’étranger.
3.5. Comportement anticoncurrentiel
Un investisseur peut fort bien, au nom de la stratégie selon laquelle il faut acheter les concurrents qu’on ne peut pas battre (« if you can’t beat them, buy them »), utiliser le fait qu’il dispose d’un pouvoir financier supérieur à un concurrent local pour acheter ce dernier. Le coût d’une telle stratégie est élevé mais sera compensé par le renforcement du pouvoir de marché de l’entité issue de la fusion. Il ne fait aucun doute que ce risque existe, tout comme le risque de constitution d’ententes et d’autres actes de collusion, actes qui n’impliquent pas de transaction financière. C’est pourquoi il est indispensable de mettre en œuvre une politique de la concurrence volontariste. Il ressort d’une revue d’études sur les effets concurrentiels des fusions nationales et transfrontières réalisée par la CNUCED (2000) que la majorité des fusions et acquisitions n’ont pas d’incidence négative sur la concentration des marchés mais que peu de données prouvent qu’elles se traduisent par une baisse des prix – ce qui serait logique, si l’acquisition entraînait une intensification de la concurrence. Au contraire, beaucoup d’études révèlent que les fusions sont souvent suivies d’une hausse des prix.
3.6. Baisse des exportations du pays d’accueil ou augmentation des importations
Il ressort de l’analyse des ventes des multinationales, que l’IDE a pour objectif essentiel l’approvisionnement du marché local ou régional. Des exceptions existent, mais restent rares, même s’il est possible qu’elles soient de plus en plus nombreuses. Comparativement aux investissements de création, les acquisitions étrangères sont généralement perçues comme un moyen d’accéder plus largement au marché local, en particulier à celui de services tels que les services bancaires et d’infrastructure. Par conséquent, l’IDE est perçu comme ayant moins d’effets positifs en termes d’exportations et de renforcement de l’intégration à l’économie mondiale lorsqu’il prend la forme d’acquisitions que lorsqu’il consiste en projets entièrement nouveaux. Parallèlement, on considère généralement qu’un investissement de création a davantage d’incidences sur les importations parce que l’investisseur a besoin de temps pour constituer un réseau de fournisseurs.
Dans le même ordre d’idées, l’autre préoccupation est le risque d’une réduction des exportations de l’entreprise locale, si l’investisseur étranger possède, dans d’autres régions du monde, des filiales présentes sur ces marchés d’exportation. Ce risque est certainement bien réel, de même que l’est celui,
86 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
encore plus important, auquel est exposée toute entreprise locale de voir ses exportations pénalisées par des fournisseurs plus compétitifs originaires d’autres régions. Toutefois, les entreprises multinationales jouant un rôle de canal international pour la circulation des biens et services, il est tout aussi possible que l’entreprise achetée voie ses exportations augmenter suite à l’acquisition. Il s’agit d’une question essentiellement empirique, qui sera débattue ci-dessous. Quel que soit l’effet net sur les exportations et les importations, les politiques devraient être axées sur la composition des échanges plus que sur le solde commercial lui-même. Toutefois, au-delà de l’analyse statique des exportations avant et après l’acquisition, il importe encore davantage de s’interroger sur l’impact à long terme de l’acquisition sur la compétitivité de l’entreprise locale – voire, plus largement, de l’économie d’accueil – sur les marchés d’exportation.
3.7. Secteurs « stratégiques »
La description ci-dessus présente les différents risques séparément, comme s’ils constituaient des phénomènes bien délimités, dont il est possible d’isoler l’impact. S’il est vrai que certains de ces risques peuvent être quantifiés isolément, comme le montre la partie sur les données empiriques, beaucoup d’entre eux sont en interrelation les uns avec les autres. Ainsi, si une acquisition induit une perte de compétences technologiques, il s’ensuivra, in fine, des conséquences sur les exportations, voire, si l’entreprise opère dans un secteur lié à la défense ou fournit des biens intermédiaires à un secteur lié à la défense, sur la sécurité nationale. De surcroît, les pouvoirs publics des pays d’accueil sont nombreux à considérer que cumulés, ces risques sont supérieurs à la somme de chacun d’entre eux : le fait que certains secteurs « stratégiques » restent propriété nationale est perçu comme ayant des effets bénéfiques intangibles sur l’économie.
La liste des secteurs qui pourraient être jugés stratégiques varie d’un pays à l’autre et selon les périodes, mais pourrait inclure n’importe quelle activité. Ainsi, beaucoup de pays considèrent que les activités de production de biens et services faisant appel aux technologies les plus modernes ou encore celles où la demande mondiale devrait croître rapidement sont stratégiques. D’autres activités pourraient être intégrées à la liste au nom de leur contribution à l’emploi ou parce qu’elles fournissent des biens intermédiaires essentiels à beaucoup d’autres secteurs. Beaucoup d’autorités publiques, tant nationales que locales, cherchent, pour des raisons stratégiques, à protéger ou à promouvoir les entreprises qui opèrent dans ces secteurs.2
L’importance attachée aux secteurs stratégiques n’est pas seulement une dimension de la politique industrielle ou de celle de la défense. Les pouvoirs publics pensent pouvoir plus facilement exercer une influence sur les entreprises
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 87
nationales que sur celles qui appartiennent à des intérêts étrangers. Ainsi, dans le secteur des infrastructures, les autorités seraient en mesure de persuader les entreprises de ne pas augmenter trop vite leurs tarifs après une privatisation ; dans le secteur bancaire, les banques nationales pourraient être enclines à suivre les directives des pouvoirs publics et à accorder des prêts à certains secteurs privilégiés. Les propriétaires d’une entreprise nationale seraient également plus faciles à convaincre de fusionner avec d’autres entreprises pour donner naissance à des champions nationaux.
Alors que la déréglementation et la libéralisation des échanges ne menacent l’existence de champions nationaux qu’à long terme, l’acquisition d’entreprises par des intérêts étrangers peut faire disparaître la propriété nationale presque immédiatement. Si rien, dans les statuts des sociétés nationales ou dans la législation du pays, ne fait obstacle à la réalisation d’une telle hypothèse, les pouvoirs publics des pays d’accueil ont peu de moyens à leur disposition pour intervenir. Pour protéger les « champions », ils ont jusqu’à présent eu recours à des discours dissuasifs tenus par les membres les plus haut placés du gouvernement ou recherché le soutien du public pour trouver un « chevalier blanc » ou un autre partenaire pour fusionner avec l’entreprise cible.
La partie suivante présente des études empiriques réalisées pour essayer d’évaluer l’impact économique des fusions et acquisitions étrangères sur la productivité, les exportations, l’emploi et autres variables liées à l’entreprise cible ou, de manière plus générale, à l’économie d’accueil. Cette revue de la littérature empirique est complétée par des études de cas sur l’impact d’acquisitions spécifiques sur les entreprises cibles. Certaines des préoccupations évoquées dans les parties précédentes ne peuvent pas être abordées sous le seul angle de l’analyse empirique et des études de cas. C’est pourquoi les implications plus larges des acquisitions étrangères et des politiques mises en œuvre dans ce domaine seront traitées dans la dernière partie.
4. Données empiriques
Les études empiriques concernant l’impact des opérations transfrontières de fusion et acquisition sur les pays d’accueil se situent entre deux autres catégories de travaux : l’abondante littérature empirique qui analyse l’incidence des fusions et acquisitions sur les résultats de l’entité issue de l’opération, d’une part et les travaux, tout aussi nombreux, sur l’impact des entrées d’IDE sur l’économie d’accueil, d’autre part. Les études sur les opérations transfrontières de fusion et acquisition ont une portée plus large que les travaux appartenant à la première catégorie, souvent axés sur les fluctuations des cours des titres, et plus étroite que les travaux de la deuxième catégorie, qui s’intéressent aux effets de l’IDE sur l’ensemble de l’économie. La plupart des études évoquées ci-
88 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
dessous analysent l’impact du passage d’une entreprise nationale sous contrôle étranger sur ses performances, en se basant sur divers critères, notamment la productivité, l’emploi et la demande de différents niveaux de qualification.
4.1. Travaux empiriques sur les fusions et acquisitions nationales
Les études empiriques sur les fusions et acquisitions sont nombreuses, controversées et non probantes. Par ailleurs, les résultats dépendent du motif de la fusion, qui tend à varier selon les pays, les secteurs d’activité et les périodes. Ils dépendent également du critère retenu (cours des actions, rentabilité, parts de marché, prix des produits, productivité, salaires ou recherche et développement), du scénario contrefactuel (la situation de l’acheteur et de l’entreprise achetée avant et après l’acquisition ou la situation par rapport aux entreprises concurrentes) et de l’horizon temporel (court ou long terme). Deux effets communs à toutes les études se dégagent : l’opération est avantageuse pour les actionnaires de la société achetée (les cours des actions augmentent de 20 à 35 %) et les prix augmentent dans le secteur et le pays.3
Une opération de fusion et acquisition étant justifiée par la volonté de réaliser des gains d’efficience en créant des synergies, il est surprenant que ces gains soient fréquemment peu évidents dans les tests empiriques. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce paradoxe apparent. La première est que les fusions et acquisitions nationales aboutissent à des résultats médiocres parce qu’elles ont souvent été réalisées à partir d’une position peu favorable dans un contexte de diminution de la part de marché. L’industrie automobile britannique, qui en quelques décennies a connu un mouvement de concentration qui a abouti à sa disparition, est emblématique de cette situation. Selon Davis et al. (1993) : « les opérations nationales de fusion n’ont pas vraiment conduit à une amélioration des performances intérieures. Elles visaient d’abord à créer des économies d’échelle – qui se sont révélées illusoires – au sein de marchés uniques. »4
Une autre des raisons avancées pour expliquer les résultats contrastés des fusions est l’orgueil démesuré des dirigeants, qui seraient plus motivés pour augmenter la taille de leur entreprise que pour améliorer ses résultats. Bien que cette hypothèse aille dans le sens de la défiance qui prévaut aujourd’hui vis-à-vis des dirigeants d’entreprise, il ne paraît pas plausible que les marchés financiers puissent être systématiquement influencés par la perspective illusoire de gains d’efficience, en particulier lorsque les actions de l’entreprise acquéreuse tendent à ne connaître, au mieux, qu’une hausse modeste après la fusion. Un autre facteur d’explication tient au fait que, même si l’acquéreur retire peu de gains de la fusion, elle lui permet au moins d’éliminer le risque de voir un concurrent acheter l’entreprise cible. « Il est logique pour les entreprises
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 89
de réaliser des opérations d’acquisition qui ont un impact négatif sur leurs perspectives de bénéfices dans les situations où ces opérations visent à empêcher des acquisitions qui seraient encore plus dommageables pour leurs résultats ».5
Certaines études montrant qu’une fusion peut être bénéfique aux deux entreprises, il suffit que les investisseurs soient convaincus que tel est le cas de la fusion qu’ils envisagent pour réaliser leur projet. En outre, on pense en général que chaque nouvelle vague de fusions et acquisitions est différente de celles qui l’ont précédée. Du fait que la diversification concerne de plus en plus, non plus les marchés de produits, mais les marchés géographiques, les conglomérats cédant la place aux entreprises multinationales, d’aucuns avancent que les opérations transfrontières de fusion et acquisition aboutiraient à de meilleurs résultats que les opérations nationales traditionnelles parce qu’elles sont sous-tendues par une logique plus saine. Par exemple, dans l’étude déjà citée, Davis et al. (1993) avancent qu’après 1992 les opérations transfrontières de fusion et acquisition réalisées en Europe avaient plus de chance d’être bénéfiques que les fusions nationales parce qu’elles « créaient réellement des marchés uniques en améliorant la pénétration de produits prometteurs sur des marchés auparavant fermés ».6
La question de l’impact des fusions n’est pas encore tranchée, mais une revue de la littérature semble plaider en faveur de l’existence d’effets économiques bénéfiques. Ainsi, dans une telle revue, Norbäck et Persson (2005) aboutissent aux conclusions suivantes : 1) les fusions jouent un rôle important dans les changements structurels ; 2) elles permettent un transfert des compétences technologiques et administratives entre les entreprises ; 3) elles jouent un rôle important pour l’introduction de nouvelles technologies dans l’économie ; 4) elles aboutissent à une concentration efficiente des secteurs qui pâtissent d’un excès de capacités et 5) elles contribuent au transfert des capacités des secteurs et entreprises en déclin vers ceux qui ont un fort potentiel de croissance.
Les études empiriques des fusions et acquisitions transfrontières examinées ci-après ont en général été réalisées selon une approche différente des études plus générales sur les fusions et acquisitions. Elles sont axées, non pas sur les résultats de l’entité issue de la fusion, mais sur ceux de l’entreprise locale acquise par l’investisseur étranger, puisqu’ils constituent les principaux effets en termes de bien-être du point de vue des décideurs nationaux. En outre, le critère de référence sur lesquels elles reposent est, non pas le cours de l’action, mais l’impact sur l’emploi, les exportations, les activités de R&D locales et la survie même de l’entreprise achetée.
90 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Tableau 4.1. Études empiriques montrant que les entreprises sous contrôle étranger réalisent de meilleurs résultats
Auteurs Année Pays
Doms et Jensen 1998 États-Unis
Feliciano et Lipsey 1999 États-Unis
Griffith et Simpson 2002 Royaume-Uni
Girma, Greenaway, Wakelin 2001 Royaume-Uni
Girma et Görg 2003 Royaume-Uni
Conyon, Girma, Thompson, Wright 2002 Royaume-Uni
Fukao, Ito, Kwon 2004 Japon
Fukao et Murakami 2003 Japon
Kimura et Kiyota 2003 Japon
Aitken, Harrison, Lipsey 1996 Mexique
Heyman, Sjöholm, Tingvall 2004 Suède
Almeida 2004 Portugal
Kertesi et Kollo 2001 Hongrie
Cseng di, Jungnickel, Urban 2005 Hongrie
4.2. Études empiriques sur les acquisitions d’entreprises locales par des intérêts étrangers
Les données empiriques montrent indubitablement que les entreprises contrôlées par des intérêts étrangers sont plus performantes que leurs concurrentes locales dans le pays d’accueil : elles obtiennent de meilleurs résultats en termes de productivité du travail, d’investissement, d’intensité de compétence et de R&D, elles rémunèrent mieux leurs salariés et sont plus rentables. Le tableau 1 énumère des études qui portent sur divers pays de l’OCDE et tendent à corroborer au moins une de ces conclusions.
Au niveau agrégé, certains de ces écarts – par exemple le niveau plus élevé des salaires – peuvent s’expliquer par divers facteurs : taille, intensité capitalistique, âge, implantation et secteur d’activité de l’entreprise sous contrôle étranger par rapport aux entreprises locales. Ainsi, Globerman et al. (1994), considèrent que ces facteurs peuvent expliquer l’écart entre les entreprises canadiennes et les entreprises sous contrôle étranger établies au Canada. Graham et Krugman (1995) font peu ou prou la même analyse concernant les entreprises sous contrôle étranger établies aux États-Unis. Toutefois, il ressort des études qui figurent dans le tableau que l’écart entre les deux catégories d’entreprises persiste même après neutralisation de ces facteurs d’explication.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 91
Plusieurs raisons pourraient expliquer que les investisseurs étrangers rémunèrent mieux leur personnel que les entreprises locales : une volonté d’éviter la rotation du personnel, soit pour limiter les retombées technologiques potentielles sur d’autres entreprises présentes sur le marché ou parce que les nouveaux entrants doivent faire face à des coûts de recherche plus élevés pour recruter ; la plus forte rentabilité des entreprises sous contrôle étranger, qui leur permet d’avoir une meilleure « capacité à payer » (dans l’hypothèse de marchés du travail imparfaits) ; le partage des rentes entre des entreprises oligopolistiques ; un niveau de formation plus élevé dans les entreprises sous contrôle étranger ; une plus grande volatilité de la demande ou un risque de fermeture plus élevé pour les entreprises sous contrôle étranger.
Le fait que les entreprises sous contrôle étranger sont plus performantes que les entreprises locales pourrait notamment s’expliquer par le phénomène dit de sélection ou de « picorage », les investisseurs étrangers achetant des entreprises locales qui affichent déjà de bons résultats dans l’économie d’accueil et qui, par conséquent, correspondent le mieux à leur profil. Bien que beaucoup d’études confirment son existence, ce phénomène n’explique qu’une partie de l’écart entre entreprises locales et entreprises sous contrôle étranger. Toutes les études présentées ci-après prennent cet écart comme point de départ et cherchent à expliquer la prime que les entreprises sous contrôle étranger offrent en termes de rémunération. D’un point de vue méthodologique, les auteurs ont en général cherché à isoler précisément l’impact d’une acquisition étrangère en étudiant l’entreprise cible avant, pendant et après l’opération. Bien que de nombreux pays aient des carences en matière de bases de données sur les entreprises, les études ci-après constituent un échantillon représentatif des situations rencontrées dans les pays de l’OCDE.
Calderon et al. (2004) ont exploré le lien de causalité entre l’IDE de création7 et les opérations transfrontières de fusion et acquisition et leur influence respective sur l’investissement et la croissance au niveau national, dans les pays développés et en développement. Il en ressort qu’un plus grand nombre d’opérations transfrontières de fusion et acquisition dans une économie conduit ensuite à une augmentation de l’investissement de création, tandis que l’inverse n’est vrai que dans les pays en développement. Les fusions et acquisitions étrangères ne représentent pas seulement ponctuellement un changement de propriété : elles encouragent, dans le pays d’accueil, l’IDE de création, qui connaît une progression au moins égale à la hausse initiale des fusions et acquisitions et nettement plus marquée dans les pays en développement. Parmi les autres variables, l’investissement national suit l’IDE, tandis que la croissance a tendance à le précéder, que l’on considère les investissements de création ou les opérations transfrontières de fusion et acquisition.
92 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Comment expliquer que l’acquisition d’une entreprise nationale par des intérêts étrangers puisse induire, dans les années qui suivent, une hausse de l’IDE dans le pays d’accueil ? La raison en est peut-être qu’en investissant à l’étranger, une multinationale étrangère en incite d’autres, par exemple des fournisseurs ou des concurrents, à faire de même et à établir leurs installations dans le pays ou fait indirectement la promotion du pays d’accueil en tant que destination d’investissements. Il est également possible que les acquisitions étrangères qui renforcent la qualité des infrastructures ou améliorent indirectement le climat local des affaires jouent un rôle incitatif sur les investisseurs potentiels de tous les autres pays.
En outre, l’investisseur étranger qui a acquis une entreprise est souvent amené à effectuer d’autres dépenses par la suite pour injecter, dans l’entreprise locale, des liquidités en plus du prix d’achat. Ainsi, dans le secteur des infrastructures, la vente d’une entité publique à un investisseur privé est fréquemment suivie par d’importants investissements visant à améliorer la qualité et à étendre la couverture. Yun (2000) estime, en ce qui concerne la Corée, que les investissements effectués après une acquisition sont supérieurs à ceux induits par un investissement de création, même si son étude porte sur une période courte. De même, d’après une étude sur la Pologne citée par la CNUCED (2000), pendant la période de privatisations, au début des années 90, les entités privatisées contrôlées par des intérêts étrangers ont beaucoup plus investi que les entreprises achetées par des investisseurs polonais.8
Autre question : est-ce parce qu’elles bénéficient de transferts de savoir-faire de leur société mère que les entreprises sous contrôle étranger sont plus performantes que les entreprises nationales ou est-ce parce qu’elles étaient déjà particulièrement florissantes au moment de l’acquisition ? Pour faire la part entre le phénomène de sélection et l’impact du passage sous contrôle étranger en tant que tel, on a examiné les entreprises locales avant et après leur acquisition par un investisseur étranger. Dans une étude sur les acquisitions d’entreprises par des intérêts étrangers au Portugal, Almeida (2004) constate, même après avoir neutralisé les effets du secteur, de la région et la taille et de l’âge de l’entreprise, que les entreprises étrangères versent des salaires nettement plus élevés, à tous les niveaux de qualification. Cette prime augmente avec la qualification (mesurée sur la base du nombre d’années d’étude). Les investisseurs étrangers choisissent des entreprises locales dont les caractéristiques sont déjà très proches d’autres entreprises du pays d’accueil contrôlées par des intérêts étrangers en termes de qualification et de rémunération du personnel. Parallèlement, l’acquisition entraîne une légère hausse de la productivité et des salaires dans l’entreprise cible – en particulier aux niveaux de qualification élevés. C’est l’opération d’acquisition, plus que le passage sous contrôle étranger en tant que tel, qui est à l’origine de ces
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 93
améliorations, ce qui porte à croire que les fusions et acquisitions nationales pourraient produire les mêmes effets.9
Heyman et al. (2004, 2005) ont étudié spécifiquement l’effet des acquisitions étrangères sur la situation individuelle des travailleurs en Suède.Comme dans d’autres pays, les investisseurs étrangers versent des rémunérations plus élevées (de 20 % en moyenne) et emploient un personnel relativement qualifié. Heyman et al. (2004) constatent que l’essentiel de cette différence correspond à un effet de composition, puisque les entreprises sous contrôle étranger ont généralement une main d’œuvre plus qualifiée : en d’autres termes, à qualification égale, elles ne rémunèrent pas mieux leurs salariés que les entreprises suédoises. En outre, même si, au départ, les salaires sont globalement plus élevés à tous les niveaux de qualification, ils tendent à progresser moins vite dans les entreprises sous contrôle étranger. De plus, les entreprises sous contrôle étranger établies en Suède ont des caractéristiques similaires aux multinationales suédoises, ce qui porte à croire que la multinationalité importe plus que le fait d’être sous contrôle étranger.
Heyman et al. (2005) ont étudié les changements affectant les salariés à tous les niveaux de qualification, afin de déterminer si l’acquisition d’entreprises suédoises par des intérêts étrangers contribue à augmenter la dispersion des salaires entre les niveaux de qualification. L’acquisition tend à induire une hausse des salaires du personnel très qualifié, du moins des dirigeants et directeurs généraux, et une baisse de la rémunération des travailleurs peu qualifiés. Selon toute vraisemblance, les investisseurs étrangers cherchent à s’attacher la fidélité des dirigeants pour garantir la continuité. Les auteurs constatent également que les modifications de la rémunération sont dues à l’acquisition plutôt qu’au passage sous contrôle étranger, puisque le rachat par des intérêts nationaux d’une entreprise sous contrôle étranger a les mêmes conséquences sur la dispersion des salaires.
Cseng di et al. (2005) ont étudié les effets des acquisitions étrangères sur les salaires en Hongrie. Ils constatent, même après neutralisation de l’effet des caractéristiques des salariés et de l’entreprise, que les entreprises sous contrôle étranger paient une prime de 15 % par rapport aux entreprises hongroises ; toutefois, même avant l’acquisition, l’entreprise locale rémunérait déjà ses salariés 11 % de plus que la moyenne (résultat obtenu après neutralisation de l’effet des caractéristiques des salariés, du lieu d’implantation, du secteur d’activité et des caractéristiques de l’entreprise). Dans les entreprises achetées, les salaires baissent immédiatement après l’acquisition, puis augmentent lentement pour dépasser les niveaux initiaux, de sorte qu’à long terme, la prime est nettement plus élevée qu’avant l’acquisition. L’opération est également suivie d’une amélioration de la PTF et de l’emploi (11 %).
94 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Le niveau plus élevé des salaires concourt à expliquer pourquoi la rotation du personnel ralentit après l’acquisition. Bien qu’elle semble indiquer que l’acquisition est favorable aux salariés, cette faible rotation limite les retombées que l’opération pourrait, en favorisant la mobilité du personnel, avoir sur l’ensemble de l’économie, si bien que, les autres entreprises locales ne semblent guère réaliser de gains de productivité suite à l’acquisition.
Les acquisitions étrangères ont une incidence plus forte sur les salaires que le passage sous contrôle étranger lui-même (l’investissement de création est inclus). Leur répercussion sur les salaires varie également selon la qualification des salariés. À la différence du reste du personnel, les travailleurs qui ont une formation de type professionnel ou de niveau inférieur ne voient pas leur salaire augmenter après une acquisition. Dans le modèle construit par les auteurs, ce résultat s’explique par le fait que l’investisseur étranger n’a pas autant besoin d’empêcher la rotation du personnel non qualifié, ce dernier étant beaucoup moins susceptible de contribuer à ce que les autres entreprises du pays bénéficient de retombées positives.
Le Japon est l’un des pays de l’OCDE où le taux de pénétration de la participation étrangère à l’économie est le plus faible. La raison communément avancée pour expliquer cette situation est que l’écart technologique entre les entreprises japonaises et celles d’autres pays, qui pourrait se traduire par une plus grande présence locale d’entreprises étrangères, est faible. Il est donc intéressant de se demander si les résultats obtenus pour des pays de l’OCDE plus petits et moins développés sont également observés au Japon. Fukao et al.(2004) ont étudié les acquisitions étrangères d’entreprises japonaises. Au Japoncomme ailleurs, les entreprises sous contrôle étranger sont plus productives et versent des salaires plus élevés que les entreprises locales. Elles affichent également une PTF 5 % plus élevée, des rendements du capital et une densité de R&D supérieurs et ont à la fois une intensité capitalistique plus forte et une meilleure rentabilité. Dans un contexte dynamique, les acquisitions étrangères améliorent à la fois la rentabilité et la PTF des entreprises cibles, même si ces dernières sont déjà plus productives que l’entreprise japonaise moyenne. Les acquisitions n’induisent en revanche pas d’amélioration de l’emploi. Dans une étude de suivi plus détaillée, Fukao et al (2006) ont examiné séparément le secteur manufacturier et celui des services et ont constaté que l’amélioration de la PTF était plus marquée dans le secteur des services – ce qui n’est peut-être pas surprenant compte tenu que ce secteur est généralement jugé moins dynamique que le secteur manufacturier.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 95
Encadré 4.1. Étude de cas : Renault (France) – Nissan (Japon)
Les fusions transfrontières sont courantes dans le secteur automobile, où elles ciblent souvent des entreprises en difficulté financière ou jugées trop petites pour affronter seules la concurrence sur le marché mondial (Daimler-Chrysler, Ford-Volvo, Ford-Isuzu, GM-Daewoo, BMW-Rover, Renault-American Motors). Nombre de ces opérations n’ont pas abouti à des résultats à la hauteur des attentes initiales. Toutefois, l’alliance conclue en 1999 entre Renault (France) et Nissan (Japon), fait exception à cette règle. Au lieu d’opter pour une fusion pure et simple, Renault a versé 5.1 milliards USD pour acquérir une participation de 44 % dans le capital de Nissan, tandis que Nissan prenait une participation de 15 % dans le capital de Renault. À l’époque, Nissan était le huitième constructeur automobile du monde et Renault le dixième.
Malgré la structure de l’alliance, c’est sans conteste Renault qui était aux commandes du fait que Nissan avait obtenu de mauvais résultats pendant la majeure partie des années 90 et avait accumulé plus de 20 milliards USD de dettes. De ce point de vue, l’alliance s’apparentait à une opération de sauvetage et ressemblait davantage aux fusions entre entreprises japonaises qu’à d’autres acquisitions transfrontières d’entreprises nipponnes. Toutefois, il est peu probable qu’une fusion de Nissan avec un autre constructeur automobile japonais – même si elle avait été autorisée par le droit de la concurrence – aurait permis d’obtenir les mêmes résultats.
Avant l’alliance, Nissan avait pâti d’une mauvaise gestion et du réseau de liens qui l’unissait aux fournisseurs (système kereitsu). Beaucoup de ces fournisseurs étaient dirigés par d’anciens salariés du constructeur, de sorte qu’il était difficile de réduire les coûts en introduisant de la concurrence dans la chaîne d’approvisionnement. Même si la nécessité du changement était largement reconnue, les dirigeants de l’entreprise japonaise n’auraient guère été en mesure de démanteler le système keiretsu, qui caractérisait la majeure partie de l’industrie japonaise depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ou de mettre en œuvre les changements radicaux qui devaient s’opérer par la suite.
Carlos Ghosn, dirigeant de Renault, avait déjà une réputation de « tueur de coûts ». Lorsqu’il est arrivé à la tête de Nissan, il a réduit le nombre de participations croisées, le faisant passer de 1 400 à 4, a fermé 5 sites et supprimé 21 000 emplois sur 150 000 du fait du départ normal de salariés ou de mises en préretraite. Certains des fournisseurs existants étaient au bord de la faillite. Curieusement, alors que ces mesures auraient auparavant été tabou au Japon, Carlos Ghosn est presque passé pour un héros.
Nissan a renoué avec les bénéfices en 2001. La marque avait toujours était respectée pour sa technologie et son ingénierie avancées, sa productivité et sa gestion de la qualité totale. Elle était cependant mal gérée et la structure qui avait fait son succès pendant des décennies ne fonctionnait plus. Renault a précisément apporté ses compétences en matière de gestion. Cet exemple témoigne du rôle vital que peuvent jouer les acquisitions dans la restructuration des entreprises. Les dirigeants en place sont parfois dans l’incapacité de mettre en œuvre les réformes dont chacun, y compris les dirigeants eux-mêmes, reconnaît la nécessité. Dans certains cas, la restructuration intervient entre deux entreprises nationales. Toutefois, en l’espèce, on peut avancer que la dimension internationale a joué un rôle capital du fait que les changements nécessaires étaient encore relativement étrangers à la culture d’entreprise japonaise.
96 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Paradoxalement, ce sont les Japonais qui ont investi en Europe et en Amérique du Nord dans les années 80 et 90 qui ont contribué à la diffusion de la culture de production du juste-à-temps et de la production au plus juste sur ces marchés. Aujourd’hui, la surcapacité croissante dont souffre le secteur automobile dans les pays de l’OCDE permet aux forces occidentales traditionnelles en matière de maîtrise des coûts de retrouver leurs lettres de noblesse et d’être diffusées dans l’autre sens, par le canal de l’IDE.
À noter qu’au cours du premier semestre 2006, le bénéfice opérationnel du groupe Nissan a baissé de 15 %, ce qui constitue la première baisse en huit ans. La production nationale et la production à l’étranger ont l’une et l’autre reculé, de même que les ventes intérieures et les exportations, alors qu’au cours de la même période, Toyota et Honda connaissaient une expansion rapide aux États-Unis. « Les analystes se demandent maintenant si Carlos Ghosn n’a pas accordé trop d’importance à ses « engagements » à court terme, autrement dit à ses objectifs de ventes, au détriment de la croissance et de la productivité à plus long terme. »
Les auteurs de ces deux études sur le Japon se sont également intéressés aux fusions entre entreprises japonaises. À la différence des opérations transfrontières, qui ont en général pour cible des entreprises qui font partie des plus performantes, les fusions entre entreprises nationales concernent souvent des entreprises moins performantes que la moyenne et ont donc plus souvent des allures « d’opérations de sauvetage ». Toutefois la description de l’alliance Renault-Nissan semble indiquer que les acquisitions transfrontières peuvent également être des opérations de sauvetage.
Girma et Görg (2003) ont examiné les conséquences, en termes de survie des entreprises locales et d’évolution de l’emploi, des acquisitions étrangères d’entreprises dans les secteurs alimentaire et de l’électronique au Royaume-Uni. Du point de vue de la croissance de l’emploi, ils ont constaté que ces opérations induisaient peu de changement pour l’emploi qualifié dans ces deux secteurs et entraînaient un net ralentissement de la croissance de l’emploi non qualifié dans le secteur de l’électronique, mais pas dans le secteur alimentaire. Selon les auteurs, ce résultat « s’expliquerait plus par le fait que la hausse de la productivité du travail dépasse celle de la production que par des destructions d’emplois liées à une baisse de la production ».10 Concernant la survie des entreprises, les régressions montrent qu’une acquisition étrangère réduit la durée de vie de l’entreprise acquise, aussi bien dans le secteur alimentaire que dans celui de l’électronique, même si les résultats sont sensibles aux spécifications du modèle. L’une des raisons pourrait en être que le réseau de distribution, le savoir-faire technologique et autres ressources de l’entreprise cible – comme les marques – intéressent davantage l’investisseur multinational que les capacités productives de ladite entreprise sur le marché concerné. Un autre facteur d’explication pourrait être que même si l’entreprise acquise est relativement performante par rapport à d’autres entreprises locales, ses résultats
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 97
peuvent être médiocres comparativement à ceux des entreprises étrangères. Il est possible que l’investisseur estime que le marché peut-être approvisionné à moindre coût par ses filiales établies dans d’autres pays.
Le ministère américain du Commerce et de l’Industrie (DTI, 2004), a constaté, en se basant notamment sur des données établies par Hubert et Pain (2000), que les acquisitions étrangères pouvaient avoir des effet positifs au-delà, non seulement de l’entreprise, mais aussi du secteur cible. D’après l’étude du DTI, les entreprises cibles ont des retombées importantes, à la fois intra- et intersectorielles. Il arrive que les investisseurs étrangers adoptent des stratégies visant à éviter que leurs concurrents les plus proches bénéficient de retombées de connaissance ; en revanche, rien ne les incite à tenter d’empêcher que leur présence ait des effets bénéfiques sur la société dans son ensemble.
Encadré 4.2. Étude de cas : Vodafone (Royaume-Uni) – Mannesmann (Allemagne)
Au moment de l’opération, Mannesmann était un conglomérat allemand de renom et était la deuxième entreprise de l’indice DAX par la taille. Fondée en 1890, l’entreprise n’était présente sur le marché des télécommunications que depuis 1990, même si, en 1999, elle réalisait la plus grande partie de son chiffre d’affaires dans ce secteur. Vodafone, qui a lancé des services de téléphonie mobile en 1986, avait à peine vingt ans d’existence à l’époque de l’opération. Contrairement à la plupart des autres grandes entreprises de télécommunication, l’opérateur n’offrait que des services de téléphonie mobile, ce qui lui a permis de devenir numéro un mondial de ce secteur. Par ailleurs, alors que Mannesmann visait essentiellement le marché européen – qui était le plus grand marché de la communication mobile – Vodafone était présent dans 24 pays.
L’offre d’achat lancée par Vodafone sur Mannesmann était l’une des premières offres d’achat hostiles de l’histoire allemande et la plus grosse fusion jamais envisagée dans le monde. Elle avait manifestement été motivée par l’entrée de Mannesmann sur le marché britannique. D’après la presse, le président de Vodafone jugeait l’initiative de l’entreprise allemande « contraire à l’accord tacite par lequel les opérateurs s’interdisaient mutuellement de se faire concurrence sur leurs territoires respectifs ». Dans un premier temps, l’offre a été rejetée par le président de Mannesman, qui, selon Höpner et Jackson (2001) « n’a jamais remis en cause le fait qu’il appartient aux seuls actionnaires de décider du sort de l’entreprise ». 60 % des actionnaires n’étaient pas allemands et, les deux tiers d’entre eux étaient soit britanniques, soit américains. Mannesmann était moins lié par des accords de participation croisée et autres liens avec les banques que beaucoup de grandes entreprises allemandes. L’engagement à ne pas licencier a emporté l’accord des représentants du personnel qui siégeaient au conseil de surveillance. Le président a finalement accepté l’offre et les actionnaires de Mannesmann ont gagné 100 millions d’euros, le titre ayant progressé de 120 % en quatre mois.
La lutte pour l’acquisition de Mannesmann découlait pour l’essentiel du fait que les deux entreprises avaient des conceptions commerciales différentes. Vodafone plaidait en faveur d’une stratégie ciblant exclusivement les abonnés de la téléphonie mobile et reposant sur une présence mondiale. Au contraire, Mannesmann avait une stratégie
98 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
axée sur le marché européen et estimait qu’il devait être « un fournisseur opérant à la fois sur les segments de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et des services Internet (…) parce que les produits intégrés répondent mieux à la demande des clients et permettent de dégager des recettes moyennes par utilisateur plus élevées ».
Si le titre des deux entreprises affichait de bonnes performances avant la fusion, du fait de la croissance rapide du secteur, les marchés financiers ont semblé faire confiance à l’approche de Vodafone. Comme le soulignait the Economist, « la stratégie [de Vodafone] était audacieuse, lumineuse et extrêmement fructueuse » pendant 20 ans. Aujourd’hui, cette approche est toutefois remise en cause par les marchés et la performance de l’action Vodafone est en deçà de celle de l’indice FTSE 100 depuis début 2005. La stratégie mondiale de l’opérateur et sa spécialisation dans la téléphonie mobile sont maintenant l’une et l’autre considérées comme des faiblesses : sur le segment de l’équipement, les économies d’échelle sont limitées par le fait que les spécifications ne sont pas les mêmes sur les principaux marchés ; on prévoit une baisse du prix des services de téléphonie mobile ; on assiste à une convergence de la téléphonie mobile, des technologies à large bande, des services de télévision et des services sans fil.
Dans un secteur qui évolue rapidement du fait de la déréglementation et du progrès technologique, une entreprise peut fort bien être numéro un du marché un jour et se retrouver dans le peloton de queue quelques années plus tard. Vodafone continue de miser sur le fait que le processus de convergence sera sans incidence majeure sur la demande dont ses services font l’objet. Mais les marchés financiers commencent à penser différemment. Or, ce sont eux qui ont donné à l’opérateur le pouvoir financier de mettre en œuvre son expansion mondiale, notamment de réaliser l’acquisition de Mannesmann, entièrement financée par actions.
En ce qui concerne Mannesmann, la division des télécommunications a été rebaptisée Vodafone AG et les autres parties de l’entreprise ont rapidement été vendues à Bosch et Siemens. Selon Höpner et Jackson (2001), durant l’année qui a suivi la fusion, le moral du personnel était bas et nombre de salariés ont quitté l’entreprise pour rejoindre la concurrence, même si l’on a pu lire dans le Financial Times que « [m]ême ceux qui étaient sceptiques reconnaissent que les salariés de la division téléphonie mobile de Mannesmann estiment, dans l’ensemble, avoir été traités équitablement ».
4.3. Acquisitions étrangères et exportations du pays d’accueil
L’une des raisons qui incitent les pouvoirs publics des pays d’accueil à déployer autant d’efforts pour attirer des investissements de création est qu’ils espèrent voir ces investissements entraîner une hausse des exportations. Au contraire, les fusions et acquisitions transfrontières sont souvent considérées comme risquant de produire l’effet inverse, par exemple parce que la société mère estime parfois que les marchés d’exportation seront mieux desservis par ses filiales établies dans d’autres pays. Une revue d’études sur la situation des pays d’Europe centrale et orientale en matière d’investissement étranger et d’exportations, réalisée par la CNUCED (2000), aboutit à des résultats contrastés : en Hongrie, les investisseurs qui créent de nouveaux projets tendent
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 99
à exporter davantage que ceux qui achètent des entreprises, alors qu’en République tchèque, aucune différence notable n’est constatée entre ces deux catégories d’investisseurs, même si l’acquisition de l’entreprise tchèque Skoda par Volkswagen a été suivie par une hausse des exportations de Skoda, qui sont passées de 34 % des ventes en 1990 à 80 % en 1999.
Une récente étude approfondie sur les multinationales au Royaume-Uni apportera peut-être un nouvel éclairage sur les stratégies d’exportation des entreprises sous contrôle étranger. D’une part, Girma et al. (2005) ont en effet constaté une probabilité nettement plus forte de voir les investisseurs étrangers acquérir des entreprises déjà exportatrices. D’autre part, en examinant, sur la base de données recueillies au niveau des entreprises, l’impact des acquisitions étrangères sur l’intensité d’exportation des entreprises du secteur manufacturier, ils sont parvenus à la conclusion que non seulement les entreprises sous contrôle étranger ont plus de chances d’exporter que les entreprises locales, mais aussi que celles qui exportent ont une intensité d’exportation supérieure à celle des entreprises locales.
La question des exportations des entreprises sous contrôle étranger s’inscrit dans le cadre d’une problématique plus large, à savoir celle de l’impact des entrées d’IDE sur les échanges. Bien que l’impact global des entrées d’IDE soit difficile à quantifier, on peut, en toute logique, penser que si les entreprises sous contrôle étranger se révèlent en général plus performantes que les entreprises locales, c’est parce qu’elles sont plus compétitives sur les marchés d’exportation.
4.4. L’impact des acquisitions étrangères sur les activités de R&D des entreprises locales
Les travaux empiriques n’apportent pas de réponse tranchée à la question de l’impact des acquisitions étrangères sur les capacités de R&D existantes. La CNUCED (2000, p. 177) souligne que « dans plusieurs entreprises acquises en Amérique latine, les capacités de R&D ont été supprimées ou réduites du fait que la production a été réorientée vers des activités à moindre intensité technologique ». Toutefois, le rapport de la CNUCED cite également des exemples dans lesquels les activités de R&D ont été développées dans l’entreprise acquise. Ainsi, dans le cas de Samsung, en Corée, la division équipement de construction, alors en difficultés, s’est vue attribuer un mandat mondial après sa vente à Volvo en 1998. Le même phénomène s’est produit en ce qui concerne la fusion GE-Tungsram, qui, au final, a permis le développement des activités de R&D de l’entreprise hongroise (voir étude de cas). Le tableau 4.2 recense plusieurs études de cas portant sur des pays développés et en développement.
100 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Tableau 4.2. Études sur l’impact de l’investissement étranger sur la R&D nationale
Auteurs Pays ou régionétudiée
Constatations
Cassiman et al. (2004)
UE L’acquisition a été suivie par une réduction ou un recentrage des activités de R&D. Plus grande tendance des salariés occupant des postes clés à quitter l’entreprise.
Velho (2004), Cimoli (2001)
Amérique latine
Les activités de R&D ont été réduites ou transférées dans le pays d’origine de l’acquéreur ou dans un pays tiers.
Costa (2005), Queiroz et al.(2003)
Brésil Les activités de R&D d’une entreprise dotée d’un haut niveau de compétences technologiques ont été développées, tandis que celles d’une autre ont été supprimées. Plusieurs grandes multinationales ont d’abord réduit leurs capacités de R&D mais les ont ensuite reconstituées pour renforcer leur compétitivité sur le marché.
Kalotay & Hunya (2000)
Europecentrale et orientale
Dans 23 grandes entreprises privatisées, la croissance des dépenses de R&D a ralenti et les dépenses de R&D en pourcentage des ventes ont accusé un net recul.
Griffith et al.(2004)
Royaume-Uni
L’acquisition étrangère a eu peu d’effets négatifs, les fermetures d’installations de R&D étant restées peu nombreuses.
Munari & Sobrero(2005)
Huit pays européens
Les dépenses de R&D en pourcentage des ventes ont reculé, mais les résultats se sont améliorés en termes de qualité et de nombre de brevets.
Rugman & D’Cruz (2003)
Canada Dans l’industrie chimique, deux gros investisseurs étrangers ont fermé leurs installations de R&D locales et un investisseur étranger a agrandi les siennes.
Source : Études recensées dans CNUCED (2005), p. 191.
Nombre des études recensées dans le tableau 4.2 montrent que l’IDE entraîne une diminution des activités de R&D de l’entreprise achetée. Pour autant, cela ne suffit pas à prouver que l’investissement étranger induit une diminution globale des activités de R&D. Dans certains cas, en particulier dans les entreprises publiques, les dépenses consacrées à la R&D peuvent ne pas être justifiées du point de vue de leur qualité et de leur efficience. Dans de tels cas, la fermeture des installations consécutive à l’acquisition étrangère permet de libérer des ressources qui peuvent être consacrées à des activités de R&D dans d’autres secteurs de l’économie. In fine, l’impact en termes de bien-être varie selon que les activités de R&D existantes avaient ou non des retombées positives sur le reste de l’économie, même si elles manquaient d’efficience.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 101
5. Synthèse et enseignements à tirer du point de vue des politiques publiques
D’un point de vue économique, il n’est guère justifié que les responsables de l’action publique fassent une distinction entre deux catégories d’IDE : celui qui serait « bon » (par exemple l’investissement de création) et celui qui « poserait problème » (acquisitions transfrontières de grandes entreprises). D’après les données empiriques, la supériorité attribuée à l’investissement de création – en termes de création nette d’emplois et de renforcement des capacités d’exportation – ne concerne pas les principaux effets bénéfiques de l’IDE, qui sont notamment, comme l’a souligné l’OCDE (2002), les gains de productivité, et qui existent en général quel que soit le mode d’entrée de l’investisseur sur le marché.
Il ne faut pas pour autant en déduire que tout projet d’investissement sert nécessairement l’intérêt public. Les autorités des pays d’accueil craignent notamment une perte de capacités technologiques, ou, en l’absence de réel transfert de technologies à l’extérieur de l’économie d’accueil, une perte des avantages compétitifs conférés par ces capacités. Par ailleurs, la transformation d’une entité indépendante en filiale comporte un risque de réduction des activités de R&D et du nombre d’emplois à valeur élevée dans le pays d’accueil. Il faut également que les autorités se protègent d’éventuels effets anticoncurrentiels des opérations transfrontières de fusion et acquisition, non seulement en termes de production finale mais aussi du point de vue de tous les aspects des chaînes de valeur des entreprises concernées. Au niveau politique, il n’est pas exclu que les pouvoirs publics soient peu enclins à accueillir favorablement les opérations transfrontières réalisées par des entreprises dont le pays d’origine ne garantit pas une réciprocité d’accès. Reste à savoir si ces inconvénients potentiels des opérations transfrontières de fusion et acquisition l’emportent ou non sur leurs effets bénéfiques.
De nombreuses données empiriques montrent que les opérations transfrontières de fusion et acquisition ont, sur les entreprises cibles, des effets bénéfiques qui l’emportent largement sur les effets négatifs. Bien que les études empiriques n’aboutissent pas à des conclusions unanimes – en particulier parce qu’il est difficile de déterminer comment aurait évolué l’entreprise cible dans un autre scénario –, elles portent à croire que l’impact positif concerne surtout la productivité. Après une acquisition transfrontière la plupart des entreprises cibles voient leur efficience opérationnelle, et, partant, leur compétitivité internationale, s’améliorer. En outre, sans doute du fait de ces gains de productivité, les acquisitions transfrontières tendent à avoir un impact positif sur les salaires du personnel, en particulier du personnel qualifié, de l’entreprise acquise.
102 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Il n’en reste pas moins que, même si les opérations transfrontières de fusion et acquisition sont bénéfiques aux entreprises acquises, les responsables de l’action publique doivent s’interroger sur le point de savoir si leur impact sur l’économie dans son ensemble est lui aussi positif. Les études d’impact macroéconomique directement axées sur les fusions et acquisitions sont rares voire inexistantes mais, comme cela a déjà été souligné, les effets des fusions et acquisitions sur l’économie d’accueil sont le plus souvent semblables à ceux de l’IDE en général.
Il ressort d’une étude complète des données disponibles réalisée il y a quelques années par le Comité de l’investissement (OCDE, 2002) que les effets positifs macroéconomiques des entrées d’IDE l’emportent sur leurs coûts dans la majorité des cas. Les données empiriques réalisées à ce jour autorisent à affirmer qu’en règle générale, l’investissement direct de l’étranger contribue à la hausse de la PTF et, par conséquent, du PIB. Cette hausse est due à des impacts directs d’une part : (1) amélioration de l’accès aux échanges mondiaux par l’intégration aux réseaux internationaux de l’investisseur ; (2) restructuration et amélioration de la gouvernance dans les entreprises cibles ; (3) impact sur la concurrence dans le pays d’accueil. La plupart de ces impacts sont observés dans les études empiriques sur les retombées des fusions et acquisitions sur les entreprises. D’autre part, les fusions et acquisitions ont également d’importants effets indirects (« externalités ») notamment sous forme de (4) retombées technologiques et (5) de diffusion de capital humain et de connaissance. L’OCDE (2002) a non seulement trouvé des éléments démontrant l’existence de ces impacts, mais a aussi constaté que l’investissement direct de l’étranger conduit généralement à une hausse de la PTF au niveau macroéconomique, et, par conséquent, à l’augmentation du PIB.
Toutefois, la concrétisation de ces effets bénéfiques n’est pas automatique et dépend pour beaucoup des politiques mises en œuvre par les pays d’accueil. Tous les domaines qui contribuent à l’instauration d’un environnement propice à l’investissement, tels qu’énoncés dans le Cadre d’action pour l’investissement par exemple, jouent un rôle à cet égard. Ainsi, en ce qui concerne certaines des préoccupations évoquées, le transfert à l’extérieur du pays d’accueil de la R&D et autres activités à forte intensité de connaissance est beaucoup moins probable si les pouvoirs publics adoptent des politiques propres à promouvoir des normes éducatives et scientifiques élevées. En outre, l’instauration d’un cadre réglementaire de la concurrence solide garantit la concrétisation des effets positifs de l’entrée sur le marché d’investisseurs étrangers tout en évitant une trop forte concentration des marchés dans l’économie d’accueil.
Il existe également une considération de politique économique secondaire, qui a trait à l’adoption de mesures destinées à atténuer l’impact. En particulier,
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 103
les gains d’efficience induits par les acquisitions transfrontières peuvent entraîner une réorganisation de l’emploi dans les entreprises acquises. D’un point de vue macroéconomique, une telle situation est une excellente occasion d’utiliser une partie de la main d’œuvre de manière plus productive. Reste que l’existence sur les marchés du travail et les marchés de produits de rigidités structurelles telles que les ressources ainsi libérées risquent de rester durablement inutilisées peut avoir des conséquences macroéconomiques et sociales graves. Par conséquent, une politique d’ouverture vis-à-vis des fusions et acquisitions transfrontières doit aller de pair avec un effort soutenu de réforme structurelle. Dans l’intervalle, il peut être justifié que les pouvoirs publics adoptent des mesures pour faciliter le processus de restructuration consécutif aux fusions.
Notes
1. Voir Thomsen (2006) pour une revue des études sur l’approvisionnement en technologie.
2. Ainsi, au Canada, le gouvernement du Yukon a créé le Fonds stratégique de développement des industries, qui a vocation à contribuer à identifier les industries et projets stratégiques susceptibles d’avoir des retombées positives sur l’économie du Yukon dans son ensemble et à soutenir leur développement.
3. Pour une revue de qualité d’études empiriques, voir Röller et al. (2000).
4. Davis et al. (1993), p. 346.
5. Norbäck et Persson (2005), p. 1.
6. Davis et al. (1993), p. 346.
7. Dans cette étude, l’IDE de création est défini comme la différence obtenue en retranchant la valeur des opérations transfrontières de fusion et acquisition des entrées totales d’IDE. Il ne correspond donc pas nécessairement à un investissement dans un nouveau site de production ou un nouvel équipement.
8. Pour d’autres exemples, y compris concernant des pays en développement, voir CNUCED (2000), pp. 170-171.
9. Les données sur les fusions et acquisitions nationales n’avaient pas été communiquées à l’auteur à la date de l’étude.
10. Girma et Görg (2003), p. 8.
104 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Bibliographie
Aitken, Brian, Anne Harrison & Robert Lipsey (1996), « Wages and foreign ownership: A comparative study of Mexico, Venezuela and the United States », Journal of International Economics, vol. 40, pp. 345-371.
AlAzzawi, Shireen (2004), « Foreign direct investment and knowledge flows: evidence from patent citations », University of California, Davis, document interne, 8 janvier.
Almeida, Rita (2004), « The labor market effects of foreign-owned firms », document interne, Washington, DC: Banque mondiale, 21 avril.
Andersson, Thomas, Torbjörn Fredriksson et Roger Svensson (1996), Multinational Restructuring, Internationalization and Small Economies: The Swedish Case, Routledge Studies in International Business and the World Economy, London and New York: Routledge.
Bernard, A., P. Schott et J. Redding (2005), « Products and Productivity », document de travail du NBER n° 11575.
Bishop, Matthew & John Kay eds. (1993), European Mergers & Merger Policy,Oxford: Oxford University Press.
Calderon, Cesar, Norman Loayza & Luis Serven (2004), « Greenfield foreign direct investment and mergers and acquisitions: feedback and macroeconomic effects », document de travail de la Banque mondiale consacré à la recherche sur les politiques 3192, Washington, DC: Banque mondiale, janvier.
Cassiman, Bruno, Massimo Colombo, Paola Garrone & Reinhilde Veugelers (2004), « The impact of M&A on the R&D process: an empirical analysis of the role of technological and market relatedness », document interne.
Christiansen, Hans & Ayse Bertrand (2006), « Tendances et évolution récente de l’investissement direct étranger », Perspectives de l’investissement international, Paris: OCDE.
Cimoli, Mario (2001), « Network market structures and economic shocks: the structural changes of innovation systems in Latin America », communication présentée lors du séminaire intitulé “Redes productivas e institucionales en America Latina”, Buenos Aires, 9-12 avril.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 105
Conyon, Martin, Sourafel Girma, Steve Thompson & Peter Wright (2002), « The productivity and wage effects of foreign acquisition in the United Kingdom », Journal of Industrial Economics, vol. L, pp. 85-102.
Costa, Ionara (2005), « Notes on R&D and TNCs affiliates in Brazil », communication présentée lors de la Réunion d’experts sur les incidences de l’IED sur le développement, Genève, 24-26 janvier.
Cseng di, Sandor, Rolf Jungnickel & Dieter Urban (2005), « Foreign takeovers and wages: Theory and evidence from Hungary », document interne, 27 juillet.
Davis, Evan, Graham Shore & David Thompson (1993), « Continental mergers are different », in Bishop & Kay (dir. pub.) (1993), European Mergers & Merger Policy, Oxford: Oxford University Press.
Department of Trade and Industry (DTI) (2006), « International Trade and Investment – the Economic Rationale for Government Support », DTI Economics Paper n° 18.
Department of Trade and Industry (DTI) (2004), « Liberalisation and Globalisation: Maximising the Benefits of International Trade and Investment », DTI Economics Paper n° 10. Doms, Mark & Bradford Jensen (1998), « Comparing wages, skills and productivity between domestically and foreign-owned manufacturing establishments in the United States », in Robert Baldwin, Robert Lipsey & David Richardson (dir. pub.), Geography and Ownership as Bases for Economic Accounting, Studies in Income and Wealth, vol. 59, Chicago: Chicago University Press, pp. 235-258.
Evenett, Simon (2003), « The cross border mergers and acquisitions wave of the late 1990s », document de travail 9655, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, avril.
Feliciano, Zadia & Robert Lipsey (2002), « Foreign entry in US manufacturing by takeovers and the creation of new firms », document interne, Queens College and the Graduate Center, CUNY, New York.
Fukao, Kyoji, Keiko Ito & Hyeog Ug Kwon (2004), « Do out-in M&As bring higher TFP to Japan? An empirical analysis based on micro-data on Japanese manufacturing firms », Hi-Stat Discussion Paper Series n° 41, Hitotsubashi University Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences, septembre.
106 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Fukao, Kyoji, Keiko Ito, Hyeog Ug Kwon & Miho Takizawa (2006), « Cross-border acquisitions and target firms’ performance: Evidence from Japanese firm-level data », document préparé pour le 17ème séminaire annuel est-asiatique d’économie du NBER, « International Financial Issues around the Pacific Rim », Hawaii, 22-24 juin.
Girma, S., R. Kneller and M. Pisu (2005), « Acquisition FDI and the Export Intensity of Multinational Firms », Document de recherche de laUniversity of Nottingham 2005/1.
Girma, Sourafel & Holger Görg (2003), « Blessing or curse? Domestic plants’ survival and employment prospects after foreign acquisitions », document de discussion de l’Institute for the Study of Labour n° 706, Bonn, janvier.
Girma, Sourafel, David Greenaway & Katherine Wakelin (2001), « Who benefits from foreign direct investment in the UK? », Scottish Journal of Political Economy, 48, 2, pp. 119-133.
Globerman, Steven, John Ries & Ilan Vertinsky (1994), « The economic performance of foreign affiliates in Canada », Revue canadienne d’économique, vol. 27, pp. 143-156.
Graham, Edward & Paul Krugman (1995), Foreign Direct Investment in the United States, 3ème édition, Institute for International Economics, Washington.
Griffith, Rachel & Helen Simpson (2001), « Characteristics of foreign-owned firms in British manufacturing », document de travail n° 01/10, London: Institute for Fiscal Studies.
Griffith, Rachel, Stephen Redding & Helen Simpson (2004), « Foreign ownership and productivity: new evidence from the service sector and the R&D lab », Document de discussion du CEPR n° 4691, Londres: Centre for Economic Policy Research.
Gugler, Klaus, Dennis Mueller, Burcin Yurtoglu & Christine Zulehner (2001), « The effects of mergers: an international comparison », International Journal of Industrial Organization, 21, 625-653.
Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm et Patrik Gustavsson Tingvall (2004), « Is there really a foreign ownership wage premium? », Document de travail du FIEF n° 199, Trade Union Institute for Economic Research, 15 décembre.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 107
Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm et Patrik Gustavsson Tingvall (2005), « Acquisitions, multinationals and wage dispersion », document interne.
Höpner, Martin & Gregory Jackson (2001), « An emerging market for corporate control? The Mannesmann takeover and German corporate governance », document de discussion du Max-Planck-Institut für Gesellschaftforschung n° 01/4, septembre.
Hubert, F. et N. Pain (2000), « Inward Investment and Technical Progress in the UK Manufacturing Sector », document de travail de l’OCDE n° 268.
Kalotay, Kalman & Gabor Hunya (2000), « Privatization and foreign direct investment in Central and Eastern Europe », Transnational Corporations,9, 1, pp. 39-66.
Kang, Nam-Hoon & Sara Johansson (2000), « Cross-border mergers and acquisitions: the role in industrial globalisation », documents de travail de l’OCDE sur la science, la technologie et l’industrie 2000/1, Paris: OCDE.
Kaplan, Eben (2006), « Foreign ownership of US infrastructure », document de référence, Council of Foreign Relations, 10 mars.
Kedia, Simi (2003), « Vodafone Airtouch’s Bid for Mannesmann », étude de cas, Harvard Business School, 22 août.
Munari, Federico & Maurizio Sobrero (2005), « The effects of privatisation on R&D investments and productivity: an empirical analysis of European firms », document interne.
Norbäck, Pehr-Johan & Lars Persson (2001), « Investment liberalization – who benefits from cross-border mergers & acquisitions? », document de travail n° 569, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm.
Norbäck, Pehr-Johan & Lars Persson (2005), « Necessary mergers », traduit par Phil Holmes, Axess Magazine (http://www.axess.se/english/2005/07/theme_norback.php).
Norbäck, Pehr-Johan & Lars Persson (2006), « Investment liberalization – why a restrictive cross-border merger policy can be counterproductive », document interne, 13 juin.
OCDE (2001), Le nouveau visage de la mondialisation industrielle : Fusions-acquisitions et alliances stratégiques transnationales, Paris.
OCDE (2002), L’investissement direct étranger : Optimiser les avantages, minimiser les coûts, Paris.
108 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
PA Cambridge Economic Consultants (1995), Assessment of the Wider Effects of Foreign Direct Investment in Manufacturing in the UK, rapport préparé pour le compte du DTI, du Scottish Office, du Northern Ireland Office et du Cabinet Office.
Queiroz, Sergio, Mariana Zanatta & Carolina Andrade (2003), « Internationalization of MNCs’ technological activities: what role for Brazilian subsidiaries? », communication présentée lors de la conférence du SPRU en l’honneur de Keith Pavitt, Brighton, 13-15 novembre.
Rohatyn, Felix (1989), « America’s Economic Dependence », Foreign Affairs68, n° 1, pp. 53-65.
Röller, Lars-Hendrik, Johan Stennek & Franck Verboven (2000), « Efficiency gains from mergers », document de travail n° 543, The Research Institute of Industrial Economics, Stockholm.
Rugman, Alan & Joseph D’Cruz (2003), Multinationals as Flagship Firms: Regional Business Networks, Oxford: Oxford University Press.
Thomsen, Stephen (2006), « L’investissement direct à l’étranger : quels effets bénéfiques pour les pays d’origine ? », Perspectives de l’investissement international, Paris: OCDE.
CNUCED (2005), Rapport sur l’investissement dans le monde 2005:Les sociétés transnationales et l’internationalisation de la recherche-développement, Nations Unies: Genève.
Velho, Lea (2004), « Science and technology in Latin America and the Caribbean: an overview », document de discussion, 2004-4, Maastricht: UNU-INTECH.
Yun, Mikyung (2000), « Cross-border M&As and their impact on the Korean economy », communication présentée lors du séminaire de la CNUCED intitulé Cross-border M&As and Sustained Competitiveness in Asia: Trends, Impacts and Policy Implications, Bangkok, 9-10 mars.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 109
PARTIE I
Chapitre 5
INTÉRÊTS ESSENTIELS DE SÉCURITÉ AUX TERMES DU DROIT INTERNATIONAL DE L’INVESTISSEMENT*
Introduction
Dans de nombreux accords internationaux, les États ont négocié des dispositions aux termes desquelles, même lorsqu’ils ont souscrit des engagements en vertu d’un traité, lesdits engagements ne les empêchent pas d’adopter des mesures pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité.
Les dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité se rencontrent-elles fréquemment dans les accords relatifs à l’investissement ? Quelle est leur portée ? L’État peut-il être seul juge de l’opportunité de les invoquer, en d’autres termes ces dispositions ont-elles un caractère automatique (self-judging) ? Le droit international coutumier prévoit-il des dispositions en la matière ? Comment les tribunaux arbitraux ont-ils interprété ces dispositions ? Telles sont les questions auxquelles le présent article tente d’apporter une réponse. Il analyse : i) la fréquence de ces dispositions dans les accords et instruments relatifs à l’investissement auxquels les membres de l’OCDE sont parties, ainsi que leur portée ; ii) la manière dont le droit international coutumier
* Cet article a été préparé par Katia Yannaca-Small, Conseiller juridique, Division de l’investissement, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE et tire parti des réflexions, commentaires et divers points de vue des membres du Comité. Des remerciements sont adressés à Julien Fouret, consultant auprès de la Division de l’investissement, pour son apport en termes de recherche. Cet article, qui est une étude factuelle, n’est pas nécessairement représentatif du point de vue de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres. Il ne saurait être interprété comme préjugeant de l’issue de négociations ou différends en cours ou futurs dans le cadre d’accords internationaux sur l’investissement.
110 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
traite cette question et iii) les positions des tribunaux arbitraux qui se sont prononcés sur ces questions dans des affaires précises.
1. Pratique des États dans le cadre des accords internationaux relatifs à l’investissement
Comment les accords internationaux relatifs à l’investissement traitent-ils les exceptions liées à la protection des intérêts essentiels de sécurité ? Un certain nombre d’instruments multilatéraux prévoient de telles exceptions, même si la majorité de ceux examinés pour les besoins du présent article limitent leur portée aux situations de guerre, au trafic d’armes et autres situations d’urgence. Certains traités bilatéraux en matière d’investissement (TBI) contiennent également des dispositions qui font de la protection des intérêts essentiels de l’État en matière de sécurité un argument légitimant une intervention des autorités publiques qui, en d’autres circonstances, serait proscrite. Les dispositions contenues dans les accords régionaux ou multilatéraux analysés pour les besoins de l’article ont systématiquement un caractère expressément automatique (self-judging) puisqu’elles permettent à un État partie de prendre toutes mesures « qu'il estimera nécessaires » à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité. La plupart des TBI ne contiennent pas de telles dispositions : ainsi, parmi les modèles de TBI, seule la version 2004 du modèle des États-Unis et la version 2004 de l’Accord canadien sur la protection des investissements étrangers (APIE) en contiennent.
1.1. Instruments de l’OCDE
Concernant la phase du pré-établissement, les Codes de l'OCDE de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes disposent, dans leur article 3, que les dispositions du Code « n’empêchent pas un Membre de prendre les mesures qu’il estime nécessaires (…) ii) à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité (…) ».
Aux termes des commentaires du Comité de l’investissement concernant les Codes, ces clauses de sauvegarde sont « censées intervenir dans des situations exceptionnelles. Elles permettent en principe aux Membres de mettre en place, de réinstaurer ou de maintenir des restrictions qui ne sont pas couvertes par les réserves aux Codes et, dans le même temps, d’exempter ces restrictions du principe de libéralisation progressive. Au cours des dernières années, cependant, les Membres ont été encouragés à formuler des réserves au moment où ils mettent en place des restrictions pour des raisons de sécurité nationale, au lieu de maintenir ces restrictions hors du champ disciplinaire des Codes. En plus d’offrir l’avantage d’améliorer la transparence et l’information au bénéfice des utilisateurs des Codes, cela représente un premier pas vers une libéralisation
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 111
future, en particulier quand la sécurité nationale ne constitue pas le motif prédominant des restrictions, mais que celles-ci s’accompagnent de considérations économiques. »1
Les Codes autorisent les pouvoirs publics de tout Membre de l’OCDE à prendre les mesures qu’ils « estime[nt] nécessaires », ce qui implique que cette clause a un caractère expressément automatique (self-judging).
En 1986, le Conseil de l’OCDE a adopté une Recommandation2 invitant les pays membres à être aussi transparents que possible lorsqu’ils notifient à l’Organisation les mesures relatives aux intérêts essentiels de sécurité dans le cadre de l’Instrument relatif au traitement national de la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales.Il recommandait, entre autres, aux pays membres :
« b) de faire preuve, à l'occasion des changements qu'ils pourraient apporter aux mesures existantes ou de leur réexamen, ou lorsqu'ils envisagent l'adoption de nouvelles mesures, de modération dans les restrictions qu'ils apportent à l'application du traitement national pour des motifs tenant (…) aux intérêts essentiels de la sécurité, afin de limiter les mesures prises pour ces motifs aux domaines dans lesquels ces préoccupations jouent un rôle prédominant ;
c) d'examiner la possibilité de modifier les mesures prises pour des motifs tenant (…) aux intérêts essentiels de la sécurité dans un sens qui permette d'atténuer ou d'éviter l'incidence directe ou indirecte de cette discrimination à l'encontre des activités des entreprises sous contrôle étranger en dehors de la zone lorsque les considérations (…) d'intérêts essentiels de la sécurité jouent un rôle prédominant ;
(…)
e) d'étudier, dans les domaines où des restrictions sont appliquées aux opérations des entreprises sous contrôle étranger pour des motifs tenant (…) aux intérêts essentiels de la sécurité, et en particulier dans les domaines où ces entreprises sont totalement exclues, la possibilité d'appliquer des réglementations alternatives qui leur permettraient d'atteindre leurs objectifs concernant (…) les intérêts essentiels de la sécurité tout en permettant aux entreprises sous contrôle étranger d'opérer dans les pays concernés. »
112 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Cette Recommandation entend renforcer la transparence à travers une procédure de notification, dans le but de limiter les conséquences de la discrimination exercée à l’encontre des investisseurs étrangers au nom d’intérêts essentiels de sécurité. Par ailleurs, le Comité de l’investissement a publié des clarifications afin que ces dispositions ne soient pas utilisées comme clause de sauvegarde (voir annexe 5.A1.1).
Les 39 pays qui adhèrent à l’Instrument relatif au traitement national actualisent actuellement la liste des mesures qu’ils prennent au nom de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité, conformément à l’obligation de notification prévue par l’article 1 de la troisième Décision révisée du Conseil relative au traitement national.
Le projet d’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) prévoyait, dans son article sur les exceptions générales,3 une exception relative à la protection des intérêts essentiels de sécurité. Sa portée était limitée aux mesures nécessaires à cette protection en période de guerre, de conflit armé ou autre situation d’urgence ou à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération d’armes de destruction massive ainsi qu’aux mesures relatives à la production d’armes. Le projet d’accord prévoyait toutefois une disposition visant à empêcher une partie contractante de prendre des mesures destinées en réalité à protéger des intérêts économiques ou disproportionnées par rapport à l’intérêt protégé.
Exceptions générales
« 2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme :
a. empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité :
(i) prise en période de guerre, de conflit armé ou dans toute autre situation d’urgence dans les relations internationales ;
(ii) relative à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération d’armes de destruction massive ;
(iii) relative à la production d’armes et de munitions ;
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 113
[…]
4. Les mesures prises au titre du présent article sont notifiées au Groupe des parties.
5. Si une partie contractante (“la partie requérante”) estime que des mesures prises par une autre partie contractante (“l’autre partie”) au titre du présent article l’ont été uniquement pour des raisons économiques, ou que ces mesures sont disproportionnées par rapport à l’intérêt protégé, elle peut demander des consultations avec cette autre partie conformément à l’article VI. B.1 (procédure de consultation entre États). Celle-ci devra fournir des informations à la partie requérante sur les mesures prises et les motifs qui y ont présidé. »
1.2. Accords régionaux et multilatéraux
1.2.1. ALENA
Le Chapitre 21 de la partie « Autres dispositions » de l’ALENA,4 prévoit, dans son article 2102, une exception au titre des intérêts essentiels de la sécurité. Aux termes de cet article, qui s’applique à l’Accord dans son ensemble, y compris au chapitre sur l’investissement :
« 1. Sous réserve des articles 607 (Énergie – Mesures de sécurité nationale) et 1018 (Marchés publics – Exceptions), aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :
[…] (b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
(i) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
(ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
114 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
(iii) se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins explosifs nucléaires.
Ces dispositions relatives aux intérêts essentiels de la sécurité ont, elles aussi, un caractère expressément automatique (self-judging). Elles ne portent toutefois que sur les mesures relatives au trafic d’armes, sur les mesures prises en temps de guerre ou autre situation d’urgence dans les relations internationales, ainsi que sur celles qui se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou accords internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires.
1.2.2. Traité sur la Charte de l’énergie
L’article 24 du traité sur la Charte de l’énergie prévoit lui aussi des exceptions au titre de la protection des intérêts essentiels des signataires en matière de sécurité. Il dispose que :
« Les dispositions du présent traité autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire :
(a) à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui
(i) concernent l'approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques, ou
(ii) sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d'urgence survenant dans les relations internationales.
Comme celles de l’ALENA, ces dispositions ont un caractère expressément automatique (self-judging). Bien que similaire à celle de l’ALENA à certains égards, la liste des intérêts de sécurité couverts du traité sur la Charte de l’énergie contient des exemples, introduits par l’expression « y compris », ce qui n’est pas le cas de l’article 2102(1)(b) de l’ALENA.
1.2.3. Accord général sur le commerce des services (AGCS)
L’article XIVbis de l’Accord général sur le commerce et les services (AGCS) prévoit lui aussi des exceptions au titre de la protection des intérêts essentiels de la sécurité pour les mesures se rapportant aux matières nucléaires
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 115
ou à la fourniture de services destinés à l’approvisionnement des forces armées ou appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ces dispositions ont aussi un caractère expressément automatique (self-judging) :« Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée (…) comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité » [italique ajouté].
1.3. TBI et chapitres sur l’investissement d’accords de libre échange (ALE)
On trouve une exception au titre de la protection des intérêts essentiels de sécurité dans les nouveaux modèles de TBI adoptés par le Canada (2004),5
l’Allemagne (2005),6 l’Inde (2003)7 et les États-Unis (2004),8 mais pas dans les modèles de la France ou du Royaume-Uni.
Les 43 pays9 dont les TBI (conclus) ont été analysés pour les besoins de la présente étude peuvent être répartis en quatre catégories :
• Ceux qui n’ont jamais prévu dans leurs TBI de disposition relative à la protection de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. 10 des 39 pays dont les traités ont été examinés relèvent de cette catégorie : Brésil, Canada (en tenant compte de l’ancien modèle de TBI), Danemark, Islande, Irlande, Italie, Norvège, Slovénie et Afrique du Sud.
• Ceux qui ont prévu une disposition relative à la protection de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité dans la majorité de leur traités (plus de 50 %). Cinq pays relèvent de cette catégorie : Allemagne, Inde, Mexique et Union économique belgo-luxembourgeoise.10
• Ceux qui prévoient une disposition relative à la protection de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité dans tous leurs traités : États-Unis (et dans tous leurs ALE).11
• Ceux qui prévoient une disposition relative à la protection de leurs intérêts essentiels en matière de sécurité dans leurs traités de manière occasionnelle, c'est-à-dire lorsqu’ils concluent un TBI avec un État relevant de la deuxième ou de la troisième catégorie : les 27 autres pays dont les TBI ont été examinés appartiennent à cette catégorie.12
Les dispositions relatives à la protection des intérêts essentiels de sécurité diffèrent en termes de contenu et de portée.
116 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
• La plupart des dispositions, par exemple celle du TBI entre les États-Unis et l’Argentine, utilisent le concept d’intérêts essentiels de sécurité sans le délimiter ou le définir plus précisément, tandis que quelques autres (comme l’APIE type canadien) délimitent et définissent plus précisément les intérêts essentiels de sécurité couverts, afin, par exemple, de ne couvrir que les mesures se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’à la non-prolifération des armes nucléaires.
• Certaines dispositions, par exemple celles de la version 2004 du modèle de TBI des États-Unis et l’APIE type du Canada (même si sa portée est plus étroite –voir ci-dessus), sont formulées de telle sorte qu’elles ont un caractère expressément automatique (self-judging), autorisant par exemple une partie à prendre toutes mesures qu’elle « estime nécessaire » à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, tandis que d’autres ne sont pas formulées de cette manière.
• La plupart des dispositions s’appliquent au TBI en général, mais certaines ne s’appliquent qu’à des parties spécifiques du TBI :
− expropriation ou nationalisation : TBI entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la Chine ;
− non-discrimination : TBI entre le Japon et la Chine ;
− règlement des différends : TBI entre l’Autriche et le Mexique ;
− application de la législation du pays d’accueil à l’investissement étranger : TBI entre le Royaume-Uni et l’Inde.
2. Droit international coutumier – État de nécessité.
Il convient maintenant d’examiner la situation aux termes du droit international coutumier. Un État d’accueil peut-il déroger aux obligations qui lui sont imposées par un traité ? Il est reconnu dans le cadre du droit international coutumier que la réponse à cette question est affirmative en ce qui concerne les obligations qui, par leur contenu ou leur nature, n’excluent pas une telle possibilité. Aux termes du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international (CDI)13 (articles 20 à 25), il existe des circonstances dans lesquelles les États peuvent ne pas être considérés comme ayant contrevenu à leurs obligations
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 117
internationales. Ces circonstances, qui légitiment un acte qui serait, en leur absence, illicite, sont le consentement (article 20), la légitime défense (article 21),14 les contre-mesures à raison d’un fait internationalement illicite (article 22), la force majeure (article 23), la détresse (article 24) et l’état de nécessité (article 25).
L’article 25 dispose que :
« 1. L’État ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à l’une de ses obligations internationales que si ce fait :
(a) Constitue pour l’État le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent ;
(b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des États à l’égard desquels l’obligation existe ou de la communauté internationale dans son ensemble ;
2. En tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’État comme clause d’exclusion de l’illicéité :
(a) Si l’obligation internationale en question exclut la possibilité d’invoquer l’état de nécessité ; ou
(b) Si l’État a contribué à la survenance de cette situation. »
Dans ses commentaires, la CDI précise que « [l’excuse de nécessité] naît de l’existence d’un conflit insoluble entre un intérêt essentiel, d’une part, et une obligation, d’autre part, de l’État invoquant l’état de nécessité. Ces caractéristiques particulières font que l’état de nécessité ne pourra être que rarement invoqué pour excuser l’inexécution d’une obligation et que cette excuse est soumise à de strictes limitations pour prévenir les abus » [italique ajouté].15
Une étude des affaires dans lesquelles l’état de nécessité a été invoqué démontre qu’il l’a été pour protéger des intérêts très divers, y compris pour protéger l’environnement, préserver l’existence même de l’État et de sa population en situation d’urgence publique, ou pour assurer la sécurité de la population civile. Comme le souligne la CDI, « pour bien marquer le caractère exceptionnel de l’état de nécessité et le souci de ne pas le voir invoquer abusivement, l’article 25 est formulé négativement (“l’état de nécessité ne peut être invoqué (…) que si”). » La CDI a fixé des conditions restrictives pour déterminer si l’exception au titre de l’état de nécessité est admissible. Le Professeur Crawford, Rapporteur spécial de la CDI, a fait observer que
118 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
« lorsque [un État] invoque l’état de nécessité, [il] est parfaitement conscient d’avoir choisi délibérément d’agir d’une manière non conforme à une obligation internationale ».16
Conditions requises pour invoquer l’état de nécessité
Dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros,17 citée par la CDI dans ses commentaires, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu l’état de nécessité comme un argument de droit international coutumier et admis qu’il pouvait être légitime de l’invoquer pour protéger des intérêts dépassant les frontières d’un État, par exemple en cas de dommages écologiques.18
Il existe toutefois d’importantes limites. D’une part, l’état de nécessité ne peut être invoqué que pour sauvegarder un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent. En 1980, le Comité d’experts de la CDI sur la responsabilité des États a, par l’intermédiaire de son président, Roberto Ago, affirmé que « l’intérêt essentiel de l’État » au nom duquel l’État serait autorisé à ne pas observer une obligation internationale devait être un intérêt vital, tel que sa « survie politique ou économique, le maintien de la possibilité de fonctionnement de ses services essentiels, la conservation de sa paix intérieure, la survie d’une partie de sa population, la conservation écologique de son territoire ou d’une partie de son territoire, etc. »19 Dans son rapport, le Professeur Crawford, soulignait que le caractère « essentiel » d’un intérêt ne peut être défini et doit être apprécié en fonction de chaque cas d’espèce.20
La CIJ n’a eu « aucune difficulté à reconnaître que les préoccupations exprimées par la Hongrie vis-à-vis de l’environnement naturel de la région concernée par le Projet Gabcikovo-Nagymaros se rapportaient à un “intérêt essentiel”, au sens de l’article 33 du projet d’articles de la Commission du droit international » – article remplacé par l’article 25 – , allant ainsi dans le sens du rapport de Roberto Ago.
En ce qui concerne la notion de « péril imminent », dans l’affaire du ProjetGabcikovo-Nagymaros, la CIJ a déclaré :
« Cela n’exclut pas (…) qu’un “péril” qui s’inscrirait dans le long terme puisse être tenu pour “imminent” dès lors qu’il serait établi, au moment considéré, que la réalisation de ce péril, pour lointaine qu’elle soit, n’en serait pas moins certaine et inévitable ».
En outre, la mesure prise doit constituer « le seul moyen » de sauvegarder l’intérêt essentiel en cause. Si d’autres mesures sont susceptibles d’atteindre cet objectif, elles doivent être envisagées, même si leur mise en œuvre est plus
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 119
difficile ou plus coûteuse pour l’État. Dans l’affaire relative au ProjetGabcikovo-Nagymaros, la CIJ n’était pas convaincue que la suspension et l’abandon des travaux était le seul moyen que la Hongrie avait à sa disposition pour sauvegarder son intérêt essentiel et a fait observer qu’elle aurait pu « recourir à d’autres moyens pour faire face aux dangers qu’elle redoutait ».21
La deuxième limite à l’invocation de l’état de nécessité réside dans le fait que le comportement en question ne doit pas porter gravement atteinte à l’intérêt essentiel du ou des autres États concernés ou de la communauté internationale dans son ensemble. Autrement dit, le poids de l’intérêt invoqué doit être tel qu’il l’emporte sur toutes les autres considérations, « non seulement du point de vue de l’État auteur du fait dont il s’agit, mais selon une appréciation raisonnable des intérêts en présence, qu’ils soient individuels ou collectifs ».22
Dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros, la Cour a estimé nécessaire de tenir compte de tout intérêt qu’aurait pu avoir la République slovaque en contrepartie.23
Troisièmement, l’état de nécessité ne peut pas être invoqué pour exonérer un État lorsque l’obligation internationale en cause exclut, explicitement24 ou implicitement, l’argument de l’état de nécessité. Il y a exclusion implicite lorsque l’impossibilité d’invoquer l’état de nécessité résulte de l’objet et du but de l’accord.
Quatrièmement, l’état de nécessité ne peut pas être invoqué pour exonérer un État si ce dernier a contribué à sa survenance. Ainsi, dans son rapport, le Professeur Crawford souligne que la contribution doit être suffisamment « substantielle et non pas simplement accessoire ou secondaire ». Dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros, la CIJ a estimé que la Hongrie avait « contribué, par action ou omission » à la survenance de l’état de nécessité allégué en concluant un traité, puis en cherchant y mettre fin, alors qu’elle était pleinement consciente que le projet aurait des conséquences sur l’environnement.25
3. Interprétations des tribunaux arbitraux dans le cadre des différends entre investisseurs et États
Les tribunaux arbitraux sont appelés à interpréter les traités selon l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.26 Par conséquent, toute analyse d’un traité qui contient une exception au titre de la protection d’un intérêt essentiel de sécurité commence par l’analyse du texte de la clause relative à ces intérêts. Depuis peu, les chercheurs et les tribunaux examinent le
120 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
lien entre les dispositions relatives aux intérêts essentiels de la sécurité contenus dans les traités et le principe d’état de nécessité du droit international coutumier.27 La jurisprudence sur les différends entre investisseurs et États faisant intervenir des considérations liées à un intérêt essentiel de sécurité ne comporte que trois affaires (présentées ci-après). Dans ces affaires, l’État défendeur et les tribunaux ont respectivement invoqué et examiné à la fois les dispositions relatives aux intérêts essentiels contenues dans le traité concerné et le principe d’état de nécessité du droit international coutumier.
3.1. Une situation d’urgence économique peut-elle être considérée comme un intérêt essentiel de sécurité ?
Jusqu’à présent, seuls les tribunaux qui ont jugé les affaires CMS contre République argentine28, LG&E contre République argentine29 et Enron contre République argentine30 ont examiné l’exception relative à la protection d’intérêts essentiels de sécurité dans le cadre de l’arbitrage en matière d’investissement. Ces trois affaires sont liées à la crise économique qu’à connue l’Argentine en 2000, qui s’est soldée par la « pesification » de son économie.31
Dans ces affaires, l’État argentin estimait pouvoir être exonéré de ses obligations en raison d’un état de nécessité ou d’urgence provoqué par la crise économique, sociale et politique qui avait frappé le pays. Les tribunaux qui ont examiné les affaires CMS et Enron sont parvenus aux mêmes conclusions ; en revanche, celui qui a statué dans l’affaire LG&E a rendu une décision différente,32 alors qu’il était appelé à se prononcer sur des faits similaires, liés à la même mesure gouvernementale, et à interpréter les mêmes dispositions du TBI entre les États-Unis et l’Argentine, notamment l’article XI qui dispose que :
« Le présent Traité ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties de prendre toutes mesures nécessaires au maintien et au rétablissement de l’ordre public, au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, ou à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité ».
Les tribunaux qui se sont prononcés dans les affaires CMS et Enron ont analysé la situation en examinant si « l’exclusion de l’illicéité entraîne une absence de conséquences juridiques »33 de la violation du traité concernée. Ils ont examiné l’argument de l’état de nécessité aux termes du droit international coutumier et ont analysé l’article 25 du projet d’articles sur la responsabilité des États ainsi que les travaux et commentaires de la CDI à cet égard. Ils ont cherché à déterminer si les mesures adoptées par l’Argentine constituaient le « seul moyen » pour l’État de sauvegarder ses intérêts et ont répondu par la négative.34 Ils ont également examiné si la condition voulant que l’État n’ait pas
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 121
contribué à l’état de nécessité était remplie et ont conclu, dans les deux affaires, que compte tenu des circonstances, l’Argentine avait contribué de manière substantielle à la crise.35 Dans l’affaire CMS, le tribunal est finalement parvenu à la conclusion que « des éléments constitutifs d’un état de nécessité étaient certes partiellement présents (…), mais que les conditions requises pour qu’il y ait état de nécessité au sens du droit international coutumier n’étaient pas suffisamment remplies pour exclure l’illicéité des actes ».36 De même, le tribunal qui a statué dans l’affaire Enron a estimé que « compte tenu des divers éléments examinés (…), les conditions requises pour qu’il y ait état de nécessité au sens du droit international coutumier n’étaient, en l’espèce, pas toutes réunies ».37
Les tribunaux qui ont statué dans les affaires CMS et Enron ont également examiné le traité lui-même, même s’ils se sont de nouveau principalement fondés sur les conditions à réunir selon la doctrine de l’état de nécessité du droit international coutumier. Ils se sont, d’une part, interrogés sur le point de savoir si l’objet et le but du traité « exclu[aient] la possibilité d’invoquer l’état de nécessité »,38 selon les termes de l’article 25.2(a) du projet d’articles de la CDI, et ont, d’autre part, cherché à établir si la mesure portait « gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des États à l’égard desquels l’obligation existe »,39 selon l’article 25.1(b). Bien qu’aucun des deux tribunaux n’ait exposé son interprétation des termes concernés de l’exception relative aux intérêts essentiels de sécurité, ils sont l’un et l’autre parvenus à la conclusion que les situations de crise économique majeure ne pouvaient pas être exclues par principe du champ des intérêts essentiels de sécurité en vertu de l’article XI.
À cet égard, le tribunal qui a statué dans l’affaire CMS a estimé que :
« Aucun élément, du point de vue du droit international coutumier ou de l’objet et du but du traité, ne peut, en soi, exclure une situation de crise économique majeure du champ d’application de l’article XI (…). Si le concept d’intérêts essentiels de sécurité devait être limité à des préoccupations politiques et de sécurité nationale immédiates, notamment à caractère international, et exclure d’autres intérêts, par exemple les situations d’urgence économique majeure, il y aurait un risque d’interprétation déséquilibrée de l’article XI. Une telle approche ne serait pas totalement cohérente avec les règles qui régissent l’interprétation des traités ».40
Dans l’affaire Enron, le tribunal a estimé que :
« (…) de manière générale, le traité a pour objet et pour but de s’appliquer en cas de difficultés économiques exigeant la protection
122 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
des droits internationaux garantis de ses bénéficiaires. Dans cette mesure, toute interprétation aboutissant à une dérogation aux obligations définies est peu conciliable avec cet objet et ce but. En conséquence, une telle possibilité, quelle qu’elle soit, ne peut être interprétée que de manière restrictive ».41
« (…) du point de vue des traités sur l’investissement, il reste nécessaire de tenir compte des intérêts des entités privées qui sont, in fine, les bénéficiaires de ces obligations (…). En l’espèce, l’application de l’article XI ou du critère d’état de nécessité porterait certainement gravement atteinte à l’intérêt essentiel de la partie demanderesse ».42
Le tribunal qui a statué dans l’affaire LG&E a d’abord cherché à appliquer la lettre du TBI et « dans la mesure où l’interprétation et l’application de ses dispositions le permettent, le droit international général. »43 À l’instar des tribunaux qui se sont prononcés dans les affaires CMS et Enron, celui qui a statué dans l’affaire LG&E n’a certes pas énoncé son interprétation des termes significatifs de l’exception au titre des intérêts essentiels de sécurité mais a néanmoins conclu qu’une situation de crise économique grave ne pouvait être exclue du champ d’application de l’article XI. Il a rejeté l’argument selon lequel l’article XI ne s’applique qu’en cas d’intervention militaire ou de situation de guerre et a affirmé que :
« Estimer qu’une crise économique d’une telle gravité ne peut constituer un intérêt essentiel de sécurité revient à minimiser les ravages que l’économie peut faire sur les vies de populations entières et à diminuer la capacité du gouvernement à gouverner. Lorsque les fondations économiques d’un État sont en péril, la situation peut être aussi grave qu’en cas d’invasion militaire, quelle qu’elle soit ».44
Dans l’affaire LG&E, le tribunal a également indiqué que, même si, en l’espèce, les protections prévues par l’article XI étaient suffisantes pour statuer sur la responsabilité de l’Argentine, sa position était également étayée par son analyse des conditions énoncées par l’article 25 du projet d’articles de la CDI concernant « l’état de nécessité au sens du droit international ».45 Il a rejeté l’allégation de la partie demanderesse, selon laquelle les mesures mises en œuvre par le gouvernement argentin ne constituaient pas le seul moyen à sa disposition pour faire face à la crise et a affirmé que l’article XI se rapportait à des situations dans lesquelles un État n’a pas d’autre choix que d’intervenir. Enfin, il a considéré que non seulement le gouvernement argentin n’avait pas contribué à la grave crise qui a frappé le pays, mais encore qu’il avait, par son
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 123
attitude, prouvé « sa volonté d’atténuer, par tous les moyens possibles, la gravité de la crise ».
La raison pour laquelle les tribunaux sont parvenus à des conclusions divergentes est une différence d’appréciation du degré de gravité de la crise économique. Dans les affaires CMS et Enron, les tribunaux ont considéré que la crise était « grave mais n’entraînait pas un effondrement économique et social total »46 et que « l’argument selon lequel une telle situation mettait en jeu un intérêt essentiel de l’État parce qu’elle compromettait son existence même et son indépendance n’était pas convaincant ».47 En revanche, dans l’affaire LG&E, le tribunal a jugé la crise suffisamment grave pour menacer « le gouvernement et l’État argentin d’effondrement total »,48 estimant que « du 1er
décembre 2001 au 26 avril 2003, l’Argentine a connu une crise qui a nécessité l’adoption de mesures pour maintenir l’ordre public et protéger les intérêts essentiels de sa sécurité ». Il a donc exonéré l’Argentine de toute responsabilité pour violation du traité, mais a limité cette exonération à une période définie (du 1er décembre 2001 au 26 avril 2003)49, qui correspondait, selon lui, à la période de crise extrême.50
« Cette exonération [de responsabilité] n’est applicable que dans des situations d’urgence ; une fois l’urgence passée, en d’autres termes une fois une certaine stabilité retrouvée, l’État n’est plus exonéré de sa responsabilité en cas de violation des obligations imposées par le droit international et est tenu de recommencer immédiatement à les honorer ».
3.2. Le caractère automatique des dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Il importe de s’interroger sur le point de savoir à qui il appartient de décider si les intérêts essentiels d’un État en matière de sécurité sont en jeu. Pour reprendre la question posée par le tribunal qui a statué dans l’affaire CMS,l’État qui adopte les mesures doit-il être seul à apprécier s’il est légitime d’invoquer l’argument de ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou doit-il y avoir « une forme quelconque de contrôle par les juges » ? 51
Dans l’affaire CMS, le tribunal a déclaré que « quand les États entendent créer pour eux-mêmes un droit à déterminer unilatéralement la légitimité de mesures exceptionnelles impliquant le non-respect des obligations qu’ils ont contractées dans le cadre d’un traité, ils le font expressément ».52 Dans le même esprit, le tribunal qui s’est prononcé dans l’affaire Enron a indiqué que « toute clause se voulant réellement exceptionnelle et extraordinaire, par exemple une disposition à caractère automatique (self-judging), doit en principe être rédigée
124 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
de manière à indiquer expressément cette intention, car à défaut, rien n’empêcherait de présumer qu’elle n’a pas ce sens compte tenu de sa nature exceptionnelle ».53 Les deux tribunaux, citant les décisions de la CIJ dans les affaires Nicaragua (1986),54 Gabcikovo-Nagymaros (1997)55 et plates-formes pétrolières (2003),56 ont relevé que la CIJ avait pris une position claire à cet égard. À la lumière de ces réflexions, les tribunaux qui ont statué dans les affaires CMS et Enron ont considéré que l’article XI du TBI n’avait pas un caractère automatique (self-judging).57
Dans l’affaire LG&E, le tribunal est parvenu à la même conclusion, considérant que « d’après les éléments portés à sa connaissance concernant l’intention des parties en 1991, lorsque le traité a été signé, le tribunal décide de considérer que la disposition n’a pas un caractère automatique ».58
4. Synthèse
Le droit de protéger les intérêts essentiels de l’État en matière de sécurité, à titre d’exception aux engagements souscrits dans le cadre d’un traité d’investissement, est désormais bien établi dans la pratique en matière de traités. Il a été expressément inclus dans les accords internationaux, les instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement et dans un certain nombre de traités bilatéraux d’investissement. Dans certains cas, les dispositions du traité qui instituent l’exception sont expressément limitées, définissant et délimitant précisément les intérêts essentiels de sécurité visés. La jurisprudence est peu abondante. Récemment, trois tribunaux arbitraux, ayant à statuer sur des requêtes découlant de la crise argentine, ont examiné l’argument de l’état de nécessité à la lumière du droit international coutumier et de la disposition relative aux intérêts essentiels de sécurité contenue dans le TBI entre les États-Unis et l’Argentine. Le lien entre la doctrine de l’état de nécessité du droit international coutumier et la disposition du TBI n’a pas été établi avec certitude. Alors que les trois tribunaux ont considéré que les dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité s’appliquaient aux intérêts économiques, ils ne sont pas parvenus à la même conclusion en ce qui concerne l’applicabilité de cet argument dans les affaires sur lesquelles ils avaient à se prononcer, deux tribunaux ayant estimé que cette exception ne s’appliquait pas et le troisième qu’elle s’appliquait.
Concernant la question de savoir à qui il appartient de juger si les intérêts essentiels d’un État en matière de sécurité sont en jeu, un certain nombre d’accords, notamment des accords bilatéraux et les instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement, attribuent expressément ce rôle à l’État lui-même. Il n’en va peut-être pas de même de certains TBI qui n’indiquent pas expressément que l’exception a un caractère automatique (self-judging). Les
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 125
tribunaux qui se sont penchés sur cette question dans le cadre de différends entre investisseurs et États ont refusé de reconnaître que les clauses sur les intérêts essentiels de sécurité puissent avoir un caractère automatique inhérent dès lors qu’il n’est pas précisé expressément qu’elles ont un tel caractère.
Notes
1. Codes de l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes, Guide de référence, OCDE 2003, disponible à l’adresse : http://www.oecd.org/document/8/0,3343,fr_2649_34887_21227604_1_1_1_1,00.html
2. Recommandation concernant « les mesures se rapportant au traitement national des entreprises sous contrôle étranger prises par les pays Membres de l'OCDE pour des motifs tenant à l'ordre public et aux intérêts essentiels de leur sécurité » adoptée par le Conseil au cours de sa 646ème réunion, le 16 juillet 1986.
3. http://www1.oecd.org/daf/mai/indexf.htm
4. Voir à l’adresse http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/chap21-fr.asp
5. Article 10 – Exceptions générales : cette disposition est très similaire à l’article 2102 de l’ALENA ; elle a un caractère automatique (self-judging) et une portée limitée.
6. Article 3 (Protocole additif au traité).
7. Article 12 : Droit applicable.
8. Article 18 : Intérêts essentiels de sécurité.
9. Membres de l’OCDE ; pays qui ont le statut d’observateur au Comité de l’investissement (Argentine, Brésil, Chili) ; autres pays non membres qui ont adhéré à l Déclaration (Estonie, Lituanie, Israël, Slovénie, Roumanie) ; Chine, Russie, Inde et Afrique du Sud.
10. Allemagne (examen de 79 TBI sur 88), Inde (examen de 20 TBI sur 24), Mexique (examen de 9 TBI sur 15) ; Union économique belgo-luxembourgeoise (examen de 30 TBI sur 58).
11. Les 46 TBI auxquels les États-Unis sont parties ont été examinés, ainsi que les ALE conclus et entrés en vigueur entre les États-Unis et l’Australie, le Bahreïn, le Chili, l’Amérique centrale et la République dominicaine, Israël, la Jordanie, le Maroc, l’ALENA, l’L’Oman et Singapour.
126 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
12. Argentine (examen de 4 TBI sur 43), Australie (examen de 1 TBI sur 20), Chili (examen de 1 TBI sur 49), Chine (examen de 10 TBI sur 59), République tchèque (examen de 4 TBI sur 65), Estonie (examen de 2 TBI sur 16), France (examen de 3 TBI sur 91), Hongrie (examen de 2 TBI sur 55), Israël (examen de 1 TBI sur 12), Japon (examen de 3 TBI sur 19), Corée (examen de 3 TBI sur 80), Lettonie (examen de 2 TBI sur 22), Lituanie (examen de 3 TBI sur 24), Nouvelle-Zélande (examen de 1 TBI sur 4), Pologne (examen de 3 TBI sur 31), Portugal (examen de 1 TBI sur 46), Roumanie (examen de 3 TBI sur 45), Russie (examen de 5 TBI sur 26), République slovaque (examen de 1 TBI sur 31), Espagne (examen de 7 TBI sur 60), Suède (examen de 2 TBI sur 52), Turquie (examen de 3 TBI sur 41), Royaume-Uni (examen de 1 TBI sur 91), Autriche (examen de 2 TBI sur 23), Finlande (examen de 11 TBI sur 49), Pays-Bas (examen de 3 TBI sur 87), Suisse (examen de 10 TBI sur 94).
13. Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, articles 20 à 25, disponible à l’adresse : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d'articles/9_6_2001_francais.pdf
14. La pertinence de l’argument de la légitime défense est plus évidente en matière d’intégrité territoriale et de stratégie militaire et en cas d’agression armée. La mesure considérée comme licite parce que justifiée par la légitime défense doit être conforme à la Charte des Nations Unies.
Commentaire
(1) L’existence d’un principe général admettant que la légitime défense constitue une exception à l’interdiction visant l’usage de la force dans les relations internationales n’est pas contestée. L’article 51 de la Charte des Nations Unies préserve le droit naturel d’un État à la légitime défense dans les cas où il est l’objet d’une agression armée. Cet article fait partie de la définition de l’obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force énoncée à l’article 2, paragraphe (4).
15. Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Commentaire (2) relatif à l’article 25, disponible à l’adresse : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf.
16. J. Crawford, « Deuxième rapport sur la responsabilité des États », Assemblée générale des Nations Unies, Commission du droit international, 51ème session, Genève, 23 juillet 1999, A/CN.4/498/Add2, p .26.
17. Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. République slovaque), CIJ Recueil 1997 p. 7, 40 (25 septembre 1997). Le traité à la base de l’affaire prévoyait la
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 127
réalisation d’un investissement conjoint des parties, en l’occurrence la Hongrie et la République slovaque, afin, essentiellement, de produire de l’hydro-électricité, d’améliorer la navigation sur le fleuve et d’éviter les inondations. La mise en œuvre du traité s’est révélée difficile. Dans les deux pays, plus particulièrement en Hongrie, des inquiétudes de plus en plus vives se sont manifestées au sujet de la viabilité économique et de l’impact environnemental du projet. La Hongrie a fini par suspendre les travaux relatifs à la partie du projet qui lui incombait. Lorsqu’elle a soumis le différend à la CIJ, la Hongrie a allégué, entre autres, qu’elle avait violé l’obligation que lui imposait le traité en raison d’un « état de nécessité écologique », précisant que l’énorme réservoir entraînerait des risques écologiques inacceptables, notamment des inondations artificielles, une diminution de la qualité de l’eau et l’extinction de diverses espèces végétales et animales.
18. Pour une réflexion approfondie sur l’état de nécessité, voir Andrea K. Bjorklund, « Emergency Exceptions to International Obligations in the Realm of Foreign Investment: The State of Necessity as a Circumstance Precluding Wrongfulness », Report for the International Law Association Committee on International Investment 2006 ; Vaughan Lowe, « Precluding Wrongfulness or Responsibility: A Plea for Excuses », Euro. J. Int’l L. n° 10, p. 405 (1999).
19. Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 32e session, [1980] Annuaire de la Commission du droit international, vol. 2, Doc. NU A/CN.4/SER.A/1980/Add.1 (partie 1).
20. Deuxième rapport sur la responsabilité des États : Additif, Commission du droit international, 51e session, p. 30, Doc. NU A/CN.4/498/Add.2 (1999).
21. Gabcikovo, CIJ. Recueil 1997, pp. 44-45.
22. Commentaires de la CDI par. 17.
23. CIJ Recueil 1997, p.7, p. 46, par. 58.
24. Certaines conventions humanitaires applicables aux conflits armés excluent expressément la possibilité d’invoquer la nécessité militaire.
25. Gabcikovo, CIJ Recueil 1997 p. 45.
26. Aux termes de l’article 31(1) de la Convention de Vienne, un traité doit être interprété « suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». L’article 31(2) précise que le contexte à prendre en compte comprend, outre le texte du traité, le préambule et les annexes, tout accord ou instrument ayant rapport au traité ; Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 331.
128 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
27. Les chercheurs se sont interrogés sur le point de savoir si, par leur nature et leur objet, à savoir la protection des investisseurs en cas de difficultés, les traités qui protègent l’investissement n’excluent pas la possibilité d’invoquer un tel argument. Voir A. Reinisch : « Les TBI visent en principe à protéger les investisseurs contre les mesures que prennent les pays d’accueil dans un contexte de difficultés économiques (…) C’est précisément dans ces situations que la protection offerte par les TBI s’applique (…) Si l’on admet ce raisonnement, il semble difficile de justifier qu’on puisse l’abandonner en cas d’aggravation des difficultés économiques et, partant, d’augmentation du risque que des mesures défavorables aux investisseurs soient prises. Les normes de protection de l’investissement spécifiquement négociées contenues dans un TBI remplaceraient la norme minimale de traitement du droit international coutumier et, par conséquent, se substituerait également aux autres arguments de défense prévu par ce droit pour justifier des exceptions. Autoriser les États à se fonder sur l’argument de l’état de nécessité dans des situations pour lesquelles ils se sont engagés à fournir une protection aux termes d’un TBI serait contraire à l’objet du TBI. », in « Necessity in International Investment Arbitration – An Unnecessary Split of Opinions in Recent ICSID Cases? Comments on CMS v. Argentina and LG&E v. Argentina”, TDM vol. 3, numéro 5, décembre 2006. Voir également A. Bjorklund : « l’état de nécessité a une relation ambiguë avec les obligations souscrites par les États dans le cadre des traités sur l’investissement auxquels ils sont parties (…) ; du fait qu’il peut avoir une vaste portée, l’argument relatif à l’état de nécessité a dû être strictement délimité », in « Emergency Exceptions to International Obligations in the Realm of Foreign Investment: The State of Necessity as a Circumstance Precluding Wrongfulness » op. cit. note 18.
28. CMS Gas Transmission Company contre la République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/01/08, sentence, 12 mai 2005..
29. LG&E Energy Corp., L&E Capital Corp., LG&E International Inc contre la République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/02/1, décision sur la responsabilité, 3 octobre 2006.
30. Enron Corporation Ponderosa Assets, L.P. contre la République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/01/3, sentence, 22 mai 2007.
31. La requête initiale pour l’introduction d’une instance d’arbitrage déposée par Enron auprès du CIRDI en 2001 était sans rapport avec la crise financière argentine. Elle concernait une série de mesures fiscales qui, selon l’entreprise, avaient été illicitement appliquées aux investissements qu’elle avait réalisés en Argentine. Par la suite, Enron a introduit une « demande accessoire » au titre des pertes qu’elle prétendait avoir subies durant la crise financière. Les impôts qui faisaient l’objet du différend ont ensuite été supprimés par un tribunal argentin. En 2005, Enron a abandonné cet aspect
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 129
de sa demande d’arbitrage tout en maintenant ses demandes en lien avec la crise financière, in http://www.iisd.org/investment/itn/news.asp, 27 mai 2007.
32. À noter que les tribunaux qui ont statué dans les affaires CMS et Enron avait le même président. Toutefois, un autre élément mérite d’être souligné : l’un des arbitres était à la fois membre du tribunal de l’affaire LG&E et de l’affaire Enron et un autre était à la fois membre du tribunal de l’affaire CMS et de l’affaire LG&E. Or, ces tribunaux sont parvenus à des conclusions différentes.
33. CMS, par. 318, Enron, par. 339.
34. Le tribunal n’était pas en mesure de se prononcer sur le point de savoir « laquelle, parmi ces autres mesures, aurait été plus appropriée », cette décision outrepassant son rôle. CMS par. 323. Dans l’affaire Enron, le tribunal ne s’est pas considéré compétent pour désigner quelle solution était souhaitable : « le rôle du tribunal n’est pas de faire des choix économiques à la place du gouvernement, mais seulement de déterminer si le choix effectué était le seul possible, ce qui, en l’espèce, ne semble pas être le cas ». Enron, par. 309.
35. « La crise n’était pas le fait d’une administration en particulier et a son origine dans la crise antérieure, survenue dans les années 80 et dans le caractère changeant des politiques publiques dans les années 90, qui a atteint son paroxysme à partir de 2002. Le tribunal constate donc que les politiques mises en œuvre par l’État et leurs insuffisances ont contribué de manière significative à la crise et à la situation d’urgence et que, même si des facteurs exogènes ont effectivement ajouté aux difficultés, ils n’exonèrent pas l’État de sa responsabilité dans l’affaire ». CMS par. 329. « (…) l’État a contribué de manière substantielle à l’état de nécessité et la situation ne saurait être considérée comme entièrement imputable à des facteurs exogènes. Cette situation n’est pas l’œuvre d’une administration en particulier, mais un problème dont les effets s’ajoutent les uns au autres depuis une décennie ; cependant, il n’en reste pas moins que l’État, dans son ensemble, doit en répondre ». Enron, par. 312.
36. CMS par. 331.
37 Enron par. 313.
38. CMS par. 353.
39. Idem par. 357.
40. Idem par. 359-360.
41 Enron par. 331.
42 Idem par. 342.
43. LG&E par. 206.
130 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
44. Idem par. 238.
45. Idem par. 245.
46. CMS par. 355.
47 Enron, par. 306.
48. LG&E par. 231.
49. Idem par. 229.
50. Ces dates correspondent, pour la première, à l’annonce par le gouvernement du gel des fonds et, pour la deuxième, à l’élection du président Kirchner.
51. CMS par. 366.
52. Idem par. 370. Le tribunal a souligné à cet égard que la position des États-Unis en faveur du caractère automatique des clauses est apparue après la décision rendue dans l’affaire Nicaragua.
53 Enron par. 335.
54. Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, par. 221-222.
55. Dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros, la CIJ, se référant aux vues et travaux de la CDI, a mentionné les conditions qui doivent être cumulativement réunies pour invoquer l’état de nécessité aux termes du droit international et a noté que « l’État concerné n’est pas seul juge de la réunion de ces conditions », par. 51-52.
56. Affaire des plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 6 novembre 2003, par. 43.
57. CMS, par. 373, Enron par. 339.
58. LG&E par. 212.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 131
ANNEXE 5.A1.1
L’ORDRE PUBLIC ET LES INTÉRÊTS ESSENTIELS DE LA SÉCURITÉ DANS LE CADRE DE L’INSTRUMENT RELATIF AU
TRAITEMENT NATIONAL
(Clarifications du Comité de l’investissement figurant dans « Traitement national des entreprises sous contrôle étranger », OCDE, édition 2005)
La Déclaration exclut du champ d’application de l’instrument relatif au Traitement national les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et à la protection des intérêts essentiels de la sécurité. L’interprétation de ces notions dépend du contexte particulier dans lequel ces mesures sont prises et peut évoluer dans le temps selon les circonstances. Toutefois, ces dispositions doivent être appliquées avec prudence, en conservant à l’esprit les objectifs de l’Instrument, et elles ne doivent pas servir de clause de sauvegarde générale permettant aux gouvernements adhérents de se soustraire à leurs engagements. On peut, dans certains cas, considérer que l’ordre public et la sécurité englobent la santé publique. Par ailleurs, les mesures prises pour des raisons économiques, culturelles ou autres doivent être identifiées comme telles et ne doivent pas être prises sous couvert d’une interprétation excessivement large de l’ordre public et des intérêts essentiels de la sécurité.
Tout recours excessif aux considérations relatives à l’ordre public et aux intérêts essentiels de la sécurité pour justifier des mesures non conformes au Traitement national est préjudiciable à la mise en œuvre de l’Instrument relatif au Traitement national et met en question l’équilibre global des engagements pris par les gouvernements adhérents. Le Comité a attiré l’attention sur les considérations suivantes :
• Les mesures de cette catégorie doivent tout particulièrement retenir l’attention lorsque des mesures similaires sont notifiées comme exceptions par la plupart des adhérents. Même si le cas particulier de chaque pays doit être pris en considération, la cohérence de l’Instrument exige que des mesures similaires soient classées de la
132 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
même façon par les différents pays. Le facteur essentiel est de savoir si les considérations de sécurité prédominent ou non.
• Dans certains cas, par exemple dans les domaines des transports et des communications, la situation a évolué et on comprend mal comment les restrictions à l’investissement étranger peuvent être entièrement justifiées par des considérations de sécurité nationale.
• Lorsque les motivations sont mixtes (c'est-à-dire qu’elles ont trait en partie à des questions commerciales et en partie à la sécurité nationale), il est préférable de faire apparaître la mesure concernée comme une exception plutôt que comme une mesure notifiée à des fins de transparence. À cet égard, de nouvelles mesures non conformes au Traitement national peuvent être prises si elles sont réellement justifiées par des considérations de sécurité nationale, et ce, même si le pays concerné avait précédemment formulé une exception pour des mesures connexes dans le même secteur.
• Dans les cas où, pour une mesure particulière non conforme, des pays membres ont formulé une réserve à l’égard de la rubrique du Code de libération des mouvements de capitaux qui a trait aux investissements directs en provenance de l’étranger, il n’y a pas de raison apparente pour ne pas notifier cette même mesure comme exception au Traitement national, même si elle est en partie motivée par des considérations de sécurité nationale. De fait, étant donné que l’Instrument relatif au Traitement national concerne les entreprises qui opèrent déjà sur le territoire du pays concerné, le recours aux considérations de sécurité nationale doit être moins fréquent que dans le cas du Code.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 133
ANNEXE 5.A2. 2
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TBI ET ALE (chapitres sur l’investissement) CONTENANT DES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INTÉRÊTS ESSENTIELS DE SÉCURITÉ
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
Modèles de TBI
1. Modèle de TIB du Canada (2004)
Article 10 – Exceptions générales […]
4. Aucune disposition du présent Accord n’a pour effet :
(a) d’imposer à une Parie l’obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ;
(b) d’empêcher une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité
(i) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité, (ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, (iii) se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires ou explosifs ; ou
(c) d’empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du
134 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
maintien de la paix et de la sécurité internationale.
2. Modèle de TBI de la France
Néant
3. Modèle de TBI de l’Allemagne (2005)
Protocole additif au traité
3. Ad Article 3
(a) Seront considérés comme « activité » au sens de l’article 3(2) notamment, mais pas exclusivement : la gestion, l’entretien, l’utilisation, l’usage et la liquidation d’un investissement. Seront considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens de l’article 3 : toute inégalité de traitement en cas de restrictions à l’achat de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute inégalité de traitement en cas d’entraves à la vente de produits à l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi que toutes autres mesures ayant des effets similaires. Les mesures prises pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, de santé publique ou de moralité ne seront pas considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens de l’article 3.
4. Modèle de TBI de l’Inde (2003)
Article 12
Droit applicable
(1) Sauf disposition contraire du présent Accord, tous les investissements seront soumis à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où ils sont effectués.
(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, aucune disposition du présent Accord ne saurait empêcher la Partie contractante d’accueil de prendre toutes mesures pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou pour faire face à une situation d’extrême urgence, dans le respect de sa législation, appliquée normalement et raisonnablement et sur une base non discriminatoire.
5. Modèle de TBI du Royaume-Uni (2005)
Néant
6. Modèle de TBI des États-Unis Article 18 : Intérêts essentiels de sécurité
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 135
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
(2004) Aucune disposition du présent traité ne saurait être interprétée comme : 1. obligeant une Partie à fournir des informations ou à permettre l’accès à des informations dont elle estime que la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ; ou 2. d’empêcher une Partie d’appliquer toutes mesures qu’elle estime nécessaires au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Exemples de TBI et d’ALE
Exclusions substantielles (traitement, protection…)
7. TBI Argentine – Belgique
(Bruxelles, 28 juin 1990)
Articulo 5
Medidas Privativas y Restrictivas de Propiedad
[…]
1. En caso de que imperativos de utilidadpublica, de seguridad o de interés nacionaljustifiquen una derogación de lo indicado en elpárrafo 1, deberán cumplirse las siguientescondiciones:
a/ que las medidas sean tornadas según el respectivo procedimiento legal;
b/ que ellas no sean discriminatorias, nicontrarias a un compromiso especifico;
c/ que las mismas estén acompañadas dedisposiciones que prevean el pago de unaindemnización adecuada y efectiva.
4 TBI (conclus avec l’Allemagne,1 le Pérou et les États-unis) sur les43 examinés contiennent une telle disposition
8. TBI Australie – Inde
(New Delhi, 26 février 1999)
Date d’entrée en vigueur : 4 mai 2000
Article 15
Interdictions et restrictions
Aucune disposition du présent Traité ne saurait empêcher la Partie contractante d’accueil deprendre, dans le respect de sa législation, appliquée raisonnablement et sur une base non discriminatoire, toutes mesures nécessaires à laprotection de ses intérêts essentiels en matière desécurité ou à la prévention des maladies ou desparasites.
1 TBI sur les 20examinés contient une telle disposition.
136 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
9. TBI Union économique belgo-luxembourgeoise – Chine
(Bruxelles, 4 juin 1984)
Date d’entrée en vigueur : 5 octobre 1986
Article 4
1. Aucune des Parties contractantes ne prendra,sur son territoire, de mesures d’expropriation, denationalisation ou autres mesures similaires àl’égard d’un investissement réalisé par uninvestisseur de l’autre Partie contractante, sauf sides impératifs de sécurité et d’intérêt public l’exigent et sous réserve que les conditionssuivantes soient remplies :
(1) les mesures doivent être prises selon laprocédure légale nationale ;
(2) les mesures ne doivent pas êtrediscriminatoires par rapport à celles prises à l’égard des investissements ouinvestisseurs d’un pays tiers ;
(3) des dispositions prévoyant uneindemnisation doivent être prévues.
30 TBI2 sur les 58 examinés comprennent une disposition de ce type.3
10. TBI Chili – Allemagne
(Bonn, 21 octobre 1991)
Date d’entrée en vigueur : 18 juillet 1999
PROTOCOLO
(2) Ad Artículo 3
a) Por "actividades" en el sentido del párrafo 2se entenderán en especial, pero noexclusivamente la administración, la utilización,el uso y el aprovechamiento de una inversión. Se considerará especialmente como trato "menosfavorable" en el sentido del Artículo 3: lalimitación en la adquisición de materias primas einsumos auxiliares, energía y combusTBIles, asícomo cualesquiera medios de producción yexplotación, la obstaculización de la venta de productos en el interior del país y en elextranjero, y toda medida de efectos análogos.Las medidas que haya que adoptar por razonesde seguridad y de orden público, de saludpública o de moralidad, no se considerarán comotrato "menos favorables" en el sentido del Artículo 3.
1 TBI sur les 49examinés contient une telle disposition
11. TBI Chine – Philippines
(Manille, 20
Article 4
1. Chacune des Parties contractantes estautorisée à prendre, pour des raisons de sécurité
104 TBI sur les 59 examinés contiennent une telle disposition.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 137
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
juillet 1992)
Date d’entrée en vigueur : 8 septembre 1995
nationale et d’intérêt public, des mesuresd’expropriation, de nationalisation ou autresmesures similaires (ci-après dénommées « expropriation ») à l’encontre d’investissementsréalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante, à condition,toutefois :
a) de suivre la procédure prévue par lalégislation nationale ; b) de s’interdire toute discrimination ; c) de verser une indemnisation équitable et adéquate.
12. TBI République tchèque – États-Unis
(Signé à Washington le 22 octobre 1991)
Date d’entrée en vigueur : 19 décembre 1992
Article X
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prendre toutes mesuresnécessaires au maintien et au rétablissement del’ordre public, au respect de ses obligations enmatière de maintien ou de rétablissement de lapaix et de la sécurité internationales, ou à laprotection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité. 2. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prescrire des formalitésspéciales en liaison avec l’établissementd’investissements, étant entendu que cesformalités ne doivent en aucun cas porter atteinte à la substance des droits énoncés dans le présentTraité.
4 TIB (conclus avec les États-Unis, le Guatemala, l’Inde et la République de l’Île Maurice)5 sur les 65examinés contiennent une telle disposition.
13. TBI Estonie – États-Unis
(Washington, 19 avril 1994)
Date d’entrée en vigueur : 16 février 1997
Article IX
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prendre toutes mesuresnécessaires au maintien et au rétablissement del’ordre public, au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de lapaix et de la sécurité internationales, ou à laprotection de ses intérêts essentiels en matière desécurité.
2 TBI6 sur les 16examinés contiennent une telle disposition.
14. TBI France – Bangladesh
Échange de Lettre n°3 […]
a) L’expression « activité » signifie, dans le
3 TIB (conclus avec l’Inde et les Philippines)
7 sur les 91
138 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
(Paris, 10 septembre 1985)
Date d’entrée en vigueur : 3 octobre 1986
paragraphe 1 de l’article 5 particulièrement, maisnon exclusivement, la gestion, la maintenance,l’usage et la jouissance d’un investissement.L’expression « traitement moins favorable » signifie dans le paragraphe 1 de l’article 5notamment : toute restriction à l’achat dematières premières ou de matières auxiliaires,d’énergie ou de combustibles ou de moyens de production ou d’exploitation de tout genre, touteentrave, ainsi que toute autre mesure ayant uneffet analogue, dans le cadre de laréglementation de chacune des Partiescontractantes. Les mesures qui ont été prisespour des motifs de sécurité publique et d’ordre, de santé publique ou de moralité ne sont pasconsidérées comme un « traitement moins favorable » au sens de l’article 5.
examinés contiennent une telle disposition.
15. TBI Allemagne – Fédération de Russie
(Bonn, 13 juin 1989)
Date d’entrée en vigueur : 5 août 1991
Protocole additif au Traité […]
(2) Eu égard à l’article 3[…] (c) Sont notamment considérés comme des« mesures discriminatoires » au sens de l’article3, Paragraphe 4, les restrictions injustifiées à l’achat de matières premières et de matièresauxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsique de moyens de production et d’exploitationde tout genre, les obstacles à la vente de produitset à l’utilisation de crédits, et les entraves au travail du personnel et autres mesures ayant deseffets similaires. Les mesures prises dans l’intérêt de la loi, del’ordre et de la sécurité, de la moralité ou de lasanté publique ne sauraient être considéréescomme des « mesures discriminatoires ».
79 TBI sur les 88examinés contiennent une telle disposition.8
16. TIB Hongrie – Inde
(New Delhi, 3 novembre 2003)
Article 12
Droit applicable
1. Sauf disposition contraire du présent Accord,tous les investissements seront soumis à lalégislation en vigueur sur le territoire de la
2 TBI9sur les 55
examinés contiennent une telle disposition.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 139
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
Partie contractante où ils sont réalisés.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du présent Accord nesaurait empêcher la Partie contractanted’accueil de prendre toutes mesures pourprotéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou pour faire face à une situationd’extrême urgence, conformément à salégislation, appliquée normalement et raisonnablement et sur une base nondiscriminatoire.
17. TBI Inde – République tchèque
(Prague, 11 octobre 1996)
Date d’entrée en vigueur : 6 février 1998
Article 12
Exception
Les dispositions du présent Accord ne limitentd’aucune façon le droit de l’une ou l’autre Partiecontractante à intervenir en cas d’extrêmeurgence dans le respect de sa législationappliquée en toute bonne foi, sur une base nondiscriminatoire, et seulement dans la mesure etpendant la durée nécessaires, en vue de laprotection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, ou de la prévention de maladies ou parasites affectant les espèces animales ou végétales.
20 TIB10
sur les 24examinés contiennent une telle disposition.
18. TBI Israël – Allemagne
(Bonn, 24 juin 1976)
Protocole
[…]
(2) Ad Article 3
(a) Seront considérés comme « activité » au sens de l’article 3(2) notamment, mais pasexclusivement : la gestion, l’entretien, l’utilisation, l’usage et la liquidation d’un investissement. Seront considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens de l’article 3 : toute inégalité de traitement en cas de restrictions à l’achat de matières
1 TBI sur les 12examinés contient une disposition relative à la sécurité nationale.
140 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens deproduction et d’exploitation de tout genre, touteinégalité de traitement en cas d’entraves à lavente de produits à l’intérieur du pays et àl’étranger ainsi que toutes autres mesures ayantdes effets similaires. Les mesures prises pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, de santé publique ou de moralité ne seront pas considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens de l’article 3.
19. TBI Japon – Chine
(Pékin, 27 août 1988)
Date d’entrée en vigueur : 14 mai 1989
Protocole
[…] 3. Aux fins des dispositions du Paragraphe 2 del’article 3 de l’Accord, le fait, pour l’une oul’autre des Parties contractantes, de réserver untraitement discriminatoire, dans le respect de sa législation et réglementation applicables, à des ressortissants ou entreprises de l’autre Partiecontractante, ne saurait constituer un« traitement moins favorable » dès lors que ce traitement est réellement justifié par des raisonsd’ordre public, de sécurité nationale ou de bonne santé de l’économie nationale.
3 TBI11sur les 10
examinés contiennent une telle disposition.
20. TBI Corée – Chine
(Pékin, 30 septembre 1992)
Date d’entrée en vigueur : 4 décembre 1992
Protocole
[…]
2. Aux fins des dispositions des paragraphes 2 del’article 3 et 2 de l’article 13 de l’accord, le fait, pour le gouvernement de l’un ou l’autre pays, de réserver un traitement discriminatoire, dans lerespect de sa législation et réglementation applicables, aux investisseurs de l’autre pays,n’est pas considéré comme constituant un« traitement moins favorable » dès lorsque ce traitement est indispensable à l’intérêt public, àla sécurité nationale, à la bonne santé del’économie nationale et sous réserve que ce traitement discriminatoire justifié par des raisons d’intérêt public, de sécurité nationale ou debonne santé de l’économie ne vise passpécifiquement des investisseurs de l’autre pays ou des coentreprises dans lesquelles les
3 TBI12sur les 80
examinés contiennent une telle disposition.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 141
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
investisseurs de l’autre pays possèdent des actifss.
21. TBI Lettonie – États-Unis
(Washington, 13 janvier 1995)
Date d’entrée en vigueur : 26 décembre 1996
Article IX
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prendre toutes mesuresnécessaires au maintien de l’ordre public, aurespect de ses obligations en matière de maintienou de rétablissement de la paix et de la sécuritéinternationales, ou à la protection de ses intérêtsessentiels en matière de sécurité.
2 TBI13 sur les 22
examinés contiennent une telle disposition.
22. TBI Lituanie – Belgique
(Bruxelles, 15 octobre 1997)
Date d’entrée en vigueur : 4 avril 1999
Art.4. Mesures privatives et restrictives de propriété.
[…] 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécuritéou d'intérêt national justifient une dérogation auparagraphe 1er, les conditions suivantes doiventêtre remplies : a) les mesures sont prises selon une procédurelégale ; b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contrairesà un engagement spécifique ; c) elles sont assorties de dispositions prévoyantle paiement d'une indemnité adéquate eteffective.
3 TBI 14 sur les 24 examinés contient une telle disposition.
23. TBI Nouvelle-Zélande – Chine
(Wellington, 22 novembre 1988)
Date d’entrée en vigueur : 25 mars 1989
Article 11 Interdictions et restrictions
Les dispositions du présent Accord ne sauraiententraver en aucune façon le droit de l’une oul’autre des Parties contractantes à imposer toutes interdictions ou restrictions, de quelque natureque ce soit, ou à appliquer toutes mesures visant à protéger ses intérêts essentiels en matière desécurité ou la santé publique ou à prévenir lesmaladies et les parasites affectant les espèces animales ou végétales.
1 TBI sur les 4examinés contient une telle disposition.
24. TBI Pologne – États-Unis
(Washington, 21 mars 1990)
Article XII Droits réservés
[…]
3. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prendre toutes mesures
3 TBI15 sur les 31examinés contiennent une telle disposition.
142 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
Date d’entrée en vigueur : 6 août 1994
nécessaires au maintien de l’ordre public, au respect de ses obligations en matière de maintienou de rétablissement de la paix et de la sécuritéinternationales, ou à la protection de ses intérêtsessentiels en matière de sécurité.
25. TBI Portugal – Inde
(Lisbonne, 28 juin 2000)
Artigo 12 Leis aplicáveis
[…] 2 — Apesar do previsto no n.o 1 do presenteartigo, nada neste Acordo impede a ParteContratante receptora do investimento detomar medidas para a protecção dos seus interesses essenciais de segurança, ordempública ou, em circunstâncias de emergênciaextrema, de acordo com a respectivalegislação, aplicada de forma nãodiscriminatória.
1 TBI sur les 46examinés contiennent une telle disposition.
26. TBI Roumanie – Égypte
(Le Caire, 24 novembre 1994)
Date d’entrée en vigueur : 3 avril 1996
Protocole […] (1) Dans l’article 2 a) L’expression « traitement non favorable » désigne en particulier : toute restriction àl’achat de matières premières ou de matièresauxiliaires, d’énergie ou de combustibles oude moyens de production ou d’exploitation detout genre, toute entrave à la vente de produitsà l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi quetoutes autres mesures ayant des effetssimilaires. Les mesures prises pour des raisons de sécurité, d’ordre, de santé publique ou de moralité ne seront pas considérées comme« traitement moins favorable » au sens de l’article 2.
3 TBI16 sur les 45examinés contiennent une telle disposition.
27. TBI Russie – Hongrie
(Moscou, 6 mars1995)
Date d’entrée en vigueur : 29 mai 1996
Article 2 Promotion et protection réciproque
des investissements
[…]
3. Le présent Accord ne saurait empêcher l’uneou l’autre des Parties contractantes deprendre toutes mesures nécessaires à sadéfense, au maintien de la sécurité nationaleet de l’ordre public et à la protection del’environnement, de la moralité et de la
5 TBI17 sur les 26examinés contiennent une telle disposition.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 143
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
santé publique.
28. TBI République slovaque – États-Unis
(Washington, signé le 22 octobre 1991)
Date d’entrée en vigueur : 19 décembre 1992
Article X
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prendre toutes mesuresnécessaires au maintien de l’ordre public, aurespect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécuritéinternationales, ou à la protection de ses intérêtsessentiels en matière de sécurité. 2. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prescrire des formalitésspéciales en liaison avec l’établissementd’investissements, étant entendu que cesformalités ne doivent en aucun cas porter atteinteà la substance des droits énoncés dans le présentTraité.
1 TBI sur les 31examinés contient une telle disposition.
29. TBI Espagne – Bolivie
(Madrid, 29 octobre 2001)
Date d’entrée en vigueur : 9 juillet 2002
Artículo 4. Trato nacional y cláusula de nación más favorecida.
[…] 5. Las medidas que se adopten por razones deorden público o seguridad y salud pública no seconsiderarán tratamiento «menos favorables» enel sentido del presente artículo.
7 TBI18 sur les 60examinés contiennent une telle disposition.
30. TBI Suède – Russie
(Moscou, 19 avril 1995)
Date d’entrée en vigueur : 7 juin 1996
Article 3 Traitement des investissements
[…] (3) Chacune des Parties contractantes estautorisée à prévoir, dans sa législation, desexceptions de portée limitée au principe dutraitement national énoncé au Paragraphe (2) duprésent article. Aucune nouvelle exception, lecas échéant, ne saurait s’appliquer aux investissements réalisés sur le territoire de laPartie contractante par des investisseurs del’autre Partie contractante avant l’entrée envigueur de ladite exception, sauf si elle estnécessaire à des fins de défense, de protection dela sécurité nationale, de maintien de l’ordre public, de protection de l’environnement, de lamoralité et de la santé publique.
2 TBI19 sur les 52examinés contiennent une disposition relative à la sécurité nationale.
144 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
31. TBI Turquie – États-Unis
(Washington, 3 décembre 1985)
Date d’entrée en vigueur : 18 mai 1990
Article X
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prendre toutes mesuresnécessaires au maintien de l’ordre public, aurespect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécuritéinternationales, ou à la protection de ses intérêtsessentiels en matière de sécurité. 2. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prescrire des formalitésspéciales en liaison avec l’établissement d’investissements, étant entendu que cesformalités ne doivent en aucun cas porter atteinteà la substance des droits énoncés dans le présentTraité.
3 TBI20 sur les 41examinés contiennent une telle disposition.
32. TBI Royaume-Uni – Inde
(Londres, 14 mars 1994)
Date d’entrée en vigueur : 6 janvier 1995
Article 11 Droit applicable
[…]
(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présentarticle, aucune disposition du présent Accord nesaurait empêcher la Partie contractante d’accueilde prendre toutes mesures pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou pourfaire face à une situation d’extrême urgence,conformément à sa législation, appliquée normalement et raisonnablement et sur une basenon discriminatoire.
1 TBI sur les 91examinés contient une telle disposition.
33. TBI États-Unis – Argentine
(Washington, 14 novembre 1991)
Date d’entrée en vigueur : 20 octobre 1994
Article XI 1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une oul’autre des Parties de prendre toutes mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, aurespect de ses obligations en matière de maintienou de rétablissement de la paix et de la sécuritéinternationales, ou à la protection de ses intérêtsessentiels en matière de sécurité.
Les 44 TBI21 examinés contiennent une telle disposition.
34. ALE États-Unis – Australie
(18 mai 2004)
CHAPITRE VINGT-DEUX
DISPOSITIONS ET EXCEPTIONS GÉNÉRALES
6 ALE contenant un chapitre sur l’investissement contiennent aussi une telle disposition.22
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 145
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
Date d’entrée en vigueur : 1er
janvier 2005
Article 22.2: Intérêts essentiels de sécurité
Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme :
(a) imposant à une Partie l’obligation defournir des renseignements ou de donner accèsà des renseignements dont la divulgation serait,à son avis, contraire à ses intérêts essentiels enmatière de sécurité ;
(b) empêchant l’une ou l’autre des Parties deprendre toutes mesures nécessaires au maintiende l’ordre public, au respect de ses obligationsen matière de maintien ou de rétablissement dela paix et de la sécurité internationales, ou à laprotection de ses intérêts essentiels en matière desécurité.
Exclusions du mécanisme de règlement des différends
35. TBI Autriche – Mexique
(29 juin 1998)
Date d’entrée en vigueur : 26 mars 2001
ARTICLE 19
Exclusions
Les dispositions relatives au règlement desdifférends contenues dans cette Section nes’appliquent pas aux décisions prises par unePartie contractante dans le respect de lalégislation de chacune des Parties contractantes, afin, pour des raisons de sécurité nationale,d’interdire ou de restreindre l’acquisition, pardes investisseurs de l’autre Partie contractante,d’un investissement situé sur son territoire,contrôlé par ses ressortissants ou leurappartenant.
2 TBI23 sur les 23examinés contiennent une telle disposition.
36. TBI Finlande – Mexique
(22 février 99)
Date d’entrée en vigueur : 30 août2000
Artículo 18
Exclusiones
El mecanismo de solución de controversias deesta Sección no será aplicable a las resoluciones adoptadas por una ParteContratante, la cual, de acuerdo con sulegislación y por razones de seguridad nacional, prohíban o restrinjan la adquisición
11 TBI24 sur les 49 examinés contiennent une telle disposition.
146 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
por inversionistas de la otra Parte Contratantede una inversión en el territorio de la primera Parte Contratante, que sea propiedad o estéefectivamente controlada por sus nacionales.
37. TBI Mexique – Suède
(3 octobre 2000)
Date d’entrée en vigueur : 1er
juillet 2001
Article 18 Exclusions
Les dispositions relatives au règlement desdifférends contenues dans cette Section nes’appliquent pas aux décisions prises par unePartie contractante dans le respect de salégislation, afin, pour des raisons de sécuriténationale, d’interdire ou de restreindre l’acquisition, par des investisseurs de l’autrePartie contractante, d’un investissement situé surson territoire, contrôlé par ses ressortissants ouleur appartenant.
9 TBI25 sur les 15examinés contiennent une telle disposition.
38. ALENA(Canada, Mexique et États-Unis)
Article 1138: Exclusions
1. Sans préjudice de l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions sur le règlement des différends de la présente section ou du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) aux autres mesures prises par une Partie conformément à l'article 2102 (Sécurité nationale), la décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur d'une autre Partie, ou son investissement, conformément audit article ne sera pas assujettie à ces dispositions. 2. Les dispositions de la présente section et du chapitre 20 sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas aux questions mentionnées à l'annexe 1138.2.
39. TBI Pays-Bas –Mexique
(13 mai 1998)
Article douze Exclusions
Les dispositions relatives au règlement desdifférends contenues dans cette Annexe nes’appliquent pas aux décisions prises par unePartie contractante pour des raisons de sécurité nationale.
3 TBI26 sur les 87examinés contiennent une disposition sur la sécurité nationale.
40. TBI Suisse – Mexique
(10 juillet 1995)
Date d’entrée en
Article 12
Exclusions Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans cette Section nes’appliquent pas aux décisions prises par une
10 TBI27 sur les 94 examinés contiennent une disposition sur la sécurité nationale.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 147
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
vigueur : 14 mars 1996
Partie contractante dans le respect de lalégislation de chacune des Partiescontractantes, afin, pour des raisons desécurité nationale, d’interdire ou de restreindre l’acquisition, par des investisseurs de l’autrePartie contractante, d’un investissement situésur son territoire, contrôlé par sesressortissants ou leur appartenant.
AUCUNE DISPOSITION
41. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (8 TBI ont été examinés).
42. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (25 TBI ont été examinés).
43. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (37 TBI ont été examinés).
44. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (35 TBI ont été examinés).
45. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (3 TBI ont été examinés).
46. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (1 TBI a été examiné).
47. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (18 TBI ont été examinés).
48. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (16 TBI ont été examinés).
148 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
TBI Dispositions relatives aux intérêts essentiels de sécurité
Nombre de TBI contenant des dispositions sur les intérêts essentiels de sécurité par rapport au nombre de TBI examinés
49. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (17 TBI ont été examinés).
50. Aucun TBI contenant une disposition sur la sécurité nationale n’a été trouvé (17 TBI ont été examinés).
1. Protocolo
[…]
(2) Ad articulo 3
a) Por “actividades” en el sentido des apartado 2 del articulo 3 se consideraran en especial pero no exclusivamente, la administración, la utilización, el uso y el aprovechamiento de una inversion. Se consideraran en especial pero no exclusivamente come “trato menos favorable” en el sentido del articulo 3 a las medidas menos favorables que afecten la adquisición de materias primas y otros insumos, energía combustibles, asi como medios de producción y de explotación de toda clase o la venta de productos en el interior del país y en el extranjero. No se considerarán come “trato menos favorable” en el sentido del articulo 3 las medidas que se adopten por razones de seguridad interna o externa y orden publico sanidad publica o moralidad
2. Il s’agit des TBI conclus avec l’Albanie, l’Algérie, l’Argentine, l’Arménie, le Bénin, la Bolivie, le Burundi, le Burkina Faso, le Cameroun, la Chine, les Comores, Chypre, El Salvador, l’Estonie, la Géorgie, la Guinée, l’Inde, le Kazakhstan, la Lettonie, le Liban, la Lituanie, le Mexique, la Macédoine, la Mongolie, la République de Moldova, le Paraguay, les Philippines, l’Ukraine,l’Ouzbékistan et le Viet Nam
3. Le TBI conclu avec l’Inde est le seul qui contienne une disposition différente :
Art. 12 Règles applicables
[…]
(2) Aucune disposition du présent Accord ne s'opposera à ce que l'une ou l'autre Partie contractante impose des interdictions ou des restrictions, dans la
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 149
mesure nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou à la prévention des maladies, parasites et prédateurs.
4. Les autres pays sont : la Belgique (voir plus haut dans le tableau), le Brunéi Darussalam, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande (voir plus bas dans le tableau), Singapour, le Japon, le Sri Lanka, l’Allemagne et la Pologne. Les autres types de dispositions sont les suivants :
– Dans le TBI avec la Corée :
P R O T O C O L.E
2. Aux fins des dispositions des paragraphes 2 de l’article 3 et 2 de l’article 13 de l’Accord, le fait, pour le gouvernement de l’un ou l’autre pays, de réserver un traitement discriminatoire, dans le respect de sa législation et réglementation applicables, aux investisseurs de l’autre pays, n’est pas considéré comme constituant un « traitement moins favorable » dès lorsque ce traitement est indispensable à l’intérêt public, à la sécurité nationale, à la bonne santé de l’économie nationale et sous réserve que ce traitement discriminatoire justifié par des raisons d’intérêt public, de sécurité nationale ou de bonne santé de l’économie ne vise pas spécifiquement des investisseurs de l’autre pays ou des coentreprises dans lesquelles les investisseurs de l’autre pays possèdent des actifs.
– Le TBI avec Singapour contient la même disposition que les TBI conclus avec la Nouvelle-Zélande et le Sri Lanka :
ARTICLE 11 INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS
Les dispositions du présent Accord ne sauraient entraver en aucune façon le droit de l’une ou l’autre des Parties contractantes à imposer toutes interdictions ou restrictions, de quelque nature que ce soit, ou à appliquer toutes autres mesures visant à protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou la santé publique ou à prévenir les maladies et les parasites affectant les espèces animales ou végétales.
– Dans les TBI conclus avec l’Allemagne et avec le Brunéi Darussalam:
Protocole additif à l’Accord
4. Ad article 3
(a) Seront considérés comme « activité » au sens de l’article 3(2) notamment, mais pas exclusivement : la gestion, l’entretien, l’utilisation, l’usage et la liquidation d’un investissement. Seront considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens de l’article 3 : toute inégalité de traitement en cas de restrictions à l’achat de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute inégalité de traitement en cas d’entraves à la vente de produits à l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi que toutes autres mesures ayant des effets similaires. Les mesures prises pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, de santé publique ou de moralité ne
150 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
seront pas considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens de l’article 3.
– Dans le TBI conclu avec la Pologne :
Article 4
1. Chacune des Parties contractantes est autorisée à prendre, pour des raisons de sécurité ou d’intérêt public, des mesures de nationalisation, d’expropriation ou autres mesures similaires (ci-après dénommées « mesures d’expropriation ») à l’encontre d’investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante. Ces mesures d’expropriation devront être non discriminatoires, être prises dans le respect de la législation nationale et donner lieu à indemnisation.
5. Voir ci-dessous les dispositions de deux TBI ne figurant pas ailleurs dans le tableau :
Le TBI avec le Guatemala contient la disposition suivante :
Article 11 Intérêts essentiels de sécurité
Aucune disposition du présent Accord ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties contractantes de prendre toutes mesures pour respecter ses obligations eu égard au maintien de la paix ou de la sécurité internationale.
Le TBI avec la République de l’Île Maurice contient la disposition suivante :
Article 12 Interdictions et restrictions
Les dispositions du présent Accord ne sauraient entraver en aucune façon le droit de l’une ou l’autre des Parties contractantes à imposer toutes interdictions ou restrictions, de quelque nature que ce soit, ou à prendre toutes mesures, dans le respect de sa législation appliquée en de bonne foi et sur une base non discriminatoire, seulement dans la mesure et pendant la durée nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, à la protection de la santé publique ou à la prévention des maladies et parasites affectant les espèces animales ou végétales
6. TBI avec la Belgique :
Art. 4. Expropriation et indemnisation.
[…]
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies :
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 151
a) les mesures seront prises selon une procédure légale ;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique ;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement sans délai d'une indemnité adéquate et effective.
7. Ces deux TBI contiennent des dispositions différentes :
TBI avec l’Inde :
Article 12
Exceptions
Les dispositions du présent accord ne restreignent en aucune façon le droit de l’une ou de l’autre Partie contractante dans les cas d’extrême urgence de prendre des mesures conformément à ses lois appliquées de bonne foi et de façon non discriminatoire et uniquement dans les limites et pour la durée nécessaires visant à assurer la protection de ses intérêts essentiels de sécurité ou la prévention des maladies et épidémies animales ou végétales.
TBI avec les Philippines :
Article 3
Les investissements français ne pourront faire l’objet d’expropriation ou de nationalisation, ou de toute autre forme de dépossession, que pour cause d’utilité publique ou dans l’intérêt public, ou pour le bien national, ou dans l’intérêt de la défense nationale et moyennant une juste indemnité […]
8. 60 TBI, conclus avec Antigua-et-Barbuda, l’Argentine, le Bangladesh, la Barbade, le Bénin, la Bolivie, la Bosnie, le Botswana, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, l’Afrique centrale, le Tchad, le Chili, la Chine, le Congo, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, Cuba, la Dominique,l’Éthiopie, le Gabon, la Guinée, l’Indonésie, Israël, la Jordanie, le Kenya, le Libéria, le Mali, Malte, la Mauritanie, la République de l’Île Maurice, le Nicaragua, l’Oman, Panama, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pakistan, le Pérou, la Pologne, le Qatar, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sierra Leone, Singapour, la Syrie, le Swaziland, la Somalie, la Turquie,l’Uruguay, le Venezuela, le Sri Lanka, le Soudan, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda, le Yémen, la Zambie, le Zimbabwe, contiennent cette disposition, presque systématiquement rédigée dans les mêmes termes, du modèle de TBI allemand.
17 TBI, conclus avec l’Algérie, le Cameroun, El Salvador, la Guinée, la Guyane, l’Iran, la Corée, la Malaisie, Madagascar, le Mexique, le Niger, les
152 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Philippines, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan, le Royaume-Uni, la Yougoslavie, contiennent la disposition suivante :
Protocole
[…]
2. a) Seront considérés comme traitement « moins favorable » au sens de l’article 3 notamment toute restriction des fournitures de matières premières et consommables, des fournitures en énergie et de combustibles ainsi que d’outillage et de moyen de production de toute sorte, toute entrave à la vente des produits à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi que toute autre mesure ayant un effet similaire. Toute mesure prise en raison de la sécurité et de l’ordre publics, de la santé publique ou des bonnes mœurs ne représente pas un traitement « moins favorable » conformément à l’article 3.
Dans les TBI conclus avec Haïti et la Roumanie, la sécurité n’est pas expressément mentionnée comme dans les autres TBI ; ces deux TBI reflètent toutefois la même position et ont presque la même signification que les autres en ce qui concerne l’ordre et la sécurité.
PROTOCOLE
[…]
(2) Ad article 2
(a) (a) Seront considérés comme des activités au sens de l’article 2, paragraphe 2, notamment, mais pas exclusivement : la gestion, la mise en œuvre, l’usage et la jouissance d’un investissement. Seront notamment considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens du de l’article 2, Paragraphe 2 : les restrictions à l’achat de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, les entraves non légales à la vente de produits sur les marchés intérieur et extérieurs ainsi que toutes autres mesures ayant des effets similaires. Les mesures prises pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, de santé publique ou de moralité ne seront pas considérées comme « traitement moins favorable » aux fins d’application de l’article 2.
Le TBI avec l’Inde contient la disposition suivante :
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 153
Article 12
Interdictions et restrictions
Aucune disposition du présent Accord ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties contractantes d’imposer des interdictions ou restrictions dans la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou à la prévention des maladies et parasites affectant les espèces animales et végétales.
Le TBI avec le Mexique contient une deuxième disposition :
Article 20
Exclusions
Les dispositions de la présente Section relatives au règlement des différends ne s’appliquent pas aux décisions prises par une Partie contractante afin, pour des raisons de sécurité nationale, d’interdire ou de restreindre l’acquisition, par des ressortissants ou entreprises de l’autre Partie contractante, d’un investissement situé sur son territoire, contrôlé par ses ressortissants ou leur appartenant, dans le respect de la législation de l’État contractant concerné.
Les TBI conclus avec Sainte-Lucie et Singapour contiennent également une deuxième disposition, formulée dans des termes similaires :
PROTOCOLE
[…]
(3) Ad article 3
[…]
(b) Chacune des Parties contractantes s’engage à examiner avec bienveillance, dans le cadre de sa législation nationale, les demandes d’entrée et de séjour formulées par des ressortissants d’une Partie contractante pour entrer sur le territoire de l’autre Partie en lien avec la réalisation et la mise en œuvre d’un investissement ; cette obligation s’applique également aux ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui, pour des raisons en lien avec un investissement, souhaitent entrer sur le territoire de l’autre Partie et y séjourner pour y occuper un emploi. Des restrictions peuvent toutefois être imposées à une telle entrée sur le territoire pour des raisons de politique publique, de sécurité publique ou de santé publique. Les demandes de permis de travail devront être examinées avec bienveillance.
23 TIB, conclus avec le Bangladesh, le Bénin, le Cameroun, l’Afrique centrale, le Tchad, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, l’Indonésie, la Corée, le Libéria, la Malaisie, Madagascar, la République de l’Île Maurice, le
154 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Pakistan, le Rwanda, le Sri Lanka, le Soudan, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda, la Zambie, contiennent une deuxième disposition, rédigée dans des termes similaires, généralement dans un échange de lettres joint au traité.
« Pour faciliter et promouvoir les investissements réalisés par les ressortissants allemands ou les entreprises allemandes sur le territoire de la République du Soudan conformément à l’article 1 du Traité et le Paragraphe 1 du Protocole, la République du Soudan s’engage à accorder les autorisations nécessaires aux ressortissants allemands qui souhaitent, en lien avec de tels investissements, entrer et séjourner sur le territoire de la République du Soudan pour y exercer une activité salariée, sauf si des raisons d’ordre, de sécurité et de santé publics ou de moralité s’y opposent.
9. TBI avec la Russie :
Article 2
Promotion et protection réciproque des investissements
[…]
3. Le présent Accord ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties contractantes de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la défense, la sécurité nationale et l’ordre public, protéger l’environnement, la moralité et la santé publique.
10. Les TBI conclus avec l’Australie, la Belgique, la France, l’Allemagne, la République de l’Île Maurice et les Pays-Bas contiennent une clause similaire à celle contenue dans le TBI avec la République tchèque.
Les TBI conclus avec l’Autriche, la Croatie, l’Égypte, le Ghana, la Hongrie,l’Indonésie, le Kazakhstan, l’Oman, le Portugal, le Sri Lanka, la Suède, la Suisse, la Thaïlande et le Royaume-Uni contiennent une disposition rédigée en termes similaires.
Article 11
Droit applicable
[…]
(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, aucune disposition du présent Accord ne saurait empêcher la Partie contractante d’accueil de prendre toutes mesures pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou pour faire face à une situation d’extrême urgence, conformément à sa législation, appliquée normalement et raisonnablement et sur une base non discriminatoire.
11. Les TBI avec la Corée et le Viet Nam contiennent la même disposition :
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 155
Article 15
1. Nonobstant toutes dispositions du présent Accord autres que celles de l’article 10, chacune des Parties contractantes est autorisée :
(a) à prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité :
i) prises en période de guerre, de conflit armé ou autre situation d’urgence sur le territoire de ladite Partie contractante ou concernant les relations internationales ;
(ii) relatives à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes ;
12. Le TBI conclu avec l’Allemagne reprend la clause du modèle de TBI de l’Allemagne ; concernant le TBI avec le Japon, voir la note ci-dessus.
13. TBI conclu avec la Belgique :
Art. 4. Mesures privatives et restrictives de propriété.
[…]
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure légale; b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique; c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.
14. Voir plus bas dans le tableau la disposition contenue dans le TBI conclu avec les États-Unis. Le TIB conclu avec le Koweït contient la disposition suivante :
Article 4 Traitement des investissements
[…]
(4) Seront notamment considérées comme constituant un « traitement moins favorable » au sens du présent article : les restrictions à l’achat de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, les entraves à la vente de produits sur les marchés intérieur et extérieurs ainsi que toutes autres mesures ayant des effets similaires. Les mesures prises pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, de santé publique ou de moralité ne seront pas considérées comme « traitement moins favorable » au sens du présent article.
156 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
15. Le TBI conclu avec l’Uruguay contient la disposition suivante :
Artículo II
Promoción, admisión
1) Cada Parte Contratante fomentará en su territorio, las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus leyes y reglamentos. Las Partes Contratantes reconocen el derecho de cada una de ellas de no permitir actividades económicas por razones de seguridad, orden público, salud pública o moralidad, así como otras actividades que por ley se reserven a sus propios inversores.
Le TBI avec l’Allemagne contient la disposition suivante :
PROTOCOLE
[…]
(2) Ad article 3
[…]
(b) Les mesures qui doivent être prises pour des raisons de sécurité et d’ordre publics, pour protéger la vie, la santé ou la moralité publique ne sauraient être considérées comme un « traitement moins favorable » au sens de l’article 3.
16. Pour le TBI avec les États-Unis, voir la note 21 ci-après ; pour le TBI avec la Roumanie, qui contient une disposition conférant la même protection sans faire référence à la sécurité, voir la note 8 ci-dessus.
Le TBI avec la République de l’Île Maurice contient la disposition suivante :
ARTICLE 2
PROMOTION ET ADMISSION
(1) Chacune des Parties contractantes s’engage à promouvoir le plus possible les investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et à admettre ces investissements dans le respect de sa législation et de sa réglementation nationales. Le présent Accord ne saurait toutefois empêcher une Partie contractante d’imposer des restrictions de toute nature ou de prendre toutes autres mesures afin de protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou la santé publique ou pour prévenir les maladies et parasites affectant les espèces animales ou végétales.
17 Pour la disposition contenue dans le TBI avec la Suède et celle figurant dans le TBI avec l’Allemagne, se reporter au tableau. Les dispositions des autres TBI sont les suivantes :
– Disposition du TBI avec la Thaïlande :
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 157
Article 3
Traitement des investissements
[…]
3. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit d’accorder et d’introduire des exceptions aux principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée tels que définis aux Paragraphes 1 et 2 du présent article vis-à-vis d’investisseurs de l’autre Partie contractante et de leurs investissements, y compris des réinvestissements, pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
– Disposition du TBI avec les États-Unis :
ARTICLE X
Le présent Traité ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties de prendre toutes mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
18. Les TBI conclus avec l’Albanie, la Bosnie, la Guinée équatoriale, le Guatemala, la Jamaïque, la Namibie et le Nigeria.
19 Pour la disposition contenue dans le TBI avec le Mexique, se reporter à la partie consacrée aux « exclusions du mécanisme de règlement des différends », ci-après.
20. La disposition du TBI avec l’Allemagne est contenue dans le Protocole additif au Traité et est rédigée comme suit :
3. Ad article 2:
(a) Sont considérées comme des « conditions » au sens de l’article 2 : les restrictions à l’achat de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, les entraves à la vente de produits à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi que toutes autres mesures ayant des effets similaires. Les mesures de nature générale prises sans discrimination par rapport à ses ressortissants ou entreprises et aux ressortissants et entreprises de pays tiers, ainsi que les mesures prises pour des raisons de sécurité, d’ordre et de santé publics ou de moralité ne seront pas considérées comme des « conditions » au sens de l’article 2.
La disposition contenue dans le TBI avec le Qatar est la suivante :
158 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Article VII
Exclusions
1. Le présent Accord ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties de prendre toutes mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la moralité publics, au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
21. 25 TBI, conclus avec l’Arménie, le Bangladesh, le Congo, la République tchèque et la République slovaque, la République démocratique du Congo,l’Estonie, Grenade, Haïti, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la République de Moldova, la Mongolie, le Maroc,Panama, la Pologne, la Roumanie, la Russie, le Sénégal, le Sri Lanka, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine contiennent la même disposition que le TBI avec l’Argentine.
Les autres TBI contiennent les dispositions suivantes :
– TBI avec l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Bolivie, la Bulgarie, le Cameroun, la Croatie, l’Équateur, la Géorgie, le Honduras, la Jordanie, le Nicaragua,Trinidad et Tobago, l’Ouzbékistan :
Article XIV
Mesures non interdites par le présent Traité
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties de prendre toutes mesures nécessaires au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
– TBI avec l’Égypte :
ARTICLE X
MESURES NON INTERDITES PAR LE TRAITÉ
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties ou de ses subdivisions politiques ou administratives de prendre toutes mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la moralité publics, au respect de ses obligations internationales existantes et à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou toutes mesures que les Parties estiment nécessaires au respect de leurs obligations internationales futures.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 159
– TIB avec le Bahreïn, El Salvador, le Mozambique :
Article XIV
1. Le présent Traité ne saurait empêcher l’une ou l’autre des Parties de prendre toutes mesures nécessaires au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, ou à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
– Le TBI le plus récent, conclu avec l’Uruguay, a été rédigé suivant le modèle de TBI de 2004. Par conséquent, il contient la disposition suivante :
Article 18 : Intérêts essentiels de sécurité
Aucune disposition du présent traité ne saurait être interprétée comme :
1. obligeant une Partie à fournir des informations ou à permettre l’accès à des informations dont elle estime que la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ; ou
2. d’empêcher une Partie d’appliquer toutes mesures qu’elle estime nécessaires au respect de ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
22. Il s’agit des ALE conclus avec le Chili, l’Amérique centrale et la République dominicaine, le Maroc, l’Oman et Singapour.
23. La disposition du TBI avec l’Inde est libellée comme suit : :
Article 12
Droit applicable
[…]
(2) Aucune disposition du présent Accord ne saurait empêcher la Partie contractante d’accueil de prendre toutes mesures nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité dans des circonstances exceptionnelles ou en cas d’extrême urgence, dans le respect de sa législation, appliquée sur une base non discriminatoire.
160 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
24. On trouve une disposition similaire dans les TBI conclus avec l’Arménie, le Bélarus, la Bosnie, l’Éthiopie, le Guatemala, le Kirghizistan, le Nicaragua, le Nigeria, la Tanzanie, la Zambie:
Article 15
Exceptions générales
1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu’elle juge nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité en période de guerre ou de conflit armé ou dans toute autre situation d’urgence dans les relations internationales.
25. Même disposition que dans le TBI avec l’Uruguay.
Concernant les TBI avec les Pays-Bas et avec la Suisse, voir plus bas dans le tableau. Pour les TBI avec l’Autriche et la Finlande, voir plus haut dans le tableau.
Voir la note 2 concernant le TBI avec la Belgique et la note 8 concernant les deux dispositions du TBI conclu avec l’Allemagne.
Le TBI avec Cuba contient la disposition suivante :
Artículo Décimo Segundo
Exclusiones
No estarán sujetas al mecanismo de solución de controversias de este Apéndice, las resoluciones que adopte una Parte por razones de seguridad nacional o aquellas resoluciones que prohíban o restrinjan la adquisición de una inversión en su territorio, que sea propiedad o esté controlada por nacionales de esa Parte, por inversionistas de la otra Parte, de conformidad con la legislación nacional de cada Parte.
26. Pour la disposition du TBI contenue dans le TBI avec l’Inde, voir la note 10 ci-dessus.
Le TBI avec l’Uruguay contient la disposition suivante :
Article 2
1) Chacune des Parties contractantes s’engage, dans le cadre de sa législation et de sa réglementation, à promouvoir la coopération économique en
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 161
protégeant les investissements réalisés sur son territoire par les ressortissants de l’autre Partie contractante. Chacune des Parties s’engage à admettre ces investissements, sous réserve de son droit à exercer les pouvoirs que lui confèrent sa législation et sa réglementation.
2) Les activités qui, pour des raisons de sécurité, de moralité, d’hygiène ou d’ordre publics sont interdites ou sont réservées aux ressortissants des Parties contractantes sont exclues du champ d’application des dispositions du présent Accord.
27. Concernant la disposition contenue dans le TBI avec l’Inde, voir la note 10 ci-dessus. Les autres dispositions sont les suivantes :
– TBI avec le Tchad :
Art. 2
[…]
Les mesures prises pour des raisons de sécurité, d’ordre, de santé et de moralité publics, ne sont pas considérées comme « traitement moins favorable » au sens du premier paragraphe de cet article.
– TBI avec l’Égypte, la Jordanie et le Soudan :
Art. 4
Les Parties Contractantes n’entraveront pas la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante facilitera sur son territoire de tels investissements et délivrera à cet effet les autorisations nécessaires, y compris les autorisations relatives à la mise en oeuvre des accords de fabrication, à l’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi qu’à l’emploi d’experts et d’autres personnes qualifiées de l’autre Partie Contractante ou d’un Etat tiers, et ceci conformément à sa législation en vigueur en la matière.
Cependant, chaque Partie Contractante peut refuser des permis d’emploi pour des raisons de sécurité.
– TBI avec la République de l’Île Maurice :
Art. 11 Autres règles et engagements particuliers
[…]
(3) Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie contractante de prendre toute mesure nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, ou pour des motifs de santé publique ou de prévention des maladies affectant les animaux et les végétaux.
– TBI conclu avec l’Ouganda:
162 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Protocole
[…]
add article 3, alinéa 1
Les mesures prises pour des raisons d’ordre public et de sécurité ainsi que de santé publique ou des principes de moralité ne seront pas considérées comme déraisonnables ou discriminatoires.
– TBI avec l’Uruguay :
Art. 2 Promotion, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à sa législation. Les Parties Contractantes se reconnaissent mutuellement le droit de ne pas autoriser des activités économiques pour des raisons de sécurité, d’ordre, de santé ou de moralité publics, ainsi que les activités réservées par la loi à leurs propres investisseurs.
– TBI avec les Émirats arabes unis :
Art. 11 Autres règles et engagements particuliers
[…]
(4) Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d’entreprendre toute action demandée par la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité public.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 163
PARTE I
Chapitre 6.
INDICE DE RESTRICTIVITÉ DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À L’IDE DANS LES PAYS DE L’OCDE : RÉEXAMEN
ET EXTENSION À D’AUTRES ÉCONOMIES ET SECTEURS*
Principales conclusions
Les niveaux de restrictivité des pays de l’OCDE à l’égard de l’investissement direct étranger (IDE) ont été progressivement abaissés au fil du temps et sont en moyenne peu élevés. Les variations qui subsistent sont largement le fait du petit groupe de pays qui maintiennent certaines formes de filtrage général des investissements étrangers. Les pays non membres de l’OCDE qui adhèrent à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales sont en général aussi ouverts que les pays membres de l’OCDE. D’autres pays non membres de l’OCDE comme la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Russie appliquent des restrictions plus importantes. Parmi les neuf secteurs couverts par l’indice de restrictivité, ceux où l’indice est le plus élevé sont l’électricité et les transports et ceux où il est le plus bas sont le tourisme, la construction et le secteur manufacturier. L’indice ne prend pas en compte un certain nombre de facteurs autres que la discrimination réglementaire ayant une incidence sur les entrées
* Cet article précise les faits initialement présentés dans le document de travail de l’OCDE sur la politique de l’investissement n° 2006 (également disponible dans le document de travail n° 525 du Département des affaires économiques) préparé par Takeshi Koyama, alors qu’il était administrateur principal à la Division de l’investissement de l’OCDE et Stephen Golub, consultant au Département des affaires économiques et professeur de sciences économiques au Swarthmore College, aux États-Unis. Il contient de nouvelles données sur l’Égypte, recueillies par la Division de l’investissement (OCDE, 2007), des données révisées sur l’Australie et l’Autriche ainsi que des estimations concernant le secteur des pêcheries établies à partir des travaux de la Division des politiques des pêcheries de l’OCDE (OCDE, 2006c).
164 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
d’investissement direct. Cependant, lorsqu’il est combiné avec ces facteurs, l’indice prédit efficacement les résultats concernant l’IDE.
Données
Cet article présente le nouvel indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE établi par l’OCDE pour 29 pays membres de l’OCDE1 et l’étend à dix pays non membres qui adhèrent à la Déclaration de l’OCDE (l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Égypte, l’Estonie, Israël, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovénie) de même qu’à quatre autres grands pays non membres de l’OCDE (l’Afrique du Sud, la Chine, l’Inde et la Russie). L’indice de restrictivité à l’encontre de l’IDE couvre neuf secteurs et onze sous-secteurs ; les estimations concernant les pêcheries, qui reposent sur une méthodologie légèrement ajustée, sont données séparément.
La méthode utilisée est très similaire à celle qui a été adoptée pour la série d’indicateurs précédente (voir annexe 6.A1.) L’analyse est principalement fondée sur des données produites par l’OCDE – en particulier par le biais des travaux réalisés par le Comité de l’investissement dans le cadre de la mise en œuvre du Code de l'OCDE de la libération des mouvements de capitaux (OCDE, 2004a) et de l’Instrument relatif au traitement national (OCDE, 2005) ; des rapports de l’OCDE sur la participation des investisseurs internationaux dans les télécommunications et les infrastructures ; des Examens de l’OCDE des politiques de l'investissement consacrés respectivement à la Russie et à la Chine (OCDE, 2006a et b) ; et des Dialogues sur les politiques à suivre dans le domaine de l’investissement menés avec l’Inde et l’Égypte2. Comme cela a été fait pour les indicateurs précédents ayant servi à établir l’indice de restrictivité, les listes d’engagements dans le cadre de l’AGCS – remontant à l’année 2000 – ont fourni des sources additionnelles d’information pour certains secteurs de services et certains pays3. Des sources nationales ont également été consultées, notamment en ce qui concerne des pays non membres comme l’Afrique du Sud, la Chine, l’Égypte, l’Inde et la Russie. L’examen systématique des sources de données nationales pour chaque pays n’entrait toutefois pas dans le cadre de la présente étude, ni ne correspondait aux moyens qui y ont été affectés.
La validité des résultats est donc principalement tributaire de l’exactitude des informations mises à la disposition de l’OCDE. Pour éviter que les informations soient inexactes ou périmées, les pays membres de l’OCDE, de même que les pays non membres de l’Organisation qui adhèrent à l’Instrument relatif au traitement national, ont prêté leur concours en vue de l’obtention de données plus précises. L’indice sera amélioré et actualisé à la lumière des évolutions nouvelles et des informations additionnelles.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 165
Méthodologie
Les indicateurs visent principalement à mesurer les écarts par rapport au « traitement national », c’est-à-dire la discrimination exercée à l’encontre de l’investissement étranger, plutôt que le cadre institutionnel plus général. La réglementation applicable à la main-d’oeuvre et aux marchés de produits ainsi qu’aux investisseurs nationaux n’est pas abordée ici, si l’on excepte les monopoles d’État. Les restrictions concernant le traitement national peuvent être réparties entre les restrictions à l’exploitation effectuées a priori et aposteriori. Les indicateurs prennent en compte les obstacles discriminatoires à l’entrée se manifestant par des limitations de la participation, des procédures de filtrage spéciales visant seulement les investisseurs étrangers ainsi que des restrictions appliquées a posteriori concernant la direction et d’autres aspects de l’exploitation. Les restrictions réglementaires applicables à l’IDE peuvent être générales, et s’appliquer à tous les secteurs, ou n’être valables que pour certains d’entre eux. Les limitations des niveaux de participation étrangère sont généralement précisées secteur par secteur alors que les critères d’autorisation discriminatoires sont souvent généralisés4.
La restrictivité est mesurée sur une échelle de 0 à 1, où 0 correspond à une ouverture complète et 1 à l’interdiction de l’IDE. En raison de leur importance évidente, les restrictions envers les participations étrangères reçoivent un coefficient de pondération élevé. La restrictivité est établie par secteur, après quoi une moyenne pondérée est obtenue pour les pays de l’OCDE en utilisant les coefficients, d’après la composition sectorielle de l’IDE global et des courants d’échanges des différents pays. L’annexe 6.A1 apporte d’autres précisions sur la méthodologie et le système de pondération.
L’indice couvre neuf secteurs et onze sous-secteurs. Étant donné que les perspectives d’investissement dans l’énergie, par exemple dans le pétrole et le gaz, varient considérablement d’un pays à l’autre en fonction des ressources naturelles, les secteurs énergétiques autres que l’électricité ne sont pas couverts par l’indice. L’exclusion d’autres secteurs primaires comme l’exploitation minière peut fausser les indicateurs de restrictivité des différents pays. Dans la zone OCDE, la part des secteurs primaires est cependant modeste et l’extension de l’indice ne devrait vraisemblablement pas avoir d’effets significatifs sur le classement global d’un pays. L’annexe 6.A2 présente un exemple d’adaptation de la méthodologie utilisée pour calculer l’indice de restrictivité de l’IDE à l’estimation de la restrictivité dans d’autres secteurs, à savoir la capture et la transformation des produits de la mer. L’indice pourrait à l’avenir être étendu à d’autres secteurs.
166 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Il convient d’émettre des réserves importantes en ce qui concerne les niveaux de restrictivité de la réglementation de l’IDE indiqués ici. Les calculs sont limités aux restrictions réglementaires manifestes sur l’IDE et font abstraction des restrictions institutionnelles ou informelles ne relevant pas de l’action publique, par exemple les restrictions des modalités de financement et de contrôle des entreprises, et des pratiques qui affectent indirectement l’IDE, en particulier la réglementation économique et sociale. De même, le degré d’application des restrictions statutaires, qui est difficile à déterminer, n’a pas été pris en compte dans les calculs. Il se peut que le niveau de restrictivité associé aux critères de filtrage soit particulièrement variable selon les pays. En outre, certains pays sont peut-être plus disposés que d’autres à signaler d’eux-mêmes les restrictions qu’ils appliquent. Par conséquent, il se pourrait que les pays les plus transparents se voient attribuer des notes plus élevées, non pas parce qu’ils sont en fait plus restrictifs, mais parce qu’ils fournissent des déclarations plus complètes. Dans certains pays à structure fédérale, la réglementation sectorielle relative à la composition du conseil d’administration des sociétés relève dans certains cas de la compétence de l’administration infranationale. Il se peut qu’en conséquence les niveaux de restrictivité fondés principalement sur la prise en compte de la législation nationale ne reflètent pas nécessairement les écarts existant entre les différents pays en ce qui concerne l’ampleur des exigences relatives à la nationalité. Enfin, les restrictions réglementaires déclarées par les différents pays ne sont pas normalisées, et il est donc difficile d’évaluer les restrictions applicables dans chaque pays et de les mettre en perspective.
Utilisé seul, l’indice de restrictivité ne permet pas de prédire efficacement l’attrait d’un pays pour l’IDE. En revanche, lorsqu’il est combiné avec d’autres facteurs, l’indice peut contribuer à expliquer les écarts entre les pays en ce qui concerne cet aspect5. En dépit de leurs limites, ces calculs se sont révélés utiles aussi bien pour les décideurs que pour les chercheurs qui souhaitent évaluer les pratiques en matière d’IDE.
Résultats
Le tableau 1 présente les résultats synthétiques par secteur pour 29 pays membres et 14 pays non membres de l’OCDE. Le graphique 1 répartit les niveaux de restrictivité globale en fonction de critères liés à la participation, au filtrage et à l’exploitation.
Parmi les pays de l’OCDE, les plus ouverts se trouvent généralement en Europe. Depuis la fin des années 80, les flux d’IDE intra-UE sont presque entièrement exempts de restrictions et l’Espace économique européen (EEE) a également libéralisé les investissements intrabloc dans une certaine mesure6. En
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 167
outre, de nombreux pays de l’Union européenne et de l’EEE appliquent des restrictions formelles minimales aux entrées d’investissements en provenance de pays tiers. L’UE n’est pas encore un bloc entièrement unifié en termes de pratiques vis-à-vis de l’investissement direct de l’étranger. Une harmonisation et une libéralisation importantes des échanges sont toutefois survenues à l’intérieur de l’Union. Les pays de l’OCDE où les niveaux globaux de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE sont les plus élevés sont l’Islande, le Mexique, l’Australie et le Canada, avec des résultats supérieurs à 0.20. Les autorités australiennes ont récemment décidé de libéraliser le système de filtrage de l’investissement étranger en portant de 50 à 100 millions AUD le seuil d’application de ce système.
La restrictivité de la réglementation est plus différenciée entre les pays non membres. Certains de ces pays, pour la plupart des pays d’Europe orientale, auxquels s’ajoutent le Chili et l’Argentine, ont un faible indice de restrictivité de la réglementation. Des mesures récentes de libéralisation ont également permis à l’Égypte de réduire considérablement la restrictivité de sa réglementation applicable à l’IDE. D’autres pays, en particulier la Chine, l’Inde et la Russie, affichent encore des niveaux de restrictivité relativement élevés. En moyenne, les pays non membres de l’OCDE sont légèrement plus restrictifs que les pays membres, comme l’illustrent les dernières colonnes du tableau 1.
Dans l’ensemble des pays, le schéma des restrictions sectorielles est plus ou moins semblable. Les secteurs les plus affectés par des restrictions sont l’électricité, les transports, les télécommunications et les services financiers. Le secteur manufacturier, le tourisme, la construction et la distribution sont en général moins touchés. On observe toutefois des différences entre pays membres et pays non membres de l’OCDE. En particulier, dans les pays non membres de l’OCDE, les restrictions affectant les transports et le tourisme sont moins importantes et celles qui visent l’électricité, la distribution et les services financiers sont très fortes.
Pour étudier les évolutions survenues au chapitre de la libéralisation, il ne faut pas comparer directement les nouveaux résultats avec ceux qui ont été publiés initialement en 2003. De fait, de nombreuses variations par rapport aux précédents résultats ne découlent pas d’un réexamen des pratiques mais de la modification des sources d’information7. Enfin, la méthode de calcul du nouvel indice de restrictivité a été légèrement modifiée (voir annexe 6.A1.)
168
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
200
7 –
ISB
N-
978-
92-6
4-03
758-
8 ©
OE
CD
200
7
Gra
ph
iqu
e 6.
1. In
dic
e d
e re
stri
ctiv
ité
de
la r
égle
men
tati
on
ap
plic
able
à l’
IDE
dan
s n
euf
sect
eurs
, par
typ
e d
e re
stri
ctio
n*
0.00
0
0.05
0
0.10
0
0.15
0
0.20
0
0.25
0
0.30
0
0.35
0
0.40
0
0.45
0
exp
loita
tion
filtr
age
par
ticip
atio
n
*C
et
indi
ce
agré
gé
couv
re
les
sect
eurs
et
so
us-s
ecte
urs
suiv
ants
: se
rvic
es
aux
entr
epri
ses
(ser
vice
s ju
ridi
ques
, co
mpt
abili
té,
arch
itec
ture
et
in
géni
erie
),
télé
com
mun
icat
ions
(té
léph
onie
fix
e et
mob
ile),
con
stru
ctio
n, d
istr
ibut
ion,
ser
vice
s fi
nanc
iers
(as
sura
nce
et b
anqu
e), t
ouri
sme,
tran
spor
ts (
aéri
en, m
ariti
me
et te
rres
tre)
, él
ectr
icité
et s
ecte
ur m
anuf
actu
rier
.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 169
Il reste que les modifications décidées par les pouvoirs publics des pays membres de l’OCDE entre 1998-2000 et 2006 en ce qui concerne l’abaissement des plafonds des participations étrangères sont limitées. Conformément à l’obligation de statu quo observée par les pays membres aux termes des instruments de l’OCDE, on n’a pas recensé de relèvement de ces plafonds au cours de la période considérée. Parmi les pays de l’OCDE, c’est la Turquie qui a engagé la plus importante initiative de libéralisation des restrictions applicables aux participations étrangères, qui s’est traduite par une baisse de près de 0.1 de son indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE. Les indices de la Pologne, du Mexique, de la République tchèque et du Canada diminuent légèrement, pour s’établir entre 0.05 et 0.03. À la suite d’efforts considérables de libéralisation, notamment de la réduction de la participation obligatoire dans un certain nombre de secteurs, plusieurs pays de l’OCDE, notamment l’Égypte, ont considérablement amélioré le niveau de restrictivité de leur réglementation applicable aux investissements de même que leur classement à cet égard.
Graphique 6.2. Restrictivité de la réglementation par secteur, moyenne OCDE et hors OCDE
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Touris
m
Constr
uction
Man
ufactu
ring
Distrib
ution
Busin
ess
All Ind
ustrie
s
Finance
Teleco
ms
Trans
port
Electr
icity
OECD Average
Non-OECD Average
Traduction des légendes
Tourisme Construction Secteur manufacturier Distribution Services aux entreprises Ensemble des secteurs Services financiers Télécommunications Transports Électricité
Moyenne OCDE Moyenne hors OCDE
170
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
200
7 –
ISB
N-
978-
92-6
4-03
758-
8 ©
OE
CD
200
7
Tab
leau
6.1
. In
dic
e d
e re
stri
ctiv
ité
de
la r
égle
men
tati
on
ap
plic
able
à l’
IDE
, par
pay
s et
par
sec
teu
r (1
= fe
rmé,
0 =
ouv
ert)
Aus
tral
ie
Aut
riche
B
elgi
que
Can
ada
Rép
ubliq
ue
tchè
que
Dan
emar
kF
inla
nde
Fra
nce
Alle
mag
neG
rèce
H
ongr
ie
Isla
nde
Irla
nde
Italie
Ser
vice
s au
x en
trep
rise
s
Ser
vice
s ju
ridiq
ues
0.23
5 0.
248
0.02
2 0.
200
0.12
5 1.
000
0.55
0 0.
233
0.02
2 0.
462
0.10
0 0.
266
0.02
2 0.
022
Co
mpt
abili
té
0.23
5 0.
248
0.02
2 0.
200
0.37
5 0.
562
0.55
0 0.
033
0.02
2 0.
506
0.10
0 0.
266
0.02
2 0.
022
Arc
hite
ctur
e 0.
185
0.24
8 0.
022
0.15
0 0.
050
0.02
2 0.
110
0.03
3 0.
022
0.46
2 0.
100
0.26
6 0.
022
0.02
2
Ingé
nier
ie
0.18
5 0.
248
0.02
2 0.
150
0.05
0 0.
022
0.11
0 0.
033
0.02
2 0.
462
0.10
0 0.
266
0.02
2 0.
022
Tot
al
0.21
0 0.
248
0.02
2 0.
175
0.15
0 0.
432
0.33
0 0.
083
0.02
2 0.
473
0.10
0 0.
266
0.02
2 0.
022
Tél
éco
mm
un
icat
ion
s
Fix
es
0.68
5 0.
072
0.07
2 0.
525
0.05
0 0.
072
0.11
0 0.
072
0.12
2 0.
122
0.20
0 0.
266
0.12
2 0.
072
M
obile
s 0.
185
0.07
2 0.
072
0.52
5 0.
050
0.07
2 0.
110
0.07
2 0.
122
0.12
2 0.
100
0.26
6 0.
122
0.07
2
Tot
al
0.56
0 0.
072
0.07
2 0.
525
0.05
0 0.
072
0.11
0 0.
072
0.12
2 0.
122
0.17
5 0.
266
0.12
2 0.
072
Co
nst
ruct
ion
0.
185
0.07
2 0.
022
0.15
0 0.
100
0.02
2 0.
110
0.02
2 0.
022
0.02
2 0.
100
0.26
6 0.
022
0.02
2
Dis
trib
uti
on
0.
185
0.07
2 0.
022
0.15
0 0.
050
0.02
2 0.
110
0.02
2 0.
022
0.02
2 0.
100
0.26
6 0.
022
0.02
2
Ser
vice
s fi
nan
cier
s
Ass
uran
ce
0.18
5 0.
172
0.04
4 0.
200
0.15
0 0.
044
0.11
0 0.
138
0.11
6 0.
088
0.15
0 0.
266
0.08
8 0.
088
Ban
que
0.30
0 0.
072
0.04
4 0.
225
0.15
0 0.
022
0.16
0 0.
094
0.07
2 0.
088
0.10
0 0.
442
0.04
4 0.
144
Tot
al
0.27
4 0.
095
0.04
4 0.
219
0.15
0 0.
027
0.14
9 0.
104
0.08
2 0.
088
0.11
2 0.
401
0.05
4 0.
131
Hô
tels
et
rest
aura
nts
0.
185
0.07
2 0.
022
0.15
0 0.
050
0.02
2 0.
110
0.02
2 0.
022
0.02
2 0.
100
0.26
6 0.
022
0.02
2
Tra
nsp
ort
s
Tra
nspo
rt a
érie
n 0.
635
0.22
2 0.
122
0.67
5 0.
450
0.42
2 0.
310
0.19
8 0.
248
0.52
2 0.
500
0.39
8 0.
466
0.49
4
Tra
nspo
rt m
ariti
me
0.
485
0.37
2 0.
248
0.30
0 0.
100
0.02
2 0.
210
0.19
8 0.
198
0.25
4 0.
400
0.26
6 0.
066
0.06
6
Tra
nspo
rt r
outie
r 0.
185
0.12
2 0.
072
0.25
0 0.
100
0.12
2 0.
154
0.07
2 0.
022
0.02
2 0.
150
0.26
6 0.
022
0.02
2
Tot
al
0.47
1 0.
269
0.16
9 0.
413
0.21
7 0.
176
0.23
2 0.
171
0.17
7 0.
294
0.38
0 0.
310
0.19
0 0.
199
Éle
ctri
cité
0.
185
0.07
2 0.
022
0.35
0 0.
450
0.12
2 0.
210
0.32
2 0.
122
1.00
0 0.
200
1.00
0 1.
000
0.12
2
Sec
teu
r m
anu
fact
uri
er
0.18
5 0.
072
0.02
2 0.
150
0.05
0 0.
022
0.11
0 0.
072
0.02
2 0.
022
0.10
0 0.
266
0.02
2 0.
022
TO
TA
L
0.26
7 0.
142
0.05
2 0.
228
0.12
2 0.
131
0.18
0 0.
094
0.06
3 0.
187
0.15
3 0.
309
0.07
8 0.
073
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
ÉD
ITIO
N 2
007
– IS
BN
978
-92-
64-0
3758
-8 -
© O
CD
E 2
007
171
Tab
leau
6.1
(su
ite)
In
dic
e d
e re
stri
ctiv
ité
de
la r
égle
men
tati
on
ap
plic
able
à l’
IDE
, par
pay
s et
par
sec
teu
r (1
= fe
rmé,
0 =
ouv
ert)
Japo
n C
orée
M
exiq
ueP
ays-
Bas
N
ouve
lle-
Zél
ande
N
orvè
geP
olog
ne
Por
tuga
l R
épub
lique
sl
ovaq
ue
Esp
agne
Suè
de
Sui
sse
Tur
quie
R
oyau
me-
Uni
É
tats
-Uni
s
Ser
vice
s au
x en
trep
rise
s
Ser
vice
s ju
ridiq
ues
0.10
0 0.
075
0.15
0 0.
011
0.12
5 0.
405
0.22
5 0.
022
0.07
5 0.
512
0.55
6 0.
175
0.25
0 0.
017
0.07
5
Co
mpt
abili
té
0.10
0 0.
075
0.42
5 0.
011
0.12
5 0.
405
0.17
5 0.
066
0.37
5 0.
066
0.29
2 0.
100
0.15
0 0.
017
0.02
5
Arc
hite
ctur
e 0.
025
0.05
0 0.
125
0.01
1 0.
125
0.05
5 0.
075
0.02
2 0.
075
0.02
2 0.
066
0.10
0 0.
100
0.01
7 0.
025
Ingé
nier
ie
0.02
5 0.
050
0.12
5 0.
011
0.12
5 0.
055
0.07
5 0.
022
0.07
5 0.
022
0.06
6 0.
100
0.10
0 0.
017
0.02
5
Tot
al
0.06
3 0.
063
0.20
6 0.
011
0.12
5 0.
230
0.13
8 0.
033
0.15
0 0.
156
0.24
5 0.
119
0.15
0 0.
017
0.03
8
Tél
éco
mm
un
icat
ion
s
F
ixes
0.
286
0.40
0 0.
425
0.01
1 0.
480
0.05
5 0.
375
0.12
2 0.
072
0.32
2 0.
166
0.20
0 0.
100
0.01
7 0.
025
M
obile
s 0.
025
0.40
0 0.
150
0.01
1 0.
125
0.05
5 0.
375
0.12
2 0.
072
0.32
2 0.
166
0.10
0 0.
100
0.01
7 0.
025
Tot
al
0.22
1 0.
400
0.35
6 0.
011
0.39
1 0.
055
0.37
5 0.
122
0.07
2 0.
322
0.16
6 0.
175
0.10
0 0.
017
0.02
5
Co
nst
ruct
ion
0.
025
0.05
0 0.
125
0.01
1 0.
125
0.05
5 0.
075
0.02
2 0.
072
0.02
2 0.
066
0.10
0 0.
100
0.01
7 0.
025
Dis
trib
uti
on
0.
025
0.05
0 0.
125
0.01
1 0.
125
0.05
5 0.
075
0.02
2 0.
072
0.02
2 0.
066
0.10
0 0.
100
0.01
7 0.
025
Ser
vice
s fi
nan
cier
s
Ass
uran
ce
0.02
5 0.
050
0.42
5 0.
055
0.12
5 0.
105
0.07
5 0.
116
0.17
2 0.
226
0.11
6 0.
100
0.10
0 0.
083
0.17
5
Ban
que
0.07
5 0.
050
0.52
5 0.
033
0.12
5 0.
105
0.32
5 0.
172
0.17
2 0.
182
0.11
6 0.
110
0.15
0 0.
067
0.27
5
Tot
al
0.06
4 0.
050
0.50
2 0.
038
0.12
5 0.
105
0.26
8 0.
159
0.17
2 0.
192
0.11
6 0.
108
0.15
0 0.
070
0.25
2
Hô
tels
et
rest
aura
nts
0.
025
0.05
0 0.
125
0.01
1 0.
125
0.05
5 0.
075
0.02
2 0.
072
0.02
2 0.
066
0.10
0 0.
100
0.01
7 0.
025
Tra
nsp
ort
s
Tra
nspo
rt a
érie
n 0.
675
0.35
0 0.
625
0.41
1 0.
574
0.15
5 0.
375
1.00
0 0.
372
0.30
4 0.
316
0.50
0 0.
500
0.26
7 0.
650
Tra
nspo
rt m
ariti
me
0.
275
0.45
0 0.
425
0.35
5 0.
225
0.45
5 0.
075
0.12
2 0.
122
0.31
6 0.
266
0.59
4 0.
500
0.36
1 0.
275
Tra
nspo
rt r
outie
r 0.
025
0.05
0 0.
125
0.01
1 0.
125
0.35
5 0.
125
0.02
2 0.
072
0.02
2 0.
166
0.15
0 0.
100
0.01
7 0.
025
Tot
al
0.35
6 0.
333
0.42
8 0.
301
0.32
0 0.
334
0.18
5 0.
434
0.19
4 0.
250
0.26
2 0.
469
0.41
6 0.
256
0.34
6
Éle
ctri
cité
0.
025
0.40
0 1.
000
0.61
1 0.
225
0.15
5 0.
175
0.12
2 0.
322
0.02
2 0.
166
0.40
0 0.
400
0.01
7 0.
125
Sec
teu
r m
anu
fact
uri
er
0.02
5 0.
050
0.12
5 0.
011
0.12
5 0.
055
0.07
5 0.
022
0.07
2 0.
072
0.06
6 0.
100
0.10
0 0.
017
0.02
5
TO
TA
L
0.10
1 0.
120
0.27
8 0.
074
0.17
0 0.
144
0.15
1 0.
120
0.12
8 0.
140
0.14
7 0.
174
0.17
3 0.
065
0.11
9
172
PER
SPE
CT
IVE
S D
'INV
EST
ISSE
ME
NT
IN
TE
RN
AT
ION
AL
200
7 –
ISB
N-
978-
92-6
4-03
758-
8 ©
OE
CD
200
7
Tab
leau
6.1
(su
ite)
In
dic
e d
e re
stri
ctiv
ité
de
la r
égle
men
tati
on
ap
plic
able
à l’
IDE
, par
pay
s et
par
sec
teu
r (1
= fe
rmé,
0 =
ouv
ert)
Arg
entin
e B
rési
l C
hili
Isra
ël
Égy
pte
Est
onie
Letto
nie
Litu
anie
R
oum
anie
S
lové
nie
Chi
ne
Inde
R
ussi
e A
friq
ue
du S
udM
oyen
ne
OC
DE
Moy
enne
ho
rsO
CD
E
Moy
enne
gé
néra
le
Ser
vice
s au
x en
trep
rise
s
Ser
vice
s ju
ridiq
ues
0.12
5 0.
100
0.12
5 0.
150
0.22
5 1.
000
0.00
0 0.
050
0.25
0 0.
125
0.30
0 1.
000
0.17
5 0.
125
0.21
7 0.
268
0.23
6
Co
mpt
abili
té
0.12
5 0.
100
0.02
5 0.
050
0.22
5 0.
022
0.00
0 0.
050
0.05
0 0.
125
0.42
5 1.
000
0.17
5 0.
125
0.19
2 0.
178
0.18
9
Arc
hite
ctur
e 0.
125
0.10
0 0.
025
0.05
0 0.
225
0.02
2 0.
000
0.05
0 0.
050
0.10
0 0.
100
1.00
0 0.
175
0.12
5 0.
090
0.15
3 0.
110
Ingé
nier
ie
0.12
5 0.
100
0.02
5 0.
050
0.22
5 0.
022
0.00
0 0.
050
0.05
0 0.
100
0.10
0 0.
050
0.17
5 0.
125
0.09
0 0.
086
0.08
8
Tot
al
0.12
5 0.
100
0.05
0 0.
075
0.22
5 0.
272
0.00
0 0.
050
0.10
0 0.
113
0.23
1 0.
863
0.17
5 0.
125
0.14
8 0.
179
0.15
9
Tél
éco
mm
un
icat
ion
s
F
ixes
0.
125
0.20
0 0.
025
0.25
0 0.
450
0.02
2 0.
000
0.05
0 0.
150
0.20
0 0.
550
0.35
0 0.
400
0.65
0 0.
194
0.24
4 0.
200
M
obile
s 0.
125
0.20
0 0.
025
0.25
0 0.
050
0.02
2 0.
000
0.05
0 0.
150
0.10
0 0.
450
0.35
0 0.
350
0.60
0 0.
139
0.19
4 0.
146
Tot
al
0.12
5 0.
200
0.02
5 0.
250
0.35
0 0.
022
0.00
0 0.
050
0.15
0 0.
175
0.52
5 0.
350
0.38
8 0.
638
0.18
0 0.
232
0.18
6
Co
nst
ruct
ion
0.
125
0.10
0 0.
025
0.05
0 0.
475
0.02
2 0.
000
0.05
0 0.
050
0.10
0 0.
150
0.25
0 0.
200
0.15
0 0.
070
0.12
5 0.
086
Dis
trib
uti
on
0.
125
0.10
0 0.
025
0.05
0 0.
100
0.02
2 0.
000
0.05
0 0.
050
0.10
0 0.
450
0.60
0 0.
100
0.15
0 0.
068
0.13
7 0.
089
Ser
vice
s fi
nan
cier
s
Ass
uran
ce
0.12
5 0.
150
0.02
5 0.
050
0.20
0 0.
122
0.00
0 0.
050
0.05
0 0.
100
0.35
0 0.
450
0.85
0 0.
350
0.13
1 0.
205
0.15
0
Ban
que
0.17
5 0.
400
0.02
5 0.
050
0.10
0 0.
022
0.00
0 0.
100
0.17
5 0.
100
0.55
0 0.
350
0.55
0 0.
250
0.15
3 0.
203
0.16
8
Tot
al
0.16
4 0.
343
0.02
5 0.
050
0.12
3 0.
045
0.00
0 0.
089
0.14
6 0.
100
0.50
4 0.
373
0.61
9 0.
273
0.14
8 0.
204
0.16
4
Hô
tels
et
rest
aura
nts
0.
125
0.10
0 0.
025
0.05
0 0.
125
0.02
2 0.
000
0.05
0 0.
050
0.10
0 0.
150
0.05
0 0.
100
0.10
0 0.
068
0.07
5 0.
070
Tra
nsp
ort
s
Tra
nspo
rt a
érie
n 0.
125
0.60
0 0.
475
0.55
0 0.
450
0.32
2 0.
132
0.35
0 0.
750
0.74
0 0.
550
0.55
0 0.
600
0.25
0 0.
439
0.46
0 0.
451
Tra
nspo
rt m
ariti
me
0.
175
0.20
0 0.
575
0.15
0 0.
525
0.36
6 0.
000
0.09
4 0.
150
0.24
4 0.
550
0.05
0 0.
400
0.25
0 0.
276
0.26
6 0.
273
Tra
nspo
rt r
outie
r 0.
425
0.60
0 0.
345
0.05
0 0.
125
0.02
2 0.
100
0.05
0 0.
050
0.10
0 0.
150
0.05
0 0.
200
0.30
0 0.
102
0.18
3 0.
125
Tot
al
0.21
1 0.
416
0.49
4 0.
261
0.41
6 0.
279
0.06
5 0.
169
0.32
7 0.
377
0.46
6 0.
215
0.42
4 0.
261
0.29
5 0.
313
0.30
2
Éle
ctri
cité
0.
125
0.10
0 0.
025
0.65
0 0.
550
0.62
2 1.
000
0.65
0 0.
450
0.70
0 0.
750
0.15
0 0.
750
1.00
0 0.
322
0.53
7 0.
378
Sec
teu
r m
anu
fact
uri
er
0.12
5 0.
100
0.02
5 0.
050
0.05
0 0.
022
0.00
0 0.
050
0.05
0 0.
100
0.40
0 0.
200
0.23
0 0.
200
0.07
2 0.
114
0.08
3
TO
TA
L
0.14
5 0.
195
0.10
7 0.
109
0.19
1 0.
127
0.03
0 0.
087
0.13
2 0.
162
0.40
5 0.
401
0.31
8 0.
234
0.14
4 0.
189
0.15
7
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 173
Notes
1. Les estimations antérieures de l’OCDE sont présentées dans Golub (2003). Elles figurent également dans le document OCDE (2003a) ainsi que dans les Études économiques de l’OCDE consacrées à plusieurs pays.
2. Les données utilisées sont fondées sur les évolutions de la réglementation notifiées par les administrations qui adhéraient aux instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement au mois de juin 2007 et ne prennent pas en compte les mesures de libéralisation subséquentes annoncées mais qui n’étaient pas encore en vigueur à cette date. Dans le cas de l’Égypte, les estimations sont fondées sur les informations fournies dans le cadre de l’examen, réalisé en mars 2007 par le Comité de l’investissement, de la conformité de l’Égypte à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales (OCDE, 2007).
3. Les informations fondées sur l’AGCS n’ont été utilisées que dans les cas où elles couvraient des aspects de la réglementation spécifiques à certains pays ou secteurs qui n’étaient pas complètement détaillés dans la position des pays à l’égard des instruments de l’OCDE.
4. Le Code de l’OCDE de libération des mouvement de capitaux définit les investissements directs étrangers comme des « investissements effectués en vue d’établir des liens économiques durables avec une entreprises, tels que, notamment, les investissements qui donnent la possibilité d’exercer une influence réelle sur la gestion de ladite entreprise ». En conséquence les dispositifs qui permettent les acquisitions étrangères d’actions non assorties de droit de vote et d’autres formes d’investissement de portefeuille (par contraste avec un investissement direct étranger), par exemple dans le transport aérien, n’ont pas été pris en compte dans le calcul des niveaux de restrictivité de l’IDE.
5. Voir, par exemple, Golub (2003) et Nicoletti, et al. (2003).
6. Les résultats des pays européens sont réduits proportionnellement lorsque des préférences intra-européennes sont en vigueur.
7. En particulier, les rapports de la Commission européenne, du US Trade Representative et du Ministère de l’économie et du commerce du Japon sur la pratique des autres pays n’ont plus été utilisés et la position des pays à l’égard des instruments de l’OCDE relatifs à l’investissement a été prise en compte de façon plus systématique.
174 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Bibliographie
Golub, Stephen S. (2003), Mesure des restrictions visant les investissement directs de l’étranger dans les pays de l’OCDE, Revue économique de l'OCDE, n° 36, vol. 2003-1.
Hardin, Alexis et Leanne Holmes (1997), Service Trade and Foreign Direct Investment,Australian Productivity Commission, (http://www.pc.gov.au/ic/research/information/servtrad/index.html).
Hardin, Alexis et Leanne Holmes (2002), « Measuring and Modelling Barriers to FDI », in Bora, B. (dir. publ.), Foreign Direct Investment: Research Issues, Routledge, Londres.
Nicoletti, Giuseppe, Stephen Golub, Dana Hajkova, Daniel Mirza et Kwang-Yeoul Yoo (2003), « Policies and international integration: influences on trade and foreign direct investment », documents de travail du Département des affaires économiques n° 359.
OCDE (2003a), Perspectives économiques de l'OCDE, juin, n° 73, vol. 2003-1,Paris.
OCDE (2004a), Code de l'OCDE de la libération des mouvements de capitaux, édition 2003, Paris.
OCDE (2005), Traitement national des entreprises sous contrôle étranger, édition 2005, Paris.
OCDE (2006a), Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement – Chine : Politiques ouvertes envers les fusions et acquisitions, Paris.
OCDE (2006b), Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement - Fédération de Russie : Pour une politique de l’investissement plus transparente, Paris.
OCDE (2006c), Analyse de certaines questions liées aux investissements étrangers dans le secteur pêche des pays de l’OCDE : révision, AGR/FI(2006)2/REV, Paris.
OCDE (2007), Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement -- Égypte.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 175
ANNEXE 6.A1.
MÉTHODOLOGIE UTILISÉE PAR L’OCDE POUR CALCULER LA RESTRICTIVITÉ DE LA RÉGLEMENTATION
APPLICABLE À L’IDE1
L’indice couvre les secteurs et sous-secteurs suivants : services aux entreprises (services juridiques, comptabilité, architecture et ingénierie), télécommunications (téléphonie fixe et mobile), construction, distribution, services financiers (assurance et banque), tourisme, transports (transport aérien, transport maritime et transport routier), électricité et secteur manufacturier. Les résultats concernant les pêcheries sont présentés séparément à l’annexe 6.A2.
Les restrictions de la réglementation à l’encontre de la participation étrangère constituent les obstacles les plus évidents aux entrées d’IDE. Elles consistent habituellement à limiter la part de capitaux propres des sociétés dans un secteur cible que des non-résidents sont autorisés à détenir, par exemple à moins de la moitié, ou même à interdire toute participation étrangère. Des procédures obligatoires de filtrage et d’agrément peuvent aussi être utilisées pour limiter l’IDE, encore que leur action restrictive dépende d’une application effective. Les clauses stipulant que les investisseurs étrangers doivent faire apparaître les avantages économiques de leurs projets d’investissements risquent d’alourdir le coût d’entrée et, partant, de décourager l’entrée de capitaux étrangers. L’agrément préalable, requis pour tous les projets d’IDE, dans quelques pays de l’OCDE, est également susceptible de freiner les entrées de capitaux étrangers s’il est perçu comme le signe d’une attitude ambivalente à l’égard du principe de libre circulation de l’IDE, même s’il n’est pas appliqué de façon rigoureuse.
Parmi d’autres restrictions formelles susceptibles de décourager les entrées d’IDE figurent les limitations de la capacité des ressortissants étrangers d’exercer des tâches d’encadrement ou d’autres fonctions dans les filiales de sociétés étrangères, ainsi que d’autres dispositifs de contrôle opérationnel visant ces entreprises. Les dispositions spécifiant que les nationaux ou les résidents doivent être majoritaires au conseil d’administration risquent de compromettre le contrôle des propriétaires étrangers sur leurs avoirs et de les rendre donc plus
176 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
hésitants à investir dans ces conditions. De même, si des réglementations limitent l’emploi de ressortissants étrangers, les investisseurs peuvent estimer qu’il leur est impossible de mobiliser l’expertise nécessaire pour rendre leur investissement productif. En outre, les prescriptions d’exploitation, notamment les restrictions à l’égard des non-membres concernant le cabotage dans le transport aérien, routier ou maritime, risquent de limiter les bénéfices des sociétés sous contrôle étranger et, par conséquent, le montant des fonds que les investisseurs étrangers sont disposés à engager.
Le tableau 6.A1.1 présente le système de notation utilisé pour calculer les indicateurs de restrictivité globaux dans chaque secteur et chaque pays, en fonction des réglementations dans chacun de ces trois domaines : prise de participation, filtrage et autres restrictions. L’échelle va de 0 à 1, 0 correspondant à une ouverture totale et 1 à une fermeture totale.
Les restrictions de participation sont fortement pondérées compte tenu du fait que la participation étrangère est une condition nécessaire et essentielle de l’IDE. En cas d’interdiction de la participation étrangère, les autres types de restrictions deviennent sans objet2. Les notes attribuées au tableau A1 au titre de la participation étrangère sont construites de manière à saisir les non-linéarités dans les restrictions de participation et les relations inverses entre la part de l’investissement étranger autorisée et la restrictivité. Les pratiques de filtrage et les limites du personnel d’encadrement sont généralement moins importantes. Des non-linéarités ont également été incorporées au système de notation afin de traduire l’idée que l’interdiction totale de la participation étrangère est considérablement plus restrictive que l’autorisation d’une faible participation étrangère. La restrictivité est calculée au niveau de la branche, puis une moyenne pondérée est obtenue en fonction du coefficient de pondération de l’IDE et des échanges (voir tableau A2.) Le même ensemble de pondérations sectorielles est utilisé pour tous les pays. Même s’il se peut que ces pondérations ne reflètent pas exactement la composition de l’IDE ou de la production dans certains pays, un ensemble uniforme de coefficients de pondération fournit une base commune pour la comparaison des notes globales des différents pays. Les restrictions moyennes des pays de l’OCDE et des pays hors OCDE sont de simples moyennes des notes des différents pays.
On a vu précédemment que l’accent est mis sur les écarts par rapport au traitement national plutôt que sur les obstacles réglementaires à l’accès au marché tant pour les entreprises nationales que pour les entreprises étrangères. Font exception à cette règle les cas de participation de l’État, et notamment les monopoles ou les quasi-monopoles publics, étant donné que les monopoles publics équivalent en réalité à une interdiction de fait de l’IDE. Les secteurs réservées à l’État sont notés comme si la propriété étrangère était interdite.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 177
Lorsqu’il a été établi que la participation de l’État dépasse 50 % dans des secteurs clés comme les télécommunications, l’électricité et les transports, une restriction partielle de la participation a été comptabilisée3.
En cas de dérogation aux restrictions visant les investissements intra-européens, la restriction a été pondérée par le coefficient 0.44, du fait qu’en 1998, 56 % des entrées d’IDE dans les pays européens provenaient d’autres pays européens (bien que la part de l’IDE intra-européen ne soit pas la même pour tous les pays européens), ce qui est susceptible d’amplifier l’effet de la dérogation au point que celle-ci augmente de façon endogène la part des IDE intra-européens.
La méthodologie utilisée pour calculer ce nouvel indice diffère légèrement de celle qui a été retenue dans l’étude précédente. Les obligations déclaratives ex post concernant les investissements étrangers imposées à des fins statistiques et poursuivant des objectifs généralement admis ne sont plus considérées comme des restrictions réglementaires. Enfin, le poids accordé à la participation partielle de l’État a été abaissé.
Les sources d’information diffèrent également de celles qui ont été utilisées dans l’étude précédente. Plus particulièrement, les rapports de la Commission européenne, du US Trade Representative et du Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie du Japon sur la pratique d’autres pays et les rapports d’entreprises de consultants privées n’ont pas été utilisés et la position des pays à l’égard des instruments de l’OCDE sur l’investissement a été prise en compte de manière plus systématique. La modification des sources utilisées a considérablement affecté la position du Japon, des États-Unis et de la Corée, en particulier.
Les dossiers des pays sont disponibles sur le site web de l’OCDE(www.oecd.org/eco/pmr).
178 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Tableau 6.A1.1. Coefficients concernant les restrictions à l’IDE (maximum : 1.0)
Notes
Limitation de la participation étrangère directe
Aucune participation étrangère autorisée 1Participation étrangère de 1 à 19 % autorisée 0.6 Participation étrangère de 20 à 34 % autorisée 0.4 Participation étrangère de 35 à 49 % autorisée 0.3 Participation étrangère de 50 à 74 % autorisée 0.2 Participation étrangère de 75 à 99 % autorisée 0.1
Filtrage et agrément
L’investisseur doit démontrer l’existence d’avantages économiques
0.2
Agrément accordé sauf si l’investissement est contraire à l’intérêt national
0.1
Notification 0.05
Autres restrictions
Membres du conseil d’administration/dirigeants majorité de nationaux ou de résidents 0.1 au moins un national ou un résident 0.05 ils doivent détenir un agrément au niveau local 0.025
Circulation des personnes pas d’entrée 0.1 moins d’un an 0.075 de un à deux ans 0.05 de trois à quatre ans 0.025
Restrictions concernant les intrants et l’exploitation Le contenu national doit être supérieur à 50 % 0.1 Autres restrictions 0.05
Total* Entre 0 et 1
* Si la participation étrangère est interdite, les autres critères deviennent sans objet, si bien que l’indice est de 1.0. Il est possible que le total de certaines notes soit légèrement supérieur à 1.0 même si la participation étrangère n’est pas interdite. Le cas échéant, l’indice est plafonné à 1.0.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 179
Tableau 6.A1.2. Coefficients par secteur
Secteurs Coefficients d’IDE et des échanges
Entreprises 0.192 Télécommunications 0.041 Construction 0.021 Distribution 0.094 Services financiers 0.163 Tourisme 0.004 Transports 0.164 Électricité 0.019 Secteur manufacturier 0.302
Total 1.000
Note : l’utilisation de coefficients d’IDE accentue les effets d’endogénéité : les secteurs très affectés par des restrictions peuvent enregistrer moins d’entrées d’IDE et se voir donc attribuer un coefficient plus faible. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé une moyenne des coefficients de l’IDE et des échanges pour le secteur des services. L’agrégation des restrictions sectorielles affectant l’IDE au moyen de coefficients de l’IDE au lieu de coefficients de valeur ajoutée tend à abaisser légèrement les niveaux de restrictivité dans la plupart des pays.
Source : Golub, 2003
Notes
1. Pour plus de détails et un examen de cette question, voir Golub (2003) et Hardin et Holmes (1997, 2002).
2. L’indice est plafonné à 1. Comme on peut le déduire au vu du tableau A1, il est possible que le total des notes des différentes composantes de la restrictivité soit supérieur à 1 même si la participation étrangère n’est pas interdite, si le chiffre n’est pas arrondi.
3. Les données sur la participation de l’État sont limitées dans la plupart des secteurs. En ce qui concerne d’autres secteurs, notamment le transport aérien, les télécommunications et surtout l’électricité, où les données sur la participation de l’État sont plus nombreuses, la restrictivité a été calculée comme suit :
Part de la participation de l’État noteMonopole d’État 1.0 Privatisation en cours 0.6 90 % ou plus 0.4 75 à 90 % 0.2 Actionnaire majoritaire 0.1
Ces notes prennent en compte le fait que la participation partielle de l’État en soi n’est pas nécessairement une entrave à la croissance de l’investissement étranger, alors que le monopole d’État est par nature un frein à l’investissement étranger.
180 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
ANNEXE 6.A2
RESTRICTIVITÉ EN MATIÈRE D’IDE DANS LE SECTEUR DES PÊCHERIES DES PAYS DE L’OCDE
La Division des politiques des pêcheries de l’OCDE, à la Direction des échanges et de l’agriculture, a calculé l’indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE dans les sous-secteurs de la capture et de la transformation des produits de la mer des pays de l’OCDE. Les coefficients de pondération ont été ajustés pour prendre en compte le cadre réglementaire spécifique de la pêche, notamment en ce qui concerne les autres restrictions de l’exploitation (voir tableau 6.A2.1.)
Les résultats obtenus montrent que le sous-secteur de la capture est beaucoup plus restrictif que celui de la transformation, qui est considéré comme faisant partie du secteur manufacturier (voir graphiques 6.A2.1 et 6.A2.2.) Dans tous les pays de l’OCDE, la restrictivité moyenne du sous-secteur de la capture proprement dite est de 0.6, tandis que celle de la transformation est de 0.1. Un niveau relativement élevé de restrictivité de l’IDE dans le sous-secteur de la capture témoigne des préoccupations que suscitent de manière générale les questions de souveraineté et de sécurité alimentaire ainsi que les difficultés potentielles de contrôle et de mise en œuvre de la réglementation nationale dans ce domaine.
Tableau 6.A2.1. Coefficients de pondération de la restrictivité en matière d’IDE dans le secteur de la pêche
Type de restriction Critères Coefficient
Restrictions à la participation étrangère
Aucune participation étrangère autorisée 1.0
Participation étrangère de 1 à 19 % autorisée 0.6 Participation étrangère de 20 à 34 % autorisée 0.4
Participation étrangère de 35 à 49 % autorisée 0.3 Participation étrangère de 50 à 74 % autorisée 0.2
Participation étrangère de 75 à 99 % autorisée 0.1 Aucune restriction 0
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 181
Participation restreinte aux ressortissants l’UE 0.3 Filtrage et agrément L’investisseur doit démontrer l’existence
d’avantages économiques 0.2
Agrément accordé sauf si l’investissement est contraire à l’intérêt national
0.1
Notification – a priori ou a posteriori 0.05 Autres restrictions Lien économique réel 0.4
Restrictions concernant les licences et quotas 0.2 Siège social de la société établi dans le pays
d’accueil 0.1
Restrictions concernant l’équipage 0.1 Restrictions dans le secteur de la transformation
Conditions à l’acquisition de licences 0.2
Source : OCDE 2006c
Graphique 6.A2.1. Restrictions à l’IDE dans le sous-secteur de la capture de la zone OCDE, par type
(0 = degré le moins restrictif ; 1 = degré le plus restrictif)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turke
y
Spain
Finlan
d
Nethe
rland
s
Belgiu
m
Ireland
Mex
ico
Austra
lia
Ger
man
y
Poland
Japa
n
Korea
OECD
UnitedKin
gdom
Gre
ece
Italy
United Sta
tes
New Z
ealand
Canad
a
Portuga
l
Sweden
Franc
e
Denmar
k
Icela
nd
Norway
Equity Screening and approval Other restrictions
Source : OCDE 2006c
Traduction des légendes
Turquie Espagne Finlande Pays-Bas Belgique Irlande Mexique Australie Allemagne Pologne Japon Corée OCDE Royaume-Uni Grèce Italie États-Unis Nouvelle-Zélande Canada Portugal Suède France Danemark Islande Norvège
Participation Filtrage et agrément Autres restrictions
182 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Graphique 6.A2.2. Restrictions à l’IDE dans le sous-secteur de la transformation de la zone OCDE (0= degré le moins restrictif ; 1= degré le plus restrictif)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turkey
Spain
Finlan
d
Nethe
rland
s
Belgium
Ireland
Mex
ico
Australia
German
y
Poland
Japa
n
Korea
OEC
D
UnitedKi
ngdo
m
Greec
eIta
ly
UnitedSt
ates
NewZe
alan
d
Can
ada
Portu
gal
Swed
en
Fran
ce
Denmark
Icelan
d
Norway
Source : OCDE 2006c
Traduction des légendes
Turquie Espagne Finlande Pays-Bas Belgique Irlande Mexique Australie Allemagne Pologne Japon Corée OCDE Royaume-Uni Grèce Italie États-Unis Nouvelle-Zélande Canada Portugal Suède France Danemark Islande Norvège
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 183
PARTIE II.
LE NOUVEAU CADRE DE L’INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL
La mondialisation transforme le cadre dans lequel se déploie l’IDI. La nouvelle technologie, l’apparition de pratiques d’investissement plus ouvertes et transparentes, de même que la place plus importante dévolue aux marchés en tant que dispositifs d’affectation des ressources, contribuent à faire avancer la mondialisation de la production par le biais de l’investissement international. D’une part, le passage à une économie fondée sur le savoir et la technologie qui s’opère actuellement a mis au premier plan les problèmes liés aux modes de création, d’acquisition et de diffusion des connaissances, et à leurs incidences sur la performance économique des pays, et suscite des préoccupations concernant la protection des « actifs stratégiques ». L’investissement international a pris une plus grande importance étant donné qu’il est l’un des principaux vecteurs d’acquisition et de diffusion du savoir-faire en matière de technologie et de gestion.
Ces évolutions nouvelles constituent d’autre part un moteur de l’internationalisation des PME. En outre, à l’heure où, dans une économie mondiale en expansion, les grandes entreprises externalisent certaines parties de leur chaîne logistique, les PME voient s’accroître leurs perspectives d’internationalisation par le biais de l’investissement direct ou d’accords de coopération transnationale sous forme de coentreprises. On dispose toutefois de données limitées sur le phénomène de l’internationalisation des PME par le biais de l’investissement.
La présente partie contient les rapports suivants :
Chapitre 7. Actifs intellectuels et investissement international
Chapitre 8. Investissement international et PME : bilan des travaux
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 185
PARTIE II.
Chapitre 7.
ACTIFS INTELLECTUELS ET INVESTISSEMENT INTERNATIONAL : SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS*
Le passage à une économie fondée sur le savoir et la technologie qui s’opère actuellement a mis au premier plan les problèmes liés aux modes de création, d’acquisition et de diffusion des connaissances, et à leurs incidences sur la performance économique des pays, et suscite des préoccupations concernant la protection des « actifs stratégiques ». L’investissement international a pris une plus grande importance étant donné qu’il est l’un des principaux vecteurs d’acquisition et de diffusion du savoir-faire en matière de techonologie et de gestion.
Les activités de R-D des filiales étrangères des entreprises commerciales visent principalement à adapter les produits et technologies mis au point dans le pays d’origine de la société-mère aux conditions du marché local (« exploitation de la R-D réalisée dans le pays d’origine ou R-D d’adaptation »). De fait, l’un des rôles classiques de l’IDE consiste à servir de vecteur de l’exploitation d’actifs intellectuels élaborés dans le pays d’origine des entreprises multinationales (EMN). La R-D à l’étranger joue un autre rôle, qui gagne en importance, et qui consiste à élaborer de nouvelles technologies à l’étranger et favoriser l’acquisition de technologie dans les pays d’accueil (« amélioration de la R-D réalisée dans le pays d’origine ou « R-D d’innovation »). Dans ce cas, la R-D menée par la filiale a pour but de profiter de l’accès, dans le pays d’accueil, aux ressources de R-D et aux avancées techniques et scientifiques des universités, de leurs principaux concurrents et de leurs fournisseurs.
* Le présent article s’inspire d’un rapport rédigé par René Belderbos et Léo Sleuwaegen, de l’Université catholique de Louvain, consultants externes auprès de la Division de l’investissement de l’OCDE.
186 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
L’investissement dans la R-D s’internationalise de plus en plus
La comparaison internationale et chronologique de la R-D pose, on le sait, des difficultés dues au fait que les informations disponibles proviennent d’indicateurs indirects, comme les montants consacrés à la R-D, le nombre de brevets et celui des partenariats de R-D. L’analyse des données sur les dépenses de R-D et les brevets permet néanmoins de formuler un certain nombre d’observations :
• Au cours des deux dernières décennies, l’internationalisation de la R-D a progressé, bien qu’à un rythme relativement lent. Les EMN externalisent maintenant davantage leurs activités de R-D et pour ce faire, ont en partie recours à des entreprises étrangères. Les grandes entreprises implantent davantage de filiales à l’étranger dans le but de mener localement des activités de R-D. Les choix d’implantation les plus courants se portent sur les pays possédant des universités dont l’excellence est reconnue ou dans lesquels il est possible de recruter des ingénieurs ou des scientifiques à un coût relativement faible, par exemple l’Inde et la Chine.
• Les secteurs de haute technologie sont ceux qui ont le plus internationalisé leurs activités de R-D. Dans certains de ces secteurs, jusqu’à 30 % de la R-D est menée hors du pays d’origine de l’entreprise. Il subsiste toutefois d’importantes différences d’un pays à l’autre. Les entreprises dont le siège est aux États-Unis sont les plus internationalisées à cet égard, suivies des entreprises de l’Union européenne et du Japon.
• Les pays d’accueil dans lesquels les entreprises sous contrôle étranger réalisent la plus grande part de la R-D sont en général de petites économies où le niveau d’instruction est relativement élevé, comme l’Irlande, la Belgique, la République tchèque et Singapour.
• L’implantation des activités de R-D se diversifie et englobe maintenant des économies en transition. La Chine, l’Inde, Singapour, la Corée et le Brésil ont gagné du terrain, mais partaient de très loin. L’implantation n’y est pas encore importante en termes économiques, mais des enquêtes réalisées auprès des entreprises indiquent qu’elle pourrait le devenir dans un proche avenir. La R-D internationale demeure cependant dominée par les entreprises ayant leur siège dans les grandes économies -- États-Unis, Japon et Union européenne.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 187
• Il apparaît que dans le cadre de leurs politiques plus dynamiques d’investissement à l’étranger, les entreprises multinationales ayant leur siège dans certaines économies émergentes d’Asie méridionale et orientale internationalisent leurs activités de R-D. C’est en partie la faiblesse des bassins de compétences de leur pays d’origine qui incite ces entreprises à acquérir le savoir-faire des économies développées.
• La coopération internationale, plutôt que les prises de contrôle motivées par la R-D, est le modèle qu’ont choisi de nombreuses entreprises à forte intensité de recherche. Au cours de la dernière décennie, la part des innovations – établie d’après le nombre de brevets – auxquelles ont pris part des collaborateurs étrangers a quasiment doublé.
Plusieurs facteurs expliquent cette internationalisation
Un certain nombre d’évolutions concurrentielles, internationales et technologiques expliquent l’importance grandissante des investissements internationaux de R-D. Les facteurs de changement sont notamment les suivants :
• Dans une large mesure, les investissements de R-D à l’étranger s’inscrivent dans la tendance à la création de chaînes logistiques dans le secteur manufacturier et celui des services par le biais de l’IDE, du fait que la R-D est nécessaire pour soutenir les activités de fabrication et de commercialisation menées localement par les EMN. L’accroissement de l’intensité de l’IDE traduit à son tour la croissance des marchés et la libéralisation de l’investissement et des échanges dans les pays hors triade comme la Chine, l’Inde et le Brésil. (La triade s’entend ici des États-Unis, du Japon et des pays de l’Union européenne.)
• Même si les processus de R-D se caractérisent par des économies d’échelle et de gamme, qui favorisent la centralisation des activités, les progrès de la codification et de la normalisation permettent mieux de segmenter les activités de R-D et d’en répartir géographiquement les étapes. Les innovations réalisées dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC) ont facilité encore la gestion d’activités décentralisées de R-D.
• Dans certains secteurs de haute technologie, l’interdépendance croissante des progrès scientifiques et de l’innovation technologique a entraîné un relâchement des liens qui unissaient jusque-là le secteur manufacturier et la R-D, de sorte que les laboratoires peuvent dorénavant être implantés dans des lieux distincts des sites de
188 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
fabrication, ce qui apporte une plus grande liberté. À cet égard, la R-D s’inscrit dans une tendance plus générale à l’externalisation et à la délocalisation des services.
• L’augmentation des coûts des investissements de R-D, en particulier dans les secteurs appuyés sur la science, de même que l’intensification de la concurrence mondiale dont l’innovation fait l’objet, ont nécessité la mise en œuvre de moyens destinés à réduire les coûts de R-D tout en accélérant le processus de développement. Cela a conduit les entreprises à s’en remettre davantage à des sources externes d’innovation, en utilisant un éventail de dispositifs très poussés : alliances stratégiques, fusions et acquisitions, capital-risque et externalisation de la R-D. Les investissements étrangers de R-D destinés à créer de nouvelles technologies font partie des solutions qui s’offrent étant donné que les entreprises ont besoin d’avoir accès à des centres d’excellence dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique ainsi qu’à des groupes de scientifiques et d’ingénieurs de talent, à moindre coût.
• Ces évolutions ont été facilitées par des amendements législatifs et des avancées technologiques. Par exemple, dans de nombreuses économies, le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle a diminué le risque associé à la relocalisation d’activités de R-D sensibles qui pesait sur les entreprises. De même, la codification accrue des processus de R-D par le biais des chaînes logistiques des entreprises et de l’amélioration des technologies des communications ont permis d’augmenter la segmentation et la dispersion géographique de la R-D.
Les débouchés qui s’offrent aux entreprises et aux pays d’accueil
Les investissements internationaux de R-D peuvent représenter une solution doublement gagnante pour la société-mère et sa filiale à l’étranger. En général, la R-D d’innovation menée dans les filiales à l’étranger est considérée comme un moyen efficace d’acquisition de technologie qui stimule la rentabilité des entreprises. De leur côté, les filiales locales profitent de l’acquisition de technologie (bien que ce soit principalement par le biais de la R-D d’adaptation), ce qui stimule leur productivité et leur compétitivité. L’utilisation de plus en plus courante de sites de R-D dispersés géographiquement est complexe et onéreuse. Cette pratique engendre également des difficultés nouvelles du point de vue du gouvernement d’entreprise, notamment en ce qui concerne les incitations offertes aux employés et la comparaison du rendement dans un cadre transculturel. Il semble pourtant que les entreprises multinationales aient surmonté ces difficultés. Il n’est pas encore établi que la R-D centralisée soit plus efficace que les structures décentralisées en plusieurs pôles.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 189
Du point de vue des pays d’accueil, les activités de R-D internationale réalisées par les filiales d’entreprises étrangères améliorent en général l’impact positif de l’IDE sur l’économie nationale. Cet impact n’est toutefois pas automatique. Pour bénéficier des retombées positives de la R-D internationale, l’économie d’accueil doit posséder une « capacité d’absorption » suffisante. En particulier, s’il existe un trop grand décalage entre la complexité des technologies utilisées par les entreprises multinationales et le niveau de développement du pays d’accueil, il se peut que seule l’entreprise bénéficie des avantages des activités de R-D de la filiale.
La conclusion à tirer pour l’action des pouvoirs publics est qu’une stratégie mise en œuvre pour attirer l’investissement de haute technologie ne pourra produire des avantages significatifs que si elle est conjuguée à des efforts visant à assurer un niveau élevé d’instruction et de formation scientifique. Les mesures destinées à assurer la mobilité internationale du personnel de R-D au niveau des entreprises considérées individuellement ou à un niveau plus général peuvent se révéler utiles à cet égard. On peut craindre par ailleurs que les acquisitions d’entreprises ayant des activités de R-D importantes et géographiquement diversifiées entraînent une concentration de la R-D dans un nombre restreint de lieux, ce qui pourrait créer une source de pression en faveur d’une politique d’investissement protectionniste.
Enfin, il existe un risque que certains pays et régions surestiment la valeur associée à l’accueil de centres de R-D d’entreprises et rivalisent pour attirer ce type d’activités en offrant des incitations, par exemple des allégements fiscaux et des aides directes. Ces subventions peuvent coûter cher en deniers publics et fausser les mécanismes du marché. Enfin, on constate qu’elles ne parviennent pas toujours, au bout du compte, à influencer les choix d’implantation des entreprises.
190 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
ACTIFS INTELLECTUELS ET INVESTISSEMENT INTERNATIONAL : TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX
Le passage à une économie fondée sur le savoir et la technologie qui s’opère actuellement a mis au premier plan les problèmes liés aux modes de création, d’acquisition et de diffusion des connaissances, et à leurs incidences sur la performance économique des pays, et suscite des préoccupations concernant la protection des « actifs stratégiques ». L’investissement international a pris une plus grande importance étant donné qu’il est l’un des principaux vecteurs d’acquisition et de diffusion du savoir-faire en matière de techonologie et de gestion.
La meilleure compréhension du rôle joué par les actifs intellectuels dans la création de valeur, la croissance et la performance économique figure parmi les thèmes abordés à l’occasion de la Réunion ministérielle de l’OCDE de 2006. Le rapport de synthèse met en lumière l’importance de plus en plus grande des actifs intellectuels pour les entreprises et pour l’ensemble de l’économie et en tire les conséquences pour les pouvoirs publics (OCDE, 2006a). Il effectue une analyse essentiellement macroéconomique et n’aborde pas les liens entre actifs intellectuels et investissement international.
Le présent article vise à combler cette lacune en examinant le rôle tenu par l’investissement international dans la création et la diffusion des actifs intellectuels. La première section dresse l’inventaire des données disponibles qui permettent de dégager des faits stylisés concernant le rôle des actifs intellectuels dans l’IDE et les activités des EMN. À partir de cette synthèse, la deuxième section examine les principaux facteurs qui ont conduit les EMN à décentraliser leurs activités de R-D à l’étranger au cours des récentes décennies. La troisième section indique les enseignements à tirer quant aux effets probables de ces évolutions sur les pays et les entreprises.
1. Internationalisation de la R-D des entreprises multinationales : tour d’horizon des données
Les statistiques présentées dans cette section portent sur le rôle des actifs intellectuels dans l’investissement direct étranger. Nous examinons les intérêts détenus au niveau international par les entreprises multinationales dans des
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 191
actifs intellectuels. Bien que ces actifs puissent être associés aux compétences, aux connaissances générales et aux ressources en matière d’organisation et de gestion, ils consistent principalement en actifs technologiques dérivés des activités de R-D, exprimées en fonction des dépenses de R-D ou des demandes de brevets.
La R-D formelle constitue souvent une étape importante du processus de construction d’actifs intellectuels, qui débute par le développement des compétences et des ressources organisationnelles nécessaires pour permettre d’améliorer les produits et les processus. Elle nécessite un personnel hautement compétent, et l’édification de bases de savoir technologique efficaces requiert de solides capacités d’organisation et de gestion. La R-D formelle n’est pas une condition préalable à l’innovation mais constitue néanmoins, avec l’octroi de brevets, le meilleur indicateur dont on dispose pour se faire une idée des actifs intellectuels fondés sur la technologie.
Étant donné qu’un certain nombre de tendances de la R-D internationale, par exemple l’importance de plus en plus grande de la R-D en Inde et en Chine, ne se sont manifestées que récemment, nous nous sommes efforcés ici d’utiliser les données les plus à jour possible. Cependant, la plupart des données statistiques ne sont disponibles qu’au bout de plusieurs années, et cela complique l’analyse systématique des tendances des trois dernières années. En outre, à l’exception en partie des statistiques de la base de données des activités filiales étrangères (AFA) de l’OCDE, il n’existe pas de statistiques comparatives sur les dépenses de R-D d’entreprises multinationales provenant de différents pays. La plupart des autres données présentées ici sont fondées sur les enquêtes annuelles des administrations (États-Unis, Japon), les enquêtes réalisées par la CNUCED et des enquêtes distinctes citées dans différents travaux.
La comparaison des entreprises multinationales d’origines diverses indique qu’il existe des différences marquées entre les grandes entreprises multinationales ayant leur siège dans des petites économies (principalement dans les pays de l’UE) et celles qui proviennent de grandes économies (Japon et États-Unis). Les premières affichent un degré élevé d’internationalisation, qui s’explique par la petite taille de leur marché national et la forte ouverture internationale de leurs activités de commercialisation et de fabrication. Les activités de R-D à l’étranger sont cependant concentrées en partie dans la zone européenne. Pour ajouter un élément de comparaison entre les entreprises des pays de l’UE, des États-Unis et du Japon, le présent article donne également les ratios des activités de R-D menées à l’étranger, qui, pour les pays de l’UE, s’entendent des activités de R-D menées hors Europe.
192 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
1.1. Dépenses de R-D d’entités sous contrôle étranger
La base de données AFA de l’OCDE est établie à partir d’un ensemble d’enquêtes nationales auprès de filiales sous contrôle étranger et de filiales étrangères, notamment les enquêtes du US Bureau of Economic Analysis (BEA) et du ministère de l’Économie, du commerce et de l’industrie du Japon (METI), afin d’évaluer les chiffres comparables concernant les activités de R-D à l’étranger de différents pays. Les données les plus récentes concernent un petit nombre de pays seulement (graphique 7.1). Pendant la période 1995-2003, la croissance de la R-D effectuée à l’étranger a été plus rapide que celle de la R-D nationale, de sorte que la proportion entre les deux catégories s’est élevée pour tous les pays. La Suisse fait exception à la règle mais possède également le ratio d’internationalisation le plus élevé : le volume de R-D menée à l’étranger par ses entreprises multinationales a dépassé celui de la R-D réalisée à l’échelle nationale. Le ratios des activités de R-D menées à l’étranger est également élevé dans un certain nombre d’autres pays d’Europe (Allemagne, Finlande, Suède) où il se situe entre 20 et 30 %. Par comparaison, les ratios de l’Italie et du Japon sont faibles puisqu’ils ne dépassent pas 5 %.
Graphique 7.1. Dépenses de R-D à l’étranger de certains pays de l’OCDE, 1995 et 2003 (Pourcentage de la R-D nationale de certains pays)
0
20
40
60
80
100
120
Switzerland (1) Germany Sweden Finland (2) Belgium United States Japan (3) Italy
%
1995 2003
Source : OCDE (2006b).
Traduction des légendes
Suisse (1) Allemagne Suède Finlande (2) Belgique États-Unis Japon Italie
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 193
La base de données AFA semble également indiquer qu’entre 1995 et 2003, les dépenses de R-D dans des filiales sous contrôle étranger ont plus que doublé en termes de parités de pouvoir d’achat dans certains pays de l’OCDE. La plus grande part des activités de R-D effectuées à l’étranger revient aux États-Unis, suivis de l’Allemagne et du Royaume-Uni. L’importance de plus en plus grande prise par les multinationales étrangères leur a conféré un rôle dominant dans les dépenses de R-D d’un certain nombre de petits pays d’Europe. La figure 2 montre que la part de la R-D contrôlée par des entreprises multinationales étrangères dans la R-D nationale a grimpé à plus de 40 % en Irlande, en Belgique, en Hongrie, en République tchèque et en Suède. Parmi les grands pays d’Europe, le Royaume-Uni détient la part la plus élevée de R-D sous contrôle étranger (41 %).
Graphique 7.2. Part de la R-D sous contrôle étranger dans la R-D totale par pays, 1995 et 2003
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Japa
n
Greec
e
Turkey
Poland
Finlan
d
UnitedStates
Slov
ak R
epub
lic
Fran
ce
Portu
gal
Spain
German
yIta
ly
Netherland
s
Cana
da
Australia
Unite
d King
dom
Swed
en
Czec
h Re
public
Hunga
ry
Belgium
Ireland
% 1995 2003
Source : OCDE (2006b)
Traduction des légendes Japon Grèce Turquie Pologne Finlande États-Unis République slovaque France Portugal Espagne Allemagne Italie Pays-Bas Canada Australie Royaume-Uni Suède République tchèque Hongrie Belgique Irlande
Les données de sources variées sur les projets d’IDE portant sur des installations nouvelles et comportant des activités de R-D apportent certaines indications sur ce qui a pu se produire depuis 2003. L’enquête de la CNUCED (2005, p. 132) cite des données fondées sur les résultats fournis par Locomonitor. En 2002-2004, sur les 1 773 projets d’IDE répertoriés dont la composante R-D constituait une fonction stratégique de l’entreprise, au moins 1 095 ont été conduits en Europe orientale et en Asie, l’Inde et la Chine étant les deux principaux pays destinataires. D’après les statistiques officielles sur la Chine, quelque 750 centres de R-D étrangers s’étaient établis en Chine fin 2004,
194 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
la plupart après 2001 ; il a été estimé qu’à la fin de 2004, plus de 100 multinationales avaient implanté des centres de R-D en Inde (CNUCED, 2005). D’autres enquêtes récentes menées auprès d’EMN interrogées sur leurs projets d’investissement de R-D indiquent plus clairement encore que la Chine, l’Inde, Singapour et le Brésil figurent parmi les dix principaux choix d’implantation des activités de R-D, après les États-Unis et le Royaume-Uni (graphique 3).
Graphique 7.3. Implantation de nouvelles installations de R-D
(En pourcentage des entreprises interrogées ayant des projets d’investissement de R-D)
0
10
20
30
40
50
60
70
China
United
Sta
tes India
Japa
n
United
King
dom
Russia
n Fed
erat
ion
Franc
e
Germ
any
Nether
lands
Canad
a
Singap
ore
Chines
e Taipei
Belgium Ita
ly
Mala
ysia
Korea
Thaila
nd
Austra
liaBra
zil
Czech
repu
blic
Irelan
dIsr
ael
Mexico
Moroc
co
Norway
Poland
Roman
ia
OECD non-OECD economy
%
Sources : CNUCED (2005) ; OCDE (2006b).
Traduction des légendes Chine États-Unis Inde Japon Royaume-Uni Fédération de Russie France Allemagne Pays-Bas Canada Singapour Taipei chinois Belgique Italie Malaisie Corée Thaïlande Australie Brésil République tchèque Irlande Israël Mexique Maroc Norvège Pologne Roumanie
Même si, comme on pouvait le prévoir, les entreprises multinationales à l’origine de l’IDE lié à la R-D sont généralement implantées dans des pays développés, 10 % des projets d’IDE ont été signalés par des entreprises provenant d’économies moins développées, soit principalement la Chine, l’Inde, le Brésil, la Corée, Taïwan et Singapour (CNUCED, 2005, p. 132). Cela porte à croire que les statistiques disponibles ne captent pas nécessairement une tendance très récente de la R-D conduite à l’étranger par des multinationales implantées hors des pays de la triade. Un certain nombre d’entreprises indiennes du secteur des technologies de l’information sont apparemment engagées dans
OCDE économies hors OCDE
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 195
des activités de R-D à l’étranger (CNUCED, 2005, p. 150) mais ce sont surtout les entreprises chinoises qui font une place importante à cette activité. En effet, selon une enquête récente, 37 laboratoires de R-D chinois sur 77 sont implantés à l’étranger (Von Zedtwitz, 2005). En ce qui concerne l’importance des dépenses de R-D à l’échelle mondiale, seules quelques-unes de ces multinationales ne provenant pas de pays de la triade figurent aujourd’hui en tête du classement, la société Samsung étant la principale exception.
États-Unis
Les enquêtes comparatives sur l’investissement direct étranger conduites par le BEA sont la source de statistiques systématiques sur la R-D la plus complète qui soit. Ces enquêtes à caractère obligatoire réalisées annuellement font l’inventaire des dépenses de R-D des filiales dans lesquelles les entreprises multinationales américaines détiennent une participation majoritaire. Le tableau 7.1 montre que ces dépenses de R-D à l’étranger ont connu une progression annuelle, quoique modeste, et atteint 22.3 milliards USD en 2003. Elles représentent 13.7 % des dépenses totales de R-D des entreprises multinationales interrogées, en hausse comparativement à 11.5 % en 1994 et à 13.3 % en 2002.
Tableau 7.1. Dépenses de R-D à l’étranger des entreprises américaines
(en millions USD)
1994 2002 2003
Dépenses à l’étranger 11 877 21 151 22 328
Dépenses nationales 92 574 137 968 140 103 Total 103 451 159 119 162 431 % des dépenses à l’étranger 11.5 13.3 13.7 Source : Sources : CNUCED (2005) ; Mataloni et Yorgason (2006) ; BEA (2006).
D’après une étude réalisée par le Secrétariat de l’OCDE à partir des données du BEA, l’importance des activités de R-D à l’étranger par rapport à celles qui sont menées à l’échelle nationale n’est généralement pas supérieure dans les secteurs de haute technologie appuyés sur la science comme les produits chimiques et pharmaceutiques et l’électronique (Belderbos et Sleuwaegen, 2007). Les entreprises engagées dans ces secteurs ont effectué à l’étranger environ 12 % de leurs dépenses de R-D. Les pourcentages les plus élevés (qui se situent autour de 20 %) ont été atteints dans les secteurs des machines électriques, de l’équipement de transport et des aliments et boissons, dans lesquels des efforts de R-D d’adaptation sont en général requis pour desservir les marchés locaux. Le tableau montre également que près des trois quarts des dépenses de R-D sont effectuées en Europe, les principaux pays
196 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
d’accueil étant le Royaume-Uni et l’Allemagne. Le niveau des dépenses de R-D faites au Japon est sensiblement le même qu’en France.
Japon
Au Japon, le METI recueille annuellement des données sur la R-D à l’étranger. Celles-ci figurent dans les enquêtes sur l’investissement japonais à l’étranger (par exemple, METI, 2006)1. Selon l’enquête de 1997, les dépenses de R-D à l’étranger s’élevaient à 279 milliards JPY. Elles ont ensuite fortement augmenté pour atteindre 778 milliards JPY en 2004 (tableau 7.2). Toujours en 2004, ces dépenses ont représenté 7.8 % de la R-D exécutée au Japon, contre 4 % en 1997. Selon les données du METI, la R-D menée à l’étranger est concentrée dans l’automobile (plus de 60 %), loin devant les produits chimiques et pharmaceutiques. En ce qui concerne la répartition des dépenses de R-D entre les différents pays, les États-Unis arrivent au premier rang, suivis de l’Europe, mais une part substantielle (22 %) de la R-D à l’étranger est également menée en Asie.
Tableau 7.2. Dépenses de R-D à l’étranger des multinationales japonaises par secteur et par région, 2004
R-D (en millions JPY)
% à l’étranger
Répartition par région (%)
Tous secteurs 7 758 Etats-Unis 46 Hors secteur manufacturier 226 Europe 28 Secteur manufacturier 7 558 7.8 Asie 22 Alimentation 17 0.7 Dont Chine 3 Produits chimiques et pharmaceutiques 1 627 9.6 Pétrole 27 10.3 Métaux 11 1Machines 121 1.3 Équipement électronique 128 1.6 Équipement des TIC 195 0.9 Matériel de transport 5 353 19.7 Instruments de précision 28 1.6 Source : METI (2006).
Autres pays
Les autres enquêtes réalisées à partir d’échantillons plus petits d’entreprises attribuent généralement un rôle plus important à la R-D à l’étranger. Des données détaillées sur les multinationales suédoises indiquent que dans leur cas, la part de la R-D à l’étranger a grimpé à 43 % en 2003, contre 22 % en 1995. Cette progression rapide est en partie due aux activités de fusions et d’acquisitions des entreprises suédoises. À l’occasion d’enquêtes réalisées
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 197
dans les années 90 sur les activités de R-D à l’étranger des entreprises allemandes, qui n’étaient auparavant pas à l’avant-garde en matière d’internationalisation, Ambos constate une augmentation rapide des dépenses de R-D à l’étranger, le nombre de nouveaux laboratoires de R-D ayant doublé. Dans son enquête auprès de 290 grandes entreprises multinationales des pays de la triade, Roberts (2001) observe que celles-ci ont régulièrement augmenté leurs dépenses de R-D à l’étranger, qui sont passées de 15 % de leur budget total de R-D en 1995 à 22 % en 2001. D’autres enquêtes concernant des groupes de grandes entreprises multinationales à forte intensité de R-D situent également les parts de R-D à l’étranger dans le même ordre de grandeur (par exemple, von Zedtwitz et Gassmann 2002 ; CNUCED). L’écart entre ces résultats et ceux des enquêtes officielles s’explique par le fait que la population d’entreprises multinationales interrogées dans les enquêtes officielles (METI, BEA) englobe une majorité d’entreprises essentiellement nationales ayant des activités limitées à l’étranger, tandis que les enquêtes ponctuelles s’intéressent généralement aux plus grandes entreprises multinationales.
1.2. Brevets obtenus par des entités sous contrôle étranger
Les indicateurs relatifs aux brevets proviennent des travaux statistiques sur les brevets effectués par l’OCDE (OCDE, 2006b et 2006c). L’indicateur des entreprises multinationales sous contrôle étranger correspond à la part des brevets accordés pour une invention nationale à un demandeur étranger dans le nombre total des inventions nationales, et traduit l’importance du contrôle exercé par des entreprises implantées à l’étranger sur des inventions nationales (tableau 7.3).
Les données indiquent une faible activité de R-D sous contrôle étranger dans la plupart des économies développées, comme les États-Unis et l’Allemagne. Le Japon et la Corée sont de loin les pays où l’on compte le moins d’entreprises multinationales étrangères engagées dans la R-D. Un certain nombre de petites économies européennes où est situé le siège de grandes entreprises multinationales (Finlande, Suède, Pays-Bas, Suisse) présentent également une faible activité de R-D sous contrôle étranger. Outre la Fédération de Russie, la Hongrie, la Chine et le Brésil, plusieurs petits pays développés (Luxembourg, Irlande, Belgique, Autriche) affichent les plus hauts niveaux de R-D sous contrôle étranger. Le Royaume-Uni est la seule grande économie où se retrouvent de nombreuses multinationales étrangères, ce qui s’explique en partie par le rôle qu’y tiennent de longue date les entreprises multinationales américaines.
Dans la majorité des pays, la part des brevets détenus par une entité étrangère a progressé au cours de la décennie, le total mondial étant passé de 10
198 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
à 16 %. Il existe des exceptions notables, comme l’Inde et Singapour, où le pourcentage de R-D sous contrôle étranger a enregistré un recul marqué. Certaines de ces évolutions s’expliquent peut-être également par le changement de cessionnaire des brevets demandés par les EMN : lorsque les filiales qui effectuent de la R-D localement prennent de l’expansion, elles sont parfois autorisées à déposer elles-mêmes des demandes de brevets, de sorte que le demandeur et l’inventeur résident tous deux dans le pays d’accueil et que les statistiques ne rendent plus compte de l’internationalisation. Une autre explication possible est l’augmentation du nombre d’entreprises nationales ayant des capacités de R-D.
Étude détaillée des entreprises multinationales aux États-Unis, en Europe et au Japon
Il est possible d’obtenir des indicateurs détaillés à partir de la base de données sur 184 entreprises mentionnée dans une étude récente, qui permet de prendre en compte les brevets accordés à des filiales d’EMN établies à l’étranger. Les tableaux 7.3 à 7.5 montrent la répartition des inventions brevetées sur la période 1996-2003 (les données concernant 2003 ne couvrent pas l’année entière.) Les données sur les brevets ne font pas ressortir de tendance nette à l’augmentation de la part des activités de R-D menées à l’étranger par les entreprises américaines et européennes. Selon cet indicateur, les entreprises américaines de l’échantillon mènent en moyenne 20 % de leurs activités de R-D à l’étranger. Ce pourcentage, qui semblait augmenter lentement, a néanmoins connu une nouvelle diminution en 2003. Suivent les entreprises européennes, dont le pourcentage des activités de R-D hors Europese situe autour de 15 à 18 % et celui des activités de R-D dans d’autres pays européens, autour de 22 à 24 %. Les entreprises japonaises ne réalisent pour leur part que 6 à 8 % de leur R-D à l’étranger. Les activités de R-D à l’étranger des entreprises japonaises, dont le niveau était faible au départ, sont nettement en hausse, les données de 2003 semblant indiquer que 8.3 % de la R-D est effectuée à l’étranger.
Les tableaux 7.4 à 7.6 confirment la concentration des activités de R-D des entreprises américaines en Europe et des entreprises européennes aux États-Unis, par pays d’implantation. La R-D étrangère des entreprises japonaises est répartie plus également entre les États-Unis et l’Europe. Les choix d’implantation des activités de R-D des entreprises américaines et européennes traduisent une tendance nette à l’augmentation de la part des pays asiatiques. De 1996 à 2003, la part de l’Asie dans les activités mondiales de R-D a doublé, passant de 0.4 à 0.8 % pour les entreprises américaines, et quadruplé, passant de 0.3 à 1.4 % pour les entreprises européennes. Singapour, la Chine, l’Inde et la Corée sont les principaux pays de prise de brevets d’invention. Fait étonnant,
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 199
l’Asie n’apparaît pas comme un lieu d’implantation important pour les activités de R-D des entreprises japonaises, contrairement à ce qu’évoquent les données sur les dépenses de R-D provenant des enquêtes du METI. Cela peut s’expliquer vraisemblablement par le fait que les activités de R-D des entreprises japonaises en Asie soutiennent leur forte présence dans le secteur manufacturier et se concentrent sur la R-D d’adaptation plutôt que sur les inventions brevetables. Les demandes de brevets peuvent être présentées au Japon et sur les marchés locaux mais non en Europe auprès de l’OEB.
Tableau 7.3. Détention d’inventions nationales par des intérêts étrangers1
1990-92 2000-2002
Coopération mondiale % du total Coopération mondiale % du total
Japon 1 236 3.4 2 265 3.7
Corée 40 7.8 245 4.8
Finlande 186 13.0 383 9.0
Union européenne 6 766 8.2 18 074 11.5
États-Unis 4 129 7.6 12 267 12.9
Allemagne 3 407 9.7 9716 14.2
Total mondial 19 573 10.8 53 113 16.0
Italie 862 12.4 2 256 17.8
Suède 451 14.6 1 326 19.3
Taipei chinois 52 13.1 228 19.6
Pays-Bas 875 18.6 2 341 20.0
Danemark 184 15.7 677 22.6
Suisse 998 17.9 2 250 23.5
France 1 842 12.2 5 836 24.5
Nouvelle-Zélande 41 27.9 137 25.8
Australie 285 22.6 841 26.3
Norvège 81 14.9 361 28.2
Israël 264 32.2 880 29.5
Afrique du Sud 73 27.7 131 29.6
Espagne 196 20.7 940 32.1
Inde 63 68.5 343 33.1
Canada 641 32.6 2 109 35.8
Royaume-Uni 3 107 27.8 7 258 38.3
Brésil 50 35.2 179 38.5
Autriche 501 23.8 1 660 39.1
Irlande 108 43.9 327 40.7
Belgique 872 41.5 2 081 45.0
Chine 59 49.2 726 46.5
Singapour 88 77.2 334 49.7
200 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Hongrie 52 26.8 226 54.2
Fédération de Russie 167 49.9 510 62.3
Luxembourg 53 44.2 195 63.7
Note : Les brevets sont comptés en fonction de la date de priorité, du pays de résidence de l’inventeur et de comptages simples. L’UE est traitée comme une unité à part entière ; la coopération intra-communautaire n’est pas prise en compte. 1. Part des demandes de brevets à l’OEB correspondant à des inventions détenues par des résidents étrangers sur le territoire national dans le total des inventions nationales. Source : OCDE (2006b)
Tableau 7.4. Implantation des activités de R-D d’après les indications fournies par les données sur les brevets : 60 entreprises multinationales
ayant leur siège aux États-Unis
1996 1999 2001 2003 États-Unis % du total
4365 79.5
5819 79.3
6728 77.0
5299 79.4
Europe occidentale % du total
832 15.1
1197 16.3
1635 18.7
1026 15.4
Japon % du total
157 2.9
134 1.8
117 1.3
119 1.8
Autres pays développés % du total
109 2.0
131 1.8
172 1.9
166 2.7
Asie % du total
21 0.4
44 0.6
56 0.6
56 0.8
Nombre total de brevets 5491 7340 8737 6677 Source : d’après Belderbos (2006).
Tableau 7.5. Implantation des activités de R-D d’après les indications fournies par les données sur les brevets : 63 entreprises multinationales
ayant leur siège dans les pays de l’UE
1996 1999 2001 2003 Pays d’origine % du total
5399 62.3
7955 63.1
9259 63.9
6106 60.2
Autres pays d’Europe occidentale % du total
1894
21.8
2724
21.6
2984
20.6
2271
22.4 États-Unis % du total
1097 12.7
1560 12.4
1767 12.2
1242 12.3
Japon % du total
114 1.3
97 0.8
110 0.8
81 0.8
Autres pays développés % du total
101 1.2
133 1.2
168 1.2
193 1.6
Asie % du total
30 0.3
62 0.5
91 0.6
141 1.4
Nombre total de brevets 8669 12600 14497 10136 Source : d’après Belderbos (2006).
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 201
D’autres études mentionnées par Belderbos et Sleuwaegen (2007) utilisent les mêmes données pour rendre compte de la répartition des activités de R-D à l’échelle internationale et nationale des 184 entreprises, par secteur. Dans le cas des entreprises américaines, ce sont les machines et l’équipement électrique qui suscitent le plus d’activités de R-D à l’étranger. Plus récemment (2001-2003) des secteurs comme les TIC et l’électronique ont accru leurs activités de R-D à l’étranger, tandis que les secteurs chimique et pharmaceutique ont enregistré les parts les plus faibles. L’Inde et Singapour sont, parmi les pays en développement, les choix d’implantation les plus courants pour la R-D dans le matériel informatique et les appareils de télévision et de communications.
Tableau 7.6. Implantation des activités de R-D d’après les indications fournies par les données sur les brevets : 61 entreprises multinationales
ayant leur siège au Japon
1996 1999 2001 2003 Japon % du total
6151 93.7
8114 92.6
10619 93.4
9791 91.7
États-Unis % du total
234 3.6
291 3.3
234 2.1
332 3.1
Europe occidentale % du total
162 2.5
333 3.8
473 4.2
520 4.9
Autres pays développés % du total
10 0.2
17 0.3
29 0.3
11 0.1
Asie % du total
1 0.0
50.1
70.1
90.1
Nombre total de brevets
6563 8765 11367 10677
Source : d’après Belderbos (2006).
Les activités de R-D des entreprises européennes sont de manière générale moins internationalisées que celles des américaines (s’agissant des lieux d’implantation des activités de R-D situés hors d’Europe). Les secteurs pharmaceutique et chimique représentent la plus forte proportion d’activités de R-D à l’étranger, et les États-Unis constituent le principal pays d’implantation. Les entreprises japonaises les plus internationalisées œuvrent dans le matériel de communications, les ordinateurs et les produits pharmaceutiques. Pour ce qui est de l’implantation de la R-D, les économies parvenues à maturité continuent de se tailler la part du lion. Les pays d’Asie autres que le Japon, avec pour chefs de file Singapour, l’Inde et la Chine, attirent davantage la R-D de secteurs comme l’informatique, l’équipement électrique, et la télévision et les communications.
202 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
1.3 Modes d’entrée utilisés pour accéder à la R-D à l’étranger
Un certain nombre de sources de données additionnelles fournissent des éclairages sur le mode d’entrée qu’utilisent les entreprises en matière de R-D. Les auteurs font habituellement la distinction entre les sites de R-D nouvellement établis (IDE portant sur de nouvelles installations), la R-D menée à l’étranger dans le cadre de coentreprises formées avec des entreprises locales et l’internationalisation de la R-D attribuable aux fusions et acquisitions transnationales. La présente sous-section s’intéresse aux activités de R-D autres que celles qui sont favorisées par l’investissement dans de nouvelles installations.
La R-D et les fusions et acquisitions transnationales
On ne dispose pas de données sur les fusions et acquisitions qui sont formellement ou indirectement motivées par l’accès à des ressources de R-D. Il est toutefois possible d’analyser de manière générale l’importance des fusions et acquisitions dans des secteurs considérés comme appartenant à la haute et moyenne technologie (graphique 7.4). De 2000 à 2004, les fusions et acquisitions transnationales liées à ces secteurs ont représenté 52 % de la valeur des activités de fusions et acquisitions dans le secteur manufacturier, une hausse modeste comparativement à 48 % entre 1990 et 19942. La part des opérations de fusions et acquisitions avec les États-Unis en tant que cible des industries de moyenne et haute technologie a décliné légèrement, passant de 15 à 13 %. La part de l’Europe a chuté plus fortement, passant de 23 à 17 %, ce qui indique que les entreprises européennes ont perdu de leur attrait en tant que cibles des fusions et acquisitions dans les industries de moyenne et haute technologie. Ce nombre est à mettre en relation avec l’attrait croissant exercé par les entreprises cibles des fusions et acquisitions dans les pays qui ont récemment amorcé leur développement. Les principaux pays cibles sont la Chine, y compris Hong Kong, la République de Corée, le Brésil et le Mexique (CNUCED, 2005). En Asie et en particulier en Chine, les opérations de fusions et acquisitions interviennent le plus souvent entre des pays asiatiques. Entre 2000 et 2004, le Japon, la Corée et le Taipei chinois ont été les principaux acquéreurs d’entreprises de moyenne et de haute technologie alors que les entreprises américaines et européennes enregistraient respectivement 34 et 21 % de ces opérations (Garnier, 2006).
La principale source de données systématiques sur la coopération internationale en matière de R-D, et notamment sur les coentreprises de R-D formées par des entreprises associées provenant de différents pays, est la base de données MERIT/CATI. Les statistiques publiées dans cette base de données sont valables jusqu’en 1999 seulement (Hagedoorn, 2002 ; CNUCED, 2005 ; Royakkers et Hagedoorn, 2006)3. Les données sur les alliances font état d’une forte augmentation des alliances de R-D jusqu’en 1999, et même jusqu’en 2001
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 203
(CNUCED, 2005, 126), le point culminant ayant été atteint en 2001, avec plus de 600 alliances conclues. La part du lion (90 %) revient toutefois aux alliances contractuelles et sans participation au capital, le nombre absolu d’alliances avec participation au capital ayant de fait diminué au fil des années pour s’établir à 57 en 2001.
Graphique 7.4.Fusions et acquisitions transnationales interrégionales dans les secteurs de haute et moyenne technologie
1990-94
52%
10%
23%
15%
OTHER TECH-OC TECH-EU TECH-US
2000-04
48%
22%
17%
13%
OTHER TECH-OC TECH-EU TECH-US
Notes : TECH-UE : fusions et acquisitions dans le secteur de la haute et moyenne technologie dans les pays de l’Union européenne TECH-É-U. : fusions et acquisitions dans le secteur de la haute et moyenne technologie aux États-Unis TECH-AU : fusions et acquisitions dans le secteur de la haute et moyenne technologie dans d’autres pays – principalement en Asie AU : fusions et acquisitions transnationales dans d’autres secteurs
Source : Garnier (2006)
204 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Coentreprises de R-D internationale
Les alliances technologiques conclues par des entreprises provenant de pays hors triade ont progressé plus rapidement que celles conclues par des entreprises provenant de pays de la triade. Au cours de la décennie 1991-2001, la part des entreprises provenant de pays hors triade a augmenté, passant de 4 à 14 % tandis que la domination des entreprises américaines s’estompait (elle est passée de 80 à 73 %.) Parmi les secteurs concernés, la principale évolution intervenue dans les années 90 est la réduction de la part des alliances dans les TIC et la forte augmentation de la part des alliances dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des biotechnologies. Royakkers et Hagedoorn (2006) notent que dans les années 90, les grandes entreprises pharmaceutiques ont été les principaux acteurs de l’essor des partenariats de R-D interentreprises dans le secteur. En ce qui concerne les modalités générales des alliances, la part des alliances avec participation au capital dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des biotechnologies a diminué à 20 % à la fin des années 90, et 80 % des alliances portent sur des formes contractuelles de coopération en matière de R-D (accords et recherche contractuelle)4.
Une deuxième indicateur, bien qu’imparfait, de la coopération internationale en matière de R-D, est fondé sur le nombre et la part des brevets qui ont été obtenus par des co-inventeurs de pays différents. Il rend compte de la coopération internationale en matière de R-D, pour autant que cette coopération débouche sur des demandes de brevets. Ces brevets peuvent être le fruit d’une collaboration entre a) différents inventeurs b) des entreprises de différents pays c) des filiales d’une même entreprise multinationale implantées dans des pays différents. Cet indicateur inclut donc la collaboration internationale en matière de R-D menée par des entreprises multinationales. Le tableau 7.7 présente les parts des demandes de brevets présentées par des co-inventeurs d’origines différentes. Entre 1990-1992 et 2000-2002, la collaboration internationale en matière de R-D exprimée en fonction du nombre de co-inventions internationales a progressé, sa part passant de 3.8 à 7.0 % des brevets. Le classement des entreprises et l’éventail des pourcentages sont assez semblables à ceux que l’on retrouve dans les tableaux sur les brevets détenus par des résidents étrangers et les tableaux sur les brevets détenus à l’étranger, ce qui porte à croire que la collaboration intervient principalement à l’intérieur des frontières des pays où sont implantées les entreprises multinationales.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 205
Tableau 7.7. Évolution des brevets détenus conjointement avec des co-inventeurs étrangers
1990-92 2000-2002 Co-inventeurs
étrangers % du total
Co-inventeurs étrangers
% du total
Japon 838 2,3 1813 3.0
Corée 37 7,2 270 5.3
Total mondial 6905 3,8 23055 7.0
Union européenne 3644 4,4 12076 7.7
Italie 370 5,3 1262 9.9
États-Unis 3303 6,1 11332 11.9
Allemagne 2321 6,6 8137 11.9
Taipei chinois 41 10,3 170 14.6
Finlande 120 8,4 630 14.7
Pays-Bas 522 11,1 1806 15.4
Israël 160 19,5 463 15.5
France 1066 7,1 3824 16.0
Suède 303 9,8 1123 16.3
Australie 180 14,3 615 19.2
Afrique du Sud 35 13,3 85 19.2
Danemark 166 14,2 592 19.7
Espagne 135 14,2 604 20.6
Nouvelle- Zélande 29 19,7 118 22.3
Royaume-Uni 1335 11,9 4285 22.6
Norvège 82 15,1 319 24.9
Autriche 336 16,0 1142 26.9
Inde 44 47,8 302 29.2
Brésil 36 25,4 137 29.5
Chine 45 37,5 472 30.3
Canada 470 23,9 1804 30.6
Suisse 1042 18,7 2957 30.9
Irlande 74 30,1 262 32.6
Belgique 563 26,8 1601 34.6
Hongrie 36 18,6 155 37.2
Singapour 50 43,9 285 42.4 Fédération de Russie 78 23,3 361 44.1
Luxembourg 51 42,5 169 55.2 Note : Les brevets sont comptés en fonction de la date de priorité, du pays de résidence de
l’inventeur et de comptages simples. L’UE est traitée comme une unité à part entière et la coopération intracommunautaire est exclue.
Part des demandes de brevets présentés à l’OEB correspondant à des inventions détenues conjointement avec un co-inventeur qui est un résident étranger sur le territoire national.
Source : OCDE (2006)
206 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
L’Enquête communautaire sur l'innovation (ECI), qui est menée auprès des entreprises innovantes des pays de l’Union européenne, est une autre source de données sur la collaboration en matière de R-D (par exemple, Commission des communautés européennes, 2006). Une étude des données recueillies à la fin des années 90 a montré que 26 % des entreprises du secteur manufacturier et 24 % des entreprises de services innovantes de l’UE étaient engagées dans une forme ou une autre de partenariat en matière de R-D (La politique scientifique fédérale (Belgique) et OCDE, 2005). La plupart de ces entreprises étaient engagées dans des activités de collaboration avec des associés nationaux (84 et 74 % d’entre elles respectivement), mais la collaboration en matière de R-D menée avec des associés de l’UE était également assez répandue (50 et 37 % respectivement). Le quart environ des entreprises qui travaillent en collaboration a également conclu des accords avec des entreprises américaines et un peu moins avec des entreprises japonaises (de 9 à 12 %).
2. Moteurs et vecteurs des activités de R-D à l’étranger
2.1 Motivations : R-D « innovante » ou R-D « d’adaptation »
De nombreuses études ont analysé les dépenses de R-D effectuées par les filiales étrangères des EMN afin de mieux connaître les facteurs qui attirent la R-D étrangère5. Ces études confirment que la R-D est attirée par des marchés locaux caractérisés par leur grande taille ainsi que par les marchés sophistiqués où le revenu par habitant est élevé. La R-D est également liée de près à l’étendue des activités manufacturières locales des multinationales et suit généralement avec un certain décalage l’IDE dans le secteur manufacturier.
Une série d’études empiriques semblent également indiquer que les facteurs liés à la création et à l’acquisition de la technologie influent sur les décisions concernant les activités de R-D à l’étranger. À cet égard, les facteurs associés à la solidité technologique des pays d’accueil et à la disponibilité et au coût du personnel de R-D (scientifiques et ingénieurs) revêtent de l’importance. Belderbos (2006) constate que les pays d’accueil sont d’autant mieux disposés à accueillir des activités de R-D d’entreprises multinationales américaines, européennes et japonaises qu’ils possèdent une assise technologique forte dans le domaine concerné. Belderbos, Fukao et Iwasa (2005) remarquent que la R-D menée par des entreprises multinationales japonaises aux États-Unis est plus importante dans les secteurs où les débouchés offerts par la technologie (tels qu’indiqués par les pourcentages de croissance des brevets) sont élevés comparativement à ceux du pays d’origine (en l’occurrence le Japon). Le ministère des Affaires économiques des Pays-Bas (2004), dans une analyse des données contenues dans la base de données AFA de l’OCDE, observe que le niveau d’instruction des pays d’accueil de la zone OCDE constitue un facteur
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 207
déterminant de l’importance des flux de R-D dans ces pays, qui s’ajoute à l’ampleur de l’IDE dans leurs activités manufacturières et des dépenses de R-D de leurs entreprises.
Chung et Alcacer (2002) examinent les effets des différences d’intensité de R-D entre les pays d’origine et les pays d’accueil sur la propension des investisseurs étrangers à s’implanter dans les États américains. Ils constatent que les entreprises provenant de pays à faible intensité de R-D choisissent les États américains à forte intensité de R-D, ce qui semble indiquer ce sont les régions où l’on retrouve la plus grande concentration d’entreprises à forte intensité de R-D qui attirent les pays qui accusent un retard technologique et effectuent des investissements en vue d’acquérir des connaissances. Le Bas et Sierra (2002), dans une étude portant sur les brevets déposés par 350 entreprises au cours de la période 1994-1996, constatent que dans la plupart des domaines technologiques, les entreprises effectuent leurs activités de R-D à l’étranger dans des pays d’accueil qui sont relativement spécialisés dans les domaines en question, ce qui semble indiquer que ces activités de R-D sont motivés par la volonté d’améliorer les acquis. Cantwell et Janne (1999) montrent que les entreprises implantées dans des pays possédant d’importantes compétences technologiques mettent en œuvre une stratégie plus diversifiée en matière technologique dans leurs filiales étrangères en y complétant leurs avantages acquis. Selon Belderbos, Kwon et Fukao (2006), tout porte à penser que les dépenses de R-D des pays d’accueil sont affectées négativement par les coûts salariaux des scientifiques et des ingénieurs6.
D’autres données sur les différents rôles confiés aux filiales qui mènent des activités de R-D font apparaître que la R-D effectuée dans le but d’améliorer des avantages acquis prend de l’importance. Dans une étude portant sur un échantillon d’entreprises multinationales allemandes, Wortmann (1990) constate que les activités de R-D visent rarement l’acquisition de technologie, sauf dans le cas des entreprises du secteur des biotechnologies, tandis que Florida (1997), dans le cadre d’une enquête réalisée aux États-Unis auprès de 207 laboratoires indépendants exploités par des entreprises étrangères, constate que l’acquisition de technologie est un motif d’activité au moins aussi important que l’exploitation de technologie. Kuemmerle (1997) constate à peu près la même chose : sur 156 sites de R-D à l’étranger exploités par 32 grandes entreprises multinationales américaines, européennes et japonaises des secteurs pharmaceutique et électronique, 70 se consacrent à l’« acquisition de technologie ». Shimizutani et Todo (2006) recensent les filiales japonaises qui, en 2003, menaient des activités de R-D « d’innovation » (recherche et développement pour les marchés mondiaux) et celles qui menaient des activités de R-D d’adaptation (développement et conception pour les marchés locaux). La proportion de filiales du secteur manufacturier engagées dans la R-D
208 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
d’innovation était relativement élevée aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France mais également dans un certain nombre de pays d’Asie, notamment la Corée et le Taipei chinois. Von Zedtwitz (2005) note toutefois que la plupart des installations de R-D situées en Chine se concentrent encore sur les activités destinées au marché local ou sur des tâches de R-D cloisonnées particulières pour le compte du siège.
Les études qui s’intéressent plus particulièrement au rôle des laboratoires de R-D à l’étranger et des filiales qui mènent des activités de R-D à l’étranger montrent bien que les facteurs pertinents qui constituent les moteurs de la R-D diffèrent considérablement selon qu’il s’agit d’exploiter la technologie acquise (R-D d’adaptation) ou de renforcer l’assise technologique (R-D d’innovation). Von Zedtwitz et Gassmann (2002), en s’appuyant sur des entretiens et des enquêtes auxquels ont participé de grandes entreprises internationales, estiment que dans le cas de la R-D d’adaptation, l’activité est liée à la base de production locale, aux compétences techniques disponibles dans la filiale et à la proximité de fournisseurs et de clients, et que les coûts de la R-D et les droits de protection de la propriété intellectuelle sont relativement moins importants. S’agissant des laboratoires qui se concentrent sur la R-D d’innovation, les coûts de R-D jouent un rôle non négligeable, de même que la disponibilité de scientifiques et d’ingénieurs, la force de la recherche publique et de la R-D locale, l’existence de parcs scientifiques, et d’incitations publiques, et la protection des droits de propriété intellectuelle.
Un certain nombre d’études empiriques ont pu établir une distinction entre la R-D d’innovation, qui renforce l’assise technologique, et la R-D d’adaptation, qui exploite l’assise technologique, dans les choix d’implantation. Kuemmerle (1999) a montré que les laboratoires qui renforcent l’assise technologique sont associés à l’excellence scientifique, consacrée par le prix Nobel, et la R-D exploitant des avantages acquis est régie par la taille du marché concerné. Belderbos, Fukao et Iwasa (2006) constatent que les activités de recherche sont corrélées à des débouchés technologiques, comme en témoignent la croissance des brevets, alors que les activités de développement sont corrélées à la croissance du secteur concerné. De même, Shimizutani et Todo (2005) montrent que les dépenses de recherche correspondent à la productivité totale des facteurs des pays d’accueil, dans la mesure où elles reflètent leur développement technologique, alors que les dépenses de développement correspondent à la taille du marché.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 209
Graphique 7.5. Facteurs d’implantation des installations de R-D
(échelle de 1 à 5. 5 : très important ; 1 : non important)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Growth
pot
entia
l
Qualifi
ed R
&D per
sonn
el
Suppo
rt to
sales
IPpr
otec
tion
Owners
hip o
f IP
Low R
&D costs
Collab
orat
ion w
ith u
niver
sities
Prese
nce
of u
niver
sities
Few re
strict
ions
Suppo
rtfo
r exp
orts
Creat
ion o
f new
bus
iness
Tax b
reak
s
Lega
l pre
requ
isite
Agree/Disagree Importance
Source : Thursby et Thursby (2006) ; OCDE (2006b)
Traduction des légendes
Potentiel de croissance
Personnel de R-D qualifié
Soutien à la commercialisation
Protection de la propriété intellectuelle
Détention des droits de propriété intellectuelle
Faible coûts de R-D
Collaboration avec des universités
Présence d’universités
Restrictions rares
Appui aux exportations
Création de nouvelles entreprises
Allégements fiscaux
Conditions juridiques
210 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
La complexité des motivations qui président aux choix des lieux d’implantation des activités de R-D dans les pays d’accueil est également bien cernée dans une enquête récente menée auprès de 200 entreprises multinationales, interrogées sur les raisons qui les avaient incitées à étendre leurs activités de R-D à l’étranger (Thursby et Thursby, 2006 ; OCDE, 2006b). Dans le cas de la R-D axée sur l’exploitation d’avantages acquis, l’accroissement du chiffre d’affaires au niveau local ou la perspective de tirer avantage de la croissance du marché figurent parmi les principales motivations (graphique 5). La disponibilité de personnel de R-D compétent occupe le deuxième rang, tandis que la protection des DPI, le coût de la R-D, la présence d’universités et la possibilité de collaboration avec des universités figurent également parmi les motivations importantes. Les auteurs font remarquer qu’à l’origine de la création de centres de R-D dans les pays en développement, parmi lesquels la Chine et l’Inde sont les principaux pays d’accueil, on trouve sensiblement les mêmes motivations que dans les pays développés (Thursby et Thursby, 2006).
Le rôle de la protection des droits de propriété intellectuelle
Le rôle que joue la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’internationalisation de la R-D mérite que l’on s’y attarde. En effet, la protection des DPI a été un des principaux problèmes associés à la réforme de la réglementation dans les pays en développement. Le risque de diffusion du savoir-faire auprès des concurrents locaux a longtemps été un argument en faveur de la centralisation de la R-D dans le pays d’origine. Ces dernières années, dans la foulée de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle, les institutions chargées des brevets et des autres systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle se sont considérablement améliorées dans les pays en développement.
Les travaux empiriques relatifs à l’impact des DPI portent essentiellement sur leur effet sur la valeur des licences détenues par les entreprises étrangères (Smith, 2001 ; Yang et Maskus, 2000 ; Wakasugi et Ito, 2005), la valeur et la composition de l’IDE des entreprises étrangères (Lee et Mansfield, 1996 ; Smarzynska, 2004 ; Maskus, 1998 ; OCDE, 2007) et les importations (Smith, 1999) dans les pays d’accueil. Dans l’ensemble, les études tendent à démontrer que la protection des DPI a un effet favorable sur les importations, l’IDE, et le transfert de technologie en provenance de l’étranger par le biais des concessions de licences, encore que certaines semblent indiquer que la protection des DPI est sans effet dans les pays où le niveau de développement économique est faible.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 211
Les études spécialement consacrées à l’impact des DPI sur la R-D à l’étranger montrent que la protection des DPI revêt de l’importance. Kumar (1996), dans une analyse de données d’ensemble réunies dans le cadre d’une étude internationale des activités de R-D au Japon et aux États-Unis, constate son impact positif sur les décisions en matière de R-D, mais non sur le niveau de la R-D (il faut dire cependant que cette analyse porte sur des données qui datent de 1989, soit avant l’Accord sur les ADPIC.) Dans une étude récente, Branstetter et al. (2006) examinent l’impact de la réforme des régimes de protection des droits de propriété intellectuelle engagée dans 12 pays sur la R-D et les accords de licence intra-entreprises conclus par des entreprises multinationales américaines avec leurs filiales locales. À partir de données de panel couvrant les années 1982-1999, ils montrent que la réforme des DPI a un fort impact positif sur les licences et les activités de R-D des filiales américaines, mais seulement dans le cas des entreprises multinationales qui détiennent un portefeuille de brevets supérieur à la moyenne. Leur hypothèse est que les entreprises qui n’ont pas activement recours à des brevets pour protéger leurs inventions profitent moins des modifications apportées au régime des brevets à l’étranger. Belderbos, Fukao et Kwon (2006), dans une étude portant sur les dépenses de R-D effectuées par des multinationales japonaises à l’étranger, constatent également les effets bénéfiques liés au degré de protection des DPI instaurée dans le pays d’accueil sur les dépenses de R-D dans ces pays. Belderbos, Lykogianni et Veugelers (2005), qui se penchent sur le lieu d’implantation des activités de R-D des multinationales européennes, montrent bien l’existence d’un impact bénéfique de la protection des DPI sur les flux entrants de R-D et ce, même parmi les pays d’Europe. Des modèles formels du rôle des DPI et de leurs retombées positives sur les décisions en matière de R-D internationale confirment que la R-D a tendance à se concentrer dans le pays offrant la meilleure protection en matière de DPI (Belderbos et al., 2004).
Dans ce contexte, la CNUCED (2005) et Zhao (2004) expliquent pourquoi les entreprises multinationales continuent de mener des activités de R-D dans des pays où le régime de DPI est peu développé. Zhao (2004) constate que dans ces pays, la R-D se concentre sur les technologies qui sont habituellement utilisées avec d’autres technologies complémentaires développées par l’entreprise concernée. En l’absence de ces technologies associées, les fuites technologiques locales ne constituent pas une menace grave. Selon Zhao (2004), les inventions pour lesquelles les EMN détiennent un brevet dans des pays où la protection des droits de propriété intellectuelle est peu développée suscitent davantage d’autocitations des entreprises et moins de citations extérieures, ce qui signifie que les technologies mises au point sont principalement utilisées en conjugaison avec d’autres innovations élaborées au sein de l’entreprise.
212 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
2.2 Choix du mode d’entrée de la R-D étrangère : fusions et acquisitions transnationales et coentreprises internationales
Les articles consacrés aux choix du mode d’entrée de l’IDE présentent souvent l’acquisition comme un moyen utilisé par l’entreprise acquéreuse pour se familiariser avec des technologies qu’elle ne connaît pas bien (voir par exemple Roberts et Berry, 1985), en d’autres termes comme une initiative motivée par l’acquisition de technologie. L’entreprise opte pour la croissance interne par le biais d’installations nouvelles lorsqu’elle s’appuie sur des technologies et des compétences existantes supposant, du moins au début, l’exploitation des compétences technologiques de la société-mère.
Des études empiriques confirment que les entreprises dont les compétences ou les avantages concurrentiels en matière de R-D sont moins manifestes que ceux de leurs rivales étrangères adoptent généralement une stratégie d’entrée axée sur l’acquisition plutôt que sur la création d’installations nouvelles (Hennart et Park, 1992 ; Yamawaki, 1993) ce qui laisse à penser que l’acquisition est un moyen d’accéder à des ressources concurrentielles. C’est ce qui ressort également d’autres études selon lesquelles l’accès à des technologies et à des connaissances exclusives est un motif d’acquisition de plus en plus courant (Grandstrand et Sjölander, 1990, Chakrabarti et al., 1994). Capron et al(1998) montrent que pendant la période 1988-1992, il s’est opéré un redéploiement considérable des ressources de R-D en Europe et en Amérique du Nord. Pour ces auteurs, il est souvent nécessaire de reconfigurer les ressources pour améliorer les activités existantes et conserver les avantages concurrentiels, afin de faire face à l’évolution des conditions et à l’accroissement de la concurrence.
Les entreprises privilégient l’acquisition plutôt que le développement interne lorsque l’imitation des ressources uniques que possède l’entreprise cible en matière d’organisation est difficile ou demanderait du temps. De fait, l’avantage crucial de l’acquisition est qu’elle permet une entrée rapide dans de nouveaux domaines technologiques, dans un contexte où, en raison des évolutions rapides du cadre concurrentiel, les entreprises ne disposent pas du temps voulu pour développer de nouvelles ressources en interne (voir Capron etal, 1998, 633 ; Chaudbury et Trabizi, 2000). Belderbos (2001, 2003) a constaté en particulier que les EMN japonaises recourent aux fusions et acquisitions pour accélérer le développement de leurs compétences de R-D à l’étranger. Les entreprises qui procèdent à des fusions et acquisitions enregistrent globalement une plus forte intensité de R-D à l’étranger et leurs filiales sont également plus actives en R-D.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 213
Les fusions et acquisitions internationales visent sans doute l’acquisition de technologie et la combinaison d’actifs technologiques, mais tel n’est pas toujours le cas (voir Hakanson et Nobel, 1993 ; Capron et al., 1998) ; il se peut qu’elles soient motivées par d’autres raisons importantes, comme l’accès aux marchés et aux réseaux de distributions à l’étranger ou la rationalisation des chaînes logistiques et des activités manufacturières. Cela explique peut-être l’absence de preuve des effets des fusions et acquisitions sur l’innovation. Les études concernant l’impact des fusions et acquisitions sur les dépenses de R-D constatent qu’elles induisent souvent une réduction de l’intensité de R-D (voir par exemple Hitt et al., 1991). Tel est le cas lorsque l’intégration de la R-D conduit à une réorganisation s’accompagnant d’une réduction de la R-D si celle-ci fait double emploi avec les activités existantes ou ne correspond pas à la stratégie de R-D de l’entreprise acquéreuse (voir par exemple Hakanson, 1995 ; Belderbos, 2001 ; Cassiman et al, 2005).
La difficulté qu’il y a à intégrer, après une acquisition, des activités de R-D menées dans différent lieux dans des entreprises situées dans des pays différents, porte à croire que les effets moins positifs des fusions et acquisitions relevés dans les études ont une autre cause. De Man et Duysters (2005) examinent 15 études consacrées aux effets des fusions et acquisitions sur l’innovation et constatent qu’aucune de ces études ne démontre clairement leurs effets positifs sur les performances en matière d’innovation (en fonction de l’intensité de R-D ou des brevets attribués). Ahuja et Katila (2001) citent les cas où les fusions et acquisitions exercent un effet vraisemblablement positif sur l’innovation : il s’agit des cas où les portefeuilles technologiques ne se recoupent pas fortement mais ne sont pas trop dissemblables (cela permet la fertilisation croisée) et où l’entreprise cible n’est pas de taille trop modeste (cela facilite l’intégration). Dans une étude récente, Cloodt et al. (2006) soulignent que les fusions et acquisitions qui interviennent dans les secteurs de haute technologie sont plus susceptibles de produire des effets positifs que celles qui sont réalisées dans d’autres secteurs, encore que ces effets aient été identifiés seulement au cours des années qui suivent immédiatement la fusion ou l’acquisition.
Les publications qui s’intéressent aux alliances technologiques stratégiques font état des évolutions technologiques et contextuelles qui ont milité en faveur d’un recours croissant à la R-D en collaboration (par exemple, Hagedoorn, 2002 ; Hagedoorn et Royakkers, 2006 ; De Man et Duysters, 2005 ; Vonortas, 1997) : coûts croissants de la R-D et rapidité de mise au point des produits ; meilleure répartition du savoir-faire technologique et scientifique entre les entreprises et les pays ; le fait que dans de nombreux domaines technologiques, la recherche est davantage appuyée sur la science ; enfin, l’évolution des méthodes de R-D, qui permettent le fractionnement et la gestion
214 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
distincte des tâches de R-D. Ces facteurs contribuent également à accroître la R-D à l’étranger par le biais de l’IDE, mais du point de vue de la coopération en matière de R-D, ils favorisent des modèles contractuels, sans participation au capital. Tel est notamment le cas des partenariats public-privé et des consortiums de parrainage de R-D, qui excluent la participation conjointe d’entreprises dans la R-D, mais également des accords bilatéraux entre entreprises. Les modes contractuels de coopération offrent aux entreprises plus de souplesse pour gérer leur portefeuille de technologie et leur permettent de miser simultanément sur différentes trajectoires technologiques et d’élargir ainsi leurs perspectives d’innovation et de croissance futures.
Des études sur la R-D menée par des coentreprises internationales semblent indiquer que celles-ci représentent pour les entreprises qui ne possèdent pas de compétences en R-D un moyen d’acquisition de technologie. Ces études portent en grande partie sur des entreprises japonaises. Kogut et Chang (1991) constatent que les entreprises japonaises créent aux États-Unis davantage de coentreprises dans des secteurs à plus forte intensité de R-D qu’elles ne le font dans des secteurs comparables au Japon. Hennart et al.(1999) constatent que les coentreprises japonaises établies aux États-Unis dans les années 80 visaient à tirer parti des compétences technologiques de leurs associées américaines en s’appuyant sur de nouvelles ressources de R-D. Belderbos (2003) montre que les entreprises ayant de faibles compétences en R-D créent davantage de coentreprises avec des associées à forte intensité de R-D.
Les auteurs qui ont examiné les effets des alliances technologiques sur les résultats estiment qu’ils sont de manière générale importants et vraisemblablement positifs. L’examen des études réalisées sur ce sujet (De Man et Duysters, 2005) révèle que près des trois quarts d’entre elles démontrent les effets positifs des alliances technologiques. Pour être couronnées de succès, les activités d’acquisition de technologie doivent s’appuyer en grande partie sur un certain niveau de R-D interne, devant permettre d’évaluer et d’assimiler les informations technologiques acquises à l’extérieur (voir par exemple Veugelers, 1997 ; Cohen et Levinthal, 1990). S’agissant des alliances technologiques, cela implique la nécessité d’un certain recoupement des portefeuilles technologiques des entreprises associées. Les autres facteurs qui accroissent les chances de succès sont notamment l’expérience antérieure en matière d’alliance, en particulier avec la même entreprise associée, de même qu’une expérience similaire (la préférence accordée aux alliances nationales plutôt qu’internationales). Il est moins probable que les consortiums de R-D régis dans le cadre d’un parrainage puissent accroître la production d’innovation des entreprises participantes.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 215
2.3 Gestion de la R-D internationale et flux de connaissances internationaux
L’importance croissante prise par la R-D d’innovation à l’échelle mondiale représente pour les entreprises multinationales un défi consistant à utiliser leurs acquis technologiques locaux dans des sites géographiques dispersés en les communiquant et en les intégrant à leur organisation mondiale et en les adaptant à d’autres marchés. Cet aspect suscite un nombre croissant de travaux sur l’efficacité des processus de coordination et de contrôle dans le cadre de la R-D internationale et sa relation avec la connaissance de l’organisation (Brockhoff et Schmaul, 1996 ; DeMeyer, 1997 ; DeMeyer et Mizushima, 1989 ; Gassmann et von Zedtwitz, 1999 ; Ghoshal et Bartlett 1988 ; Reger, 1999 ; Von Zedtwitz et Gassmann, 2002).
Les articles qui abordent la gestion de la R-D internationale montrent que l’adaptation des processus de coordination et de contrôle, qui est nécessaire à la gestion efficace d’un réseau de sites de R-D dispersés géographiquement, est extrêmement difficile et suppose de nombreux tâtonnements ainsi que des investissements dans les nouvelles activités de l’organisation. Les problèmes sont accentués par le fait que les différences entre les ressources et le cadre des activités de R-D à l’étranger ne permettent pas d’instaurer des procédures uniformes et qu’il faut donc établir des dispositifs spécifiques pour chaque filiale (Nobel et Birkinshaw, 1998).
De fait, rares sont les entreprises multinationales qui administrent des réseaux de collaboration internationale en R-D reliant des sites dispersés affectés à des projets communs. En général, les entreprises réduisent le plus possible l’interdépendance entre les laboratoires en les laissant se spécialiser dans des domaines technologiques précis. Il est particulièrement difficile de passer d’un système de contrôle de gestion centralisé à un système de gestion décentralisé nécessaire pour que les responsables de la R-D à l’étranger disposent de l’autonomie voulue (DeMeyer et Mizushima, 1989). Brockhoff et Schmaul (1996) constatent ainsi que des entreprises multinationales allemandes exploitant un modèle de plate-forme centralisée assurant la coordination de leurs activités de R-D à l’étranger estiment que leur système de gestion de la R-D fonctionne mieux que celui des entreprises qui ont commencé à exploiter un modèle en « réseau » dans lequel le contrôle et l’attribution des tâches de recherche sont plus décentralisés.
Selon Frost (2001), l’efficacité de la diffusion intra-entreprise des connaissances nécessite un double enracinement des filiales dans les réseaux existant tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des entreprises. Frost (2001) et Almeida (1996) observent que les filiales étrangères sont plutôt enracinées
216 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
localement et citent davantage des inventeurs des pays d’accueil. Singh (2004) fait le même constat dans une analyse à grande échelle de données sur les brevets qui aborde les flux bidirectionnels de connaissances entre les pays d’accueil et les filiales d’entreprises multinationales. Aux États-Unis, en particulier, les entreprises multinationales étrangères citent les entreprises locales alors que l’inverse est moins fréquent, ce qui montre bien que les filiales étrangères sont engagées dans l’acquisition de technologie. Cela concorde, en ce qui concerne l’acquisition locale de connaissances, avec l’observation de Branstetter (2006), selon lequel la probabilité que les entreprises japonaises qui investissent aux États-Unis citent les brevets d’autres entreprises américaines est considérablement plus forte. Par ailleurs, les données sur l’enracinement intra-entreprise sont moins probantes. En particulier, même si elles sont enracinées localement, les entreprises ayant fait l’objet d’une acquisition semblent souvent conserver leur autonomie sans s’intégrer beaucoup au réseau de R-D des entreprises multinationales (Frost, 2001). Plusieurs études portant sur les flux de connaissances transnationaux au sein des entreprises multinationales conduisent à penser que les flux de connaissances allant des filiales étrangères vers leur siège sont demeurés plus limités (Frost, 2001 ; Gupta et Govindarajan 2000). Gupta et Govindarajan (2000) estiment que la diversité des réseaux de communication (formels et informels) entre les sièges et les filiales peut augmenter les transferts réciproques de technologie.
3. L’impact de la R-D étrangère sur les entreprises et les pays
3.1 L’impact de la R-D étrangère sur les résultats des entreprises multinationales et sur les pays d’origine
Étonnamment, compte tenu de l’intérêt croissant porté à la R-D à l’étranger et en particulier du fait que ce type de R-D est axée sur l’acquisition de technologie et qu’elle a un caractère novateur, il est difficile de déterminer son impact sur l’innovation dans les entreprises. Quelques études ont été consacrées à l’impact des activités de R-D des filiales sur les résultats de ces dernières en examinant la croissance de leur productivité ou de leur valeur ajoutée. Fors (1996) confirme l’effet positif attendu des activités de R-D de filiales d’entreprises suédoises sur la croissance de ces dernières ; de leur côté, Belderbos, Ito et Wakasugi (2007) montrent que les importations de technologie intra-entreprise effectuées par une filiale par le biais de licences, ainsi que la R-D qu’elle effectue, contribuent à la croissance de la productivité de manière complémentaire. Ces résultats sont caractéristiques de la R-D d’adaptation, qui s’appuie sur l’exploitation de la technologie.
Plus convaincantes sont les données sur l’efficacité de la R-D à l’étranger vouée à l’innovation en ce qui concerne les activités de la société-mère. Fors
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 217
(1996) constate que la R-D menée à l’étranger par des entreprises suédoises n’a pas d’impact sur la croissance de la société-mère, ce qu’ont confirmé Braconier et al. (2000). Des études plus récentes apportent des données probantes sur le transfert réciproque de technologie. Il est très important à cet égard de faire la distinction entre la R-D d’innovation et la R-D d’adaptation. Iwasa et Odagiri (2003) constatent que pour autant qu’elles se concentrent sur la recherche, les activités de R-D menées aux États-Unis par les filiales d’entreprises japonaises ont un impact positif sur les demandes de brevets présentées par les sociétés-mères au Japon. Griffith, Harrison et van Reenen (2003) montrent que les activités de R-D menées aux États-Unis par des entreprises multinationales britanniques ont un impact positif sur la productivité de ces entreprises si les efforts de R-D déployés aux États-Unis aboutissent à l’obtention de brevets et si la R-D est « enracinée localement » (autrement dit, si les brevets citent les entreprises américaines ou les institutions d’accueil américaines). Shimizutani et Todo (2005) présentent également des indications probantes de flux réciproques de technologie associés à la R-D visant l’acquisition de technologie dans le cas d’entreprises japonaises : la recherche d’innovation menée à l’étranger accroît la productivité des activités de la société-mère japonaise, alors que ce n’est pas le cas des activités de développement axées sur l’adaptation. Belderbos, Fukao et Kwon (2006) modélisent les différents déterminants de la R-D d’innovation et de la R-D d’adaptation.
Alors que la R-D d’innovation peut servir à mettre au point des produits destinés à différents marchés étrangers, la R-D d’adaptation doit se dérouler dans un pays d’accueil précis. Dans ce cas, les pays ne sont pas en concurrence directe pour les activités de développement, alors qu’ils le sont dans celui de la R-D d’innovation, qui est en principe libre. Le modèle identifie une complémentarité de la recherche et du développement au niveau de l’entreprise : la recherche est nécessaire au développement local alors qu’un meilleur développement local accroît la demande et les avantages pour la recherche mondiale. Cette complémentarité réduit à son tour la concurrence entre les pays : l’augmentation de la R-D d’adaptation attirée par un pays donné a un impact positif sur la R-D d’innovation dans le pays d’origine ou dans un autre pays d’accueil.
Dans l’ensemble, de nouveaux éléments semblent indiquer que la R-D à l’étranger peut avoir des effets positifs sur les activités des sociétés-mères. La R-D à l’étranger peut être avantageuse pour les pays d’origine si elle s’apparente à une R-D d’innovation « qui renforce l’assise technologique » et complète l’activité d’innovation locale et si les technologies et les connaissances sont redirigées vers le pays d’origine (Singh, 2004).
218 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
3.2 L’impact sur les pays d’accueil
L’IDE peut accroître la productivité du pays d’accueil en favorisant une meilleure répartition des ressources, l’intensification de la concurrence et le perfectionnement des compétences locales par le biais d’un transfert de savoir-faire technologique (voir par exemple : Caves, 1995 ; Blomstrom et Kokko, 1998 ; Belderbos, Fukao et Capannelli, 2001). Il y a perfectionnement des compétences locales lorsque l’IDE introduit des pratiques organisationnelles, du matériel et des technologies de niveau supérieur et que le savoir-faire est répercuté localement sur les fournisseurs et clients, la main-d’œuvre et les entreprises concurrentes et est assimilé par ces derniers.
L’ampleur de ces retombées est fonction de la force technologique de la société-mère, de l’importance du transfert technologique vers la filiale et du degré d’intégration de l’entreprise étrangère dans l’économie d’accueil (OCDE, 2002). En outre, pour bénéficier de retombées substantielles, l’économie locale doit posséder une « capacité d’absorption » suffisante – degré d’avancement technologique des fournisseurs locaux, compétence de la main-d’œuvre, et perfectionnement technologique des entreprises du pays hôte dans le secteur où exerce la filiale (Cohen et Levinthal, 1990 ; Greenaway et Gorg, 2004). Dans ce contexte, l’intégration correspond au degré d’interaction avec la main-d’œuvre locale, les fournisseurs locaux, les clients, les institutions publiques, les associations professionnelles, les établissements d’enseignement et les centres de recherche.
L’élargissement du rôle des filiales de manière à ce qu’elles englobent des activités de R-D locales d’adaptation ou d’innovation accroît les capacités d’innovation de la filiale et son enracinement local de même que l’applicabilité des technologies dans le pays d’accueil. En conséquence, la R-D menée par la filiale aura vraisemblablement un impact positif en termes de retombées locales et d’ampleur desdites retombées. Les pays d’accueil bénéficient sans doute des flux entrants de R-D, premièrement parce qu’ils renforcent la concurrence et la productivité des filiales étrangères, ce qui favorise l’amélioration de leurs capacités d’exportation et leur confère un rôle plus étendu dans le réseau de filiales de la multinationale. Deuxièmement, la R-D réalisée localement apporte des perspectives de formation et d’emploi aux scientifiques et aux ingénieurs du pays d’accueil et accroît ses compétences en matière d’innovation, ce qui peut lui permettre d’attirer d’autres investissements étrangers. Troisièmement, les activités de R-D ont des retombées sur les entreprises locales à la faveur des effets de démonstration, de la mobilité du personnel de R-D, de l’enracinement dans les réseaux locaux dont font partie les universités et les entreprises locales et des interactions avec les fournisseurs et les clients. Les investissements étrangers de R-D sont vraisemblablement plus avantageux pour les économies
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 219
d’accueil si les acteurs locaux possèdent un niveau de connaissances technologiques suffisant pour absorber les technologies développées et exploitées par les multinationales étrangères et en tirer des enseignements (La Politique scientifique fédérale (Belgique) et OCDE, 2005).
De rares études empiriques s’intéressent à l’impact des flux entrants d’investissements de R-D sur les pays d’accueil. On observe que les EMN qui mènent des activités de R-D sont mieux enracinées dans les économies d’accueil et que cela favorise les retombées locales. Par exemple, selon des observations recueillies sur l’Irlande, pays le plus tributaire des flux entrants d’IDE, plus du quart des EMN étrangères ont collaboré avec les universités locales, un pourcentage considérablement supérieur à celui des entreprises irlandaises (La politique scientifique fédérale (Belgique) et OCDE, 2005). Veugelers et Cassiman (2004) constatent qu’en Belgique, les accords de coopération en matière de R-D conclus par des filiales étrangères et des entreprises locales constituent une source précieuse de transfert technologique vers l’économie locale (bien que l’on ait également observé que les EMN ayant effectué des transferts de technologie vers leurs filiales belges étaient davantage portées à conserver la technologie en interne.)
Il est manifeste que dans de petits pays comme l’Irlande, la Belgique et Singapour, le fait d’avoir attiré des projets d’investissement portant sur la construction de nouvelles installations par des EMN dans des secteurs de haute technologie a contribué à développer les compétences technologiques et le potentiel de croissance dans des secteurs où les compétences du pays d’accueil étaient peu développées. La R-D réalisée par ces EMN accroît leur avance en termes de productivité mais les filiales étrangères n’effectuent pas nécessairement plus R-D d’innovation que les entreprises nationales. Sadowski et Sadowski-Rasters (2006) constatent qu’aux Pays-Bas, les EMN étrangères sont plus susceptibles d’introduire des innovations supplémentaires, mais qu’elles n’ont pas davantage tendance à mener des activités de R-D débouchant sur des innovations plus radicales sur le marché. Belderbos et al. (2004) observent également que même lorsque les filiales étrangères sont plus productives que les établissements nationaux, elles n’introduisent pas davantage de nouveaux produits sur le marché.
En général, l’intensité des activités de R-D des entreprises nationales a tendance à être supérieure à celle des filiales étrangères (OCDE, 2006b, p. 50). Seules quelques études empiriques examinent certains aspects des retombées de la R-D sous contrôle étranger sur les économies locales. Guellec et Van Pottelsberghe (2004) remarquent que la R-D exécutée dans d’autres pays de l’OCDE a un impact positif sur la croissance de la productivité des pays d’accueil, et que cet impact positif est plus marqué dans les pays où les
220 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
dépenses de R-D sont les plus élevées, mais n’examinent pas l’impact de la R-D sous contrôle étranger dans les pays d’accueil. Griffith et al. (2004) font le même constat. Xu (2000) établit un lien entre l’intensité technologique des filiales étrangères et la productivité du pays d’accueil, mais s’intéresse surtout à la concession de licences technologiques intra-entreprise à des filiales aux États-Unis plutôt qu’à la R-D menée par des filiales. Il constate que le transfert technologique vers les filiales américaines a un impact positif pour les économies développées mais non pour les pays en développement ayant un faible niveau d’éducation secondaire.
Pour conclure, les actifs intangibles transférés par le biais de l’IDE et étoffés par les activités de R-D locales peuvent avoir un effet positif sur le bien-être des économies d’accueil. En ce qui concerne les externalités sous forme de retombées pour les entreprises locales, elles sont essentiellement fonction du niveau critique de capacité d’absorption dans les pays d’accueil et de l’écart technologique entre les EMN et les pays hôtes, qui ne doit pas être trop prononcé.
Notes
1. Cette enquête présente un problème de taille tenant au fait qu’elle n’est pas obligatoire, de sorte que les taux de réponse sont plutôt faibles et variables d’une année sur l’autre, ce qui rend les données sur les tendances difficiles à interpréter. En outre, les questions sur la R-D n’ont suscité que des réponses insatisfaisantes et les données sous-estiment les dépenses de R-D à l’étranger (par exemple : Belderbos, 2003).
2. De même, Cloodt (2005) constate que dans la deuxième partie des années 90, la part des fusions et acquisitions transnationales dans le total des opérations de fusions et acquisitions dans le secteur de la haute technologie est restée relativement stable.
3. G. Duysters travaille actuellement à la mise à jour des données sur les alliances pour les dernières années.
4. Une autre source de données sur les partenariats de R-D, EUROSTAT-CIS, semble indiquer que la collaboration formelle en matière de R-D a diminué entre 1996 et 2000, mais l’utilisation de méthodes d’enquête différentes rend malaisées les comparaisons chronologiques (par exemple : OCDE-BELSPO, 2005).
5. Voir, par exemple, Zejan, 1990 ; Fors, 1996 ; Kumar, 2001 ; Odagiri et Yasuda, 1996 ; Belderbos, 2001, 2003 ; Belderbos, Kwon et Fukao, 2006 ; Belderbos, 2006 ; Chung et Alcacer, 2002 ; Cantwell et Janne, 1999 ; Cantwell et Mudambi, 2000l ; Kuemmerle, 2001.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 221
6. Cantwell et Mudambi (2000) constatent également que les incitations à la R-D proposées par les pays d’accueil ont un impact positif sur l’intensité de R-D des filiales, bien que cet impact soit faible comparativement aux autres facteurs déterminants de la R-D étrangère.
Bibliographie
Ahuja, G. et R. Katila, 2001, Technological Acquisitions and the innovation performance of acquiring firms: A longitudinal Study, Strategic Management Journal 22, 197-200.
Aitken, Brian, Gordon H. Hanson et and Ann E. Harrison, 1997, Spillovers, Foreign Investment, and Export Behaviour, American Economic Review, 43, 103-132.
Almeida, Paul, 1996, Knowledge Sourcing by Foreign Multinationals: Patent Citation Analysis in the U.S. Semiconductor Industry, Strategic Management Journal, 17 (hiver), 155-156.
Ambos, Björn (2005). « Foreign direct investment in industrial research and development: a study of German MNCs », Research Policy, 34, 4, p. 395-410.
Audretsch, D. et M. Feldman, 1996, « R&D spillovers and the geography of innovation and production », American Economic Review, 86, 630-40.
Bartlett, Christopher A. et Sumantra Ghoshal, 1991, Managing Innovation in the Transnational Corporation, in Christopher A Bartlet, Yves Doz et Gunnar Hedlund (dir. publ.), 1991, Managing the Global Firm, Londres et New York, Routledge.
Belderbos, René, 2006, R&D Activities in East Asia by Japanese, European, and US Multinationals, document présenté à l’occasion de la conférence intitulée « Multinational Firms' Strategies in East Asia: A Comparison of Japanese, U.S., European, and Korean Firms », Japan Center for Economic Research, Tokyo, 1er juin 2006.
Belderbos, R. A., 2003 Entry Mode, Organisational Learning, and R&D in Foreign Affiliates: Evidence from Japanese Firms, Strategic Management Journal, 24 (3), 235-259.
Belderbos, R., 2001. Overseas Innovation by Japanese Firms: An Analysis of Patent and Subsidiary Data. Research Policy 30(2), 313-332.
222 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Belderbos, R., B. Ito et R. Wakasugi, 2007, Intra-firm Technology Transfer and R&D in Foreign Affiliates: Substitutes or Complements? Evidence from Japanese Multinational Firms, GSEC Working Paper, Université de Keio,
Belderbos, R., E. Lykogianni et R. Veugelers, 2005, Strategic R&D location by multinational firms: Spillovers, technology sourcing, and competition, 47e réunion annuelle de l’Academy of International Business, Québec (Canada), 9-12 juillet.
Belderbos, R., K. Fukao et T. Iwasa, 2006, Domestic and foreign R&D investment, document de travail, ICSEAD, 2006-01.
Belderbos, R., Lykogianni, E. et Veugelers, R. (2004), « Strategic R&D location by multinational firms: spillovers, technology sourcing and competition », document de synthèse n° 5060, CEPR.
Belderbos, René A. et Léo Sleuwaegen, 2007, Intellectual Assets and International Investment: A Stocktaking of the Evidence, Documents de travail de l’OCDE sur l’investissement international, 2007/1.
Belderbos, René A. et Leo Sleuwaegen, 1996, Japanese Firms and the Decision to Invest Abroad: Industrial Groups and Regional Core Networks, Review of Economics and Statistics, 78, 214-220.
Belderbos, René, Kyoji Fukao et Hyeog Ug Kwon, 2006, Intellectual Property Rights Protection and the Location of Research and Development Activities by Multinational Firms, document de travail, ICSEAD, 2006-02, KitaKyushu.
Belderbos, René, Giovanni Capannelli et Kyoji Fukao, 2001, Backward Vertical Linkages of Foreign Manufacturing Affiliates: Evidence from Japanese Multinationals, World Development, 29 (1), 189-208.
Bertschek, Irene, 1995, Product and Process Innovation as a Response to Increasing Imports and Foreign Direct Investment, Journal of Industrial Economics, 43 (4), 341-357.
Blomström, M. et Kokko, A., 1998, Multinational Corporations and Spillovers, Journal of Economic Surveys, 12, 3, 247-277.
Branstetter, L. G., 2006, Is Foreign Direct Investment a Channel of Knowledge? Spillovers: Evidence from Japan's FDI in the United States, Journal of International economics, 8 (2), 325-344.
Brantstetter, L G., R. Fisman et C. F. Foley, 2006, Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Knowledge Transfer? Empirical Evidence from U.S. Firm-Level Panel Data, Quarterly Journal of Economics, vol. 121, n° 1, p. 321-349.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 223
Brockhoff, Klaus K. L. et Bernd Schmaul, 1996, Organisation, Autonomy, and Success of Internationally Dispersed R&D Facilities, IEEE Transactions on Engineering and Management, 43 (1), 33-40.
Bureau of Economic Analysis, U.S. Direct Investment Abroad: Operations of U.S. Parent Companies and Their Foreign Affiliates, différentes années.
Cantwell, John A. et Odile E.M. Janne (1999). « Technological globalization and innovative centres: the role of corporate technological leadership and locational hierarchy », Research Policy, 28, 2-3, p. 119-144.
Cantwell, John et Ram Mudambi (2000). « The location of MNE R&D activity: the role of investment incentives », Management International Review, 40, 1, p. 127-148.
Capron, Laurence, Pierre Dussauge et Will Mitchell, 1998, Resource Deployment Following Horizontal Acquisitions in Europe and North America, 1988-1992, Strategic Management Journal, 19, 631-661.
Cassiman, B., M. Colombo, P. Gerrone, et R. Veugelers, 2005, The impact of M&A on the R&D process. An empirical analysis of the role of technological and market relatedness, Research Policy, vol. 34, n° 2 (mars.), p. 195-220
Caves, Richard E., 1995, Multinational Enterprise and Economic Analysis, deuxième édition (MIT Press, Cambridge).
Chakrabarti, Alok, Jürgen Hauschildt, et Christian Süverkrup, 1994, Does it Pay to Acquire Technological Firms? R&D Management, 24 (1), 47-56.
Chaudhuri, Saikat, et Benham Tabrizi, 1999, Capturing the Real Value in High-Tech Acquisitions, Harvard Business Review, 99503, 123-130.
Cheng, J.L. C. et D.S. Bolon, 1993, The Management of Multinational R&D: A Neglected Topic in International Business Research, Journal of International Business Studies, 24 (1), 1-18.
Chung, W. et J. Alcacer, 2002. Knowledge Seeking and Location Choice of Foreign Direct Investment in the United States, Management Science 48(12), 1534-1554.
Cloodt M., J. Hagedoorn et H. Van Kraneburg, 2006, Mergers and acquisitions: Their effect on the innovative performance of companies in high-tech industries, Research Policy, 35, 5, 642-654.
Cloodt, M., 2006, M&As in High Tech Industries, thèse de doctorat, Université de Maastricht.
224 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Cohen, W. et al., 2003, R&D Spillovers, Patents, and Incentives to Innovate in Japan and the United States, Research Policy, 31 ( 8/9), 1349-1358.
Cohen, W. et D Levinthal, 1990 Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, vol. 35, 128-152.
CNUCED, World Investment Report 2005, New York et Genève, 2005.
CNUCED, World Investment Report 2006, New York et Genève, 2006.
Dalton, D. H., M. G. Serapio et P. Genther Yoshida, 1999, Globalizing Research and Development, U.S. Department of Commerce, Office of Technology Policy.
De Man, A. et G. Duysters, 2005, Collaboration and innovation: a review of the effects of mergers, acquisitions and alliances on innovation, Technovation, 25, 1377-1387.
DeMeyer, Arnaud, 1997, Management of International R&D Operations, inLawrence H. Wortzel et Heidi Vernon-Wortzel (dir. publ.), Strategic Management in a Global Economy, John Wiley, Chichester, 419-430.
DeMeyer, Arnaud et A. Mizushima, 1989, Global R&D Management, R&D Management, 19 (2), 135-146.
Edler, Jakob, Frieder Meyer-Krahmer et Guido Reger (2002). « Changes in the strategic management of technology: results of a global benchmark survey », R&D Management, 32, 2, p. 149-164
Erken, H.P.G. et V.A. Gilsing, Relocation of R&D: a Dutch Perspective, Technovation, 2006
Fisch, Jan Hendrik (2003). « Optimal dispersion of R&D activities in multinational corporations with a genetic algorithm », Research Policy, 32, 8, p. 1381-1396.
Florida, R., 1997, The globalization of R&D: results of a survey of foreign-affiliated R&D laboratories in the USA, Research Policy, 26, 85-103.
Fors, G., 1996, Utilisation of R&D Results in the Home and Foreign Plants of Multinationals, Journal of Industrial Economics, 45, 3, 341-358.
Fors, Gunnar, 1998, Locating R&D Abroad: The Role of Adaptation and Knowledge-Seeking, in Pontus Braunerhjelm and Karolina Ekholm (dir. publ.), The Geography of Multinational Firms, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Frost, Thomas, 2001, The geographic sources of foreign subsidiaries’ innovation, Strategic Management Journal, 22, 101-124.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 225
Garnier, G., 2006, Mergers and Acquisition Note, Affaires économiques et financières (UE), avril 2006.
Gassmann, Oliver et Maximilian von Zedtwitz, 1999, New concepts and trends in international R&D organisation, Research Policy, 28 (2-3), 231-250.
Gerybadze, Alexander et Guido Reger, 1999, Globalization of R&D: recent changes in the management of innovation in transnational corporations, Research Policy, 28 (2-3), 251-274.
Ghoshal, Sumantra et Christopher Bartlett, 1988, Creation, Adoption, and Diffusion of Innovations by Subsidiaries of Multinational Companies, Journal of International Business Studies, 19 (3), 365-388.
Globerman, Steven, 1978, Foreign Direct Investment and “Spillover” Efficiency Benefits in Canadian Manufacturing Industries, La Revue canadienne d’économique, 12 (1), 42-56.
Görg, H. et E. Strobl, 2001, Multinational companies and productivity spillovers: a meta-analysis, The Economic Journal, 111, 723-739.
Görg H. et Greenaway D. (2004), « Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign investment? », Banque mondiale, World Bank Research Observer, 19 (2), 2004.
Grandstand, O. et S. Sjolander, 1990, The Acquisition of Technology and Small Firms by Large Firms, Journal of Economic Behaviour and Organisation, 13, 367-386.
Grandstrand, Ove, Erik Bohlin, Chirster Oskarsson et Niklas Sjöberg, 1992, External Technology Acquisition in Large Multi-Technology Corporations, R&D Management, 22 (2), 111-133.
Granstrand, Ove, 1999, Internationalisation of corporate R&D: a study of Japanese and Swedish corporations, Research Policy, (28) 2-3, 275-302.
Granstrand, Ove, Lars Hakanson et Sören Sjölander, 1993, Internationalisation of R&D: A Survey of Some Recent Research, Research Policy, 22, 413-430.
Griffith, Rachel, Rupert Harrison et John van Reenen, 2003, technology sourcing by UK Manufacturing firms: an empirical analysis using firm-level patent data, document de travail, Institute of Fiscal Studies, Londres.
Guellec, D. et B. van Pottelsberghe, 2001, The Internationalisation of Technology Analysed with Patent data, Research Policy, 30 (8), 1256-1266.
226 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Gupta, A. K. et V. Govindarajan, 2000, Knowledge Flows within Multinational Corporations, Strategic Management Journal, 21, 473-496.
Haddad, Mona et Ann Harrison, 1993, Are there Spillovers from Direct Foreign Investment? Evidence from Panel Data for Morocco, Journal of Development Economics, 42, 51-74.
Hagedoorn, John, Inter-firm R&D partnerships: an overview of major trends and patterns since 1960. Research Policy, mai 2002, vol. 31, n° 4, p. 477, 16p.
Hakanson, L. et R. Nobel, 1993, Foreign research and development in Swedish multinationals, Research Policy, 22, 373-396.
Hakanson, L., 1995, Learning through Acquisitions, International Studies of Management and Organisation, 25, 121-138, 152-155.
Hennart, Jean-François et Young-Ryeol Park, 1992, Greenfield versus Acquisition: The Strategy of Japanese Investors in the United States, Management Science, 37, 1054-1070.
Hennart, Jean-François, Thomas Roehl et Dixie S. Zietlow, 1999, “Trojan Horse” or “Workhorse”? The Evolution of U.S.-Japan Joint Ventures in the United States, Strategic Management Journal, 20, 15-29.
Hitt, Michael A., Robert E. Hoskisson, R. Duane Ireland et Jeffrey S. Harisson, 1991, Effects of Acquisitions on R&D Inputs and Outputs, Academy of Management Journal, 34 (3), 693-706.
Iwasa, Tomoko; Odagiri, Hiroyuki, 2004, Overseas R&D, knowledge sourcing, and patenting: an empirical study of Japanese R&D investment in the US, Research Policy, 33 (5), 807-829.
Jaffe, Adam B., Trajtenberg, Manuel et Henderson, Rebecca, 1993, Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations, Quarterly Journal of Economics, août 1993, 108(3), p. 577-598
Kogut, Bruce et Sea Jin Chang, 1991, Technological Capabilities and Japanese Foreign Direct Investment in the United States, Review of Economics and Statistics, 3, 400-413.
Kuemmerle, W., 1997, Building Effective R&D Capabilities Abroad, Harvard Business Review, mars-avril, 61-70.
Kuemmerle, W., 1999, The Drivers of Foreign Direct Investment into Research and Development: an Empirical Investigation, Journal of International Business Studies, 30(1), 1-24.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 227
Kumar, N., 1996, Intellectual property protection, market orientation and location of overseas R&D activities by multinational enterprises, World Development 24, 673-688.
Lall, S., 1979, International Allocation of Research Activity by US Multinationals, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41, 313-331
Le Bas, C. et C. Sierra, 2002, Location versus home country advantages in R&D activities: some further results on multinational locational strategies, Research Policy, 31, 589-609.
Ministère des affaires économiques des Pays-Bas, 2004, Buitenlandse directe investeringen in research and development (investissements étrangers dans la R-D) Ministère des affaires économiques/SenterNovem, La Haye.
Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie du Japon (2006), 39e
enquête sur les écolutions des activités commerciales des sociétés affiliées étrangères (en japonais), Tokyo.
Nobel, Robert et Julian Birkinshaw, 1998, Innovation in Multinational Corporations: Control and Communication Patterns in International R&D Operations, Strategic Management Journal, 19, 479-496.
Odagiri, Hiroyuki et Akira Goto, 1993, The Japanese System of Innovation: Past, Present, and Future, in Richard R. Nelson (dir. publ.) National Innovation Systems, Oxford University Press, Oxford, 76-114.
Odagiri, Hiroyuki et Hideto Yasuda, 1996, The Determinants of Overseas R&D by Japanese Firms: An Empirical Study at the Industry and Company Levels, Research Policy, 25, 1059-1079.
OCDE et La politique scientifique fédérale (2005). « Internationalisation of R&D: trends, issues and implications for S&T policies: a review of the literature ». Document de synthèse pour le Forum sur l’internationalisation de la R-D, Bruxelles, 29-30 mars.
OCDE, 2002, L'investissement direct étranger au service du développement : optimiser les avantages, minimiser les coûts, Paris.
OCDE, 2006a, Actifs intellectuels et création de valeur, Paris.
OCDE, 2006b, Science, technologie et industrie: Perspectives de l'OCDE 2006, OCDE, Paris.
OCDE, 2006c, Compendium statistique sur les brevets 2005, OCDE, Paris.
OCDE, 2007, Les impacts économiques de la contrefaçon et du piratage, Direction de la science, de la technologie et de l’industrie, à paraître.
228 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Papanastassiou, Marina, et Robert D. Pearce, 1994, The Internationalisation of Research and Development by Japanese Enterprises, R&D Management, 24, 155-165.
Patel, Pari, 1996, Are large firms internationalising the generation of technology? Some new evidence, IEEE Transactions on Engineering Management, 43(1), 41-47.
Pearce, Robert D., 1989, The Internationalisation of Research and Development by Multinational Enterprises, Macmillan, Basingstoke et Londres.
Penner-Hahn, Joan D., 1998, Firm and Environmental Influences on the Mode and Sequence of Foreign Research and Development Activities, Strategic Management Journal 19, 149-168.
Pottelsberghe, B. van, et F. Lichtenberg, 2001, Does FDI transfer Technology Across Borders? Review of Economics and Statistics 83, 490-487.
Mataloni Jr., Raymond J.et Daniel R. Yorgason, 2006, Operations of U.S. Multinational Companies: Preliminary Results From the 2004 Benchmark Survey, BEA, Department of Commerce, novembre 2006.
Reger, Guido, 1999, How R&D is coordinated in Japanese and European Multinationals, R&D Management, 29 (1), 71-88.
Roberts, Edward B. (2001). « Benchmarking global strategic management of technology », Research Technology Management, 44, 2, p. 25-36.
Roberts, Edward B., et Charles A. Berry, 1985, Entering New Businesses: Selecting Strategies for Success, Sloan Management Review, Spring 1985, 3-17.
Roijakkers, Nadine ; Hagedoorn, John, 2006, Inter-firm R&D partnering in pharmaceutical biotechnology since 1975: Trends, patterns, and networks. Research Policy, avril 2006, vol. 35, n° 3, p. 431-446.
Sadowski, Bert M., et Gaby Sadowski-Rasters, 2006, On the innovativeness of foreign affiliates: Evidence from companies in The Netherlands, Research Policy, 35 (3), p. 447-462
Shimizutani, S. et Y. Todo, 2005, Overseas R&D Activities by Japanese Multinational Enterprises: Causes, Impacts, and Interaction with Parent firms, ESRI Discussion Paper Series, n° 132, Economic and Social Research Institute, Tokyo.
Shimizutani, S. et Y Todo, 2006, What Determines Overseas R&D activities? The Case of Japanese Firms, document de travail, Université de Hitotsubashi.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 229
Singh, Jashit, 2004, Multinational Firms and Knowledge Spillovers, document de travail de la Harvard Business School.
Smarzynska, Beate, 2004, Composition of Foreign Direct Investment and Protection of Intellectual Property Rights: Evidence from Transition Economies, European Economic Review, vol. 18 (1), 39-62.
Smith, P, 2001, How do Foreign Patent Rights Affect U.S. Exports, Affiliate Sales, and Licenses?, Journal of International Economics 55, 411-439.
Thursby, Jerry et Marie Thursby , 2006, Here or There? A Survey of Factors in Multinational R&D Location – Report to the Government-University-Industry Research Roundtable, National Academy of Sciences.
Van de Vrande, V., Lemmens, C., et Vanhaverbeke, W. (2006), Choosing Governance modes for External Technology Sourcing, R&D Management, 36, 3, juin, p. 347-363.
Vernon, Raymond, 1979, The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41, 255-267.
Veugelers, R., 1997, Internal R&D expenditures and External Technology Sourcing, Research Policy, 26 (3), 303-316.
Veugelers, R., et B. Cassiman, 2004, Foreign subsidiaries as channel of international technology diffusion: some direct firm level evidence from Belgium, European Economic Review, vol. 48, n° 2, avril, p. 455-476.
Vonortas, Nicholas S., 1997, Research Joint Ventures in the United States, Research Policy, 26, 577-595.
Wang, Jian-Ye, et Magnus Blomstrom, 1992, Foreign Investment and Technology Transfer: A Simple Model, European Economic Review, 36, 137-155.
Westney, Eleanor, 1993, Cross-Pacific Internationalisation of R&D by U.S. and Japanese Firms, R&D Management, 23 (2), 171-181.
Wortmann, M., 1990, Multinationals and the Internationalisation of R&D: New Developments in German Companies, Research Policy, 19 (2), 175-183.
Yamawaki, Hideki, 1993, International Competitiveness and the Choice of Entry Mode: Japanese Multinationals in the US and European Manufacturing Industries, document présenté à l’occasion des Allied Social Science Meetings, Anaheim, janvier, 1993.
Zedtwitz, Maximilian von, 2005, International R&D strategies in companies from developing countries – the case of China. Document présenté lors
230 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
de la réunion des spécialistes de la CNUCED sur l’impact de l’IDE sur le développement, Genève, 24-26 janvier.
Zedtwitz, M. Von, et Gassmann, O. (2002), Market versus Technology Drive in R&D Internationalisation: Four Different Patterns of Managing Research and Development, in: Research Policy, vol. 31, 2002, n° 4, 569-588
Zejan, Mario C., 1990, R&D Activities in Affiliates of Swedish Multinational Enterprises, Scandinavian Journal of Economics, 92 (3), 487-500.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 231
PARTIE II
Chapitre 8.
INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ET PME : BILAN DES TRAVAUX*
1. Introduction et synthèse
La mondialisation, dit-on souvent, modifie le paysage de l’IDE. Les nouvelles technologies, l’ouverture et la transparence accrues des politiques d’investissement et l’intérêt grandissant porté aux marchés en tant qu’instruments d’affectation des ressources ne sont pas étrangers à la progression de la mondialisation de la production par le biais de l’investissement international. Ces évolutions nouvelles sont un moteur de l’internationalisation des PME. Les progrès accomplis dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information, par exemple, ont permis aux PME et aux nouvelles entreprises d’entrer en contact avec des associés et des clients à l’étranger et diminué l’importance des économies d’échelle dans de nombreux secteurs (OCDE, 2006). En outre, à l’heure où les grandes entreprises externalisent certaines parties de leur chaîne logistique dans une économie mondiale en plein essor, les PME voient s’accroître leurs perspectives d’internationalisation par le biais de l’investissement direct ou des accords de coopération internationaux prenant la forme de coentreprises.
Le Groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat a effectué des études détaillées sur les perspectives d’internationalisation des PME et sur les obstacles à cette internationalisation (voir par exemple OCDE, 1997 ; OCDE, 2005c ; OCDE, 2006b et OCDE, 2006c). Ces études, comme d’autres, se concentrent sur l’internationalisation des PME par le biais des échanges internationaux et sur son incidence sur la politique relative aux PME. Les indications probantes de l’internationalisation des PME et des nouvelles entreprises par le biais de l’investissement sont toutefois limitées et ses
* Le présent article est inspiré d’une étude réalisée par Jolanda Hessels, d’EIM Business and Policy Research, aux Pays-Bas, consultante à la Division de l’investissement de l’OCDE. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.
232 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
répercussions du point de vue de la politique d’investissement demandent encore à être examinées systématiquement1.
Le présent article poursuit en conséquence un triple objectif. Premièrement, il vise à mieux situer, dans une perspective théorique, les forces qui sont à l’œuvre dans l’internationalisation des PME (section 2) en faisant un tour d’horizon des travaux spécialisés (section 3). Deuxièmement, il entend faire le point sur l’importance croissante et la structure de l’investissement international des PME et des nouvelles entreprises dans les pays de la zone OCDE, à l’aide des données statistiques disponibles (section 4). La section 5 éclaire ensuite les rapports entre la mondialisation et l’internationalisation des PME à partir d’une analyse des corrélations entre ces deux phénomènes. Troisièmement, l’article a pour but de dégager des quatre premières sections les conséquences de l’internationalisation des PME du point de vue de la politique d’investissement (section 6), qui seront développées et étayées à une étape ultérieure du projet.
Les principales constatations de la présente étude se résument comme suit :
• La mondialisation agit directement et indirectement sur l’internationalisation des PME. Son influence directe tient au fait qu’elle est susceptible d’aider les PME à accéder aux marchés étrangers et à tirer parti des débouchés qu’ils offrent. Son action indirecte s’exerce par le biais des liens qui se créent entre les entreprises multinationales (EMN) et les PME : renforcement des liens commerciaux, intensification de la concurrence et augmentation des retombées sur le plan des ressources humaines (section 2).
• D’après les travaux empiriques, l’internationalisation des PME obéirait à des motivations semblables à celles des EMN. Dans leurs décisions d’investissement, les petites entreprises sont cependant plus influencées que les grandes par les conditions qui prévalent dans les pays d’accueil. Elles sont également plus sensibles aux obstacles à l’investissement international (section 3.2).
• L’internationalisation d’une petite entreprise est un processus graduel comportant un certain nombre d’étapes au terme desquelles la présence sur les marchés étrangers, qui était faible au départ, se renforce. L’IDE est souvent l’étape ultime de l’internationalisation d’une entreprise. Le processus d’internationalisation a été formalisé dans des modèles dits « par étapes » et a donné lieu à une foule d’analyses empiriques visant à
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 233
déterminer si les facteurs d’internationalisation rapide (celle des entreprises mondiales par définition, qui s’internationalisent sitôt créées) diffèrent de ceux qui caractérisent l’internationalisation selon un rythme lent. Les auteurs de ces travaux soulignent un aspect intéressant, à savoir que la mondialisation semble modifier l’importance relative des facteurs qui déterminent l’investissement international des PME (section 3.3).
• Les données concernant l’internationalisation des PME proviennent principalement de trois sources – enquêtes ENSR pour les pays européens, fournisseurs de données exclusives et agences statistiques nationales -, mais il n’existe aucune source de données complètes et comparables internationalement sur l’IDE par taille d’entreprise. Enfin, les sources d’informations précitées comportent toutes des limites, mais permettent néanmoins de brosser un tableau réaliste de l’internationalisation des PME dans certains pays de l’OCDE (section 4).
• L’investissement international est le mode d’internationalisation le plus rarement utilisé par les PME. Dans la zone UE, 3 % seulement des PME détiennent un investissement direct à l’étranger, dont la valeur est généralement très modeste. Par exemple, en 2004, près de la moitié des PME néerlandaises qui ont investi à l’étranger ont engagé moins de 100 000 EUR. La part de PME qui recourent à l’IDE est plus importante en Corée et au Japon. On observe toutefois une tendance à la hausse du nombre de PME qui optent pour l’IDE, les coentreprises et les alliances stratégiques internationales (section 4.1).
• Parmi les pays sur lesquels des données sont disponibles – à savoir 18 pays d’Europe, le Japon, la Corée et la Nouvelle-Zélande – les PME qui recourent à l’IDE sont davantage concentrées dans le secteur manufacturier que dans celui des services et sont le plus souvent implantées dans un autre pays industrialisé situé à proximité de leur siège. Ces destinations sont généralement comparables à celles de l’IDE global. Deux pays font toutefois exception à cette règle, à savoir le Royaume-Uni, dont la part des PME qui investissent à l’étranger est relativement faible, et l’Italie, qui à l’inverse recueille une large part de l’IDE des PME européennes (section 4.1).
• Selon les PME des pays de l’UE, ce sont principalement les restrictions imposées par la législation et la réglementation qui les empêchent de recourir à l’IDE dans les pays européens. L’absence
234 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
de financement ou le manque de qualifications ou de compétences du personnel sont souvent invoqués comme obstacles. En outre, les PME qui souhaitent s’internationaliser par le biais de l’IDE ne se heurtent pas toutes à des obstacles. En effet, 40 % des PME européennes ne déclarent aucune restriction d’ordre interne et 29 %, aucun obstacle externe qui limiterait leurs initiatives en matière d’IDE (section 4.2).
• L’analyse des corrélations apporte un éclairage sur la manière dont plusieurs des liens présumés entre la mondialisation et l’internationalisation des PME, exposés à la section 2, sont corroborés par les faits stylisés présentés à la section 4. Mentionnons en particulier le lien observé entre les relations EMN-PME et l’internationalisation des PME. Il existe également une relation positive entre les indicateurs relatifs à la diffusion de la nouvelle technologie et l’internationalisation des PME, de même qu’entre cette internationalisation et l’ouverture à l’investissement international (section 5).
• La similarité des motivations et des facteurs déterminants l’utilisation de l’IDE par les PME et les EMN, mais aussi la sensibilité plus grande des PME aux obstacles qui pèsent sur les décisions d’investissement semblent indiquer qu’un cadre réglementaire complet et cohérent comme le Cadre d’action pour l’investissement est un instrument précieux d’évaluation des mesures destinées à attirer les flux d’IDE des PME et à favoriser leur expansion à l’étranger. La phase 2 du projet pourrait, à toutes fins utiles, consister à transposer l’outil de vaste portée qu’est le Cadre d’action pour l’investissement dans un ensemble spécifique de mesures adaptées aux PME dans le domaine de l’investissement et à examiner les données concernant les pratiques et les expériences des PME qui réussissent leur internationalisation (section 6).
2. Aperçu théorique des effets de la mondialisation sur l’internationalisation des PME par le biais de l’IDE
Avant de passer en revue les travaux spécialisés et les faits stylisés concernant l’internationalisation des PME, la présente section examine en détail la manière dont la mondialisation peut influencer l’internationalisation des PME par le recours à l’investissement étranger.
La mondialisation agit directement et indirectement sur l’internationalisation des PME. Son influence directe tient au fait qu’elle est
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 235
susceptible d’aider les PME à accéder aux marchés étrangers et à tirer parti des débouchés qu’ils offrent. Cette influence directe est liée à des facteurs relevant de l’action publique comme la réduction des obstacles à l’IDE, de même qu’aux progrès technologiques, qui accroissent et diversifient les débouchés en matière d’investissement international et permettent la formation de structures commerciales mondiales à la faveur de l’adoption de nouvelles technologies. Les progrès réalisés dans le domaine des technologies des réseaux d’information et de communications, par exemple, permettent à de nombreuses petites entreprises de services, qui auparavant ne pouvaient pas s’engager de manière rentable dans des activités internationales, d’investir à l’étranger et d’y former des coentreprises et des alliances.
La mondialisation peut aussi renforcer les liens entre les EMN et les PME et faciliter l’internationalisation des PME. Le rôle indirect de la mondialisation dans l’internationalisation des PME prend à cet égard des formes multiples (graphique 1)2. Premièrement, les liens commerciaux prennent la forme de relations avec les fournisseurs et les sous-traitants ou d’alliances stratégiques avec des EMN étrangères ou nationales. Ces liens aident les PME à surmonter les obstacles à l’entrée sur les marchés internationaux (Acs, Morck, Shaver et Yeung, 1997) en leur permettant par exemple d’y accéder et de s’y engager par le biais des canaux de distribution et des réseaux de filiales internationales des multinationales ou parfois, lorsque demande leur en est faite, d’accompagner des multinationales clientes sur des marchés étrangers3. De manière plus générale, les PME sont susceptibles de s’internationaliser, lorsqu’elles sont exposées aux activités internationales des multinationales, par effet de démonstration ou d’imitation (Wang et Blomström, 1992 ; Aitken et al., 1997, et Greenaway, Morgan et Wright, 2004). Les liens commerciaux peuvent également susciter des transferts de connaissances des EMN vers les PME. Ces transferts interviennent lorsque les EMN communiquent aux PME des informations sur les marchés étrangers qui, au fil du temps, facilitent l’entrée des PME elles-mêmes sur ces marchés (Blomström et Kokko, 1998, et De Clercq, Hessels et van Stel, 2006).
236 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Graphique 8.1. Les liens entre EMN et PME favorisent l’internationalisation des PME
Liens commerciaux
Internationalisation des PME
Intensification de la concurrence
Effets sur la formation etsur le capital humaint
++
+
Source : EIM, 2007.
L’intensification de la concurrence est le deuxième lien entre EMN et PME qui influe sur l’internationalisation des PME. La mondialisation accroît la concurrence sur le marché intérieur, par exemple lorsque des EMN y accèdent, ainsi que sur les marchés étrangers (Etemad, 2005). Cela peut inciter les PME à devenir plus compétitives et à envisager de s’engager hors des marchés nationaux (Barrell et Pain 1997 ; Cantwell, 1989 ; Chuang et Lin 1999 ; Glass and Saggi, 1998). Bref, les PME peuvent tirer parti des nouveaux débouchés offerts par la mondialisation en prenant elles-mêmes les devants ou encore en réagissant a posteriori à la concurrence plus robuste des entreprises étrangères (De Clercq, Hessels et van Stel, 2006).
Les retombées sur le plan des ressources humaines sont le troisième lien entre EMN et PME qui agit indirectement sur l’internationalisation des PME. Elles correspondent aux compétences qu’acquièrent les salariés lorsqu’ils travaillent pour une EMN et qu’ils mettent à profit lorsqu’ils décident de créer leur propre entreprise ou de travailler pour une PME. Par exemple, un dirigeant de filiale étrangère peut retourner travailler pour une PME dans son pays d’origine ou décider d’utiliser son expérience acquise à l’étranger pour créer une nouvelle entreprise et devenir ainsi un entrepreneur tourné vers l’international (Fosfuri, Motta et Rønde, 2001 ; Cantwell et Hodson, 1991 ; De Clercq, Hessels et van Stel, 2006).
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 237
3. Le moteur de l’internationalisation des PME : tour d’horizon des travaux sur la question
3.1. Modes d’internationalisation des PME
Les PME peuvent s’intégrer davantage à l’économie mondiale par divers moyens (tableau 1 et OCDE, 1997). Ces moyens concernent les activités d’entrées/sorties que mènent les PME et dont les plus importantes sont la création de liens commerciaux. L’internationalisation des PME peut également s’effectuer par le biais de l’investissement direct, qui souvent complète les activités commerciales. Il arrive aussi que les PME coopèrent avec des partenaires commerciaux sur les marchés internationaux sans toutefois acquérir des entreprises étrangères. Cette coopération peut prendre la forme d’une participation à une alliance stratégique, à une coentreprise ou à un accord de licence à l’échelle internationale. Elle est souvent classée dans la catégorie des modes d’internationalisation relevant de la création de liens. En général, les PME qui veulent s’internationaliser choisissent davantage la création de liens que l’IDE, du moins au début (Buckley, 1997, et Hollenstein, 2005).
Tableau 8.1. Modes d’internationalisation des PME
Activité commerciale internationale
Description
Sorties Exportation indirecte Commercialisation de biens ou de services auprès de
clients étrangers par le biais d’intermédiaires tels que des mandataires, des distributeurs indépendants et des sociétés de courtage
Exportation directe Commercialisation de biens ou de services auprès de clients étrangers sans l’intervention d’un intermédiaire
Investissement direct étranger - Création de nouvelles installations à l’étranger
Implantation d’une nouvelle filiale à l’étranger
- Acquisition à l’étranger Obtention du contrôle d’une société à l’étranger par l’acquisition de la totalité ou la majorité de ses actions en circulation, ou de ses actifs
- Fusion transnationale Formation d’une seule entité économique avec une ou plusieurs entreprises à l’étranger
- Coentreprise transnationale Conclusion d’un accord en vue de créer une nouvelle entité à l’étranger avec une ou plusieurs parties. Toutes les parties participent au capital et partagent les bénéfices, les pertes et le contrôle de l’entreprise. L’initiative peut se limiter à un projet spécifique ou viser une relation commerciale durable.
Entrées Importation indirecte Acquisition de biens ou de services auprès d’un fournisseur
étranger par le biais d’intermédiaires tels que des mandataires, des distributeurs indépendants et des sociétés de courtage.
Importation directe Acquisition de biens ou de services auprès d’un fournisseur
238 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
étranger sans l’intervention d’un intermédiaire Établissement de liens Alliance transnationale formelle : - Alliance stratégique transnationale
Relation de coopération avec une ou plusieurs entreprises étrangères indépendantes fondée sur des contrats élaborés en vue d’améliorer les stratégies concurrentielles des parties concernées
- Accord de licence Conclusion avec une partie étrangère d’un accord relatif à l’obtention ou à la concession d’une licence accordant l’autorisation légale d’exploiter un brevet, une marque de commerce ou une technologie
Alliance transnationale informelle
Coopération avec une ou plusieurs entreprises étrangères menée sans contrat ou accord écrit formel.
Source : EIM, 2007.
En matière d’internationalisation, entrées et sorties sont interdépendantes, comme en témoigne le fait que les activités de la majorité des entreprises sont bidirectionnelles (entrées et sorties) (Fletcher, 2001). L’exportation peut également constituer la première étape de l’investissement direct étranger, étant donné que les liens commerciaux concourent au développement des contacts commerciaux qui peuvent faciliter le resserrement des liens, par exemple le partenariat dans le cadre de l’investissement direct (Buckley, 1988).
Le processus d’internationalisation des PME a été formalisé dans des modèles d’internationalisation par étapes. Parmi les plus connus, citons le modèle d’Uppsala (voir par exemple, Johanson et Vahlne, 1977 ; 1990 ; Eriksson, Johanson, Maijkgard et Sharma, 1997). Selon le modèle d’Uppsala, l’internationalisation d’une entreprise est un processus graduel qui se déroule suivant un certain nombre d’étapes de développement, et qui permet de renforcer sa présence sur des marchés étrangers. L’IDE correspond à la dernière étape de l’internationalisation d’une entreprise.
L’une des prédictions du modèle d’Uppsala est que les entreprises peuvent commencer à s’internationaliser en menant des activités qui supposent de faibles niveaux de risque et d’engagement de ressources. À mesure que les entreprises acquièrent de l’expérience et de la confiance, elles renforcent leurs activités à l’étranger, par exemple dans le domaine de la production (Coviello et McAuley, 1999). De plus, lorsqu’elles se lancent dans des activités à caractère international, les PME amorcent un processus d’apprentissage dans lequel leur perception des obstacles évolue progressivement (OCDE, 2006b). Certains analystes contestent cette opinion et soulignent que de plus en plus de nouvelles entreprises, dites « mondiales par définition », effectuent d’entrée de jeu des investissements internationaux. (Rennie, 1993 ; Knight et Cavusgil, 1996,Oviatt et McDougall, 1994). Cependant, il n’y a pas nécessairement d’opposition entre les modèles qui décrivent un processus d’internationalisation
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 239
par étapes et l’existence d’entreprises dont la vocation mondiale était évidente au départ. En effet, l’internationalisation des entreprises mondiales par définition est sans doute progressive également, mais elle est très rapide (Commission européenne, 2004). En outre, ces entreprises ne sont pas nécessairement représentatives de la majorité des PME parce qu’elles exploitent généralement des niches.
3.2. Les facteurs d’internationalisation des PME
De nombreux travaux spécialisés sont consacrés aux moteurs de l’internationalisation des PME (un tour d’horizon est présenté dans l’encadré 1 et le tableau 2.) Ces moteurs se divisent en trois catégories :
• Facteurs spécifiques aux dirigeants/à l’entrepreneur. En général, plus l’entrepreneur est âgé et plus son niveau d’instruction est élevé, plus la PME est susceptible d’avoir des activités internationales (Westhead, 1995 et Simpson et Kujawa, 1974). Le degré d’expérience des affaires à l’étranger et la connaissance de lois, normes, règles et langues étrangères expliquent également l’internationalisation des PME (Eriksson, Johanson, Majkgard et Sharma, 1997).
• Facteurs spécifiques à l’entreprise ou à l’organisation. La grande taille d’une PME (Chetty et Hamilton, 1993 ; Westhead, 1995 ; Lefebvre et Lefebvre, 2002 et Hollenstein, 2005) et le caractère unique de son produit (Cavusgil et Nevin, 1981 ; Akoorie et Enderwick, 1992) déterminent également son internationalisation. L’assise technologique d’une entreprise est également un moteur de l’internationalisation. Elle englobe, par exemple, la présence d’activités de R-D (Lefebvre et Lefebvre, 2002) et l’intensité de technologie de l’entreprise (Cavusgil et Nevin, 1981). L’intérêt démontré par l’entreprise pour l’internationalisation, qui se manifeste par l’exploration systématique des débouchés qui s’offrent à l’étranger (Cavusgil et Nevin, 1981 ; Cavusgil, 1984), ainsi que la volonté de tirer parti de ces débouchés jouent également un rôle dans l’internationalisation des PME (Rosson et Ford, 1982 ; Bello et Barksdale, 1986).
• Facteurs extérieurs. Ces facteurs concernent les stimulations extérieures, comme l’aide publique aux échanges et à l’investissement (Requena-Silvente, 2005 ; Wilkinson, 2006), ainsi que les obstacles extérieurs tels que le degré de concurrence à l’étranger et le cadre réglementaire (Thirkell et Dau, 1998), le niveau et l’évolution des coûts de production (Axinn, 1988) et le degré d’instabilité politique sur les marchés étrangers (Leonidou, 2004).
240 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Encadré 8.1. L’étude réalisée par l’OCDE en 1997 sur les PME et la mondialisation
Entre 1994 et 1996, le Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat a menéune étude approfondie sur la mondialisation des PME. L’étude a fait ressortir les points suivants :
Les principaux effets de la mondialisation sont :
– d’entraîner des changements structurels et d’améliorer l’efficacité des marchés et des PME ; et
– d’accroître la compétitivité des entreprises et d’élargir leurs débouchés, en particulier dans le cas des PME adaptables et compétitives au plan international.
Les principaux facteurs contribuant à la mondialisation accrue des PME sont :
Au niveau macroéconomique :
– l’émergence des marchés communs ou de marchés ouverts et la réduction des barrières protectionnistes ;
– la mondialisation accrue des grandes entreprises dans des secteurs bien déterminés (tels que l’automobile, l’informatique, etc.) qui ont des relations de sous-traitance avec les PME ;
– l’intensification des échanges mondiaux et de l’investissement étranger ;
– la mobilité accrue du capital, de la technologie et de la gestion ; et
– les mouvements monétaires accrus qui ont modifié la compétitivité relative des différentes économies.
Au niveau micro-économique :
– l’évolution de la technologie, des communications et des modes d’organisation qui rendent les PME internationales plus compétitives ;
– les possibilités accrues pour les PME de se constituer en partie leur valeur ajoutée à l’étranger parce que les coûts sont moindres ou pour d’autres raisons ; et
– l’évolution des attitudes et des compétences en matière de gestion.
Les pressions dans le sens de la mondialisation s’exercent sur les PME par divers mécanismes qui dépendent du contexte industriel et économique :
– les importations et la concurrence au niveau des importations aussi bien directes qu’indirectes apparaissent manifestement comme un des moyens par lesquels ces pressions s’exercent dans toutes les économies.
– la concurrence d’autres entreprises plus internationalisées implantées aussi bien sur place qu’à l’étranger.
– les besoins des consommateurs dans la mesure où en s’internationalisant, ceux-ci attendent de leurs fournisseurs la même évolution. Les PME des secteurs bancaire et tertiaire, par exemple, sont particulièrement touchées.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 241
– les besoins des grandes entreprises, et en particulier des industries, qui ont besoin de sous-traitants pour être compétitives au plan mondial.
– les alliances, coentreprises, etc. avec une autre entreprise qui débouchent sur une approche plus mondiale des nouveaux débouchés, des méthodes de production et de la stratégie en général. C’est en particulier le cas en Europe où les PME ont largement eu recours à ces alliances pour faire face à la mondialisation ; cette même stratégie a été adoptée par les PME japonaises qui se sont implantées en Asie.
– les conventions et normes internationales (concernant par exemple l’environnement, l’énergie, les normes de qualité, etc.) qui contraignent les petites entreprises à se conformer à de nouveaux règlements mais qui leur ouvrent également de nouveaux marchés internationaux si elles respectent ces règlements.
Source : OCDE (1997).
Tableau 8.2. Vue d’ensemble des études portant sur les facteurs d’internationalisation des PME
Facteur/Thème Auteurs Échantillon Analyse / méthode statistique
Constatation concernant le facteur / le thème
Facteurs concernant le dirigeant/l’entrepreneur
Facteurs démographiques :
- Âge Westhead (1995)
267 propriétaires-dirigeants de petites entreprises de fabrication et de services de production du Royaume-Uni (203 entreprises non exportatrices et 64 entreprises exportatrices) (enquête postale réalisée en 1989)
Analyse à une seule variable et analyse logit à plusieurs variables
Les exportateurs sont notablement plus âgés que les non-exportateurs lorsqu’ils lancent leur entreprise (l’âge moyen des exportateurs est 41 ans et celui des non-exportateurs, 34 ans.
- Éducation Simpson et Kujawa (1974)
50 décideurs d’entreprises exportatrices et 70 décideurs d’entreprises non exportatrices
Test de Kolmogorov-Smirnov sur deux échantillons et comparaison de la moyenne
Les exportateurs tendent à avoir un niveau d’éducation supérieur à celui des non- exportateurs.
242 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Facteur/Thème Auteurs Échantillon Analyse / méthode statistique
Constatation concernant le facteur / le thème
implantées dans le Tennessee (entretiens personnels effectués en 1972)
pondérée des réponses des entreprises exportatrices et des entreprises non exportatrices
Exposition aux échanges internationaux et expérience des affaires au niveau international
- Expérience des affaires à l’étranger
Eriksson, Johanson,Majkgard et Sharma (1997)
362 entreprises suédoises du secteur des services
LISREL (modélisation en équations structurelles)
Les coûts de l’internationalisation sont perçus par l’entreprise comme étant d’autant plus élevés que celle-ci a une faible connaissance des concurrents, des clients et des marchés étrangers.
- Connaissance des institutions étrangères
Eriksson, Johanson,Majkgard et Sharma (1997)
362 entreprises suédoises du secteur des services
LISREL (modélisation en équations structurelles)
Les coûts de l’internationalisation sont perçus comme étant d’autant plus élevés que la connaissance de la loi, des normes, des règles et de la langue des marchés étrangers est faible.
Méthode de gestion :
- Gestion axée sur la planification
Cavusgil (1984)
175 PME exportatrices du secteur manufacturier du Wisconsin
Analyse de classification multiple et détection automatique d’interaction
Tous les exportateurs actifs ont recours à la planification.
Facteurs spécifiques à l’entreprise/à l’organisation
Caractéristiques de base de l’entreprise :
-Taille Chetty et Hamilton (1993)
Examen de 29 études empiriques menées dans différentes
Analyse d’un certain nombre de constatations non significatives,
17 des 29 études font état d’une association significativement positive entre la
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 243
Facteur/Thème Auteurs Échantillon Analyse / méthode statistique
Constatation concernant le facteur / le thème
régions – Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe – qui portaient sur la relation entre la taille d’une entreprise et ses résultats à l’exportation
significativement positives et significativement négatives
taille de l’entreprise et ses résultats à l’exportation.
Westhead (1995)
Échantillon aléatoire de 267 entreprises du secteur manufacturier et des services aux entreprises du Royaume-Uni (203 entreprises non- exportatrices et 64 entreprises exportatrices)
Analyse à une seule variable
La probabilité qu’une entreprise soit exportatrice est d’autant plus grande que sa taille est importante en termes d’effectifs et de chiffre d’affaires.
Lefebvre et Lefebvre (2002)
Base de données sur 3 032 entreprises manufacturières américaines et ayant un effectif de moins de 500 salariés en 1994 (recensées dans la base de données en 1994 et en 1997).
Modèles probit et tobit
La taille de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires annuel et d’effectif influe significativement sur la probabilité que celle-ci exporte et sur ses résultats à l’exportation (pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur les marchés étrangers).
- La nature du produit
Cavusgil et Nevin (1981)
Échantillon de 473 dirigeants d’entreprises manufacturières implantées dans le Wisconsin (enquête postale)
Analyse statistique en deux étapes – détection automatique d’interaction et analyse de classification multiple
Le fait de posséder un produit unique est positivement corrélé à l’intérêt manifesté par une entreprise pour les activités d’exportation.
Akoorie et Enderwic
Échantillon de 252 sociétés
Analyse des réponses au
Le fait de posséder un produit nouveau
244 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Facteur/Thème Auteurs Échantillon Analyse / méthode statistique
Constatation concernant le facteur / le thème
k (1992) néo-zélandaises, principalement des petites entreprises ayant un effectif de moins de 200 salariés (enquête postale)
questionnaire de l’enquête
ou unique revêt une grande importance pour la décision initiale de s’internationaliser.
Assise technologique :
- Activités de R-D Lefebvre et Lefebvre (2002)
Base de données sur 3 032 entreprises manufacturières américaines ayant un effectif de moins de 500 salariés en 1994 (recensées dans la base de données en 1994 et en 1997).
Modèles probit et tobit
La probabilité qu’une entreprise exporte et ses résultats à l’exportation (pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur les marchés étrangers) sont dans une large mesure déterminés par la présence d’activités de R-D.
- Intensité de technologie
Cavusgil et Nevin (1981)
Échantillon de 473 dirigeants d’entreprises manufacturières implantées dans le Wisconsin (enquête postale)
Analyse statistique en deux étapes – détection automatique d’interaction et analyse de classification multiple
L’intensité de technologie d’une entreprise est un facteur significatif de son comportement en matière d’exportation.
Intérêt manifesté à l’égard de l’internationalisation :
- Exploration systématique des marchés étrangers/élaboration d’une stratégie d’exportation
Cavusgil et Nevin (1981)
Échantillon de 473 dirigeants d’entreprises manufacturières implantées dans le Wisconsin (enquête postale)
Analyse statistique en deux étapes – détection automatique d’interaction et analyse de classification multiple
L’exploration systématique des marchés et l’élaboration d’une stratégie en matière d’exportation jouent un rôle important dans la volonté d’exporter des entreprises.
Cavusgil (1984)
175 PME du secteur
Analyse de classification
La plupart des entreprises qui ont
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 245
Facteur/Thème Auteurs Échantillon Analyse / méthode statistique
Constatation concernant le facteur / le thème
manufacturier implantées dans le Wisconsin
multiple et détection automatique d’interaction
des activités d’exportation explorent systématiquement les marchés étrangers et sont dotées d’une stratégie en matière d’exportation.
- Intérêt porté à l’expansion commerciale à l’étranger
Rosson et Ford (1982)
21 entreprises canadiennes du secteur manufacturier et 21 entreprises de distribution du Royaume-Uni (entretiens personnels)
Analyse de corrélation
La manifestation d’un intérêt pour l’expansion commerciale sur des marchés étrangers (en termes d’intensité des contacts et des moyens mis en œuvre) est corrélée positivement aux résultats à l’exportation.
Facteurs extérieurs
Incitations extérieures :
- Aide publique Requena-Silvente (2005)
Un panel de 1 679 PME (effectif inférieur à 250 salariés) du Royaume-Uni comportant sept observations annuelles échelonnées de 1992 à 1998
Modèle probit dynamique
La dépendance vis-à-vis de l’État joue un rôle important dans la décision d’exporter et le maintien des activités d’exportation.
Wilkinson (2006)
114 missions commerciales à l’étranger appuyées par l’État
Analyse de régression
On constate une relation positive entre les dépenses consacrées aux missions commerciales et les exportations.
- Facteurs liés au marché étranger
Thirkell et Dau (1998)
253 exportateurs néo-zélandais du secteur manufacturier (enquête postale)
Régression multiple
Lorsque les entreprises perçoivent l’existence d’une concurrence plus serrée à l’étranger, elles renforcent
246 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Facteur/Thème Auteurs Échantillon Analyse / méthode statistique
Constatation concernant le facteur / le thème
leurs activités de commercialisation, ce qui améliore (de leur propre avis) leurs résultats à l’exportation.
- Facteurs liés au marché national
Axinn (1988)
Échantillon de dirigeants de sociétés de machines-outils implantées dans l’Ontario (21) et le Michigan (81) ; enquête postale
Analyse des résultats de l’enquête fondée sur des indices à variables multiples
La perception qu’ont les dirigeants de la diminution des prix de production influence favorablement les activités d’exportation.
Obstacles externes :
- par exemple, absence d’aide publique et instabilité sur les marchés étrangers
Leonidou (2004)
32 études empiriques sur les obstacles aux exportations
Examen d’études empiriques
Ce document analyse les travaux de recherche empiriques sur les obstacles à l’exportation. En ce qui concerne les obstacles externes, il montre par exemple que l’absence d’aide publique à l’exportation dans le pays d’origine a un impact négatif modéré sur les activités d’exportation et que l’instabilité politique sur les marchés étrangers a un très fort impact.
Source : EIM, 2007.
Bon nombre des travaux synthétisés au tableau 2 s’intéressent à l’internationalisation par le biais des relations commerciales. Certains auteurs ont toutefois tenté d’examiner comment le paradigme OLI (spécificité, localisation et internalisation) (Dunning, 1993) peut expliquer l’internationalisation des PME par le biais de l’IDE4. Hollenstein (2005), par exemple, conclut à la pertinence de ce paradigme à partir de l’examen d’un échantillon composé de 2 424 grandes et petites entreprises suisses. Ses constatations semblent indiquer que les avantages spécifiques s’équivalent pour
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 247
les grandes comme les petites entreprises en tant que facteurs d’investissement direct international, et que les avantages liés à la localisation (salaires et cadre réglementaire) revêtent relativement plus d’importance dans le cas de l’investissement international des petites entreprises. Buckley (1997) constate également que les raisons qui incitent les PME à s’internationaliser par le biais de l’investissement ne diffèrent pas de celles mises en avant par les EMN. Kuo et Li (2003), remarquent toutefois, dans leur échantillon de PME du Taipei chinois, que la volonté d’emboîter le pas aux principaux clients est également une raison qui incite les PME à investir à l’étranger.
Bien que les PME et les EMN s’internationalisent pour les mêmes raisons, les petites entreprises sont plus sensibles que les grandes aux conditions qui prévalent dans les pays d’accueil lorsqu’elles prennent leurs décisions en la matière. Par exemple, dans une analyse des PME japonaises, Urata et Kawai (2000) constatent que l’accès à une main-d’œuvre à bas salaire, à une infrastructure développée et à des agglomérations industrielles sont des critères auxquels les PME attachent beaucoup plus d’importance que les grandes entreprises dans leurs décisions en matière d’IDE. En outre, les petites entreprises sont plus sensibles que les grandes aux obstacles à l’investissement international. Elles ne disposent en général pas des ressources ni des compétences administratives et financières nécessaires pour pénétrer les marchés internationaux (Hollenstein, 2005 et Kuo et Li, 2003) et courent en conséquence un risque d’échec plus grand que les grandes entreprises solidement implantées (Coviello et McAuley, 1999).
3.3. Les facteurs d’internationalisation précoce
L’influence des modèles qui décrivent l’internationalisation des PME comme étant un processus par étapes et les controverses qu’ils suscitent ont donné lieu à une foule d’analyses empiriques, constituées pour la plupart d’études de cas effectuées dans le but d’identifier les facteurs spécifiques de l’internationalisation précoce (le tableau 3 présente une vue d’ensemble de ces études.) Ces études définissent l’internationalisation à un stade précoce comme « un processus rapide d’expansion internationale sitôt l’entreprise créée, suivant différents modes d’entrée sur plusieurs marchés » (Jones et Coviello, 2005).
L’une des principales questions examinées consiste à savoir si les facteurs d’internationalisation précoce valent également dans les autres situations et si la spécialisation croissante et l’émergence de niches internationales modifient l’importance relative de ces facteurs. Les principales conclusions de ces travaux sont les suivantes :
248 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
• En ce qui concerne les PME existantes, l’activité d’exportation est le mode le plus courant d’internationalisation précoce des nouvelles entreprises (Zahra, Neubaum et Huse, 1997).
• Un éventail de facteurs liés à l’environnement général des entreprises incitent celles-ci à s’internationaliser rapidement. Ces facteurs sont notamment l’ouverture et l’intégration plus poussée des marchés (voir par exemple, Ohmae, 1990 ; 1995 ; Rennie, 1993 ; Fraser et Oppenheim, 1997), que favorisent les innovations technologiques, en particulier dans les secteurs de l’information et des communications ainsi que des transports (Oviatt et McDougall, 1994 ; Knight et Cavusgil, 1996 ; Fraser et Oppenheim, 1997, et Bloodgood, Sapienza et Almeida, 1996).
• Les facteurs qui sous-tendent la tendance à la spécialisation et aux niches favorisent l’internationalisation et réduisent certains des obstacles qui l’entravent (Knight et Cavusgil, 1996 ; Madsen et Servais, 1997). Par exemple, en ce qui concerne les incitations, le fait qu’une entreprise détienne l’exclusivité d’une technologie, d’un procédé ou de compétences de gestion a été valorisé par l’ouverture et l’accessibilité plus grandes des marchés internationaux (Roberts et Senturia, 1996 ; Keeble, Lawson, Smith, Moore et Wilkinson, 1998 ; Autio, Sapienza et Almeida, 2000). De même, la mondialisation a réduit les cycles de vie des produits, tandis que les activités de R-D sont de plus en plus organisées sur une base internationale. Les entreprises s’intéressent en conséquence aux niches pour profiter d’économies d’échelle, couvrir les coûts de R-D (Knight et Cavusgil, 1996 ; Keeble, Lawson, Smith, Moore et Wilkinson, 1998) et avoir davantage de partenaires dans des réseaux internationaux (Oviatt et McDougall, 1995 ; Coviello et Munro, 1995). Toutes ces tendances incitent les entreprises à s’internationaliser précocement.
• La mondialisation semble également modifier l’importance relative des facteurs d’internationalisation. Les compétences du personnel et l’expérience des affaires à l’échelle internationale des dirigeants et des créateurs de nouvelles entreprises sont maintenant considérées comme des facteurs particulièrement importants d’internationalisation « précoce » (Bloodgood, Sapienza et Almeida, 1996). Le rythme accéléré de l’internationalisation des nouvelles entreprises comparativement à celui des PME existantes reflète en partie le fait que les créateurs ont souvent acquis les compétences et les qualifications requises lorsqu’ils travaillaient dans des entreprises bien implantées, tournées vers l’international (McDougall et al., 1994).
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 249
Tableau 8.3. Vue d’ensemble des études concernant les facteurs d’internationalisation précoce des PME
Facteur/thème Auteur Échantillon Méthode/analyse statistique
Constatation relative au facteur/au thème
Facteurs liés spécifiquement à la gestion/à l’entrepreneur
Expérience internationale
Oviatt et McDougall (1995)
12 nouvelles entreprises internationales implantées aux États-Unis (5), au Royaume-Uni (3), en Allemagne (2),en France (1) et en République tchèque (1)
Analyse d’une étude de cas
L’expérience internationale est un facteur de réussite important pour les nouvelles entreprises.
Bloodgood, Sapienza et Almeida (1996)
61 nouvelles entreprises américaines
Régression L’expérience de travail internationale est positivement corrélée à l’internationalisation.
Perspective mondiale
Oviatt et McDougall (1995)
12 nouvelles entreprises internationales implantées aux États-Unis (5), au Royaume-Uni (3), en Allemagne (2) en France (1) et en République tchèque (1)
Analyse d’une étude de cas
Une perspective mondiale d’entrée de jeu est indispensable à la réussite d’une nouvelle entreprise mondialisée.
Facteurs spécifiques à l’entreprise/à son mode d’organisation
Motivations nécessaires
McDougall et Oviatt (1991)
4 nouvelles entreprises internationales implantées aux Etats-Unis
Analyse d’une étude de cas
Les besoins de ressources et de financement, l’importance du marché et l’inertie locale font partie des facteurs qui stimulent les nouvelles entreprises internationales.
Base de ressources d’une entreprise
- Assise technologique
Keeble, Lawson, Smith, Moore et Wilkinson, (1998)
100 entreprises implantées au Royaume-Uni dans les régions de Cambridge et d’Oxford
Analyse d’une étude de cas et entretiens détaillés
Les PME à forte intensité de technologie doivent souvent s’internationaliser très tôt.
Roberts et Senturia
19 sociétés de fabrication de
Entretiens détaillés
Les petites sociétés qui fournissent des
250 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Facteur/thème Auteur Échantillon Méthode/analyse statistique
Constatation relative au facteur/au thème
(1996) produits de haute technologie (pour ordinateurs de bureau) dans le Massachusetts
produits pour ordinateurs de bureau peuvent s’internationaliser plus rapidement que ce que les modèles classiques de l’internationalisation prévoient et c’est ce qu’elles font.
Autio, Sapienza et Almeida (1996)
Données de panel de 59 entreprises finlandaises du secteur électronique pour la période 1992-1997
Régression La plus forte intensité de connaissances est associée à une plus grande croissance internationale.
- Caractère unique des connaissances
Oviatt et McDougall (1995)
12 nouvelles entreprises implantées aux États-Unis (5), au Royaume-Uni (3), en Allemagne (2), en France (1) et en République tchèque (1)
Analyse d’une étude de cas
Le caractère unique des connaissances est un atout incorporel essentiel pour les nouvelles entreprises.
- Association avec des partenaires dans un réseau international
Oviatt et McDougall (1995)
12 nouvelles entreprises implantées aux États-Unis (5), au Royaume-Uni (3), en Allemagne (2), en France (1) et en République tchèque (1)
Analyse d’une étude de cas
L’association à des réseaux internationaux explique la réussite des nouvelles entreprises internationales.
Coviello et Munro (1995)
4 entreprises de logiciels néo-zélandaises (étude de cas détaillée) et 21 entreprises néo-zélandaises exportatrices de logiciels (enquête postale)
Analyse d’une étude de cas et d’une enquête
L’association à un réseau international permet aux entreprises de s’internationaliser rapidement.
Facteurs externes
Conditions propres au secteur :
- Nature McDougall 160 nouvelles Analyse de Par rapport aux
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 251
Facteur/thème Auteur Échantillon Méthode/analyse statistique
Constatation relative au facteur/au thème
compétitive au plan international du secteur concerné
(1989) entreprises des secteurs de la fabrication de matériel informatique et des communications implantées aux États-Unis. L’échantillon comprend des nouvelles entreprises internationales et nationales.
variance simple (ANOVA) et construction de matrices de classification
nouvelles entreprises nationales, les nouvelles entreprises internationales entrent en concurrence dans des secteurs où la concurrence internationale est plus vive.
Facteurs propres au marché intérieur :
- Petite taille du marché d’origine
Rasmussan, Madsen et Evangelista (2001)
2 entreprises danoises et 3 entreprises australiennes mondiales par définition
Analyse d’une étude de cas
L’internationalisation est parfois nécessaire lorsque le marché d’origine du produit est inexistant ou de petite taille
Coviello et Munro (1995)
4 entreprises de logiciels néo-zélandaises (étude de cas détaillée) et 21 entreprises néo-zélandaises exportatrices de logiciels (enquête postale)
Analyse d’une étude de cas et d’une enquête
Un marché intérieur limité incite les entreprises à prendre rapidement de l’expansion à l’étranger.
Source : EIM, 2007.
4. Bilan des faits stylisés concernant l’internationalisation des PME par le biais de l’IDE
La présente section vise à présenter les principales évolutions et les faits stylisés qui illustrent la relation entre la mondialisation et l’internationalisation des PME par le biais de l’investissement international. Elle examine l’importance de l’IDE des PME, sa répartition géographique et sectorielle ainsi que des données d’enquête sur les obstacles à l’internationalisation des PME. Elle est nécessairement sélective et limitée en termes de pays couverts étant donné la rareté des statistiques comparatives internationales sur l’IDE par taille d’entreprises.
252 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Trois sources principales de données apportent un éclairage sur l’internationalisation des PME par le biais de l’IDE5.
• La première source de données, sur laquelle repose essentiellement la présente étude, est l’Enquête ENSR 20036, qui est menée auprès d’entrepreneurs et de dirigeants de PME comptant moins de 250 salariés. Les données contiennent des informations sur l’IDE et les activités de coopération internationale de PME de 19 pays d’Europe, à savoir l’UE-15, la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein. Quelque 8 000 PME participent à l’Enquête ENSR7.
• La deuxième source de données est celle des fournisseurs de données exclusives comme Deal Logic, Thomson Financial et Bloomberg. Ces sociétés administrent des données sur les fusions et acquisitions transnationales, de même que sur les alliances internationales auxquelles participent des PME. La définition d’une PME est en général fondée sur le nombre de salariés ou sur un seuil de capitalisation, habituellement en deçà de 5 millions USD. Ces sources tendent à sous-estimer la signification de l’IDE des PME étant donné qu’une bonne partie des données qu’elles fournissent proviennent d’articles de journaux annonçant des fusions et de communiqués émis par des sociétés qui concernent surtout des grandes entreprises.
• La troisième source est constituée d’agences statistiques et d’associations de petites entreprises. Ces dernières offrent un ensemble éclectique de statistiques qui ne sont pas comparables internationalement étant donné que les concepts mesurés et les méthodes de collecte ne sont pas les mêmes. Ces statistiques brossent toutefois un portrait réaliste de l’internationalisation des PME dans certains pays de l’OCDE et sont en conséquence citées dans la présente étude lorsque les données sont disponibles.
4.1 Quel est le degré d’activité des PME en matière d’investissement international ?
L’investissement international n’est pas le mode d’internationalisation le plus fréquent des PME. En moyenne, dans les 19 pays de l’UE sur lesquels des données sont disponibles, seulement 3 % des PME européennes sont engagées dans des activités d’investissement international, c’est-à-dire qu’elles possèdent des filiales, des succursales et/ou des coentreprises à l’étranger8. La situation diffère toutefois considérablement selon les pays. En Islande, au Danemark et en Suisse, l’investissement international des PME, représente plus du double de la moyenne pour la région alors qu’en Italie, en Autriche, en France, en Suède et en Allemagne il s’établit à 2 % ou moins (graphique 8.2). En outre, et cela
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 253
correspond à la faiblesse de l’IDE effectué par les PME, la grande majorité des sociétés-mères de PME en Europe ne possède qu’une ou deux filiales à l’étranger (Conseil de l’Union européenne, 2006).
Graphique 8.2. Les investissements internationaux des PME européennes sont très variables
(Pourcentage de PME possédant des filiales/des succursales/des coentreprises à l’étranger, 2003)
0
2
4
6
8
10
12
Italy
Austri
a
Franc
e
Sweden
Germ
any
Nethe
rland
s
Spain
United
Kingdo
m
Belgium
Greec
e
Portu
gal
Finlan
d
Irelan
d
Norway
Luxe
mbo
urg
Switzer
land
Denm
ark
Icelan
d
Avera
ge
Traduction des légendes Italie Autriche France Suède Allemagne Pays-Bas Espagne Royaume-Uni Belgique Grèce Portugal Finlande Irlande Norvège Luxembourg Suisse Danemark Islande Moyenne
Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
Il y a peu de détails sur les filiales étrangères des PME des autres pays de l’OCDE. D’après les données limitées réunies récemment, il ressort que :
• En Corée, 38 % des PME9 ont effectué des investissements internationaux, soit plus du double du pourcentage enregistré en 2000 (OCDE, 2004). Cela correspond largement aux données de l’Eximbank, selon lesquelles le nombre de projets d’investissement à l’étranger des PME a presque doublé entre 2000 et 2006, pour s’établir à 2 00510.
• Au Japon également, de plus en plus de PME11 investissent dans des filiales à l’étranger12. Entre 1992 et 2003, la proportion de PME japonaises possédant des filiales à l’étranger a quasiment doublé et est
254 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
maintenant de 11 % (JSBRI, 2004 et 2005)13. Le nombre moyen de filiales est toutefois faible ; les PME de moins de 300 salariés possèdent environ 1.8 filiale comparativement à 2.3 pour les entreprises de plus de 300 salariés (JSBRI, 2004). Selon d’autres données sur les filiales étrangères de PME japonaises, le nombre d’entreprises indépendantes augmente alors que celui des coentreprises diminue (JSBRI, 2004). Pendant la période 1994-1998, environ la moitié de l’IDE imputable aux PME était le fait d’entreprises indépendantes et l’autre moitié, de coentreprises. Cependant, au cours de la période 1999-2003, 66 % de l’IDE effectué par les PME provenait d’entreprises indépendantes et 34 %, de coentreprises.
• En Nouvelle-Zélande, l’enquête sur les activités des entreprises (Business Operations Survey) classe les PME en fonction du nombre de salariés. Selon cette enquête, 2 % des entreprises de 6 à 49 salariés, 7 % des entreprises de 50 à 99 salariés et 11 % des entreprises de plus de 100 salariés détiennent une participation dans des entreprises à l’étranger14.
• En ce qui concerne les États-Unis, le Canada et l’Australie, le consultant a indiqué que ces pays ne publient pas de statistiques officielles sur l’investissement direct étranger par taille de société-mère ou qu’il n’y a pas de statistiques sur cette question provenant d’autre sources, par exemple d’associations de PME.
Certains spécialistes des investissements estiment que les PME sont davantage portées à s’engager dans des modes non contractuels de coopération internationale que dans une relation formelle d’investissement direct à l’étranger. Les résultats de l’enquête ENSR menée auprès des entreprises confortent cette idée jusqu’à un certain point. Dans les pays qui ont participé à cette enquête, la moitié des PME sont engagées dans une coopération formelle et/ou informelle avec d’autres PME. En outre, 10 % de l’ensemble des PME déclarent compter une ou plusieurs PME parmi leurs principaux partenaires de coopération (graphique 8.3)15.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 255
Graphique 8.3. De nombreuses PME sont associées avec une PME étrangère dans le cadre d’une coopération
(Pourcentage de l’ensemble des PME dans 18 pays de l’UE)
0
5
10
15
20
25
30
Portu
gal
Finlan
d
Germ
any
Spain
Nethe
rland
sIta
ly
Franc
e
United
King
dom
Belgium
Austri
a
Norway
Icelan
d
Sweden
Irelan
d
Denm
ark
Switzer
land
Luxe
mbo
urg
Greec
e
Avera
ge
Traduction des légendes Portugal Finlande Allemagne Espagne Pays-Bas Italie France Royaume-Uni Belgique Autriche Norvège Islande Suède Irlande Danemark Suisse Luxembourg Grèce Moyenne
Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; données pondérées sur des
PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
La section qui précède fait également apparaître que les activités internationales des PME sont souvent interdépendantes. Cet avis est également appuyé par les données de l’enquête ENSR auprès des entreprises. Parmi les PME propriétaires de filiales/de succursales/de coentreprises à l’étranger, 62 % exportent également des biens ou des services et 72 % traitent avec un fournisseur étranger. On constate en outre l’existence d’une corrélation positive significative entre toutes les activités internationales au niveau des entreprises. Dans l’ensemble, 30 % des PME européennes sont engagées dans des activités d’importation et 18 % dans des activités d’exportation. En conséquence, lorsque d’autres modes d’internationalisation sont pris en compte, l’importation est le type d’activité internationale le plus souvent cité des PME européennes (graphique 8.4).
256 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Graphique 8.4. L’IDE est le mode d’internationalisation des PME le moins important
(Pourcentage de l’ensemble des PME de 18 pays de l’UE)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Austri
a
Belgium
Denm
ark
Finlan
d
Franc
e
Germ
any
Greec
e
Icelan
d
Irelan
dIta
ly
Luxe
mbo
urg
Nethe
rland
s
Norway
Portu
gal
Spain
Sweden
Switzer
land
United
King
dom
Avera
ge
Exports Imports FDI Foreign cooperation
Traduction des légendes
Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne Grèce Islande Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Norvège Portugal Espagne Suède Suisse Royaume-Uni Moyenne
Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE
Dans une perspective à long terme, et malgré les réserves qu’il convient de faire lorsque l’on compare des sources de données, on peut raisonnablement présumer que l’internationalisation des PME par le biais de l’investissement augmente. C’est ce dont témoignent les constatations faites à partir des données concernant les années 90 contenues dans la base de données de Thomson Financial, et selon lesquelles les PME ont représenté seulement 1.2 % du nombre total de fusions et acquisitions transnationales et 0.4 % de la valeur totale des transactions, qui s’élevait à 2.6 milliards de milliards USD (OCDE, 2001a). Le nombre d’alliances internationales concernant des PME était plus important, puisqu’il équivalait à près de 10 % du total en moyenne au cours de la décennie précédente ; la plupart sont intervenues pendant la deuxième moitié de la période. Considérées globalement, ces statistiques montrent que dans les années 90, les PME ont accru leur participation à des fusions et acquisitions transnationales et à des alliances internationales, en particulier dans le secteur des TIC.
Exportations Importations IDE Coopération à l’étranger
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 257
4.2. Quelles sont les principales caractéristiques de l’IDE effectué par les PME ?
Comme dans le cas des grandes EMN, l’importance de l’IDE imputable aux PME varie selon le secteur d’activité concerné. En Corée, plus de la moitié de la valeur des projets d’investissement à l’étranger des PME concerne le secteur manufacturier. Dans les autres secteurs, cette part est beaucoup plus faible. Le commerce de gros et de détail représente 16 % de l’ensemble des projets (6 % de leur valeur), les services 15 % (10 % de leur valeur) et la construction 7 % (11 % de leur valeur 11). De même, au Japon, la proportion des PME du secteur manufacturier qui possèdent des filiales à l’étranger, qui était de 13 % en 2002, est supérieur à la moyenne de 9 % atteinte pour l’ensemble des PME. (JSBRI, 2004). On ne dispose pas de résultats quant à la part des PME japonaises dans l’IDE dans les autres secteurs, bien que selon certains analystes, les PME qui sont présentes dans les secteurs de haute technologie soient plus internationalisées et leur internationalisation plus précoce que celle des PME des secteurs à moyenne ou faible intensité de technologie.
Le tableau 8.4 présente de manière plus détaillée l’IDE effectué par les PME européennes, par secteur, ainsi que leurs activités de coopération internationales. C’est dans le commerce de gros que la part des PME qui possèdent des filiales/des succursales/des coentreprises à l’étranger est la plus élevée. Dans le secteur manufacturier, les transports et les communications, le commerce de détail et les services aux entreprises, la part des PME qui possèdent des filiales/des succursales/des coentreprises à l’étranger est légèrement supérieure ou égale à la moyenne générale. C’est dans la construction et les services aux particuliers que les activités d’investissement international sont les plus faibles.
Le fait synthétisé probablement le plus connu en ce qui concerne l’internationalisation des PME est la manière dont la taille de l’entreprise influe sur l’importance de l’investissement international. Dans la zone UE, les très petites entreprises (moins de 10 salariés) sont 10 fois moins susceptibles d’être engagées dans des activités à l’échelle internationale que les entreprises qui comptent entre 50 et 250 salariés (tableau 8.5). Les PME japonaises enregistrent une proportion similaire (tableau 8.6). S’agissant toutefois des formes moins courantes de coopération, l’écart lié à la taille de l’entreprise est moins important.
258 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Tableau 8.4. IDE des PME, par secteur de l’industrie
(Pourcentage de l’ensemble des PME de 18 pays de l’UE possédant des succursales/des filiales/des coentreprises à l’étranger)
Secteur Succursales/filiales/ coentreprises à l’étranger
Coopération à l’étranger
Secteur manufacturier 3 10
Construction 1 3
Commerce de gros 6 17
Commerce de détail 3 9
Transports et communications 4 15
Services aux entreprises 4 11
Services aux particuliers 1 9
Moyenne 3 10 Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
Tableau 8.5. IDE des PME européennes, selon la taille de l’entreprise
(Pourcentage de l’ensemble des PME de 18 pays de l’UE possédant des succursales/des filiales/des coentreprises)
Taille de l’entreprise (nombre de salariés)
Succursales/filiales/ coentreprises à l’étranger
Coopération à l’étranger
De 0 à 9 2 9
De 10 à 49 7 11
De 50 à 249 22 13
Moyenne 3 10 Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
Tableau 8.6. IDE des PME japonaises, selon la taille de l’entreprise
(Pourcentage des entreprises japonaises possédant des filiales à l’étranger)
Taille de l’entreprise (nombre de salariés) Filiales à l’étranger
Coopération à l’étranger
Moins de 100 6 3
De 101 à 300 12 4
De 301 à 1 000 25 8
1 001 et plus 47 16 Source : EIM, d’après l’enquête de base du METI sur la structure et les activités des entreprises japonaises (SBRI, 2004).
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 259
Dans les pays de l’OCDE, la tendance vers une production à plus forte intensité de savoir, assurée par des entreprises spécialisées, paraît concorder avec le fait que les entreprises récentes détiennent une plus grande part d’investissement international que les entreprises plus anciennes. Le tableau 8.7 montre l’importance de l’IDE effectué par les PME de certains pays de l’UE, selon l’ancienneté de l’entreprise. Bien que les parts soient petites, celle des entreprises de moins de cinq ans est le double (soit 4 %) de celle des entreprises de 10 ans et plus. La coopération à l’étranger est également plus courante chez les jeunes entreprises que chez les anciennes.
Tableau 8.7. IDE des PME, selon l’âge de l’entreprise
(Pourcentage de l’ensemble des PME de 18 pays de l’UE possédant des succursales/des filiales/des coentreprises à l’étranger)
Âge de l’entreprise Succursales/filiales/ coentreprises à
l’étranger
Coopération à l’étranger
5 ans 4 14
6-10 ans 3 11
>10 ans 2 8
Moyenne 3 10 Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 menée auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
L’investissement direct étranger des PME des pays industrialisés se fait généralement dans un autre pays industrialisé situé à proximité16. Selon des données de l’Eximbank, l’IDE des PME est majoritairement situé en Asie et représente environ les trois quarts des projets engagés en Asie pour le nombre et la valeur. À elle seule, la Chine compte pour environ la moitié de l’ensemble des projets et le Japon, 5 %. Hors de l’Asie, les États-Unis ont attiré 11 % de l’ensemble des projets d’investissement international des PME coréennes (13 % de leur valeur) et l’Europe, 5 % (6 % de leur valeur). Les lieux d’implantation de l’IDE des PME japonaises sont un peu plus diversifiés. En 2001, 29 % des filiales japonaises à l’étranger étaient implantées en Amérique du Nord et en Europe ; 25 % en Asie du Sud-Est ; 18 % en Chine ; 15 % dans les économies nouvellement industrialisées (Hong Kong, le Taipei chinois et la Corée) ; et, enfin, 13 % dans d’autres régions (JSBRI, 2004). Il n’y a pas de données récentes pour les États-Unis, mais selon une étude de Fujita (1995), les pays d’Europe occidentale étaient les principaux lieux d’implantation de l’IDE effectué par les PME américaines, le Royaume-Uni étant dans une large mesure le principal pays d’accueil. Cet auteur constate également que les PME
260 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
originaires du Canada et de l’Australie qui investissent à l’étranger privilégient les États-Unis.
Les résultats de l’Enquête ENSR auprès des entreprises apportent des précisions sur l’implantation de l’IDE des PME de la zone UE (tableau 8). En général, les principales destinations sont les mêmes que pour l’IDE en général, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas (voir également l’encadré 2) et l’Espagne accueillant entre 12 et 19 % des PME européennes qui effectuent des investissements à l’étranger. Signalons toutefois deux exceptions, à savoir le Royaume-Uni, qui accueille un pourcentage relativement faible (7 %) des PME européennes qui investissent à l’étranger, et l’Italie, un acteur relativement important, sans doute en raison de la place plus grande des PME dans l’économie italienne.
Encadré 8.2. L’IDE effectué par les PME : les Pays-Bas
Aux Pays-Bas, l’enquête réalisée par EIM auprès d’un panel d’entreprises sur les orientations des PME apporte des précisions sur l’investissement direct étranger des PME. En 2004, ce panel a été consulté en particulier sur des thèmes concernant l’IDE. Voici le compte rendu des principales constatations faites à cette occasion.
Aux Pays-Bas, comme dans d’autres pays de l’UE, seulement 2 % des PME ont investi à l’étranger pendant la période 2002-2004, principalement dans une organisation commerciale (la moitié des investissements ont été faits dans ce secteur). Les PME néerlandaises ont également investi dans la production (35 %) et dans l’innovation et le développement (30 %).
La moitié des PME qui ont investi à l’étranger a opté pour des projets de création de nouvelles entreprises ; un peu moins des 2/5 ont acquis une participation dans une entreprise étrangère et environ le quart possédait une coentreprise à l’étranger avec un associé néerlandais ou étranger. On a recensé nettement moins d’acquisitions à l’étranger (9 %) et d’investissements de sociétés-mères dans des filiales (7 %). (Certaines entreprises ont participé à plusieurs types d’investissements internationaux.) En ce qui concerne l’orientation géographique, la zone composée de 15 pays de l’UE est de loin la plus importante destination des flux sortants d’IDE des PME néerlandaises.
Les données recueillies apportent également des précisions sur les montants investis à l’étranger par les PME. Ainsi, entre 2002 et 2004, 46 % des PME néerlandaises ont effectué un investissement direct à l’étranger de moins de 100 000 EUR ; 35 % ont investi entre 100 000 et 1 000 000 EUR, enfin, 19 % ont investi plus de 1 000 000 EUR.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 261
Tableau 8.8. Destination de l’IDE des PME de 18 pays de l’UE
Pays Pourcentage de PME ayant des filiales/succursales/coentreprises
à l’étranger
UE-15 Autriche 7
Belgique 6
Danemark 6
Finlande 1
France 15
Allemagne 19
Grèce -
Irlande 1
Italie 13
Luxembourg 4
Pays-Bas 13
Portugal 2
Espagne 12
Suède 7
Royaume-Uni 7
Nouveaux pays de l’UE
Chypre -
République tchèque 8
Estonie 2
Hongrie 8
Lettonie 1
Lituanie 2
Malte 1
Pologne 9
Slovaquie 5
Slovénie 2
Autres pays d’Europe
Bulgarie 7
Islande -
Norvège 5
Roumanie 7
Suisse 4
Turquie 2
262 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Pays Pourcentage de PME ayant des filiales/succursales/coentreprises
à l’étranger
Autres pays Japon 2
Etats-Unis 2
Autres pays 37 Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 menée auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
4.3. Qu’est-ce qui incite les PME à investir à l’étranger, ou, au contraire les dissuade de le faire ?
Habituellement, l’internationalisation des entreprises est motivée par la recherche de marchés, d’efficience et de ressources. Plus récemment, la recherche d’actifs intellectuels est venue s’ajouter à cette liste17. Les réponses obtenues dans le cadre de l’Enquête ENSR auprès des entreprises précisent l’importance attachée à ces différents motifs par les PME européennes qui investissent à l’étranger. La recherche de marchés (accès à des marchés nouveaux et plus grands) est certainement le principal motif d’investissement (tableau 8.9). La recherche de ressources, c’est-à-dire de main-d’œuvre et de capital, est le motif le moins fréquent18. La moitié des PME interrogées accordent une importance à peu près égale à la recherche d’efficience et d’actifs intellectuels. Au Japon, il semble que les raisons qui incitent les PME à recourir à l’IDE varient selon les régions. Selon une enquête réalisée par l’Institut japonais de recherche sur les PME, l’IDE en Amérique du Nord et en Europe est fortement motivé par la recherche de marchés tandis que l’IDE en Chine et dans les nouvelles économies industrialisées est plutôt associé à la recherche d’efficience (JSBRI, 2004).
Au bout du compte, cependant, les PME recourent à l’IDE pour améliorer leur rendement économique et, partant, augmenter leur production et leur rentabilité. Selon les réponses recueillies à l’occasion de l’Enquête ENSR auprès des entreprises, la majorité des PME européennes améliorent effectivement leur chiffre d’affaires lorsqu’elles se développent à l’étranger par le biais de l’investissement international (tableau 8.10). Fait étonnant, le tiers des PME qui investissent à l’étranger déclarent que cela n’a aucun impact sur leur chiffre d’affaires et certaines font même état d’un impact négatif.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 263
Tableau 8.9. Raisons qui motivent l’internationalisation des PME par le biais de l’IDE
(Pourcentage du total des PME de 18 pays de l’UE possédant des filiales/des succursales/des coentreprises à l’étranger)
Motivations Important Non
important
Accès à des marchés nouveaux et plus grands pour vos produits et services
84 16
Coûts de production élevés sur le marché national 49 51
Sévérité de la législation et de la réglementation sur le marché national
49 51
Capacité de production additionnelle 48 52
Accès aux connaissances et à la technologie 46 54
Accès à la main-d’œuvre 29 71
Accès au capital 29 71Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
Tableau 8.10. Pour la majorité des PME, l’IDE a un impact positif sur le chiffre d’affaires
(Pourcentage du total des PME de 18 pays de l’Union européenne possédant des filiales/des succursales/des coentreprises à l’étranger)
Impact
Impact positif considérable 13
Impact positif 39
Aucun impact 33
Impact négatif 7
Impact négatif considérable 1
Ne sait pas/pas de réponse 7
Total 100 Source : EIM, d’après l’Enquête 2003 auprès des entreprises ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE.
En ce qui concerne les obstacles à l’internationalisation des PME, l’absence de compétences en matière de financement et de gestion sont souvent les principaux obstacles à l’internationalisation des PME (voir par exemple OCDE, 2006b). Selon l’Enquête ENSR 2003, les PME européennes estiment toutefois que la législation et la réglementation sont les obstacles les plus importants et que le manque de financement et l’insuffisance des qualifications
264 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
et des compétences du personnel le sont beaucoup moins (tableau 8.11). Bien entendu, toutes les PME qui souhaitent s’internationaliser ne se heurtent pas à des obstacles. De fait, 40 % des PME interrogées dans le cadre de l’Enquête ENSR auprès des entreprises n’ont pas signalé l’existence de contraintes locales à l’internationalisation et 29 % n’ont pas rencontré d’obstacles extérieurs.
Tableau 8.11. Obstacles auxquels se heurtent les PME qui souhaitent recourir à l’IDE
(Pourcentage du total des PME de 18 pays de l’UE possédant des filiales/des succursales/des coentreprises à l’étranger)
Obstacles Important
Obstacles locaux à l’internationalisation :
- Coûts élevés du processus d’internationalisation 22
- Prix de vos produits et services 14
- Qualité et/ou spécificité de vos produits et services 12
- Qualifications ou compétences insuffisantes du personnel 10
- Autres 7
Obstacles extérieurs à l’internationalisation :
- Législation et réglementation en vigueur 29
- Absence de soutien et/ou de conseils 22
- Différences culturelles et linguistiques 19
- Manque d’information 16
- Absence de capital ou de financement 16
- Autres 4Source : EIM, d’après l’Enquête ENSR 2003 ; données pondérées sur des PME de 18 pays européens membres de l’OCDE. Note : les réponses multiples étaient autorisées et le total des pourcentages n’est donc pas de 100.
5. Corrélations entre les indicateurs de la mondialisation et de l’internationalisation des PME
La section 2 de la présente étude examine sous un angle théorique l’influence de mondialisation sur le comportement des PME en matière d’investissement international. La présente section propose un examen superficiel qui vise à montrer comment plusieurs des relations indiquées sont corrélées aux faits stylisés présentés dans la section précédente et aux indicateurs de mondialisation, pour 18 économies de l’UE. Les indicateurs de mondialisation utilisés portent sur l’internationalisation des marchés, les mesures du transfert et la diffusion de la technologie et les obstacles aux échanges et à l’investissement. L’annexe 8.A1 contient une description plus
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 265
détaillée des indicateurs ainsi qu’une liste des codes mnémoniques des variables et des sources des données.
La complémentarité bien établie qui existe entre l’IDE et les échanges est étroitement associée au phénomène des échanges intrabranche, dont une proportion considérable intervient entre les grandes EMN et leurs filiales à l’étranger (échanges intra-groupe). Cette complémentarité ne semble toutefois pas s’appliquer aux petites multinationales. Le tableau 8.12 montre qu’il n’existe pas de corrélation significative et positive entre les PME ayant effectué des investissements à l’étranger et l’intensité des exportations et des importations des PME. Cela tient peut-être au nombre très restreint et à la petite taille des PME qui ont jusqu’à présent effectué des investissements internationaux, au regard de la valeur totale de l’IDE (Hessels, Overweel et Prince, 2005). C’est sans doute ce qu’illustre le graphique 8.5, qui montre la relation ténue et non significative qui existe entre les flux sortants d’IDE d’un pays et la proportion de PME qui détiennent des investissements directs à l’étranger19.
Tableau 8.12. L’IDE et les échanges des PME sont corrélés mais non de manière significative.
(Coefficients de corrélation)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. IDE PME
2. COOPINT PME 0,28
3. EXPORT PME 0,16 0,45*
4. IMPORT PME 0,36 0,63*** 0,59***
5. POS ENTR IDE -0,01 0,01 0,33 0,51**
6. POS SORT IDE 0,02 -0,03 0,36 0,17 0,58**
7. ENTR IDE 0,13 -0,02 0,39 0,45* 0,93*** 0,48*
8. SORT IDE 0,10 -0,20 0,14 -0,11 0,44* 0,84*** 0,45*
9. EXPORT 0,21 0,42* 0,67*** 0,79*** 0,91*** 0,51** 0,86*** 0,36
10. IMPORT 0,19 0,44* 0,63*** 0,79*** 0,91*** 0,49** 0,83*** 0,36 0,98***
N 18 18 18 18 17 17 17 17 18 18
*** p<0.01, ** p <0.05, * p < 0.1; º les données sur le Luxembourg sont manquantes.
Source : Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; OCDE ; Banque mondiale.
266 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Graphique 8.5. Part des PME recourant à l’IDE comparativement à la position des sorties d’IDE
Sweden
UKSpainGermany
FranceAustria
Italy
Portugal
Norway
Denmark
Iceland
Switzerland
Belgium
Netherlands
Greece
FinlandIreland
0
2
4
6
8
10
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Outward FDI Position (OECD)
Sh
are
of
SM
Es
wit
h F
DI (
EN
SR
En
terp
rise
Su
rvey
200
3)
Traduction des légendes
Part des PME recourant à l’IDE (Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises)
Islande Danemark Suisse Irlande Norvège Finlande Grèce Portugal Belgique Allemagne Espagne Royaume-Uni Pays-Bas Autriche France Suède Italie
Position des sorties d’IDE (OCDE)
Source : EIM, 2007.
Par comparaison, le tableau 12 semble indiquer que l’existence de relations entre les EMN et les PME favorise effectivement l’internationalisation des PME. L’intensité globale des exportations d’un pays, par exemple, est corrélée positivement à l’orientation internationale des PME par le biais des échanges (0.67). Les échanges globaux sont également corrélés positivement à l’intensité de la coopération internationale des PME (0.42 dans le cas des exportations et 0.44 dans celui des importations). En outre, on décèle une corrélation significative de 0.41 entre le revenu provenant des flux sortants d’IDE et les activités d’exportation des PME (non illustré). Cela signifie peut-être que plus les investissements à l’étranger des investisseurs d’un pays sont fructueux, plus les débouchés à l’exportation qui s’offrent aux PME de ce pays sont considérables. Enfin, selon un indicateur de l’importance des marchés internationaux, ceux-ci sont positivement corrélés avec plusieurs mesures des modes d’internationalisation des PME (non indiqués dans le tableau 12), ce qui semble indiquer que l’élargissement du champ d’activité des entreprises
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 267
exportatrices accroît également les perspectives des PME sur les marchés étrangers. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les PME ont plus de facilité à entrer en contact avec des clients à l’étranger lorsque d’autres entreprises nationales ont déjà établi des réseaux commerciaux à l’étranger.
La section 2 avance également qu’il existe une relation entre la mondialisation, la nouvelle technologie et l’internationalisation des PME, étant donné que les innovations technologiques peuvent réduire les coûts et incitent les petites entreprises à s’internationaliser en recourant à l’investissement20. Le tableau 13 conforte dans une certaine mesure l’idée selon laquelle le transfert et la diffusion de technologie appuient les activités d’investissement direct étranger des PME. Il montre qu’il existe des corrélations positives et significatives entre l’importance des licences technologiques, l’intensité de l’utilisation d’Internet et d’ordinateurs et l’investissement direct étranger effectué par les PME (0.44, 0.41 et 0.41 respectivement). Les graphiques 6 et 7 illustrent la corrélation entre les économies européennes en ce qui concerne les licences technologiques et l’intensité de l’utilisation d’Internet.
Tableau 8.13. La diffusion de technologie et l’IDE des PME sont positivement associés
(Coefficients de corrélation)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. IDE PME
2. COOP INT PME 0,28
3. EXPORT PME 0,16 0,45*
4. IMPORT PME 0,36 0,63*** 0,59***
5. LIC TECH ETR 0,44* 0,00 -0,14 -0,03
6.TRANSF TECH ETR 0,08 -0,11 -0,18 -0,26 0,58**
7. UTIL INTERNET 0,41* -0,13 0,25 -0,08 0,05 -0,05
8. NBRE ORDINATEURS 0,41* 0,18 0,58 0,28 -0,05 -0,39 0,67***
9. DET ETR INV NAT 0,33 0,42* 0,29 0,70 0,42* 0,24 -0,10 -0,09
10. DET NAT INV ETR 0,33 0,46* 0,58** 0,76*** 0,13 -0,31 0,19 0,53** 0,59**
*** p<0.01, ** p <0.05, * p < 0.1
Source : Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises, OCDE, Banque mondiale ; Forum économique mondial.
268 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Enfin, l’examen de la détention étrangère d’inventions nationales montre une corrélation positive significative de celle-ci avec la part des PME engagées dans la coopération à l’étranger. En conséquence, lorsqu’une grande part d’investisseurs étrangers détiennent des inventions sur le marché d’accueil, cela peut accroître les perspectives de coopération avec des associés à l’étranger qui s’offrent aux PME. En outre, l’indicateur de la détention nationale d’inventions étrangères montre une forte corrélation positive entre celle-ci et la part des PME engagées dans différents modes d’internationalisation.
Graphique 8.6. Part des PME recourant à l’IDE au regard des licences technologiques à l’étranger
Belgium
Iceland
Denmark
PortugalUK
Switzerland
Luxembourg
Spain
Norway
Greece
Sweden
Netherlands
FinlandIreland
Germany
AustriaFrance
Italy
0
2
4
6
8
10
12
4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8
Prevalence of foreign technology licensing (WEF)
Sh
are
of
Eu
rop
ean
SM
Es
wit
h F
DI
(EN
SR
En
terp
rise
Su
rvey
200
3)
Traduction des légendes
Part des PME européennes recourant à l’IDE (Enquête ENSR 2003)
Islande Danemark Suisse Luxembourg Finlande Norvège Irlande Belgique Grèce Portugal Allemagne Pays-Bas Espagne Royaume-Uni Autriche Suède France Italie
Licences technologiques à l’étranger (Forum économique mondial)
Source : EIM, 2007.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 269
Graphique 8.7. Part des PME recourant à l’IDE au regard de l’utilisation d’Internet
Iceland
Denmark
Finland
Netherlands
SwedenAustria
UK
Switzerland
Luxembourg
Germany
Italy
Belgium
Norway
Ireland
France
Spain
PortugalGreece
0
2
4
6
8
10
12
0 100 200 300 400 500 600 700
Number of internet users per 1,000 (WDI/World Bank, 2002)
Sh
are
of
Eu
rop
ean
SM
Es
wit
h F
DI
(EN
SR
En
terp
rise
Su
rvey
200
3)
Traduction des légendes
Part des PME européennes recourant à l’IDE (Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises)
Islande Danemark Suisse Luxembourg Irlande Norvège Finlande Grèce Portugal Belgique Espagne Allemagne Royaume-Uni Pays-Bas France Autriche Suède Italie
Nombre d’utilisateurs d’Internet par tranche de 1 000 entreprises (WDI (indicateurs du développement dans le monde)/Banque mondiale, 2002)
Source : EIM, 2007.
Nous examinons enfin la corrélation entre l’internationalisation des PME et l’ouverture à l’investissement international en utilisant le nouvel indice étendu de la restrictivité de la réglementation en matière d’IDE de l’OCDE (tableau 8.14)21. Paradoxalement, cet indice démontre une corrélation significative avec la part des PME qui effectuent des investissements directs à l’étranger (graphique 8). Cela ne manque pas d’étonner, puisque l’on pourrait supposer que les PME qui évoluent sur des marchés protégés contre les flux entrants d’investissement ne sont pas poussées ou incitées à étendre leurs propres activités à l’étranger. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les données à ce sujet sont limitées. En particulier, la part des PME européennes recourant à l’investissement international comprend également les PME participant à des coentreprises et à des alliances stratégiques transnationales. En conséquence, il se peut que les PME d’un pays qui restreint sévèrement l’IDE
270 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
soient incitées de ce fait à privilégier les formes de coopérations autres que l’IDE. Un autre point qui ressort du tableau 14 est la corrélation positive entre le délai nécessaire pour s’acquitter des procédures en matière d’exportation et d’exportation et la participation des PME aux initiatives de coopération internationale (0.6 et 0.61 respectivement). Cela traduit peut-être le fait que lorsque les délais nécessaires pour remplir les conditions imposées en matière d’exportation et d’importation sont plus longs, les PME ont tendance à rechercher des associés à l’étranger, sans doute dans le but de réduire les coûts de transaction associés à la conduite des affaires.
Graphique 8.8. Part des PME recourant à l’IDE au regard de l’indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE établi par l’OCDE
Iceland
Greece
Finland
Switzerland
Denmark
Norway
Portugal
Spain
AustriaSwedenFrance
Italy
NetherlandsGermanyUK
Ireland
Belgium
0
2
4
6
8
10
12
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
FDI Restrictiveness Index (OECD)
Sh
are
of
Eu
rop
ean
SM
Es
wit
h F
DI
(EN
SR
En
terp
rise
Su
rvey
200
3)
Traduction des légendes
Part des PME européennes recourant à l’IDE (Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises)
Islande Danemark Suisse Irlande Norvège Finlande Belgique Portugal Grèce Allemagne Royaume-Uni Pays-Bas Espagne France Suède Autriche Italie
Indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE (OCDE)
Source : EIM, 2007.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 271
Tableau 8.14. Corrélation entre l’internationalisation des PME et l’ouverture des marchés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. IDE PME
2. COOP INT PME 0,28
3. EXPORT PME 0,16 0,45*
4. IMPORT PME 0,36 0,63*** 0,59***
5. IND RESTR IDE º 0,53** 0,24 -0,06 0,26
6. OBSTACLES INT -0,15 0,13 -0,10 -0,11 0,16
7. PROC DISCR -0,02 0,53** -0,02 -0,03 0,15 0,21
8. DÉLAI EXPORT 0,04 0,60** -0,44* 0,09 0,28 0,30 0,66***
9. DÉLAI IMPORT -0,03 0,61*** -0,38 0,19 0,16 0,33 0,63*** 0,96***
*** p<0.01, ** p <0.05, * p < 0.1; ºles données sur le Luxembourg sont manquantes. Source : Enquête ENSR 2003 auprès des entreprises ; OCDE ; Banque mondiale.
6. Conséquences à tirer du point de vue de la politique d’investissement
La présente étude fait ressortir un certain nombre de problèmes existants ou qui pourraient se poser relativement à la politique d’investissement :
• Le fait les PME recourent à l’IDE pour les mêmes raisons que les EMN mais qu’elles soient plus vulnérables aux obstacles aux décisions en matière d’investissement laisse à penser qu’un cadre réglementaire complet et cohérent comme le Cadre d’action pour l’investissement est un instrument précieux d’évaluation des mesures destinées à attirer les flux d’IDE des PME et à favoriser leur expansion à l’étranger. La phase 2 du projet pourrait, à toutes fins utiles, consister à transposer l’outil de vaste portée qu’est le Cadre d’action pour l’investissement dans un ensemble spécifique de mesures adaptées aux PME dans le domaine de l’investissement et à examiner les données concernant les pratiques et les expériences des PME qui réussissent leur internationalisation. Cette initiative pourrait être menée en collaboration avec des organismes de l’OCDE qui ont une connaissance des PME, notamment le Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat.
• La présente étude conclut que la base d’information disponible pour comprendre les problèmes auxquels sont confrontées les PME qui entrent sur les marchés internationaux est incomplète. Il est donc difficile de mettre en œuvre des moyens d’action fondés sur les faits et les données analytiques en général, et, en particulier dans le domaine
272 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
spécifique de la politique d’investissement. Dans le cadre des travaux actuellement menés par les statisticiens de l’OCDE et du FMI afin d’améliorer les normes internationales et la conduite des enquêtes, il conviendrait d’étudier la possibilité de produire des données sur l’IDE en fonction de la taille des entreprises.
• L’évolution vers l’internationalisation des PME s’est surtout observée jusqu’à présent dans les pays situés à proximité de la société du pays d’origine, mais il se pourrait que de nouveaux intervenants prennent davantage d’importance. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de promouvoir auprès des nouveaux venus la mise en œuvre de normes internationales stables comme les Lignes directrices de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Les PME veulent bénéficier de règles du jeu plus égales au plan international parce que les obstacles engendrent davantage d’occasions manquées d’investissement. À cet égard, les Lignes directrices de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui s’appliquent à toutes les entreprises multinationales indépendamment de leur taille, reconnaissent explicitement les difficultés auxquelles sont confrontées les PME. La prochaine étape des travaux, du point de vue de l’action, pourrait consister à dresser un inventaire détaillé des outils et approches dont disposent les entreprises et en particulier les entreprises de moindre envergure qui souhaitent mettre en œuvre les Lignes directrices.
Notes
1. En novembre 2005, le Comité de l’investissement a publié une vue d’ensemble des bonnes pratiques encourageant les liens entre entreprises multinationales et PME (OCDE, 2005a), dans le cadre du processus de Bologne de l’OCDE. Les liens que nouent les entreprises multinationales et les PME favorisent l’internationalisation des PME par le biais de l’investissement.
2. Voir aussi OCDE, 2005a qui présente une vue d’ensemble des bonens pratiques qui ont pour effet de favoriser la création de liens entre entreprises multinationales et PME.
3. Sur la question de l’externalisation et du rôle des PME dans les chaînes mondiales de l’offre et de la distribution, voir l’étude du Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat [CFE/SME(2006)12/REV2.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 273
4. Selon le paradigme OLI, l’IDE tient à la combinaison de trois types d’avantages : les avantages liés à la spécificité (par exemple le fait que l’entreprise possède des compétences supérieures en gestion ou des technologies supérieures) ; les avantages liés spécifiquement à la localisation (par exemple, le fait d’avoir accès à certaines ressources ou à une main-d’oeuvre compétente) ; les avantages liés à l’internalisation (par exemple lorsqu’il est plus intéressant pour une entreprise d’internaliser ses avantages spécifiques liés à la sa spécificité en élargissant ses propres activités que d’externaliser ces avantages par le biais de l’octroi de licences ou d’autres accords passés avec des entreprises indépendantes. )
5. Au début des années 90, la CNUCED a compilé des informations statistiques sur les petites et moyennes entreprises multinationales mais a cessé depuis.
6. L’ENSR est l’European Network for Social and Economic Research ; voir http://www.ensr-net.com. L’enquête de l’ENSR est réalisée dans le cadre de l’Observatoire des PME européennes créé par la Commission européenne en 1992.
7. L’Enquête ENSR auprès des entreprises a également été menée en 1999, 2001, 2002 et 2003, mais les enquêtes de 1999 et de 2001 ne contenaient pas d’informations sur l’IDE imputable aux PME, et les informations recueillies en 2002 à cet égard étaient similaires à celles de 2003. La présente étude se concentre donc sur les résultats de l’enquête de 2003.
8. On ne dispose pas de données ventilées par filiales, succursales et coentreprises.
9. En Corée, la définition d’une PME est fonction du secteur concerné. Dans le secteur manufacturier, les PME sont définies comme étant des entreprises de moins de 300 salariés ou disposant d’un capital de moins de 8 millions de dollars ; dans l’exploitation minière, la construction et les transports, une PME s’entend d’une entreprise de moins de 300 salariés ou dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 3 millions de dollars ; enfin, dans le commerce de gros, le commerce de détail et les autres secteurs, les PME sont les entreprises de moins de 300 salariés dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 30 millions de dollars.
10. L’auteur exprime sa gratitude à Sunyoon Kwan et Joon-Ho Lee, de l’Institut coréen des PME, qui lui ont fourni les données sur l’IDE des entreprises coréennes.
11. Au Japon, les PME sont définies comme étant des entreprises dont le capital est inférieur à 300 millions JPY ou de moins de 300 salariés réguliers. Cependant, dans l’industrie du commerce de gros, les PME sont définies comme les entreprises dont le capital est inférieur à 100 millions JPY ou de moins de 100 salariés ; dans les services, les PME sont les entreprises ayant un capital de moins de 50 millions JPY ou de moins de 100 salariés ; enfin,
274 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
dans le commerce de détail, sont considérées comme PME les entreprises dont le capital est inférieur à 50 millions JPY ou comptant 50 salariés ou moins (JSBRI, 2004).
12. L’IDE est défini comme le fait de détenir une participation d’au moins 20 % dans une filiale à l’étranger.
13. L’auteur remercie Noriyuki Takahashi, de l’Université de Kobe, pour l’aide qu’il lui a apportée dans la recherche de statistiques sur l’IDE des PME japonaises.
14. Ces informations ont été fournies par un fonctionnaire de la Nouvelle-Zélande.
15. L’Enquête ENSR auprès des entreprises ne fournit pas d’informations sur l’importance de la coopération des PME avec des grandes entreprises étrangères, par exemple des entreprises multinationales.
16. Buckley (1997) constate que les PME sont plus portées que les grandes entreprises multinationales à concentrer leurs investissements à proximité de leur pays d’origine.
17. On trouvera un panorama des études et des informations sur l’investissement international dans les actifs intellectuels dans le document DAF/INV/WD(2007)6.
18. La recherche de ressources porte principalement sur les ressources minières et énergétiques mais celles-ci sont moins pertinentes dans la zone de l’UE.
19. Pour vérifier dans quelle mesure le caractère atypique de l’Islande est responsable de l’absence de corrélation, l’analyse a été effectuée en excluant l’Islande. La corrélation s’en trouve renforcée (coefficient 0,40) mais n’est pas pour autant significative (valeur de p : 0,14).
20. Cette relation est examinée au chapitre 2 des Perspectives de l’investissement international 2006 de l’OCDE, édition 2006.
21. Pour de plus ample détails sur l’indice de restrictivité de la réglementation applicable à l’IDE, voir le document de travail sur l’investissement international de l’OCDE n° 2006/4, sur le site www.oecd.org/investment
Bibliographie
Acs, Z. et Audretsch, D. (1990), Innovation and Small Firms. Cambridge, MIT Press.
Acs, Z.J. et Preston, L. (1997), Small and Medium-Sized Enterprises, Technology and Globalization: Introduction to a Special Issue on Small
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 275
and Medium-Sized Enterprises in the Global Economy, Small Business Economics, 9(1), 1-6.
Acs, Z.J., Morck, R., Shaver, J.M. et Yeung, B. (1997), The Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises: A Policy Perspective, Small Business Economics, 9(1), 7-20.
Aitken, B., Hanson, G.H., et Harrison, A.E. (1997), Spillovers, foreign investment and export behaviour, Journal of International Economics, 43, 103-132.
Akoorie, M. et Enderwick, P. (1992), The international operations of New Zealand companies, Asia Pacific Journal of Management, 9(1), 51-69.
Autio, E., Sapienza, H.J., et Almeida, J.G. (2000), Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth, Academy of Management Journal 43(5), 909-924.
Axinn, C.N. (1988), Export performance: do managerial perceptions make a difference?, International Marketing Review, 5, 67-71.
Barrell, R., et Pain, N. (1997), Foreign direct investment, technological change, and economic growth within Europe, The Economic Journal, 107, 1770-1786.
Bello, D.C. et Barksdale, H.C. (1986), Exporting at industrial trade shows, Industrial Marketing Management, 15(3), 197-206.
Blomström, M., et Kokko, A. (1998), Multinational corporations and spillovers, Journal of Economic Surveys, 12(2), 1-31.
Bloodgood, J.M., Sapienza, H.J., et Almeida, J.G. (1996), The Internationalization of New High-Potential U.S. Ventures: Antecedents and Outcomes, Entrepreneurship Theory and Practice, 20(4), 61-76.
Buckley, P.J., Newbould, G.D. et Thurwell, J. (1988), Foreign Direct Investment by Smaller UK Firms, Macmillan, Londres.
Buckley, P.J. (1989), Foreign Direct Investment by Small and Medium Sized Enterprises: The Theoretical Background, Small Business Economics, 1(2), 89-100.
Buckley, P.J. (1997), International Technology Transfer by Small and Medium-Sized Enterprises, Small Business Economics, 9(1), 67-78.
Cantwell, J. (1989), Technological innovation and multinational corporations, Basil Blackwell, Oxford.
276 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Cantwell, J., et Hodson, C. (1991), Global RandD and UK competitiveness, in M. Casson (dir. publ.), Global Research Strategy and International Competitiveness, Basil Blackwell, Oxford et Cambridge.
Cavusgil, T. et Nevin, J.R. (1981), Internal Determinants of Export Marketing Behavior: An Empirical Investigation, Journal of Marketing Research, 18(1), 114-119.
Cavusgil, S.T. (1984), Organizational characteristics associated with export activity, Journal of Management Studies, 21(1), 3-22.
Chetty, S.K. et Hamilton, R.K. (1993), Firm level determinants of export performance: a meta-analysis, International Marketing Review, 10(3), 26-34.
Chuang, Y. C., et Lin, C. M. (1999), Foreign direct investment, R&D and spillover efficiency: Evidence from Taiwan's manufacturing firms, Journal of Development Studies, 35, 117-137.
CNUCED (1993), Small and Medium-sized Transnational Corporations: Role, Impact and Policy Implications, Programme de la CNUCED relatif aux sociétés transnationales, Nations Unies, New-York, Genève.
CNUCED (2006), Promotion de liens entre STN et PME en vue de renforcer la capacité productive des entreprises des pays en développement : une perspective stratégique, Conseil du commerce et du développement, CNUCED, Nations Unies, New-York, Genève.
Commission européenne (2004), L’internationalisation des PME, Observatoire des PME européennes ; Report 2003, n° 4, rapport soumis à la DG Entreprises par KPMG Special Services, EIM Business & Policy Research, et ENSR ; Bruxelles
Conseil de l’Union européenne (2006), Lutte contre les obstacles liés à la fiscalité des sociétés qui affectent les petite et moyennes entreprises dans le marché intérieur – Description d’un éventuel système pilote d’imposition selon les règles de l’État de résidence – analyse d’impact 5182/06 ADD 1, Commission des Communités européennes, Bruxelles.
Coviello, N.E. et McAuley, A. (1999), Internationalisation and the Smaller Firm: A Review of Contemporary Empirical Research, Management International Review, 39(3), 223-256.
Coviello, N.E. et Munro, H.J. (1995), Growing the Entrepreneurial Firm: Networking for International Market Development, European Journal of Marketing, 29(7), 49-61.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 277
De Clercq, D., Hessels, S.J.A. et Stel, A. van (2006), Knowledge Spillovers and Entrepreneurs’ Export Orientation, document de travail H200619, EIM, Zoetermeer.
Dunning, J.H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Workingham.
Eriksson, K., Johanson, J. Majkgård, A. et Sharma, D.D. (1997), Experiential Knowledge and Cost in the Internationalization Process, Journal of International Business Studies, 28 (2), 337-360.
Etemad, H. (2004), Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises: A Grounded Theoretical Framework and an Overview, Revue canadienne des sciences de l’administration, 21(1), 1-21.
Etemad, H. (2005), SMEs’ Internationalization Strategies Based on a Typical Subsidiary’s Evolutionary Life Cycle in Three Distinct Stages, Management International Review, 45(3), 145-186.
Fletcher, R. (2001), A holistic approach to internationalisation, International Business Review 10(1), 25-49.
Fosfuri, A., Motta, M., et Rønde, T.(2001), Foreign direct investment and spillovers through workers' mobility, Journal of International Economics, 53, 205-222.
Fujita, M.(1995), Small and Medium-sized Transnational Corporations: Trends and Patterns of Foreign Direct Investment, Small Business Economics, 7, 183-204.
Fraser, J. et Oppenheim, J. (1997), What’s New About Globalization? The McKinsey Quarterly, 2, 168-179.
Glass, A., et Saggi, K. (1998), International technology transfer and the technology gap, Journal of Development Economics, 55, 369-398.
Gomes-Casseres, B. (1997), Alliance Strategies of Small Firms, Small Business Economics, 9(1), 33-44.
Greenaway, D., Morgan, W., et Wright, P. (2004), Trade liberalization and growth in developing countries: Some new evidence, World Development 25, 1885-1892.
Hessels, J. (2005), Internationalisation of Dutch SMEs, étude M200507, EIM, Zoetermeer.
Hessels, S.J.A., Overweel, M.J., et Prince, Y.M. (2005), Internationalisering van het Nederlandse MKB. Bestaande en gewenste inzichten (en néerlandais :
278 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
l’internationalisation des PME néerlandaises – faits connus ou à explorer), EIM, Zoetermeer.
Hollenstein, H. (2005), Determinants of International Activities: Are SMEs Different?, Small Business Economics, 24(5), 431-450.
JBIC (2006), Survey Report On Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies, JBIC Institute, Japan Bank for International Cooperation.
Johanson, J. et Vahlne, J.E. (1977), The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, 8, 23-32.
Johanson, J. et Vahlne, J.E. (1990), The Mechanism of Internationalization, International Marketing Review, 7, 11-24.
Johnson, J.E. (2004), Factors Influencing the Early Internationalization of High Technology Start-ups: US and UK Evidence, Journal of International Entrepreneurship, 2(1-2), 139-154.
Jones, M.V. et Coviello, N.E. (2005), Internationalisation: conceptualising and entrepreneurial process of behaviour in time, Journal of International Business Studies, 36, 284-303.
JSBRI (2004), White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, Japan Small Business Research Institute, METI (ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie), Tokyo, Japon.
JSBRI (2005), White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, Japan Small Business Research Institute, METI, Tokyo, Japon.
Keeble, D., Lawson, C., Smith, H., Moore, B. et Wilkinson, F. (1998), Internationalisation Processes, Networking and Local Embeddedness in Technology-Intensive Small Firms, Small Business Economics, 11(4), 327-342.
Knight, G.G. et Cavusgil, S.T. (1996), The born global firm: A challenge to traditional internationalization theory, Advances in International Marketing, 8, 11-26.
Knight, G. (2000), Entrepreneurship and Marketing Strategy: The SME Under Globalization, Journal of International Marketing 8(2), 12-32.
Kohn, T.O. (1997), Small Firms as International Players, Small Business Economics, 9(1), 45-51.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 279
Korhonen, H., Luostarinen, R. et Welch, R. (1996), Internationalisation of SMEs: Inward-Outward Patterns and Government Policy, Management International Review, 36(4), 315-329.
Kuo, H-C., et Li, Y. (2003), A Dynamic Decision Model of SMEs’ FDI, Small Business Economics, 20(3), 219-231.
Lefebvre, E. et Lefebvre, L.-A. (2002), Innovative Capabilities as Determinants of Export Performance and Behaviour: A Longitudinal Study of Manufacturing SMEs, in Kleinknecht, A. et Mohnen, P. (2002), Innovation and firm performance: econometric explorations of survey data, Palgrave, Londres.
Leonidou, L. (2004), An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development, Journal of Small Business Management, 42(3), 279-302.
Lu, J.W. et Beamish, P.W. (2001), The Internationalization and Performance of SMEs, Strategic Management Journal 22(6/7), 565-586.
Madsen, T.K. et Servais, P. (1997), The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?, International Business Review 6(6), 561-583.
McDougall, P.P. (1989), International Versus Domestic Entrepreneurship: New Venture Strategic Behaviour and Industry Structure, Journal of Business Venturing, 4(6), 387-400.
McDougall, P.P., et Oviatt, B.M. (1991), Global start-ups: new ventures without geographic limits, The Entrepreneurship Forum (hiver), 1-5.
McDougall, P.P., et Oviatt, B.M. (1996), New venture internationalization, strategic change, and performance: a follow-up study, Journal of Business Venturing, 11, 34-40.
McDougall, P.P., Shane, S., et Oviatt, B.M. (1994), Explaining the formation of international new ventures: The limits of international business research, Journal of Business Venturing 9(6), 469-487.
OCDE (1997), PME et mondialisation, Paris.
OCDE (2001a), Le nouveau visage de la mondialisation industrielle : fusions-acquisitions et alliances stratégiques transnationales, OCDE, Paris.
OCDE (2001b), Tableau de bord de l’OCDE de la science, de la technologie et de l’industrie : Vers une économie fondée sur le savoir, Édition 2001, OCDE, Paris.
280 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
OCDE (2004), Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy: Towards a more responsible and inclusive globalisation, OCDE, Paris.
OCDE (2005a), Encouraging Linkages between Small and Medium-Sized Companies and Multinational Enterprises: An Overview of Good Practice, Paris.
OCDE (2005b), Manuel de l’OCDE sur les indicateurs de la mondialisation économique, OCDE, Paris.
OCDE (2005c), Perspectives de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat – Édition 2005, chapitre 3, OCDE, Paris.
OCDE (2005d), « MNE-Local Enterprise Development: Encouraging Linkages between Small and Medium-Sized Companies and Multinational Enterprises », DAF/INV/WD(2005)12/REV1.
OCDE (2006a), Perspectives d’investissement international, Paris.
OCDE (2006b), Removing Barriers to SME Access to International Markets, exposé thématique préparé à l’occasion de la conférence conjointe OCDE-APEC sur la suppression des obstacles à l’accès des PME aux marchés internationaux, Athènes, 6-8 novembre 2007.
OCDE (2006c), Draft Synthesis Report on Enhancing the Role of SMEs in Global Value Chains, CFE/SME(2006)12/REV2.
OCDE (2006d), Le déficit de financement des PME (vol. 1) : Principes et réalités, Paris.
OCDE (2006e), Plan d’action d’Athènes pour la suppression des obstacles à l’accès des PME aux marchés internationaux, adopté lors de la conférence conjointe OCDE-APEC, Athènes, 8 novembre 2006.
Ohmae, K. (1990), The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, Harper Business, New York.
Oviatt, B., et McDougall, P. (1994), Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies 25(1), 45-62.
Oviatt, B.M., et McDougall, P.P. (1995), Global start-ups: Entrepreneurs on a worldwide stage, The Academy of Management Executive, 9(2), 30-44.
Rasheed, H.S. (2005), Foreign Entry Mode and Performance: The Moderating Effects of Environment, Journal of Small Business Management, 43(1), 41-54.
Rasmussen, E.S., Madsen T.K. et Evangelista, F. (2001), The Founding of the Born Global Company in Denmark and Australia: Sensemaking and
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 281
Networking, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 13(3), 75-107.
Rennie, M.W. (1993), Global competitiveness: born global, The McKinsey Quarterly, 4, 45-52.
Requena-Silvente, F. (2005), The Decision to Enter and Exit Foreign Markets: Evidence from UK SMEs, Small Business Economics, 25(3), 237-253.
Reynolds, P.D. (1997), New and Small Firms in Expanding Markets, Small Business Economics, 9(1), 79-84.
Roberts, E.B., et Senturia, T.A. (1996), Globalizing the Emerging High-Technology Company, Industrial Marketing Management, 25(6), 491-506.
Rosson, P.J. et Ford, L.D. (1982), Manufacturer-overseas distributor relations and export performance, Journal of International Business Studies, 13(2), 57-72.
Sakai, K. (2004), Global Industrial Restructuring: Implications for Small Firms, document de travail de la DSTI, OCDE, 2002/4.
Simpson, C.L., et Kujawa, D. (1974), The export decision process: an empirical inquiry, Journal of International Business Studies, 5(1), 107-117.
Thirkell, P.C., et R. Dau (1998), Export performance: success determinants for New Zealand manufacturing exporters, 32(9/10): 813-829.
Urata, S. et Kawai, H. (2000), The Determinant of the Location of Foreign Direct Investment by Japanese Small and Medium-sized Enterprises, Small Business Economics, 15(2), 79-103.
Westhead, P. (1995), Exporting and non-exporting small firms in Great Britain, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 1(2), 6-36.
Wilkinson, T.J. (2006), Entrepreneurial Climate and U.S. State Foreign Trade Offices as Predictors of Export Success, Journal of Small Business Management, 44(1), 99-113.
Zahra, S.A., Neubaum, D.O. et Huse, M. (1997), The Effect of the Environment on Export Performance Among Telecommunications New Ventures, Entrepreneurship Theory and Practice, 22(1), 25-46.
282 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
ANNEXE 8.A1.
LISTE DES CODES MNÉMONIQUES DES VARIABLES POUR L’ANALYSE DES CORRÉLATIONS
Code mnémonique des variables
Description Source
Internationalisation des PME
IDE PME Part des PME d’un pays ayant des succursales, des filiales ou des coentreprises à l’étranger
Enquête ENSR auprès des entreprises
COOP INT PME Part des PME d’un pays dont le principal associé dans le cadre d’une coopération est une PME à l’étranger
Enquête ENSR auprès des entreprises
EXPORT PME Part des PME d’un pays qui exportaient en 2002
Enquête ENSR auprès des entreprises
IMPORT PME Part des PME d’un pays qui traitait avec un fournisseur à l’étranger en 2002
Enquête ENSR auprès des entreprises
Indicateurs de la mondialisation
POS ENTR IDE Position des entrées d’IDE par rapport au PIB en 2002
OCDE
POS SORT IDE Position des sorties d’IDE par rapport au PIB en 2002
OCDE
ENTR IDE Entrées moyennes d’IDE par rapport au PIB entre 2000 et 2003
OCDE
SORT IDE Sorties moyennes d’IDE par rapport au PIB entre 2000 et 2003
OCDE
EXPORT Exportations par rapport au PIB en 2002
Banque mondiale
IMPORT Importations par rapport au PIB en 2002
Banque mondiale
ENTR REV IDE Entrées de revenu de filiales à l’étranger par rapport au PIB
OCDE
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ÉDITION 2007 – ISBN 978-92-64-03758-8 - © OCDE 2007 283
Code mnémonique des variables
Description Source
SORT REV IDE Sorties de revenu d’entreprises d’investissement direct de l’étranger par rapport au PIB
OCDE
LIENS COMM A L’ETR
Étendue des liens commerciaux à l’étranger d’un pays, d’après une échelle de 1 à 7. (1 = petit nombre de destinations à l’exportation ; 7 = exportation dans presque tous les marchés étrangers.
Global Competitiveness Report, 2005-2006
CONTINT Degré de contrôle étranger sur la distribution internationale, d’après une échelle de 1 à 7. 1 = des sociétés étrangères contrôlent la distribution et la commercialisation internationales et ; 7 = ce contrôle est exercé par des sociétés nationales.
Global Competitiveness Report, 2005-2006
Transfert et diffusion de technologie
LIC TECH ETR Octrois de licences technologiques à l’étranger sur une échelle de 1 (à 7. 1 = octroi rare ; 7 = octroi fréquent.
Global Competitiveness Report, 2005-2006
TRANSF TECH ETR IDE et transfert technologique sur une échelle de 1 à 7. 1 = les enquêtés estiment que l’IDE est une source limitée de technologie ; 7 = ils estiment que l’IDE est une source importante de nouvelle technologie.
Global Competitiveness Report, 2005-2006
UTIL INTERNET Utilisation d’Internet. Nombre d’utilisateurs d’Internet en 2002 par 1 000 habitants.
Banque mondiale
NBREORDINATEURS
Nombre d’ordinateurs en 2002 par 1 000 habitants
Banque mondiale
DET ETR INV NAT Participation étrangère dans les inventions nationales, c’est-à-dire la part des demandes de brevet présentées à l’Office européen par des résidents étrangers par rapport au total des brevets détenus par des inventeurs nationaux.
OCDE
DET NAT INV ETR Participation nationale dans les inventions à l’étranger, c’est-à-dire la part des demandes de brevets présentées à l’étranger auprès de l’Office européen des brevets pour des inventions réalisées à l’étranger
OCDE
284 PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 2007 – ISBN- 978-92-64-03758-8 © OECD 2007
Code mnémonique des variables
Description Source
dans le total des brevets détenus par des résidents nationaux.
Obstacles aux échanges et à l’investissement
IND RESTR IDE Indice de restrictivité de l’IDE mesuré sur une échelle de 0 à 1 ; 0 = ouverture totale ; 1 = interdiction de l’IDE.
OCDE
OBSTACLES INT Obstacles à la participation de non-résidents dans des sociétés locales sur une échelle de 0 à1 ; 0 = les restrictions sont les moins nombreuses.
OCDE
PROC DISCR Importance des procédures discriminatoires à l’égard de l’IDE sur une échelle de 0 à 1 ; 0 = les procédures discriminatoires sont les moins nombreuses.
OCDE
DELAI EXP Délai nécessaire pour s’acquitter des procédures d’exportation, mesuré en nombre de jours.
Banque mondiale
DELAI IMP Délai nécessaire pour s’acquitter des procédures d’importation, mesuré en nombre de jours.
Banque mondiale
ÉDITIONS OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16
IMPRIMÉ EN FRANCE
(20 2007 05 2 P) ISBN 978-92-64-03758-8 – no 55800 2009
www.oecd.org/editions-:HSTCQE=UX\Z^Z:
Le texte complet de cet ouvrage est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.sourceocde.org/finance/9789264037595
Les utilisateurs ayant accès à tous les ouvrages en ligne de l’OCDE peuvent également y accéder via : www.sourceocde.org/9789264037595
SourceOCDE est une bibliothèque en ligne qui a reçu plusieurs récompenses. Elle contient les livres, périodiques et bases de données statistiques de l’OCDE. Pour plus d’informations sur ce service ou pour obtenir un accès temporaire gratuit, veuillez contacter votre bibliothécaire ou [email protected].
ISBN 978-92-64-03759-5 20 2007 05 2 P
Perspectives d’investissement international 2007LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT DANS UN MONDE EN CHANGEMENTLes conditions d’investissement direct étranger (IDE) au niveau mondial se sont améliorées en 2006, les flux d’investissement à destination des pays de l’OCDE ayant atteint 910 milliards USD, chiffre sans précédent depuis le montant record de l’année 2000. Les fusions et acquisitions transfrontalières, élément central de l’IDE, ont continué de progresser en 2007 et leur montant pourrait être finalement le plus élevé jamais enregistré. Ces évolutions ont suscité des inquiétudes dans certains milieux. Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’opinion publique se focalise depuis quelque temps sur le risque de perte d’emplois dû à la délocalisation de certains maillons de la chaîne de valeur d’entreprises nationales. En outre, les décideurs sont préoccupés aujourd’hui par le fait que des secteurs « stratégiques », englobant notamment des entreprises qui ont accès à des technologies ou ressources naturelles sensibles, passent aux mains d’investisseurs étrangers. Pourtant, l’internationalisation de l’activité économique, par l’intermédiaire de l’investissement et des échanges a été l’un des principaux facteurs qui ont contribué à la création de valeur dans l’économie mondiale au cours de la décennie écoulée. Preuve en est la croissance rapide et l’intégration plus complète des structures économiques internationales de plusieurs économies émergentes, qui sont devenues d’importantes sources d’investissement direct à l’étranger.
La présente édition des Perspectives d’investissement international se divise en deux grandes parties analytiques. La première traite de la recrudescence évidente, ces dernières années, des pratiques discriminatoires à l’égard des investissements transfrontaliers, phénomène qui s’explique par les craintes liées à la sécurité nationale et les préoccupations fondamentales connexes. Quatre chapitres résument les travaux menés par l’OCDE en prévision du Sommet du G8 de juin 2007, où cette question figurait parmi celles à examiner en priorité. Ces chapitres passent en revue les coûts associés à l’existence de restrictions excessives, examinent jusqu’à quel point les autorités peuvent définir elles-mêmes la notion de « sécurité », et proposent une méthodologie pour l’établissement de tableaux de bord concernant les restrictions réglementaires à l’investissement. La seconde partie porte essentiellement sur les nouveaux débouchés offerts par l’IDE et la nature évolutive du contexte économique international, dans lequel les investissements sont réalisés. Un des chapitres de cette partie est consacré aux liens entre l’IDE et les actifs intellectuels ; il s’attache en particulier à déterminer si les investissements internationaux peuvent favoriser (ou freiner) le développement des connaissances dans les pays hôtes. Un autre chapitre se penche sur l’importance des petites et moyennes entreprises pour l’IDE, compte tenu notamment de leurs liens avec les grandes entreprises.
Persp
ectives d’investissem
ent international 2007 LIB
ER
TÉ
D’IN
VE
ST
ISS
EM
EN
T D
AN
S U
N M
ON
DE
EN
CH
AN
GE
ME
NT
Perspectives d’investissement international 2007LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT DANS UN MONDE EN CHANGEMENT