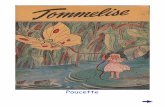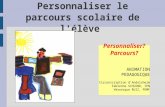PERSONNALISER L’ACTE...
-
Upload
truongxuyen -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of PERSONNALISER L’ACTE...
PERSONNALISERL’ACTED’ENSEIGNEMENTDu côté de l’imaginaire : La Morte amoureuse de Théophile Gauthier.
Tenir compte des différentes difficultés rencontrées par les E.I.P. afin de les remédier dans
une séquence ayant pour thème le récit imaginaire.
TABLE DES MATIERES
Pages
Du côté de l’imaginaire : La Morte amoureuse de Théophile Gauthier 3
capacités 3
connaissances 3
interrogations 3
Présentation synoptique de la séquence 4
Séance 3 : Quel genre de fiction ? 6
Consignes et définition de Todorov 6
Document de travail 7
Réponses attendues 8
Rédaction d’un texte de synthèse, aide à son élaboration et au classement des idées. 9
Elaboration du plan, brouillon guidé 10
Rédaction guidée. 11
Critères d’évaluation, grille 12
Première Bac Pro ‐ Français « Du côté de l’imaginaire : La Morte amoureuse de Théophile Gauthier. »
Capacités :
Interpréter le discours tenu sur le réel à travers le discours de l’imaginaire.
Réaliser une production faisant appel à l’imaginaire.
Connaissances :
Champ littéraire : le registre fantastique.
Champ linguistique : lexique des émotions, point de vue et modalisation du doute.
Interrogations :
Les récits imaginaires sont‐ils réservés aux jeunes lecteurs ?
Le lecteur d’œuvres de fictions fuit‐il la réalité ?
La séquence présentée ci‐après tente de tenir compte de différentes difficultés rencontrées par les
EIP afin de les pallier.
Premier type de difficulté : certains élèves maîtrisent déjà tout ou partie des notions abordées dans
la séquence. Pour ceux‐là (EIP ou non) une évaluation diagnostique est proposée en début de sé‐
quence, permettant de déterminer avec précision les contenus déjà acquis. Afin d’éviter redites et
ennui, les élèves ayant réussi l’évaluation diagnostique pourront réaliser d’autres tâches pendant les
séances reprenant ces contenus (en particulier la séance de langue).
Second type de difficulté : Certains élèves (dont souvent les EIP) ont du mal à se représenter les pro‐
cédures mentales séquentielles permettant de répondre aux attentes de l’institution scolaire. Les
activités proposées ici tentent donc d’expliciter au maximum les attentes et de détailler pas à pas les
procédures sous diverses formes, afin de donner à tous les élèves un cadre méthodologique précis.
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 3
PRESENTATION SYNOPTIQUE DE LA SEQUENCE
titre, dominante amorce Objectifs Supports Activités EIP Trace écrite
Séan
ce 1 :
« La morte
amoureuse : une
fiction. »
Lecture
A quoi servent les
récits imaginaires ?
Amuser les enfants ?
Fuir la réalité ?...
Elaborer en commun
la problématique qui
sera le fil conducteur
de la séquence.
Nouvelle intégrale. ‐ Elaborer des hypo‐
thèses à partir des
paratextes.
‐ Définir des attentes
de lecture à confir‐
mer ou infirmer.
‐ lecture magistrale
du début (à terminer
pour la séance sui‐
vante)
Liste des attentes de
lecture.
Problématique rédi‐
gée.
Séan
ce 2
Evaluation
diagnostique
Mise en route, pour
ceux qui ont terminé
en avance, d’un
travail de réalisation
d’un portfolio sur la
représentation de
femmes vampires
dans la littérature
et/ou au cinéma par
exemple…
Séan
ce 3 :
« Quel genre de
fiction ? »
1h30
Lecture
Rêve ou réalité ? ‐ Montrer le carac‐
tère fantastique du
récit de Théophile
Gauthier.
‐ Définir la notion de
fantastique
Nouvelle intégrale.
Tableau à compléter.
Définition du fantas‐
tique selon Todorov.
Travail par équipes.
Relecture de pas‐
sages clé en cher‐
chant des indices.
Mise en commun
écrite et orale.
Laisser la possibilité à
certains de travailler
sur tous les extraits à
la fois (Les EIP en
particulier seront
plus efficaces s’ils ont
la tâche à accomplir
dans toute sa com‐
plexité.)
Tableau complété.
Séan
ce 4 :
« Méthode :
rédiger un texte
de synthèse »
écriture
« Dans un texte
d’une vingtaine de
lignes, vous montre‐
rez en quoi La morte
amoureuse est un
récit fantastique. »
Etre capable de
rédiger un texte
argumenté et struc‐
turé d’une vingtaine
de lignes.
Traces écrites des
séances précédentes.
élaborer des critères
de réussite en com‐
mun.
Rédaction individuel‐
le.
Procédure détaillée
pour les élèves qui
ont du mal à « déve‐
lopper » une répon‐
se.
Tableau des critères
de réussite.
Synthèse rédigée.
Séan
ce 5 :
« La scène du
cimetière »
Lecture métho‐
dique
Le Bien est le Mal
sont‐ils à leurs places
habituelles ?
Construire le sens
d’une scène clé de
l’œuvre.
Le texte de la scène Lecture méthodique
Axes possibles :
La scène de destruc‐
tion du vampire : un
topos détourné
Portraits de Sérapion
et de Clarimonde :
qui représente le
bien, qui représente
le mal ?
Romuald, bénéfi‐
ciaire ou victime ?
Demander aux élèves
de prendre une
demi‐feuille de copie
par axe de lecture et
compléter au fur et à
mesure avec ce qu’ils
trouvent dans le
texte.
Les demi‐feuilles se‐
ront ensuite collées
dans le cahier selon
un ordre choisi en
commun.
Séan
ce 6 :
Langue
«émotions, point
de vue et dou‐
te…»
Préparer la séance
d’écriture.
Manuel Français
« Nouveaux cahiers »
Foucher p. 37 « Lexi‐
que : les émotions, la
peur », et pp. 55‐56,
« Les procédés qui
créent l’étrangeté. »
Travail en équipes de
2, puis correction au
tableau.
Travail sur le portfo‐
lio pour les élèves
ayant réussi l’évalua‐
tion diagnostique.
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 4
Séan
ce 7 :
Ecriture
« Tantôt je me
croyais être… »
Ecrire un texte fan‐
tastique à partir d’un
déclencheur.
« Tantôt je me
croyais un prêtre qui
rêvait chaque soir
qu’il était gentil‐
homme, tantôt un
gentilhomme qui
rêvait qu’il était
prêtre. »
Montrer le caractère
antinomique de ces
deux personnages,
puis en imaginer un
nouveau binôme an‐
tinomique permet‐
tant l’écriture d’un
texte fantastique.
« Tantôt je me
croyais un
_________________
qui rêvait chaque soir
qu’il était
_________________,
tantôt un
_________________
qui rêvait qu’il était
_______________. »
Texte relevé et noté.
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 5
La Morte Amoureuse Théophile Gauthier
Séance 3 : « Quel genre de Fiction ? »
Objectif : Caractériser la nouvelle comme appartenant au genre « fantastique ».
Compléter le tableau ci‐joint.
Constituer des équipes de travail pour chaque extrait.
Laisser la possibilité à certains de travailler sur tous les extraits à la fois (Les E.I.P. en particulier se‐
ront plus efficaces s’ils ont la tâche à accomplir dans toute sa complexité.)
Définition de Todorov
« (…) Ainsi se trouve‐t‐on amené au cœur du fantastique. Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se produit un événement qui ne peut s'ex‐pliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles : ou bien il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de l'imagination et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont ; ou bien l'événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Ou bien le diable est une illusion, un être imaginaire, ou bien il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants : avec cette réserve qu'on le rencontre rarement. (…)
Le fantastique occupe le temps de cette incertitude ; dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. »
Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique ,
© Tous droits réservés. Éditions du Seuil, 1970.
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 6
Extraits à relire
Ce qui pose problème (la
ou les raison(s) pour la
(les)quelle(s) on hésite
entre deux interprétations
Interprétation rationnelle
(citer le texte)
Interprétation surnaturelle
(citer le texte)
La distance qui
sépare la cure de
Romuald et le châ‐
teau de Clarimonde.
lignes 315 à 388 lignes 440 à 470
Le « réveil » de
Clarimonde lors de
la veillée funèbre.
Lignes 480 à 590
Le retour de Clari‐
monde et le départ
pour Venise.
Lignes 663 à 832
La double vie de
Romuald.
Lignes 7 à 27 Lignes 833 à 888
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 7
Réponses attendues
Extraits à relire
Ce qui pose problème (la
ou les raison(s) pour la
(les)quelle(s) on hésite
entre deux interprétations
Interprétation rationnelle
(citer le texte)
Interprétation surnaturelle
(citer le texte)
La distance qui
sépare la cure de
Romuald et le châ‐
teau de Clarimonde.
lignes 315 à 388 lignes 440 à 470
Comment se fait‐il que
Romuald mette 3 jours
pour aller à sa cure, et
seulement une nuit pour
revenir ?
A l’aller il chevauche un mu‐
let : « sa mule » l.370
Au retour il est sur un cheval
« Le fer de nos chevaux »
l.449
La chevauchée du retour semble ma‐
gique « feux follets », « yeux phospho‐
riques » « étincelles » lignes 453 à 460
Le « réveil » de
Clarimonde lors de
la veillée funèbre.
Lignes 480 à 590
Clarimonde est tenue
pour morte, elle n’est
donc pas censée se ré‐
veiller…
Peut‐être que Romuald a
rêvé : « Quand je revins à
moi, j’étais couché sur mon
lit. » ligne 591.
Le baiser de Romuald a réveillé Clari‐
monde comme dans la Belle au Bois
Dormant : « Et je rends la vie que tu as
rappelée sur moi une minute avec ton
baiser. » l. 582‐583.
Le retour de Clari‐
monde et le départ
pour Venise.
Lignes 663 à 832
Rêve ou réalité ?
« Je fis un rêve » l. 668
« Les sensations avaient été si vives
qu’il était difficile de croire qu’elles
n’étaient pas réelles. » l. 771‐772.
La double vie de
Romuald.
Lignes 7 à 27 Lignes 833 à 888
A‐t‐il réellement vécu
deux vies à la fois ?
Il rêve son autre vie : « Je me
croyais un prêtre qui rêvait
chaque soir qu’il était gentil‐
homme. » l.835‐837
« De cette vie somnambulique, il m’est
resté des souvenirs d’objets et de mots
dont je ne puis pas me défendre, et,
quoique je ne sois jamais sorti des
murs de mon presbytère, on dirait
plutôt, à m’entendre, un homme ayant
usé de tout et revenu du monde(…) » l.
20‐24
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 8
La Morte Amoureuse Théophile Gauthier
Rédiger un texte de synthèse.
Sujet : Dans un texte d’une vingtaine de lignes, vous montrerez en quoi La morte amoureuse est un
récit fantastique.
Elément de contenu pour la synthèse : Définition de « récit fantastique »
« (…) Ainsi se trouve‐t‐on amené au cœur du fantastique. Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se produit un événement qui ne peut s'ex‐pliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles : ou bien il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de l'imagination et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont ; ou bien l'événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Ou bien le diable est une illusion, un être imaginaire, ou bien il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants : avec cette réserve qu'on le rencontre rarement. (…) Le fantastique occupe le temps de cette incertitude ; dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. »
Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique ,
© Tous droits réservés. Éditions du Seuil, 1970.
Aide à l’élaboration de la synthèse : A partir de ce texte, donnez une définition simple pour chacune
des notions suivantes :
Naturel :
Surnaturel :
Merveilleux :
Fantastique :
Aide au classement des idées : D’après le texte de Todorov, quels sont les trois « ingrédients indis‐
pensables » pour faire un récit fantastique ?
‐
‐
‐
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 9
BROUILLON
Aide à l’élaboration du plan : chaque « ingrédient indispensable » constitue un argument et le titre
d’une partie. Dans chaque partie, cherchez un ou plusieurs exemples tirés de La morte amoureuse
qui permettent d’illustrer (vous pouvez vous aider du tableau en annexe, mais aussi de l’œuvre inté‐
grale)
I‐ _______________________________________________________________________________
Exemples tirés de l’œuvre :
II‐ _______________________________________________________________________________
Exemples tirés de l’œuvre :
III‐ _______________________________________________________________________________
Exemples tirés de l’œuvre :
Introduction :
‐ définir les notions importantes :
‐ Enoncer ou la problématique (= la question posée par le sujet) :
Conclusion :
‐ Répondre à la problématique :
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 10
Rédaction
Introduction
‐Phrase d’accroche. ‐Définir les notions importantes. ‐Enoncer la problématique.
Partie 1
‐Phrase qui annonce le titre et qui commence par un connec‐teur. ‐Un ou plusieurs exemples qui illustrent l’idée contenue dans le titre.
Partie 2
‐Phrase qui annonce le titre et qui commence par un connec‐teur. ‐Un ou plusieurs exemples qui illustrent l’idée contenue dans le titre.
Partie 3
‐Phrase qui annonce le titre et qui commence par un connec‐teur. ‐Un ou plusieurs exemples qui illustrent l’idée contenue dans le titre.
Conclusion
‐Réponse à la problématique en une ou deux phrase(s).
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 11
Critères d’évaluation
(Exemple de grille négociée avec une classe de niveau assez faible)
Prénom et nom :
Date :
Critère de réussite note commentaire
Rédiger un texte d’au moins 20 lignes
répondant au sujet posé
__________ /2
Le texte doit être structuré :
‐ une introduction qui définit les no‐tions et énonce la problématique. ‐ Un paragraphe pour chaque argu‐ment (tiré de la définition) illustré par un ou plusieurs exemples (tirés du ré‐cit ou du tableau). ‐ Une conclusion qui répond à la pro‐blématique.
__________ /1
__________ /2
__________ /1
Utiliser des liens logiques. __________ /1
Les exemples apparaissent sous forme de
citation entre guillemets.
__________ /1
Syntaxe : Faire des phrases courtes et
bien construites.
__________ /1
Orthographe : aucune erreur sur les ac‐
cords du pluriel et du féminin.
__________ /1
Note :
Emilie LHUILLIER -Académie de Montpellier- 12