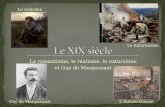Nouvelles études françaises sur le romantisme
-
Upload
istvan-fodor -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
Transcript of Nouvelles études françaises sur le romantisme
ISTV~N FODOR
NOUVELLES t~TUDES FRAN~AISES SUR LE
RO MANTIS ME
Ces derni6res anndes, l'intdr& ~t l'dgard du romantisme s'est particuli6rement accru en France. La Socidtd des l~tudes Romantiques, rdcemment fondde, fait paraRre plusieurs col- lections de livres (Nouvelle BibliothOque Romantique, Etudes Romantiques) et une importante revue internationale pluri- disciplinaire, intitulde Romantisme. Parallblement aux theses et aux articles qui jettent de nouvelles lumi~res sur certains aspects de ce courant international, des ouvrages de synth~se voient 6galement le jour les uns apr& les autres, et ils m6ri- tent uric attention particuli~re, surtout parce qu'ils ne se con- tentent pas d'dtudier le romantisme comme un courant purement littdraire, mais le traitent dans un contexte historique, sociologi, que etiddologique. Malheureusement les nouvelles synthbses n'dtudient pas le romantisme ~ l'dchelle internat ionale.
La synth6se d 'Henri Peyre, professeur de l 'Universitd de New York Qu'est-ee que le romantisme? 1 digne pendant de son Qu' est-ee que le elassieisme ?2 fait exception, mais elie aussi se contente d'dtudier les principales littdratures occidentales (anglaise, frangaise, allemande) et les :principaux th~mes du romantisme. La rdponse qu'il propose ~ la question posde darts le titre du livre n'est pas tr& claire, parce que sa notion du romautisme est un peu diffuse. Presque tousles auteurs de ta deuxi6me moitid du XVIII c si~cle ~t nos jours, de Rousseau
1 H. Peyre, Qu'est-ee que le romantisme ? (Paris: Presses Universitaires de France, 1971).
2 H. Peyre, Qu'est-ce que le classlcisme ? (Paris: Droz, 1933); (Paris: Nizet, 1965, ddition revue et augment6e).
16
242 FODOR
/t Aragon et /t Michel Butor, rentrent pour lui dans la cat6-: gorie du romantisme. Bien qu'il critique la th6orie du pr6ro- mantisme, il 6tudie longuement le ~ premier romantisme ~ fran~ais (1760-75) sans en donner aucune explication sociale ou historique. Ce ~ premier romantisme ~ pr6c~de - se lon lui - les autres premiers romantismes nationaux. Sa d6finition du romantisme, bas6e sur la connaissance de la nouvelle litt6rature fran~aise ou anglo-saxonne consacr6e au romantisme est plut6t th6matique, bien qu'elle n'exclue pas l'histoire. Parmi les th~mes romantiques, il 6tudie la r6volution, le mal du si~cle, la religion panth6iste et le mysticisme. L'6tude th6ma- tique mSme aurait gagn6, si l'auteur avait 6galement &udi6 l'individualisme, l'histoire, l'amour romantiques, etc. Malgr6 la structure th6matique du livre, l'histoire et l'histoire des id6es n'en sont pas absentes: l'auteur parle de la R6volution comme th~me romantique, de la r6action des 6crivains aux r6volu- tions, et il 6claire m~me tr~s bien le r61e des id6es socialistes dans le romantisme social. Par contre, il nie qu'il y ait un rapport quelconque entre le romantisme et la r6volution industrielle, ce qui semble pourtant &re reconnu par presque tous les chercheurs. Un seul chapitre 6tudie la forme et le style romantiques et propose une analyse nouvelle de la th6orie romantique de l'imagination et du symbole.
Si Peyre propose une image th6matique relevant plut6t de l'histoire litt6raire traditionnelle, la monographie de Max Milner 3 pulse beaucoup plus largement dans l'histoire, la sociologie et les autres sciences humaines. Toute la collection de Litt~rature fran~aise, publi~e chez Arthaud 6tudie la litt6- rature dans u n large contexte d'histoire sociale et d'histoire de la civilisation. Milner est nettement influenc6 par F6cole historique des Annales qui 6tudie l'histoire de la civilisation et des mentalit6s. Pour Milner, le romantisme n'est pas seule- merit un courant litt6raire, mais un grand processus de trans- formation des mentalit6s. I1 est vrai qu'il envisage plut6t le
3 M. Milner, Le Romantisme L 1820--1843. (Paris: Arthaud, 1973).
ETUDES FRAN~AtSES SUR LE R O M A N T I S M E 243
r6sultat et non pas le long processus complexe, plein de contra- dictions de cette transformation. Au centre de cette histoire de la litt6rature se trouvent non pas les auteurs et leurs oeuvres, mais la vie et le mouvement litt&aires qu'il 6tudie darts un large contexte historique et social, m~me si dans ce volume les limites chronologiques sont les dates litt6raires: 1820, la publi- cation des Mdditations de Lamartine, et 1843, la chute des Buryraves de Hugo, consid6r6es traditionnellement comme les dates de la naissance et de la fin du mouvement romantique fran~ais. Mais ceci s'explique plut6t par des raisons techniques: la s6rie traite en trois volumes ~ le romantisme )) (1820-1896) et consid~re le romantisme comme un large mouvement qui domine tout le si~cle3
L a structure mSme du livre refl&e son aspiration ~t ~tre plut6t l'histoire d'une civilisation qui a pour point de d6part te g6n6ral, le collectif, le mouvement et la structure globale,: et qui n'6tudie les auteurs que plus tard, dans une sorte d'appen- dice. Les proportions des chapitres caract6risent la conception du livre: la partie g6n6rale est trait6e sur 246 pages, les auteurs sur ~t peine plus de 100 pages .
Le premier chapitre 6tudie la conjoncture ~conomique, sociale et politique, puis il analyse ~ fond les points d'attaehe directs de la soci6t6 et de la culture, dans le chapitre consacr6 aux, conditionnements mat6riels de la production litt6raire. Ce chapitre utilise les r6sultats de la sociologie de la litt6rature et de la culture et d6crit, par une analyse exacte, le processus de la commercialisation, de la transformation de la litt6rature en marchandise. I1 parle de la situation sociale de l'6crivain,. des droits d'auteur, de la cons6quence du d6veloppement de la presse, de la naissance d'une ~ litt6rature industrieUe ~). I1 fait une constatation tr~s importante: malgr6 la diff6rence de la situation financi~re des romantiques, ceux-ci avaient besoin de leurs droits d'auteur pour vivre.
R. Pouilliard, Le Romantisme IlL 1869--1896. (Paris: Arthaud, 1968); le second volume n'a pas encore paru.
16"
244 rODOR
La deuxi~me partie (Les milieux et les ~tapes) propose une br~ve histoire du mouvement romantique frangais, il montre les luttes id6ologiques et litt6raires des deux g6n6rations roman- tiques, les deux centres du romanfisme, le romantisme monar- ehiste de dro i te (Chauteaubriand, Hugo, Lamartine, Vigny) et le centre lib6ral (Constant, Stendhal, Sainte-Beuve, M6rim6e, les historiens), ainsi que leur union dans la deuxi~me moiti6 des ann6es 20 et l'identification du romantisme et du lib6ralisme. La deuxi~me g6n6ration romantique (Gautier, Nerval) est pr6sent6e dans le dynamisme de l'espoir de la r6volution de 1830, et de ses suites d6courageantes. Le triomphe du romantis- me (1830-1836) est suivi d 'un reflux, caract6ris6 par le ren- forcement des tendances apolog6tiques bourgeoises ( 1 8 3 6 - 1843). Voici comment il caract6rise le dilemme des 6crivains apr~s 1830: t~ La R6volution de 1830, dans laquelle ces deux courants se sont confondus, va poser le probl6me en termes nouveaux. Devant une bourgeoisie solidement install6e aux, postes de commande et soucieuse d'utiliser ~t son profit les libert6s politiques qu'elle a arrach6es, ceux qui r6clamaient la libert6 dans l'art auront le choix entre deux attitiades: ou bien tenter de s'int6grer ~t cette s0ci6t6 en faisffnt jouer la libert6 arfistique sur un plan surtout formel (versification, respect des unit6s, m61ange des genres), et en T ournissant ~t cette soci6t6 des modules, les d6rivatifs ou les 6pouvantaiis qu'elle r6clame, ou bien faire jouer cette exigence de libert6 contre la bourgeoisie toute-puissante et mettre e n question les fonde- ments de l 'ordre social, soit en analysant impitoyablement ses m6canismes, soit en cherchant les contacts avec les masses, soit en s'enfermant dans des attitudes teint6es de nihilisme. C'est h ce moment-l~t seulement que le romantisme frangais r6v61era sa vraie nature, qui est, tout compte fait, moins esth6ti- que que philosophique, 6thique et sociale. ~)
A la suite de ce court chapitre diachronique nous trouvons un long chapitre donnant une description synchronique et th6matique du romantisme (Perspective thdmatique) qui analyse le ~ ressourcement romantique ~r, les rapports de l'artiste et
ETUDES FRANCAISES SUR LE R O M A N T I S M E 245
de la soci6t6, ainsi que ceux d e l'art et de la vie. Si jusqu'h pr6sent, dans ses analyses pertinentes, Milner s'est servi plutft des m6thodes des historiens des Annales, dans l'analyse th6mati- que il utilise certaines cat6gories ph6nom6nologiques de Geor- ges Poulet, en recourant parfois aux constatations de marxistes tels que Gy. Luk~cs et P. Barb6ris.
La presentation des th~mes est nouvelle: un des plus grands sujets du romantisme est ~ le temps comme exp6rience int6ri- eure >> et le temps historique dont il 6tudie les diff&entes mani- festations. Le <~ primitivisme ~> et le gu6t du pass6 supposent 6galement aussi l'orientalisme et le goflt du folklore. Le chapitre ~< 6nergie >~ regroupe des traits aussi diff6rents que le mythe de Napol~on, le probl~me esth6tique du dynamisme de l'ceuvre d'art et de la cr6ation, l'intensit6, la couleur, le mouvement, l'expansion, la passion, la r~volte, le refus des limites. La nostalgie de l'arribre-monde parle des sources occultes du romantisme, des tendances syncr~tiques, du r6ve comme moyen de contact avec l'invisible, du fantastique, de la reverie, de la recherche de l'unit6 perdue. Dans la partie consacr6e ~t la lib6ration des moyens d'expression, il traite de la comp6n6tra- tion des genres, de la conqu~te du mot propre et de la musique int6rieure.
Le chapitre intitul6 L'artiste et la socidtJ &udie les diff6rents rapports possibles entre l'artiste et la soci6t6 bourgeoise: il analyse, d'une part, les id6es litt6raires du socialisme utopiste (saint-simoniens, fouri6ristes) et du socialisme chr6tien (La- mennais), ainsi que les id6es antibourgeoises, mais nihilistes, de l'art pour l'art et du dandysme. I1 critique 6galement l'id6a- lisme rdvolutionnaire illusionniste des grands romantiques.
Le dernier chapitre nous semble un peu hdt6rog6ne. II r6sume les diff6rents genres litt6raires proches de la vie (roman, drame) mais/'analyse de la po6sie lyrique, dont la renaissance date de l'6poque romantique, aurait 6galement m6rit6 une mention. M~me s'il reconna~t la possibilit6 de donner plusieurs r6ponses/t la m~me r6alit6, il ne parle gu~re d'autres courants que du romantisme, et tfiche de classer tousles auteurs darts
,246 FODOR
la cattgorie du romantisme. (Stendhal et Balzac aussi). Ceux qui ne peuvent aucunement ~tre classts dans cette cattgorie (p. e. P. L. Courier) ne figurent que dans la dernitre partie, le dictionnaire. Ainsi, malgr6 ses grands mtrites et sa nou- veautt, le Romantisme de Max Milner n'est pas suffisamment concret, l'auteur ramtne tout au romantisme, l'analyse concrtte de la coexistence du romantisme, du rtalisme, du ntoclassi- cisme et d'autres courants fait dtfaut, ainsi que l'explication du comment et du pourquoi de la transformation de la menta- lit& Certains probl~mes essentiels de la naissance du romantisme (probl~me du ~ prtromantisme ~) et de sa fin ne sont m~me pas touchts, la notion m~me de ce courant reste vague.
La transformation de la litttrature et de la mentalit6 est expliqute par un processus historique et sociologique complexe dans le Manuel marxiste d'histoire littdraire de la France, publi6 sous la direction de Pierre Abraham et Roland Desnt. 5 La coordination des deux volumes consacr~s ~t la ptriode allant de 1789 h 1848 a 6t6 assurte par Pierre Barbtris et Claude Duchet, influencts par les idtes esthttiques et litttraires de Gy6rgy Luk~tcs et s'occupant ~t la fois de la thtorie et de rhistoire litttraires. Ces deux volumes proposent un large tableau, r~- sultant des recherches, en grande partie originales, des aspira- tions sociales, idtologiques et esthttiques de l'tpoque. Les dates-limites chronologiques (de 1789 ~t 1848) et la conception des deux volumes sugg~rent une vision homogtne, essentielle- ment historique. La ptriode allant de 1789 ~t 1848, de la grande R~volution fran~aise ~t la premitre manifestation autonome de la classe ouvri~re, qui devient une Classe pour soi en juin 1848, correspond, sur le plan social, h la victoire de la bourgeoi- sie, sur le plan litttraire au romantisme, au r~alisme c~itique, mais aussi au ntoclassicime et aux survivances des Lumi~res et ~t une litttrature bourgeoise typiquement apologttique (tht~ttre bourgeois).
P. Abraham--R. Desn6 6d.,Histoire litt~raire de la France 1789-- 1848., vol. 1--2, coordination assur6e par P. Barbtris et CI. Duchet (Paris: t~ditions Sociales, 1972-- 1973).
ETUDES FRAN(~AISES SUR LE ROMANTISME 247
L'rtude approfondie et minutieuse de l'histoire sociale et de l'histoire des idres permet aux auteurs de ce manuel de tirer la conclusion que la base sociale et idrologique du roman- tisme est la rrvolte anticapitaliste des deux classes frustrres des rrvolutions bourgeoises successives: la noblesse et la petite bourgeoisie, ainsi que la grande contradiction entre l 'idral ~ citoyen ~> des Lumirres qui survit d'une part, et d'autre part les angoisses quotidiennes de l'existenee bourgeoise post- rrvolutionnaire rrelle, la continuelle peur de la prol~tarisation de l'individu librr6 de ses liens frodaux. Les rrvolutions ne remplissent pas leur promesse: au lieu d'une drmocratie petite- bourgeoise crratrice permettant le libre-6panouissement de l'individu, nait le grand capitalisme manceuvrier qui produit un rrgime bas6 sur l 'alirnati0n et la prol&arisation et domin6 par une nouvelle et mince couche de l'aristocratie de l'argent. Les vieilles certitudes sociales et idrologiques tombent, se heurtent continuellement aux anciennes et aux nouvelles bar- ri~res. C'est surtout Pierre Barbrris qui a 6tudi6 ce processus ~t partir de nombreux textes littrraires et non-litt6raires dans Balzac et le real du si~cle, 6 et il en tire des conclusions dans ce volume.
Dans le manuel, les textes littrraires sont 6tudirs dans un contexte historique (soci&6, civilisation, idrologie), le processus littrraire est envisag6 sous le triple rapport auteur-0euvre- lecteur. Les parties les plus neuves des volumes sont les chapi- tres consacrrs ~t la sociologie de la culture (Soboul, Orecchioni, Parent) qui 6clairent le nouveau public' de la littrrature et sa nouvelle fonction, ainsi que la fin du rapport direct entre l 'auteur et le leeteur et la drpendance indirecte, de moins en moins cachre des besoins et des lois du marchr. Ne connais- sant pas son public, l 'auteur se crre des illusions: tant6t il pense qu'il est le guide de l'humanit6 (Hugo), tan t f t il se considrre comme le paria de la socirt~ (Vigny), tant6t il pense
e p. Barbrris, Balzac et le mal du si~cle vol. 1--2 (Paris: Gallimard, 197o).
248 FODOR
qu'il ne travaille que pour lui-m~me (l'art pour l'art). C'est 6galement une grande nouveaut6 que des chapitres substantiels s'occupent des diff6rents genres infralitt6raires qui ont souvent influenc6 la grande litt6rature. Je songe avant tout ~t la litt6ra- ture de colportage, au roman-feuilleton, au m61odrame, au roman gothique et aux chansons. Malgr6 les difficuit6s de coordonner un manuel 6crit par pros de soixante auteurs, ce livre a trouv6 l'6quilibre n6cessaire entre les oeuvres et les attteurs individuels d'une part, et les piobl~mes g6n6raux collectifs de l'autre. Ces deux parties sont 6troitement li6es, elles ne sont pas coup6es en deux, comme dans le livre de Milner et d a n s la collection Litt~rature francaise. Parfois peut-&re, ces deux parties auraient-elles 6t6 mieux harmonis6es si les auteurs du manuel avaient mieux 6tudi6 les parties inter- m6diaires, les m6diateurs, entre les auteurs individuels et les processus collectifs, sociaux et ]itt6raires, c'est-h-dire les groupes litt6raires, les journaux et les revues, ainsi que les genres et les formes litt6raires. Le chapitre de Barb6ris, consacr6 au roman r6aliste est la seule exception qui traite d'un genre.
La m6thode historique du manuel explique pourquoi il ~claire ~galement tr~s bien les p~riodes plutOt n6glig6es par l'histoire litt6raire traditionnelle, par exemple les p6riodes si peu connues et pourtant si importantes pour l'avenir de la R6volution et de l'Empire, Le chapitre tr~s dense sur les con- flits id6ologiques de la R6volution, les nouvelles conditions de la lecture, la d6mociatisation de la litt6rature est 6crit par le grand sp6cialiste de la R6volution, l'historien Albert Soboul. Un tableau est 6galement pr6sent6 sur la presse et la musique, qui ont acquis une tr~s grande importance pendant la R6vo- lution. Par cons6quent, si l'6poque r6volutionnaire n'a pas cr66 beaucoup de chefs-d'0euvre et bien que le style reste n60classique, elle a donn6 naissance ~t une nouvelle conception de la culture, la culture destin6e aux masses, doric h sa diffusion massive, et la grande mode du roman et du m61odrame est le signe avant-coureur de l'6mancipation du roman et du drame /t l'6poque romantique.
ETUDES FRANCAISES SUR LE ROMANTISME 249
Le deuxi~me grand chapitre (De la France rOvolutionnaire d la France rOvolutionnOe) pr6sente les aspirations id6ologiques dans la France post-thermidorienne. C'est ici que se situe
�9 l'&ude de P. Barb6ris et de M. Baude sur le <~ premier roman- tisme 7> et sur ses rapports avec la conscience humaine moderne, qui prouve que l'anticapitalisme romantique et certains traits du romantisme existaient d6j~ avant le mouvement romanti- que, m~me avant la R6volution frangaise, dans les ~euvres de Rousseau, de Chateaubriand et de Senancour, Bien stir, il ne s'agit pas de la r6habilitation du terme <~ pr6romantisme ~>, mais d 'un anticapitalisme romantique qui exprime le sentiment d ' inadaptation h une r6alit6 qui s'embourgeoise, ainsi que la soif d'absolu et l'exigence de la totalit6 de toute une g6n6ration. Les auteurs insistent aussi sur les diff6rences entre ce <~ premier romantisme ~> et le vrai romantisme. La partie consacr6e ~t l'histoire des id6es traite de la survie mat6rialiste-sensualiste des Lumi~res (J. Gaulmier: les Id6ologues) et souligne la transformation partielle du rationalisme voltairien en apologie bourgeoise (A. Billaz: Les ills de Voltaire), mais elle brosse 6ga- lement des tableaux justes et 6quitables sur les penseurs con- servateurs (J. Gritti: L. de Bonald, R. Triomphe: J. de Maistre; J. Madaule: Chateaubriand). Ce dernier palle des contradic- tions int6rieures de Chateaubriand et montre bien son 6volution d 'un romantisme de droite vers un romantisme de gauche. Les id6es lib6rales, philosophiques et litt6raires sont 6galement bien 6tudi6es par S. Balay6, (Madame de Stall, le groupe de Coppet) M. Baude (Constant) comme un des foyers du futur romantisme.
La troisi6me partie (Les conditions de la production littO- raire) constitue une 6tude pluridisciplinaire tr6s int6ressante sur la d6mocratisation et en m~me temps sur la commercialisa- tion de la litt6rature. J'insiste particuli6rement sur l'&ude de D. Coste sur la langue et sur la pens6e linguistique, l'article de P. Orecchioni qui propose une 6tude sociologique, bas6e sur les statististiques, de l'6dition frangaise et l'6tude de F. Parent sur l e r61e des cabinets de lecture et de leur public. La presse
250 FODOR
et la critique expriment les aspirations, les attenteS des diff6- rentes couches de la bourgeoisie. Leur r61e grandit sans cesse depuis la Restauration. Elles sont &udi6es respectivement par P. Albert et R. Fayolle.
Des chapitres tr6s int6ressants au point de vue th6orique sont 6crits par P. Barb6ris (Les romantismes) qui distingue le romantisme aristocratique et le romantisme pl6b6ien, et 6tudie leur influence r6ciproque. La base de ces deux romantismes est l'anficapitalisme romantique. Ensuite, il confronte le roman- tisme r6volutionnaire et la r6alisme critique dans l'esprit de Gy. Lukfics, en insistant sur l'iUusionnisme id6aliste petit- bourgeois des romantiques r6volutionnaires et la lucidit6 des r6alistes critiques. Nous avons parfois l'impression qu'il est trop s6v~re ~t l'6gard des romantiques progressistes (Hugo, G. Sand, Michelet), mais les autres auteurs du manuel com- pl&ent par une analyse concr&e et nuanc6e les constatations th6oriques de Barb6ris (H. Meschonnic, A. Ubersfeld: Hugo, A. Ubersfeld: G. Sand).
Un autre m6rite tr6s important du manuel est qu'il fait connaitre les syst6mes id6ologiques typiquement bourgeois dans leur complexit& C'est de ce dernier que s'occupe le chapitre intitul6 Les iddologiques de la France nouvelle~ Les combats de la bourgeoisie. M. Bouvier-Ajam r6sume l'6con0mie lib6-- tale et la litt6rature historique; J. Gaulmier &udie les d6mocra- tes rationalistes, fid~les aux id6es des Lumi~res (P.-L, Courier, B6ranger), P. Barb6ris se penche sur le mythe de Napol6on, O. Cecconi analyse la naissance de l'6clectisme (Cousin)et du positivisme (Comte), Barb6ris les id6es des saint-simoniens. Malgr6 cette richesse, ce chapitre nous laisse iun peu sur notre faim, car il est loin d'etre complet, et ainsi le vrai tableau des luttes id6ologiques des diff6rentes couches ne se dessine pas dans toutes ses nuances. A c8t6 des historiens lib6raux (Thierry, Thiers, Guizot) il aurait fallu mettre les historiens d6mocrates (Michelet, Quinet) et le lucide conservateur Tocqueville. Leur place h la fin du second volume dans le chapitre L'esprit de 1848 n'est pas justifi6. Ils exerc~rent une grande influence
ETUDES FRAN~AISES SUR LE ROMANTISME 251
sous la monarchie de Juillet 6galement. La m~me dispersion peut ~tre observ6e dans l'analyse des diff6rentes id6es socia- listes. Les saint-simoniens sont dans ce chapitre, Fourier darts L'esprit de 1848, Proudhon, Louis Blanc, Cabet, et d'autres socialistes ou communistes pr6marxistes sont h peine mention- n e s .
La communication des arts constitue un probl~me important de litt6rature compar6e. A. R. James traite de la ~ fraternit6 des arts ~) (litt6rature et arts plastiques), L. Guichard et F. Robert parlent des rapports de la musique et de la littdrature, J. Gandon nous parle de Talma et de l'6volution du th6fitre, A. Ubersfeld donne une analyse nouvelle du m41odrame.
Le chapitre Face au sikcle couvre les itin6raires individuels des principaux auteurs de l'4poque (L.' Le Guillou: Lammenais; H. Guillemin: Lamartine; M. Tournier: Vigny; C. Duchet: Musset; R. Molho: Sainte-Beuve avant 1848; M. C. Book: Gautier et les Jeunes-France; J. Mallion: M4rim6e; M. Bou- vier-Ajam: Dumas; G. Cogniot: A. Barbier; J. Bruneau: Le premier Flaubert; P. Barb6ris-A. Wurmser: Balzac; G. MouiUaud: Stendhal; A. Ubersfeld: George Sand; H. Meschonnic-A. Ubersfeld: Hugo). Parmis ces portraits je signale avant tout pour leur nouveaut4 l'&ude de M. T0urnier sur Vigny, celle de C. Duchet sur Musset, celle de Wurmser et de Barbdris sur Balzac, les articles de G. Mouillaud sur Stendhal, et ceux de Meschonnic et d'A. Ubersfeld sur Hugo, Les 6tudes r6ussissent h donner un tableau exact de la carri6re des principaux cr6ateurs, en tenant compte des motivations sociales et psychologiques, et elles proposent 6galement des analyses des oeuvres.
Malgr6 la r6ussite de tousles chapitres, la partie Nouveaux horizons et continuit~s reste h6t6rog~ne (R. Jean: Nerval, J. Madaule: Maurice et Eug6nie de Gu4rin, J. Bellemin-NoEl: La litt4rature fantastique, P. Brochon: Evolution de la chanson, R. Guise: Le roman populaire, J. Guillon: C1. Tillier, P. Bro- chon: La litt6rature de colportage, R. Lafont: La litt6rature d'oc) car elle m61ange les 616merits de la culture des masses et
252 FODOR
de la po6sie romantique. On pourrait dire la m~me chose de l ' importante partie consacrde h l'Esprit de quarante-huit (P. F. Bowman: La litt6rature r6volutionnaire en 1848; P. Gaudibert : Fourier et le fouri6risme; F. Marmande: Chansons et po&es ouvriers; P. Albert: La presse sous la IU R~publique; G. Co- gniot: M6nard; J. Chomarat: Tocqueville; J. Seebacher: Michelet, J. Bruhat: L'esprit de 1848.)
Le chapitre intitul6 Au milieu du ehemin du sidele 6crit par Barb6ris montre bien l 'importance de la coupure de 1848. Le r6alisme et le romantisme bas6s sur l'individu actif qui croit en l'histoire, seront remplac6s, ~ cause de la perte des illusions romantiques, par un id6alisme ~ imaginaire d6risoire ~ et un ~ r6alisme de renoncement ~). Le personnage actif est remplac6 par des personnages passifs, insuffisamment individualis6s, qui, au lieu de faire l'histoire, en subissent la fatalit6 (songez surtout ~ Flaubert).
Les deux volumes se terminent par une tr~s bonne biblio- graphic de R. Fayolle, et les tableaux chronologiques de Gold- zink.
Si le manuel marxiste pose l'ensemble des probl~mes relatifs au romantisme et au r6alisme au point de vue social et de l'id~ologie sociale, le grand livre de P. B6nichou: Le Sacre de l'derivain 1750-18307 insiste sur un seul aspect de cette trans- formation des mentalit6s: la transformation m&aphysique. L'individu n'est plus soumis ~t une hi6rarchie stable, f6odale, mais il est aussi de moins en moins soumis / t une hi6rarchie m6taphysique. L'id6e orthodoxe d'un dieu absolu tout-puissant est morte 6galement avec la disparition d e la foi absolue darts ie roi, l 'aristocratie et le clerg6. I1 est remplac6 par d'autres absolus, humains ou naturels dont Fun est le po&e et l'artiste de g6nie. Le livre de P. B6nichou traite justement de la nais- sance du po&e-mage romantique. Le sous-titre du livre dit exactement l 'ambition de l 'auteur: ~ Essai sur l'av~nement
P. B6nichou, Le Saere de l'derivain 1750--i830. Essai sur l'av6ne- merit d'un pouvoir spirituel la'/que clans la France moderne (Paris: J. Corti, 1973).
ETUDES FRAN~AISES SUR LE R O M A N T I S M E 253
d'un pouvoir spirituel laique dans la France moderne ~. Le pouvoir spirituel laique - qui dtait essentiellement critique ~t l'dpoque, est nd vers le milieu du XVIII e si~cle ~t cause de la ddsudtude des dogmes et du discrddit des autoritds tradition- nelles, ~ Le philosophe a surgi d'abord [ . . . ] comme concurrent direct et successeur avoud du thdologien . . . Le porte est venu ensuite combiner son ministate h celui du penseur ~>. I1 dtudie la littdrature au point de vue sociologique et iddologique. L 'homme de lettres, le philosophe remplissent cette fonction au XVIII e si~cle, mais ils sont discrdditds vers 1800 et le po&e - d ' o r i g i n e divine - les remplace avec la renaissance d'une
iddologie irrationnelle qui r~gne dans les deux camps roman- tiques: dans le camp aristocratique contre-rdvolutionnaire, comme dans le camp libdral. Apr~s la Revolution de 1830 le po&e et le philosophe sont de nouveau r6unis, par exemple, chez Hugo, o~ le po&e devient philosophe du progr~s, homme des utopies. Malheureusement, Bdnichou, n'dtudie pas l'dpo- que de la monarchie de Juillet, ni le Second Empire o/1 le po6te devient de plus en plus un 6tre en marge de la socidt6.
Bdnichou &udie le probl6me de cette transmission des pouvoirs du XVIII e si6cle (En qu&e d'un sacerdoce laique, Le porte sacrd, Illuminisme et podsie, Louis-Claude de Saint-~ Martin), mais l'essentiel est consacrd au po&e au XIX ~ si~cle: II se penche d'abord sur le camp contre-rdvolutionnaire: oil la podsie d'origine divine est utilisde contre la philosophie matdrialiste des Lumi6res. I1 traite surtout du G~nie du christia- nisme de Chateaubriand, de Ballanche et des ddbuts de Lamar- tine. Pour d'autres raisons, darts le camp libdral aussi, le spiritualisme laique triomphe dans l'esthdtique. Les id6es de Senancour, de Nodier, de Madame de StaE1 et de Benjamin Constant, tout comme celles des dclectiques (Cousin, Jouffroy) sont teintdes de ce spiritualisme qui dl~ve le po&e dans l'infini. La r6volution romantique rdunit vite les deux groupes (La Muse Franr et le Globe) et donne au po&e une haute mission sociale o~t se refl&ent aussi les illusions d'une <~ classe pensante ~>, d'une aristocratie de l'intelligence qui pourrait
254 FODOR
diriger la soci6t6. Cette union est devenue possible parce qu'il n 'y avait pas de retour absolu ~t l 'orthodoxie religieuse et sociale dans le groupe des jeunes royalistes non plus. Ils exal- taient l'individu et non pas sa soumission. Ensuite, il analyse cette idle de divinisation du po&e par la grande g6n~ration (Vigny, Hugo, Sainte-Beuve) puis sa transfolmation h la suite de la r6volution de 1830 par les membres de la Jeune- France sous l'influence de la d6ception, de l'impossibilit6 de r6unir l'id~al et le R~el, le Po&e et la Soci6t6. C'est pourquoi, darts la th6orie de l 'art pour l'art, Gautier faille h la fois l'id6al et le r6el et il consid~re l'art comme une pure jonglerie.
En r6alit6 - pense-t-il, ~ dans la religion po&ique n6gative qui nait de la m6sentente du romantisme avec la soci&6, il y a et il y aura longtemps une marque d'impuissance, un signe et une tentative du vide. Le po&e n'est rien, au moment m~me o~ il est tent6 de se croire tout ~.
Ce qui, par contre, est discutable, c'est que B6nichou con- sid~re le philosophe, le po&e et en g6n6ral l'intellectuel comme u n ~tre qui vit au-dessus de la soci&6, e t trouve qu'ils sont ~t un certain degr6, de par leur fonction, les juges de la soci&6 en m~me temps que ses soutiens. C'est ainsi qu'il croit pouvoir expliquer l'anticapitalisme des romantiques. En r6alit6, notre sens, cet anticapitalisme s'explique plut6t par l'anti- capitalisme d'importantes couches sociales, qui veulent rester fid~les h l'id6al ~ citoyen ~ au lieu d'adopter l'atomisme et l'ali6nation de l'Enrichissez-vous.