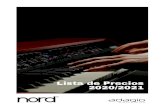nord-livblan2.pdf
-
Upload
reynold-junior-mendes -
Category
Documents
-
view
73 -
download
0
Transcript of nord-livblan2.pdf
-
MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPRATION EXTERNE (MPCE)
DIRECTION DPARTEMENTALE DU NORD
LMENTS DE PROBLMATIQUE DPARTEMENTALE DU NORD, Vol. II
(Version de Consultation)
Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD)
Centre des Nations Unies pour les tablissements Humains (CNUEH-Habitat)
Projet dAppui en Amnagement du Territoire (HAI-94-016)
-
2
4.- LE CONCEPT DAMNAGEMENT ET DE DVELOPPEMENT............................... 6 4.1- LE DIAGNOSTIC ........................................................................................................... 6
4-1-1.- LES GRANDES CONTRAINTES 12 4-1-1-1.- Des infrastructures inadquates ou sous-quipements du dpartement. ..... 13 4-1-1-2.- Le drainage de la Plaine du Nord..................................................................... 14 4-1-1-3.- Insuffisance de systme dirrigation ................................................................ 14 4-1-1-4.- La faiblesse des institutions............................................................................... 16 4-1-1-5.- Labsence dun vritable aroport international............................................ 17 4-1-1-6.- Linsuffisance et linadquation des services et quipements publics. ......... 17 4.1.1.7.- Dgradation des infrasttructures routires et enclavement des montagnes
humides. ............................................................................................................... 18 4-1-1-8.- Faiblesse des rendements du secteur agricole ou dclration marque de la
production agricole. ............................................................................................ 18 4.1.1.9.- Faiblesse des infrastructures daccueil et de service ...................................... 19 4-1-1-10.- La croissance spontane des agglomrations .................................................. 19 4-1-1-11.- La pauvret de la paysannerie ou du monde rural......................................... 20 4-1-1-12.- La pauprisation au niveau des agglomrations............................................. 21 4-1-1-13.- Labsence de recherche dveloppement ....................................................... 21 4.1.1.14.- La faiblesse/ou labsence dindustrie de transformation de produits de base ............................................................................................................................. 21 4.1.1.15.- La dgradation de lenvironnement (des bassins versants) .......................... 22 4-1-1-16.- Le drainage et lassainissement ........................................................................ 24 4.1.1.17.- La non-exploitation du plateau continental Atlantique ................................ 24 4.1.1.18.- Le non-encadrement du secteur artisanat ....................................................... 25 4.1.1.18.- Linorganisation du systme de commercialisation des produits agricoles.. 25 4.1.1.20.- La pression dmographique.............................................................................. 26
4.1.1.20.1.- Lvolution de la population non-urbaine du Nord ............................... 26 4.1.1.20.2.- La Rpartition spatiale de la population .................................................... 27
4-1-1-21.- La dgradation du patrimoine historique et bti et essoufflement du centre-ville historique du Cap-Hatien......................................................................... 29
4-1-2.- LES ZONES DINTRTS AVEC TYPE DINTRT 30 4-1-2-1.- La position gographique et la proximit du grand march Nord Amricain
et des routes de croisires. ................................................................................. 30 4-1-2-2. La prsence du 2e ple conomique national................................................... 32 4.1.2.3.- La prsence dun tissu urbain dense................................................................ 33 4-1-2-4.- Les mines et les carrires................................................................................... 33 4-1-2-5.- Limage du Cap-Hatien et du Nord ................................................................ 34 4-1-2-6.- Le tourisme......................................................................................................... 35 4-1-2-7.- Les ressources en eau......................................................................................... 36 4-1-2-8.- La diversit du secteur agricole et ses grandes possibilits de
dveloppement.................................................................................................... 38 4-1-2-6.- Les potentialite commerciales........................................................................... 39 4-1-2-10.- Les sols ................................................................................................................ 40
-
3
4-1-2-11.- La pche et la pisciculture................................................................................. 40 4-1-2-12.- Lartisanat .......................................................................................................... 41
4-1-3.- LES INDICATEURS DE DVELOPPEMENT. 41
4-1-4.- LES ASPIRATIONS DE LA POPULATION 52 4-1-4-1.- Dans le secteur transport et communications ................................................. 52 4-1-4-2.- Dans le secteur agriculture................................................................................ 53 4-1-4-3.- Dans le secteur pche......................................................................................... 53 4-1-4-4.- Dans le secteur levage ...................................................................................... 53 4-1-4-5.- Dans le secteur dveloppement urbain et habitat ........................................... 54 4-1-4-6.- Dans le secteur environnement......................................................................... 54 4-1-4-7.- Dans le secteur de leau potable........................................................................ 54 4-1-4-8.- Dans le secteur nergie ...................................................................................... 54 4-1-4-9.- Dans le secteur industrie et artisanat............................................................... 54 4-1-4-10.- Dans le secteur tourisme.................................................................................... 55 4-1-4-11.- Dans le secteur sant.......................................................................................... 55 4-1-4-12.- Dans les secteurs ducation, sports et loisirs ................................................... 55 4-1-4-13.- Dans le secteur de commerce ............................................................................ 56
4-1-5.- LE MONDE URBAIN DU NORD 56 4-1-5-1.- Le monde urbain du Nord en 2015 .................................................................. 56 4-1-5-2.- La population rurale.......................................................................................... 60 4-1-5-3.- Lesquisse darmature urbaine et rurale........................................................ 60
4-1-6.- LES ENJEUX DU DVELOPPEMENT ET DAMNAGEMENT DU DPARTEMENT DU NORD 63
4-2.- LE CONCEPT ................................................................................................... 65 4-2-1.- LES GRANDES ORIENTATIONS 66
4-2-1-1.- 1re orientation : Favoriser le dveloppement du secteur agricole. ............... 67 4-2-1-1-1- 1re orientation spcifique : Maintenir et dvelopper la diversit agricole 68 4-2-1-1-2.- 2meorientation spcifique : Intensifier la production agricole............... 69 4-2-1-1-3.- 3me orientation spcifique : Rentabiliser la production agricole.............. 71 4-2-1-1-4.- 4me orientation spcifique : Promouvoir le dveloppement des activits dlevage ........................................................................................................ 72 4-2-1-1-5.- 5me orientation spcifique : Implanter un ple agro-industriel dans le
triangle : Saint Raphal, Saint Michel de lAttalaye et Pignon......... 73
4-2-1-2.- 2me orientation : Rhabiliter lenvironnement et lutter contre la pauvret 74 4-2-1-2-1.- 1re orientation spcifique : Protger et matriser les bassins versants et les
principales rivires du dpartement et promouvoir une agriculture conservationniste. .......................................................................................... 75
4-2-1-2-2.- 2e orientation spcifique : Favoriser le dveloppement de la pche ctire et aquatique, la protection et la mise en valeur du littoral marin et de ses cosystmes..................................................................................................... 78
-
4
4-2-1-2-3.- 3me orientation spcifique : Favoriser la protection des parcs naturels, des sites historiques et leur mise en valeur. ....................................................... 80
4-2-1-3.- 3me orientation : Assurer la desserte de toute la population en services de base, infrastructures et quipements................................................................. 81
Eau potable..................................................................................................................... 82 Electricit........................................................................................................................ 82 Sant publique................................................................................................................ 83 Education........................................................................................................................ 83 Communication.............................................................................................................. 84 Assainissement ............................................................................................................... 84 Transport........................................................................................................................ 85 Justice et police .............................................................................................................. 85 Assistance sociale ........................................................................................................... 85 Equipements et services collectifs. ............................................................................... 86
4-2-1-4.- 4me orientation : Dvelopper le tourisme. ...................................................... 86 4-2-1-5.- 5me orientation : Faire bnficier le Nord de sa proximit avec le grand
march Nord amricain et des routes de croisires et des opportunits daffaires offertes par les rgions limitrophes.................................................. 90
Dotation du nord en infrastructures de transports . ................................... 91 Infrastructures routieres................................................................................... 91 Infrastructures aeroportuaires......................................................................... 93 Infrastructures portuaires ................................................................................ 94
4-2-1-6.- 6me orientation : Renforcer les capacits locales de gestion des institutions 94 4-2-1-7.- 7me orientation : Renforcer les activits commerciales et de services du Nord ............................................................................................................................. 95 4-2-1-8.- 8me orientation : Maintenir et dvelopper les activits artisanales ............. 96 4-2-1-9.- 9me orientation : Promouvoir le developpement industriel du Nord.......... 97 4-2-1-10.- 10me orientation :Coordonner la croissance des agglomrations ................. 98
4-2-1-11.- 11me orientation : Renforcer le rle national de la deuxime ville du pays : Cap-Hatien. ..................................................................................................... 100
1re orientation spcifique : Renforcer la vocation touristique de la ville................ 101 2me orientation spcifique : Renforcer la fonction conomique du Cap-Hatien ... 101 3me orientation spcifique : Renforcer la fonction sociale du Cap-Hatien ............. 102 4me orientation spcifique : Renforcer le rle de centre de services du Cap-Hatien........................................................................................................................................... 102 5me orientation spcifique : Planifier et contrler la croissance du Cap-Hatien.... 103 6me orientation spcifique : Dcongestionner le centre-ville historique................... 103 7me orientation spcifique : Protger lenvironnement de la rgion du Cap-Hatien........................................................................................................................................... 104 8me orientation spcifique : Faciliter les changes entre Cap-Hatien et la grande rgion Nord...................................................................................................................... 104
4-2-1-12.- 12me orientation : Renforcer le rle rgional de la ville du Limb............ 104
-
5
4-2-1-13.- 13me orientation : Renforcer le rle des villes de St-Raphal et de Pignon dans la frange Nord de la rgion naturelle du Plateau Central.................... 105
4-2-1-14.- 14me orientation : Renforcer le rle de la ville de la Grande Rivire du Nord 107 4-2-1-14.- 15me orientation : renforcer le rle des villes moyennes : Limonade, Milot,
Port Margot, Plaisance, Dondon, Plaine du Nord, Pilate, Borgne .............. 109
4-2-2.- LA STRATGIE DINTERVENTION ET LES ACTIONS PRIORITAIRES 109 4-2-2-1.- LA STRATGIE ............................................................................................. 109 4-2-2-2.- LES ACTIONS PRIORITAIRES .................................................................. 114
PROGRAMME 1 : Environnement et Bassins Versants ........................................... 115 PROGRAMME 2 : Assainissement.............................................................................. 121 PROGRAMME 3 : Agriculture.................................................................................... 123 PROGRAMME 4 : levage .......................................................................................... 129 PROGRAMME 5 : Pche.............................................................................................. 130 PROGRAMME 6 : Industrie, Commerce et Artisanat.............................................. 131 PROGRAMME 7 : Mines et Carrires........................................................................ 134 PROGRAMME 8 : Tourisme et Culture..................................................................... 135 PROGRAMME 9 : Transport routier ......................................................................... 140 PROGRAMME 10 : Transport Aerien et Maritime .................................................. 144 PROGRAMME 11 : Irrigation.................................................................................... 145 PROGRAMME 12 : nergie ....................................................................................... 146 PROGRAMME 13 : Communication ......................................................................... 148 PROGRAMME 14 : Eau Potable................................................................................ 150 PROGRAMME 15 : Sant ........................................................................................... 153 PROGRAMME 16 : ducation ................................................................................... 155 PROGRAMME 17 : Dveloppement urbain.............................................................. 158 PROGRAMME 18 : Sports et Loisirs......................................................................... 163 PROGRAMME 19 : quipements et Services Collectifs .......................................... 166 PROGRAMME 20 : Justice.......................................................................................... 170 PROGRAMME 21 : Renforcement des Capacits Locales de Gestion ................... 172
-
6
4.- LE CONCEPT DAMNAGEMENT ET DE DVELOPPEMENT
Le prsent chapitre proposera un concept de dveloppement et dAmnagement du territoire. Le concept reposera sur lidentification des principales contraintes de dveloppement et des potentiels du Dpartement. Il considrera galement les indicateurs de dveloppement et les aspirations de la population. Tous ces lments seront ci-dessous regroups dans une premire partie prsentant le diagnostic du Dpartement.
Dans une seconde partie, seront proposes les premires orientations de dveloppement et damnagement du territoire visant le redressement conomique et social du Dpartement. Cette partie proposera galement une stratgie dintervention et des actions prioritaires pouvant permettre denclencher le dit redressement.
Dans une troisime partie, seront prsentes lensemble des cartes qui soutiennent le diagnostic et le concept de dveloppement du Nord. Ces cartes qui sont au nombre de fournies en synthse ce quest le Nord et ce que sera le Nord, dans la mesure o tous les partenaires impliqus dans le dveloppement et lAmnagement de ce Territoire y tiennent compte dans leurs diffrents programmes.
4.1- LE DIAGNOSTIC
Le Dpartement du Nord fait partie des bassins versants de la cte Atlantique et occupe une partie de la Frange Nord de la rgion naturelle du Plateau Central. Born au Nord par locan Atlantique, lEst par le dpartement du Nord-Est, au Sud par les dpartements du Centre et de lArtibonite et du Nord-Ouest, il couvre une superficie de 2105,43 km soit 7,60% du territoire de la Rpublique dHati et se range en 7me position dans le classement des Dpartements par superficie. En 1996, sa population est estime 772.576 habitants, soit 10,53% de la population nationale avec un taux de croissance annuelle de 1,66% entre 1990-1996. Le Nord possde aprs lOuest la plus forte densit : 366,82 habitants au km2 plus leve que la moyenne nationale 264,84 hab/km2. Cette population rpartie dans dix-neuf (19) communes est rurale 71,12%. Le Dpartement induit une agglomration urbaine de plus de 100.000 habitants : Cap-Hatien. La distribution par sexe de sa population fait ressortir un dpassement de seulement 1% de la population fminine sur celle des hommes. Cette population fminine est en-dessous de la moyenne nationale qui est de 2% suprieure celle des hommes.
La population est principalement concentre dans la Plaine du Nord (arrondissements Cap-Hatien et Acul du Nord) qui absorbe 39,48% de la population totale du Dpartement soit 305.028 habitants en 1996, en croire les chiffres de lIHSI. Cependant, en considrant les autres estimations de la population urbaine du Cap-Hatien ( 300.000 par exemple du PNUD, 1996), elle aurait avoisin un million de personnes. Les communes de Plaisance, Pilate, Port-Margot et Borgne, zones de montagnes humides, totalisent 27,69 % soit 213963 habitants. LArrondissement de Saint Raphal abrite 17,05% de la population du Nord soit 131698 habitants. LArrondissement du Limb 7,56% soit 58387 hab. La partie ouest du Nord, dans son ensemble compte 35,25% de la population globale. LArrondissement de la Grande Rivire du Nord englobe 8,12% de la population du Dpartement.
-
7
La densit de la population en zone non urbaine du Dpartement 261 hab/km2 avoisine la densit globale nationale qui est de lordre de 264,84 habitants par km2. Cela nest pas sans consquences sur les ressources naturelles rgionales. Cette forte densit en zone non urbaine des communes du Nord est beaucoup plus marque dans les communes de Plaisance (473,1 hab/km2), Pilate (411,8 hab/km2, Acul du Nord, la commune dtentrice de la plus forte population rurale du Nord (366,6 hab/km2, Cap-Hatien (328,1 hab/km2) etc.
En terme durbanisation, Cap-Hatien accuse un taux de 85,83%; celle du Limb de 49,68%; de Pignon de 38,27%; de Port-Margot de 40,85%; de Milot de 37,19%. La commune du Cap-Hatien absorbe 46,59% des urbains du Nord; le Limb 10,11%; de la Grande Rivire du Nord de 4,42%; de Port-Margot 6,26% etc.
En terme doccupation de sol, les villes prennent de lextension et en milieu rural la situation ne semble pas volue par rapport celles antrieures. Toute mme, la tendance de regroupement dans les zones de Plaine, le long des routes, dans les priphries des villes se fait de plus en plus marque.
Le dpartement du Nord est divis du point de vue physiographique en trois zones bien distinctes : une partie du massif du Nord, la Plaine du Nord et larrondissement de Saint Raphal, Frange de la rgion naturelle du Plateau Central.
Les zones de Plaine et de Plateaux reprsentent 31,87% de la superficie du Dpartement et les zones de montagnes 68,13% reprsentes par une srie de chanons dorientations WNW-ESE certains endroits trs escarps, comme celui sur lequel se dresse la citadelle La Ferrire (875 m daltitude au sud de Milot. De faon dtaille, le Nord est constitu de 1% de plaine irrigue soit 20,71 km2; de 21,74% de plaine humide, soit 450 km2; de 8,79% de plaine semi-humide, soit 182 km2; de 0,34% de plaine sche, soit 7 km2; les montagnes trs humides reprsentent 26,38% soit 546 km2; les montagnes humides 31,16%, soit 645 km2. Le primtre irrigu est 2271 ha soit 3,81% de la surface irrigable qui est de lordre de 53624 ha. La superficie irrigue (ha)/1000 habitants est extrmement faible soit de 2,64. La surface irrigue (ha) par rapport la superficie totale du Nord est aussi extrmement faible 0,97%. Les surfaces irrigues se rpartissent dans les communes de la Plaine du Nord, de lAcul du Nord, de Milot, de Saint Raphal, de Pignon et du Limb. La superficie cultivable par rapport la superficie totale du Nord est de lordre de 83,19% cest--dire que 83,19% des terres disponibles est mise sur culture. Celle cultivable (en ha)/1000 habitants est de lordre de grandeur de 226,72. Les terres rodes sont values environ 15% de lensemble.
Le Nord se caractrise galement par 125 km de ctes, soit 8,21% des faades maritimes du pays le plateau continental quoique riche en ressources halieutiques est sous-exploit.
Le Dpartement situ entre 19 et 20 degrs de la latitude Nord est soumis au rgime des alizs (vagues dEst) soufflant du Nord-Est et des nords (courants froids du Nord) en provenance du secteur Nord-Ouest qui apportent les prcipitations les plus importantes. Et pour le cas particulier de larrondissement de Saint-Raphal, les pluies sont dues par lorientation des versants, de laltitude et du relief.
-
8
Sur la plaine, la hauteur de pluie augmente dEst en Ouest (1400 2000 mm) avec une valeur moyenne de 1600 mm. Dans les montagnes humides les prcipitations passent de 1500 2000 mm, au pied des versants, plus de 2400 mm sur les sommets avec une moyenne de 1900 mm.
En ce qui concerne la zone de Saint-Raphal, Pignon, La Victoire et Ranquitte, on observe un rgime climatique du type du Plateau Central, la saison des pluies dure 7 mois davril octobre, la hauteur deau atteint 1171mm/an.
Ces caractristiques pluviomtriques allies la pdologie du Dpartement, la temprature, lhumidit de lair et la grande disponibilit deau souterraine au niveau des Plaines font bnficier ce dpartement dexcellentes potentialits agricoles.
Cette agriculture fournit une gamme varie de produits allant de vivres et crales (mas, riz, millet, haricot, manioc, banane, lgumes, ignames, patate) aux cultures commerciales (caf, cacao, canne de bouche), aux cultures agro-industrielles (canne sucre) et les agrumes sans oublier les mangues. Cependant, cette agriculture, jadis, lune des bases de lconomie dpartementale, fait face des contraintes : insuffisance des infrastructures dirrigation, faiblesse de lencadrement technique, inorganisation du systme de commercialisation, pression dmographique sur les terres cultivables, morcellement excessif des parcelles, manque de crdit, absence de politique agricole, absence de moyen de contrle des inondations, dgradation de lenvironnement, manque de moyens de conservation, difficults de transport, manque de moyen de transformation, faiblesse des rendements des principales cultures, mauvaise mise en valeur des zones de plaines dexcellentes productivits, sous-utilisation des ressources en eaux, pauvret ruralo-urbaine, problme de sous-quipement rural (routes, eau, lectricit, habitat, services , etc.) faiblesse de linvestissement dans le secteur, vieillesse des plantations de caf, etc
Quant llevage, il joue un rle important dans lpargne paysanne. En dpit de cette importance, la production par tte de btail est trs faible . Cela rsulte des contraintes telles : encadrement technique, inexistence des travaux damlioration gntique, espace disponible rduit, scheresse, transhumance, soins vtrinaires, alimentation, inefficiente du service de la quarantaine..
Pour ce qui a trait la pche, malgr quil peut constituer un secteur dactivits important avec le large plateau continental et la grande possibilit pour la pisciculture existant fait face des problmes dquipements, dencadrement technique, de moyens de conservation, dnergie.
Le secteur agro-industriel, crateur de valeur ajoute, malgr le fort potentiel qui existe nest pas dvelopp. Il est form pour lessentiel de petites units de transformation des produits de base (canne sucre, manioc, mas). En 1997, on compte 186 units de transformations dont un (1) dextractions dhuiles essentielles, vingt-trois (23) cassaveries, trois (3) distilleries, deux (2) fabriques de boissons gazeuses, cent cinquante sept (157) guildives.
Dans le domaine industriel, en dpit de la rgression des activits, les possibilits offertes
-
9
au dveloppement par cette branche sont normes. Elles restent sous-exploites occasionnant bien de gaspillage de ressources et matires premires transformables dans plusieurs communes ou lagro-industrie aurait favoris des rentres montaires importantes et une augmentation de la production. Le secteur de la construction constitue la branche la plus dynamique. Concernant les industries lgres, la situation est loin dtre brillant. La monte des prix de matires premires compliquer la situation dj prcaire. Aux problmes structurels viennent sajouter des difficults conjoncturelles dues la raret des devises ncessaires, limportance des matires premires et de lquipement.
En outre les services quoffre le dpartement sont nettement insuffisants par rapport aux besoins ou la demande de la population.
Du point de vue de sant, la situation est critique. Le Dpartement est caractris par une trs faible couverture en soins sanitaires due au nombre insuffisant des quipements de proximit. En tmoignent les donnes qui suivent : deux (2) hpitaux, huit (8) cal, neuf (9) CSL, trente huit (38) dispensaires, un asile communal desservent plus de 772576 habitants. En terme de ressources humaines, la situation est alarmante. Le dpartement dispose :
845 lits pour 772576 habitants 1,09 lits/1000 habitants, 0,097 mdecins/1000 habitants 0,23 infirmire/1000 habitants 0,39 docteur feuille/habitants 0,164 agent de sant/1000 habitants 2,01 femmes-sages/1000 habitants 0,4 auxiliaires/1000 habitants 0,021 dentiste/1000 habitants 0,6 collaborateurs volontaires/1000 habitants
En milieu rural, la situation est plus prcaire par rapport la situation urbaine seulement 4 mdecins y travaillent soit un pour 135115 ruraux, 7 infirmires soit 1/77209 ruraux et 30 auxiliaires pour 540463 habitants soit une pour 18015. Ainsi la couverture en ressources humaines est insuffisante et la rpartition de celles existantes est inadquate. En effet deux communes (Bahon et Bas-Limb) ne disposent pas de mdecin. Seules huit (8) communes sur dix-neuf (19) ont une prsence de dentiste. Pour la commune de Bahon, un (1) auxiliaire et quatre (4) agents de sant desservent plus de 21576 habitants.
Pour ce qui concerne le domaine de lducation, mille cent quarante cinq (1145) coles primaires, cinq cent trente-deux (532) institutions prscolaires, cent vingt-quatre (124) institutions secondaires fonctionnent dans le dpartement. De lensemble de ces institutions soit 1801; 48,47% sont localiss en zones urbaines et 51,53 au niveau des sections communales. Le taux de scolarisation pour les niveaux primaires et secondaires combins est de lordre de 66,18% qui est plus leve par rapport la moyenne nationale de 64,9%. Au niveau primaire, le taux se chiffre 57,45% soit 42,30% en zone rurale contre 72,60% en zone urbaine. Le taux de scolarisation du secondaire natteint que 8,73%. Les communes de Saint-Raphal, du Borgne, de Dondon, de lAcul du Nord ont les plus faibles taux de scolarisation au niveau primaire. Elles
-
10
ont respectivement 35,64%, 37%; 37,5%, et 43,06%. Les communes de Pignon (92,69%, de Pilate (65,96%), du Cap-Hatien (58,79%), du Limb (57,17%) affichent les taux de scolarisation les plus levs en zones rurales. Au niveau des infrastructures, on dnote une surcharge du secteur public par rapport au priv comme attestent les statistiques qui suivent le ratio lve/cole est de 324,01 dans le public contre 146,28 dans le priv. La situation est identique dans les secondaires o le ratio au niveau des lyces est de 767,82 contre 194,60 dans les collges. La qualit de lenseignement dispens dans le secteur public est douteuse vue la forte densit doccupation et le faible taux dencadrement pour chaque 100 lves. Cela rsulte dune nette insuffisance de locaux et de personnels li ltat dlabre et de vtust de certaines infrastructures.
Il est important de mentionner que la majeure partie des coles sont prives, au niveau du primaire (83,84%) avec 70,10% des lves; 74,87% des professeurs et 78,73% des salles de classe. Dans le prscolaire, les institutions prives reprsentent 7 fois le nombre dinstitutions que compte le public soit soixante-quatre (64). Pour ce qui a trait au niveau secondaire, le secteur priv possde 91,13% des coles existantes.
Lducation des adultes prend de plus en plus dimportance dans le systme.
Pour lEnseignement universitaire au niveau du Dpartement, les tablissements denseignement suprieur sont concentrs dans deux communes : Cap-Hatien et Limb. La zone urbaine du Cap-Hatien abrite 87,50% des institutions offrant ses services.
Domaine eau potable. En dpit de labondance des ressources en eau du Dpartement (105 sources captes, 513 sources non captes, 1158 puits traditionnels dans le plus de 1000 dans la seule commune du Cap-Hatien, 42 puits avec rseaux, 44 puits profonds, 300 pompes bras et 224 fontaines publiques distribues travers les villes et les sections communales) la desserte en eau potable au niveau des diffrentes collectivits est extrmement critique. La couverture pour lensemble du Dpartement est value 49,22% de la population.
Tous les chefs-lieux de communes disposent de systme de distribution deau qui sont insuffisants et inadquats. La majorit de ces systmes construits au dbut des annes 80 ont dj atteint leur dure de vie et ne rpondent plus la demande. Cest le cas de la ville du Cap-Hatien, construit depuis 1922, de la Grande Rivire du Nord, de Saint Raphal, de Pignon, de Dondon, de Port Margot, de Pilate, de Limonade, de la Plaine du Nord, du Bas-Limb, de lAcul du Nord.
Au niveau des sections communales, la population sapprovisionne dans des sources captes ou non captes, des puits, des fontaines publiques ou dans les rivires. La couverture en eau potable en zones rurales est assure lordre de 33,05% pour lensemble du Dpartement. La distribution est trs ingale entre zones urbaines et rurales mme lintrieur des communes. En effet la couverture des sections communales du Borgne est nulle. Trois communes (Grande Rivire du Nord, Limb et Limonade) ont une couverture infrieure l6% en milieu rural. Six communes (Plaisance, Pilate, Bas-Limb, Port-Margot, Bahon, Acul du Nord) ont une desserte comprise entre 21,24% et 35,26%. Saint-Raphal et Dondon ont respectivement un taux de 47,12 et 40,47% en zone rurale. Le secteur eau potable fait face des contraintes lies la
-
11
mauvaise desserte (problmes lies la distribution, fuite sur les rseaux, manque dentretien et mauvaise gestion, dgradation avance des captages et des adductions dans les diffrentes communes etc.) et autres contraintes majeures (faiblesse de linvestissement dans le secteur eau potable, sous-quipements et carence en personnels techniques du SNEP etc.).
Domaine lectricit. Actuellement, la puissance installe 14180 kW est nettement insuffisante pour satisfaire la population desservie et reprsente 4% de celle du pays pour 10,8% de la population. Cependant, la puissance disponible du Nord, 3900 kW, en Fvrier 1998, 22,5% de la capacit de production des centrales installes. Ce qui donne 5,05 kW pour 1000 habitants. Cette puissance disponible ne permet dapprovisionner que 19% de la population soit 9903 abonns. Alors que la demande est en nette augmentation. La qualit des services laisse dsirer et fluctue entre 5 10 heures par jour de faon trs irrgulire.
En matire de tlcommunication, le dpartement dispose de 36,6 lignes tlphoniques pour 10000 habitants, toutes localises dans la ville du Cap-Hatien. Des liaisons tlphoniques interurbaines desservent les chefs des communes sauf Pignon, Ranquitte, Bahon et La Victoire. Le fonctionnement du service est souvent dfectueux , en priode pluvieuse le trafic interurbain est gnral interrompu ou perturb.
Le dnombrement des institutions financires au niveau du Nord, soit dix (10) succursales de banque, soixante-dix (70) coopratives, vingt-deux caisses populaires et autres associations fonctionnant dans le secteur du crdit, pourrait laisser croire tout va bien au niveau des activits conomiques. Cependant le nombre lev dorganismes daide au dveloppement traduit le contraire. Cela se comprend, car depuis environ 15 ans aucun investissements importants ou significatifs et aucun programme de dveloppement denvergure ne se sont pas raliss dans le Nord, pourtant dot dun norme potentiel de dveloppement. A date, lconomie dpartementale ne dispose daucune base (ni agricole, ni touristique) solide pouvant lui servir de levier.
Le dpartement du Nord apparat une rgion socio-conomiquement faible et sous-quipe, population rurale pauvre, en dpit du fort potentiel de dveloppement unanimement reconnu qui existe dans les domaines de lagriculture, de lagro-industrie, du tourisme, de lartisanat, du commerce, de la pche, de la culture, de sa position gographique stratgique et de sa proximit du grand march Nord amricain, et des routes de croisire et des Petites Antilles (Turck and Caicos, Providencia, Bahamas), de son potentiel minier, de ses attraits environnementaux, de lexistence, dun secteur financier en essor et un secteur priv bien structur et dynamique, de la prsence de huit (8) grands marchs rgionaux et dun rseau de ville assez dense tournant autour du deuxime ple conomique national, la prsence du deuxime aroport international et du deuxime port ouvert au commerce extrieur et dun port touristique bien protg.
Le dveloppement touristique Labadie, la construction dun grand aroport international Madras, limplantation dun complexe touristique de plus de dix mille (10000) chambres Fort-Libert, selon le plan directeur du Tourisme, le parc national historique Citadelle-Sans-Souci, la prsence des villes importantes proches (Gonaves, Hinche, Sain-Michel de lAttalaye, Ouanaminthe, le dpartement du NordEst, les plages du Nord (Chouchou Bay,
-
12
etc.) garantissent des possibilits daffaires normes pour le Nord.
Dans la prsente partie nous prsentons de manire synthtique : Les grandes contraintes qui paralysent le dveloppement du Dpartement; Les potentialits des diffrentes zones du Dpartement; Les indicateurs de dveloppement et damnagement; Les aspirations de la population exprimes lors des divers ateliers thmatiques
En dernier lieu sera prsent trs succinctement le monde urbain du Nord ou le dveloppement urbain du Nord.
4-1-1.- LES GRANDES CONTRAINTES
Le dveloppement rel du dpartement du Nord ou de la rgion Nord ne pourrait se raliser ou se concrtiser sans la leve des contraintes majeures paralysant toute action susceptible davoir des effets dentranement durables, modifiant les conditions dexistence des habitants de la rgion, leur mode doccupation et dutilisation de lespace et rhabilitant lenvironnement . Ainsi, lanalyse de la documentation disponible et les divers rsultats obtenus lors des ateliers thmatiques communaux montrent que les goulets dtranglements sont complexes et interrelis et que leur rsolution exigera la conjugaison de tous les acteurs intervenant dans le dveloppement et lamnagement ainsi que la participation et la mobilisation dimportantes ressources financires et humaines.
Les principales contraintes qui se dgagent sont : Des infrastructures inadquates ou sous-quipement du Dpartement Le drainage de la Plaine du Nord Linsuffisance de systme dirrigation La faiblesse des institutions Labsence dun vritable aroport international Linsuffisance et linadquation des services et quipements publics Dgradation des infrastructures routires et enclavement des montagnes humides. La faiblesse des rendements du secteur agricole ou d acclration marque de la
production agricole. La faiblesse des infrastructures daccueil et de service. La croissance spontane des agglomrations La pauvret de la paysannerie ou du monde rural La pauprisation au niveau des agglomrations Labsence de recherche-dveloppement La faiblesse /ou labsence dindustrie de transformation des produits de base La dgradation de lenvironnement (des bassins versants). Le drainage et lassainissement des agglomrations La non-exploitation du plateau continental atlantique Le non-encadrement du secteur artisanat Linorganisation du systme de commercialisation des produits agricoles.
-
13
La pression dmographique La dgradation du patrimoine historique et bti et essoufflement du centre ville du Cap-
Hatien.
4-1-1-1.- DES INFRASTRUCTURES INADQUATES OU SOUS-QUIPEMENTS DU DPARTEMENT.
Cest un des problmes majeurs du Dpartement et du pays en gnral. Tout le dveloppement socio-conomique durable du Nord et du grand Nord et la stabilisation des populations dans leur zone dorigine sy rattachent. Les problmes dinfrastructures constituent lhandicap de base ou un frein srieux bloquant ou empchant toute volont dinvestir dans le Nord et toutes tentatives damliorer le bien-tre des habitant. Cette contrainte se manifeste tous les niveaux et touche tant les domaines des infrastructures de base, de productions que de lquipement urbain. Elle couvre les secteurs tels : eau potable, assainissement, drainage, tlcommunications, nergie, port et aroport, marchs publics, rseau routier et transport en commun, quipements sanitaires, barrages et systme dirrigation, installations industrielles et touristique et de loisirs, dquipements publics communaux et/ou locaux, etc.
En effet, dans le domaine du transport toutes les infrastructures routires du dpartement sont dgrades. Des routes qui jadis taient goudronnes redeviennent des routes en terre battue (par ex. : la route Cap-Carrefour La Mort et la plus grande partie de la route carrefour La Mort-Grande Rivire du Nord. Actuellement part les tronons de route Cap-Gonaves et carrefour La Mort-Trou du Nord, quoiquelles sont en de trs mauvais tat, il nexiste que des routes en terre battue au niveau du dpartement. Ceci a des consquences dsastreuses sur la production agricole, donc sur le revenu des paysans qui sappauvrissent de jour en jour. Cette situation empche totalement le dveloppement des communes recules. Les communes de Pignon, Ranquitte, La Victoire, Pilate et Borgne sont pendant les priodes des pluies coupes du reste du Dpartement par labsence des ouvrages de franchissement (ponts) sur les rivires de Bouyaha, Desfonds, Margot (Pilate), Champagne (Plaisance), Piment (Pilate), Rivire Laporte (Pilate), Bayeux (Port Margot), Borgne et Ravine Marianne (Ranquitte. Au niveau des montagnes humides, la grande majorit des sections communales forte potentialit agricole sont toujours enclaves. Le transport des passagers et des marchandises par ses routes ravines, dfonces est trs pnible voire inhumain. A cause des problmes routiers et de transport, le Cap-Hatien concentre toutes les infrastructures sociales, conomiques, culturelles les plus importantes du Dpartement. En effet, Cap-Hatien loge la moiti des hpitaux du Nord (1/2), prs de 18,34% des coles primaires; 24,44% des kendergarden; 42,74% des coles secondaires; 87,50% des centres universitaires du Nord; 90% des coles professionnelles et techniques; 80% des institutions bancaires; 90% des infrastructures de loisirs, concentre la part la plus importante du commerce rgional.
Limb abrite le reste des institutions bancaires prsentes dans le Nord. part, les villes du Cap-Hatien, Limb, Port-Margot, Acul du Nord, Plaine du Nord, Quartier Morin, Limonade, Milot et Grande Rivire du Nord, toutes les autres villes sont dpourvues dlectricit. Ce facteur de dveloppement indispensable est inexistant dans les zones sections communales.
-
14
Le nombre dcoles primaires et secondaires est nettement insuffisant. Les rares systmes dadduction deau potable existant ont atteint leur dure de vie et taient insuffisant, tous les centres urbains souffre de manire dun srieux problme de drainage et dassainissement. La Bidonvilisation rongent le systme urbain dpartemental linstar de laire mtropolitaine de Port-au-Prince.
4-1-1-2.- LE DRAINAGE DE LA PLAINE DU NORD
La vaste Plaine du Nord y compris les Plaines du Limb et de Port-Margot, considre comme les meilleurs sols du pays, par sa topographie plane et lensablement des lits de ces principales rivires et linexistence de rseaux dirrigation, souffre dun problme de drainage trs aigu. En effet, dans certaines parties, moins dun km de la cte atlantique sont une hauteur de moins de 3 mtres au-dessus du niveau de la mer. Ce problme de drainage constitue avec linsuffisance des infrastructures dirrigation et les problmes dencadrement les premires causes de la chute de la production agricole des plaines.
Sous leffet du dboisement combine aux mauvaises pratiques culturales et labsence dinfrastructures appropries, la capacit dabsorption pluviomtrique du Dpartement considrablement baisse ou diminue. A moindre averse, on sattend des inondations dans les plaines comme dans les villes avec les consquences dsastreuses. Donc, ce problme de drainage conduit deux fatalits : dgradation des sols et pauprisation grandissante du monde rural et sur les ctes, la dgradation des bassins versants provoque la destruction des niches cologiques des poissons. Cette dgradation environnementale observe perturbe le rgime dcoulement des eaux de surface, provoquant des flaques deau stagnantes au niveau de toutes les plaines. Cela conduit une baisse de productivit agricole des sols. En ce sens, les rivires et cours deau et ravines charrient, chaque averse de grandes quantits de sdiments en raison de lrosion leve et les dposent dans les zones de plaines. Ce qui entrane le recouvrement et lensablement des zones agricoles fertiles par des sdiments striles. Ce problme de drainage est aussi cuisant pour les villes de la plaine qui accusent un dficit important et chronique en infrastructures de base pour lvacuation des eaux pluviales et uses.
4-1-1-3.- INSUFFISANCE DE SYSTME DIRRIGATION
Le Nord, lun des grandes zones agricoles du pays, sous la pression dun ensemble de contraintes conjugues, a vu sa production agricole dcrotre de jour en jour par linsuffisance de systme dirrigation. Malgr labondance en eau (surface et de nappe), seulement 3,86% des 53642 ha de sols irrigables sont irrigus et trs difficilement. Au cours de la tenue des ateliers thmatiques, on a pu constater que les rseaux dirrigation existant sont en vtust et mal entretenus. Les systmes existent sont inefficaces et/ou sous-utiliss et dfectueux. Ils ncessitent construction ou rparation de barrage, drainage, construction ou rfection de canaux, forage de puits, rhabilitation de distribution, ce qui permettrait dtendre les superficies irrigues.
La rfection des canaux dirrigation existants et la cration de nouveaux permettraient dtendre les superficies irrigues dau moins 80%. Les sols irrigues du Nord peuvent procurer
-
15
une trs grande quantit de produits de toute sorte allant des commercialisables aux produits vivriers et craliers.
Dans le Nord, lensemble des systmes endommags (La tannerie, les systmes datant de la colonie et ceux victimes de cataclysmes des annes 60) nont jamais t rhabilit, cause de ressources financires. Les systmes qui fonctionnement ne sont pas utiliss rationnellement en raison de linsuffisance organisationnelle des services dirrigation du MARNDR et de sa Direction Dpartementale dans le Nord, la faiblesse de lencadrement technique et au morcellement des terres qui font de lirrigation sur de petite surface un gaspillage, une chose irrationnelle. Vu lnorme potentialit agricole et labondance en ressources en eau et en sols irrigables disponibles , lirrigation apparat pour le Nord laube du 3e millnaire lunique voie rapide pour intensifier la production agricole.
Outre la quasi-inexistence de systme dirrigation, les plaines du Nord font face aux svres crues de certaines rivires. Cest le cas de la Grande Rivire du Nord qui, par ses inondations catastrophiques en priode de crues, a des rpercussions extrmement ngative sur la production dans les zones de Quartier Morin et Limonade. La rivire Gallois, de son ct provoque, des inondations au niveau de la commune de la Plaine du Nord, il en est de mme de la rivire Grand fonds lAcul du Nord, la rivire du Limb, la rivire de Port-Margot. De ce fait, lendiguement de ces rivires susmentionnes de mme que leur captage sont vivement conseiller pour limplantation de rseaux dirrigation.
Pour la mise en valeur des sols irrigables de Saint-Raphal Pignon, plus de 14000 ha disponibles, il faut la construction de trois barrages deux sur la Bouyaha (vote Minguette et lina) et un autre sur la Gouape Grenand. Pour ce qui est de la zone de Quartier Morin, Limonade couvrant 16563 ha, le barrage de la tannerie qui arrosait environ 2000 ha a t dtruit de plus de 20 ans et le rseau a t aussi compltement dgrad. Cela implique la rhabilitation du barrage de la Tannerie, la construction dun barrage sur Petite Rivire de Limonade et lutilisation de la nappe phratique extrmement riche de cette partie de la Plaine.
La mise en valeur des sols irrigables de la zone Plaine du Nord, Grison Garde, Acul du Nord ncessite une forte utilisation des nappes pour mobiliser le potentiel existant. Outre de cela, il faut rhabiliter le barrage de Grison Garde, drainer toute la plaine, lendiguement des rivires, la rhabilitation des petits primtres en dcadence et lutte contre le dboisement des bassins versants.
Le potentiel irrigable de la zone de Limb et du Bas-Limb environ 5500 ha souffre du drainage, de linondation et du dboisement des bassins versants. Il en est de mme du potentiel de Port Margot 2600 ha victime de la dgradation du systme de Bayeux, de labsence de contrle des crues et du dboisement des bassins versants et des problmes de drainage et de protection contre les mares dans la zone de Bas-Quartier.
Le Nord est dfavoris en ce qui a trait aux rseaux dirrigation l o ils existent, ils sont pour la plupart en vtust, car ils datent presque tous de la priode coloniale. Les systmes de Quartier Morin (Cadush, Jean Bernard)
-
16
4-1-1-4.- LA FAIBLESSE DES INSTITUTIONS
A linstar des autres dpartements gographiques du pays et paralllement aux maintes contraintes majeures que connat le Nord, ses institutions et organisations souffrent dune dfaillance de structure dadministration et de gestion tous les niveaux. Quoique le Nord est aprs lOuest le mieux loti en matire de reprsentation des institutions tatiques, leur faiblesse limite leurs interventions en matire de dveloppement conomique et social. Cette faiblesse institutionnelle se caractrise par :
une reprsentation inadquate un manque de dynamisme local limage du central une faiblesse en ressources humaines cadres et qualifies une faiblesse des structures de gestion de service une absence de structures daccueil une absence de coordination entre les diffrentes structures tatiques reprsentes
dans le Dpartement. Une faiblesse de moyens logistiques, matriels et financiers rendant inefficients
les actions entreprises par ces administrations voire inoprants Une absence de volont de se dpasser Absence de projets densemble Un taux dencadrement de la population trs faible Une dpendance face ladministration centrale assez critique Une absence de dlgation de pouvoir Une inefficacit du systme judiciaire Un manque de continuit dans laction des actions et dans les programmes. Un taux dencadrement trs faible de la population Une mauvaise rpartition des agents de la fonction publique disponible.
Il est important de mentionner que les services dconcentrs de ltat ne sont pas dot dautonomie malgr la dconcentration prne par la constitution de mars 1987.
Pour ce qui concerne, les collectivits, cette faiblesse institutionnelle se traduit par : une inexistence de fonction publique locale une absence de budgets allous limitant leurs interventions Pas de suivi entre deux administrations qui se succdent Pas dorganigramme et de rpartition de rle et de tche entre les dirigeants Une mauvaise clarification des missions et rles des conseils municipaux avec les autres
instances communales il en est de mme pour les sections communales .
De leur ct, les ONGs se caractrisent par un fonctionnement hermtique et isol avec des programmes qui ne rythment pas avec les aspirations de la population et les programmes dinvestissement public Une faible coordination entre les services de ltat et les ONGs.
La socit civile, dans son ensemble, malgr la prsence de la chambre de commerce, des industries et des professions du Nord, des coopratives et des caisses populaires, est peu
-
17
organise et souffre des problmes de gestion, de formation de membres, de manque de vision, de coordination de leurs projets, de problmes de structuration.
4-1-1-5.- LABSENCE DUN VRITABLE AROPORT INTERNATIONAL.
Le Dpartement du Nord ou la grande rgion Nord (Le grand Nord comprenant le Nord, Nord-Est, Le Nord-Ouest, le Haut Plateau Central, le Haut Artibonite) souffre de labsence dun grand aroport international capable dinfluencer son dveloppement socio-conomique. Laroport du Cap-Hatien qui jadis situant en priphrie urbaine est aujourdhui au sein de la ville du Cap-Hatien. Laroport actuel ne rpond pas pour multiples raisons dont les principales :
actuellement le nombre demplois gnrs est trs faible et limpact sur lconomie du Nord quoique important apparat nettement infrieur ce quil devrait tre tant pour lemploi que stimulant pour attirer les investisseurs.
Aroport actuel incompatible avec la fonction rsidentielle adjacente et le futur ple urbain mixte le long de la route SOS crer.
Bidonvilisation des alentours de laroport actuel cause de lexode rural massif, de la faiblesse de lconomie dpartementale et dabsence de plan durbanisme et de contrle du dveloppement.
Aroport actuel ne rpond pas aux critres internationaux correspondant aux aroports de moyenne importance.
Exigut de lespace physique disponible sur le site actuel ou impossibilit dun ramnagement susceptible de rpondre aux besoins futurs dun aroport moderne.
Dcongestionnement de la ville du Cap-Hatien- en effet le dveloppement du centre-ville historique du Cap-Hatien dpend de la rlocalisation de laroport.
Dtrioration des infrastructures de laroport actuel dont le cot de rhabilitation long terme serait prohibitif.
4-1-1-6.- LINSUFFISANCE ET LINADQUATION DES SERVICES ET QUIPEMENTS PUBLICS.
Comme il apparat dans le diagnostic antrieur le niveau des services (ducation, sant, eau potable, nergie, justice, assainissement, tlcommunication, logement, drainage) et quipements disponibles dj fragile est insuffisant et inadquat pour satisfaire la population actuelle. En dgradation, ils influent sur les conditions de vie dj prcaire de la population. Cette situation alarmante constitue un puissant facteur de blocage du dveloppement du Nord et reprsente les signes manifestes du sous-dveloppement du Dpartement. Elle se traduit par :
Le sous-dveloppement urbain du dpartement freinant toute possibilit dvolution des sections communales.
Le sous-quipement des sections communales, en effet, la qualit des services et quipements publics fournis et le taux de desserte au niveau des sections communales se rvlent trs dficient, selon les indicateurs de dveloppement par rapport au milieu urbain dj critique.
-
18
4.1.1.7.- DGRADATION DES INFRASTTRUCTURES ROUTIRES ET ENCLAVEMENT DES MONTAGNES HUMIDES.
Comme mentionn dans lanalyse de la contrainte des infrastructures inadquates toutes les infrastructures routires du Nord sont compltement dtriores, ce qui freine la mobilit des marchandises et des hommes dans lespace. Cette situation rsulte du sous-quipement chronique de la Direction :Dpartementale du Ministre des TPTC, inexistence des services de voiries et de Gnie municipal, absence de systme dentretien.
Au niveau des montagnes humides, Plaisance, Pilate, Borgne, Grande Rivire du Nord, Dondon, Port-Margot, Ranquitte, Limb, toutes les sections communales sont enclaves. Ltat actuel des tronons routiers qui les desservent est tout fait dplorable. Tous les tronons routiers offrent un service de qualit trs mdiocre en saison sche qui est par ailleurs trs courte vue la forte pluviomtrie de ces zones et sont quasiment impraticable en priode de pluie en raison du ravinement et de linexistence douvrage de franchissement sur les petites rivires, les ravines. Ceci conduit lisolement des montagnes humides et rduit considrablement les rapports fonctionnels entre les diffrentes units gographiques. Pour toutes ces raisons, les centres urbains narrivent pas remplir leurs fonctions lgard de leur hinterland et les produits prissables (agrumes, avocatiers, manguiers) narrivent que sporadiquement aux marchs.
Cet enclavement est aussi constat au niveau de larrondissement de St-Raphal qui occupe la frange Nord de la rgion naturelle du Plateau Central. En saison de pluie, les communes de Pignon, la Victoire, Ranquitte sont coupes du reste du Dpartement. La route nationale No 3 qui traverse la zone est dfonce sans drainage et entretien, la rivire Bouyaha est sans ouvrage de franchissement dans la partie Sud-est de la ville de Saint Raphal, idem pour les rivires de Bohoc, Los Pinic (La Victoire) et la ravine citron.
4-1-1-8.- FAIBLESSE DES RENDEMENTS DU SECTEUR AGRICOLE OU DCLRATION MARQUE DE LA PRODUCTION AGRICOLE.
Lagriculture historiquement la base de lconomie du dpartement et de laquelle dcoule la quasi-totalit des emplois au niveau des sections communales et des villes caractre rural et qui est appele satisfaire les besoins alimentaires dune population qui augmente un rythme acclr se caractrise par sa faible productivit rsultant de srieuses contraintes physiques, techniques, conomiques quhumaines.
Les contraintes dordre physique sont : scheresse, inondation, rosion, morcellement (parcellisation des exploitations agricoles), pousse de lurbanisation dans les environs des villes, en particulier dans les environs du Cap-Hatien, prdominance des zones montagneuses, dgradation de lenvironnement.
Les contraintes humaines sont : analphabtisme, dficience de la main duvre, carence de la main-duvre, lexode rural vers Cap-Hatien et autres centres urbains et lextrieur du dpartement. En effet, au niveau des exploitations agricoles, ce sont les jeunes qui migrent, les vieux restants ne peuvent plus faire de lAgriculture avec les mmes
-
19
techniques rudimentaires des annes antrieures Peuplement des sections communales surtout des zones montagneuses agricoles - drainage des ressources humaines de la DDN/MARNDR par les projets et les ONGs, pression dmographique.
Les contraintes techniques sont : faible niveau technique des exploitants, prcarit de loutillage agricole, la carence et linadquation de lencadrement technique, faible utilisation de semences amliores, de produits phytosanitaires et dengrais, faiblesse en infrastructure dirrigation. Le systme de tenure des terres, le mtayage pertes agricoles post-rcolte pas de processus de mcanisation de lagriculture mauvais tat des voies daccs au niveau des zones de plaines et manque au niveau des zones montagneuses (Pilate, Borgne, Plaisance, Grande rivire du Nord, Dondon, Bahon, Ranquitte, Port-Margot et la zone de lAcul du Nord) Absence de structure de vulgarisation
Les contraintes infrastructurelles sont : routes, eau, lectricit, service, habitat,, sant, formation, absence de centre de recherche (recherche-dveloppement), carence de moyens dirrigation, carence de moyens de contrle dinondations, absence des infrastructures de drainage au niveau des plaines du Nord, absence des infrastructures de transformation absence de moyens de stockage.
Les contraintes conomiques sont : Le dveloppement de la contrebande qui fait chuter la production des cultures vivrires. Prix trs bas des produits trangers par rapport aux produits locaux la mvente des produits de base -non disponibilit des moyens de stockage - part de linvestissement public insuffisante - inorganisation du systme de commercialisation des produits agricoles - pauvret au niveau des campagnes -inorganisation du systme de crdit agricole.
4.1.1.9.- FAIBLESSE DES INFRASTRUCTURES DACCUEIL ET DE SERVICE
Au niveau des infrastructures daccueil et de service le dpartement est quasiment dpourvu. Les infrastructures daccueil existant sont localises dans la commune du Cap-Hatien. Il nexiste que deux orphelinats au Cap-Hatien.
4-1-1-10.- LA CROISSANCE SPONTANE DES AGGLOMRATIONS
La croissance rapide de la population ne rythme pas avec la dotation du dpartement et des investissements raliss, conjugu avec lexode rural rsultant de la non satisfaction des besoins des habitants et la dstructuration de lagriculture a eu des impacts nfastes regrettables sur le processus durbanisation. En effet, partir de 1980 et particulirement aprs les vnements politiques de 1986, le dpartement na pas t pargn du dveloppement urbain anarchique. En fait, les diffrentes agglomrations dj sous-quipes accusent des extensions en absence de toutes normes durbanisation, sans aucun contrle des organismes chargs dassurer la gestion du bti, sans aucune planification, sans aucun moyen de contrle du dveloppement urbain et rural.
Cette croissance spontane des villes du Nord peut tre dcrit comme suit :
-
20
extension des villes dans des zones inondables (Cap-Hatien, Limb, Limonade) et des zones risque sur les piedmonts et dans des ravines,
part une partie de la section communale de Bande du Nord, toute la commune du Cap-Hatien est urbaine et dborde sur les communes voisines.
Dgradation physique de la ville du Cap-Hatien Surdensification lextrme du centre-ville historique du Cap-Hatien Dmographie galopante de toutes les zones urbaines du dpartement. Explosion de la ville originelle du Cap Dveloppement rapide du secteur informel Migration massive du monde rural Absence de viabilisation des terrains construire spoliations
Les extensions anarchiques sont marques par lexpansion du secteur informel la multiplication des zones marginales sans cohrence, sans les moindres infrastructures et services de base . Pour le centre-ville du Cap-Hatien les extensions en piedmont et la Surdensification combine avec une taudification de lintrieur des blocs risque dteindre le joyau class patrimoine national.
4-1-1-11.- LA PAUVRET DE LA PAYSANNERIE OU DU MONDE RURAL
A linstar des autres rgions du pays, les paysans du Nord sont pauvres. La dtrioration du revenu en zones rurales durant les quatre (4) dernires dcennies a aggrav les conditions dexistence prcaires de gens voluant dans les sections communales. La baisse continuelle de leur pouvoir dachat depuis la dcennie 70, par lradication des porcs (lpargne des paysans) au dbut des annes 80 combine la crise socio-politique multiforme dcoulant des vnements de 1986 et lembargo conomique couvrant la priode 1991-1994, a ananti toutes leurs possibilits de sauto amliorer. Donc lconomie rurale souffre dune crise endmique caractrise par la faiblesse du capital chassant les paysans qui sont obligs dmigrer vers dautres zones, vers Cap-Hatien, Port-au-Prince ou ailleurs dans le but de survivre.
En scrutant le milieu paysan, les constatations suivantes confirment lextrme pauvret des paysans :
outillage rudimentaire et en nombre rduit par exploitation morcellement exagr des terres cultives le mode de tenure le faible niveau des investissements et de la productivit le manque dencadrement agricole la faiblesse du crdit agricole mauvaise organisation du circuit de commercialisation des produits agricoles croissance dmographique galopante absence de moyens de conservation adquat ni pour les semences, ni pour les rcoltes
dont ils perdent entre 10% 20%, voir 30% le chmage dguis sous-quipement des sections communales
-
21
Absence dinfrastructures agricoles et de transformation Insuffisance des services de base en zones rurales.
Pour toutes ces raisons, le monde paysan est dcapitalis alors quil reprsente 70% de la population dpartementale. Cette extrme pauvret les entrane ou les ternise dans une conomie de subsistance rendant illusoire tout espoir dinvestir par eux-mmes. Aussi, certains services essentiels tels que lducation, la sant malgr leur caractre thoriquement gratuit, ont un cot si lev quils sont pratiquement inaccessibles.
Donc, la pauvret de la paysannerie freine ou constitue un handicap majeur la promotion socio-conomique du Dpartement, retarde lintroduction de nouvelles technologies. Elle bloque lextension et la diversification des activits conomiques et par lintermdiaire de lexode rural alimente le secteur informel.
4-1-1-12.- LA PAUPRISATION AU NIVEAU DES AGGLOMRATIONS
Cette pauvret se manifeste de la manire suivante : taux de chmage lev insuffisance marque dinfrastructures techniques, sociales et conomiques croissance spontane des agglomrations faiblesse des infrastructures daccueil et de services. Absence dindustries de transformation Le drainage et lassainissement des agglomrations Le gonflement du secteur informel Insuffisance des services offerts Surdensification du centre ville historique du Cap-Hatien Sous quipements des municipalits Faiblesse du pouvoir dachat des populations.
4-1-1-13.- LABSENCE DE RECHERCHE DVELOPPEMENT
La recherche dveloppement reprsente toujours le moteur du dveloppement socio-conomique et de linnovation technologique. Pour lensemble du pays et du dpartement du Nord en particulier ce facteur important en fait dfaut. Aucun centre de recherche n'est remarqu. Actuellement les paysans exploitants la terre, les artisans sont livrs eux-mmes. Alors que le dpartement regorge de possibilits (potentialits) de dveloppement dans des domaines tels : agro-industries, la pisciculture, lartisanat, etc
4.1.1.14.- LA FAIBLESSE/OU LABSENCE DINDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS DE BASE
le Nord fait partie des rgions du pays possdant le plus fort taux de produits transformables. Cependant les quelques usines de transformation qui jadis existaient sont plus de 90% fermes et celles restantes font face des problmes structurels et techniques et financiers. Les industries artisanales ne sont pas pargnes par ces mmes difficults.
-
22
4.1.1.15.- LA DGRADATION DE LENVIRONNEMENT (DES BASSINS VERSANTS)
Le Nord connat la dgradation environnementale la plus dramatique de son histoire qui affecte les conditions de vie des habitants et leur dveloppement socio-conomique tant en milieu urbain que dans les sections communales. Cette dgradation est une rsultante de combinaison dlments complexes qui se manifestent de la sorte :
dboisement intensif des bassins versants qui engendre sous leffet des pluies (nords et alizs) une rosion acclre des pentes qui diminue la capacit du dpartement pour satisfaire les besoins alimentaires et nergtiques dune population en progression.
Des pratiques culturales inappropries sur des pentes dclives et trs rodables Sdimentation du barrage hydrolectrique de Caracol Surexploitation des derniers reluques forestiers des bassins versants. Pressions dmographiques sur les terres cultivables largissement des lits des rivires A lexception des valles et des piedmonts, tout le haut bassin versant de la rivire
Bouyaha est quasiment sans arbres. Mauvaise exploitation des ressources naturelles des bassins versants Ensablement et la baisse de la fertilit des plaines et des collines. Alluvionnement des cosystmes marins et ctiers (mangroves) la baie du Cap-Hatien, la
baie de lAcul, de Caracol, Bord de Mer de Limonade Inondations frquentes au niveau des plaines (Limb, toute la plaine du Nord, Port-
Margot, Borgne, St-Raphal) affectant les infrastructures dirrigation, le rseau routier existant
Lessivage des sols de montagne (certains endroits dans les bassins versants.
Cette dgradation environnementale a pour consquence pauprisation de la paysannerie chute drastique de la production agricole tarissement des sources perturbation du rgime pluviomtrique diminution de la capacit dabsorption pluviomtrique du dpartement exode rurale inondations abaissement du niveau des eaux des rivires scheresse (en 1997, sept mois de scheresse
Les dtails sur les effets prvisibles de cette dgradation environnementale sont mis en vidence travers les phnomnes dinteraction inhrents la situation. Selon ce graphe tir du document projet damnagement du bassin versant de Bouyaha , les facteurs dclenchant la grave destruction du sol par la disparition de l`humus, le lessivage et lrosion constituent une chane o les diffrents facteurs sinfluencent mutuellement et o les effets sadditionnent.
-
23
Graphe danalyse des effets
Forte croissance Dmographique
Pnurie dnergie Incertitude de la fossile proprit foncire
Raret des surfaces utilisables pour lagriculture
Dforestation Pnurie alimentaire Agriculture inadapte
Pnurie Surexploitation de bois
Destruction rosion Perte dlments de lhumus nutritifs
Perturbation Mauvaise du rgime des eaux formation
Baisse de la production agricole
Pnurie deau potable
Pauvret de la population rurale
-
24
Ainsi donc, pour aboutir la rhabilitation de l`environnement dpartemental , il faut crer des formes d`exploitation du sol cologiquement stables, favorisant la couverture permanente du sol et arrtant la progression de lrosion et la dgradation du sol. tant donn les dimensions prises par la destruction de lenvironnement, ce sont l des conditions indispensables la survie conomique de la population rurale. Ainsi donc, la restauration et le maintien de la fertilit du sol est la condition vitale indispensable au maintien et au dveloppement de la vie humaine dans les diffrents bassins versants menacs
4-1-1-16.- LE DRAINAGE ET LASSAINISSEMENT
Le drainage et lassainissement constituent lune des plus pineuses proccupations du Nord tant en milieu urbain quau niveau des sections communales. Les lments qui suivent caractrisent la problmatique :
rseau routier urbain dficient dessertes urbaines non revtues, sans drainage et fort souvent en terre battue. Eaux pluviales et uses sont vacues dans les rues rosion des mornes surplombant certaines villes (Cap-Hatien, Grande rivire du Nord,
Bahon, Pignon, Ranquitte, Acul du Nord Absence dinfrastructures de drainage Obstruction des canalisations de la ville du Cap-Hatien ( sa partie historique, le reste est
dpourvu de ces infrastructures Inondations frquentes au niveau des villes du Limb, du Bas-Limb, du Cap-Hatien, de
la Plaine du Nord, de Limonade, de Quartier Morin, du Bas de lAcul, de Saint Raphal, du Borgne etc.
Nettoyage des rues, des marchs publics, des places publiques et ramassage des ordures dficient
vacuation des dchets fcaux faite dans de mauvaises conditions Menaces imminents denvasement des fonds coralliens de la baie du Cap-Hatien ainsi
que du bassin rhodo sous leffet de lrosion Transformation des places publiques en marchs publics Sous-quipement des services de voirie municipaux Saturation de certains cimetires Utilisation des ravines, des terrains vacants pour lvacuation de certains dchets 57% de la population dfquent mme le sol intensification des bidonvilles en piedmont des mornes ceinturant la ville du Cap-Hatien construction dans les zones inondables et marcageuses du Cap-Hatien, du limb, etc. insuffisance de fosses daisances.
4.1.1.17.- LA NON-EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ATLANTIQUE
Le dpartement du Nord possde 125 kilomtres de ctes et un plateau continental trs important . Cependant, ce plateau continental est non-exploit pour raisons diverses telles :
sous-quipement des pcheurs de la cte absence de politique de pche
-
25
caractre artisanal et archaque de la pche actuelle la houle et les vents limitent srieusement les possibilits de pche artisanale absence dencadrement du secteur
En plus de la pche en haute mer, le Nord nexploite pas le potentiel quil possde dans limplantation de retenues colinaires dans les zones de Pignon, Baie de lAcul, la zone de lory. Le potentiel de pche en eau douce du Nord demeure inconnu ainsi que les effets de la dgradation de lenvironnement sur ce potentiel.
4.1.1.18.- LE NON-ENCADREMENT DU SECTEUR ARTISANAT
Les principales contraintes qui empchent lexpansion du secteur artisanat snoncent de la manire qui suit : La production est caractrise par un quipement non adapt, des difficults daccs aux
matires premires locales et imports), manque de vritable ateliers de production, faible niveau de qualification des fabricants ou des artisans, le non regroupement des artisans en association.
La commercialisation souffre de labsence de promotion des produits hatiens, du peu dexposition, du faible dveloppement du secteur touristique et du Bas-prix de certains.
La formation technique fait grandement dfaut, il nexiste que deux centres de formation: Ouvroir National qui est sur la responsabilit du MAS o la production dobjets dcoratif et militaires y est enseigne et les ateliers Taggart situs Mombin Latagne, sur la route Nationale #1 qui forment des artisans et produisent de manire quasi industrielle des objets dcoratifs et des bijoux pour le march touristique de Labadie et lexportation vers la rpublique Dominicaine.
Recul de la tradition (fabrication artisanale de briques) Labsence de crdit et des problmes dorganisation est aussi observ. Le manque de support la production de lencadrement technique, et de promotion sont aussi
des goulets dtranglement de taille au bon dveloppement de ce secteur. Le Ministre des affaires sociales qui devrait influencer lorganisation du secteur a failli sa
mission.
4.1.1.18.- LINORGANISATION DU SYSTME DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES.
La commercialisation des produits agricoles devraient tre lune des plus grandes sources de revenues pour le monde rural et un stimulent pour l`intensification de la production. Cependant, les goulot d`tranglement qui suivent montrent le contraire.
Absence d`infrastructures de commercialisation, de stockage et de conservation structures.
Absence d`amnagement des diffrents marchs du dpartement (Rgionaux, urbains et ruraux)
Absence de moyens de transport adquat Absence de vois de pntration (surtout dans les zones hautement productives) Problmes dintermdiaires (entre producteur et consommateur)
-
26
Absence de stratgie de promotion commerciale des produits provenant du secteur agricole
Faiblesse d`infrastructures de transport Absence de politique des prix (en effet, les ministres du MARNDR et du
Commerce qui devraient se pencher sur la question ne lont fait.
4.1.1.20.- LA PRESSION DMOGRAPHIQUE
4.1.1.20.1.- VOLUTION DE LA POPULATION NON-URBAINE DU NORD
Le Nord a toujours t parmi les Dpartements du pays les plus densment peupls, cela depuis la colonisation franaise. Autour de 1900, selon Semexant Rouzier, le Nord traditionnel abritant une population sestimant 250000 qui habitait dans sa grande majorit au niveau des campagnes dans des maisons isoles. Au recensement de 1950, le Nord actuel comptait 379 050 habitants dont 331185 ruraux (87,30%) et 48124 urbains (12,70%). Les communes les plus peuples taient le Limb , lAcul du Nord, le Borgne, Plaisance, Cap-Hatien, Pilate, Port Margot et Grande Rivire du Nord, Dondon. A lexception du Cap Hatien et dans une certaine mesure lAcul du Nord (pour sa partie de plaine) toutes les autres communes sont en zones de montagnes humides. Au recensement de 1971, le Nord actuel accusait une population de 496503 habitants dont 415444 en zones non urbaines et 87 754 en milieu urbain et les communes des zones des montagnes humides continuait enregistrer les densits au km2 les plus leves.
En 1982, avec le phnomne migratoire des annes 1970, la population du Nord natteignait que 564032 habitants dont 427615 en zones non-urbaines. A en croire ces chiffres sur une priode de 11 ans, la population des Sections Communales navait augment que de 12171 habitants. Cependant les communes des montagnes humides accusaient toujours les densits de population en zone non-urbaine les plus leves. Plaisance 338,27h/km2, Pilate 292,89; 216,87 au Borgne; 232,61 Dondon, 251 lAcul du Nord; 199,34 la Grande Rivire du Nord; 193,5 au Limb etc. Cette forte densit a eu des consquences nfastes sur lenvironnement du Dpartement, dboisement, rosion, inondations frquentes, pauprisation de la paysannerie, etc.
Selon les projections de lIHSI de 1996, la population des Sections Communales du Nord comptant 549472 habitants pour 223108 urbains. La densit de la population dans les zones non-urbaines 261 ha/km2 avoisinent la densit nationale 264,84 ha/km2. Les zones des montagnes humides continues afficher les densits non-urbaines les plus fortes.
Il ressort des analyses prcdentes que les risques de surexploitation de nos ressources naturelles avec ses densits actuelles, sont omniprsents. Ainsi rduire les causes humaines de lrosion devient un problme trs ardu tant il est ncessaire doprer de changements sur la rpartition spatiale de la population, sur les mthodes et faons culturelles, sur lorganisation sociale, commerciale, administrative.
Cette population non-urbaine croissante est un facteur d aggravation des ressources. Lie au morcellement des parcelles agricoles, cette pression dmographique acclre les dsquilibre
-
27
alimentaire du paysan et loblige de pratiquer une agriculture non-adapte aux potentialits naturelles des sols.
Carte de densit de population non-urbaine (non-urbains et petites villes de moins de 4000 habitants)
4.1.1.20.2.- REPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION
En croisant les densits dmographiques (cf. Carte ci-jointe tablie partir des donnes de 1996 de lIHSI) et les caractristiques go-morpho-climatiques des sections communales du Nord, on peut mettre en vidence les caractristiques suivantes de loccupation des terres dans le dit dpartement:
les montagnes sont fortement peuples, ce qui nest pas sans consquence sur laptitude lagriculture de ces zones.
les zones basaltiques sont aussi densment peuples que les mornes calcaires, avec une proportion lgrement plus leve.
Les plaines sont nettement sous-exploites par rapport leur potentiel, du fait de problmes fonciers mais aussi de manque damnagement (irrigation en zone aride, drainage ou protection damnagement humide). Ainsi, cest le climat humide qui prsente la densit de population en plaine la plus leve.
Les densits maximum observes en plaine et dans les collines (526 h/km2(1) pour certaines sections communales ) dmontrent la capacit daccueil que reprsentent ces zones si elles taient correctement amnages.
Densit de population non-urbaine observe : moyen (mini-maxi)
Habitant/Km2 ARIDE Moyen Humide 1 Plaines 278,5
(167 - 374) __ 298,67
(187 - 491) 2 Plaines et Collines __ 161
(161) 332,62
(140 - 550) 3 Collines Basaltes __ __ 351,56
(212 - 526) 4 Collines Calcaires __ 215,67
(67 - 400) 315,50
(223 -431) 5 Mornes Agricoles/Basaltes __ __ 275,33
(107 -688) 6 Mornes Agricoles/Calcaires __ 240
(143 - 3337) 312,14
(184 - 433) 7 Mornes non Agricoles/basaltes __ __ 274,2
(137 - 465) 8 Mornes non agricoles/Calcaires __ __ 264
(264)
-
28
Ainsi, si certaines variations de densit sexpliquent par les ressources naturelles, la corrlation nest pas vidente et les carts entre les densits des sections communales dune mme classe (minimum, moyenne et maximum) montrent que la population nest pas rpartie comme les ressources naturelles le permettent.
Certaines zones supportent donc, des pressions dmographiques suprieures ce que pourrait donner une meilleure rpartition et les rpercussions sur les sols et la fort y sont plus catastrophiques.
Une autre mise en valeur des plaines beaucoup plus intensive avec une utilisation systmatique de lirrigation aurait offert de lemploi une population qui aurait pu sy installer avec une densit deux fois suprieure lactuelle. Ainsi la pression dmographique dans les montagnes les plus sujettes lrosion aurait t moindre.
Il est sr galement quun autre dveloppement urbain aurait t un moyen efficace de freiner la densification des espaces non-urbains les plus fragiles.
Pour fixer les ides, une rpartition thorique de la population a t imagine partir dun modle fond sur des capacits daccueil de chacune des units morpho-climatiques estimes partir des densits moyennes observes en Hati, ou partir de comparaisons internationales (cf. Tableau ci-aprs).
CAPACITE DACCUEIL (Hab/km2)
Climat Morphologie
1 2 3
1 (750) (750) (750) 2 (250) (350) (400) 3 4
--
70 150 100
200 150
5 6
--
50 100 80
150 100
7 8
--
30 75 50
100 75
Source :Gestation des ressources Naturelles en vue dun dveloppement durable en Hati, rapport final, octobre 1990.
La comparaison entre les capacits daccueil thorique et des densits actuelles permet de dresser la carte du Bilan de la pression agricole sur les terres. Cette carte met en vidence:
Des sections communales fortement surexploites: La densit actuelle est plus de 2 fois suprieure la capacit thorique daccueil (Pilate, Plaisance, Bahon , Ranquitte, Dondon, ).
Des zones surexploites (densit de 1, 2 2 fois suprieure la capacit) (Limb, Borgne, La Victoire, Grande Rivire du Nord ).
-
29
Et linverse des zones daccueil potentiel: nettement sous-exploites ( densit actuelle infrieure 0,5 fois la capacit daccueil) ou lgrement sous-exploites (densit actuelle comprise entre 0,5 et 0,8 fois la capacit).
Cette reprsentation traduit les grands dsquilibrs dans loccupation des sols actuels du Nord avec:
La forte sous-valorisation des plaines et plateaux du Nord qui constituent des zones daccueil potentiel pour plus dun demi million de ruraux (Quartier Morin, Limonade, Acul du Nord, Plaine du Nord, Milot, Pignon, Saint-Raphal, Bas-Limb, Port Margot ).
La surexploitation dramatique dans les mornes calcaires: Chane du Nord Le fichier par section communale permet de dresser par unit morpho-climatique un bilan des zones daccueil et des zones excdentaires.
Bilan des Flux de population potentiels (pour le Nord) en 1000 habitants (% de la population 1996)
+ = Accueil - = Excdent
Gomorphologie
Climat
Plaines
1
Plaines +
Collines
2
Collines Basaltes
3
Collines Calcaires
4
Mornes Basaltes
5
Morne Calcaire
s
6
Haut Mornes Basaltes
7
Haut Mornes
Calcaires
8
Total
Aride 1
+471.5 (+169%)
__ __ __ __ __ __ __ +471.5 (+169%)
Moyen 2
__ +239 (+148%)
__ -115.67 (-54%)
__ -160 (-67%)
__ __ -36.67 (+27%)
Humide 3
+451,33 (+151%)
+67,33 (+20%)
-159,56 (-44,36%)
-165,5 (-45,52%)
-125,35 (-45,52%)
-212,14 (-68%)
-174,2 (-63,53%)
-189 (-71,6%)
-517,01 (-171,47%)
Total 922,83 (150%)
306,33 (84%)
-159,56 (-44%)
-281,17 (-49%)
-125,35 (-45%)
-372,14 (-67%)
-174,2 (-63%)
-189 (-71%)
-72,26
Le tableau met en vidence les possibilits daccueil des zones de plaines et de collines quelles soient de climat aride , moyen ou humide
4-1-1-21.- LA DEGRADATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET BATI ET ESSOUFFLEMENT DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE DU CAP- HATIEN.
A part, la Citadelle qui a t rhabilite avec laide de lUNECO au cours de la dcennie 80, tous les autres sites caractre historique sont rests sans amnagement, sans entretien dont certains sur le poids du temps et des intempries tombent en ruine. Certains sont t victimes des actes de vandalisme. Les actes de vandalisme constitue un problme serieux pour la prservation du patrimoine historique et bti du Nord.
De plus, laugmentation de la population du Cap-Haitien rsultant de la trs forte migration ruralo-urbaine des annes 80 et dbut des annes 90 a eu des consquences regrettables sur le Centre-Ville historique et de lextension de la ville au-del de sa trace
-
30
originelle. En effet, la situation de la ville est frappante. Les rues regorgent de gens comme Port-au-Prince, la circulation devient presquimpossible, les loyers excessivement levs, surdensification inimaginable du Centre-historique et de sa dgradation, surconcentration des activits conomiques dans le centre originel, bidonvillisation des Piedmont des mornes surplombant la ville causant la dfiguration du Site Touristique et des problmes dassainissement (drainage) normes, lextension de la ville se fait sans aucune planification et est essentiellement constitue de Bidonvilles dont certaines sont implantes dans des zones risques. Aujourdhui, la ville originale qui a atteint sa capacit daccueil limite implose. Le centre ville historique, sous le poids des usages actuels, risque de disparatre. Tout se fait sans planification approprie.
4-1-2.- LES ZONES DINTRTS AVEC TYPE DINTRT
En dpit des diffrents blocages identifis, le dpartement possde de trs forts potentiels de dveloppement pouvant contribuer lamlioration du bien-tre gnralis de ses rsidents court, moyen et long termes. Les observations de terrain, les rflexions tenues lors des ateliers de travail au niveau des communes, les rencontres avec le secteur priv et des personnalits avises et des recherches documentaires montrent que ce potentiel est constitu des composantes qui suivent. Il snonce de la manire suivante :
la position gographique et la proximit du grand march Nord amricain et des routes de croisire
la prsence du 2e ple conomique national la prsence dun tissu urbain trs dense les mines et carrires limage du Cap-Hatien et du Nord le tourisme les ressources en eau la diversit du secteur agricole et ses grandes possibilits de dveloppement Les potentialits commerciales les sols la pche et la pisciculture lartisanat
Outre ces potentiels, le Nord doit accorder une considration importante la mise en valeur du potentiel hydrolectrique, de llevage, des attraits environnementaux, de la culture, de lindustrie de transformation de la canne sucre, aux petites et moyennes industries agroalimentaires, la prsence dune multitude dorganisme de dveloppement (coopratives, caisses populaires, chambres dagriculture), la prsence dun entrepreneurship rgional, au secteur informel, aux sports et loisirs
4-1-2-1.- LA POSITION GOGRAPHIQUE ET LA PROXIMIT DU GRAND MARCH NORD AMRICAIN ET DES ROUTES DE CROISIRES.
-
31
La position gographique du Dpartement reprsente un atout indiscutable pour son dveloppement. Avec sa forme de cne, au Nord, il donne accs sur locan atlantique sur plus de 125 km, cest--dire 8,21% des faades maritimes du pays, lEst sur le dpartement du NordEst qui apparat comme son appendice tant que les relations sont troites ou tanches. au sud il souvre sur les dpartements du Centre et de lArtibonite dans les zones Nord et Nord-Ouest de la rgion naturelle du Plateau Central o ils forment lune des zones davenir du dveloppement agricole et agro-industriel du pays, et lOuest, il accde lArtibonite par deux (2) axes routiers et le Nord-Ouest par voie routire et maritime. Donc, le Nord occupe une position centrale dans le Grand Nord (Nord-Est, Nord, Nord-Ouest, le Haut Artibonite, le Haut Plateau Central). Elle lui offre tous les grands bassins de population comme march. En effet, Gonaves, lEstre , Saint Michel de lAtallaye, Gros Morne, Hinche sont environ dans ltat actuel des infrastructures routires, trois(3) heures du Cap-Hatien. Le NordEst dans son ensemble y est branch. Bientt, la rhabilitation ou la construction de la route Cap-Ouanaminthe le mettra une soixantaine de minutes de la frontire Hatiano-Dominicaine.
Sa position par rapport la cte Atlantique lui offre son ouverture aux les voisines Turks and Cacos, Providence, les Bahamas etc. qui connaissent un dveloppement touristique florissant en perptuelle croissance. Dj dans le cadre dactivits commerciales et autres, elles entretiennent avec le Nord, quoique labsence de statistiques constate, un volume de transactions importantes. Le Nord les fournit des produits agricoles (vivres alimentaires et autres) et elles servent de transit pour quelques touristes qui peuvent tre en nette augmentation dans le futur.
Quant au grand march Nord amricain, le Nord est moins dune heure et demie davion de la cte de Floride o rside lune des plus importantes migrations hatiennes aux tats-Unis qui pourrait constituer le premier march extrieur pour le Nord. Par mer, un bateau de marchandises ou de croisire fait le trajet Floride-Cap-Ha





![Nord Nord Ost [Leseprobe]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5790910f1a28ab7b278f595a/nord-nord-ost-leseprobe.jpg)