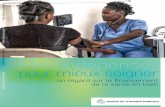Mieux que aide
Transcript of Mieux que aide

Direction Action France et Institutionnelle 8 juillet 2009
En temps de crise...l’aide et l’entraide !
L es analyses de la crise insistent sur son caractère multiple : y sont liés des éléments d’ordre économiques, financiers, mais aussi culturels, sociaux, en termes de sens. Pouvons-nous la voir comme une opportunité de prendre du recul par rapport à nos pratiques, d’inventer d’autres modes de vivre ensemble, situant
l’économie comme un moyen, de repenser le projet de société vers laquelle nous pouvons aller ? Et ce, au niveau national, mais aussi en prenant en compte l’impact de la crise sur les pays en voie de développement….(voir en annexe les articles et références).Face à cette crise, et à ses répercussions sur les plus pauvres, nous pouvons nous interroger, comme le fait Eléna Lasida, théologienne et économiste (voir article en annexe) : doit-on promouvoir un ensemble de mesures à destination de ceux que l’on regarde alors comme pauvres, ou bien parier sur la possibilité de refonder un projet de société en partant des plus fragiles, des plus en difficulté, qui sont acculés à des questions qui finalement se posent à tous ?
La crise a des conséquences directes pour nous aujourd’hui. Même si elle ne touche pas encore directement les plus pauvres (phrase entendue dans un groupe de personnes en situation de pauvreté en mars 2009 : « la crise ? C’est tous les jours la crise, pour nous, et depuis longtemps ! »), des personnes en fragilité par rapport à l’emploi (intérim, CDD, personnes licenciées par des entreprises qui mènent des plans sociaux ou font faillite) commencent à arriver dans les accueils, et le montant des secours augmente de manière significative dans plusieurs délégations.
Il est donc important de prendre des temps de recul pour analyser la situation locale, et situer nos réponses dans ce contexte nouveau… Ce document veut y aider, et les départements de la Direction Action France et Institutionnelle sont à votre disposition pour y travailler.

Sommaire1 - La crise, quelles répercussions ? Quels sont nos constats ? 1 - Constats généraux
2 - Quelques tendances générales
3 - Les politiques publiques
4 - Constats du Secours Catholique
2 - Les acquis d’expériences menées depuis 25 ans au Secours Catholique
3 - Expériences nouvelles et recherche d’alternatives 1 - Des lieux où se créent des relations d’entraide
2 - Des expérimentations de circuits économiques alternatifs
3 - Des expériences génératrices de revenus
4 - Des lieux où l’on réfléchit ensemble a des modes de vie en société
4 - Des pistes pour le Secours Catholique 1 - Les pratiques de terrain à partir des secours matériels et financiers
2 - Les pistes pour mettre en œuvre des pratiques alternatives
3 - L’action institutionnelle locale et nationale
4 - Des points de repères pour se situer par rapport à des offres de mécénat local
5 - Des points de repère pour se situer par rapport aux propositions des pouvoirs publics pour la vie associative
6 - La coopération à développer sur un territoire
7 - La crise ne s’arrête pas l’été !
Annexes I • Politique des secours en temps de crise - Proposition d’animation
• Les 8 repères de la politique des secours
II • Lien entre pratiques de terrain et vision de la société - Proposition d’animation
III • Collectif interassociatif ALERTE - Intervention du secrétaire général du Secours Catholique • ALERTE demande un plan de relance sociale
IV • Enquête du CREDOC réalisée en décembre 2008
V • “Pour une écosophie politique” Patrick Viveret
VI • “Lutter contre la pauvreté ou faire projet avec les pauvres ?” Eléna Lasida
02

1 - La crise, quelles répercussions ? Quels sont nos constats ?
1 - constats généraux
Le CREDOC a réalisé à la demande de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale une étude sur les conséquences de la crise en décembre 2008. Il a cherché à mesurer les consé-quences de la crise par l’ensemble des mé-nages et par ceux qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. 64% des ménages français, pauvres ou non, estime s’en sortir plus difficilement qu’un an auparavant, cette proportion est de 70% chez les ménages pauvres.
Parmi les ménages qui estiment que leur situation a changé, ceux en situation de pauvreté mettent en avant, pour expliquer le phénomène, la conjonction d’une diminution des ressources et d’une augmentation des charges (changements dans la vie professionnelle et augmentation du coût de la vie).
Les questions posées permettent de mieux cerner les difficultés rencontrées par les ménages en situation de pauvreté et leur aggravation depuis 3 mois ou un an, notamment dans les restrictions de consommation, l’inquiétude ressentie, les changements vécus dans la situation pro-fessionnelle.
Au final, l’étude montre que l’impact de la crise est très important pour 13% de l’ensemble des ménages, mais pour 28% des ménages en situation de pauvreté. Les facteurs de fragilité repérés sont le fait de toucher moins de 1500 € mensuels, d’avoir des enfants, d’avoir moins de 30 ans, d’être au chômage et d’être locataire…
Voir résumé de l’enquête en annexe…
2 - quelques tendances Dans l’opinion publique, quelques mouvements se font sentir : ainsi, l’enquête du CREDOC indique que les ménages français pensent en majorité donner comme avant aux associations, (seuls 7% pensent donner moins) et certains (5%) pensent donner plus. En Allemagne, Peter Neher, président de la Caritas, face à la multiplication des distributions alimentaires dans lesquelles s’engagent des volontaires de plus en plus nombreux, s’est ainsi exprimé : « on ne peut pas se donner le but de soutenir des groupes de gens sur le long terme en leur offrant de la soupe, des vêtements de seconde main et des tarifs réduits, cela signifierait entériner le développement et la stabilisation de deux mondes parallèles ». Il rejoignait en cela le président des associations de solidarité protestantes qui s’inquiétait : « l’engagement croissant de ceux qui portent secours à leurs semblables dans la misère est certes très louable, mais la charité doit aller de pair avec un engagement pour plus de justice sociale ».
Des entreprises mécènes annoncent en cette période vouloir faire plus dans le mécénat, et font des propositions aux associations, orientées sur la réponse immédiate à des besoins supposés, dans le registre matériel. Le modèle économique dominant, les incitations fiscales, encouragent cette pratique qui se révèle rentable pour elles…
Quelques comportements, encore margi-naux, se développent ou reviennent :• la pratique du glanage : accord entre
un agriculteur, ou un maraicher et des personnes qui viennent ramasser ce
qui n’est pas utilisé par l’agriculteur ou le maraicher selon des modalités convenues ensemble… pratique qui pourrait être généralisée ! « Je vous laisse vous approvisionner sur la partie de récolte que j’aurais abandonnée, mais vous êtes vigilant à respecter mes terres et mes arbres ; voire, je peux vous présenter, ainsi qu’à vos enfants, ma passion pour la terre et pour ses produits, pour la confection de confitures, selon la saison… » ;
• la récupération, particulièrement dans les poubelles, qui vient d’être étudiée par le CERPHI sur commande du Haut Commissariat aux Solidarités Actives, mais qui pourrait être approfondie par le dialogue avec les éboueurs ou vigiles de supermarchés parfois chargés de neutraliser les denrées restantes ;
• des groupes qui s’organisent pour aller se servir dans les grandes surfaces en mettant leur précarité de revenus au regard des marges de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution ;
• les squats par nécessité où habitent des personnes et familles n’ayant pu accéder à un logement décent malgré de multiples démarches.
Ces pratiques sont l’occasion de gestes de solidarités informelles, qui pourraient être étudiées, mises en valeur, encouragées : certains vigiles et responsables de super-marchés attendent que des personnes qui en ont manifestement besoin se soient servies avant de répandre l’acide ou l’eau de Javel, des éboueurs patientent lorsque des personnes fouillent dans les poubelles avant de les vider, des commerçants de marché mettent de côté leurs surplus qu’ils n’utiliseront plus pour des personnes qui les récupèrent, etc.
03

3 - les politiques publiques
Des politiques gouvernementales s’appuient aussi sur le mécénat pour assurer des missions de service public, ce qui invite à être vigilant pour que ne soient pas substituées à des politiques publiques des apports de mécènes qui ne présentent pas toutes les garanties des missions essentielles de la puissance publique. Ainsi une charte sur l’aide alimentaire a été signée début mars 2009 entre les acteurs de l’agro-alimentaire, de la distribution, les transporteurs, le gouvernement et la Croix Rouge, le Secours Populaire, la Fédération des Banques alimentaires pour faciliter l’approvisionnement des structures d’aide alimentaire, formalisant des pratiques existantes et sans réelle nouveauté. Elle était accompagnée d’un guide des bonnes pratiques à destination des opérateurs économiques souhaitant intervenir auprès des associations d’aide alimentaire (industrie agro alimentaire, distributeurs, voire restaurateurs), précisant les types de produit à donner ou non. Depuis plusieurs années, l’ANIA, Association Nationale des Industries de l’Agro-alimentaire, apparaît dans les communications gouvernementales et sur les affiches du plan « alimentation et insertion », sans toutefois avoir d’engagements très clairs sur la sensibilisation à manger ni trop sucré ni trop gras. Le plan de relance décidé par le gouvernement a fait le choix de consacrer 20 millions d’€ à l’amélioration de la traçabilité et de la chaine du froid dans la distribution de denrées alimentaires par les associations, que ces denrées viennent des Banques alimentaires, de collectes directes, ou de dons d’entreprises de la grande distribution, qui cherchent à contractualiser avec les associations sur ce point….
La logique d’appels d’offre qui se développe pour assurer des missions de service public risque de se renforcer avec la crise. Or cette logique se fonde sur l’identification des besoins par la seule puissance publique,
qui définit aussi le mode de réponse qu’elle juge pertinent, sans concertation avec les personnes concernées ni les acteurs engagés avec elles ; elle peut ainsi décider que pour anticiper des difficultés dans les quartiers cet l’été, il faut développer les formes de surveillance policière, et lancer un appel d’offres en ce sens, que ne verront pas les associations qui présenteraient des actions de loisirs et de mobilisation de jeunes….Elle peut aussi conduire à la restriction de la vie associative, car la puissance publique tend à ne reconnaître que les missions de service public, et non plus le projet associatif qui contribue au lien social, à la vie démocratique sur un territoire.
Dans le même temps l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale a lancé une étude à laquelle le Secours Catholique participe, avec d’autres organismes, pour travailler à des indicateurs de pauvreté avec les personnes qui vivent la pauvreté. Elle s’inscrit dans la ligne européenne qui veut que les plans nationaux d’inclusion sociale soient élaborés avec les personnes qui subissent la pauvreté.
4 - constats du Secours CatholiqueDe nombreuses délégations font le constat d’une augmentation importante de la fréquentation des accueils et des secours depuis l’automne 2008, voire depuis le printemps 2008, de 20 à 30%. Les statistiques d’accueil notaient déjà une augmentation, le suivi au jour le jour le confirme. Il faut se garder d’une interprétation hâtive de ces chiffres, qui peuvent traduire une demande plus forte des personnes, mais aussi une attitude de services sociaux qui ont recours plus facilement aux associations, par exemple dans le cadre de la mise en place des pôles emploi ou de la réorganisation de certaines CAF qui rendent l’attribution des secours
plus longue ou incertaine. Par ailleurs des équipes, des bénévoles peuvent être pris dans un climat où la crise est très présente, à donner, voire à anticiper la dégradation de situations. Cela dit, des délégations relèvent l’aggravation de nombre de situations, notamment de personnes qui travaillaient et n’ont plus de contrat en intérim ou CDD. On voit aussi arriver de manière croissante des personnes âgées, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins avec leur retraite.
Quelques éléments d’explication reviennent régulièrement : on estime que 76 % des revenus d’un ménage en situation de pauvreté sont des charges fixes, ce qui laisse 24 % seulement de marge de manœuvre au quotidien…alors que cette proportion était de 50 % il y a 10 ans…Lorsque les charges sont mensualisées, alors que les ressources, elles, sont variables d’un mois à l’autre, en cas d’intérim, de CDD, de changement de situation, de dépenses imprévues (panne de voiture, de réfrigérateur, de machine à laver,…) mais aussi du fait des primes « exceptionnelles » (de rentrée scolaire, de Noël, de Solidarité Active,…), la situation devient critique ! Et les stratégies marketing qui proposent précisément des promotions sur tel ou tel équipement juste après la date du versement de ces primes, ou des allocations, profitent de ces aubaines… Un « baromètre » a été mis en place en interne, pour se donner les moyens de suivre les effets de la crise au plus près. Il s’agit d’un sondage régulier, tous les 2 mois, auprès de 135 accueils dans 27 délégations. Les premiers résultats sont à prendre avec prudence, car de très nombreux facteurs peuvent les expliquer, et qu’ils ne sont pas nécessairement à attribuer à la crise des derniers mois ; cependant, il semble que se dégagent des demandes liées à l’arrêt net d’emploi en intérim, aux frais de transport, à la situation des jeunes (voir article dans Messages du mois de juin 2009).
04

2 - les acquis d’expériences menées depuis 25 ans au Secours Catholique
Lorsqu’en 1984, la France entrait dans une nouvelle période de crise (avec une forte augmentation du nombre de
chômeurs, l’accroissement de la durée du chômage touchant davantage les seniors et les jeunes, le nombre grandissant de personnes sans domicile fixe…), une prise de conscience s’est faite à l’échelle du pays. On parlait alors des « nouveaux pauvres » et l’on vit fleurir les initiatives, les associations (Restaurants du cœur, Banques Alimentaires, missions en France de Médecins du monde, Fondation Abbé-Pierre, etc.).
Le gouvernement lança un plan d’envergure « Pauvreté Précarité » qui allait financer de multiples initiatives proposées et portées par les grandes associations nationales. Certaines délégations du Secours Catholique saisirent alors cette opportunité. Celle-ci coïncidait avec un mûrissement de leur réflexion sur l’aide et la nécessité de transformer les activités de secours en révisant sérieusement leurs méthodes et mises en œuvre. Cela s’est fait notamment dans la suite d’échanges avec des Caritas du Sud dont certains membres séjournaient en délégation et portaient un regard sur nos actions. Malgré un contexte alarmiste, cette période fut féconde et innovante. Créées dans cette décennie, elles existent encore pour beaucoup d’entre elles.
• C’est ainsi que l’on vit peu à peu se substituer des épiceries sociales, ou groupements d’alimentation familiale avec accompagnement éducatif et budgétaire, aux anciennes distributions de colis alimentaires ou de casse-croûtes.
• des repas partagés, au-delà de la fourniture de nourriture, créaient du lien social en proximité.
• Des personnes aidées ont mis en place des groupements d’achats alimentaires où elles sont à la fois impliquées comme bénévoles et bénéficiaires, avec parfois des liens privilégiés avec des agriculteurs en difficulté.
• Certaines équipes s’orientèrent vers des systèmes de journées de travail (création et développement des groupes « travail et partage », réunissant plusieurs
familles qui employaient une personne en lui donnant des heures de travail qui constituaient un temps plein, et des réseaux d’accompagnement) et la création d’entreprises d’insertion, d’associations intermédiaires, etc.
• Des « vestiaires » ou « services mobilier » se sont transformés en entreprises de retraitement de textiles, friperies avec de « vrais » magasins ouverts à tous…, employant souvent des personnes en insertion, dans un processus de remise à l’activité.
• On vit également se créer des jardins collectifs, des troupes de théâtre, des groupes de parole et d’action institutionnelle...
• Les premiers « voyages de l’Espérance » à Lourdes étaient organisés, mêlant personnes accueillies et bénévoles en un seul peuple de chercheurs de sens.
• Des familles commençaient à se regrouper pour envisager un projet de vacances ensemble.
Depuis, cette dimension s’est développée et approfondie : ainsi, des assemblées de la solidarité, dans plusieurs régions, ont réuni plusieurs centaines de personnes pendant des séjours qui alliaient le bien-être ensemble, l’action collective et institutionnelleOn pourrait multiplier les exemples, en allant plus en détail dans des domaines variés, des contextes (urbains, ruraux), des populations (Rroms, d’origine étrangère, personnes incarcérées ou familles en visite, etc.). Ce qui est sans doute le plus remarquable dans tout cela, c’est que le Secours Catholique a tenté, dans le contexte de crise des années 80, de s’adapter aux personnes en situation de pauvreté, en cherchant :- à reconnaitre leur dignité (en tournant le dos de plus en plus résolument à l’assistanat) ; - à prendre en compte la pauvreté économique mais aussi toutes les autres dimensions de la vie des personnes : sociale, politique, culturelle, spirituelle.- à inventer des formes nouvelles d’action qui mettaient en jeu la participation directe des personnes ;
- à créer des espaces de synergie collective : chacun contribue d’une manière ou d’une autre au groupe et chacun bénéficie de l’apport de tous. Cette dimension collective de la solidarité est devenue une constante et a permis de mieux valoriser la dimension individuelle et les espaces qui lui sont consacrés (accueil, écoute, accompagnement de personnes en recherche d’emploi, de logement, soutien administratif, parrainage de personnes sans-papiers, etc).
Cette vision s’est progressivement diffusée au sein du Secours Catholique. Il est intéressant de noter que cette évolution a également traversé le travail social ainsi que d’autres associations : permettre davantage que les personnes deviennent actrices, citoyennes. La dimension collective et la participation des personnes sont devenues des axes majeurs. Dans cette perspective et dans le prolongement direct des pratiques mises en œuvre par de nombreuses Caritas de pays du Sud, le Secours Catholique s’est par exemple engagé, depuis une dizaine d’années, dans le développement social, en voulant privilégier une action en direction de territoires fragilisés qui prenne appui sur la population elle-même, dans une démarche de transformation sociale. Ces expériences ont particulièrement vu le jour en quartiers populaires.
Cette politique a-t-elle apporté une réelle amélioration dans la lutte contre la pauvreté et est-elle toujours pertinente en temps de crise ? Dans les 20 dernières années, on a vu en France se renforcer le filet protecteur ultime avec la mise en place du RMI et, plus récemment, du RSA. La décentralisation a opéré un transfert progressif (pas toujours équitable) des charges de l’Etat vers les collectivités locales et les acteurs associatifs. Pour autant, la pauvreté a reculé dans la mesure où le taux de chômage régressait. Si l’on observe d’autres paramètres que le seul pouvoir d’achat (isolement, santé, scolarisation, insécurité…), le mal-être ne s’est pas résorbé. Il suffit d’analyser de près les phénomènes récurrents de crises dans les banlieues pour s’en convaincre.
05

3 - Expériences nouvelles et recherche d’alternatives
1 - des lieux où se créent des relations d’entraide.Elles permettent de mieux maitriser le budget familial, par l’échange de stratégies et l’entraide entre personnes qui vivent des difficultés du même ordre, ou par l’accès à une alimentation de qualité sous forme de repas partagés ou de relations créées avec des producteurs locaux.
Échanges de “tuyaux”• D’une association où les personnes
viennent échanger leurs vêtements, une personne en situation de précarité dit: « C’est un lieu convivial, c’est autour d’un café et d’un gâteau. D’un truc tu peux repartir avec quatre… On prend en compte les souffrances du quotidien, on se débat pour trouver des choses importantes pour les familles comme une poussette pour jumeaux. ».
Dans des groupes de femmes, des tuyaux, s’échangent : l’adresse de l’école de coiffure où on sert de modèle gratuitement, des commerçants qui acceptent que leurs invendus soient pris par des personnes qui n’ont pas les moyens de s’en acheter, etc.
Accès coopératif à l’alimentation• dans un département, un Forum Social
Local a permis la rencontre entre des initiatives autour de l’accès à l’alimentation digne pour des personnes à très faibles revenus. Il s’agit là de mener une réflexion avec l’ensemble des personnes concernées, des associations, des élus pour réfléchir aux solutions à inventer, ailleurs de permettre à des habitants de s’organiser entre eux pour l’achat en gros de denrées alimentaires et dans la cueillette des fruits, à un autre endroit, de faire vivre une épicerie de quartier ouverte à tous, mais à prix réduits pour les personnes en difficulté…. et de l’engagement d’élus, d’associations, de travailleurs sociaux.
Système D• Un groupe de femmes sollicité pour un
colloque décrit les gestes d’entraide qui permettent de faire face lorsque le budget est très contraint : « C’est le système D, pour rentrer à la piscine, j’ai la carte de la culture du cœur, 1,5 euros pour aller au théâtre ou à la piscine » ; « il y a l’école de coiffure, ce sont des jeunes apprentis qui coupent les cheveux gratuitement, mais il y a toujours le chef qui contrôle. On est toujours bien coiffé. C’est gratuit, vous servez un peu de modèle. J’y suis allée plusieurs fois même pour des mariages et je n’ai jamais été déçue » ; « Entre nous on se donne des petits trucs, et j’ai trouvé un troc de vêtements » ; « Il faut chercher tout ce qui est gratuit, les conférences…pour dire un peu de sortir un peu de chez soi et pas se cantonner à la télé ».
Autoréhabilitation• Le PADES mène des démarches d’auto
réhabilitation dans des quartiers où certains habitants « rajeunissent » leur intérieur avec l’aide et les conseils de quelqu’un qui s’y connaît, et apprennent ainsi à le faire ailleurs, chez leurs proches ou voisins.
• En région parisienne, une équipe a créé une « cuisine autogérée » où les parents habitant dans les hôtels viennent régulièrement cuisiner des plats chauds pour leur famille.
Tables ouvertes• les tables ouvertes sont des temps
privilégiés pour inviter l’ensemble de la communauté paroissiale à vivre une démarche communautaire d’accueil et de rencontre fraternelle pour « élargir l’espace de la tente » (Isaïe 54,2) avec tous ceux qui nous sont les plus « lointains » : les personnes isolées, marginalisées, démunies, tous ceux en manque d’amour, de relations sociales et familiales, en manque de pain et de toit… et réunir ainsi dans un même banquet, réunissant les personnes âgées et les jeunes, les chefs d’entreprise et les chômeurs, les sans-grades et les officiers, les croyants et les incroyants, les sans-famille et les familles nombreuses, les riches et les pauvres.
06
Nous avons l’occasion de rencontrer des porteurs d’initiatives originales, alternatives, au sein du réseau Caritas, ou ailleurs, qui ouvrent de nouveaux chemins pour penser l’économie et la société autrement, et permettent aux personnes qui vivent des situations de pauvreté de se situer autrement, de participer vraiment à l’invention de pistes nouvelles, intéressantes pour l’ensemble de la société.

2 - des expérimentations de circuits économiques alternatifs
Au Québec...Dans le quartier du Plateau Mont-Royal, à Montréal, un groupe de personnes en situation de pauvreté se retrouvait de temps en temps avec un animateur lié à la paroisse. Ses membres ont décidé qu’ils ne pouvaient plus continuer à mal se nourrir, avec les rebus et les surplus que leur donnait la banque alimentaire. Ils ne pouvaient plus supporter les conditions dans lesquelles ce don leur était fait. « On n’est pas des petits pauvres, on est des citoyens ! » Ils ont donc trouvé des petits producteurs agricoles qui pouvaient leur vendre en gros des produits de bonne qualité. Ainsi un groupement d’achats alimentaires est né, destiné à des personnes de toutes conditions sociales. Mélanger les gens a favorisé l’échange : les pauvres relèvent la tête, les plus favorisés sont sensibilisés à la misère. Ils sont maintenant une centaine de personnes du quartier de tous horizons sociaux. La honte de quêter de la nourriture de mauvaise qualité a fait place à la fierté légitime de s’en être sorti ensemble, de mieux se nourrir et donc d’améliorer ainsi sa santé physique et mentale. « La solidarité c’est rentable ! ».
Petits producteursDans une épicerie solidaire en lien avec une équipe locale du Secours Catholique, des relations ont été créées eu fil du temps avec des petits producteurs locaux : des temps de cueillette des fruits, de ramassages des légumes sont organisés régulièrement, ainsi que des moments de transformation, ensemble, des produits récoltés : confection de confitures, de tartes, de conserves, etc. L’approvisionnement en fruits et légumes frais devient donc une solution durable pour les familles concernées. Des rencontres sont proposées autour de sujets très divers que les participants choisissent.
3 - des expériences génératrices de revenus
Au BrésilDans l’état du Rio Grande do Sul, dont la capitale est Porto Alegre, la ville de Santa Maria est pionnière en économie populaire et solidaire. Près de 150 groupes de personnes en situation d’extrême pauvreté ont organisé leur survie économique autour d’activités génératrices de revenu. La plupart sont des coopératives fonctionnent selon le principe d’autogestion. Par la prise de responsabilité rapide et l’appui d’ONG comme la Caritas Brésil (soutenue par Caritas France), les personnes se forment et rapidement deviennent autonomes dans la gestion de leur entreprise… Par exemple, la coopérative de Justas Tramas, s’est créée suite à la fermeture d’une usine de confection de la région. Des femmes ont alors décidé de s’organiser pour recréer une activité à partir de leur savoir-faire. Elles ont bénéficié du prêt d’un local par la ville pour une durée de 5 ans. Spécialisées dans la confection de vêtements, elles ont élargi leurs activités (création de modèles, sérigraphie, etc.) grâce à des cours de formation obtenus via des ONG comme Caritas.
CoopérativesEn France, des groupes de femmes, réunies au départ autour de leurs savoir-faire, souvent culinaires, cherchent à en vivre, à en faire une source de revenus. Deux d’entre eux cherchent à créer ensemble des coopératives de traiteur, pour valoriser leurs compétences et en vivre : elles ont entamé des démarches pour approfondir les questions juridiques, commerciales, etc.
4 - des lieux où l’on réfléchit ensemble à des modes de vie en société
Démarche de recherche actionEn 2005-2006, des groupes de différentes délégations ont participé à une démarche de recherche action collective. Réunis autour de préoccupations communes (améliorer la vie dans le quartier, avoir de meilleures relations avec les professionnels de santé, s’insérer en France, pour des demandeurs d’asile, trouver un terrain pour un jardin, briser la solitude, etc.), ils entamaient une démarche de recherche, avec formulation de la problématique, approfondissement des concepts, recherche d’hypothèses,
vérification des hypothèses, pour déboucher sur une action qui améliore leur vie et celle de leur environnement. Certains groupes ont ainsi réfléchi sur la manière de vivre ensemble malgré les différences, d’autres sur l’importance de la culture dans l’appréhension du système de soins, sur la peur engendrée chez d’autres par le fait d’être pauvre, sur les liens entre pauvreté et solitude, sur la manière d’habiter et les alternatives aux solutions classiques de relogement qui ne prennent généralement pas en compte les liens créés et l’aspiration à avoir des lieux partagés, sur l’importance de la sensibilisation de l’opinion dans l’évolution des lois, etc. Cette expérience de « penser ensemble » transforme les regards et permet d’aborder des questions de société : la recherche d’habitat autrement renvoie au mode d’habiter dans les villes, les questions sur l’altérité, la peur des uns par rapport aux autres, la différence et le vivre ensemble pour des groupes en précarité, à la façon dont la société le vit, la mise en évidence des phénomènes culturels dans l’approche du milieu médical concerne de nombreuses catégories de population, etc.
Démarches de développementDepuis une dizaine d’années, des démarches de développement ont été engagées par une quinzaine de délégations dans des quartiers populaires. Des animateurs vont « à mains nues » dans le quartier, sans rien proposer, pour aller à la rencontre des habitants, créer des liens avec eux, et les aider, s’ils le souhaitent, à se mobiliser pour faire changer des aspects de la vie du quartier. C’est ainsi que des groupes d’habitants ont mené des actions pour changer l’image de leur quartier, (donner un nom à des tours, remettre en état les boites aux lettres, représenter le quartier dans des réunions publiques, organiser des fêtes de quartier…), pour prendre part aux décisions concernant sa vie au quotidien (meilleures conditions pour payer les charges, interpellation des bailleurs sur leurs responsabilités en matière de travaux d’étanchéité, sensibilisation aux conditions dangereuses de circulation dans le quartier, pour finalement obtenir des aménagements routiers,…), etc. Au-delà des actions menées, ce sont des dynamiques de changement individuel et collectif qui se créent entre habitants d’un même quartier, avec d’autres interlocuteurs, avec des habitants d’autres quartiers.
07

4 - Des pistes pour le Secours Catholique
1 - les pratiques de terrain à partir des secours matériels et financiersVoir le document en annexe : « quelle politique des secours en temps de crise ? » déjà travaillé par plusieurs délégations.
Plusieurs régions souhaitent travailler sur une plus grande cohérence régionale de la politique des aides et secours. Il importe en ce domaine de bien distinguer l’aide, qui est évidemment nécessaire, et l’assistance, qui crée de la dépendance et ne répond pas à ce que nous voulons mettre en œuvre.
Favoriser la relation dans tous les lieuxamorcer des liens d’une autre nature à partir de lieux qui peuvent paraître distributifs, créer des relations entre les personnes, favoriser la rencontre entre-elles et bénévoles, la prise en compte d’autres aspects de la vie, autour d’activités artistiques, de supports d’expression. Cela peut passer par la chaleur du lieu, la disposition qui permet ou non l’échange, le climat créé, les prétextes à l’échange (affichage de belles photos,
objets réalisés dans des groupes, le rituel du café, l’invitation à faire partager objets décoratifs, poèmes, chants, etc). Le risque, en temps de sollicitations accrues, est de faire passer au second plan les dimensions de convivialité, de relations gratuites si importantes à la vie de chacun….
Proposer la participation à un groupesituer les réponses à une personne sur différents registres : au dela de l’aide matérielle, proposer systématiquement la participation à un groupe par exemple, du Secours Catholique ou d’ailleurs (maison de quartier, centre social, foyer rural, association de quartier,…). En groupe, on peut échanger des stratégies pour se débrouiller au quotidien, et améliorer la vie (adresses où se faire coiffer gratuitement, maximisation des périodes creuses, pour faire marcher les appareils électro-ménagers, relations créées avec les commerçants pour récupérer les invendus en fin de marché, etc.)…et travailler ensemble sur le repérage des stratégies qui, si on s’y laisse prendre, peuvent grever lourdement le budget !
Orienter vers d’autres solutionsrepérer l’ensemble des acteurs d’un territoire pour bien identifier tous les lieux où trouver des réponses en termes de vie matérielle (l’analyse de territoire dans une délégation a montré qu’il existait différentes réponses matérielles de la part d’autres organismes, que les personnes ne sollicitaient pas toujours et vers qui on pouvait les orienter). Cela suppose de mieux connaître les prestations proposées, les conditions d’accès, et de solliciter les savoirs des personnes que l’on accompagne, parfois très expérimentées !
Prendre du recul et décider à plusieursse donner les moyens de prendre du recul avant d’accorder une aide : poser le principe de ne jamais accorder une aide directement, mais toujours après un temps de réflexion personnelle, ou mieux, un échange entre 2 bénévoles, ou mieux encore, un passage en commission. Quelques questions, quelques points de repère sur les droits des personnes, et les manières d’y accéder, peuvent aider
08
Aujourd’hui, l’apparition d’une nouvelle crise économique et financière ne manque pas d’avoir des répercussions progressives mais inévitables, sur toute la population. Se pose immédiatement la question des aides d’urgence. Faut-il palier les carences de ressources financières des personnes lorsque celles-ci sont durablement affectées ? Si l’on répond positivement, s’agissant
d’aides ponctuelles répondant à une situation accidentelle comment imaginer qu’une association, si puissante soit-elle, puisse répondre à ces besoins énormes, durablement ? Quant aux multiples formes d’actions mentionnées ci-dessus, elles gardent leur raison d’être mais montrent des limites. Comment proposer un parcours d’insertion professionnelle s’il n’y a pas de travail ? Comment faire durer des lieux de repas, de convivialité sans tomber dans une assistance déguisée ? Il est donc nécessaire de répondre à la crise en activant d’autres leviers que l’aide individuelle ponctuelle.
L’occasion se présente aujourd’hui de faire preuve d’imagination et de créativité. Depuis les années 1980, nous avons progressé dans « l’association avec les pauvres ». Avec eux, nous voulons « construire une société juste et fraternelle ». Ce défi est le nôtre depuis 1996. Ce sont les personnes qui vivent ces situations de pauvreté qui vont pouvoir prendre en main leur destinée, avec nous. Ensemble nous devons inventer des solutions de solidarité. Il y a des alternatives possibles. Certains se sont déjà engagés dans ces directions. Elles sont fondées sur les notions de réseau, de coopération, d’entraide, d’échanges de savoir, d’économie non monétaire… A chacun de s’associer avec d’autres pour créer autant d’expériences, de recherche-action, les mettre en synergie pour qu’elles s’auto fécondent, se renforcent et se diffusent. Il suffit d’y croire…

les bénévoles de terrain à prendre le recul nécessaire.
Logique qui apaise,logique qui transforme
s’arrêter pour réfléchir à notre logique d’action, et ce qu’elle change dans la vie des personnes que nous accueillons, de manière durable et profonde… Sommes-nous dans une logique qui apaise, qui permet de reprendre souffle momentanément, ou dans une logique transformatrice des personnes, qui acquièrent ainsi de la maitrise sur leur vie, de leur environnement, des causes des situations ? voir en annexe les outils d’analyse du lien entre les pratiques de terrain et de la vision de société que l’on porte…
2 - les pistes pour mettre en œuvre des pratiques alternatives
Identifier des situations concrètes1 des expériences existent pour mettre en relation des personnes qui ont besoin d’aide alimentaire avec des petits producteurs pour faciliter l’accès à des produits de qualité, à moindre coût, de manière durable, il nous faut repérer des liens entre des épiceries sociales et des agriculteurs, maraichers, éleveurs, sont à construire pour mettre en place des circuits économiques courts accessibles aux personnes à faibles revenus. Des relations d’échanges et de services mutuels (ramasser les pommes de terre ou cueillir les cerises, donner quelques heures d’entretien des champs, etc), peuvent aussi être crées sous des formes telles que les Systèmes d’Echanges Locaux. Au-delà, tous les liens qui se créent entre des personnes vivant la pauvreté et d’autres font changer des choses dans la vie quotidienne, et plus largement : liens de voisinage, rencontres, échanges mutuels débouchant sur un engagement ensemble dans des dynamiques solidaires qui ouvrent des voies nouvelles…
2 Les processus d’apprentissage des savoirs qui peuvent améliorer la vie quotidienne, et pallier les risques de déséquilibre soudain du budget, sont à consolider : des initiatives d’auto-organisation se développent (garages coopératifs, coopératives, lieux de fabrication de confitures, conserves, etc.). Des liens avec le PADES, spécialisé dans les démarches d’auto-promotion, peuvent se renforcer… De
même que des relations avec l’association Voisins et Citoyens en Méditerranée par exemple, qui met en relation des personnes ayant des idées ou questions pour inventer des systèmes alternatifs (garages coopératifs, épiceries sociales en lien avec des producteurs,…).
3 Des contacts sont à amplifier avec les circuits du commerce équitable et des circuits courts pour réfléchir à l’accès des personnes à faibles revenus à ces circuits, les utiliser en tant qu’institution, et peu à peu inventer des modes alternatifs de recours à l’économie.
3 - l’action institutionnelle locale et nationaleEn fonction de ce qui est repéré comme revenant souvent dans les situations des personnes accompagnées, il s’agit de signaler les dysfonctionnements d’exercice des droits ou d’accessibilité (bornes informatiques dans les administrations, services vocaux chers et parfois inadaptés, complexité croissante des démarches,…) pour provoquer des changements, surtout quand l’analyse est vraiment portée par les personnes qui subissent les dysfonctionnements.
Identifier les situations récurrentes1 se donner les moyens, en commission, en équipe, d’identifier des situations récurrentes pour les faire remonter à la délégation, à la région, pour les renforcer le cas échéant (formaliser des outils de recueil des disfonctionnements ou situations, « clignotants »).
2 se donner les moyens de les analyser précisément (rencontres régulières en équipe, en commission, grilles d’analyse pour préciser les situations).
3 réunir les personnes qui les vivent pour réfléchir ensemble, imaginer des pistes d’amélioration (méthodes de travail en action collective pour aider à l’expression et l’analyse par les personnes concernées)
4 élaborer collectivement des propositions concrètes pour éliminer les dysfonctionne-ments, transformer les pratiques des insti-tutions, mettre en œuvre des circuits plus efficace pour l’accès de tous aux droits, et les faire valoir auprès des institutions, par divers moyens.
4 - des points de repère pour se situer par rapport à des offres de mécénat local
Attention au risquede la substitution aux aides publiques : les pouvoirs publics ont à garantir l’égal accès de tous aux droits, ce qui suppose un accompagnement des plus faibles ; on peut craindre, en acceptant ou en sollicitant du mécénat à grande échelle, de cautionner une tendance (de la part de la puissance publique, de la société en général, à l’image des sociétés nord américaines) à au financement des dépenses sociales par des fonds privés, ce qui peut présenter des risques (sélection des populations aidées, des modes d’action, inégalités selon les régions, etc). Les bénéfices de grandes entreprises pétrolières sont aujourd’hui fortement valorisés alors qu’on leur demande (sans obligation) de contribuer à un fonds public pour l’énergie.
Quelles contreparties ?des contreparties en termes de communication, de la contractualisation nécessaire des règles en ce domaine, des juxtapositions de logos que nous acceptons, dans quelle perspective.
Cohérence des comportementsdes comportements éthiques des entreprises concernées : vérification nécessaire de la cohérence de nos positions, au niveau national et international, de nos interlocuteurs d’entreprises (pouvons-nous nous figurer en France sur les mêmes affiches, alors qu’une Caritas peut soutenir des mouvements qui vont l’interpeller vigoureusement sur ses pratiques ?)
Dialoguer sur des projetsde la capacité à dialoguer avec elles sur les projets, sur l’adaptation à nos projets, pistes d’action, des critères imposés (distribution, choix des publics,…), modes de communication, etc : quelle liberté nous est laissée, quelle marge de manœuvre, quels moyens pour mieux se rencontrer et se donner la chance de transformer notre regard les uns sur les autres ?
09

5 - des points de repère pour se situer par rapport aux propositions des pouvoirs publics pour la vie associative
1 du soutien à d’autres associations plus petites qui font de l’éducation populaire, du lien social, de l’animation rurale,…., dans des démarches communes, des questions posées, des alliances créées sur le terrain.
2 de la reconnaissance des associations comme porteuses de projets de vie pour les territoires, d’alternatives à un système uniquement marchand, de lieux de vie démocratique (et pas seulement d’exercice des missions de service public).
3 pour les politiques sociales, de maintenir l’égal accès de tous aux droits de tous, avec quelles ressources (et l’attention à porter au financement de politiques publiques par des mécènes…)
4 d’attitudes d’indulgence à avoir par rapport aux mesures d’expulsion locative dans les squats par nécessité.
6 - la coopération à développer sur un territoire
Circuits courts, alternatives économiques, relations de proximité, relations avec des acteurs locaux invitent à penser en termes de territoire, de bassin de vie. Plusieurs dimensions peuvent être renforcées :
1 Reconnaître et valoriser les réseaux informels d’entraide et de solidarité, dans les cages d’escalier, dans un micro quartier, dans un hameau, et les soutenir le cas échéant, par la mise en réseau, la formation, l’échange avec des pairs, etc. Parmi eux peuvent se développer les Comités Solidaires pour les droits dans lesquels s’engagent des personnes de tous horizons aux côtés des personnes victimes d’injustice, pour leur permettre d’exercer leurs droits.
2 rechercher les moyens de coopérer localement avec d’autres associations : comment réfléchir en coopération, et non
en rivalité sur un territoire, au moment où le soutien public aux dynamiques associatives semble menacé ? Nous avons une responsabilité d’attention à ce que la vie associative, les petites associations aient des garanties de survie par des financements publics et de proposition de modes de travail ensemble entre associations pour imaginer des synergies locales. Elles peuvent être fortes et sont en général bien reçues face à la multiplicité des associations, qui pose souvent question. Sinon, nous entrons dans une logique de marché à se partager (celui des donateurs, des médias, de l’image) et de compétition, logique que nous dénonçons comme étant à l’origine de la crise….Cette coopération peut prendre 2 principaux aspects :- Le soutien à la vie associative comme contribution à la vie démocratique, au lien social, à la dynamique de projets que les associations portent…à partir de l’analyse de territoire ;- La stratégie pour solliciter de manière concertée, et en fonction d’enjeux bien déterminés à l’avance, des fonds publics.
7 - La crise ne s’arrête pas l’été !
1 Se coordonner entre associations sur un territoire donné pour garder ouverts pendant toute la période des lieux d’accueil.
2 Interpeller les pouvoirs publics sur leurs propres ouvertures de permanences pendant la période, et leurs possibilités de réponse aux personnes en difficulté particulière à cette période.
3 Interpeller sur la nécessité de maintenir ou développer parallèlement loisirs quotidiens et propositions de vacances aux familles qui ne peuvent pas partir sans ces dispositifs. L’Accueil Familial de Vacances, les vacances en famille, en groupes, les camps d’enfants ou d’adolescents, sont particulièrement pertinents en cette période !
4 Cultiver les relations de voisinage simples : par une simple présence d’adultes, créer les conditions pour que les enfants jouent en tranquillité et en sécurité, proposer quelques jeux, des ballons, des livres suscitant l’intérêt d’enfants qui assez vite s’y intéresseront.
5 Proposer des temps de rencontre, de partage, d’échange en proximité: la fête des voisins peut se prolonger et se répéter dans l’été ! Mais aussi les échanges de savoirs, de savoirs faire, les sorties au vert, les tables ouvertes, etc !
Un exemple : des familles qui avaient l’habitude de partir (vacances, retour au pays,…) ne se déplaceront pas cet été faute de moyens. Les enfants et adolescents resteront donc chez eux. Face à cela, le Secours Catholique peut intervenir de différentes façons cumulables :• organiser des activités de loisirs
quotidiens pendant les grandes vacances, à partir des désirs, des aspirations des enfants, jeunes et adultes concernés
• interpeller les pouvoirs publics locaux pour qu’ils mettent en place des activités et animations dans les quartiers, plus nombreuses, variées, ouvertes que précédemment…et sur la qualité de ces animations (activités de consommation, ou permettant aux participants de créer, d’inventer, de se mobiliser ?)
• soutenir les organismes, structures qui en développent (centres sociaux, foyers ruraux, maisons de quartier, associations de quartier, etc).
• mobiliser pour cela des communautés paroissiales, pour que leurs membres :
- s’investissent dans l’animation d’activités proposées par les délégations et équipes,- incitent leurs municipalités à dévelop-per de manière un peu exceptionnelle, au vu de la situation, des activités de loisirs pour les enfants et jeunes,… et donc acceptent le cas échéant des aug-mentations des impôts locaux,- assurent une veille dans leurs quartiers, villages, pour repérer des enfants, jeunes qui pourraient en bénéficier,- partagent des temps de loisir, de convivialité, gratuits, d’échanges de savoirs faire, de service, avec des personnes connaissant des situations difficiles, et les organisent (tables ouvertes paroissiales, repas de quartier, sorties, balades, en campagne, etc).
10

11
Annexe • I
Politique des secours en temps de crise
Sur 1/2 ou une journée, inspirée de diverses réunions en délégation
1) présentation croisée : (15 mn)2 personnes qui ne se connaissent pas bien se présentent mutuellement 1 (2m 30 chacun(e))Puis chacun présente son binôme au groupe
2) attentes majeures des partici-pants à la réunion évoquées d’entrée ou ayant émergé au cours des échanges, inévitablement très diverses et sur diffé-rents registres :Expression orale, l’animateur note sur paper board (10 mn)
Puis la/les feuille(s) de paper-boardsont affichées de manière à rester visible
de tous pour toute la réunion
3) l’aide matérielle et financière de mon équipe. Dans l’invitation à la rencontre, chaque équipe aura été invitée à envoyer avant la réunion quelques lignes sur • le fonctionnement de son équipe (sur une
1e feuille A4)• ce qui marche bien (sur une 2e feuille A4)• ce qu’il souhaiterait améliorer (sur une 3e
feuille A4)
Le jour même, chaque représentant désigné par l’équipe présente ce que l’équipe a écrit (5 mn par représentant d’équipe ou de secteur)L’animateur pâte-à-fixe les feuilles A4, par thèmeOU écrit sur 3 feuilles de paper board (il peut se limiter à 2 : • une « pour notre équipe, ce qui marche
bien » ; • l’autre «ce que notre équipe souhaiterait
améliorer»)
4) les raisons de l’aide matérielle et financière au Secours Catholique. (40 à 45 mn)
• chaque participant, écrit une raison par post it 2 (autant de post its que de raisons) (10 mn d’écriture silencieuse)
• chacun va poser sur un support suffisamment grand, où les post it adhèrent bien (5 mn)
• sollicitation d’un(e) volontaire qui, devant le groupe, propose des regroupements par thèmes (si aucun volontaire, l’animatrice/teur peut le faire, l’essentiel étant d’avoir commencé à y réfléchir pendant la pose progressive des post-it) (10 mn)
• nommer ces regroupements de post-it• puis échanges en groupe (15 mn)- prendre le temps de demander au groupe
si ces regroupements lui conviennent- après accord sur un nom de thème, l’écrire
sur paper board- lister sur un autre paper board les points
éventuels de désaccords entre bénévoles d’équipes représentées 3 sous forme de questions
5) Comment faisons nous le lien avec la mission plus globale du Secours Catholique ? (1 h)Réflexion, en petits groupes, autour de : • soit des 3 premiers repères de la Politique
des Secours du SC 4 (1 groupe par repère).
Comment, très concrètement, les aides financières de mon équipe permettent l’application de ce repère ? Quels sont : • les facteurs facilitant sa mise en œuvre ?• les principaux obstacles rencontrés ? 5 • les moyens que nous pouvons prendre,
personnellement, avec le soutien de l’équipe locale, avec celui des animateurs de la délégation, pour contourner nos difficultés ?
1 Si le groupe est composé de personnes estimant bien se connaître, elles peuvent se dire mutuellement, « Pour moi le minimum vital, c’est… », toujours en binôme, mais en prenant 2 x 5 mn d’échanges à 2, avant présentation au groupe de ce qu’a dit l’autre
2 On peut aussi utiliser des feuilles A4 de couleur qui seront collées à la pâte-à-fix, et écrire avec marqueurs, pour faciliter la lecture des autres participants à la réunion.3 pas pour les opposer, mais indiquer que ces divergences montrent bien qu’il n’y a pas d’un côté des bénévoles de première ligne, confrontés aux réalités, et, de l’autre, l’équipe d’animation, qui resterait trop
déconnectée de ces réalités lorsqu’elle invite à prendre du recul4 1 - Rencontrer la personne et pas seulement distribuer une aide. 2 - Promouvoir la personne […]. C’est-à-dire lui permettre de changer de regard sur elle-même, […] de redevenir actrice notamment par des
actions collectives. 3 - Développer l’échange, l’entraide, au sein du Secours Catholique ou ailleurs, pour instaurer une relation d’égal à égal. Il s’agit de permettre à la personne de trouver des lieux où elle se sente utile, où elle donne à son tour.
Cela permet notamment aux équipes d’exprimer leurs préoccupations légitimes sur le nombre de personnes simultanément présentes à l’accueil, le sentiment de devoir répondre très souvent en urgence, la hausse pressentie des besoins en aide matérielle et financière…
Proposition d’animation

12
• soit un fonds commun d’évidence sur Notre mission.Puis relecture ensemble du document de poche Nos orientations 2006-2011.« Notre Mission :Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes et enfants vivant des situations de pauvreté sont les premiers acteurs de leur développement.Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion et promouvoir le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. » - Pour nous, qu’est ce que cela signifie ?- Comment faire concrètement, dans le
contexte de notre accueil ?(Constat que beaucoup de gens viennent pour des aides matérielles MAIS que, dans le même temps, le besoin d’être écouté longuement et reconnu comme habitant avec des aspirations à combattre la pauvreté qu’il subit implique de prendre du temps avec chacun).
6) En préparation du retour en équipe : pistes de travail proposées : 15 mnLes pistes ci-dessous sont celles qui reviennent le plus souvent. Ce schéma est évidemment à adapter, suite à l’expression des participants.
Il s’agit de mieux partir de la confiance que des accueillis témoignent plus particulièrement à un(e) ou quelques membres de l’équipe, d’être vigilant pour éviter le « maternage », de garder une attitude pédagogique, et de favoriser la prise de confiance des accueillis dans leurs potentialités pour avancer progressivement vers une plus grande autonomie. Cela ne s’improvise pas. Et chaque point listé exige de nous un travail en profondeur, avec le temps nécessaire. C’est à chacun de voir comment il souhaite s’y engager, là où il est.
Sont plus que jamais indispensables :
• L’approfondissement du travail de concertation en équipe
- réunions courtes mais régulières, pour échanger sur nos difficultés mais aussi nos satisfactions, s’informer mutuellement, chercher une meilleure cohérence entre membres d’une même équipe.
- utilisation plus systématique de fiches de liaison
• les échanges de savoirs et d’expérience entre équipes. exemples :
- temps de prise de recul ou relecture de l’accueil : comment fait-on dans l’équipe “y ” ?
- les étrangers en situation administrative très précaire (demandeurs d’asile, sans papiers …) sont nombreux à devoir solliciter l’aide matérielle et financière.
6 01 45 49 74 447 Notamment le repère 7, Travailler en partenariat pour des montages financiers ou pour orienter au mieux vers d’autres solutions (les relations ainsi engagées pouvant s’ouvrir sur une véritable collaboration).
C’est aussi valable pour une réflexion sur : cette aide alimentaire si vitale, d’autres associations en proposent sur le territoire de notre équipe. Comment travaillons nous en lien avec elles ? Si les participants n’ont pas exprimés trop de réticences sur le repère 7, évoquer les repères 5 et 6. 5 - Intervenir en dernier recours, ne pas donner en secours ce qui est dû en justice, c’est-à-dire faire d’abord jouer toutes les aides publiques possibles, ne serait-ce que dans le souci de respecter le don. 6 - Déboucher sur l’action institutionnelle si nécessaire, c’est-à-dire faire connaître les situations qui se répètent et proposer des réflexions ou des pistes de proposition aux pouvoirs publics.Voir en Annexe un communiqué de presse d’ALERTE, dont le SC est signataire, et une contribution de notre Secrétaire Général à une Conférence de presse de ce même collectif interassociatif
Les questions que cela nous pose, leur situation, leurs difficultés, notamment matérielles, mais aussi leur courage, ce qu’ils nous apprennent …peuvent être approfondies avec la Pastorale des migrants du diocèse et / ou le Département Etranger6 du Siège
- ….
• La participation active aux formations Accueil / écoute et aux Modules Accompagnement de la personne dans sa globalité organisées par la délégation
• Une réflexion à engager ou reprendre, en réunions de secteurs et d’EAT : quelle politique des secours 7 de la délégation ?
Beaucoup de travail nous attend, mais notre prise de conscience et notre motivation constituent des moteurs irremplaçables.
Si nous disposons d’une journée
Intercaler après le (5) une séquence sur le changement de regard (par exemple LE SOLEIL)Les gens expriment essentiellement ces besoins d’aide matérielle et financière. Sans nier ces besoins, comment les aider à reprendre conscience, et comment reprenons nous conscience, qu’ils ont aussi des raisons de vivre et des points forts sur lesquels s’appuyer ?
Annexe • I
Les 8 repèresde la politique des secours1. Rencontrer la personne et pas seulement distribuer une aide.2. Promouvoir la personne et la rendre actrice de son développement.
C’est-à-dire lui permettre de changer de regard sur elle-même, de prendre en charge sa promotion, son autonomie, son développement, de redevenir actrice notamment par des actions collectives.
3. Développer l’échange, l’entraide, au sein du Secours Catholique ou ailleurs, pour instaurer une relation d’égal à égal. Il s’agit de permettre à la personne de trouver des lieux où elle se sente utile, où elle donne à son tour.
4. Laisser la posibilité d’aborder les questions de sens, les attentes spirituelles, les valeurs, à l’occasion de la relation individuelle ou dans le cadre de groupes.
5. Intervenir en dernier recours, ne pas donner en secours ce qui est dû en justice, c’est-à-dire faire d’abord jouer toutes les aides publiques possibles, ne serait-ce que dans le souci de respecter le don.
6. Déboucher sur l’action institutionnelle si nécessaire, c’est-à-dire faire connaître les situations qui se répètent et proposer des réflexions ou des pistes de proposition aux pouvoirs publics.
7. Travailler en partenariat pour des monteges financiers ou pour orienter au mieux vers d’autres solutions (les relations ainsi engagées pouvant s’ouvrir sur une véritable collaboration).
8. Communiquer le sens que l’on donne à l’attribution de secours et nos critères d’intervention aux personnes accompagnées, aux travailleurs sociaux, à l’Église locale, aux partenaires, afin de nous défaire de l’image de “distributeur de secours” et d’être sollicités pour ce que nous voulons faire.

13
Lien entre pratiques de terrainet vision de la société
La complexité du travail social aujourd’hui, et des situations que vi-vent certaines personnes en situation
de précarité ou de pauvreté, les manières d’agir tellement diverses des acteurs so-ciaux et des équipes du Secours Catholi-que, la complexité des politiques publiques en matière de pauvreté, supposent un ef-fort de compréhension important de la part des acteurs du Secours Catholique (béné-voles, salariés, personnes en situation de précarité), eux-mêmes très divers dans leurs parcours de vie, leurs attentes et leurs engagements.Face au sentiment fréquent de n’avoir pas prise sur les enjeux mondiaux (la mondialisa-tion, l’accroissement des inégalités Nord-Sud ou dans les pays du Nord, les phénomènes migratoires, la prégnance de l’économique, la spéculation immobilière, les délocalisations,...), ces réflexions peuvent aider à comprendre comment les actions très locales peuvent favo-riser l’une ou l’autre des tendances à l’œuvre. Par ailleurs, beaucoup d’acteurs du Secours Catholique sont très pris dans l’action, et ont peu d’occasions de s’arrêter, de s’interroger sur cette action et sur leur engagement ; les propositions qui suivent peuvent les y aider.La boite à outils proposée ici vise à permettre à chaque acteur du Secours Catholique de comprendre que son mode d’action est lié à une analyse de la société, qu’il a ou non explicitée. La manière de proposer, de vivre l’attribution de secours ponctuels, un groupe de paroles, la création d’une structure d’insertion, un groupe d’intérêt, une démarche de développement peut relever d’analyses de la société et de son évolution très diverses. Il est important d’en être conscient et de dialoguer entre acteurs du Secours Catholique sur ces analyses différentes, pour mieux comprendre les différences d’approches, qui compliquent parfois les débats, et bâtir malgré tout une certaine cohérence. Toutes les actions menées
doivent bien en effet tendre à la perspective, à l’utopie créatrice que nous proclamons, une société plus juste et plus fraternelle....C’est l’horizon que nous nous sommes donnés, dans lequel ne s’inscrivent pas forcément toutes les actions, très diverses, menées au sein du Secours Catholique.L’objectif est de rendre explicite l’analyse de la société sous-jacente aux pratiques des acteurs du Secours Catholique, afin de permettre à chacun de construire une analyse critique de ces pratiques, et de vérifier si elles sont en cohérence avec l’horizon, la finalité que nous nous donnons. A partir de l’analyse des pratiques, il s’agit de rendre explicite le regard porté sur la personne, l’analyse de la pauvreté, et donc l’analyse de la société qui y sont sous-jacentes.II ne s’agit pas de présenter les différentes analyses de la société, libérale, marxiste, alter-mondialiste, social-démocrate, etc. De très nombreux ouvrages existent sur ces questions ! Il s’agit plutôt de permettre à chacun de mettre à jour, de prendre conscience que son action est fondée sur une analyse, plus ou moins consciente. Car nous avons aussi à nous situer par rapport à d’autres acteurs du champ social, professionnels de l’action sociale et autres mouvements ou associations, qui ont chacun leur propre analyse. Ainsi, une approche fondée sur le seuil de pauvreté conduit à une politique d’augmentation des revenus. L’Union Européenne a une stratégie de lutte contre la pauvreté qui passepar l’augmentation de la croissance économi-que, considérant que de proche en proche, les populations en situation de pauvreté se rapprocheront de l’emploi et donc sortiront de la pauvreté. A l’inverse, pour ATD-Quart-Monde, la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par un travail avec les plus pauvres, dont les acquis pour les plus pau-vres profiteront à tous.C’est un travail de fond, qui part nécessairement
de l’analyse des pratiques, et peut durer plusieurs mois, selon les publics différents.Cette boite à outils est conçue pour être utilisée dans différentes circonstances, avec des publics, des durées, des objectifs différents : une réunion d’équipe locale, une partie d’un conseil de délégation, un temps de formation, une réflexion sur l’action, etc.Elle articule différentes dimensions à partir de l’analyse de l’action. En effet, pour vérifier que cette action contribue à la lutte contre la pauvreté, il faut s’interroger sur ce qu’est la pauvreté des personnes qui y participent, et au-delà de l’action menée, quelles sont les formes et les causes de la pauvreté dans la société. Ces différentes dimensions sont :• le regard porté sur les personnes en situation de pauvreté,
• l’analyse d’une action menée par les participants,
• la prise de conscience de scénarios possibles d’évolution de la société.
« Mon regard sur la personne éclaire la manière dont j’agis, la manière dont je vis la relation, et renvoie à une analyse de la pauvreté et les moyens de la combattre, dont celle du Secours Catholique. Et ma vision de la société s’appuie sur le regard que je porte sur les personnes, qui conditionne ma manière d’agir...Mon action révèle une vision de la société et un regard porté sur la personne... ». Les 3 dimensions sont donc intimement liées, mais peuvent s’aborder, selon le contexte, dans un ordre différent.En revanche, c’est bien le lien entre les 3 dimensions qui permet de faire apparaître la logique d’action : en quoi mon action contribue-t-elle à pousser l’un ou l’autre des scénarios possibles ? En quoi mon regard sur la personne révèle-t-il une vision de la société ? Et en quoi engage-t-il une forme d’action plutôt qu’une autre ? L’analyse théorique renvoie toujours à la pratique et inversement.
Annexe • II
Proposition d’animation

14
Articulation de la réfl exionsur l’analyse sociale
Objectif : faire prendre conscience de la logique d’action dans laquelle je suis / nous sommes et la situer par rapport au projet du Secours Catholique.
Mon regard sur la personne
en situation de pauvreté
Analyse de la pauvreté• comment se présente-t-elle ? • comment je l’identifi e (besoins
des personnes) ?• la représentation de chacun
Quelle est ma/notre vision de la société ?
• analyse des causes de la pauvreté• scénarios, logiques de système
1 • Analyse de la pratique
2 • travail sur les 3 éléments
3 • le projet du Secours Catholique
4 • explicitation de la logique d’action (individuelle et collective), conservatrice ou transformatrice
5 • changement de pratiques : que faire changer et comment s’y prendre ?
Analyse de la pauvreté
• la représentation de chacun
Annexe • II

ALErTE COLLECTIF INTErASSOCIATIF
du 28 novembre 2008Intervention du secrétaire général du Secours Catholique
• Face à la crise, les pauvres fragilisés.• Rapport du Secours Catholique : 90%
Familles ou isolés en dessous du seuil de pauvreté.
+ de 42% vivent que de transferts sociaux.• Niveau de vie moyen de notre public est
de 535 euros par U.C.soit 40% en dessous du seuil de pauvreté.Le reste à vivre (le revenu moyen - le loyer moyen net) diminue à cause de l’inflation.• Le Secours Catholique demande la
revalorisation des minima sociaux, pourquoi ?
2007, RMI, 44,3% du SMIC contre 48,7% en 19902007, API, 56,4% du SMIC contre 64,9% en 1990.Revenu complémentaire au RSA pour les familles monoparentales.• D’où un vrai problème de pouvoir d’achatPlus de 2 familles sur 3 font état d’impayés (loyer, fluide, crédit...)En France, 180 000 dossiers par an : augmentation croissante des dossiers de surendettement.Nous soutenons, dans l’ensemble, les propositions du Médiateur de la République et de M. MARINI, Rapporteur Général de la Commission des Finances au Sénat.• 3 dossiers sur 4 de personnes surendettés :
accident de la vie (perte d’emploi, maladie, divorce...).
Les personnes vivant seules sont plus vulnérables au surendettement.Cela rejoint le rapport du Secours Catholique sur la fragilité des familles mono-parentales.
Les familles composées d’un seul adulte avec 1 ou plusieurs enfants sont fragilisées. 60% des familles reçues par le Secours Catholique sont dans cette situation.78% des cas de surendettement : Capacité de remboursement égal ou inférieur à 450 euros. 32% en 2004.• Le micro-crédit doit se développer :des taux d’intérêts accessibles,un accompagnement de qualité,un pourcentage de remboursement très élevé.• Beaucoup de micro-crédits accordés
au Secours Catholique concernent la mobilité des personnes. Absence de moyens de transport, d’où incapacité de saisir un travail.
• L’urgence, ce n’est pas de mobiliser de l’Aide Alimentaire (même si cela reste nécessaire en urgence) :
- Allocations familiales dès le 1er enfant,- Revaloriser les minimas sociaux,- Travailler d’urgence la qualification
professionnelle des publics éloignés de l’emploi : avoir un travail à temps complet, même avec un salaire modeste, permet de se hisser au-dessus du seuil de pauvreté,
- Comment rester mobilisé pour se sortir de sa situation dans un tel marasme économique ?
- Un effort énorme est demandé à ceux qui sont touchés par la pauvreté pour qu’ils restent mobilisés.
15
Annexe • III
Conférence de presse

Communiqué de presse du 16/02/2009
ALErTE demande un plan de relance SOCIALE
A la veille du sommet social entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, le collectif ALERTE, qui
regroupe 37 associations nationales de lutte contre la pauvreté, interpelle les négociateurs : «décidez un plan de relance sociale ».
La crise, d’abord financière, puis économique, est devenue sociale. Chômage, pauvreté, exclusion sont repartis à la hausse. Les signaux captés par les associations de solidarité sont nets, la crise fragilise encore plus les plus vulnérables 1. Dans ce contexte, un fort débat s’est tenu pour savoir s’il convenait, dans une telle conjoncture, d’opérer une relance par l’investissement ou/et par la consommation.
Les risques économiques d’une relance générale par la consommation sont infiniment moindres, voire inexistants, si une partie de l’effort de la puissance publique se concentre en direction des plus faibles. Ainsi, il est temps :
• d’accélérer la revalorisation des minima sociaux et notamment du montant
forfaitaire du RSA et de l’Allocation spéciale de solidarité (ASS),
• de ne pas réduire mais d’augmenter les durées d’indemnisation des demandeurs d’emploi,
• de favoriser l’accès des demandeurs d’emploi aux dispositifs de formation,
• d’investir fortement dans l’accompagne-ment social et professionnel,
• de donner les moyens aux associations de solidarité d’accueillir des personnes en « contrats aidés »,
• de porter le plafond de ressources de la CMUC à la hauteur du seuil de pauvreté,
• de rendre possible la production massive de logements très sociaux (financés par PLAI 2)
Les plus pauvres et les plus exclus ne doivent pas être les oubliés des négociations entre pouvoirs publics et partenaires sociaux. Il est aujourd’hui nécessaire d’agir pour que ne soient pas abandonnés tant ceux qui vivent depuis longtemps dans la précarité que les victimes à venir de la crise. La solidarité ne se divise pas, elle ne choisit pas entre ceux qui valent la peine d’être aidés et les autres. La solidarité en temps de crise nécessite un « plan de relance sociale ».
1 Cf. conférence de presse ALERTE du 28 novembre 2008 sur le site d’ALERTE http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2009/02_fevrier_2009//Communique_plan_de_relance_sociale_16_Fev_09.pdf
2 PLAI : prêts locatifs aidés d’insertion
16
Annexe • III

17
Enquête du CrEDOCréalisée en décembre 2008
La détérioration de la situationdepuis 3 mois • 1/3 des ménages pauvres déclarent
avoir été plus souvent qu’auparavant en découvert au cours des 3 derniers mois, plus d’un ménage pauvre sur 5 déclare ne pas avoir d’économies disponibles contre 9% des ménages en général.
• 50% des ménages pauvres déclarent avoir retardé ou annulé une dépense importante au cours des 3 derniers mois, contre 40% des ménages français.
• Parmi les ménages qui ont un crédit ou un emprunt à rembourser, 43% estiment qu’il s’agit d’une charge importante dans leur budget contre 61% pour les ménages pauvres.
• Près d’un ménage français sur 4 déclare avoir eu du mal à payer une ou plusieurs factures au cours des 3 derniers mois, proportion qui double chez les ménages pauvres (43%) Les procédures de saisie concernent 12% des ménages pauvres ayant connu des difficultés à payer des factures, soit 3 fois plus que pour les ménages français en général.
L’inquiétude pour l’avenir Ils s’attendent, pour 40% d‘entre eux, à ce que leur situation se détériore dans les mois à venir.
Cette enquêtea été réalisée en décembre 2008 auprès de 866 ménages représentatifs des ménages métropolitains au-dessus du seuil de pauvreté, et de 434 ménages représentatifs des ménages sous le seuil de pauvreté.Ces éléments en sont un résumé (par MAF)
37% des ménages français déclarent être dans l’incapacité de faire face, seuls, à une dépense imprévue de l’ordre de 750€, cette proportion double presque pour les ménages pauvres (69%). 29% des français estiment qu’ils ne pourraient pas non plus obtenir un prêt de l’ordre de 750€ pour faire face à une dépense imprévue, proportion qui double pour les plus pauvres (56%)
Les restrictionsde consommationA la question « depuis 3 mois, vous ou votre foyer êtes-vous obligés de vous imposer des restrictions sur certains postes de votre budget ? », 39% des français disent « plus que d’habitude », mais 51% des pauvres. Cela est particulièrement vrai • des jeunes (18 à 29 ans), à hauteur de
65% pour les jeunes en situation de pauvreté,
• des ménages avec un seul actif occupé (45% pour l’ensemble des ménages, 59% pour les ménages en situation de pauvreté),
• des familles monoparentales, 54% dans l’ensemble des ménages et 62% chez les plus pauvres.
Dans l’ensemble, ces restrictions sont expliquées par les difficultés présentes et l’anticipation des difficultés futures, mais
Annexe • IV
Éléments d’analyses

18
les ménages les plus pauvres évoquent surtout les difficultés actuelles. Les postes affectés par ces restrictions, que les ménages soient pauvres ou non, sont • les vacances et les loisirs • l’habillement • l’achat d’équipement ménagerLes plus pauvres qui se restreignent le font significativement plus sur les soins médicaux, l’alimentation, le logement et les dépenses pour les enfants. Plus de la moitié des ménages pauvres se restreignent sur l’alimentation et près du quart sur les soins médicaux. Si l’on regarde plus précisément l’alimentation, 54% des ménages français déclarent avoir changé leurs habitudes alimentaires depuis un an pour des raisons budgétaires, proportion qui monte à 71% pour les ménages pauvres. Ces changements se traduisent par le fait d’éviter les produits trop chers, de choisir des marques et magasins moins chers, de manger moins souvent à l’extérieur. Plus de la moitié des ménages pauvres ont diminué leur consommation de viandes et de poissons au cours des 3 derniers mois et près du quart admettent sauter des repas. Chez 15% des ménages pauvres, il est arrivé à l’un des membres du ménage de passer une journée sans manger par manque d’argent. Sur les loisirs, 62% des ménages pauvres ont restreint leurs sorties depuis 3 mois (50% pour l’ensemble des ménages), particulièrement sur les visites à des proches et des invitations de ces proches à domicile.55% des ménages et 72% des ménages pauvres n’ont pas prévu de partir en vacances dans les 3 prochains mois. Sur la santé, les ménages pauvres se restreignent significativement plus que l’ensemble des ménages en général : près
du tiers a récemment renoncé à des soins bucco-dentaires (contre 15% des français en général). Près de la moitié des ménages interrogés, pauvres ou non, comparent plus les prix que d’habitude, et près de 40% profitent plus que d’habitude des offres promotionnelles. Les ménages pauvres sont beaucoup plus nombreux à ne pas faire d’achats sur un coup de tête (49% contre 38% des ménages en général) et à privilégier plus que d’habitude les magasins discount (40% contre 29%).
La situation par rapportaux ressourcesL’emploiMoins de 10% des actifs occupés ont connu le chômage partiel au cours des 3 derniers mois, mais 20% des actifs occupés en situation de pauvreté ; parmi ces derniers, 38% craignent d’être confrontés au chômage partiel dans les prochains mois. Une forte proportion de chômeurs (68% chez l’ensemble, 79% chez les ménages pauvres) estime que la recherche d’emploi est devenue plus difficile depuis 3 mois. Les aides extérieures 23% des ménages pauvres ont fait appel en 2008 à une aide extérieure : assistante sociale, aide matérielle d’un proche, aide de la CAF ou du Conseil Général.
Les ménages français, pauvres ou non, sont globalement inquiets au sujet de la situation des entreprises, du pouvoir d’achat et de l’évolution à venir de la crise (autour de 85% d’inquiétude sur ces sujets). Les ménages pauvres sont beaucoup plus inquiets pour leur situation : 84% sont inquiets pour leur pouvoir d’achat (68% pour l’ensemble) et 68% des plus pauvres sont inquiets pour leur situation professionnelle, contre 49% des français.
Analyse croiséeAu total, une analyse croisée de ces différents indicateurs montre que les ménages pauvres sont plus nombreux que les autres à avoir subi un impact important de la crise : 54% d‘entre eux ont soit changé leurs habitudes de consommation, sans pour autant recourir aux découverts bancaires ou à la solidarité, soit modifié leurs comportements sur 6 à 8 points (les ¾ d’entre eux ont eu une découvert plus que par le passé, la moitié ont eu des difficultés pour s’acquitter de certaines factures et les 2/3 ont sollicité une aide sociale ou amicale plus qu’auparavant). L’impact de la crise est très important pour 13% des ménages en général et 28% des ménages en situation de pauvreté. Parmi ceux-ci, les familles monoparentales sont les plus touchées : 26% d’entre elles sont ans le groupe des ménages ayant connu un impact important sur leurs dépenses contre 5% des couples avec enfants. Les plus jeunes sont également touchés : la moitié des moins de 30 ans a connu une forte dégradation de sa situation financière et de leur mode de vie au cours des 3 derniers mois. Les ménages dont la personne de référence est inactive sont les plus touchés, notamment dans le sens où les personnes en situation de pauvreté qui avaient un emploi souffrent d’un plus grand impact de la crise. Les facteurs de fragilité sont les suivants sur l’ensemble des ménages :• disposer de moins de 1500€ mensuels• avoir des enfants• être au chômage• avoir moins de 30 ans• être locataire
Annexe • IV

19
Patrick Viveret, philosophe, ancien conseiller à la Cour des Comptes,auteur de « reconsidérer la richesse », mai 2009
Pour une écosophiePOLITIQUE
La question sociale pose plus radicalement encore la question humaine et la difficulté propre à notre espèce de penser et de vivre le rapport entre notre intelligence et nos émotions. C’est toute la question de ce que Felix Guattari nommait l’écosophie, la capacité de penser écologiquement et politiquement la question de la sagesse. C’est aussi ce que Pierre Rahbbi nomme les enjeux d’une « sobriété heureuse » où s’articule, dans la justice sociale, le choix de la simplicité avec celui d’un art de vivre affranchi de sa boulimie consommatrice et consolatrice.
Il nous faut d’abord voir que ce qui est commun à toutes les facettes de la crise, ce qui la rend donc systémique, c’est le couple formé par la démesure et le mal être. Ce que les grecs nommaient l’ubris, la démesure, est en effet au cœur de notre rapport déréglé à la nature par deux siècles de productivisme et ses deux grandes conséquences : le dérèglement climatique et ce danger à ce point majeur pour la biodiversité que l’on peut évoquer le risque d’une « sixième grande extinction » des espèces, cette fois provoquée par le comportement irresponsable de notre propre famille humaine. C’est la démesure aussi qui a caractérisé le découplage entre l’économie financière et l’économie réelle : un ancien responsable de la Banque centrale de Belgique, Bernard Lietaer, a pu avancer qu’avant la crise, sur les 3 200 milliards de dollars qui s’échangeaient quotidiennement sur les marchés
financiers, seuls 2,7% correspondaient à des biens et services réels !… Démesure encore dans le creusement des inégalités sociales mondiales tant à l’échelle de la planète qu’au cœur même de nos sociétés : lorsque la fortune personnelle de 225 personnes correspond au revenu de deux milliards d’êtres humains (chiffres des Nations Unies), lorsque les indemnités de départ d’un PDG qui a mis son entreprise en difficulté peuvent représenter plus de mille fois le salaire mensuel de l’un de ses employés. Démesure enfin, il ne faudrait pas l’oublier, cette fois dans les rapports au pouvoir, qui a été à l’origine de l’autre grand effondrement politique récent, il y a tout juste vingt ans, celui du système soviétique et de sa logique totalitaire. Il est important de le rappeler si l’on veut éviter le mouvement pendulaire des années trente qui vit un politique de plus en plus autoritaire, guerrier et finalement totalitaire, prendre la relève du capitalisme dérégulé des années d’avant crise.Ainsi le caractère transversal de cette démesure permet de comprendre le caractère systémique de la crise et l’on comprend alors que des réponses cloisonnées qui cherchent par exemple à n’aborder que son volet financier se traduisent finalement par une fuite en avant dans le cas de la crise bancaire doublé de fuites en arrière dans le cas de la crise sociale : comme quoi les caisses ne sont pas vides pour tout le monde ! Mais pour construire, au-delà d’une écologie politique, une « écosophie
politique » il faut faire un pas supplémentaire dans l’analyse et comprendre ce qui lie profondément cette démesure au mal de vivre de nos sociétés. Celle-ci constitue en effet une forme compensatrice pour des sociétés malades de vitesse, de stress, de compétition qui génèrent un triple comportement guerrier à l’égard de la nature, d’autrui et de nous-mêmes. En ce sens nos « société de consommation » sont en réalité des « sociétés de consolation » et cette caractéristique se lit économiquement dans le décalage entre les « budgets vitaux » et les dépenses de stupéfiants, de publicité et d’armement. En 1998, le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) comparait en effet les budgets supplémentaires nécessaires pour couvrir les besoins vitaux de la planète (faim, non accès à l’eau potable, soins de base, logement etc.) et mettait en évidence que les seules dépenses de stupéfiants représentaient dix fois les sommes requises pour ces besoins vitaux (à l’époque 400 milliards par rapport aux 40 milliards recherchés par les Nations Unies). Même écart s’agissant des dépenses annuelles de publicité. La société dure est en permanence compensée par la production du rêve d’une société harmonieuse, et l’endroit par excellence où s’opère ce rapport est la publicité qui ne cesse de nous vendre de la beauté, du bonheur, de l’amour, voire de l’authenticité, messages dans l’ordre de l’être, pour mieux nous faire consommer dans l’ordre de l’avoir. Quant aux budgets militaires
«
Annexe • V
Réflexion de fond

20
des intégrismes excluants. Une grande partie du destin de l’humanité se joue en effet dans l’alternative guerre ou dialogue des civilisations. Nous ne sommes pas condamnés soit à la projection mondiale du modèle occidental soit à l’acceptation au nom du relativisme culturel d’atteintes fondamentales aux droits humains à commencer par ceux des femmes. On peut récuser l’impérialisme et le colonialisme, sans être obligés de tolérer l’intégrisme et l’exclusion. C’est alors la co-construction d’une citoyenneté terrienne qui est en jeu, et la rencontre des sagesses du monde est alors un enjeu capital dans cette perspective où l’homo sapiens-sapiens, à défaut d’être une origine pourrait être, devrait être un projet. C’est à ce projet planétaire qu’une Europe qui a payé le prix lourd pour comprendre que la barbarie n’est pas un danger extérieur, mais le risque intérieur par excellence de l’humanité, peut pleinement contribuer.
qui expriment les logiques de peur, de domination et caractérisent par conséquent les coûts (et les coups) de la maltraitance inter-humaine, ils représentaient eux vingt fois ces sommes ! A eux trois ces dépenses passives de mal être représentent (car le même écart est maintenu dix ans après) environ quarante fois les dépenses actives de mieux être nécessaires pour sortir l’humanité de la misère et assurer un développement humain soutenable tout à la fois écologique et social.
Il nous faut donc répondre au couple formé par la démesure et le mal être par un autre couple, celui de la « sobriété heureuse » formé par l’acceptation des limites et par l’enjeu positif du « bien vivre » (termes du forum social mondial de Belem) ou ce que les prochains « Dialogues en Humanité » qui se tiendront début juillet évoquent sous le terme de la construction de politiques et d’économies du mieux être .Et c’est ici que l’écologie doit non seulement intégrer pleinement la question sociale, celle de la lutte contre les inégalités, mais aussi la question humaine proprement dite c’est-à-dire la capacité à traiter ce que l’on pourrait appeler « le bug émotionnel » de l’humanité qui est à la racine de ce qu’Edgar Morin nomme l’homo sapiens demens. La question est en effet moins de « sauver la planète » - qui a de toutes manières plusieurs milliards d’années devant elle avant son absorption par le soleil ! - que de sauver l’humanité qui peut, elle, terminer prématurément en tête à queue sa brève aventure consciente dans l’univers.
Or, comme le soulignait Spinoza, la grande alternative à la peur est du côté de la joie. La différence aujourd’hui réside dans le fait que ce qui était traditionnellement de l’ordre personnel et privé devient un enjeu politique planétaire. La question de la sagesse, c’est-à-dire la question fondamentale de l’art de vivre, qui cherche à épouser pleinement la condition humaine au lieu de vouloir la fuir, devient alors une question pleinement politique. Nous sommes en effet à la fin du cycle des temps modernes qui furent marqués par ce que Max Weber, d’une formule saisissante, avait caractérisé comme « le passage de l’économie du salut au salut par l’économie ». La crise actuelle démontre que ces promesses n’ont pas été tenues. L’un des enjeux aujourd’hui est de savoir comment sortir de ce grand cycle de la modernité par le haut, les intégristes le faisant par le bas : garder le meilleur de la modernité, l’émancipation, les droits humains et singulièrement ceux des femmes, qui en constituent l’indicateur le plus significatif, la liberté de conscience, le doute méthodologique, mais sans le pire, la chosification de la nature, du vivant, des animaux et à terme des humains, la marchandisation n’étant qu’une des formes de cette chosification. Et retrouver, dans le même temps, ce qu’il y a de meilleur dans les sociétés de tradition, mais là aussi en procédant à un tri sélectif par rapport au pire : un rapport respectueux à la nature, sans qu’il soit de pure soumission, un lien social fort mais non un contrôle social, des enjeux de sens ouverts et pluralistes et non
»
Annexe • V

21
Lutter contre la pauvreté ouFAIrE PrOjETavec les pauvres ? Les expressions par lesquelles nous traduisons les réalités liées à la pauvreté demandent une vigilance constante : porteuses de richesses, elles deviennent facilement slogans réducteurs.C’est le cas de l’expression « lutter contre la pauvreté » que nous revisitons dans cet article, paru dans la Revue «Mission de l’Eglise» des OPM.
L’expression « lutter contre la pauvreté » est devenue une expression toute faite, utilisée largement dans le milieu politique,
national et international, ainsi qu’au niveau de la société civile. Elle est associée à une prise de conscience mondiale du phénomène de la pauvreté et à la conséquente mise en place de programmes internationaux qui visent la réduction de la pauvreté. On peut noter à ce propos les Objectifs du Millénaire pour le Développement, établis au sein de l’ONU en 2000, qui fixent la barre très haute : réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015. Cet objectif général est décliné en 8 objectifs particuliers qui concernent la faim, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, les femmes, le développement durable.On ne peut que se réjouir de voir la communauté internationale fixer un tel objectif. Et même si aujourd’hui on sait que cet objectif ne sera que partiellement atteint et qu’il faudrait une volonté politique bien plus grande pour libérer les ressources nécessaires, il y a un fait nouveau qui représente une avancée incontestable : pour la première foison a un engagement précis de la part de la majorité des chefs d’Etat, exprimé de manière quantitative et donc évaluable, et non plus une simple déclaration de principes et de bonnes
intentions. Tout en soutenant ce type d’initiatives de « lutte contre la pauvreté », on peut pourtant se poser des questions sur la conception de justice et de développement auxquelles renvoie une telle expression. Il ne s’agit pas de contester la mise en place des pratiques associées à cet objectif, mais plutôt d’approfondir l’objectif formulé afin d’orienter les pratiques dans la bonne direction.La pauvreté, dans la mesure où elle dénigre la dignité humaine, constitue, sans doute, un phénomène à refuser.Mais peut-on « lutter contre » la pauvreté ? Tout dépend de la manière dont on conçoit la pauvreté. En effet, l’expression « lutter contre la pauvreté » fait penser à la pauvreté comme une réalité objective, dont certaines personnes sont victimes, et qu’on devrait extirper, enlever, supprimer. La pauvreté apparaît ainsi comme une condition objective et subie, indépendante de la personne concernée. De ce fait, le pauvre est réduit à sa pauvreté, à ce qu’il n’a pas : un manque à combler. Dès lors, cette idée de lutte contre la pauvreté appelle surtout une justice distributive et un développement pensé en termes d’accès aux biens. Peut-on concevoir autrement la pauvreté, la justice et le développement ?Nous pensons que la pauvreté n’est pas seulement un manque à combler : elle
renvoie à toute une manière de concevoir le vivre ensemble. Si la lutte contre la pauvreté vise surtout à combler le manque dont souffrent certaines personnes, elle risque de se situer uniquement au niveau des effets plutôt que des causes. La réalité de la pauvreté devrait interroger d’abord la mécanique sociale qui, au niveau local, national ou international, créé de l’exclusion.C’est la manière dont on « fait société ensemble » qui est mise en cause avec la pauvreté, et pas seulement la distribution de ses bénéfices. Il va falloir, sans doute, redistribuer des richesses très inégalement réparties, mais le problème de la pauvreté relève surtout d’une question bien plus fondamentale, celle du projet de société. Dès lors, le pauvre n’apparaît pas seulement comme une personne en manque qui a besoin d’assistance, mais surtout comme un acteur social qui doit pouvoir participer à un projet d’ensemble. On cherchera chez lui la capacité propre qu’il pourrait développer en vue d’un projet commun plutôt que le manque à combler. Cette approche de la pauvreté sollicite une autre conception de la justice et du développement : une justice contributive plutôt que distributive ; un développement pensé en termes de projet de société plutôt que de seule croissance économique.
Annexe • VI
Réflexion de fondÉléna Lasida, théologienne et économiste

22
Lutte contre la pauvretéet justiceEn termes de justice, on peut poser deux questions à l’expression de « lutte contre la pauvreté ». D’une part, faut-ilviser la pauvreté ou plutôt l’inégalité ? Car ce qui est injuste, ce n’est pas la pauvreté en soi mais le fait qu’elle coexiste avec une très grande richesse. Associer la question de la justice à celle de la pauvreté rappelle que le véritable scandale est celui de l’inégalité plutôt que celui de la pauvreté. L’inégalité empêche d’isoler la pauvreté comme un problème « des pauvres », qui a besoin des solutions « pour les pauvres ». L’inégalité pose question au système général et pousse à transformer plutôt qu’à réparer, à intégrer plutôt qu’à assister, Ne faudrait-il pas alors parler de lutte contre l’inégalité plutôt que de lutte contre la pauvreté ?D’autre part, la justice pose une question de fond sur l’effet cherché avec la « la lutte contre la pauvreté ». S’agit-il de rendre accessible à tous les biens nécessaires pour vivre ? Ou s’agit-il plutôt de rendre possible la participation de chacun à la création d’un projet commun ? Chacune de ces deux questions renvoie à un type différent de justice.Dans le premier cas, nous nous trouvons face à une justice distributive, fondée sur la capacité d’accès des personnes. Dans le deuxième, on parle plutôt de justice contributive, fondée sur la capacité de participation, d’apport de chacun. Deux conceptions différentes de l’humain sont sous-jacentes à chacune de ces notions de justice : dans la première, l’humain est défini par ses besoins à satisfaire, dans la deuxième par sa capacité créatrice. Comment renforcer la visée d’une justice contributive dans l’idée de lutte contre la pauvreté ? La justice permet donc d’approcher la lutte contre la pauvreté d’une manière beaucoup plus intégrale : par rapport à toute la société et pas seulement aux exclus, et par rapport à toutes les dimensions de la vie humaine et pas seulement ses besoins et sa capacité d’accessibilité. Comment rendre plus explicite cette « intégralité » visée ? Un domaine aujourd’hui en plein développement, illustre bien cette lutte contre la pauvreté pensée de manière intégrale : il s’agit de l’économie sociale et solidaire. Une multiplicité de pratiques différentes comme le commerce équitable, le microcrédit, la finance éthique, les régies de quartier, le tourisme solidaire, essayent aujourd’hui d’insérer dans le circuit économique les populations qui en sont exclues. Mais il ne s’agit pas d’une économie
« pour les pauvres ». L’économie sociale et solidaire cherche à faire de l’économie autrement, en intégrant aux objectifs de rentabilité financière, des objectifs en termes de lien social, de gestion démocratique et de respect de la nature. En ce sens, elle ne crée pas une économie parallèle, pour sortir les pauvres de leur pauvreté. Au contraire, elle intègre les pauvres dans le système classique et ce faisant, elle transforme le système, car elle pense l’économie complètement articulée aux objectifsD’ordre social, politique et environnemental 1. La lutte contre la pauvreté revisitée par la justice acquiert ainsi de l’épaisseur et fait véritablement place à toute la complexité de l’humain et du social.
Lutte contre la pauvretéet développementA partir du développement, on peut également poser deux questions à la lutte contre la pauvreté : d’une part, en termes de mode de développement visé, d’autre part en termes de la conception même du développement. Ces deux aspects sont très liés, mais il est important de les distinguer. La question en termes de mode de développement renvoie à la différence habituelle entre pays développés et pays en voie de développement. A partir de cette classification, le sous-développement est souvent considéré comme un problème de rattrapage à faire entre les pays pauvres et les pays riches. De ce fait, il y a un seul mode de développement visé, celui des pays riches, et il faut faire en sorte que les pays pauvres puissent y arriver. Cette conception résonne fortement avec l’idée de « lutte contre la pauvreté ». Il s’agit toujours d’une approche bipolaire, où l’un des pôles constitue l’objectif à atteindre (la richesse, le développement) et l’autre le défaut à réparer (la pauvreté, le sous-développement). Or, le mode de développement des pays riches est aujourd’hui confronté à des limites incontournables qui montrent sa non viabilité : les ressources naturelles sur lesquelles ce développement s’est construit sont aujourd’hui en cours d’épuisement et en grande partie dégradées. Est-ce que les pays pauvres ne sont pas, eux aussi, porteurs de germes de modes de développement pluriels et nouveaux ? Est-ce que leur expérience de survie face à la pauvreté, leur créativité et leur imagination, leur « débrouillardise », n’ouvrent pas des pistes pour penser
autrement le développement ? Dans ce cas, il ne faudrait pas seulement « lutter contre la pauvreté » mais aussi et surtout, s’intéresser à ce que la pauvreté a pu libérer comme ressource nouvelle pour vivre mieux.
Lutter contre la pauvretéou faire projet avec les pauvres ?Or, la question sur le mode de développement, conduit directement à celle de la conception du développement : que veut-on développer ? Que veut-on augmenter en termes de qualité de vie ? Qu’est-ce qui fait vivre mieux ? Le pouvoir d’achat ou la qualité de présence et de relation qu’on a avec autrui ? Le fait d’accéder à plus de biens ou le fait de se sentir créateur avec d’autres d’un projet commun ? L’avoir ou l’être ? La lutte contre la pauvreté qui considère la pauvreté uniquement en termes d’accès aux biens, risque de solliciter un développement pensé seulement en termes de croissance, c’est-à-dire de capacité de production et de consommation. Lutter contre la pauvreté, devrait conduire aujourd’hui à reconsidérer la richesse, à la penser en termes de qualité plutôt que de quantité.Aujourd’hui le développement durable essaie justement de penser le développement à frais nouveaux, conçu comme un nouveau « style de vie », une nouvelle manière de vivre ensemble, au niveau local, national et international, plutôt que comme simple prolongement de ce que nous avons déjà. Il invite à inventer un style de vie avec moins de mobilité mais plus de présence, avec moins de rapidité mais plus de relation, avec moins de sécurité mais plus d’émerveillement. L’objectif n’est pas celui de lutter contre la pauvreté mais plutôt d’inventer de nouveaux modes de vie qui ne créent pas de la pauvreté, ni matérielle, ni relationnelle 2.En guise de conclusion, nous pouvons dire que la lutte contre la pauvreté revisitée par l’idée de justice et de développement, invite à un double déplacement. D’une part, il s’agirait de passer de la « lutte contre » au « faire projet ensemble », et d’autre part, de passer de « la pauvreté » aux « pauvres », en les considérant non seulement à partir de leurs manques, mais surtout à partir de leurs potentialités à développer. Dès lors, l’objectif ne serait pas tellement d’aider ni d’enrichir les pauvres, mais plutôt de trouver avec eux de nouvelles sources de richesse et de nouveaux modes de développement.
1 Pour connaître, faire avancer et se préparer aux nouveaux métiers de l_Economie sociale et solidaire : Master « Economie solidaire et logique du marché » de l_Institut Catholique de Paris. Infos : www.icp.fr (voir les formations de la FASSE), ou fasse icp.fr.
2 Pour une approche du Développement durable en termes de « style de vie nouveau », lire « Notre mode de vie est-il durable ? » Justice et Paix, Ed. Karthala, 2005, et « Mobilité durable : bouger moins pour être plus présent », Justice et Paix (5 € + frais de port) à commander à [email protected]. Copyright © Justice & Paix Page 4/4.
Annexe • VI