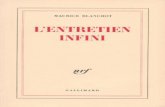Maurice Blanchot Et La Philosophie
-
Upload
nicoleta5aldea -
Category
Documents
-
view
19 -
download
6
description
Transcript of Maurice Blanchot Et La Philosophie
MAURICE BLANCHOT ET LA PHILOSOPHIE
Suivi de trois articles de Maurice Blanchot
ricHoppenotetAlainMilon(dir.)
Anne ddition: 2010
Publication sur OpenEdition Books: 20 dcembre 2012, Nombre de pages: 437 p.
DansLe Pas au-del, Maurice Blanchot fait le constat suivant: Derrire le discours parle le refus de discourir, comme derrire la philosophie parlerait le refus de philosopher: parole non parlante, violente, se drobant, ne disant rien et tout coup criant. Cette rsistance de Blanchot lgard de la philosophie montre les limites de la qualification dune uvre, quelle soit philosophique, littraire ou potique. Lcriture philosophique est-elle plus ou moins philosophique dans le fragment dHraclite, le systme dHegel ou laphorisme de Nietzsche? De tout cela, Blanchot semble se moquer. Et quimporte de savoir si Blanchot est philosophe. Notre intention dans cet ouvrage est ailleurs. Elle est dans le souhait dinterroger le et, chacun avec ses lectures et ses convictions. Ce et dans Blanchot et la philosophie, faut-il lenvisager comme une addition, une disjonction, une impossibilit, un ou bien ou bien, un ni ni, une localisation? O est Blanchot en fin de compte?
Lambigut de lthique de la souffrance dans la pense franaise contemporaine
SmadarBustan
p. 179-198
AlainMilon
Entre Blanchot et la philosophie
Lieux de bifurcation: espace littraire
Anne-LiseLarge
La seule faon daimer
AlainMilon
Nuit trange: moment de modulations
NatachaLafond
Des Forts, Blanchot et Lvinas: pour un autrement dire
Blanchot, lecteur ?
FranoisBrmondy
Pascal fut-il un penseur dialectique?
MathieuDubost
La littrature comme preuve: Blanchot, lecteur de Hegel
ManolaAntonioli
Nietzsche et Blanchot: parole de fragment
ThierryLaus
Le Livre au tombeau, apparaissant
DavidUhrig
La philosophie de laction, compagne clandestine?
ArthurCools
Intentionnalit et singularit. Maurice Blanchot et la phnomnologie
ricHoppenot
De lApocalypse Amalek. Esquisse dune rflexion sur la pense du mal dans luvre de Maurice Blanchot
SmadarBustan
Lambigut de lthique de la souffrance dans la pense franaise contemporaine
D'un thme l'autre
HuguesChoplin
La nuit transforme-t-elle la pense? partir de Blanchot
YvesGilonne
Blanchot lobscur: vers une approche hraclitenne du neutre
HugoMonteiro
Le Neutre dans les limites de la philosophie
DaianaManoury
Le Neutre blanchotien, reflets et rflexions partir deLAmiti
BertrandRenaud
Le passif de mort ou lthique limpossible: surLcriture du dsastre
EnzoNeppi
LAbsolu entre transgression et ambigut dans la rflexion de Blanchot sur la littrature
Rciprocits
ricMarty
Maurice Blanchot, Roland Barthes, une ancienne conversation
GeorgesHansel
Maurice Blanchot, lecteur de Lvinas
Tmoignage
MichelLisse
Vivre sa mort dans lcriture
Textes de Maurice Blanchot
MauriceBlanchot
Le discours philosophique
ricHoppenotet GeorgesHansel
Note de lditeur
MauriceBlanchot
Discours sur la patience(en marge des livres dEmmanuel Lvinas)
MauriceBlanchot
Notre compagne clandestine
Biographies des auteurs
TABLE DES MATIRES
AlainMilon
Entre Blanchot et la philosophieLieux de bifurcation: espace littraire
Anne-LiseLarge
La seule faon daimer
AlainMilon
Nuit trange: moment de modulations
Lespace dcriture: les modulations du dire
Lespace litteraire: grammaire de la modulation
Le desequilibre
trange etrangete: vers une autre economie de la parole
NatachaLafond
Des Forts, Blanchot et Lvinas: pour un autrement dire
Contretemps et contre-chant
Il y a
Attentionnalit
Anacrouse
Pour conclure
Blanchot, lecteur ?
FranoisBrmondy
Pascal fut-il un penseur dialectique?
Mystique et dialectique
La pense tragique duDieu cache
LesPenses, modle deLattente lOubli?
Blanchot critique de goldmann
Largumentation de Pascal
LA FORME LITTERAIRE DESPENSEES
Conclusion
MathieuDubost
La littrature comme preuve: Blanchot, lecteur de Hegel
Le nant hglien, ou le jour inverse de la philosophie
La langue de Lesprit
La nuit sans jour selon Blanchot
La littrature comme vnement irrductible
Conclusions
ManolaAntonioli
Nietzsche et Blanchot: parole de fragment
Du ct de Nietzsche
Lcriture fragmentaire
LternelRetour
ThierryLaus
Le Livre au tombeau, apparaissant
DavidUhrig
La philosophie de laction, compagne clandestine?
Honorer lintelligence
La survalorisation de soi
De lternellement actuel au rel
Passer a lacte
ArthurCools
Intentionnalit et singularit. Maurice Blanchot et la phnomnologie
Rduction transcendantale et espace littraire
Intentionnalit et criture
Subjectivit transcendantale et singularit
En guise de conclusion
ricHoppenot
De lApocalypse Amalek. Esquisse dune rflexion sur la pense du mal dans luvre de Maurice Blanchot
L'apocalypse: la fin vient, quelque chose arrive, la fin commence.
Sade et Lautramont: un espace littraire du mal
Gog et Magog:le redoublement de la question
Amalek et Auschwitz:Zahor
En guise de conclusion: job, le signifiant absent?
SmadarBustan
Lambigut de lthique de la souffrance dans la pense franaise contemporaine
Ma souffrance comme condition thique
La fatalit naturelle de la souffrance
Je me souffre
Sur la condition pr-morale du dolent
D'un thme l'autre
HuguesChoplin
La nuit transforme-t-elle la pense? partir de Blanchot
Latmosphre et le vide
Premire voie: la nuit comme atmosphre qui inspire la pense
Deuxime voie: la nuit comme vide qui interdit la pense
Le milieu de la nuit comme question quotidienne
Le concept de milieu
La question quotidienne
Entre philosophie et littrature?
crire en confiance
YvesGilonne
Blanchot lobscur: vers une approche hraclitenne du neutre
HugoMonteiro
Le Neutre dans les limites de la philosophie
Premire coute
Du regard qui se perd lui-mme de vue
Dune certaine violence appropriative
Interruption, respiration, rythme
De laccueil de lautre autre:coute!
Le contretemps dans les limites de la philosophie
Rsonner: le neutre
Dans les limites dune conclusion
DaianaManoury
Le Neutre blanchotien, reflets et rflexions partir deLAmiti
BertrandRenaud
Le passif de mort ou lthique limpossible: surLcriture du dsastre
Exigence sans foi ni loi
Mort immmoriale et agonies primitives
Dune mort, lautre
Une ou plusieurs passibilits ?
EnzoNeppi
LAbsolu entre transgression et ambigut dans la rflexion de Blanchot sur la littrature
Un dsastre couronne par la foudre
Puissance du ngatif et ambigut du sens
Transgression et littrature
Rciprocits
ricMarty
Maurice Blanchot, Roland Barthes, une ancienne conversation
GeorgesHansel
Maurice Blanchot, lecteur de Lvinas
Lamiti Blanchot-Levinas, le pacte, La dette
Lvinas dansLalittrature ou le droit a la mort
Langage commun et langage litteraire
O Lvinas apparat: Lil y a
Lvinas dansLespace Littraire
Blanchot chez Lvinas et Lvinas chez Blanchot: un pas de deux
La mort, la possibilit et limpossibilit
Lvinas dansLentretien infini
Littrature et parole neutre
Lvinas, exception la rgle
La rception de Lvinas par Blanchot
Lvinas et le neutre
Rapport du troisime genre et courbure de lespace interrelationnel
O Blanchot scarte de Lvinas
Entre le moi et autrui, une double dissymtrie
La raison de lcart
O Blanchot rejoint Lvinas
Lvinas dansLcriture du dsastre
Autrement qutre ou lultime secret de la subjectivit
Autrui et le tiers
Blanchot et Autrement qutre
Patience et passivit revisites
Responsabilit au sens de Lvinas
Problmes et solutions
Un rapport autrui pathologique?
Lobjection sartrienne
Et si autrui nest pas autrui?
Premire rponse
Seconde rponse
Autrement qutre et lcriture
Responsabilit et criture
Lamiti chez Blanchot et Lvinas
Passivit et criture fragmentaire
Problmes de langage
Le visage
La subjectivit
Blanchot et le vocabulaire religieux ou thologique de Lvinas
Lvinas et la thologie
Blanchot et la thologie de Lvinas
Conclusion
Tmoignage
MichelLisse
Vivre sa mort dans lcriture
La solitude du vivant
Maurice Blanchot et ltre-pour-la-mort
La mort de lami
Le fantasme du mourir-vivant
Textes de Maurice Blanchot
MauriceBlanchot
Le discours philosophique
ricHoppenotet GeorgesHansel
Note de lditeur
MauriceBlanchot
Discours sur la patience(en marge des livres dEmmanuel Lvinas)
MauriceBlanchot
Notre compagne clandestine
Tous, honteusement, glorieusement
Le scepticisme invincible
Valery: lautre homme... reste une conception capitale...
Linterrogation sur le langage
La diachronie irreductible
Lindiscrtion a lgard de lindicible
LaComdie divine
Biographies des auteurs
ManolaAntonioli
FranoisBrmondy
SmadarBustan
HuguesChoplin
ArthurCools
MatthieuDubost
YvesGilonne
GeorgesHansel
EricHoppenot
Anne-LiseLarge
ThierryLaus
MichelLisse
DaianaManoury
ricMarty
AlainMilon
HugoMonteiro
EnzoNeppi
BertrandRenaud
DavidUhrig
Entre Blanchot et la philosophie
AlainMilon
p. 11-17
Blanchot et la philosophie:Quest-ce que cela veut dire? On a coutume dadmettre que la premire mission de la philosophie est de produire des concepts. Mais Blanchot en produit-il seulement? Dailleurs, ce questionnement sur Blanchot et la philosophie naurait pas lieu dtre si lon disait: Platon, Spinoza ou Kant et la philosophie, autrement que pour sous-entendre leur place dans lhistoire de la philosophie. Lassociation du nom de Maurice Blanchot la notion de philosophie a un autre effet. Elle interroge beaucoup moins la place de Blanchot dans lhistoire de la pense que la nature de son criture dont on ne sait si elle est plus philosophique que littraire ou potique.
2Dans la formule Blanchot et la philosophie, Blanchot, cest qui, et la philosophie, cest quoi? Mais, le problme est peut-tre plus: Blanchot, cest quoi, et la philosophie, cest qui? Luvre de Blanchot, est-ce de la littrature, de lessai, de la posie, de la philosophie? Et la philosophie, est-ce Platon, Spinoza, Kant?
1LvinasEmmanuel,Sur Maurice Blanchot, Montpellier, Fata Morgana, 1975, p. 9.
2BlanchotMaurice,Ltrange et ltranger,inNouvelle Revue Franaise,n 70, Paris, Gall(...)
3Cette question du rapport que Blanchot entretient avec la philosophie, Lvinas laborde par ricochet dans ses rflexions SurMaurice Blanchot1. Blanchot ne tend pas vers la philosophie crit-il, non par faiblesse, mais tout simplement parce que la philosophie ne touche pas lultime possibilit, voire les limites de lhumain. Doit-on voir ici le reproche habituel adress lencontre de la philosophie trop souvent dsigne comme une matire froide? Doit-on lire le dsintrt de Blanchot pour cette discipline? Il semble que non. Par nature, lcriture de Blanchot se retrouve davantage dans lapure affirmation lexpression potique , ou danslespace de ce qui naffirme pas lexpression littraire que dansla manire dinterroger lexpression philosophique. Ces trois expressions, largement expliques dans son articleLtrange et ltranger2, montrent comment lespace de ce qui naffirme pas simpose comme la plus belle expression du neutre.
3BlanchotMaurice, Le Livre venir, Paris, Gallimard, Folio, 2003, p. 273.
4Ibid., p. 279.
5BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 157.
4Si lon revient notre point de dpart nous sommes bien en peine de rpondre la question de savoir quel concept Blanchot produit. Sil est plus ais de trouver des concepts dans lthiqueou les troisCritiqueskantiennes, cela signifie-t-il pour autant quil ny a pas de systme conceptuel chez Blanchot? En fait, plus que de systme conceptuel, cest despace notionnel dans lequel son travail thorique prend forme quil faut parler, espace notionnel gravitant autour de LEspace littraire travers la question de lcrit de lcriture. Il est vrai que souvent le philosophe est lhomme dun livre, Lthiquepour Spinoza, lesMditations mtaphysiquespour Descartes,Ainsi parlait Zarathoustrapour Nietzsche, lesCritiquespour Kant Pour Blanchot, peut-treLEspace littraire. Mais il est difficile de dire pour de multiples raisons sil existe un systme philosophique chez Blanchot, systme dont la mission essentielle est dasseoir et de stabiliser une pense. Il est vrai quavec Blanchot nous sommes loin de la fixation, de la stabilit ou de la prennisation. chapper toute dtermination essentielle3, toute stabilit reste la mission premire de la littrature, lacte dcriture par excellence que Blanchot qualifiederreur, de dehors, dinsaisissable, dirrgulier4. Avec son criture, il est plutt question de tiraillement, tirail-lementquilseraitrducteurdattribuerlaspcificitdelapenseduxxesicle, tiraillements qui viennent en fait de ce style si particulier. Non pas le style comme forme que prend lcriture dun auteur, mais comme marque propre Blanchot, lespace de sa modulation en quelque sorte. Ces tiraillements sont les traductions de ses propres incertitudes, tiraillements entre la profonde mlancolie dans laquelle se trouve lcrivain qui crit vainement, et la nostalgie dun lecteur trop heureux davoir trouv un texte chappant son malheur de livre. ... Sauver un texte de son malheur de livre5: leitmotiv lancinant et annonciateur que Blanchot reprend Lvinas. Ces tiraillements ont toutefois un avantage. Ils sont comme des points douverture qui font de lcriture des moments de respiration, mme si le corps de lcriture est en pleine asphyxie.
6LvinasEmmanuel, Sur Maurice Blanchot, op. cit., p. 74.
5Lcriture de Blanchot tue. Elle tue le lecteur qui suffoque la lecture de ses phrases qui prennent le lecteur la gorge. Elle le tue aussi parce quelle lemprisonne dans lchec de lcriture. Elle le tue mais elle na pas dautres solutions pour sauver le texte. Ce meurtre est en mme temps un sursis qui dure le moment de cette variation dcriture. Lcriture de Blanchot nous rend vivant, juste linstant de cette variation, et cest en cela quelle est encore plus dangereuse. Elle fait vibrer un point tel que Blanchot nous met dans lembarras par cette faon si singulire dcrire avec des phrases qui nen finissent pas de se dployer sur elles-mmes jusqu entraver le lecteur au point quil se demande chaque page si Blanchot ne dit pas une chose et son contraire au mme moment, modulations dcriture qui se construisent comme des galeries comme lexplique Lvinas, des galeries qui rappellent les souterrains quluard utilise pour qualifier lcriture de Paulhan, des galeries dont on ne sait o elles mnent sinon dautres galeries. Avec Blanchot il ne peut en tre autrement parce que lcriture et la lecture conduisent immanquablement lacceptation de labsence dcriture et de lecture. Cette variation, cest aussi le passage, non pas dun endroit un autre, dun pont une porte, mais le passage tout simplement quand il saffirme comme lieu de transit. La porte ouvre sur le seul espace dune autre porte qui ouvre elle-mme sur lespace dune autre porte, et cela sans fin. Cette impression se renforce par le fait que Blanchot est davantage un passeur quun penseur, et comme passeur il crit en passant, cest--dire que son criture sinscrit dans la ponctuation de textes potiques ou philosophiques quil sagisse de Char, Mallarm, Hraclite ou Nietzsche. Lcriture de Blanchot rejoint finalement le cortge de toutes ces critures qui se dploient sur elles-mmes. Proust, Woolf, Borges, Blanchot ces auteurs tricotent pour reprendre lexpression de Lvinas6parce que texte, texture et tissage sont composs du mme fil, celui qui brode limpossibilit de lcriture crire.
6Blanchot et la philosophiea pour effet de nous embarrasser, et en cela cette juxtaposition de termes met en branle un processus philosophique. Blanchot nous embarrasse parce qu le lire on navigue sans cesse entre cette impression dinachvement son uvre nous renvoie lide que nous sommes continuellement dans la variante de penses qui se font en se faisant et ce sentiment daboutissement son criture, dune rare densit, refuse lartifice. Il y a chez lui comme une sorte dimmaturit parfaitement accomplie; immaturit par son refus de la finitude et de la plnitude, accomplissement parce que ses failles le renforcent. Blanchot est en tension continuelle, tension que son criture confirme, tension qui trouve un ancrage dans son exprience de limpossibilit quil met en place dansLEspace littraire. Ce point dimpossibilit ne rend pas compte dun refus de communiquer, il exprime plutt la volont de ne pas tre un objet de communication. Ce refus rend compte en partie de ltat singulier de son criture. criture philosophique, criture littraire, criture potique? Peut-tre les trois runies! Peu importe dailleurs car les critures riches sont plurielles. Elles montrent quil ny a pas une criture philosophique, mais des critures philosophiques. Une chose est sre cependant. Blanchot nest pas dans le systme philosophique au sens classique du terme; il est dans la correspondance, pas celle de la forme pistolaire mais celle de la strate. tre en correspondance comme dans lespace mtropolitain qui a linconvnient ou lavantage de perdre le voyageur. quel niveau est-il? 1er, 2e, 3e? Il nen sait rien mais il est quand mme dans le mtro. Cette mise en correspondance plutt que la recherche tout prix dune pense systmatique explique aussi ce que Lvinas dit du rapport de Blanchot la philosophie voqu plus haut. Cette rsistance de Blanchot lgard de la philosophie montre dailleurs les limites de la qualification dune uvre, quelle soit philosophique, littraire ou potique. Lcriture philosophique est-elle plus ou moins philosophique dans le fragment dHraclite, la dmonstration de Spinoza ou laphorisme de Nietzsche? De tout cela, Blanchot semble se moquer. Et quimporte de savoir si Blanchot est philosophe. Notre intention dans cet ouvrage est ailleurs. Elle est dans le souhait dinterroger le et, chacun avec ses lectures et ses convictions. Ce et dansBlanchot et la philosophie, faut-il lenvisager comme une addition, une disjonction, une impossibilit, un ou bien ou bien, un ni ni, une localisation? O est Blanchot en fin de compte?
7Blanchot et la philosophiepour mieux apprhender linfluence de Blanchot et ses liens avec les philosophes, les crivains et les potes.Blanchot et la philosophie, est-ce que cela se comprend comme le lien que lcrivain entretient avec la philosophie, mais Blanchot est-il un crivain au sens o lon dit de Victor Hugo et de Gustave Flaubert quils sont crivains?Blanchot et la philosophie, est-ce pour se demander quelle est la doctrine de Blanchot comme lon parlerait de doctrine platonicienne, spinoziste, kantienne ou bergsonienne? Est-ce que cela se comprend comme une rflexion sur la place de la philosophie dans luvre de Blanchot, autrement dit lempreinte de telle philosophie dans la pense blanchotienne pour se demander sil est hracliten, hglien ou nietzschen? Ou linverse, est-ce le moyen de rflchir sur la marque de Blanchot sur le travail de certains intellectuels duxxesicle comme Lvinas, Merleau-Ponty ou dautres? Quelles sont la nature et la valeur de ce et. A-t-il les vertus du pli de Michaux? Est-ce un point dobscurit qui claire, sagit-il dune sorte dondulation qui nous renvoie cette trange variante du mme?
7Ibid., p. 70.
8Ce et de londulation semble avoir les caractristiques de ces suites algbriques en n-1, lexpression dune multiplicit agissant par soustraction et non par addition. Blanchot crit selon la modulation du n-1 pour montrer que le devenir voit le jour, non pas en additionnant des choses les unes sur les autres, mais en crivant par effacement, seul moyen pour le neutre de confirmer son impossibilit. Cet effacement traduit le fait quil ny a plus ou pas de lecture, pas dcriture, pas dexpression7 au sens o toute lecture, criture ou expression efface et sefface pour mieux expliquer comment les choses existent. Il nous montre aussi que les choses ont une chance de natre si elles prservent leur effacement. Lcriture de Blanchot sinscrit en fait dans un devenir et une mutation que la soustraction libre, seul moyen de lutter contre limaginaire positiviste de laddition.
8BlanchotMaurice, Labsence de livre, inLEntretien infini, Paris, Gallimard, 1983, p. 427.
9SartreJean-Paul,Situations II, Paris, Gallimard, 1948, p. 33.
10BlanchotMaurice,Exercices de la patience, Lvinas, Paris, Obsidiane, 1980, p. 67.
9Cet effacement est un avertissement que Blanchot nous adresse, lui qui faisait de son retranchement son propre signalement. Blanchot nous martle sans cesse quun livre surcharge un autre livre8. Mais comment comprendre cet avertissement? En crivant un autre livre? En refusant tout livre? En lisant? Sans prtendre rpondre pour autant ces interrogations sans fin, nous tenterons, en toute modestie, de faire de toutes les lignes qui suivent une grande forme en mouvement9 plutt quun gros tas de feuilles inertes. Mais que lon ne se mprenne pas sur le mouvement gnral de cette entreprise dont la mission essentielle est de montrer comment les critures contemporaines nous font osciller trop souvent entre des lectures dautant plus difficiles pour ceux qui, par manque de curiosit, ne saisissent pas la provenance et limplicite des discours, et des lectures dautant plus faciles et ennuyeuses pour ceux qui ont pris le temps et la peine de faire un travail gnalogique. Que retiendra lhistoire de la philosophie de la pense duxxesicle? Mais cette question pour lheure est anecdotique et factuelle. Seule peut-tre persiste une intention, celle de ne pas se laisser fasciner par lautre nuit10, la nuit de leffacement, la nuit drisoire qui nie le crpuscule de la philosophie. Lutter contre leffacement aux formes multiples de cette nuit: leffacement dun livre par un autre mme si tous les livres se construisent autant les uns sur les autres que les uns contre les autres, leffacement dun auteur par un autre, chaque auteur simaginant quil est le premier, leffacement dune personne parce que cest une autre faon de la faire disparatre de manire plus violente parce que plus lente. Mais surtout refuser leffacement pour mieux lutter contre la barbarie, la plus nocive, la plus sournoise, celle qui simmisce dans le savoir, celle qui fait croire que leffacement est un renouveau. Finalement, lutter contre leffacement pour tenter de sortir de la dsertification qui nous entoure, dsertification qui va mme jusqu faire disparatre le dsert.
10 cette occasion nous proposons de rditer certains textes de Blanchot autour de la question de lespace philosophique commeLe Discours philosophique(1971), leDiscours sur la patience. (En marge des livres dEmmanuel Lvinas) (1975), etNotre compagne clandestine(1980).
11Une dernire remarque nanmoins concernant lobjectif de cet ouvrage: tenter de faire sienne la formule de Char dansFeuillets dHypnos:Notre hritage nest prcd daucun testament. Il ny a ni hritiers, ni gardiens du temple autour des dits et crits de Blanchot. Pas de restes partager une poque o tout devient objet faire un livre. Linterview, le journal personnel, la note de lecture, le cours, le sminaire Tout se recycle, mais tous les cours ne sont pasLEsthtiquede Hegel, toutes les correspondances ne sont pas lesLettres Lucilius, et toutes les interviews ne sont pas lEntretien avec Burman. Au-del de la posture anecdotique de ce genre de pratique, cest la question de la valeur du tmoignage qui est pose. Nest-il rien de pire que le tmoignage quand il vient du tmoin qui affirme: mais jtais l le premier, jai tout vu et tout entendu Je vais tout vous dire, celui qui fait parler les morts, celui-l mme qui simagine quil a assez de prsence pour tre tmoin de la scne? Finalement, celui qui na pas saisi la porte du seuil ne pas franchir.
11CharRen,Recherche de la base et du sommet, inuvres compltes, Paris, Gallimard, 198(...)
12Ne pas franchir le seuil, cest aussi le moment o le tmoin est encore assez vigilant. Mais lest-il quand il construit le tmoignage autour de son propre enfermement? Quel crdit accorder un tmoin dont le seul objectif est de se substituer personnellement lobjet de son tmoignage? Le tmoin, sil allait au bout de sa dmarche, devrait sabstenir de tout tmoignage et se mettre en retrait pour viter quun autre tmoin, tout aussi sincre, ne vienne contredire son propre tmoignage par un autre tmoignage. La prsence du tmoignage a-t-elle un sens? Sans doute, mais seulement pour confirmer lide quil ne sert rien si ce nest sauver un texte de son malheur de livre pour sauver le livre du tmoignage Il existe nanmoins des tmoignages auxqualits probatoires, celui que Char adresse Francis Curel, grand rsistant, qui, refusant daccuser le collabo qui lavait dnonc, prononce ces mots tonnants: Puisque je ne suis pas mort, il nexiste pas11. Finalement, le tmoignage nexiste pas quand le texte est l.
12Sur le rapport Blanchot/Foucault, on peut lire larticle de Manola Antonioli: Blanchot et Miche(...)
13Un regret cependant, celui de navoir pas t en mesure de prsenter danalyses significatives sur linfluence de luvre de Blanchot auprs dintellectuels comme Merleau-Ponty, Foucault, Deleuze, Derrida12....
NOTES
1LvinasEmmanuel,Sur Maurice Blanchot, Montpellier, Fata Morgana, 1975, p. 9.
2BlanchotMaurice,Ltrange et ltranger,inNouvelle Revue Franaise,n 70, Paris, Gallimard, 1958, p. 673.
3BlanchotMaurice, Le Livre venir, Paris, Gallimard, Folio, 2003, p. 273.
4Ibid., p. 279.
5BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 157.
6LvinasEmmanuel, Sur Maurice Blanchot, op. cit., p. 74.
7Ibid., p. 70.
8BlanchotMaurice, Labsence de livre, inLEntretien infini, Paris, Gallimard, 1983, p. 427.
9SartreJean-Paul,Situations II, Paris, Gallimard, 1948, p. 33.
10BlanchotMaurice,Exercices de la patience, Lvinas, Paris, Obsidiane, 1980, p. 67.
11CharRen,Recherche de la base et du sommet, inuvres compltes, Paris, Gallimard, 1983, p. 639.
12Sur le rapport Blanchot/Foucault, on peut lire larticle de Manola Antonioli: Blanchot et Michel Foucault: htrotopies, inBlanchot de proche en proche, ricHoppenotet DaianaManoury(dir.), Paris, ditions Complicits, 2009. Sur le rapport Blanchot/Derrida et Blanchot/Deleuze, voirLAbcdaire de Jacques Derrida, M.Antonioli(dir.),Paris/Mons,Vrin/Sils Maria, 2006 les articles dH. Couchot et M. Antonioli, p. 22-25 et p. 44-48.
AUTEUR
Alain Milon
Professeur de philosophie esthtique luniversit de Paris Ouest. Directeur des Presses universitaires de Paris Ouest. Derniers ouvrages publis:LEsthtique du livre, Alain Milon et Marc Perelman (dir.), Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2009,Bacon, leffroyable viande, Paris, Les Belles Lettres, Encre marine, 2008;Emmanuel Lvinas, Maurice Blanchot: penser la diffrence,ric Hoppenot et Alain Milon (dir.), Paris, codition Unesco-Presses universitaires de Paris Ouest, 2edition 2009;Dictionnaire du corps,M. Marzano (dir.),PUF, 2007;Le Livre et ses espaces,Alain Milon et Marc Perelman (dir.), Presses universitaires de Paris Ouest, 2007;Lcriture de soi: ce lointain intrieur. Moments dhospitalit littraire autour dAntonin Artaud, La Versanne, Encre Marine, 2005;La Ralit virtuelle. Avec ou sans le corps.Paris, Autrement, Le corps plus que jamais, 2005;Contours de lumire: les territoires clats de Rozelaar Green.40 ans de voyages en pastels et dessins, Paris, Draeger, 2002;LArt de la Conversation, Paris, PUF, Perspectives critiques, 1999;Ltranger dans la Ville. Du rap au graff mural,Paris, PUF, Sociologie daujourdhui, 1999;La Valeur de linformation: entre dette et don, Paris, PUF, Sociologie daujourdhui, 1999. paratre en 2010,La Flure du cri. Violence et criture, Paris, Les Belles Lettres, Encre marine.
La seule faon daimer
Anne-LiseLarge
p. 20-31
TEXTENOTESAUTEUR
TEXTE INTGRAL
1Plus que jamais, la philosophie, oui, mais comme une oscillation. Oscillation de droite gauche, du corps droite de la pense, de la littrature gauche de la littrature. Alternance denglacement de ltre-gauchede la pense sa droiture, jusquau dglacement du dehors. La philosophie, oui, dailleurs le moment serait peut-tre venu den parler, nous qui navons pas encore non pas de la faire parler, de parler en elle, mais de parler dElle, ses cts, avec elle, de sasseoir quelques instants ct de la philosophie, non pas dans son ombre, mais en labsence momentane de lumire, dans lintimit accidente de la pnombre promiscuit noire soudain retrouve, entre elle et nous, le temps dune poigne de phrases, dune incursion de silence.
2En philosophe? Certainement pas. En ami, peut-tre. En amant, sil fallait lavouer. Mais a (se) discute, encore une fois, a dvie et a dborde, si lon veut, de part et dautre, du rapport. Et peu importe si, ds le dpart, le rapport en question est promis une impossible nomination. Peu importe, sil nous chappe jusqu la fin, jusqu safin. Blanchot le savait plus que nul autre, lui qui a pass un temps infini, dans lillgalit du temps, assis dans lombre, ct de la philosophie, oscillant ses cts, lui parlant tremblant de littrature, lui livrant sa passion pour la littrature. Et la philosophie, la fin, tait prte tout entendre, tout envisager, comme pour retenir les derniers vivants venus parler auprs delle, les derniers aussi, se tenant distance, laissant lirrductibilit de lespace parler entre eux, pour eux. Il faudrait dire: la philosophie a t essouffle, touffe, trangle par la philosophie otage de sa propre cause, gelire de sa prison de pense. Alors seul ltranger, linconnu, lAutre, le dernier homme, le presque mort, pouvait venir la dlivrer, non pas en la reconduisant au-devant de la scne, mais en lui portant secours dune manire sourde, clandestine, la librant ne la dchargeant pas.
1BlanchotMaurice, LAttente, loubli, Paris, Gallimard, 1962, p. 61.
2Ibid., p. 62.
3BlanchotMaurice,Le Pas au-del, Paris, Gallimard, 1973, p. 158.
4BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 73.
3Nous qui avions tant investi la philosophie, tant attendu, tant demand pour ne pas dire tant exig delle, tant dcri et cri gare la vrit, au point de ne plus mme stre rendu compte que nous lavions perdue en cours de route,LaPhilosophie. Ce quil pensait se dtournait de sa pense pour le laisser penser purement ce dtour1. Fuite du philosophique face lespace du dtour sans digression, de lerrement sans erreur2. Surtout ne jamais senfermer dans un face face avec la philosophie. Sil y a eu rapport donc, ce fut toujours un rapport oblique, en biais, louche, parce que non clarifi et non clarifiable. Philosopher, il le faut, mais comment et depuis quel lieu si ce nest depuis untout autre lieuque celui de la philosophie? Comme sil tait ncessaire de se dgager du poids sans mesure de notre bien trop vieille et communment partage responsabilit philosophique. Comme si, encore, ce ntait jamais depuis la philosophie quilfallaitphilosopher. Tout dabord, parce que derrire le discours parle le refus de discourir, comme derrire la philosophie parlerait le refus de philosopher3. La parole nous appelle nous tenir lcart de la gravit dece qui se ditdans la parole. Cest toujours trop grave la philosophie, rauque par moments: a racle du concept, maladivement. a fait parler la maladie du systme, a fait du systme une parole parlante, sous prtexte dun travail critique de la pense sur elle-mme, et en mme temps dun effort mrit pour rendre notre existence sa libert dans le primtre de la raison et de lexprience. Or nest-ce pas folie? Nest-ce pas folie de dlimiter en permanence le primtre dexprimentation de la pense? Ne faudrait-il pas plutt laisser un peu la folie se reposer dans le dsastre? Vous thoriciens, sachez que vous tes mortels et que la thorie est dj la mort en vous. Sachez-le, connaissez votre compagnon4. Autrement dit, il faut se mfier de la philosophie, sen mfier comme de la peste ou comme de la mort. Non pas pour la condamner elle lest dj , mais trangement, follement, secrtement, comme une faon de laimer: Je taime donc je me mfie de toi; toi, toi seule, tu es le danger de tout amour. Voil ce que Blanchot nous aura silencieusement laiss entendre: un dgot pour la philosophie, un amour allant jusquau dgot, jusqu la vie lorsquelle dborde dans le penserde la mort, cest--dire jusqu la tristesse, lamertume, la dsesprance ultime rvrence de la pense.
5BlanchotMaurice,LAmiti, Paris, Gallimard, 1971, p. 89.
6Didi-HubermanGeorges,Devant limage. Question pose aux fins de lhistoire de lart, Pari(...)
7BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre,op. cit., p. 79. et p. 80.
4Rappelons-nous ces mots issus deLAmiti, au sujet de Levi-Strauss, qui a quitt la philosophie par dgot den rpter lenseignement et peut-tre [cest l o Blanchot parle] dgot de la philosophie, ce qui est certes la meilleure faon de laimer et de lui tre fidle5. Ce qui est poignant et pointe dans toute luvre de Blanchot, cest cet amour pour la philosophie qui est la fois aversion et rpugnance: Je te tiens au cur dans lcurement que tu gnres en moi. Dsamour de la philosophie au sens o le souligne Didi-Huberman: de mme que celui qui dit je ne taime pas prononce tout de mme le mode de lamour6. Lamour est aussi cet intense sentiment de lassitude, dabsence complte dattrait, force. force de vivre ensemble, deux, de se tenir compagnie jusqu lennui, jusquau dsenchantement, jusquaux heures tardives du dplaisir. Cependant attach elle par ce devoir dexclusivit quelle impose, Blanchot a su jouer de la distancedanslattachement: je ne te trompe pas puisque je reste ct, non pas trop prs, mais trop loin, assez loin pour que tu puisses me rappeler lordre. Connaissez votre compagnon, cest--dire connaissez que ce qui dborde la philosophie, la met hors delle, cest limpossibilit de son systme comme limpossibilit de la russite: finalement on nen peut rien dire, et il y a une manire de se taire (le silence lacunaire de lcriture) qui arrte le systme, le laissant dsuvr, livr au srieux de lironie7.
8Ibid., p. 210.
9BlanchotMaurice,LAmiti,op. cit., p. 99.
10Ibid., p. 101.
5Antiphrase du silence, l o malgr tout le questionnement se poursuit, la remise en cause travaille. Disons, il est encore possible de risquer, comme lcrit Blanchot propos de Wittgenstein, ne serait-ce que la simplicit dune pense qui bouleverse, et ce parce que celle-ci appartient malgr tout au respect de la pense, dans le refus du pathtique. De sorte que si nous donnons limpression dtre lcart de lhistoire de la philosophie, si nous faisons pressentir que nous en sommes un isol, nous comprenons bien que personne ne peut ltre8. Philosophes, nous le sommes, mme en ne le voulant pas, nous le restons. Or il y a une voie propre, intouchable, non-historique, de la pense qui chappe, pour une part, au philosophique. Et cest dans cette voie que se dcouvre enfin labdication silencieuse du philosophique lui-mme, sa reddition sans conditions, sa mort sans phrases9. Dgot de la philosophie devant sa dgnrescence, devant sa putrfaction conceptuelle, nous qui venons dsormais du dehors la visiter sur son lit de mort, et en ce sens fidle jusqu ce que la mort spare. Aimons notre ennemi, puisque nous le portons en terre, puisque nous pouvons encore rivaliser de la vie dans la mort.Lentes funrailles, titre que donnait Blanchot un des chapitres deLEntretien infini:Je taime dautant plus que tu tardes mourir et que personne ne saura prendre ta place. Or si Blanchot a constat la fin de la philosophie, il na cess de nous mettre en garde sur la tendance continuer philosopher sur cette fin et sans fin, chercher jusqu la dernire heure il visait l Lefevbre sauver son gagne-pain philosophique10. Certes, la philosophie a cess comme mode dinterrogation autonome et thorique, cela veut dire quen son lieu propre et en sa place vide, il ne sagit plus daffirmer, ni devouloiraffirmer. Chercher obtenir la rsurrection du philosophique, ce serait passer le pas dune aventure impraticable. Pour ainsi dire, ce nest pas nous de rdiger son constat de dcs: elle meurt sans excuteur testamentaire, cest--dire aussi sans dernires volonts, ni mandat posthume.
11Ibid., p. 107.
12Ibidem.
13Ibid., p. 106.
14Ibidem.
6 nous daccepter la perte. Or la vrit, cest que nous ne voulons rien perdre11. Cest la raison pour laquelle la philosophie a t paradoxalement mise mort par des philosophes qui, au fond, refusaient de la voir mourir, usant alors dune pense du dpassement, telle quelle fut formule par Hegel, Heidegger et Nietzsche. Le problme est l: Nous voulons dpasser, aller au-del et tout de mme demeurer. Nous voulons congdier et conserver, rejeter et ressaisir12. Comme si ce qui justifiait ce tel vouloir antinomique, ctait la peur, non pas de tuer la philosophie, mais de tuer ce qui de la philosophie sest insinu en nous, et par l mme, frayeur absolue de nous tuer en voulant tuer.Lentes funraillesqui pour peu finissent par tre les ntres: voil quelle serait, pour le philosophe, liquidateur de lui-mme et de la philosophie, lpreuve vraiment mortelle, la mise mort qui sachve dans linsignifiance13. Ds lors, la question qui simpose serait la suivante: comment et depuis quel lieusurvivre?Sil serait videmment trop facile dentendre la fin de la philosophie comme une fin pure et simple, si ce qui finit continue14, comment prendre acte de cette fin si elle sternise dans son oraison funbre? Ou alors, si ce qui finit continue, il faudrait suspendre la bataille du dernier mot dans le mot qui commence. Il faudrait effacer les traces de ce qui finit comme de ce qui continue. De la fin, nous navons rien attendre. la fin, le dernier mot se doit dtre un mot tout de silence, rpercutant, non pas sa signification, mais lespace dans lequel sa signification steint fragilis de neplusdire, de se sentir seul, le dernier, devoir direne plus dire, non-absolument.
15BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas, Paris, Jean-Mi(...)
7Et si cette fin de la philosophie qui attend l o lattente persiste encore se faire discours, mot dordre, mot dopration, tarde effectivement finir, cest peut-tre et Lvinassur Maurice Blanchot, et Maurice Blanchotpour Lvinasse le sont renvoys en unaugenblickde lamiti parce que cette assertion a manqu sa ponctuation vritable, se perdant et stant perdue dans des explications interminables venant absenter, diffrer le point final de lui-mme, le ttanisant en points de suspension, en pourquoi et comment les points de suspension sont mme denglober le point final. Saluons alors celui qui a su ponctuer cette phrase au plus prs delle-mme, celui aussi qui a su voir en ce dbarquement exclamatif que ce qui comptait, ce ntait pas tant de proclamer la fin de la philosophie que la manire de la proclamer, cest--dire par un point dexclamation qui en modulait le sens et peut-tre le renversait15. Scandale de linaugural, indignation vivante devant ce qui passe et passe autre chose, force de dissolution, ne mortifiant pas, mais pointant lextrmit de la pense.
16BlanchotMaurice,LAmiti,op. cit., p. 108.
17DerridaJacques,La Carte postale, Paris, Gallimard, 1982, p. 205.
18Ibid., p. 190. et p. 191. Nous renvoyons galement la page 206 du mme ouvrage: Les matres-p(...)
19Ibid., p. 206.
20Ibid.
21Ibidem.
22Ibid., p. 246.
23DerridaJacques,Positions, Paris, Les ditions de Minuit, 1972, p. 14.
24Ibid.
8Noublions pas la note de bas de page finale desLentes funrailles de LAmiti non loin de Lvinas, un salut celui dont il suffit de prononcer le nom pour lui signifier notre dette infinie: Il faut bien dire ici, ft-ce en une note brve, que, par ses crits, Jacques Derrida pose dune manire nouvelle diffrente (la posant sans lexposer) la question de la fin de la philosophie16. Bien sr, elle est l cette fin, Derrida le dit expressment: Cest la fin dune poque. Une fin de course aussi ou un banquet qui trane en longueur au petit matin17. Et dans cette fin dpoque, l o la question de la fin de la philosophie sest pose sans sexposer, cela aura t travers ce que Derrida a nomm, dansLa Carte Postale, une philosophie de la poste ou la philosophie oprant depuisles postes18. Quest-ce dire ici? Dabord que la philosophie est un principe postal et en tant que telle nest plus un principe, ni une catgorie transcendantale19. Ensuite que la fin dune certaine poste et laube dune autre nous arrivent depuis unephilosophie restante, l o il ny a que des diffrences qui, de surcrot, peuventne pas arriver. Cest l o la philosophie trafique depuis une certaine pense de lenvoi: envoyer et ne pas livrer sur commande, envoyer et savoir attendre, envoyer et faire attendre, jusqu mourir peut-tre, mais toujours sans rien matriser de la destination finale20. Si bien que la fin ou la mort de la philosophie na plus son lieu dans cette question la question elle-mme envoye sous pli, la question finissant elle-mme la poste restante car cette philosophie de la poste nest quun relais qui ne dpasse rien, ne sapproprie rien: un relais pour marquer quil ny a jamais que des relais21. Voil une philosophie qui expdie tout autrement la question de sa fin: par des lettres damour, des mots damiti, des bouts de littrature, des prdestinations philosophiques, des cartes postales pleine de ddicaces secrtes, de meurtres collectifs, de dtournements de fonds22. Ce que Blanchot visait dans ce nouvel abord, cest ce quelque chose qui se destine tout entant prsent nulle part, dans et par, ce que Derrida nommait encore dansPositions, cette circulation la fois fidle et violente entre le dehors et le dedans de la philosophie23. Fin de la philosophie donc, dans la mesure o le philosophe essaie de se tenir la limite du discours philosophique24. Cest l o il faut dire limite et non mort.
25BlanchotMaurice,LEntretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 73.
26Ibid., p. 74.
27DerridaJacques,Parages, Paris, Galile, 1986 (rd. 2005), p. 31.
9Cest l aussi o, comme lindique Blanchot dansLEntretien infini, il ne faut pas dsesprer de la philosophie25. Parce que dans toute cette histoire de fin qui nen finit pas, de mort qui tarde mourir, autour dacteurs proches, tour tour amis dus, amants, dserteurs, tendres ennemis qui veillent, il y a lAutre et lamal-adressede lAutre. Plus prcisment, il y a dans toute cette philosophiedelaposte, la question primordiale, urgente,chronoposte, dirons-nous, du destinataire. Et il y a aussi nous nous tournons sans nous dtourner de Derrida vers Lvinas cet appel devenir responsables de ce quelle [la philosophie] est essentiellement, en accueillant, dans tout lclat et lexigence infinie qui lui sont propres, prcisment lide de lAutre, cest--dire la relation avec autrui. Cest l o il y a comme un nouveau dpart de la philosophie et un saut quelle et nous-mmes serions exhorts accomplir26. LAutre, ce nest plus lAutre discours, cest le tout autre dans son cheminement, dans son errance et dans sa vie. Cest lorsque lAutre demeure toujours aux alentours du philosophique que nous sommes face une pense qui ne pense plus -partir-de; elle se dpartit de cette ligne de pense qui rassura la philosophie; voil une pense qui pense, ce qui est tout autre, partir de cet loignement; cest au venir/partir et venir-de-partir quelle reconduit sans retour27.
28BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas,op. cit., p. 8(...)
29BlanchotMaurice,Le Livre venir, Paris, Gallimard, 1959, p. 339.
30BlanchotMaurice,LEntretien infini,op. cit., p. 71.
10Mise en voix de la philosophie sans entente. Fulgurance du dpart et de lenlvement de la lettre mme du philosopher. Exil de langage. Parole de labme. Perte de lidentit et oubli du nom. Philosophes anachroniques, nous le sommes tous, venant soudain jouer sous anonymat, sous pseudonyme, sous pitaphe,dsastrantlpitaphe, faisant uvrer la littrature, le savoir, le non-savoir28, retrouvant finalement la philosophie comme Orphe Eurydice dans les enfers29. Point dcisif o nous nous trouvons, o il vaut mieux, la limite, de ne pas se faire reconnatre. Il ne faudrait pas croire trop vite avoir vaincu la mort, dfaut davoir su faire perdurer lamour. Il y a un visage de la philosophie quil est prfrable de ne pas regarder, de ne pas ramener la lumire en se retournant. Et si ce regard chappe, cest quil chappe la philosophie et par l mme cest que quelque chose de dcisif chappe la philosophie30. Compagne clandestine, sil te plat, ne sors pas de lombre. Ensemble, seulement, nous nous garerons dans la nuit comme dans le jour, celui qui cherche obscurment se redresser, se retenir de partout et de nulle part. Lamour pour la philosophie se doit dtre un amour nocturne, de jour comme de nuit: une contrebande de la pense, une non-littrature prononant des paroles que personne nentend, un silence qui frle, fraude le secret. Comme si pour survivre aux cts de la philosophie, il fallait sjourner dans une zone de non-droit, l o ayant peur elle-mme dtre surprise, elle cessait un instant de nous surveiller.
31BlanchotMaurice,Le Livre venir,op. cit., p. 339.
32Ibid., p. 204.
11Contrefactricede la pense, la philosophie nous accompagne encore, l o elle ne peut elle-mme aller. Jusquau bout de notre tche dcriture, elle nous passionne pour cela qui ne la concerne plus. Par-del son malheur, elle soutient ce nouvel avenir de la parole, quelle pressent mais quelle ne peut elle-mme porter, crire. Ce qui sindique dsormais, ce qui promet une certaine fortune de la pense, malgr sa misre intellectuelle, cest le retrait de la pense dans un brouillage de piste effacement de traces de la pense mme, cest--dire la ncessit de penser moins quon ne pense, de penser le manque quest aussi la pense et, parlant, de prserver ce manque en lamenant la parole31. Ce qui se dessine au cur de cette criture hors langage que tout discours, y compris celui de la philosophie, recouvre, rcuse, offusque, cest le pas encore de la pense. criture hors langage ayant perdu le fil de ce qui aurait pu la faire discourir, manquement de la parole dans la parole, drapage dans la dliaison, glissement hors du sens. Et ce pas encore est la littrature mme32, en ce quil poursuit ce qui ne regarde dj plus, et ne le fera jamais davantage, lavnement du sens et de la vrit. Tout cela nest pas encore vrai, et quon sen tienne l, quon nen parle plus. Ici, il y va dune exprience sans mesure et sans limites de ce que lcrireest essentiellement, savoir littrature sortant de la littrature, venant elle-mme travers la non-littrature, non-philosophie aussi de ce qui se dit passionnment dans ce qui na plus vocation rpondre.
33Et cette prise de conscience delle-mme qui la rend manifeste et la rduit ntre rien de plu(...)
34BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre,op. cit., p. 101.
35BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas,op. cit., p. 8(...)
36BlanchotMaurice,La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 295.
12Lcriture ne peut rpondre que delle-mme.Et en ce sens, elle nappartient ni la philosophie ni la littrature. Or seule la littrature sait que rien ne lui appartient. Elle seule sait crire sans jamais tre certaine dcrirerellement, rapprochant alors lcriture delle-mme, tranchant dans lespace du vrai comme du non-vrai, tranchant dans lespace essentiellement. Si bien que la littrature peut tout revendiquer, mme la philosophie et cela serait encore trop peu33, puisquelle nattend rien, ne veut rien, entendons, rien devenir. Dailleurs et cette parole a trouv son lieu dansLcriture du dsastre:Ce que Schlegel dit de la philosophie vaut pour lcriture: on ne peut que devenir crivain sans ltre jamais; ds quon lest, on ne lest plus34. Et ce qui intresse Blanchot, nous le voyons une nouvelle fois, cest ce qui vaut pour lcriture plus que pour la philosophie. Oui, philosophes, nous le sommes tous, honteusement, glorieusement, par abus, par dfaut35, mais avant tout, envers et contre tout, nous sommes crivains. Nouscrivonscrivains ne ltant pas, et ce jamais dans ldification ni dans le rejet du philosophique lcriture ne le permet pas. Nous crivons depuis le point dachoppement de lcriture mme. Nous ne questionnons plus. Nous sommes la question qui chappe. Si la philosophie peut esprer sapprocher de la littrature, cela ne pourra se faire quune fois quelle aura laiss lcriture en paix, dlaisser le rflexif, ne prtendant plus fournir de rponses, comprendre, se rpandre, savoir, trop savoir. Car et l serait le danger si la rflexion imposante sapproche de la littrature, la littrature devient une force caustique, capable de dtruire ce qui en elle et dans la rflexion pouvait en imposer. Si la rflexion sloigne, alors la littrature redevient, en effet quelque chose dimportant, dessentiel, de plus important que la philosophie36.
37BlanchotMaurice,Le Livre venir,op. cit., p. 265.
38Ibid., p. 279. Nous soulignons.
39BlanchotMaurice,LEntretien infini,op. cit., p. 449.
40LvinasEmmanuel, La servante et son matre, inCritique,juin 1966,Maurice Blanchot(...)
41Ibid., p. 516. et p. 517.
13Et cet essentiel de la littrature, cest la vie mme vie dont la philosophie se doit dtre tenue distance, si lon veut laisser la vie la vie, les mots leur absence, labsence luvre, la dsertification de luvre venir. la question o va la philosophie?, il nous faudrait rpondre: vers safinvritable, vers son but aux airs de seule issue possible, cest--dire vers la littrature. Cette rponse donne lieu la logique immdiate dune autre question que Blanchot formulait dj dansLe Livre venir, savoir mais alors o va la littrature? et comme derrire cette question, o continue la philosophie?. Il faudrait cette fois dire: Sil y a une rponse, elle est facile: la littrature va vers elle-mme, vers son essence qui est la disparition37. Et cette disparition nengage pas la fin de la littrature, mais sontre mme, ce qui delle apparat lorsquelle cesse, momentanment et dj pour toujours, dtrevisible. Si la littrature se dtourne du visible et si elle demeure cette exprience de ce qui est sans entente, sans accord, sansdroit38, elle nentre pas pour autant dans la clandestinit, puisque tout simplement,elle nentre pas, elle se refuse finalement passer le seuil, se refuse crire, fusant au dehors, sabsentant de son espace propre. Et cest depuis le dehors que la littrature fissure les murs du savoir, librant le sens comme fantme, hantise, simulacre de sens, comme si le propre de la littrature tait dtre spectrale39, et non pas hante delle-mme comme le serait la philosophie, qui a toujours voulu, de manire pesante, oppressante, dominer, rgir, affirmer le sens. Cest l o, comme lcrit Lvinas, Blanchot met en cause la prtention, en apparence incontestable, dun certain langage dtre le porteur privilgi du sens, den tre la source, lembouchure et le lit40. En cela, la littrature dit la dispersion du sens, son heureuse divagation: elle bouche louverture o sannonce, mais aussi se dnonce [] le tournoiement en rond du discours cohrent41. Il ne sagit pas ici de jouer la folie littraire contre la cohrence dun discours philosophique qui se fait loi. Il ne sagit plus de dire il ne sagit pas de . Il sagit dcrire, l o tout sy refuse.
42BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas,op. cit., p. 8(...)
43Ibid. Nous soulignons.
14crire, rien que cela, la peine, peine, tout juste dans ce mot car lcriture est plus forte que nous, dailleurs plus forte que la philosophie, que la littrature, que toute catgorisation, rgime disciplinaire en toutgenre. Et par l mme et toujours plus mystrieusement, nous restons resterons fidles, bien videmment lcriture, mais aussi tout ce qui veut monstrueusementse direen elle, tout ce qui prtend, prsuppose, exigepar-dessusla vie,par-dessusla passion dmesure42 pour la vie, qui exige l o il ny a plus rien exiger. Cest sans doute pourquoi cet amour pour la philosophie ne peut qutre un amour vcu dans la distance, non pas pour en retarder laffranchissementinvitable, mais pour nous rappeler que nous sommes impossiblement lis labsence et au vieillissement du philosophique. Ce quil reste donc, cest lamour vcu dans sa perte, pourtant et par ailleurs, bel et bienvcu, et en ce sens, choisi. Dans ce cas, oui, il est plaisant de se rappeler que la philosophietaitla vie mme, la jeunesse mme43.
44BlanchotMaurice,Pour lAmiti, Paris, Farrago, 2000, p. 7.
45BlanchotMaurice, extrait dune lettre date du 11 fvrier 1980 inExercices de la patience, Paris(...)
46BlanchotMaurice,LAttente, loubli,op. cit., p. 87 et p. 88.
15La philosophietait. Loin derrire nous maintenant, il y a le souvenir de toutes les heures passes auprs delle, ltude, la patience infinie et la recherche dune tout autre patience, et lamiti la fin, rendue elle-mme la fin car il ny a pas de coup de foudre de lamiti, plutt un peu peu, un lent travail du temps. On tait amis et on ne le savait pas44. On ne savait pas quen parlant dangereusement et en gardant dangereusement le silence, tout en le rompant45, on demeurait fidle la philosophie, et de manire aussi radicale, aussi amicale, quen disant et redisant le retrait de la parole. Et puis surtout,on ne savait pas. On ne savait pas ce qutre amivoulait dire, ce quaimerne disait pas. Tels seront nos derniers mots, ceux qui sauront sans savoir imaginer Blanchot assis ct de la philosophie changeant maintenant ces quelques phrases avec elle: Cest vrai: seulement proche; je ne renierai pas ce seulement. Je lui dois de vous tenir l. Parce que vous me tenez? Eh bien, vous me tenez aussi? Je vous tiens. Mais proche de qui? Proche: proche de tout ce qui est proche. Proche, mais pas ncessairement de vous ni de moi? Ni de lun ni de lautre. Mais cest ce quil faut. Cest cela, la beaut de lattrait: jamais vous ne serez assez proche et jamais trop proche; et pourtant toujours tenus et attenants lun lautre46.
NOTES
1BlanchotMaurice, LAttente, loubli, Paris, Gallimard, 1962, p. 61.
2Ibid., p. 62.
3BlanchotMaurice,Le Pas au-del, Paris, Gallimard, 1973, p. 158.
4BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 73.
5BlanchotMaurice,LAmiti, Paris, Gallimard, 1971, p. 89.
6Didi-HubermanGeorges,Devant limage. Question pose aux fins de lhistoire de lart, Paris, Les ditions de Minuit, 1990, p. 267.
7BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre,op. cit., p. 79. et p. 80.
8Ibid., p. 210.
9BlanchotMaurice,LAmiti,op. cit., p. 99.
10Ibid., p. 101.
11Ibid., p. 107.
12Ibidem.
13Ibid., p. 106.
14Ibidem.
15BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas, Paris, Jean-Michel Place diteur, 1980, p. 79.
16BlanchotMaurice,LAmiti,op. cit., p. 108.
17DerridaJacques,La Carte postale, Paris, Gallimard, 1982, p. 205.
18Ibid., p. 190. et p. 191. Nous renvoyons galement la page 206 du mme ouvrage: Les matres-penseurs sont aussi des matres de poste.
19Ibid., p. 206.
20Ibid.
21Ibidem.
22Ibid., p. 246.
23DerridaJacques,Positions, Paris, Les ditions de Minuit, 1972, p. 14.
24Ibid.
25BlanchotMaurice,LEntretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 73.
26Ibid., p. 74.
27DerridaJacques,Parages, Paris, Galile, 1986 (rd. 2005), p. 31.
28BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas,op. cit., p. 80.
29BlanchotMaurice,Le Livre venir, Paris, Gallimard, 1959, p. 339.
30BlanchotMaurice,LEntretien infini,op. cit., p. 71.
31BlanchotMaurice,Le Livre venir,op. cit., p. 339.
32Ibid., p. 204.
33Et cette prise de conscience delle-mme qui la rend manifeste et la rduit ntre rien de plus que sa manifestation, conduit la littrature revendiquer non seulement le ciel, la terre, le pass, lavenir, la physique, la philosophie ce serait peu , mais tout, letoutquiagit dans chaque instant et dans chaque phnomne(Novalis).BlanchotMaurice,LEntretien infini,op. cit., p. 521.
34BlanchotMaurice,Lcriture du dsastre,op. cit., p. 101.
35BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas,op. cit., p. 80.
36BlanchotMaurice,La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 295.
37BlanchotMaurice,Le Livre venir,op. cit., p. 265.
38Ibid., p. 279. Nous soulignons.
39BlanchotMaurice,LEntretien infini,op. cit., p. 449.
40LvinasEmmanuel, La servante et son matre, inCritique,juin 1966,Maurice Blanchot, Paris, Les ditions de Minuit, p. 516.
41Ibid., p. 516. et p. 517.
42BlanchotMaurice, Notre compagne clandestine, inTextes pour Emmanuel Lvinas,op. cit., p. 80.
43Ibid. Nous soulignons.
44BlanchotMaurice,Pour lAmiti, Paris, Farrago, 2000, p. 7.
45BlanchotMaurice, extrait dune lettre date du 11 fvrier 1980 inExercices de la patience, Paris, Obsidiance, 1980: Jajouterai (le dire ne console pas de ce qui reste dire) que lune des grandes leons que nous donne Emmanuel Lvinas, cest que la philosophie pour garder son nom, si sottement dcri demande plus dtude, plus de patience et de recherche, en un mot une exigence beaucoup plus srieuse quaucune autre activit de savoir. Il faut se lever tt pour cela, il faut veiller dune vigilance qui surveille la nuit et mme se laisse pas fasciner par lautre nuit. Il faut enfin parler dangereusement et dangereusement garder le silence, tout en le rompant.
46BlanchotMaurice,LAttente, loubli,op. cit., p. 87 et p. 88.
AUTEUR
Anne-Lise Large
Docteur en philosophie, Anne-Lise Large a concentr lessentiel de ses recherches sur la question de lirreprsentable et du fragmentaire dans lhistoire de lart et de la littrature. Elle est par ailleurs photographe et engage dans plusieurs projets dexposition en France et ltranger. En 2008, le Muse de la Photographie Andr Villers lui a consacr une exposition monographique et un catalogue prfac par Hlne Cixous.
Nuit trange: moment de modulations
AlainMilon
p. 33-48
TEXTENOTESAUTEUR
TEXTE INTGRAL
1Nuit trangeparce que la nuit est double. Elle est la fois ce temps mtaphorique de la philosophie dont loiseau de Minerve nest quune expression, mais elle est aussi ce moment effroyable de lobscurantisme que la haine de la pense rvle.Nuit trangeaussi pour interroger les modulations de lcriture de Blanchot et la singularit de ses mcanismes, criture que lon est bien en peine de qualifier: criture littraire, potique, philosophique Cest dailleurs lexercice des modulations de son criture et non la manire de la qualifier qui nous permet de toucher au plus prs son univers.
2Le lien que Blanchot entretient avec la philosophie a un sens, me semble-t-il, la double condition de ne pas sarrter ses attaches avec tel ou tel philosophe, et surtout de ne pas se laisser prendre par les propres notions de Blanchot comme le neutre, le dehors ou le fragment. Mieux vaut saisir lintention de son criture, non pas les arrire-penses les sous-entendus ou les conventions dcriture , ni mme les modalits les qualits extrinsques de son criture , mais les modulations de son expression la manire dont elle fait vibrer ce dont elle parle , modulations pour tenter de sapprocher au plus prs des tensions que Blanchot met en uvre, tensions qui sont la matire brute de sa pense, autrement dit son dispositif philosophique.
Lespace dcriture: les modulations du dire
3Rflchir sur la spcificit du travail dcriture au cur mme du dispositif de Blanchot, ce nest pas remettre en question la profondeur de sa pense, ce nest pas non plus la rduire une simple stylistique. Ce nest pas son style si le style se rsume une certaine faon dcrire qui est intressant, mais la fabrication de son criture se dconstruisant au fur et mesure quelle se construit, processus qui est au centre de son dispositif. Le corps de cette criture constitue la matire brute de son systme, ce quon pourrait appeler sonespace littraire. Dailleurs, le problme nest pas dopposerespace littraireespace philosophique, opposition qui se rduit le plus souvent des querelles de commentateursinutiles et incertainespour justifier des points de divergence ou de convergence entre Lvinas et Blanchot. Lespace littraire nest ni une immersion dans certaines uvres littraires, ni le lieu de fabrication du concept de littrature. Il est beaucoup plus largement le lieu de questionnement du Dire. Que Blanchot privilgie le champ littraire et Lvinas celui de lthique ne change rien laffaire puisque tous deux recentrent leur questionnement sur la fabrication du Dire.
1LvinasEmmanuel,Sur Maurice Blanchot, Montpellier, Fata Morgana, 1975, p. 46.
4Lespace littraire confronte Blanchot et son criture ses propres contradictions, mais surtout elle lenferme dans son incapacit mettre crire et dire sur la mme chelle pour faire de lun la mesure de lautre. Le Dire nest pas la mesure de lcrire comme lcrire ne mesure pas le Dire. Lcriture nest que lcho sans metteur du dire de la pense, un cho avec ses avantages personne ne se fait plus dillusion sur la relle prsence dun metteur , et ses inconvnients elle renvoie le Dire des crire multiples mais invariants. Lcriture devient alors une sorte dexil, un signe de perdition qui nous montre quil ny a pas dissue, ou pour tre plus prcis une issue qui se referme sur elle-mme. Cest ce qui pousse sans doute Lvinas montrer que larticulation philosophique de Blanchotoblige le commentateur entrer dans une double contrainte: clairer autant par ce quon en dit que par ce quon ne peut en dire1. Cet espace littraire traduit finalement laffirmation de son impossibilit tre autre chose que lexpression de ce qui rend le Dire improbable, infaisable, voire impossible.
2Est-elle loccasion de justifier la prsence du dit du sujet? Blanchot ne tranche pas. Il reste s(...)
3BlanchotMaurice,Le Livre venir,Paris, Gallimard, Folio, 2003, p. 279.
4Ibid.,p. 259.
5Pour naviguer dans cet espace denfermement que limpossibilit dlimite, il faut accepter de se soumettre aux contraintes quimpose lcriture souterraine de Blanchot, criture qui se construit partir de ses propres bifurcations qui nen finissent pas de senchsser les unes dans les autres comme des cordages lofs dont on ne sait plus o se situe le point de dpart. Peut-tre est-ce lune des raisons qui lincite crire dansNotre compagne clandestine:...le Dire nest jamais qu dire pour commenter la rflexion de Lvinas sur Le Dire et le dit. Cette interrogation sur le Dire vise-t-elle condamner lincapacit de la philosophie toucher la Parole? Traduit-elle le mme reproche que Valry adresse la philosophie, savoir dtre incapable dinventer une quelconque langue, de ntre mme pas en mesure de mettre en place une possibilit de langage2? Et si le Dire est inaccessible lcriture, cette inaccessibilit prend-elle la forme du fragment 93 dHraclite qui cherche expliquer lactivit de loracle: (il ne dit, ni ne cache; il signifie)? Le langage ne dit rien, il traduit un sens port par lcriture et cest pour toutes ces raisons que la Parole nest ni la langue, ni le langage. Le pome merge de cette parole brute, immdiate et nue de Mallarm ou de Char. Cest dailleurs sur cette incapacit chronique de lcriture toucher le Dire que Blanchot construit la singularit de sa propre criture, mme sil reste, et cela fait lattrait de son travail, des interstices, ses modulations dcriture en fait, qui sont autant de refuges quil y a de possibilits des crire dune seule impossibilit le Dire ou la nudit premire de R. Char. Ces interstices, Blanchot les construit comme des obstacles qui permettent lcriture de ne pas perdre contact avec le Dire. crire devient pour lcrivain, et Blanchot ne droge pas la rgle, le moyen dinscrire son criture dans une rsistance lgard de la langue pour rendre compte du caractre insaisissable et irrgulier de ce que lon crit3, loccasion aussi de lutter contre le convenu, tre dans le oui de laffirmation loin du oui docile de lne qui porte la charge tout en faisant hi-han. Cest le oui affirmatif de lenfant, celui de Zarathoustra, celui que Blanchot adresse Ponge. Quand on a tout puis, quand lcriture est presque en faillite, il reste Ponge semble dire Blanchot: Ny a-t-il pas Francis Ponge? Oui, Ponge4, et le choix de Ponge nest pas anodin car il reste avec Char, chacun sur des terrains qui leur sont propres, parmi les potes qui ont le plus travaill la matire brute de la Parole pour chapper la langue dans lespoir de toucher le Dire dans sa matrialit.
5BlanchotMaurice,Ltrange et ltranger,Paris, Gallimard, NRF, 1958, p. 673.
6Ponge, essentiellement, mme si Blanchot a peu crit sur lui, pour montrer comment lcrire potique peut tre au plus proche du Dire, mais aussi pour expliquer pourquoi il substitue la pratique philosophique habituelle (la production de concept) le travail dcriture (lespace littraire). Par les distinctions quil met en place dansLtrange et ltranger5, entre lapure affirmation la fabrication potique ,lespace de ce qui naffirme pas lexpression littraire et lamanire dinterroger lexpression philosophique , Blanchot place son dispositif despace littraire tout autant dans le cur de la langue comme pure affirmation (la parole potique de Mallarm, Char ou Hlderlin), que dans la langue dans ce quelle ne peut affirmer (Kafka, Artaud), ou dans la langue et ses interrogations (Pascal, Hegel, Nietzsche).
6BersonHenri,Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF, Quadrige, 1990, p.(...)
7Ibid.,p. 111.
7Ce dplacement de lactivit philosophique sur le terrain de lcriture sopre, et cest en cela que le recours au oui de laffirmation potique de Ponge est significatif, non seulement en crivant contre les paroles, mais surtout en mettant au jour leparti pris des choses. Prendre le parti pris des choses, cest avant tout prendre les choses partie pour creuser la langue dans ce quelle a dessentiel puisque cest le seul moyen daffirmer son effectuation comme lieu de rsistance mme si tout ceci conduit la mme impossibilit. Cette modulation donne vie au processus mme de lcriture, processus dordre ondulatoire et non corpusculaire. Alors que le corpuscule subit un mouvement dont il nest pas responsable, londe, elle, donne vie au dplacement tout en restant immobile. Cest aussi cela un processus: le principe des choses lorigine de lacte, autrement dit expliquer comment on peut tre du mouvement sans tre dans le mouvement. Sur le registre de lcriture, cela se traduit par cette force que possde londulation pouvoir donner une impulsion la phrase sans que les mots prennent le dessus sur la phrase. Ce mouvement si singulier est admirablement traduit par Bergson dans lide du futur antrieur: il aura t6. Lorang aura t du rouge et du jaune, mais il na jamais t ni rouge, ni jaune, et il ne sera jamais ni rouge ni jaune. Il nest mme pas du rouge et du jaune, mais il aura t du jaune et du rouge. La valeur de ce futur antrieur nest pas de rendre compte dune action future qui sera passe avant une autre action future. Ce nest pas non plus un conditionnel. Ce futur antrieur est plutt employ pour exprimer unesuppositionrelative un fait pass. On peut supposer que lorange a t jaune et rouge, mais il nen est rien. Mais pour comprendre toutes les nuances de ce futur antrieur, il faut revenir la fonction fabulatrice voque par Bergson qui est, pour reprendre ses termes, lacte par lequel ressurgissent les reprsentations fantasmatiques7.
8Le neutre est une supposition au sens o il ny a pas un neutre diffrent selon celui qui en parle(...)
8 lorigine enfantine (se raconter des histoires), ou pathologique (le dlire fabulatoire), la fabulation ne consiste pas seulement dire que la fiction peut tre une ralit. Elle est beaucoup plus significative quand elle montre que le rel est en construction permanente. Lenfant et le fou peuvent exposer des motifs de ralit sous la forme de rcits imaginaires vcus comme rels, mais en faisant cela ils en restent un simple travestissement: la fiction peut tre relle et la ralit peut tre fictive. Ce renversement napporte pas grand-chose, et surtout il nexplique pas les modulations du futur antrieur et son aptitude dire dune chose quelle aura t sans que cela soit ni un pass, ni un futur. Par contre, quand la fabulation interroge le rel pour montrer quil nest quune construction, elle fait ressortir la singularit du futur antrieur. Dans ces circonstances, tenir un propos fabulatoire ce nest pas travestir une ralit, cela revient plutt inscrire la ralit sous un mode nonciatif. Cest pour cela que la ralit ne peut tre dforme car pour quune chose soit dforme, il faut prsupposer la prexistence dune forme. Lnonciation fabulatrice est en fait inscrite dans la ralit; elle fait corps avec elle ce que montre le futur antrieur par ses modulations entre ce qui a t et ce qui sera sans tre, ni du pass, ni du futur. Lasuppositionque propose le futur antrieur relve de lacte de fabulation en modulant une ralit qui nexiste que si elle est construite. Et cest sur le registre de la modulation dcriture que la phrase blanchotienne devient un vritable acte fabulatoire. Les phrases de Blanchot module en fonction de suppositions qui ne sont ni ceci, ni cela, ni le pass, ni le futur, ni une ralit, ni une fiction, mais une prsomption, le neutre finalement, le neutre surtout quand il est une supposition8. Que cette supposition soit possible ou impossible ne compte pas, car elle est avant tout une supposition dont on ne saura jamais si elle a t ou si elle sera. Seul importe le mouvement que produit ce futur antrieur, un mouvement intrieur qui est lorigine du mouvement apparent et formel du rel. La fabulation rend finalement compte de la vritable valeur du processus que la modulation met en scne. La phrase de Blanchot ne dit rien, ne cache rien; elle signifie selon les ondulations de la modulation.
9BlanchotMaurice,Lcriture de dsastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 154.
9Pour toutes ces raisons, le style, qui ne vit que par et dans les modulations quil met en uvre, ne peut pas tre un agencement formel sans aucune intention. Il est plutt un processus qui montre, par sa puissance dagir, des lignes de visibilits rsonnant les unes entre elles: Qui loue le style, loriginalit du style exalte seulement le moi de lcrivain qui a refus de tout abandonner et dtre abandonn de tout9. La cration de lartiste, de lcrivain et du philosophe renvoie en cho les multiples traductions de la ralit pour montrer combien le rel est en mouvement et pourquoi lacte de cration nest que la manire darrter, un court instant seulement, ce mouvement des choses comme pour le figer tout en se rendant bien compte que cet instantan traduit une situation dchec face ce que la ralit met en scne. En fin de compte, la vritable nature du style est dtre un lieu deffectuation que lon peut dfinir comme un processus avec dispositif par lequel la cration se ralise. La question est de savoir maintenant comment ce lieu deffectuation, autre manire de parler de modulation, prend forme et quels processus il met en scne.
10BlanchotMaurice,Le Livre venir, Paris, Gallimard, Folio, 2003, p. 272.
11Ibid., p. 273.
12BlanchotMaurice,LEntretien infini,Paris, Gallimard, 1969, p. 50.
13NietzscheFreidrich,Ecce homo, Paris, Denol Gonthier, 1971, p. 76.
10Cette modulation, Blanchot lutilise chaque fois quil veut rendre compte de la puissance daffirmation de lcriture. Elle correspond au mouvement dondulation que prend lcriture. Par ses ondulations, lcriture donne autant voir quelle fait disparatre les choses dont elle parle: [] luvre est le mouvement qui nous porte vers le point pur de linspiration do elle vient et o il semble quelle ne puisse atteindre quen disparaissant10. Lespace littraire, autrement dit le lieu de fabrication et dexpression de lcriture, est dans le mme temps le signe dune affirmation essentielle et le lieu o elle se rinvente, remettant en cause ce qui vient juste dtre affirm11.Cette ondulation entre le ressaisissement et lexclusion est la modulation de lcriture de M. Blanchot, son style en fait: Comment ressaisir en ma parole, cette prsente antrieure quil me faut exclure pour parler12. Mais Blanchot ninvente rien; il ne fait que reformuler lide dactualisation du possible chre Leibniz. La possibilit de limpossibilit, plus que limpossibilit de la possibilit, devient la force de linachev. Ces possibles obissent la grammaire de la modulation dont Buffon avait dj analys le principe dans son essai sur le style: comment la langue construit ses variations dans sa propre continuit. Cest cela moduler: Communiquer un tat dme, une tension intrieure, une motion, par des signes y compris lallure de ces signes voil le sens de toute espce de style Le bon styleen soiest une pure sottise de lidalisme pur, peu prs le mme que le beauen soi13. Le style est dabord lconomie de la langue au sens o il doit lallger de ce qui lappesantit les figures de style.
Lespace litteraire: grammaire de la modulation
14BuffonGeorges-Louis Leclerc de, Histoire des animaux,LHistoire naturelle, chapitre III, B(...)
15BuffonGeorges-Louis Leclerc de, Le discours sur le style,Discours acadmiques.Paris, 1866,(...)
11Lorsquen aot 1753, Buffon crit, loccasion de son lection lAcadmie Franaise, sonDiscours sur le Style, il travaille en mme temps sur sonHistoire Naturelledont il a dj publi plusieurs volumes, notamment les volumes consacrs lobservation des espces et leur composition. Cest en tudiant lvolution des espces quil esquisse lide moderne de circulation molculaire au travers des corps; les molcules passant dun corps lautre au fur et mesure de lvolution de ltat physique de ce corps. partir de lide dchange molculaire, Buffon va laborer la notion demoule intrieurquil applique au corps animal qui a une forme constante mais dont la masse et le volume peuvent augmenter proportionnellement et que laccroissement, ou si lon veut le dveloppement de lanimal ou du vgtal, ne se fait que par lextension de ce moule dans toutes ses dimensions extrieures et intrieures14. Lemoule intrieurnest pas une forme mais une modulation spcifique la structure de chaque individu. Il nest ni une dlimitation externe des structures, ni une forme formalisante et irrversible. Il est une modulation agissant sur la structure interne des sujets, une forme qui sactualise dans la matire du langage; cette modulation devenant le corps mme du langage. Quand Buffon crit que le style est de lhomme15, il sous-entend que chaque crivain a un style au sens o personne ne module de la mme manire. Chacun a sa langue comme chacun a sa conversation. Les modulations dArtaud ne sont pas celles de Mallarm mme si la fin elles se rejoignent pour retrouver ltat primitif de la langue.
16Confidence faite par M. Proust R. Martin-du-Gard et parue dansLe Figaro littrairedu 24 dcem(...)
17ArtaudAntonin,uvres compltes, t. XIV (2) Suppts et suppliciations, Paris, Gallimard, 19(...)
12Ce moule modle et module lintrieur des tres ou des volumes, quels quils soient, non en sen tenant uniquement aux procds rhtoriques de lAntiquit, ceux qui dlimitent lextriorit des tres ou des choses, mais en sattaquant la structure intrieure de lcriture. La force de modulation de Buffon repose sur son aptitude dnaturer et faire exploser les figures classiques du style. Le moule comme variation de ces modulations nest plus le moment o une forme simpose extrieurement, grossirement, presque avec vulgarit, une matire. Il est plutt unconatusqui donne vie la matire. Cest l le vritable enjeu du style: sortir de la rgulation rhtorique dans lesprit des confidences que Proust adresse Roger Martin du Gard: Renoncer tre proccup par le style16.Se proccuper du style revient rduire lacte dcriture un simple exercice dagencement. Par contre,oublierle style cest librer la langue de son carcan syntaxique pour permettre la matire brute de la grammaire de sextraire. Cest l toute la diffrence entre lcrivain qui a un style, qualit immanente dun acte dcriture, et le scribe, sorte de styliste de la belle criture, celui qui nest peut-tre pas assez harcel par la brutalit des choses et des vnements pour la saisir. Le style devient alors ce non-style qui permet de retrouver la langue premire. Cest celaavoir du style:toucher le sens pour redcouvrir en profondeur ce qui donne vie la langue. Mais cest aussi faire uvre de non-style afin de russir atteindre un tat de dissolution irrversible o la langue quotidienne finit par ne plus tre homogne. Cest en ce sens quArtaud ira jusqu dire dansSuppts et suppliciationsque le style lui fait horreur: Je maperois que quand jcris jen fais toujours, alors je brle tous mes manuscrits et il ne me reste que ceux qui me rappellent une suffocation, un haltement, un tranglement17.
18Lorsque Aristote, dansLa Rhtorique(Livre II, 1355 b 25-26) dfinit cette activit intellectuel(...)
13Cette dissolution est la grammaire de Blanchot, celle qui met au jour une criture en perptuel mouvement. La dissolution de la langue ne sexplique pas par le refus de la rhtorique comme sil sagissait dopposer lintriorit la langue primitive lextriorit lusage de rgles rhtoriques ; elle rend plutt compte de lusage modul de la langue, usage qui permet de faire la distinction entre la manire dont le rhteur construit son discours, et la faon dont le rhtoricien, sorte dechevalier de la carafe,joue de manire excessive avec les effets de manche18; dissolution brutale aussi parce quelle nous renvoie notre propre impossibilit.
Le desequilibre
14Blanchot trouve dans la dissolution de la langue une tension permanente. Il travaille lcart jusqu tre dsquilibr dans son propre usage de la langue. Ce dsquilibre rend compte de cette capacit quont les grands crivains trouver une langue trangre dans leur propre langue, ce que lon appelle finalement le style. Les analyses de Deleuze, Bene ou Barthes sur ltranget dans sa propre langue montrent de quelle manire se construisent ces modulations qui sont boule cri chez Artaud, affouillement chez Char, ligne de crte chez Burroughs, scansion chez Cline, mutisme chez Beckett, fissure chez Woolf ou conomie verbale chez Sarraute. Ce travail sur lcart est violent par ncessit. Corps corps poussant lcrivain dans ses retranchements, lcart rvle les modulations aux variantes incessantes de la langue de lcrivain mme si cela fait courir des risques lcriture. Lcart module jusqu enfermer lcrivain dans une sorte de bgaiement continuel, un bgaiement qui, par ses modulations, fabrique une langue. Ce bgaiement-l nest ni mcanique le dfaut locutoire , ni psychologique la surcharge motive ; il est essentiel la nudit dune langue en train de se faire. Et si le bgue drange, ce nest pas par le caractre rptitif et syncop de ses bgaiements en apparence mcaniques qui font rire ceux qui y voient une dfaillance locutoire, mais parce quil confronte lauditeur au processus dune langue en cours de construction. La modulation comme acte de fabrication devient alors linstance par laquelle lcart rend possible une langue apparemment familire, mais apparemment seulement.
15Cest tout cela le style, et cest sur tout cela que Blanchot crit. Il le fait de deux manires. Dans un premier temps il ne cesse daffirmer limpossibilit du Dire autre reformulation de limpossibilit de ltre, sorte dontologie ngative qui consiste accepter que ltre ne peut senvisager que par ce quil nest pas , mais dans le mme moment, il enferme son lecteur dans cettepossibilit de limpossibilit, ontologie indirecte qui confirme ltre dans ses substitutions. Ces deux temps prennent forme dans cette faon dcrire si singulire, criture qui va bien au-del des propres formulations de Blanchot, dapparences contradictoires. Son rapport la langue est limage des hros dHomre: plus ils parlent, plus ils sloignent de ce dont ils parlent, et trop parler, ils finissent par ne plus combattre. Lcriture de Blanchot tente de dire simplement que le fait de formuler quelque chose oblige lcrivain mettre son propos en bascule. Laffirmation est une attente quune autre affirmation va confirmer dans sa posture dattente. Les phrases sacheminent ainsi de suite vers le souterrain voqu plus haut, souterrain qui na pas dautre objectif que de mettre le lecteur comme lcrivain en suspension, un peu la manire o Godot nattend pas quelquun; il est tout simplement suspendu, sans point dancrage. Lcrire nest pas l pour dire mais pour mettre en suspension tout ce dont on parle, suspension qui chez Blanchot cherche le dsquilibre jusqu la ligne de fracture.
19BlanchotMaurice,La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 30.
20Ibid., p. 46.
16Quoi quil arrive, ces modulations se plient cette impossibilit inscrite dans le corps mme de la langue. Lorsque Blanchot affirme que ce qui rend possible le langage, cest quil tend tre impossible Ds que quelque chose est dit, quelque chose dautre a besoin dtre dit19, il ne fait que confirmer le fait que lon nest pas avec la langue comme avec un outil, mais que lon est dans la langue parce que lon ne peut faire autrement. Cette immersion est nanmoins soumise limpossibilit chronique de la langue assumer lincertitude de sa nomination. La langue ne peut faire autre chose que de substituer la chose son absence20. DHraclite Mallarm en passant avec beaucoup dinsistance sur Hegel, Blanchot confirme la langue dans ses incapacits quelles soient meurtre de la nomination pour Hegel dans laPhnomnologie de lespritou disparition vibratoire pour Mallarm dansCrise de vers. Cela ne veut pas dire que les modulations de lcriture sont le signe dune disparition, dun anantissement, dune dsagrgation de ltre, mais plutt lexpression de la permabilit de la langue et de sa capacit dissoudre plus celui qui parle que ce dont elle parle. Et cest justement parce que la langue est permable quelle dissout et se dissout en mme temps quelle se construit. Mais cette dissolution a un avantage; elle autorise ces parcours sinueux que les modulations font surgir. Cela ne veut pas dire que ce que la langue ne peut dire linnommable de la tradition philosophique est lautre du langage, mais plutt ce que nous voquions prcdemment partir dHomre (plus on parle plus on sloigne de ce dont on parle) nous signale que lloignement est un signe dapproche prvisible puisque son issue est connue davance. La duplicit du langage est dans cette situation dexclusion qui narrte pas dannoncer son inclusion. La duplicit nest pas un signe dextriorit. Le double de la langue est la langue elle-mme, et cela ne vaut pas seulement pour le double puisque la langue scrte sa scissiparit. Pour quelle soit double, il faut dabord quelle soit une, pourtant la langue nest ni une, ni deux. Elle nest pas standard et uniforme, sauf loccasion de ces grammaires dfinies par lesinterprtes de la statistiquequvoque Valry quand il les oppose auxagents dcartque sont les crivains.
17La langue est avant tout dans la scission et elle se multiplie partir de ses fractures qui, dans le cas de Blanchot, deviennent des sinuosits la mesure des constructions quil fait de son propre usage de la langue. Cet usage si particulier est loppos de celui des techniciens du langage, de ceux qui en font une science les effets de style ; il est plutt celui de la mesure potique. Et si Blanchot a accord autant dimportance Char, cest sans doute en raison de la manire dont le pote montre que la posie nest pas une faon de travailler la langue, den faire une matire uvrer mais parce quelle est dabord ce qui rend possible le langage. La mesure potique est essentiellement satisfaction de la langue au sens dusatis facerede la tradition latine. Faire assez, au sens den faire juste assez, autrement dit comprendre limportance de lusage mesur des mots pour refuser leffet ou lagencement sec et formel. Et les interpntrations frquentes de Blanchot et de Char relvent de la mme perception de la langue: le potique ne se rduit pas la catgorie de lanalyse.
21CharRen,uvres compltes, Paris, Gallimard, 1983, p. 160.
22Ibid., p. 155.
23BlanchotMaurice,La Part du feu,op. cit., p. 13
18Si pour eux, il ny a de potique, dnonc, de Sens qu partir de linstant o la posie est dans la pure affirmation de ce qui ne peut sexprimer, cest justement parce que la nomination est une tentative qui reste vaine mme si certains russissent faire ressortir ses proprits probatoires21. Dans tous les cas de figure nanmoins la posie nest pas la juste dnomination; elle est plutt le moment o le pote comprend limpossibilit denvisager linextinguible rel incr22 qui devient chez Blanchot le Tout est abme, cest--dire le mouvement partir duquel celle-ci (la parole) peut vraiment parler23. La langue est dans cette situation paradoxale dtre la fois ce qui rend possible la nomination et en mme temps ce qui mesure son impossibilit dire ce que lon nomme. Cest ce que tente de faire Blanchot dans ses modulations, modulations qui embarrassent le lecteur qui, plus il avance dans la phrase blanchotienne, plus il se perd sans espoir de se reprer. Son style est l, marqu par une sorte dtranget qui chappe autant lcrivain quau lecteur, tranget qui pousse Blanchot crire que lcrivain ne choisit pas plus son style quil ne choisit sa langue. La question devient davantage celle du lien qui relie lcrivain la langue que le problme de savoir quelle est la langue de lcrivain. Dire lcrivain et la langue, cest faire de la langue quelque chose part, une sorte de greffon halogne qui risque, en pntrant le corps de lcrivain, de le dtruire. La langue ne fait pas corps avec lcrivain, quelle soit maternelle ou trangre. Lcrivain et la langue se livrent un combat dont il doit sortir vainqueur. La seule langue que lcrivain sapproprie en fin de compte est celle quil est capable de fabriquer. Dans ces circonstances, cest beaucoup moins la langue que parle Artaud qui importe que le corps corps quil engage contre la langue, autrement dit la manire dont il vit la langue comme un corps la fois tranger et familier. Son style est l; il est la mesure du combat quil engage contre la langue. tranget familire, familire tranget ces termes ne se combinent pas, ils sont dans linterstice deux-mmes et ils affirment au mme instant lexistence du familier je suis l et de ltranget il est ailleurs. Lcriture vit de lintrieur cette scission quintroduit ltrange tranget par le fait quelle est la fois trangre elle en sort, elle est ailleurs, et la fois familire elle en vient.
trange etrangete: vers une autre economie de la parole
19Lcriture de Blanchot reste souterraine. Elle creuse la langue jusqu la faire effondrer. Ce travail de sape est pourtant le seul moyen de la faire vivre. Blanchot se livre un corps corps avec la langue mme si celui-ci est beaucoup moins risqu que celui livr par Artaud. Artaud risque tout, non parce quil a perdu moiti sa raison, mais parce que sa tentative de fabrication a failli accoucher dune langue encore plus commune. Et, il faut tout le gnie dArtaud pour que ses cholalies, ses glossolalies, ses logorrhes ne soient pas de simples figures de style.
20Blanchot porte la nuit dans son criture, non pour faire remonter la surface la barbarie latente du monde, mais pour montrer la prgnance du concept. Lomniprsence de cette nuit revient comme une ritournelle, une nuit qui exprime limpossibilit Le Dit nest jamais qu dire en mme temps que lissue le possible nest pas une alternative, un ou bien ou bien, mais simplement une voie de passage parmi mille autres.
21La nuit qui marque luvre de Blanchot est comme la ponctuation dun texte impossible crire. Il y aura toujours des virgules, des points, des majuscules, mais au fil de son criture le texte sabsente parce que, ds quil est crit, il efface lcrivain en nonant et en annonant les impasses de lcriture. Seul reste un lecteur pour contempler cette dissolution qui, malgr les apparences, permet au texte de respirer. Ces absences sauvent le texte de son tat de livre qui, dfinitif, interdit les espaces de possibilit en mme temps quil les rend probables.
24BlanchotMaurice, Ltrange et ltranger, Paris, Gallimard, NRF, 1958, p. 676.
25BatailleGeorges,La Notion de dpense, Paris, Les ditions de Minuit, 1949.
22Nuit trangepour saisir, par la dissolution, ltrange dans la banalit qui nous chappe;nuit trangepour essayer de comprendre ce que Blanchot entend par dissipation de toute identit24 pour qualifier la figure de ltranger, non seulement quand il sagit de ltranger comme lautre, mais aussi quand il est celui qui nous permet de comprendre limpossibilit de notre autochtonie. Cette tranget est autant celle de lhte accueilli que celle