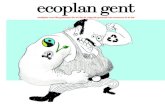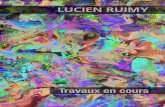Lucien Israel Pulsion de mort.pdf
-
Upload
hans-bogaert -
Category
Documents
-
view
35 -
download
0
Transcript of Lucien Israel Pulsion de mort.pdf
LUCIEN ISRAËL, PULSIONS DE MORTParis, Arcanes/Érès, 2007Michel Constantopoulos L'Harmattan | Che vuoi ? 2008/2 - N° 30pages 171 à 175
ISSN 0994-2424
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-che-vuoi-2008-2-page-171.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constantopoulos Michel, « Lucien Israël, Pulsions de mort » Paris, Arcanes/Érès, 2007,
Che vuoi ?, 2008/2 N° 30, p. 171-175.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour L'Harmattan.
© L'Harmattan. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 17
8.11
6.19
3.18
5 -
07/0
1/20
13 2
2h51
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 178.116.193.185 - 07/01/2013 22h51. ©
L'Harm
attan
Lucien Israël
Pulsions de mort Paris, Arcanes/Érès, 2007
Michel Constantopoulos
Ce livre est une surprise. Ceux qui ont connu Lucien Israël se souviennent de l'accent qu'il mettait sur la surprise, qui vient, comme il le dit dans ces pages, nous révéler que «chaque instant est un instant nouveau »\ que c'est toujours la première fois ... La surprise, comme dans les contes (qu'il évoque également): on ouvre une petite porte, quasi indistincte, dissimulée derrière une haie ou découpée dans un mur, et on se retrouve subitement transporté dans un autre espace, un autre temps. «Cy n'entrez pas », avertissait-il les lecteurs d'un de ses ouvrages, «Cy n'entrez pas» si vous ne voulez pas être surpris ...
En ouvrant ce volume de séminaire, le charme opère: transportés dans l'amphithéâtre de la Faculté de médecine de Strasbourg dans les années 1977-1978, on entend la voix de Lucien Israël, inimitable, avec ses inflexions, ses changements subits de ton, et cette présence réelle, corporelle dont il dit ici même qu'elle est si importante en analyse. Vous savez que Lacan disait être, dans son séminaire, en position d'analysant. Je crois que nous pouvons dire qu'Israël occupait, lui aussi, face à son public, la place de l'analysant: s'adonnant assez ouvertement et avec une certaine jubilation à ses associations, remplissant l'espace comme un acteur de théâtre et donnant l'impression à chacun de ses auditeurs de s'adresser personnellement à lui. De la même façon justement que l'analysant le fait parfois croire à l'analyste: « On ne sait d'ailleurs jamais », dit-il, « lequel des deux est l'analysant. »2 La transcription a réussi à faire revivre, passer à l'écrit quelque chose de cette ambiance particulière de l'exercice oral.
Ce n'est pas une simple question de forme. Ce style très personnel n'était pas chez Israël accessoire, une coquetterie (quoique ce terme ne lui aurait pas forcément déplu). fi était lié au message que son
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 17
8.11
6.19
3.18
5 -
07/0
1/20
13 2
2h51
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 178.116.193.185 - 07/01/2013 22h51. ©
L'Harm
attan
Che vuoi ? n° 30
discours véhiculait, et qui consistait à privilégier la transmission orale sur l'écrit. Vous savez que pour toute une tradition de pensée, l'écrit était relégué à la place de la propédeutique. En aucun cas il ne pouvait remplacer la pratique, se substituer à tout un mode de vie, un art de vivre. Si l'enseignement d'Israël retrouve les accents de la tradition orale, c'est parce que cette question compte pour la psychanalyse. Il insistait sur ce point; d'ailleurs, ses livres sont le plus souvent le condensé de ses cours et autres interventions orales. Ainsi, bien que ce séminaire soit un commentaire de textes de Freud (les Trois essais, Un enfant est battu, Le problème économique du masochisme), ces textes écrits sont, comme il le dit explicitement, des «pré-textes », une introduction aux « véritables textes qui sont la clinique »3. La clinique comme un texte - c'est dans la plus pure tradition freudienne -consistant à lire le symptôme comme un cryptogramme qui recèle un sens. À partir de là, les chemins de l'analyse divergent nécessairement avec ceux de la psychiatrie, car ce sens crypté il s'agit non seulement de le découvrir dans l'histoire de chacun, mais (à suivre Israël) de l'inventer dans une direction nouvelle, dans une création, comme dans le cas d'une œuvre d'art.
Ce changement d'orientation était sensible dans ses présentations cliniques, qui aboutissaient à une ouverture, un pari sur l'avenir (formule qu'il aimait souvent employer). C'est que, pour lui, comme il le dit dans ces pages, « le sujet n'est pas donné au départ ». Exit par conséquent le sujet de l'humanisme, chargé comme l'âme d'une essence a priori. Le sujet auquel on a à faire en analyse: «Il vient s'inscrire dans l'inconscient au fur et à mesure que l'individu se met à l'épreuve du désir. »4
Arrêtons-nous un instant sur cette formule un peu dense. On y voit d'abord que si le sujet est le fruit d'une histoire, il s'agit de l'histoire de sa confrontation d'avec l'altérité de son désir. Voilà pourquoi ce sujet n'est décelable que dans l'après-coup. Israël y insistait souvent: il faut que l'histoire ait eu lieu pour que le sujet puisse se l'approprier.
Mais il y a autre chose: « L'individu se met à l'épreuve du désir. »
Ce dernier est donc un facteur perturbateur, un trouble-fête qui vient faire irruption, déranger la «tranquillité de l'âme» chère aux philosophes (Sénèque), générer des conflits, créer des symptômes. Le sujet va être le condensé de cette histoire de l'épreuve du désir. Mais il ne faudrait pas le voir comme un héros tragique, lucide à la fin du drame, capable de porter un regard après-coup apaisé et magnanime sur son histoire et en tirer calmement les conséquences: on serait alors sur le terrain de la morale. Israël insiste pour dire qu'au fur et à mesure de son histoire de désirant, le sujet «vient s'inscrire dans l'inconscient ». Pas de maîtrise possible donc: il n'y a pas en analyse d'équivalent de la notion de progrès, un point de vue élevé d'où on
172
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 17
8.11
6.19
3.18
5 -
07/0
1/20
13 2
2h51
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 178.116.193.185 - 07/01/2013 22h51. ©
L'Harm
attan
Cabinet de lecture
puisse dispenser des préceptes moraux tirés de l'expérience, distribuer des recettes de bonheur et se mettre à l'abri des expériences malheureuses. La fin de l'analyse n'est pas assimilable à la sagesse et l'analyste n'est pas le Sage. La formule aurait peut-être fait sourire Israël, lui qui disait souvent que le devenir analyste est parfois le dernier refuge du symptôme ...
Sa conception du sujet a des conséquences qui engagent l'analyse et dont ce séminaire au style léger tient compte avec la plus grande rigueur. Tout d'abord, il s'agit de se tenir à l'écart du jugement morals. C'est logique: si le sujet se constitue dans l'épreuve du désir, le raisonnement qui conduit au diagnostic et qui consiste à épingler un individu sur un tableau préétabli, le réduisant à une étiquette préfabriquée, perd son sens, car il n'y a pas de lieu d'où on puisse prononcer un tel jugement: nul n'est à l'abri du désir. Ceci est d'autant plus sensible dans ce séminaire qu'il concerne le domaine délicat des perversions sexuelles, abordé ici sous un angle subversif.
Ainsi, la perversion est un instant assimilée à « l'amour sans risque» : détenir, posséder l'objet de ses vœux. Or, l'instant suivant, nous lisons qu'un tel amour est impossible, car tout simplement: « L'ennui c'est que l'objet, lui, peut très bien se défaire de nous» ! Au fil des pages, on respire à pleins poumons l'air vivifiant de l'humour narquois (adjectif qu'il affectionnait), agrémenté parfois du mordant de l'ironie. Les structures cliniques sont dialectisées, problématisées, inscrites dans le rapport à autrui. Voici à quel type d'approche cela peut conduire. Deuxième définition: « La perversion n'est probablement rien d'autre qu'une injure proférée par ceux dont la puissance pulsionnelle est restreinte par la névrose. »6
On voit que, en partant de la clinique, Israël y introduit un mode de questionnement qui contribue à subvertir les certitudes. Si un travail analytique est possible, il l'est à ce prix.
Troisième définition: « Le pervers, quel qu'il soit, a une fonction de représentation de l'au-delà [ ... ], la perversion est une tentative d'accéder à l'au-delà par le truchement du corps. »7 Si vous ne saviez pas comment vous représenter l'au-delà, en voilà une réponse! C'est une sorte de frontière du désir qui, du coup, n'est pensable que comme la représentation de quelqu'un. Cette référence à l'autre traverse le séminaire comme un fil rouge, dégageant progressivement une place particulière, à partir de laquelle il ne s'agit ni de faire l'apologie ni de condamner telle ou telle position du sujet dans l'épreuve du désir, mais de les interroger. Dans ce sens, Israël reprend à son compte la position freudienne selon laquelle même l'attachement exclusif de l'homme pour la femme (il cite, amusé, ce passage des Trois essais) cesse d'être une évidence pour devenir à son tour une question, un mystère du désir parmi tant d'autres ... s Cette
173
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 17
8.11
6.19
3.18
5 -
07/0
1/20
13 2
2h51
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 178.116.193.185 - 07/01/2013 22h51. ©
L'Harm
attan
Che vuoi ? n° 30
position a quelque chose de socratique, à quoi Israël apporte un angle spécifique d'interrogation à partir du désir.
Ainsi, pour clore ces quelques points d'une lecture partielle de ces séminaires, si le masochisme selon Israël est un développement du Moi coupable et le sadisme du Surmoi9
, il ajoute avec force que l'adaptation, elle aussi, peut être assimilée à un développement du refoulementlO
• Et la peur de la mort peut alors trouver sa place comme le «signifiant du manque à vivre »11, à savoir comme la peur de disposer de sa vie sans avoir à en référer à quelqu'un: les parents, les maîtres, Dieu, et l'analyste même parfois ... Comme il le formule: « La peur de la mort traduit une conception parentale du destin. »12 Souvenons-nous que pour les Anciens la peur de l'avenir, des malheurs et de la mort était la définition même de l'étourdissement, la stultitia de Sénèque, qui est assez proche du « brouillard névrotique» décrit ici. Mais la sagesse antique n'est pas venue à bout de cette peur, une des plus largement partagées au sein de l'humanité.
Pour Israël, la peur de la mort équivaut à l'angoisse de castration, peur de perdre quelque chose associée au désir: «On en fait une menace, mais la castration est toujours déjà derrière nous, ce n'est pas demain que nous serons incomplets, nous le sommes dès le départ. »13
Surprise: la répétition (à quoi souvent on ramène la pulsion de mort) change alors de sens. Israël nous invite à ne plus voir dans le transfert la répétition de quelque chose qui s'est passé, car ce qui s'y passe n'a jamais pu se passer avec qui que ce soit d'autre, dit-iP4
• Il s'agit donc d'une création, et c'est là je crois que réside le véritable coup de force sur lequel s'achève ce Séminaire. Sortir du «souci de continuité» où s'épuise la névrose pour aller vers la surprise, l'inédit, l'inexploré, faire de sa vie une œuvre. Aurait-il fait sienne cette formule de Foucault? En tout cas, cette mise en avant de la création est l'apport majeur d'Israël: elle confère après-coup un éclairage qui réunit les différents éléments que j'ai évoqués: le style personnel, l'accent mis sur la clinique et son enseignement en un véritable appel à création: « Que la répétition retrouve cette dimension de création qui est signe de vie. Et il n'y a pas d'autre visée dans l'analyse. »15
'Israël (L.), Pulsions de mort, Paris, Arcanes/:Ërès, 2007, p. 158. 2Jbid., p. 47. 3Ibid., p. 18. 'Ibid., p. 40. 5Ibid., p. BO. 6Ibid., p. 56. Cf aussi p. 75. 7Jbid., p. 114.
174
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 17
8.11
6.19
3.18
5 -
07/0
1/20
13 2
2h51
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 178.116.193.185 - 07/01/2013 22h51. ©
L'Harm
attan
8Ibid., p. 50. 9Ibid., p. 112. l°Ibid., p. 115. llIbid., p. 116. I2Ibid., p. 102. 13Ibid., p. 184. 14Ibid., p. 186. lSIbid., p. 185.
175
Cabinet de lecture
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 17
8.11
6.19
3.18
5 -
07/0
1/20
13 2
2h51
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 178.116.193.185 - 07/01/2013 22h51. ©
L'Harm
attan