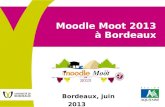Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, P.-M. Chauvin. Éditions...
-
Upload
andy-smith -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
Transcript of Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, P.-M. Chauvin. Éditions...
540 Comptes rendus / Sociologie du travail 53 (2011) 537–567
décrypte ainsi l’émergence de la « figure de la folle » dans le militantisme homosexuel, commestratégie de résistance à l’hétéronormativité, mais l’échec ou le renoncement du mouvement gayà dépasser la critique de l’ordre des sexualités pour questionner celui du genre.
Ce livre comble un déficit manifeste de travaux mobilisant une approche de genre dans lechamp du militantisme. Il rappelle très justement la nécessité d’articuler dimensions symboliqueset matérielles dans l’analyse des rapports sociaux de sexe, et de ne pas sous-estimer la pluralité etles contradictions internes à la catégorie femme. Certaines pistes de recherche méritent toutefoisd’être prolongées. Une attention plus systématique au travail des organisations dans le faconnagedes militants et des pratiques militantes permet de saisir, en contexte, les mécanismes formelset informels qui contribuent à la re-production des hiérarchies de genre (de classe et de race)dans la division du travail militant et la sélection des militants. De même, l’analyse des stratégiesindividuelles ou collectives des femmes au sein des organisations militantes permet d’apprécierl’intensité et la nature des transformations (et des résistances) de l’ordre sexué, en lien avec deseffets de période et de génération.
Cécile GuillaumeCentre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques, CLERSE - UMR CNRS
8019, Université des sciences et technologies de Lille (USTL), bâtiment SH2,59655 Villeneuve d’Ascq cedex, France
Adresse e-mail : [email protected]
doi:10.1016/j.soctra.2011.08.015
Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, P.-M. Chauvin.Éditions Féret, Bordeaux (2010). 267 pp.
Que pourrait-on dire de plus sur l’univers des Grands Crus bordelais ? Sur ces produits d’uncercle d’acteurs très restreint vendus à une élite mondiale à des prix faramineux, que pourraitapporter un regard des sciences sociales ? Tiré d’une thèse de sociologie, ce livre montre avecfinesse et élégance que les pratiques sociales, économiques et politiques liées à ces vins peuvent etdoivent être étudiées de près, à condition de les rendre comparables à d’autres. Plus exactement, ens’inscrivant dans une sociologie des marchés institutionnaliste qui, depuis une quinzaine d’années,se revitalise, Pierre-Marie Chauvin fait l’exploit de mettre pleinement en lumière les dynamiquesclés du monde des Grands Crus tout en proposant une lecture généralisable de ce qu’il appelle« les sources de réputation ».
De manière relativement classique, cette grille d’analyse exige tout d’abord que le chercheurexamine de près le statut, ou plus exactement la configuration statutaire, dont bénéficie chaqueGrand Cru. Selon l’auteur, celle-ci est toujours le produit d’un travail politique et social, menéau cours de l’histoire par une pluralité d’acteurs, qui vise à situer le vin en question par rapportà des dispositifs d’évaluation et à leurs critères respectifs. Comme le montre la partie I, dans lecas du Bordelais, le fameux « classement de 1855 » structure fortement les dispositifs les plussaillants en participant au phénomène de clôture statutaire. Mais loin de se contenter d’un travaild’archive, P.-M. Chauvin a mené une enquête par entretien extensive sur les tentatives récentesde réactualisation du classement. Ici, la très grande reproduction des statuts hérités du xixe siècleest expliquée de manière minutieuse.
Ce socle posé, l’ouvrage prend ensuite vraiment son envol dans des parties très originalesconsacrées aux « chiffres » (II) et aux « entrepreneurs » (III) de la réputation qui mettent davantage
Comptes rendus / Sociologie du travail 53 (2011) 537–567 541
en lumière d’autres institutions de cet espace social qui laissent une plus grande marge pourle changement. Tout d’abord, « l’architecture des prix » des Grands Crus est décortiquée afind’expliquer les causes de sa construction sociale. Plus spécifiquement, l’ouvrage montre en détailcomment diverses professions — des producteurs, des négociants, des courtiers, des critiques,des distributeurs — contribuent à cet édifice par leurs actes quotidiens et leurs interdépendances.Un développement approfondi est effectué sur le rôle complexe et central que jouent les prix desortie en primeurs. De même, l’impact controversé des notes données par les critiques vinicolesen général, et par Robert Parker en particulier, est analysé avec brio — et tout ceci afin de montrerles relations de causalité prix, cognition et réputations.
La dernière partie de l’ouvrage prolonge ces constats en donnant une place dans l’analyse àune catégorie d’acteurs qui, depuis une vingtaine d’années, ont fortement marqués les GrandsCrus, et plus généralement le secteur vitivinicole : les consultants œnologiques. En mobilisantnotamment les récits de vie et de carrière de certains d’entre eux, P.-M. Chauvin montre nonseulement comment cette profession a pu s’enraciner dans le milieu en remplacant partiellementles œnologues « scientistes » (rattachés à des laboratoires, voire à des universités), mais aussicomment et pourquoi autant de producteurs se sont pressés pour acheter à la fois leurs conseils etleur « signature » dans l’espoir de mieux faire et vendre leur vin.
Au total, ce livre constitue une réussite exemplaire à la fois sur le plan de l’analyse de son objetempirique et sur celui de sa contribution à la théorie sociologique. Nous laisserons aux spécialistesde « l’économie des singularités » (ex. Lucien Karpik) la tâche de se prononcer sur son apportsur le plan de la micro-sociologie de l’activité économique. En tant que politiste dont l’objetest davantage la régulation politico-économique des industries, nous voudrions plutôt saluer lapasserelle interdisciplinaire ouverte par cet ouvrage entre la sociologie, l’économie et la sciencepolitique et soulever une interrogation concernant son prolongement éventuel. Cette passerelleest indissociable de la variante institutionnaliste adoptée par P.-M. Chauvin qui lui permet decentrer son analyse sur l’évolution concomitante des pratiques et des règles. Son hypothèse surles frictions réputationnelles qui, en impulsant les tentatives de reproduction et de changement desréputations, produisent les hybridations catégorielles et ainsi de l’innovation économique, mérited’être généralisée à d’autres objets et confrontée avec confiance à d’autres manières d’aborder lechangement institutionnel.
Notre interrogation principale concerne le rapport entre l’univers des Grands Crus et le restede l’industrie vitivinicole. P.-M. Chauvin analyse bien d’un côté les phénomènes de « clôture »propres à ce monde social et, de l’autre, ses liens avec les espaces sociaux, économiques et poli-tiques externes qui empêchent son autonomisation totale. Par exemple, il montre que beaucoupdes règles qui structurent les comportements des acteurs des Grands Crus sont tout à la fois« locales » et « pluri-territoriales ». Pour autant, l’ouvrage aborde une série d’interdépendancesqui, en dépassant la filière des Grands Crus bordelais, obligent les acteurs concernés à se posi-tionner au sein d’une industrie plus large. S’il est certain que les Grands Crus bénéficient d’uneréputation globale telle que leurs propriétaires sont généralement bien placés pour concurrencerles autres vins francais et étrangers qui appartiennent à cette « gamme », peut-on faire abstractiondes « challengers » ? Ensuite, beaucoup de propriétés produisant les Grands Crus fabriquent aussiles deuxième, troisième ou quatrième vins qui sont commercialisés à des prix plus bas, selond’autres logiques et à travers d’autres canaux de distribution. Au sein d’une exploitation viti-cole qui adopte cette pratique, n’y t-il pas des stratégies commerciales, financières et techniquesqui auraient pu être prises plus en considération ? Au fond, cette question empirique renvoie àune interrogation plus théorique : quels ajustements au modèle d’explication de P.-M. Chauvinseraient nécessaires si l’on voulait le transposer à l’analyse d’autres biens économiques, notam-
542 Comptes rendus / Sociologie du travail 53 (2011) 537–567
ment ceux où la concurrence entre les entreprises s’articule plus directement avec les fluctuationsde « l’offre » et de « la demande » (par exemple, les vins de Bordeaux de milieu de gamme) ?
Andy SmithCentre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux, 11, allée Ausone, 33607 Pessac cedex, France
Adresse e-mail : [email protected]
doi:10.1016/j.soctra.2011.08.006
Living in a Material World, T. Pinch, R. Swedberg (Eds.). MIT Press, Cambridge (2008).403 pp.
L’ancrage disciplinaire des coordinateurs de cet ouvrage collectif traduit le rapprochementde deux champs de recherche : Richard Swedberg, un des principaux spécialistes de la nouvellesociologie économique (NSE) et Trevor Pinch, figure importante de la sociologie des sciences etdes techniques (STS) sont ici associés et proposent une combinaison problématisée de recherchestraitant la question suivante : « What roles do technology and materiality play in [. . .] differenttypes of the economic process ? » (p. 9).
Les contributions assemblées empruntent aux deux traditions et profitent des multiples ensei-gnements attribuables à l’une et l’autre ainsi qu’à leur rencontre : la NSE a bien montré à quelpoint l’économie et le marché ne devaient pas être laissés aux seuls économistes ; la STS, dans lalignée des injonctions séminales de Bruno Latour, a permis de repenser la nature des liens entrel’économie et le social1. Dès lors, et c’est tout l’intérêt de cette rencontre, la dimension socialedes marchés n’est plus seulement limitée à des réseaux composés exclusivement d’humains danslesquelles viendraient s’encastrer l’économie. À l’inverse, les actions économiques sous-tendentla création de collectifs hybrides, composés d’humains, d’objets et d’instruments devant être sai-sis dans leur matérialité. Ainsi, « the market [. . .] is not just some abstract structure of socialrelations or an institution consisting of rules and regulations; it also involves material objects,be it in the form of balances, coins, tickers, telephones, or computers » (p. 9).
Cette rencontre a notamment été initiée, dès le début des années 1990, par Michel Callon etquelques chercheurs associés plus ou moins directement au Centre de sociologie de l’innovation.Ce livre s’inscrit intuitivement dans la directe lignée des ouvrages The Law of the markets publiéen 2000, Market Devices en 2007 ou encore du numéro de 2003 que la revue Réseaux consacreaux « Technologies de marché », en opérant plus spécifiquement une focale sur la matérialitédes instruments et des technologies impliqués dans les collectifs économiques. L’introduction del’ouvrage resitue les enjeux, introduit les concepts issus des deux champs de recherche mobi-lisés (actor network, sociotechnical ensemble, embeddedness. . .) et assure une heuristique à ladémarche collective qui facilite largement la lecture. Elle présente, en outre, les différentes contri-butions et les distribue en quatre parties composées, chacune, de trois chapitres : la premièred’entre-elles discute le cadre de pensée partagé, en éclaire les soubassements théoriques les plusanciens et méconnus (Richard Swedberg), en identifie les enseignements du point de vue de lathéorie économique et de son principal ambassadeur, l’homo-oeconomicus (Michel Callon), voire
1 « Ce que la sociologie des sciences et des techniques avait montré pour les faits scientifiques dans les années 1980 (sansdispositifs matériels, pas de sciences) vaut désormais pour les faits marchands » (Callon, M., Licoppe, C, Muniesa, F.,2003, Présentation du numéro « Technologies de marché », Réseaux, p. 10).