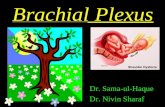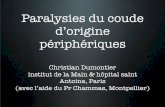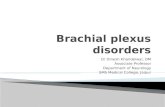L’arthrodèse de l’épaule améliore constamment la fonction du membre dans les paralysies...
Transcript of L’arthrodèse de l’épaule améliore constamment la fonction du membre dans les paralysies...

Revue de chirurgie orthopédique © Masson, Paris, 20062006, 92, 417-422
SÉLECTION DES ANALYSES DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA SOFCOTLa rubrique « Sélection des analyses du centre de documentation de la SOFCOT » propose le résumé analytique des articles jugésparticulièrement importants, regroupés par thèmes et répertoriés. L’ensemble des fiches d’analyse bibliographiques du Centre deDocumentation de la SOFCOT est diffusé sous forme numérique et peut facilement être consulté sur le CD-ROM archivant le contenu de laRCO, dont il est prévu une mise à jour annuelle, ainsi que sur Internet (Site SOFCOT) avec mise à jour mensuelle. Les membres du Centrede Documentation sont : J. Alain, J. Bedouelle, N. Biga, D. Chauveaux, L. de Leobardy, T. Defives, J. Dunoyer, J. Fenollosa, F. Fiorenza,C. Glorion, M. Guillaumat, P. Henky, A. Languepin, D. Moulies, J.-P. Padovani, J.-M. Postel, L. Rillardon, G. Taussig, R. Vialle, P. Wicart.
TUMEURS
78 familles = 172 cas de maladie exostosante = 10 sarcomespeut-être favorisés par une mutation
Cette étude prospective multicentrique de la maladie des exos-toses multiples héréditaires a été faite entre 1996 et 2000 sur172 cas dans 78 familles dans le but de connaître la relation entrela sévérité de la maladie et le risque de transformation sarcoma-teuse (chondro-sarcome). Elle a été couplée avec une étude desmutations géniques chez les patients affectés de la maladie.La sévérité a été graduée selon le nombre des exostoses, l’impor-tance des déformations, la fonction des articulations du coude,du genou, de l’avant-bras, la taille, en plus des autresparamètres : âge, sexe, nombre d’opérations chirurgicales.L’étude génétique est détaillée dans l’article, précisant la recher-che des mutations géniques EXT 1 et EXT 2 les plus souventrencontrées dans l’affection. Ces mutations EXT correspondentsoit à une perte de la fonction du gène, de beaucoup la plusfréquente puisqu’elles sont retrouvées dans 50 familles sur les61 chez qui la mutation a été décelée, soit à la substitution d’unamino-acide par un autre (missense) dans 11 familles. 71 individus avaient une mutation EXT 1 (34 familles) et 72 unemutation EXT 2 (27 familles). Chez 29 individus, dans17 familles, il n’a pas été possible de déceler de mutation. Lamutation EXT 1 s’accompagne d’une sévérité plus grande de lamaladie : taille plus petite, déformations plus importantes.Le nombre des exostoses (de 0 à 172) n’est pas très différentselon le type de mutation ; ce nombre est un peu plus grand dansle sexe masculin (27 en moyenne contre 22 chez la femme) etentraîne davantage de troubles. Leur nombre augmente avecl’âge. La perte de fonction liée à la mutation du gène EXT corre-spond peut-être à un gène suppresseur de tumeur.La dégénérescence sarcomateuse a été retrouvée 10 fois sur172 cas, dans 9 familles : 7 fois en cas de mutation EXT 1 - 6 caschez les patients examinés — soit 6 sur 71, et 1 cas familial (casdécédé) ; deux dégénérescences ont été trouvées en cas de muta-tion EXT 2 — chez un patient — soit 1 sur 72 — et un cas famil-ial. Les deux derniers cas ont été trouvés quand aucune mutationn’a pu être décelée : un patient et un cas familial. La transforma-tion maligne ne touche pas forcément les patients les plus atteints.La différence de fréquence du sarcome entre les patients quiprésentent une mutation EXT 1 et ceux de type EXT 2 pourrait
justifier un dépistage systématique chez les sujets porteurs de lamaladie exostosante surtout ceux de type EXT 1, ce qui pose desproblèmes pratiques : faut-il faire un examen annuel ? Faut-ilfaire des radiographies en connaissant le risque de cancers radio-induits ? Faut-il faire simplement un examen clinique, ensachant que la dégénérescence survient surtout sur des exostosesprofondes, du pelvis, des ceintures et de la racine des membres,du rachis (80 % surviennent sur le système osseux axial) ? Dansleur série, on note 2 rachis, 2 scapula, 3 pelvis, 1 humérus proxi-mal, 1 fémur, 1 côte.Les auteurs concluent que le dépistage systématique serait sou-haitable dans les cas de maladie exostosante en associant l’exa-men clinique et une imagerie sans émission de R.X.Severity of disease and risk of malignant change heredirary multi-ple exostoses: a genotype- phenotype study
D.E. PORTER, L. LONIE, C. DOBSON-STONE, J.R. PORTER,A.P. MONACO, A.H. SIMPSON
J Bone Joint Surg (Br), 2004, 86, 1041-1046.
MEMBRE SUPÉRIEUR
L’arthrodèse de l’épaule améliore constamment la fonction dumembre dans les paralysies supérieures ou totales du plexusbrachial
L’équipe de Montpellier (Y. Allieu) rapporte son expérience surle devenir fonctionnel après arthrodèse gléno-humérale pourséquelles de traumatisme du plexus brachial chez l’adulte avecun recul moyen de 70 mois. Cette étude comporte une comparai-son entre deux groupes : 11 patients avec paralysie haute avecmain fonctionnelle (groupe A) et 16 patients avec paralysietotale avec main en fléau (groupe B).Entre 1978 et 1998, 29 cas ont ainsi été traités, mais 1 patient estperdu de vue et 1 est décédé. Il reste donc 27 patients,25 hommes et 2 femmes, d’un âge moyen 25 ans (17 à 37). Dixatteintes droites et 17 gauches, 11 atteintes du côté dominant.Les 27 patients avaient tous recouvré une flexion active du coudecontre résistance avant la fusion de l’épaule ; 1 par récupérationspontanée, 20 après réparation nerveuse seule, 3 après réparationnerveuse + transfert tendineux, 3 après transfert libre du gracilis.

418 SÉLECTION DES ANALYSES DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA SOFCOT
Au niveau de l’épaule, il existait une force à 4 ou 5 du chefsupérieur du trapèze chez 21 patients, du serratus antérieur chez25 patients et une force à 3 ou plus du faisceau supérieur dugrand pectoral chez 6 et du chef inférieur du grand pectoralchez 17.Dix-neuf patients avaient des douleurs de désafférentation plus oumoins intenses et 9 avaient des douleurs liées à une subluxationde l’épaule. Enfin, sur le plan fonctionnel, 22 ne pouvaient uti-liser leur membre supérieur et 12 avaient le bras en bandoulière. Les indications pour l’arthrodèse étaient l’instabilité de l’épauleet l’impossibilité d’utilisation du membre supérieur. Le délaimoyen entre traumatisme et arthrodèse a été de 30 mois.Sur le plan technique : toujours voie d’abord postérieure, fixa-tion par vis + plâtre dans 6 cas, vis + fixateur externe dans21 cas. Les repères de positionnement et l’évaluation fonction-nelle sont détaillés.Avec un recul moyen de70 mois, toutes les arthrodèses sont con-solidées. La position est la même pour les deux groupes enabduction (20 à 25), en flexion ( 27 à 31), mais la rotation interneest plus faible dans le groupe A (14 vs 28).Des complications sont notées chez 6 patients : 2 pseudarthrosesreprises par greffe, 3 fractures humérales hautes sous l’arthro-dèse et 1 infection sur broche.L’arthrodèse n’a pas d’action sur les douleurs de déafférentation,mais est efficace sur les douleurs de subluxation. Elle a entraînéune amélioration de la force de flexion du coude dans tous les cas.Les deux groupes ont bénéficié d’une amélioration fonctionnelledétaillée dans le texte, même en présence d’une paralysie totalede la main, où tous les opérés, sauf 1, ont gardé leur possibilitéde pince thoracobrachiale. La force du grand pectoral est un fac-teur pronostic essentiel en termes « d’excursion » de la main etde force de l’épaule. Dix-neuf sur 27 peuvent dormir sur le côtéopéré.En termes de satisfaction, 26 patients sur 27 signalent uneamélioration et la satisfaction est élevée chez 9 sur 11 du groupeA et 5 sur 16 du groupe B.Conclusion : l’arthrodèse de l’épaule améliore la fonction chezles patients qui ont recouvré une force active du coude aprèsparalysie traumatique du plexus brachial, même quand la mainreste paralysée. La force du grand pectoral est le facteur le plusdéterminant pour l’excursion de la main et la force de l’épaule. Dans les atteintes totales, la réinnervation de ce muscle aumoment de la phase de réparation nerveuse doit être envisagéedans l’idée d’améliorer la future fonction après arthrodèse del’épaule.Glenohumeral arthrodesis in upper and total brachial plexuspalsyM. CHAMMAS, J.N. GOUBIER, Y. ALLIEU
J Bone Joint Surg (Br), 2004, 86, 692-695.
Après fracture Salter II du radius distal, un remodelageanatomique est observé 5 fois sur 6 et constant avant 10 ansd’âge
C’est une étude rétrospective.Les auteurs danois rapportent les résultats de 85 fractures Salter IIdu radius distal chez des enfants âgés de 4 à 15 ans (55 garçons,30 filles). Les mobilités du poignet et la force ont été mesuréesau recul moyen de 8,5 ans (2,5 à 15 ans). L’orientation de la
glène radiale de face et de profil et la translation de l’épiphyseont été mesurées sur les radiographies initiales puis sur les cli-chés réalisés au plus long recul avec des clichés comparatifs. Lespatients étaient répartis en 3 classes d’âge : 1 à 5 ans (3), 6 à10 ans (31) et 11 à 15 ans (51).Soixante-trois fractures ont été réduites, 7 se sont déplacées sec-ondairement sous plâtre. Deux ont été à nouveau réduites.L’angulation résiduelle moyenne à la fin de l’immobilisationétait de 10 (2 à 22). Vingt-deux fractures ont été simplementimmobilisées par plâtre avec une angulation moyenne de 9 (2 à20). L’immobilisation a varié de 4 à 5 semaines. Cinquante-troispatients (62 %) présentaient une fracture associée de l’ulna dis-tale et/ou du carpe homolatéraux dont 28 fractures de la styloïde.Au recul, 73 patients (86 %) présentaient un remodelageanatomique. Les 12 patients restants présentaient un cal vicieuxen inclinaison palmaire et/ou radiale. Tous les patients de moinsde 10 ans, sauf 1, ont présenté un remodelage anatomique.Aucune épiphysiodèse n’a été observée. Huit styloïdes ulnairesprésentaient une pseudarthrose au recul. Les mobilités et la forceétaient normales chez tous les patients. Quatre patients se plaig-naient de douleurs : 2 avaient un cal vicieux, 1 avait une pseudar-throse de la styloïde ulnaire et le dernier ne présentait aucuneanomalie radiographique.Le potentiel de remodelage après ce type de fracture est plusimportant chez les enfants de moins de 10 ans. La réductionn’est pas nécessaire pour une bascule jusqu’à 20 ou une transla-tion jusqu’à 40 %. Le remodelage incomplet est sans con-séquence à long terme sur la mobilité et la force du poignet.Commentaire : la capacité de remodelage de la physe inférieuredu radius est importante. Cela autorise une tolérance sur lesdéplacements résiduels ou secondaires, d’autant que l’enfant estjeune, âgé de moins de 10 ans. Il ne faut pas en tirer la conclu-sion exclusive qu’un décollement épiphysaire inférieur du radiusne justifie pas une réduction.Remodeling of Salter-Harris type II epiphyseal plate injury ofthe distal radiusS. HOUSHIAN, A.K. HOLST, M.S. LARSEN, T. TORFING
J Pediat Orthop, 2004, 24, 472-476.
1800 prothèses MP de Swanson pour PR : une expérience de23 ans. Beaucoup de fractures d’implant mais surviefonctionnelle et utilité confirmées
En 23 ans, 565 patients atteints de polyarthrite rhumatismale onteu une arthroplastie métacarpo-phalangienne soit 1 800 implantsselon la technique de Swanson à l’hôpital de Wrightington. Pourcette étude, les auteurs en ont retenu 381 sur une durée de 17 ansaprès élimination de 184 : perdus de vue, décédés, avec un dos-sier incomplet ou un recul trop court. Ces 381 opérés(64 hommes et 317 femmes de 29 à 92 ans, 58,7 ans en moy-enne) totalisent 404 opérations et 1 336 implants.Les auteurs s’intéressent au devenir de la prothèse en silastic deSwanson : elle est étudiée par l’évaluation radiologique et aussi àl’examen des pièces enlevées au cours de réinterventions.La prothèse est considérée comme cassée si la déviation ulnaireest supérieure à 45, s’il y a une translation importante (plus de lamoitié) de la base de P l par rapport au col du métatarsien dans leplan coronal ou sagittal, s’il y a un chevauchement entre la basede la phalange et le col du méta, une ligne de fragmentation à lapartie moyenne de l’implant.