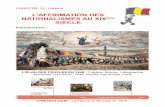L’affirmation des nationalismes L’unité italienne · • Notions : nation / nationalisme ......
Transcript of L’affirmation des nationalismes L’unité italienne · • Notions : nation / nationalisme ......
L’affirmation des nationalismes L’unité italienne
F. Sudi-Guiral – Groupe collège
Académie de Clermont-Ferrand - mars 2011
1ère heure
Le Vittoriano (histoire des arts)
Que symbolise ce monument ?
• Notions : patrie – monument national
• Connaissances :
- quelques éléments caractéristiques du style néoclassique.
• Capacités :
- identifier la nature de l’œuvre
- situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique
- décrire l’œuvre et en expliquer le sens
- distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art
• Compétences :
- avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique (C5)
- situer dans le temps des œuvres artistiques (C5)
- être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre (C5)
1- Présentation de l’édifice mise en contexte par le professeur • Localisation : au centre de Rome, près du Forum et du Capitole.
• Date : réalisé en plusieurs étapes entre 1885 et 1921 sur le projet de l’architecte G. Sacconi. Inauguré dès 1911.
• Fonction : monument initialement prévu à la mémoire d’un souverain italien : Victor-
Emmanuel II. Depuis 1921, abrite la tombe du soldat inconnu italien.
Un édifice particulièrement important
Forum Capitole
2- Lecture et description de l’édifice par les élèves.
Le Vittoriano au début des années 1920
• Des dimensions imposantes (135 m de large, 70 de haut)
• Une architecture complexe et démonstrative (pierre calcaire blanche, construction ascendante, façade surchargée …)
• L’importance des éléments sculptés
• La référence à l’Antiquité (colonnes, frontons, escaliers…)
style néoclassique
Un édifice remarquable
Quelle en est la signification ?
3- Analyse de détail au moyen de différentes vues signification
La statue équestre de Victor-Emmanuel II, installée au centre de l’édifice, de taille colossale (10 m de haut, 50 tonnes).
Un monument à la gloire du premier roi d’Italie (1861-1878).
Des éléments sculptés qui figurent l’Italie dans ses principales composantes : les régions, les villes …
… et les mers qui entourent la péninsule Une géographie symbolique.
La mer Tyrrhénienne La mer Adriatique
Le Vittoriano : une géographie symbolique … (éléments de trace écrite)
Statue équestre du roi Victor-Emmanuel II
Statues représentant les 16 régions italiennes
Statues figurant les 14 villes-capitales de l’Italie
La mer Tyrrhénienne
La mer Adriatique
Rome
Des hauts-reliefs représentant le travail et l’amour de la patrie encadrent la statue de la déesse Rome.
… et les valeurs de l’Italie. (éléments de trace écrite)
L’unité La liberté
L’amour de la patrie
Le travail
Synthèse :
Le Vittoriano est un édifice construit au centre de
Rome à la fin du XIXème siècle. Ce monument de style néoclassique fut élevé à la mémoire de Victor-Emmanuel II, premier roi d’Italie. Son architecture et sa décoration en font un symbole de la nation italienne, unie et libre.
Conclusion de la 1ère heure : observation de la carte de l’Italie en 1850
En 1850, l’Italie ne constitue pas encore un État.
Quels événements ont conduit à la formation de ce pays ?
Questions - Combien d’États trouve-t-on dans la péninsule à cette date ?
- Quelle puissance étrangère possède des territoires et exerce son influence dans la péninsule ?
2ème heure
La construction de l’Italie :
des revendications nationales à l’État-nation.
Comment est né le royaume d’Italie ? • Notions : nation / nationalisme – Risorgimento
• Connaissances :
- étapes et acteurs de la réalisation de l’unité italienne
• Capacités :
- connaître et utiliser des repères chronologiques (1861 : création du royaume d’Italie)
- décrire et expliquer les conséquences des revendications nationales au cours du XIXe siècle
• Compétences :
- avoir des connaissances et des repères dans le temps (C5)
- dégager l’essentiel d’un texte lu (C1)
- rédiger un texte bref, cohérent et ponctué en réponse à une question ou à partir de consignes données (C1)
1- Le projet national étude de texte
« Nous sommes un peuple de 21 à 22 millions d’habitants désignés depuis un temps immémorial sous un même nom – celui de peuple italien, contenu entre les limites naturelles les plus précises que Dieu ait jamais tracées, la mer et les montagnes les plus hautes d’Europe, parlant la même langue, ayant les mêmes croyances, les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, fiers du plus glorieux passé politique, scientifique, artistique, qui soit connu dans l’histoire européenne.
Nous n’avons pas de drapeau, pas de nom politique, pas de rangs parmi les nations européennes. Nous n’avons pas de capitale, pas de Constitution, pas de marché commun. Nous sommes divisés en huit États indépendants, n’ayant contracté aucune alliance ou liens particuliers. Un de ces États, comprenant à peu près le quart de la péninsule, appartient à l’Autriche ; les autres, quelques-uns par des liens de famille, tous par leur sentiment de faiblesse, en subissent aveuglément l’influence. »
D’après G. Mazzini, Revue indépendante, 1845.
Giuseppe Mazzini (1805-1872), patriote et révolutionnaire italien, fondateur de l’organisation « Jeune Italie ».
- Quelle est la situation territoriale de
l’Italie en 1845 ? Expliquez l’expression « limites naturelles ».
- Pourquoi Mazzini considère-t-il que les Italiens forment une nation ?
- D’après ce document, que souhaitent les patriotes italiens?
2- La réalisation de l’unité récit du professeur à partir de cartes et documents vidéo projetés : les principales étapes de la formation du royaume d’Italie des années 1850 à 1870.
Carte
Le rôle décisif du Piémont-Sardaigne.
Victor-Emmanuel II Cavour
(1820-1878) (1810-1861)
Le roi de Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel II et son premier ministre Cavour soutiennent l’idée de l’unification territoriale.
Dans ce but, ils modernisent le royaume et recherchent des alliés. Napoléon III, empereur des Français, accepte d’aider le Piémont à combattre l’Autriche.
Napoléon III
(1808-1873)
La guerre contre l’Autriche.
En 1859, l’armée franco-piémontaise bat les Autrichiens à Magenta et
Solferino.
C. Bossoli, La bataille de Solferino.
L’Autriche doit céder la Lombardie au Piémont.
Pour son soutien militaire, la France reçoit le comté de Nice et la Savoie.
Le rattachement des États d’Italie centrale.
Le succès du Piémont provoque des soulèvements patriotiques dans les Etats d’Italie centrale.
Leurs souverains, liés aux Habsbourg, doivent quitter le pouvoir. Les populations ratifient leur rattachement au Piémont par plébiscite.
La conquête du Sud et la proclamation du royaume d’Italie.
De mai à octobre 1860, Garibaldi et ses mille « Chemises rouges » quittent Gênes, débarquent en Sicile et font la conquête du Sud de la péninsule.
Ils sont rejoints par des troupes piémontaises et se rallient à Victor-Emmanuel II.
En mars 1861, celui-ci est proclamé roi d’Italie par le premier parlement national.
G. Garibaldi
(1807-1882)
L’achèvement de l’unité territoriale.
En 1866, l’Italie s’engage avec la Prusse dans une guerre contre l’Autriche. La défaite de cette dernière lui permet d’obtenir la Vénétie.
En 1870, après avoir occupé l’État pontifical, les troupes italiennes entrent dans Rome.
La ville devient la capitale de l’Italie.
La breccia di Porta Pia
3- Exercice élève production d’un texte (méthodologie vue en classe,
rédaction donnée en exercice à la maison).
En 12 à 15 lignes, raconte et explique comment s’est réalisée l’unité italienne.
Avant de rédiger ton texte, complète le tableau suivant. Les éléments de réponse apportés doivent servir de base à ton récit.
Un récit historique …
- repose sur un questionnement qui donne sens au récit
Comment l’Italie est-elle parvenue à réaliser son unité ?
- est situé dans le temps (dates) Une période : les années 1859-1870 1861 : naissance du royaume d’Italie
- est situé dans l’espace (lieux) Le Piémont-Sardaigne, la Lombardie, le Royaume des Deux-Siciles, la Vénétie, Rome, …
- comporte des acteurs individuels/collectifs, concrets/abstraits
Victor-Emmanuel II, Cavour, Garibaldi, le royaume de Piémont-Sardaigne, les patriotes italiens…. Mais aussi l’Autriche-Hongrie et la France de Napoléon III.
- explique des faits (motifs / intentions) Les Italiens aspirent à constituer une nation. Ils rejettent la domination autrichienne. Ils bénéficient d’appuis extérieurs : la France, la Prusse.
- envisage les conséquences à court/long terme de ce qui est raconté
Création d’un nouvel État européen.
3ème heure
De l’exemple italien à la nouvelle carte de l’Europe.
En quoi la formation de l’État italien est-elle représentative des évolutions politiques de l’Europe du XIXe siècle ?
• Notions : État-nation / État multinational / minorité nationale
• Connaissances :
- carte de l’Europe en 1848 et 1914.
• Capacités :
- situer sur une carte les principales puissances européennes à la fin du XIXe siècle.
- décrire et expliquer les conséquences des revendications nationales au cours du XIXe siècle.
• Compétences :
- avoir des connaissances et des repères dans le temps et dans l’espace (C5)
- lire et employer différents langages : textes / cartes (C5)
Reprise : correction et mise en commun du récit produit sur l’unité italienne.
1- La création des États-nations bouleverse la carte de l’Europe… étude comparée de deux cartes Questions : 1) Liste les États qui ont été créés entre 1848 et 1914. 2) À l’image de l’Italie, quel autre État s’est unifié durant cette période ? 3) Quel espace, à l’inverse, s’est fractionné ? 4) En prenant appui sur l’exemple italien, comment peut-on expliquer ces modifications territoriales ? 5) En 1914, tous les peuples européens correspondent-ils à des États ? Justifie ta réponse.
L’Europe en 1848 L’Europe en 1914
2- … et génère des tensions mettre en relation cartes et texte
Doc. 1 : Carte des terres irrédentes(1914)
« En nous choisissant, nos électeurs ont avant tout voulu affirmer leur sympathie pour leur patrie française et leur droit à disposer d’eux-mêmes. Il nous sera impossible de voir en vous des frères tant que vous refuserez de nous rendre à la France, à notre véritable famille. (…) Que récolte l’Allemagne aujourd’hui ? Toutes les nations de l’Europe se défient de sa puissance envahissante et multiplient les armements. Au lieu de cette ère de paix et de fraternité que vous étiez maîtres d’inaugurer en 1871, vous entrevoyez, avec le même effroi que nous, de nouvelles guerres. »
E. Teutsch, 18 février 1874.
Doc. 2 : Protestation d’un député alsacien au Reichstag , parlement allemand, contre l’annexion de l’Alsace .
Questions
Doc. 1
Qu’appelle-t-on « les terres irrédentes »? Où sont-elles situées ?
Doc. 2 (+ en appui : carte de l’Europe en 1914 )
Présente ce document (auteur, contexte, sujet).
Quelle est la situation de l’Alsace-Lorraine depuis 1871 ?
Doc. 1 et 2 et carte du manuel faisant apparaître les systèmes d’alliances en 1914
Quel type de problème dans les relations entre États les documents 1 et 2
illustrent-ils ?
Selon le député alsacien, quels risques cela fait-il courir à l’Europe ?
Comment les États se préparent-ils à y répondre ?
Conclusion
Rédige quelques lignes résumant la situation politique de l’Europe en 1914.
Evaluation envisagée
Exercice 1 : Rédaction d’un texte explicatif. (C1 : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué en réponse à une question ou à partir de consignes données)
Cette photo montre le Vittoriano.
Rédige un texte de 12 à 15 lignes pour présenter ce monument et en expliquer la symbolique.
« Nous n’avons d’autre but que de rendre
l’Italie aux Italiens, de fonder d’une manière durable et réelle l’indépendance de la péninsule, de la délivrer de toute sujétion. Nous n’avons cédé la Savoie et Nice que parce que nous sommes convaincus que ces pays ne font pas partie de la nationalité italienne (…). Je le répète, je suis italien avant tout (…). J’ai entrepris la lourde tâche de chasser l’Autriche de l’Italie, sans y substituer la domination d’aucune autre puissance. Le Piémont est le seul État qui ait pu demeurer indépendant de l’Autriche : c’est le seul contrepoids à son influence envahissante (…). Si Garibaldi réussit, si la grande majorité des Siciliens se réunit autour de lui, nous ne demandons pour eux que la pleine liberté de décider de leur sort (…). »
Lettre de Cavour à l’ambassadeur du roi du Piémont à Londres, 8 mai 1860.
1- Présente l’auteur de ce document.
2- Quel est, d’après ce texte, l’objectif qu’il poursuit ?
3- Pourquoi envisage-t-il de « chasser l’Autriche de l’Italie »?
4- Quel État doit pour cela jouer un rôle essentiel ?
5- A quels épisodes de la construction de l’unité italienne est-il fait référence ici ?
Exercice 2 : Compréhension d’un texte. (C1 : dégager l’essentiel d’un texte lu + C5 : avoir des repères dans le temps)
Exercice 3 : Carte de l’Europe en 1914 (C5 : avoir des repères dans le temps et dans l’espace)
1- Sur la carte ci-contre, place les principaux États : le Royaume-Uni, la France, l’Empire allemand, l’Italie, l’Empire d’Autriche-Hongrie, l’Empire russe, l’Empire ottoman.
2- Souligne en vert le nom des États qui ont réalisé leur unité entre 1848 et 1914.
3- Hachure en rouge un territoire qui est contesté entre deux États et nomme-le.
4- Cite le nom d’un État-multinational et définis ce terme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Cite le nom d’une minorité nationale et définis ce terme :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dictionnaire du XIXe siècle européen, dir. M. Ambrière, PUF, Paris, 2007.
Gilles Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine (1770-1922), Nathan, Paris, 1997.
Gilles Pécout, Cavour, Fayard, 2011 (à paraître).
Pierre Milza, Histoire de l’Italie des origines à nos jours, Fayard, 2005.
L’Italie, 150 ans d’une nation, les collections de l’Histoire, janv.-mars 2011.
Christian Sorrel, « Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises », L’Histoire, 35, mars 2010.
Bibliographie indicative