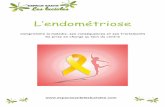L’endométriose en IRM : le pouvoir de · UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A....
Transcript of L’endométriose en IRM : le pouvoir de · UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A....

L’endométriose en IRM : le pouvoir de
l’attitude et des mots du manipulateur
d’électroradiologie médicale
Mémoire de fin d’étude par Khadidja ZENATI
Promotion E.A. CABANIS 2013/2016
Tuteur de recherche : Jean Christophe VOISEUX

L’endométriose en IRM : le pouvoir de
l’attitude et des mots du manipulateur
d’électroradiologie médical
Mémoire de fin d’étude par Khadidja ZENATI
Promotion E.A. CABANIS 2013/2016
Tuteur de recherche : Jean Christophe VOISEUX
Référente pédagogique : Laurence MAZURIER

Sommaire
I. Introduction ................................................................................................................................ 1
II. Cadre de l’étude ......................................................................................................................... 2
1. Description de la situation d’appel. .................................................................................................... 2
2. Pré-enquête exploratoire. ................................................................................................................... 2
3. Problématique : ................................................................................................................................... 3
4. Hypothèse : ......................................................................................................................................... 4
III. L’endométriose........................................................................................................................... 4
1. Définition ............................................................................................................................................. 4
2. Etiologie ............................................................................................................................................... 5
3. Signes cliniques ................................................................................................................................... 5
4. Profil des patientes ............................................................................................................................. 5
5. La place de l’IRM ................................................................................................................................. 6
IV. Cadre théorique .......................................................................................................................... 7
1. Respect et dignité du patient (article L1110-2 du CSP) ....................................................................... 7
2. Information au patient (article L1111-2 du CSP) ................................................................................. 7
3. Droit de refuser (article L1111-4 du CSP) ............................................................................................ 8
V. Cadre de référence .................................................................................................................... 10
1. Le stress ............................................................................................................................................. 10
2. La relation de confiance soignant/soigné ......................................................................................... 13
3. Les mots ............................................................................................................................................ 15
4. L’attitude (le non verbal) ................................................................................................................... 19
VI. Enquête ..................................................................................................................................... 21
1. Présentation ...................................................................................................................................... 21
2. Analyse .............................................................................................................................................. 23
3. Conclusion ......................................................................................................................................... 24
VII. Conclusion ................................................................................................................................ 26
VIII.Annexe ..................................................................................................................................... 27
IX. Bibliographie. ........................................................................................................................... 28

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 1
I. Introduction
Actuellement en troisième année à l’Institut de formation de manipulateur d’électroradiologie
médical de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, nous devons effectuer un travail de fin d’étude dont
nous avons choisis le sujet au courant de la deuxième année. Notre idée principale était la prise en
charge des patients en Imagerie par Résonnance Magnétique (I.R.M.). Cette technique particulière
dans notre métier nécessite de nombreuses vérifications et impose un stress aussi bien aux patients
qu’aux manipulateurs d’électroradiologie médicale. Nous nous sommes posé la question de savoir
si le professionnel de santé peut être le moteur du développement d’un stress pour le patient dans
le cadre de sa prise en charge. Au fur et à mesure des stages, une pathologie particulière est
ressortie de par sa technique de réalisation plus intrusive, l’endométriose. Elle a donc attiré notre
attention et a été choisi pour sa complexité. Finalement, ce sujet qui porte sur la communication
entre le professionnel de santé et le patient, permettra de trouver une solution de prise en charge la
plus efficace pour imposer un minimum de stress supplémentaire aux patients. Il permettra à la
profession de se rendre compte de la priorité a accordé lors de la prise en charge de patientes
stresser avec un contexte particulier.
Pour cela nous verrons dans un premier temps le cadre de l’étude pour poser les raisons de notre
choix de ce sujet. Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur la pathologie de
l’endométriose et son contexte particulier, puis nous verrons le cadre théorique qui explicitera les
principaux textes qui influenceront notre étude, dans un troisième temps. S’en suivra le cadre de
référence qui éclaircira des points importants à la résolution de notre problématique qui sera
complété par une enquête qui nous permettra de nous appuyer sur ce qui se passe réellement dans
les structures hospitalières. Nous terminerons par une synthèse des résultats de notre étude.

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 2
II. Cadre de l’étude
1. Description de la situation d’appel.
Étudiante en troisième année à l'institut de formation de manipulateur d’électroradiologie
médicale (IFMEM) de Poissy Saint Germain, j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage d'I.R.M. à
l'Hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart, en Mars 2015. Durant ce stage, la prise en
charge des patients m'a beaucoup intéressée et questionnée. Les patients se présentaient en IRM
souvent stressés pour toutes sortes de raisons telles que la peur de l’inconnu ou simplement le
stress du résultat de l’examen. De ce fait, lors de la prise en charge du patient dans la cabine, il
existait déjà une appréhension que je pouvais ressentir à travers des questions posées avant même
d’arriver en cabine comme « Que dois-je retirer comme vêtements ? », avant même d’arriver en
cabine. Cette appréhension augmentait très souvent au fur et à mesure que j’expliquais les
consignes et que je donnais des informations sur l’examen.
Les procédures imposent la vérification de nombreuses contre-indications avec le patient en
cabine. Ils ne comprenaient pas la nécessité de ces questions ce qui ajoutait un stress
supplémentaire. Ils me demandaient : « pourquoi voulez-vous que j’ai eu une intervention au
cœur ? », « pourquoi autant de questions ? » ou bien ils pouvaient être plus expressifs sur leur
appréhension : « j’ai très peur », « je n’aime pas du tout cet examen », « vos questions
m’inquiète ». Un autre exemple équivoque, c’est lorsqu’il faut expliquer l’utilité de la poire
d’appel. Ce moment est très générateur de stress car les patients exprimaient leur inquiétude en
m’expliquant : « pourquoi aurais-je besoin de vous appeler », « qu’elle genre de problème puis-je
avoir ? ». Nous pouvons ajouter à tout cela la pose du cathéter pour certains examens,
l’explication sur le bruit de la machine et les instructions à suivre durant les examens.
Suite à toutes ces impressions et tous ces constats, plusieurs questions se posent, quelle
information doit donner le manipulateur aux patients durant leur prise en charge d’un patient ?
Est-ce que le manipulateur le fait au bon moment ? Y a-t-il des éléments dans l'attitude du
manipulateur avec le patient qui encouragent ce stress ? Y a-t-il une méthodologie de prise en
charge du patient en IRM qui permettrait d'optimiser cette prise en charge ?
2. Pré-enquête exploratoire.
Entretiens et revue de littérature
Suite à ces questionnements, je me suis entretenue tout d'abord avec Madame BASSALI, le 08
Juin 2015. Cadre formatrice à l'IFMEM de Poissy Saint Germain, elle m'a conseillée de me diriger
vers la méthodologie de prise en charge du patient. Nous avons listé ensemble une multitude de
problèmes pouvant obliger le manipulateur à inquiéter d’avantage le patient lors de sa prise en

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 3
charge. En effet, nous avons dégagé de cet entretien que l'une des alternatives est de donner
l'information au bon moment au fur et à mesure de sa prise en charge sans charger le patient d'un
surplus de consigne dès son arrivée. Ce sujet de recherche lui a semblé intéressant et utile pour la
profession de manipulateur d'électroradiologie médical.
J'ai questionné Monsieur TEIXEIRA le 17 Juin 2015, faisant fonction de cadre formateur à
l'IFMEM de Poissy Saint Germain. Ayant exposé ce sujet par e-mail, il en est ressorti que celui ci
pouvait aboutir à deux sortes de questionnements. Un premier questionnement vis à vis de la
communication du manipulateur avec le patient. Un second vis à vis de la technique de prise en
charge, c'est à dire la manière dont les services s'organisent pour la prise en charge du patient en
IRM. En effet la communication ne passe pas seulement par la parole mais également par
l’attitude qu’aura le manipulateur envers le patient et c’est là que beaucoup de facteurs entrent en
compte : le stress du manipulateur, son expérience, sa vie personnelle qui influe sur son attitude au
travail, etc… De plus, selon les hôpitaux les prises en charge ne sont pas toutes les mêmes pour un
même examen. Le manipulateur est donc contraint à ces changements de protocoles peuvant
générer un stress du manipulateur qu’il transmettra involontairement au patient.
3. Problématique :
Lors d’un second stage d’I.R.M. à la clinique privée de Parly II au Chesnay, une vacation
gynécologique avait lieu tous les jeudi matins. Des jeunes femmes susceptibles d’être atteintes
d’endométriose venaient passer une I.R.M. La recherche de cette pathologie nécessite beaucoup de
préparation, notamment une injection de produit de contraste au gadolinium et un balisage du
vagin et du rectum avec du gel d’échographie stérile. Chaque patiente appréhendait l’examen à sa
manière et le stress était vraiment difficile à gérer pour certaines. Beaucoup de questions
revenaient souvent surtout vis-à-vis du balisage : « suis-je obligé ? », « pourquoi est-il nécessaire
de faire ça ? ». C’est pour cette raison que la prise en charge est très importante quant au contexte
et aux contraintes de cette procédure. L’étude de cette pathologie réunie une multitude de
contraintes qu’un MERM peut rencontrer en I.R.M. ce qui permettra d’englober la grande majorité
des contres indications et des difficultés auxquels il peut faire face.
Ma question de recherche est :
Dans quelle mesure la méthode de prise en charge (la communication) du manipulateur
d’électroradiologie médical en IRM réduit le stress des patientes lors d’une recherche
d’endométriose ?

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 4
4. Hypothèse :
La communication passe par l’expression orale, verbale et par le non verbal. La méthode de prise
en charge et la façon de communiquer du MERM avant une IRM peut être un moyen d’influencer
de façon positive le stress du patient.
L’aspect psychologique des patients est, parfois, dans un premier temps mis de côté. L’équipe
médicale et paramédicale reste concentrée sur son travail d’un point de vue technique. En effet, la
radiologie se base sur des images, nous attendons du MERM de faire des examens qui permettent
un diagnostic, le médecin attend donc une certaine qualité d’image et de préparation physique.
Mais pour obtenir l’image nécessaire, beaucoup de facteurs entrent en compte en I.R.M. C’est
pourquoi l’entretien en cabine est l’étape clé pour obtenir la confiance du patient et donc capter
son attention lors des séquences nécessitant sa collaboration.
Dans le cadre de la recherche d’endométriose, les patientes sont généralement des jeunes femmes
en âge de procréer. Il est donc possible que cet examen puisse être leur premier contact avec la
maladie. De plus, l’endométriose peut dans certains cas s’accompagner de problème de fertilité.
L’état psychologique des patientes est à prendre en compte. Elles sont conscientes que les résultats
seront une réponse à un certain nombre de problèmes qu’elles tentent de résoudre depuis quelques
mois voir quelques années. Elles arrivent alors avec un stress important.
L’hypothèse que j’ai décidé d’émettre est la suivante :
L’attitude et les mots utilisés par le MERM doivent être maitrisés et adaptés lors de la prise
en charge d’une patiente en I.R.M. dans le cadre de la recherche d’endométriose dans le but
d’installer une relation de confiance qui réduira son stress.
III. L’endométriose
1. Définition
D’après le CNGOF1 (collège national des gynécologues et obstétriciens français) :
« L’endométriose est définie comme la présence de tissu endométrial comportant à la fois des
glandes et du stroma en dehors de la cavité utérine […].
La présence de lésions histologiques n’est pas synonyme de l’existence d’une maladie clinique
[…].
L’aspect macroscopique des lésions est généralement évocateur […], mais un examen
histologique (pièce opératoire ou biopsie) est recommandé […]. Une histologie négative ne
1 Site référencé en bibliographie [1]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 5
permet pas d’exclure la maladie […].
Macroscopiquement, il est décrit trois formes d’endométriose externe : l’endométriose péritonéale
(ou ovarienne) superficielle, le kyste endométriosique de l’ovaire et l’endométriose sous-
péritonéale profonde […]. Il n’y a pas de données établissant que la physiopathologie et l’histoire
naturelle de ces lésions sont différentes.
En l’absence de définition validée de l’endométriose sous-péritonéale profonde, le groupe
retiendra pour la suite des recommandations celle de lésions d’endométriose qui infiltrent le
rétropéritoine ou bien les viscères (rectum, vagin, utérus, vessie, uretère, intestin grêle, etc.)
[…]. »
Autrement dit, l’endométriose se caractérise par la présence de tissus de l’endomètre en dehors de
sa situation habituelle. Les tissus peuvent migrer dans le myomètre (adénomyose), dans le pelvis
ou dans les viscères. De plus, c’est une maladie qui se caractérise par des symptômes cliniques
c’est pour cela que seule une manifestation physique de la maladie peut conclure à son diagnostic.
Cette maladie touche 1 à 2% de la population générale et plus particulièrement les femmes entre
30 et 40 ans.
2. Etiologie
L’étiologie reste encore aujourd’hui très vague. Mais, plusieurs suppositions ont été établie : les
reflux menstruels par les trompes, les stimuli par les tissus de l’endomètre, le déficit immunitaire
ou bien des facteurs génétiques. Nous ne rentrerons pas dans le détail de ces théories qui sont
toujours en discussion.
3. Signes cliniques
Deux grands types de signes cliniques peuvent aboutir à la recherche de l’endométriose : la
douleur pelvienne et les problèmes de fertilité.
Les douleurs pelviennes ont un caractère cyclique, la douleur varie d’une femme à une autre,
chacune la ressent à différentes intensités.
On peut ajouter à cela : dysménorrhée (retard de règles), dyspareunie (douleurs lors des rapports),
dysurie (difficulté à uriner), dyskésie (défécation douloureuse).
Lors d’une consultation pour infertilité, 19,6% des femmes sont diagnostiquées comme porteuses
d’une endométriose.
4. Profil des patientes
Les femmes de type caucasien ayant un niveau social et économique élevé sont souvent les plus

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 6
touchées.
Mais un revers important de la maladie a suscité beaucoup d’études. L’aspect psychologique des
patientes souffrantes d’endométriose a intéressé certains médecins et chercheurs. Ces études
rapportent que les femmes souffrant d’endométriose seraient plus anxieuses. Par exemple, un
groupe de 56 femmes infertiles, dont 38 ayant une endométriose et 18 une infertilité tubaire, ont
été soumis à des tests psychométriques. Les femmes présentant une endométriose ont montré des
niveaux plus élevés d'anxiété et une tendance à une plus grande préoccupation somatique.
D’autres expériences ont été effectuées sur des rates. Les résultats ont été publiés dans un journal
scientifique en Grande Bretagne le Reproductive Science, traitant de l’actualité obstétrique,
gynécologique et reproductive. Cette expérience a montré que l’endométriose des patientes s’est
aggravée lorsqu’elles ont été soumises à un stress.
J. Belaïsch et J.-P. Allard, deux médecin gynécologue, ont pu constater durant leurs recherches
que le niveau socioéconomique élevé et des premières grossesses tardives pouvaient constituer des
points de similitudes entre les femmes atteintes d’endométriose. Mais plus étonnant encore, ce
sont leurs constations dans l’article2 « endométriose et vécu de l’adolescence » qu’ils ont publié
dans la revue Gynécologie, Obstétrique & Fertilité où ils constatent une corrélation entre la
maladie et les abus sexuels, les événements marquant voir traumatisant de l’enfance ou des
douleurs physiques.
Ces aspects psychologiques sont pour la suite de notre recherche un point assez important à
prendre en compte lors de la prise en charge des patients.
5. La place de l’IRM
L’IRM arrive en deuxième intention après l’échographie, elle va permettre de voir les lésions
endométriales profondes sous et extra péritonéal mais également de spécifier la nature kystique
s’il y a lieu grâce à une étude des tissus mous. L’avantage de l’IRM est l’étude dans les trois plans
de l’espace des atteintes tissulaires.
Le protocole de l’IRM nécessite un balisage à l’aide d’un gel d’échographie stérile du vagin de la
patiente et du rectum. L’utilisation du gel d’échographie stérile va donner suite à un geste invasif
d’où l’importance de la stérilité du matériel utilisé pour mettre en place ce gel. Les conditions
d’asepsies seront importantes et contrôlées par le MERM. Généralement, nous utilisons des
seringues de 20 ml et des canules pour faciliter l’acte. Ajoutons à cela l’injection de produit de
2 Article référencé en bibliographie [2]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 7
contraste pendant l’examen, donc un geste invasif supplémentaire pour la patiente.
Nous ne spécifions pas le protocole complet de l’étude d’une endométriose mais nous retiendront
que 6 séquences sont en moyenne effectués lors de cet étude soit un examen qui peut durer une
vingtaine de minutes.
IV. Cadre théorique
Le cadre théorique va nous permettre de poser les impératifs et obligations que la loi3 impose aux
professionnelles de santé. En définissant clairement ces obligations, nous fixons des circonstances
et des limites à respecter. Ainsi, plusieurs articles de loi nous concernent pour cette étude. Les plus
importants ont été répertoriés dans la suite du chapitre.
1. Respect et dignité du patient (article L1110-2 du CSP)
Lors de la prise en charge des patientes, il faudra respecter le code de santé publique qui dit :
« La personne malade a droit au respect de sa dignité »
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 JORF 5 mars 2002
Il est primordial dans la prise en charge du MERM de montrer à l’égard de la patiente ce respect
qui permettra d’établir une relation de confiance et comblera le besoin de sécurité de la personne.
2. Information au patient (article L1111-2 du CSP)
Le respect et la dignité doivent être respectés mais il ne faut pas oublier l’obligation de donner
l’intégralité des informations qui est très importante pour les patientes et pour les devoirs du
MERM. Il faut leur dire tout ce qu’il va se passer et expliquer les actes. La loi dit :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles
en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé
le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins
sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de
bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
3 Tous les articles de lois sont référencés en bibliographie [3]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 8
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans
le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit
être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés,
selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent
l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de
décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la
Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve
que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des
professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations
nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la
continuité des soins après sa sortie. »
N’oublions pas les devoirs des professionnels de santé qui leur permettent de se protéger en cas de
litiges mais également aux patientes d’agir en connaissance de cause ou de refuser l’examen.
3. Droit de refuser (article L1111-4 du CSP)
La loi indique également le droit de refuser un examen par les patientes :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste
cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 9
traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai
raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la
procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à
l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement
susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne
de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés.
La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement
par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les
soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières
relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. »
Le droit de refus est très important. Si la patiente refuse le balisage par exemple, elle est dans son
droit car elle dispose de son corps. Une solution doit être trouvée avec le médecin pour une prise
en charge optimal respectant dans la mesure du raisonnable les choix des patientes.

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 10
V. Cadre de référence
1. Le stress
L’étymologie du mot stress provient du latin « stringere » qui signifie « rendre raide », « serrer »,
« presser ».
L’histoire de ce mot est intéressante car sa définition a provoqué beaucoup de discussions. Le
premier chercheur à avoir donner une définition à ce mot était Hans SELYE :
« Une contrainte non-spécifique sur le corps causée par des irrégularités dans son
fonctionnement normal (non-spécifique, car n’importe quelle maladie peut causer cette
contrainte). Ce stress résulte en une sécrétion d’hormones. C’est ce que Selye a défini comme le
Syndrome Général d’Adaptation, c’est-à-dire, les réactions à court et à long-terme de notre corps
face au stress. »
La non-spécificité de cette réaction est ce qui a posé problème dans la définition donné par Hans
SELY. Cela signifierait que nous serions tous vulnérable de la même façon face aux mêmes
situations. Ajoutons à cela que le chercheur n’a pas inclus d’aspect psychologique à sa définition.
Suite à cela, le centre d’étude sur le stress humain4, rapporte une expérience intéressante :
« Des chercheurs ont mené une expérience captivante dans laquelle ils ont mesuré les niveaux
d’hormones de stress chez des parachutistes expérimentés.
L’idée était que sauter d’un avion devait être stressant pour tout le monde! Étrangement, leurs
niveaux d’hormones de stress étaient normaux.
Ils ont ensuite mesuré les hormones de stress chez des parachutistes qui sautaient pour la
première fois et chez leurs instructeurs. Ils ont trouvé une grande différence! Le jour avant le saut,
les étudiants avaient des niveaux d’hormones normaux, mais les instructeurs avaient des niveaux
élevés. Le jour du saut, les niveaux d’hormones des étudiants étaient élevés alors que ceux des
instructeurs étaient normaux.
Ils ont alors conclu que, 24 heures avant le saut, les instructeurs anticipaient et qu’ils sécrétaient
ainsi plus d’hormones parce qu’ils savaient à quoi s’attendre. Les étudiants ne pouvaient pas
savoir!
4 Site référencé en bibliographie [4]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 11
Mais le jour du saut, la nouveauté et l’imprévisibilité de la situation ont stimulé la sécrétion
d’hormones de stress chez les étudiants, tandis que la même situation, parce qu’elle n'est plus
nouvelle ni imprévisible pour les instructeurs, ne leur a pas généré de réponse de stress. »
Ce qui est interpellant dans cette expérience est que la peur de l’inconnu déclenche un stress
seulement quelques instants avant l’action. Alors que lorsqu’on sait ce qui nous attend, le stress
arrive bien avant et peut être anticipé par notre cerveau afin de faire face et de gérer ce stress.
Nous pouvons comparer cela aux cas des patientes qui arrivent dans le service d’imagerie et qui
sont totalement dans l’inconnu de ce qui va se passer de l’autre côté de la salle d’attente. Certes,
ce n’est pas un saut en parachute mais c’est quand même un examen qui leur permettra d’avoir des
réponses à certains problèmes qu’elles ont depuis plusieurs mois. Leur santé est en jeu.
Suite à cela, 4 causes majeures de stress ont été identifiées. Le premier est la perte de contrôle,
c’est-à-dire lorsque nous ne sommes plus capables de choisir ou de changer une situation. Lorsque
nous ne sommes plus maitres de ce qui peut nous arriver, le stress s’impose entrainant une
succession de réactions à la fois physiques et psychologiques. Une deuxième raison du stress est
l’imprévisibilité, c’est-à-dire de ne pas pouvoir anticiper, être surpris par un imprévue, que les
choses ne se passent pas comme nous l’avions imaginé. La troisième cause est la nouveauté, ce
qui revient à ce que nous disions précédemment, la peur de l’inconnue. Enfin la menace de notre
égo lorsque qu’une personne remet en doute nos compétences ou nos capacités.
Toutes ces menaces que nous percevons entrainent des réactions de stress. Si nous mettons tout
cela en relation avec les patientes que le MERM prend en charge, nous constatons la présence de
toutes les causes prédisposant à un stress :
La perte de contrôle qui se caractérise par le fait d’être soumis à ce que nous leur
demandons. Par exemple, lorsque nous leurs expliquons la façon dont elles doivent se
préparer physiquement. En IRM cela constitue une partie importante que le MERM ne
peut pas négliger. Finalement en se présentant à l’examen, les patientes sont contraintes de
respecter les demandes que le MERM suggère et c’est en cela qu’une relation de confiance
est essentielle.
L’imprévisibilité est relative en fonction des patientes. Certaines arrivent en ayant bien
compris le déroulement de l’examen et d’autre ne sont absolument pas au courant du
protocole. Cela n’empêche que n’ayant jamais effectué cet examen auparavant, les
patientes sont quand même face au fait de ne pas pouvoir anticiper le déroulement de
l’examen. Par exemple, un simple retard du programme sur la matinée peut causer un
stress de la patiente due à l’imprévisibilité de la gestion du temps.

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 12
La nouveauté est peut-être l’une des principales causes de stress lors de cet examen. Dans
la grande majorité des cas les femmes n’ont jamais passées cet examen. La nouveauté est
bien présente et le stress qui en découle également.
La menace de l’égo peut se caractériser par le côté intrusif dans l’intimité de la patiente.
On touche ici à la dignité et la pudeur de la patiente, à travers lesquels l’égo est forcément
touché.
Il parait évident que le stress des patientes est inévitable avant la prise en charge. Nous l’avons
démontré non seulement par le biais du profil des patientes atteintes d’endométriose mais aussi par
la définition même du mot « stress » qui contient tous les éléments le prédisposant avant une
I.R.M.
Nous pouvons nous demander : comment le stress agit-il sur les patientes ? Quelles contraintes ce
stress va-t-il imposé lors de la prise en charge par le MERM ? Pour répondre à cela nous nous
référerons à l’article5 « le stress – quelques repères notionnels » de la psychologue Evelyne
JOSSE. Cette dernière possède une grande expérience dans le milieu de la psychologie grâce à sa
participation active à plusieurs ONG (organisation non gouvernementale), à la mise en place d’un
programme ASAB (Anti-Stress Aéronautique Brussels), et à l’écriture de plusieurs ouvrages sur la
conséquence des traumatismes vécu par l’enfant et l’adulte. Elle a également travaillé dans des
hôpitaux universitaires avec des patients atteints de VIH et des enfants atteints de cancer. La
psychologue explique la différence entre le stress positif (eustress) et le stress négatif (distress).
L’eustress, nous stimule dans la vie quotidienne, il n’y a pas d’effet négatif sur notre attitude ou
notre concentration, voir même des répercussions plutôt encourageantes concernant nos aptitudes.
Le distress, est à l’inverse, un stress a répercussion négative qui se ressent lors d’une perte de
contrôle d’une situation menaçante. C’est type de stress qui concerne nos patients. Elle explique
que les conséquences de ce stress sont nombreuses : au niveau relationnel, comportemental et
émotionnel par exemple. En effet, les personnes souffrant de distress vont constater certains
changements. Ils seront plus irritables, sur la défensive, perdront leur côté humain, seront plus
agressifs. Sur le plan professionnel, on peut constater un manque de productivité, des difficultés à
la concentration, des compétences amoindries. Même si chaque personne perçoit le stress à sa
manière, certaines caractéristiques reviennent souvent et chaque personne aura sa manière de
montrer son stress négatif.
Toutes ces manifestations, vont constituer des obstacles lors de la prise en charge des patientes, et
en relation avec l’hypothèse de notre étude, le MERM devra les maitriser de façon à ne pas
5 Article référencé en bibliographie [5]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 13
augmenter ce stress. Bien sûr, toutes les patientes ne seront pas atteintes par le stress de la même
manière car rappelons le, le stress est vécu de façon différente en fonction du vécu et de la
personnalité des patientes. Le MERM devra s’adapter de façon à ne pas augmenter ce stress et
pour cela il devra dans un premier installer une relation de confiance entre lui-même et la patiente.
2. La relation de confiance soignant/soigné
La relation de confiance entre le MERM et la patiente est primordiale à installer.
La confiance c’est :
« Sentiment de quelqu’un qui se fie entièrement à quelqu’un d’autre, à quelque chose »
d’après le Larousse
« Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle... d'une autre
personne, qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou
incompétence » d’après le CNRTL
La première définition du Larousse, montre que la confiance inspire le fait de pouvoir se reposer
sur quelqu’un d’autre. En instaurant cette relation de confiance, la patiente pourra se reposer sur le
MERM pour la soulager de son stress, de son inquiétude. En se fiant au MERM, il représentera un
point de repère pour elle, un pilier durant tout le long de l’examen. La nouveauté, se ressentira
seulement en début de prise en charge. Puis, au fur et à mesure de la préparation, si le MERM
développe cette relation de confiance, il finira par constituer ce point de repère qui donnera la
sensation de ne pas être dans l’inconnue. C’est tout simplement le besoin de sécurité de la
personne qui est comblé. En effet, la pyramide de MASLOW, qui hiérarchise les besoins de
l’Homme, place la sécurité aux deuxième étage d’une pyramide de 5 étages. Voici la pyramide de
Maslow :

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 14
Figure 1: la pyramide de MASLOW
Cette pyramide est une référence en ce qui concerne le concept de besoin de l’être humain, elle
classe les besoins du plus important (la base de la pyramide) au moins vital (haut de la pyramide).
Trois étages peuvent nous concernés. Le deuxième étage concerne le besoin de sécurité qui doit
être comblé par la relation de confiance que le professionnel de santé doit instaurer. Le besoin
d’appartenance, qui constitue le troisième étage, se retrouve dans l’écoute et le respect des choix
du patient. Le quatrième étage peut être respecté en montrant sa considération envers le patient
c’est-à-dire l’appeler par son nom, lui accorder un maximum d’autonomie. Finalement lors de la
prise en charge, le MERM devra prendre en compte tous ces points. Cela permettra de combler un
maximum des besoins des patientes et ainsi d’optimiser la prise en charge de façon significative.
La relation de confiance est donc très importante car c’est le second besoin le plus important pour
l’Homme, mais en comblant ce besoin nous pouvons aller plus loin en prenant en compte les
besoins d’estime et d’appartenance qui sont à notre portée.
La seconde définition du centre national de ressource textuelle et lexical, parle de croyance ce qui
fait pensé au côté religieux. Finalement, la confiance c’est avoir la foi en une personne. Les
patientes en donnant leur confiance, ont foi en les compétences et le respect du MERM. Cette
définition fait aussi référence aux valeurs morales, affectives et professionnelles. Le professionnel
de santé doit se montrer digne de cette confiance en prouvant son professionnalisme, son respect
et sa considération envers la patiente qu’il prend en charge. Il est vrai que, comme le dit la
définition, la croyance est spontanée ou bien acquise. Certaines personnes vont accorder leur
confiance plus rapidement que d’autre qui auront besoin de plus de temps pour sentir qu’elles
peuvent s’ouvrir à cette personne. Mais la foi est justement basée sur le fait de ne pas avoir de

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 15
preuve directe de l’existence de ce que l’on croit. Et c’est justement le message de cette définition,
les patientes auront foi en certaines valeurs et le MERM doit leur montrer qu’elles ne se trompent
pas notamment grâce à ces mots et son attitude que l’on explicitera dans la prochaine partie.
La relation de confiance va s’installer par les mots et l’attitude du professionnel mais d’autres
arguments peuvent permettre de l’instaurer. Tout simplement par le fait de s’informer sur la
patientes avant de la prendre en charge. Par exemple, l’ordonnance peut nous donner beaucoup
d’informations et nous permettre d’anticiper certaines contraintes. Par exemple, si la patiente est
atteinte d’une autre maladie ou si le médecin prescripteur nous a indiqué des informations
relatives à son intention de procréer, à la nature de ces douleurs, à son aspect psychologique. Il est
intéressant de prendre connaissance auparavant du nom et prénom de la personne afin de ne pas
écorché son identité en l’appelant. Ce sont des petites informations qui vont indiquer à la patiente
que nous la considérons, que nous prenons en compte ses douleurs, et que nous la respectons en
tant que personne et non comme objet.
Lors de mes recherches, un article6 intéressant d’un kinésithérapeute soutiré du huitième colloque
d’éthique sur le corps et l’intimité à Bicêtre en octobre 2005, expose l’importance de la relation de
confiance qui se fait dès le premier instant. Il explique l’importance de se présenter et d’analyser
les informations des patients avant de les prendre en charge. Il explique :
« Et je la regarde, je la touche, je l’examine, et parfois dans sa plus grande intimité. Alors, si je
m’éloigne du rôle que cette personne m’a donné (car elle s’adresse d’abord au personnage que je
représente, symbolisé entre autres par ma blouse blanche), il va y avoir inadéquation entre sa
représentation et la réalité. »
Il est important d’instaurer une relation de confiance mais il est encore plus important de garder
son rôle de soignant et de ne pas être familier avec ses patientes. Il faut rester à sa place pour
éviter de dépasser une limite qui pourrait installer un malaise entre le patient et le soignant. La
confiance a des limites, il faut mettre le patient dans des conditions où il se sent le plus à l’aise
possible tout en gardant son statut de soignant pour que nos gestes, qui vont parfois dans l’intimité
des patientes, ne soient pas mal perçus, ou mal vécus. Cela permettra de pouvoir parfois entrer
dans la bulle d’intimité de la patiente avec respect et considération qu’elle ressentira.
3. Les mots
Les mots sont tout d’abord un moyen de communication qui vont nous permettre de nous faire
comprendre et de comprendre notre interlocuteur. Ils vont permettre un échange entre un émetteur
et un receveur qui vont alterner les rôles durant une conversation. Lors de nos cours de première
6 Article référencé en bibliographie [6]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 16
année sur la communication, nous avons pris connaissance du modèle cybernétique de
communication qui schématise ce qui se passe lors d’une conversation :
Figure 2: schéma de la communication
Lors d’une communication entre deux personnes plusieurs éléments peuvent influencer le sens des
mots que l’on utilise et le sens que l’on comprend des mots qui nous parviennent. Tout d’abord
notre discours est influencé par notre personnalité, nos valeurs, notre culture et nos connaissances.
Par exemple, les mots du MERM sont souvent basés sur un langage médical souvent peu
compréhensible par les patients. Il faudra donc adapter son langage à la personne à qui l’on
s’adresse. L’environnement a également une influence sur la perception du message et les filtres
personnels, c’est à dire l’information que nous souhaitons intégrer ou pas.
Il faudra donc choisir sa façon de communiquer par les mots en fonction de la personne que l’on a
en face de nous. C’est aussi pour cela qu’il est intéressant de prendre un maximum d’informations
sur la patientes avant de la mettre en cabine afin d’adapter nos mots.
Une étude de référence7 est souvent ressortie lors de mes recherches :
« Albert Mehrabian est un professeur de psychologie aux Etats-unis. En 1971 il publie les
résultats de deux expériences faites en 1967, qui avaient pour objet d’étudier le rôle des
expressions faciales dans la perception de la sympathie.
Les expériences de Mehrabian
7 Site internet référencé en bibliographie [7]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 17
La première étude de Mehrabian portait sur l’impact du verbal et du para verbal. Pour cela les
sujets devaient écouter neuf mots, répartis de la manière suivante :
3 mots à connotation positive : « miel », « très chère » et « merci »
3 mots à connotation neutre : « peut-être », « réellement » et « oh »
3 mots à connotation négative : « non », « brutal », « terrible »
De plus, les mots étaient également prononcés avec différentes tonalités (neutre, positive et
négative). Après avoir écouté ces mots les sujets étaient invités à associer une émotion. Les
résultats montrent que dans l’attribution d’une émotion les sujets se basaient davantage sur les
tonalités dans lesquels les mots étaient prononcés que sur la signification du mot en lui-même.
Ainsi, dans l’attribution d’une émotion à partir de mots prononcés les conclusions de l’étude
montrent que le canal para verbal jouait un rôle plus important que le canal verbal.
La seconde expérience de Mehrabian, portait sur le para verbal et le non verbal. Les sujets
devaient écouter l’enregistrement vocal d’une femme prononçant le mot « peut-être » avec une
intonation neutre, une intonation positive et une intonation négative. Ensuite, les auteurs
montraient aux sujets trois photos de visages de femmes exprimant :
Une expression faciale d’émotion positive
Une expression faciale neutre, sans émotion particulière
Une expression faciale d’émotion négative
Les sujets devaient alors attribuer des caractéristiques de personnalité (sympathique ou non
sympathique) à la personne présentée en photo et en fonction de la voix qui y était associée. Les
résultats de cette deuxième expérience montrent que le canal visuel, donc non-verbal, était décisif
dans la perception de la sympathie lorsque le canal verbal ne permettait pas aux sujets de se faire
une opinion.
En 1971, Albert Meharabian publie les chiffres combinés de ces expériences, représentant les
parts que prennent le verbal, le para verbal et le non verbal, dans l’attribution du degré de
sympathie. C’est ainsi que 7% de la communication passe par le verbal, 38% par le para-verbal
et 55% par le non verbal »
Finalement la position du langage et le poids des mots représentent que 7% de la communication
pour cette expérience. Mais associé au para-verbal cela constitue 45% ce qui n’est pas négligeable.
C’est pour cela que dans cette partie nous ne dissocierons pas le verbal du para-verbal
(l’intonation de la voix). Nous étudierons le non verbal sur une prochaine partie.

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 18
Il est vrai que dans plusieurs domaines de la communication il est déconseillé d’utiliser des mots
négatifs. Il est préférable de ne pas utiliser la négation mais plutôt la positivité des mots. Le
cerveau n’entend pas la négation, il va se baser sur les mots qu’il entend et n’analyse pas
l’ensemble de la phrase. Par exemple, en disant « cela ne fera pas mal », le cerveau enregistre le
mot « mal ». Dans ce cas il faudrait dire « tout ira bien ». En utilisant cette positivité, les patientes
resteront dans un état d’esprit positive qui leur feront oublier leur stress et leur permettront de se
détendre.
Le para-verbal, c’est l’intonation et les pauses entre les mots. Il parait évident que l’intonation que
l’on utilise va avoir une influence sur le jugement des patientes. Si nous parlons trop fort pour elle,
elle se sentira agressée. Si nous parlons pas assez fort, la patiente sera mal à l’aise car elle ne
comprendra pas ce que l’on dit. La meilleure solution reste donc de s’aligner sur le ton de la voix
de la patiente. Ainsi elle se sentira plus à l’aise lors des échanges et se sentira entendu et comprise.
Au fur et à mesure, le MERM pourra adapter son intonation pour créer une atmosphère plus
détendue.
En ce qui concerne les pauses entre les mots, il est important de ne pas s’exprimer trop rapidement
ou trop lentement. Pareillement, s’aligner sur la vitesse de parole de la patiente lui permettra de
mieux nous écouter et de lui renvoyer un reflet plus proche d’elle-même. Elle se sentira en
confiance.
En conclusion, en adaptant un langage approprié sans mots médicaux pointilleux mais à la portée
de la patiente, des mots positifs et une intonation alignée à celle de la patiente, nous lui
permettons :
De se sentir comprise et capable de comprendre en ne remettant pas en cause ses propres
capacités intellectuelles, et de garder un certain contrôle sur ce qui se passe
Un confort qui met en place un environnement réconfortant pour la patiente de façon
inconsciente par la positivité des mots
Un reflet de sa propre personne par une même intonation permettant d’effacer la nouveauté
à laquelle elle fait face à ce moment
Ainsi, plusieurs sources de stress sont diminuées (la nouveauté, la perte de contrôle, la menace de
l’égo).
Notre hypothèse de départ qui affirme que les mots doivent être maitrisé par le MERM, ont été
démontrer indirectement. En effet, les mots sont très peu importants face à la communication non
verbale. Ce qui entre en compte c’est l’intonation sur lequel le MERM s’exprime. Le para-verbal

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 19
est donc indissociable du verbal. Certes le choix des mots est important mais la tonalité l’est
encore plus. Finalement, en utilisant simplement un langage approprié et des mots positifs sur une
intonation correspondante à celle de la patiente permettra d’instaurer une relation de confiance qui
aboutira à une diminution du stress.
4. L’attitude (le non verbal)
Nous avons vu précédemment que le non verbal représentait 55% de la communication lors des
expériences du professeur Mehrabian. L’attitude du communicant, le non-dit, a donc une
importance bien plus influente sur la compréhension et le ressentiment du récepteur. Une
définition intéressante est proposée par le site internet « la communication non verbal » :
« La communication non verbale fait référence à l’étude du langage corporel, qui correspond : aux
expressions faciales, aux gestes, aux distances interpersonnelles… Pour la définition la plus large
du non verbal c’est un mode de communication qui n’a pas recourt aux mots. C’est l’ensemble des
moyens de communication existant entre les individus n’ayant pas recours à du langage parlé. Le
domaine d’étude du non verbal est abordé par plusieurs champs scientifiques comme la
psychologie, la neurologie, la sociologie mais aussi par l’éthologie, l’anthropologie ou la
linguistique.
La communication non verbale met en jeu des actes volontaires ou involontaires, des actes
conscients ou inconscients, et mobilise plusieurs canaux de communication. Le non verbal peut
manifester des émotions, des processus cognitifs, illustrer le discours, ou être spécifique à une
culture (les emblèmes). »
On retrouve dans cette définition l’aspect personnel de la communication non verbal que l’on a pu
voir dans le schéma cybernétique de la communication. En effet, chaque culture, chaque
personnalité à sa façon de s’exprimer. Il y a donc bien une influence de notre environnement dans
notre communication non verbal.
L’attitude du MERM va inclure : la distance physique (proxémique), l’expression faciale, le
contact des yeux, le contact physique, la posture, les gestes, l’apparence et les odeurs.
La proxémique a été étudiée par l’anthropologue E.T. Hall qui propose quatre types de distance :
intime, personnelle, sociale et publique. Chaque culture et chaque personne défini sa distance. En
effet, chaque personne vit dans sa propre bulle et décide de laisser y entrer, ou non, une tierce
personne. Il faudra donc bien penser à respecter certaines distances et attendre de voir comment la
patiente que le MERM prend en charge se comporte. Et c’est là que l’on peut adopter la technique
du « mirroring » qui consiste à imiter la position et la posture de la personne. Par exemple, si la
personne nous serre la main, il faudrait accepter de lui tendre la main à son tour. De plus, en

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 20
imitant sa posture, ce reflet permettra à la personne de se projeter en nous et d’instaurer une
relation de confiance.
En ce qui concerne l’apparence et les odeurs, ce sont des éléments que l’on ne peut pas maitriser
totalement. En milieu hospitalier, nous avons l’obligation de porter une tenue de travail
convenable et les odeurs sont difficilement gérables. Mais pour démystifier la blouse blanche, il
serait intéressant de se présenter face aux patientes, d’indiquer notre prénom et notre rôle. Ainsi,
nous devenons une personne et non plus un personnel soignant. En faisant cela, la relation de
confiance s’installe une fois de plus, car un prénom peut retirer cette sensation d’inconnue et de
manque de considération de la personne ce qui permettra de réduire une fois de plus le stress. En
ce qui concerne les odeurs, nous pouvons malheureusement, au mieux proposer un masque mais
c’est un point qui est difficilement gérable et qui peut être une cause de stress supplémentaire.
L’expression facial, en restant dans une certaine logique, doit être dans un premier temps positive
(sourire). Il est plus agréable de s’adresser à une personne souriante qu’à une personne fermé ou
qui montre une expression négative. Ensuite, il est important de s’adapter à la personne, par
exemple, ne pas sourire lorsque l’on parle de circonstance compliquée, en effet cela pourrait être
mal perçu. Mais ne pas montrer d’attitude trop compatissante ou avec de la pitié. Il faut savoir
écouter et rester neutre tout en revenant à un sourire ou une expression faciale positive pour que la
communication ne se ferme pas. C’est un exercice plutôt difficile mais très important car le
visage, est la première chose que l’on voit chez une personne, et peut dire beaucoup plus que ce
que l’on pense.
Le regard, c’est le premier contact établi avec les patientes. Regarder une personne dans les yeux
c’est capter son attention et montrer notre intérêt envers elle. Le regard ne doit pas être trop
insistant pour ne pas mettre la personne mal à l’aise. Il faut regarder la personne lorsque l’on
s’adresse à elle. Ne pas rester fixer sur elle pendant un moment de silence. La maitrise du regard
est tout aussi importante et permet de donner confiance à la personne, de la considérer en tant
qu’être pensant.
Le contact physique est sûrement le plus délicat. Par le fait que chaque personne a un périmètre
qui lui est propre, il faudra anticiper le geste du balisage par exemple. D’après le livre8 «
communication soignant – soigné : repère et pratique » de Antoine Bioy, Françoise Bourgeois,
Isabelle Négre, un chapitre consacré au touché préconise de :
Considérer le patient : lui expliquer ce que l’on fait, demander son autorisation, prévenir
avant de toucher
8 Référencé en bibliographie [8]

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 21
Utiliser des touchers inévitables pour utiliser des gestes doux et rassurant comme prendre
le pouls, la tension…
Eviter le port excessif de gants lorsque cela n’est pas nécessaire. Cela déshumanise la
personne.
Ne pas évoquer le manque de temps pour montrer que le geste est consciencieux.
En effet, pour le balisage qui reste le geste le plus compliqué à effectuer, il faut en parler avant. En
expliquer l’intérêt et laisser la patiente décidée de ce qu’elle souhaite. Pourquoi pas proposer à la
patiente d’effectuer seul le balisage vaginal ce qui est tout à fait réalisable, et expliquer que le
balisage rectal sera plus confortable a effectué par le MERM. Cela permettra de montrer la
confiance que l’on accorde à la patiente, en faire une actrice de son propre examen et lui montrer
qu’elle peut maitriser certaine partie. Encore une fois, cela permet de réduire l’une des origines du
stress qui est la perte de contrôle.
Il peut être important d’accompagner la patiente en montant sur la table par exemple. Cela permet
d’établir un premier lien, de toucher et de briser le périmètre de l’intimité en douceur. Utiliser des
gants est important pour l’hygiène, on peut donc en proposer à la patiente qui souhaite mettre le
gel d’échographie stérile seule dans le vagin pour montrer que c’est une formalité d’hygiène. Et
bien sûr, en évitant de parler du manque de temps qui pourrais stresser encore plus pour la
patiente.
Le toucher est délicat mais peut être préparé. En communiquant avec la patiente, en la rendant
active durant son examen, en lui montrant de l’intérêt, le toucher sera moins compliqué à réaliser.
Le non verbal est la part la plus importante de la communication, il doit donc être maitriser grâce à
des astuces simple qui permettent d’instaurer une relation de confiance. Avoir une attitude
positive, se montrer disponible et à l’écoute de la patiente, avancer et entrer doucement dans le
périmètre intime permettra d’établir un lien et d’avoir une confiance totale de la part des patientes.
VI. Enquête
1. Présentation
Mon enquête9 avait pour but de :
Savoir si les MERM se sentent à l’aise avec la prise en charge de patientes atteintes
d’endométriose
De comprendre rapidement leurs façons de prendre en charge ces patientes
9 Voir le questionnaire en annexe

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 22
S’ils sont dans une démarche d’amélioration en ce qui concerne ce type de patientes.
La conclusion de cette enquête nous permettra de confirmer, ou pas, notre hypothèse de départ qui
est : L’attitude et les mots utilisés par le MERM doivent être maitrisés et adaptés lors de la prise
en charge d’une patiente en I.R.M. dans le cadre de la recherche d’endométriose dans le but
d’installer une relation de confiance qui réduira son stress.
Les premières questions concernent le contexte dans lequel travaillent les MERM :
Question 1 et 2 : Le lieu d’exercice : (privé ou publique) ce qui nous permet de comparer
les pratiques dans les différents secteurs.
Question 3 et 4 : L’âge et le sexe : les différences de pratiques varient elles en fonction de
l’âge ou du sexe ? Est ce qu’il est plus confortable d’être une femme dans ce contexte ?
Question 5 : L’expérience : nous indiquera si elle a un impact sur les pratiques des
professionnels.
La seconde partie va se centrer sur la pratique :
Question 6 : L’hôpital possède-t-il un protocole et si oui est-il efficace ? Cela permettra de
savoir si cette pathologie est prise en charge de façon correcte et reproductible pour
optimiser la prise en charge et est-ce qu’il est vraiment adapté selon l’avis MERM.
Question 7 : Les MERM ont-ils des difficultés à prendre en charge ces patientes et où se
trouvent ces difficultés. Cette question permettra de voir s’il y a vraiment une inquiétude
« de bien faire » chez le MERM et s’il est conscient de la difficulté de cette prise en
charge.
Question 8 : Le MERM donne-t-il les informations avant l’examen (en cabine) ou au fur et
à mesure de l’examen. Il serait intéressant de savoir si la patiente est submergée
d’informations en cabine ou si le MERM prend le temps d’expliquer le déroulement par
étapes.
Question 9 : Le professionnel de santé est-il confiant sur sa prise en charge ou pense-t-il
qu’il peut devenir une source de stress pour la patiente ?
Question 10 : La priorité se trouve-t-elle selon le MERM dans son attitude, dans ses mots,
dans le temps d’explication ou bien dans le stress de la patiente ? Cette question nous
permettra de valider l’hypothèse sur le fait de la maitrise des mots et de l’attitude du
manipulateur.
Question 11 : Enfin est ce que le MERM pense qu’il y a une nécessité d’avoir une
formation plus poussée sur la prise en charge de ces patientes.

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 23
2. Analyse
En analysant mes questionnaires, j’ai tout d’abord remarqué que l’un des deux hôpitaux privés ne
possédait pas du tout de protocole. Cependant, en hôpital public les deux hôpitaux avaient un
protocole bien défini qui était très apprécié par les manipulateurs. Plusieurs raisons ont été évoqué
pour prouver l’importance de cette mise en place :
Des documents sont transmis directement aux patients avant l’examen afin qu’ils
anticipent l’examen
Le protocole est complet et reproductible pour une meilleure interprétation de la part du
médecin
Le protocole est régulièrement réactualisé
On retrouve le fait d’informer la patiente à l’avance dans le but qu’elle se projette en prévision du
jour de l’examen et qu’elle n’arrive pas dans l’inconnu total. Elle sait comment les choses vont se
dérouler et elle pourra sentir qu’elle a un certain contrôle sur la situation. Le protocole est
reproductible ce qui permet au MERM d’être à l’aise face aux patientes. Le fait de réactualiser
certains points du protocole permet de sentir un investissement des médecins dans cette prise en
charge et d’encourager le MERM à suivre ce chemin d’amélioration.
Justement, cette recherche d’amélioration se fait ressentir dans le désir de formation qu’ont les
MERM que j’ai interrogés. Sur 22 MERM, 15 souhaiteraient avoir ou ont eu une formation de
prise en charge des patientes stressées. Il y a donc un ressenti de pouvoir et de vouloir mieux faire.
Sur les 7 personnes qui ne trouvent pas cela nécessaires, 2 ont moins de 10 ans d’expériences. Ce
qui peux expliquer une envie moindre de se former de la part de ces manipulateurs, est qu’ils
estiment avoir une expérience assez solide pour ne pas avoir recours à une formation.
En ce qui concerne le niveau d’expérience, il faut savoir que 72% des personnes interrogés
pensent que les patientes atteintes d’endométrioses ne sont pas plus difficiles à prendre en charge
que d’autre personnes souffrant d’autre pathologies en IRM. Et sur ces 72%, on retrouve 31% de
MERM ayant moins de 10 ans d’expériences. Les jeunes manipulateurs se sentent moins à l’aise
lors de leurs pratiques. Mais les personnes ayant répondu que ces patientes étaient plus difficiles
ont pour les ¾ plus de 15 ans d’expériences. Finalement, chaque professionnel ressent les choses à
sa manière qu’il ait beaucoup d’expérience ou qu’il sorte de l’école.
En ce qui concerne la pratique en elle-même, 21/22 personnes donnent les explications à leurs
patientes avant l’examen et non au fur et à mesure. Mais, comme nous l’avons dit précédemment,
lorsqu’une personne se trouve en situation de stress, ses capacités à raisonner sont moins bonnes
que la normal. Donc il serait plus judicieux de donner les informations de façon plus étalés pour

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 24
ne pas surcharger d’informations la patiente qui se trouvera en difficulté car elle aura du mal à se
concentrer à cause de son stress. De plus, si la personne n’est pas au courant du balisage vaginal et
rectal, elle risque de se concentrer sur ce point et ne pas écouter toute les autres informations.
Donner le temps à la patiente d’assimiler ces informations au fur et à mesure permettrait une
meilleure préparation de la patiente.
Un point intéressant concerne la responsabilité du MERM dans l’augmentation du stress des
patients. 40% des professionnels pensent que leur prise en charge peut être responsable de
l’augmentation du stress chez ces femmes. La raison qui ressort le plus c’est le fait de ne pas
donner toutes les explications. En effet, les personnes qui ne pensent pas que leur prise en charge
peut être stressante indique que c’est grâce à l’information qu’ils donnent aux patientes.
Finalement les MERM, se concentrent sur l’information et non pas sur la manière dont ils la
donnent. Ils se sentent obligé de tout dire aux patientes, peut-être par le sentiment d’obligation de
donner l’information complète aux patients pour se protéger en tant que professionnel. Une
minorité de personnes ont évoqués la patience et l’écoute pour expliquer une prise en charge non
stressante. Ce qui prouve que la prise en charge n’est pas centrée sur le patient et son ressenti mais
sur l’information à donner de façon à ce que la patiente réalise correctement l’examen.
Paradoxalement, la moitié des MERM pensent que leur attitude est prioritaire lors de la prise en
charge, arrive ensuite l’importance des mots. Il y a une certaine prise de conscience sur la façon
dont le professionnel présente les choses mais dans une question ouverte, il évoque d’abord le
contenu et non la forme dont sont dites les informations. La théorie et la pratique ne semblent
donc pas être corréler.
3. Conclusion
Ce qu’on retire de ce questionnaire, c’est que les pratiques sont différentes entre le privé et le
public. Le public tente d’instaurer une certaine méthode reproductible tandis que dans le privé, il y
a plus de souplesse. Le ressenti des MERM par rapport aux patientes atteintes d’endométriose est
très différent et dépend peu de l’expérience. Certains se disent très à l’aise avec moins de 10 ans
d’expériences, tandis que d’autre se sentent moins à l’aise avec plus de 20 ans d’expériences. De
plus, il y a un certain contraste entre la pratique des professionnels qui se concentrent plus sur
l’information brut à donner mais qui pensent mettre en priorité leur façon de communiquer par le
biais du non verbale. Mais il en ressort qu’une majorité de personnes qui est prête à faire évoluer
leur pratique et a envie de s’améliorer dans leur prise en charge par le biais de formation.
En ce qui concerne notre problématique, elle semble confirmée. En effet, 81% des MERM sont
d’accord sur le fait qu’une bonne prise en charge repose sur l’attitude et les mots qu’ils emploient.
Certes même si un contraste existe, cela montre bien que les pratiques doivent évoluer et doivent

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 25
être travaillées par tous. Il est primordial que les MERM soient conscients que leur attitude
influence de façon significative le ressenti des patients et que leurs mots peuvent avoir de grands
impacts. Ce qu’il faut maintenant c’est apprendre des techniques et des façons de faire qui leur
permettront d’avoir en main une base de méthode permettant la maitrise de tous ces points.

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 26
VII. Conclusion
Ce travail de fin d’étude nous a prouver l’importance de l’attitude du MERM lors de sa prise en
charge. Les mots ont également un poids mais moins important si l’on le dissocie du para verbal.
Lors de l’enquête nous avons constaté que le manipulateur d’électroradiologie médical est bien
conscient de cette importance mais se concentre beaucoup sur l’information à donner, d’où
l’utilité de cette étude. Nous constatons un contraste entre la réalité des faits et la théorie. Il est
donc important de maitrisé en priorité son attitude, puis ces mots de façon à réduire le stress des
patientes et d’optimiser leurs prises en charge. Il faut également prendre en compte le contexte
particulier de ces femmes qui se présentent avec appréhension à l’examen. Plusieurs facteurs
entrent en compte, la peur de l’inconnu, la perte de contrôle sur la situation, la nouveauté, la perte
de l’égo, sans oublier la peur du diagnostic et les problèmes d’infertilité de certaines femmes. Pour
pallier à cela chaque centre hospitalier à sa méthode : documents explicatifs donnés à l’avance,
protocole de prise en charge complet… Mais il y a aussi des centres qui ne donnent pas plus
d’importance à ce genre de pathologie qu’à d’autres. La majorité des manipulateurs
d’électroradiologie sont toujours prêts à être formés et sont dans la demande. En effet dans une
profession où les techniques évoluent en permanence, aussi bien d’un point de vue des
appareillages que par rapport à la prise en charge patient, il est important d’avoir ce volontariat, ce
qui est ressorti lors de notre étude.
En revanche, il y a beaucoup de variation entre les professionnels par rapport à leur ressenti.
Chacun à sa façon de percevoir le stress des patients, tout comme les patients montrent leur stress
de façon très différentes. L’expérience ne fait pas que les MERM se sentent plus à l’aise ou non.
Beaucoup de techniques évoluent et se mettent en place lors de formation continue voir même en
formation initiale. C’est le cas de l’hypnose conversationnelle qui est une technique intéressante
car simple à réaliser, mais est-elle vraiment à la portée de tous et est-elle vraiment efficace ?
Finalement, notre étude a permis d’éclaircir le profil de ces femmes atteintes d’endométriose et de
mettre en relation le stress qu’elles ont avant même d’entrer en cabine. Elle nous a permis de
prouver l’importance de la maitrise des mots et surtout de l’attitude des professionnels qui débute
dès le premier contact avec le patient. La profession de manipulateur d’électroradiologie médical
ne cesse d’évoluer et la communication reste un point central à maitriser pour la réalisation d’un
bon examen.

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 27
VIII. Annexe
Questionnaire :
Questionnaire du mémoire de Khadidja ZENATI 3 ème année IFMEM Poissy
Sujet : La prise en charge par le MERM des patientes atteintes d’endométrioses en IRM.
1. Lieu d’exercice : Privé / Public 2. Nom de l’établissement :
3. Age : 4. sexe : F / M
5. Depuis combien de temps travaillez-vous ?
6. Possédez-vous un protocole de prise en charge des patientes atteintes d’endométriose en IRM ?
Si oui, pensez-vous qu’il soit efficace et pourquoi ?
7. Trouvez-vous ces patientes plus difficiles à prendre en charge que les patients qui viennent
pour d’autres examens ? Si oui, pourquoi ?
8. Donnez-vous les informations relative à l’examen aux patientes au début de leurs prises en
charge ou bien tout au long de l’examen ?
1. Avant l’examen 2.Au fur et à mesure de l’examen
9. Pensez-vous que votre prise en charge puisse être responsable d’une augmentation du stress des
patientes ? Pourquoi ?
10. Choisissez, parmi ces propositions, celle qui vous semble prioritaire lors de la prise en charge
de ces patientes : (1 seule réponse)
1. Votre attitude 2. Vos mots 3. Le temps d’explication 4. Le stress de la
patiente
11. Seriez-vous intéressé pour suivre une formation qui vous aiderait à mieux gérer la prise en
charge du stress de ces patientes ?

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 28
IX. Bibliographie.
Article de loi :
[3] Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 JORF 5 mars 2002, article L1110-2 du CSP relatif au
respect et la dignité du patient :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BB54A0ADC1479A97B4FCCC7
33DCD7A58.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI00000668
5743&dateTexte=20160420&categorieLien=id#LEGIARTI000006685743
[3] Article L1111-2 du CSP version en vigueur au 28 janvier 2016, article relatif à l’information
au patient :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArt
icle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid
[3] Article L1111-4 du CSP, version en vigueur au 4 février 2016, article relatif au droit de refus
du patient :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006685767&cidTe
xte=LEGITEXT000006072665 (20/04/16)
Site Web :
[1] M. BAZOT, H. FERNANDEZ, A. MAUBON, collège national des gynécologues et
obstétriciens français, disponible en ligne : (consulté le 20 Mars 2016)
http://www.cngof.fr/pratiques-cliniques/recommandations-pour-la-pratique-
clinique/apercu?path=RPC%2BCOLLEGE%252FRPC_endometriose.pdf&i=456
[4] Centre d’Etude sur le Stress Humain, « le stress humain », disponible en ligne : (consulté le 25
mars) http://www.stresshumain.ca/le-stress/quest-ce-que-le-stress/historique-du-stress.html
[5] Evelyne JOSSE, « le stress, quelques repères notionnels », Résilience PSY, disponible en
ligne : (consulté le 17 Mars 2016) : http://www.resilience-psy.com/IMG/pdf/le_stress.pdf
[7] Benjamin ELLISALDE, la communication non verbale, « Que penser des chiffres d’Albert
MEHRABIAN », disponible en ligne : (consulté le 25 avril 2016) http://www.la-communication-
non-verbale.com/2013/02/mehrabian-8493.html
Dictionnaire de français LAROUSSE, disponible en ligne : (consulté le 05 Avril 2016)
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/confiance/18082
Centre national de recherche textuelles et lexicales, Ortolang, disponible en ligne : (consulté le 05
Avril 2016) http://www.cnrtl.fr/definition/confiance

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 29
Article en ligne :
[2] J. BELAISCH, J.-P. ALLART, "Endométriose et vécue de l'adolescence", Gynécologie
obstétrique & fertilité, volume 34, 2006, page 242-247, disponible en ligne : (consulté le 15 mars
2016): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1297958906000397
[6] Elsevier Masson Consulte, kinésithérapie la revue, « corps et intimité dans la relation de soin
point de vue d’un masseur kinésithérapeute », vol 7, page 21-23, disponible en ligne: (Consulté le
21 avril 2016) : http://ac.els-cdn.com/S1779012307704163/1-s2.0-S1779012307704163-
main.pdf?_tid=cfb94f2a-0b96-11e6-bc86-
00000aacb360&acdnat=1461665484_16a7357d06cbd381d627a748ddee6bc0
Marielly CUEVAS, Idhaliz FLORES, Kenira J. THOMPSON, "stress exacerbates endométriosis
manifestations and inflammatory parameters in an animal model", reproductive sciences, 19 aout
2012, page 851-862, disponible en ligne : (consulté le 17 mars 2016)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4046310/
Ouvrage en ligne :
[8] Antoine Bioy, Françoise Bourgeois, Isabelle Négre, « communication soignant – soigné :
repère et pratique », édition Bréal, avril 2003, disponible en ligne : (consulté le 30 avril 2016) :
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=6GEw4v_EsKQC&oi=fnd&pg=PA15&dq=commun
ication+soignant+%E2%80%93+soign%C3%A9+:+rep%C3%A8re+et+pratique+en+ligne&ots=Z
pPy3Eje9h&sig=MEjmxSguodlMy4MxzMraHLuijUg#v=onepage&q&f=false

UE 6.5 ZENATI Khadidja / IFMEM POISSY promotion E.A. CABANIS – 23/05/2016 30
ZENATI Khadidja Promotion 2013/2016
Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale C.H.I Poissy / Saint Germain-en-Laye
Mémoire réalisé dans le cadre du Travail Personnel de Fin d’Études préparant au Diplôme d’état de Manipulateur d’Électroradiologie Médicale – Région Ile de France
L’endométriose en I.R.M : le pouvoir de l’attitude et des mots du manipulateur
d’électroradiologie médical
Tuteur de recherche : VOISEUX Jean Christophe
Référent pédagogique : MAZURIER Laurence
Résumé (français) :
Durant nos stages d'Imagerie par Résonance Magnétique, nous avons vu que de nombreuses contre-
indications sont à vérifier. Suite à cela, nous nous sommes interrogé sur la prise en charge des patients
dans cette modalité complexe. Nous nous sommes concentré sur une pathologie particulière,
l'endométriose. Elle nécessite des précautions particulières à cause du balisage par un gel d'échographie
stérile dans le vagin et l'anus des patientes.
Tout au long de ce travail, nous nous intéressons aux mots et à l'attitude des manipulateurs
d'électroradiologie médicale. Nous verrons les méthodes à utilisés pour pouvoir maitriser le stress des
patientes. Le but étant de savoir si notre attitude et nos mots ont un impact sur le stress des patientes.
Nous ferons également une enquête auprès des manipulateur d'électroradiologie médical pour
comprendre leurs implications et leurs ressentis lors de ce type de prise en charge.
Abstract (english) :
During our workplacements in magnetic resonance imaging department, We saw that several side
effects are checked. Following this, we asked about the care of patients in this complex modality. We
concentrate on a particular disease, endometriosis. It requires special precautions because of the beacon
by a sterile ultrasound gel into the vagina and the anus of patients.
Throughout this work, we study the words and attitude of radiographers. We will see the methods used
to be able to control the patients stress. We will also investigate to understand radiographer's
implications and their experiences with this type of support.
Mots clés : stress, endométriose, prise en charge
L’Institut de Formation de Manipulateurs en Électroradiologie Médicale du C.H.I Poissy / Saint Germain-en-Laye n’entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire :
ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.