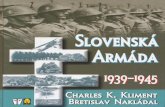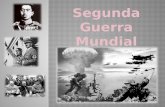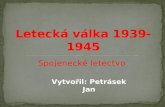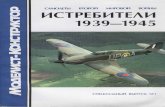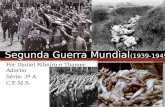La France Entre 1939 Et 1945
description
Transcript of La France Entre 1939 Et 1945
LA FRANCE ENTRE 1939 ET 1945
La IIIme Rpublique ne survit pas la dfaite. Larmistice est sign le 22 juin 1940 Rethondes. La France est coupe en deux : la partie nord, la plus grande et la plus riche est sous occupation allemande, la partie sud reste une zone libre et est dirige par le gouvernement du Marchal PETAIN install Vichy. Les 2 zones sont spares par la "ligne de dmarcation". Le 10 juillet, PETAIN obtient de lAssemble Nationale une large majorit la chute de la IIIme Rpublique et les pleins pouvoirs constituants. Il installe un nouveau rgime quon nomme lETAT FRANAIS. Il appelle Pierre LAVAL comme chef du gouvernement. 1. Le rgime de Vichy entend oprer une " Rvolution Nationale " :La " Rvolution Nationale " a pour but de rgnrer la France qui stait laiss emporter sur la voie de la dcadence politique et morale (la dfaite apparat comme une expiation des fautes et va permettre la rgnration). Le rgime doit donc tre autoritaire pour permettre ce redressement qui sordonne autour dune nouvelle devise (qui remplace la devise rpublicaine " libert, galit, fraternit ") : " Travail " : il sagit de remettre la France au travail par une rforme des structures conomiques. " Famille " : replacer les valeurs traditionnelles de la famille au centre de la socit (rle de la femme, ordre moral ) . " Patrie " : mettre le thme du nationalisme au tout premier plan.. Les rformes conomiques et sociales : Le rgime de Vichy met en place un systme de corporations qui doit organiser le travail par la Charte du Travail de 1941. Cela se traduit par la mise en place par secteur professionnel dune organisation professionnelle unique et obligatoire (les syndicats sont interdits) et par une intervention directe de lEtat dans lconomie. Le rgime idalise par idologie le travail de la terre par rapport lactivit industrielle. Il sagit dune revanche de la paysannerie sur le proltariat aprs les vnements de 1936 et le Front Populaire. . Les rformes politiques : Les liberts dmocratiques ne sont plus respectes. La chambre des dputs et le Snat ne sont plus runis. Suppression des syndicats, dissolution de la Franc-Maonnerie, poursuite des communistes, interdiction de faire grve. Emprisonnement des dirigeants politiques de la IIIme Rpublique : en 1942, le procs de Riom juge les hommes soit-disant responsables de la dfaite : Blum, Daladier et le Gal Gamelin. Les accuss sont livrs sans verdict aux Allemands en 1943.2 - Loccupation et la collaboration :. Loccupation : Le principe de loccupation allemande cest que les troupes doccupation doivent tre entretenues par le pays occup. Les Franais doivent donc payer des frais doccupation et les Allemands procdent un vritable pillage de lconomie franaise : prise de participation impose des Allemands dans le capital de certaines entreprises. Prlvement dune grande partie de la production agricole et industrielle, ce qui provoque des pnuries et des rationnements pour la population franaise. Rquisition de travailleurs franais pour aller travailler en Allemagne partir de 1943.Le deuxime aspect de loccupation est la rpression policire svre. La Gestapo et les SS arrtent, torturent et dportent impitoyablement juifs, communistes et rsistants. A partir de lt 1941, le principe dexcution dotages pour rpondre aux actions menes par la Rsistance est tabli (reprsailles collectives).. Les formes de collaboration : il existe une collaboration dordre politique et idologique : certains en France, antidmocrates et anticommunistes approuvent les ides nazies et voit dans la victoire allemande loccasion de les mettre en application. Cest le cas dun certain nombre dhommes politiques comme Jacques DORIOT, chef du PPF (Parti Populaire Franais) ou de Marcel DEAT. Cest le cas aussi de certains intellectuels fascins par le fascisme comme Robert BRASILLACH ou Pierre DRIEU LA ROCHELLE. Il existe une collaboration plus lie des motivations opportunistes : LAVAL ou son successeur lamiral DARLAN voient dans la collaboration le moyen de rserver un sort favorable la France dans lEurope nazie. Il existe une collaboration conomique : pour viter la ruine, certains industriels dcident de travailler avec les Allemands . Il existe enfin une collaboration militaire et policire : certains sengagent dans larme allemande pour aller se battre sur le front russe (la LVF : Lgion des Volontaires Franais) et certains sengagent dans la Milice pour aider les Allemands dans la rpression de la Rsistance.. La politique anti-juive : Le rgime de Vichy prend des mesures antismites soit sous la pression allemande. Deux Statuts des Juifs sont dicts : 3 Octobre 1940 et 2 Juin 1941. Ils prvoient : Le recensement des Juifs de France qui doivent se dclarer et porter ltoile jaune. Lexclusion des activits culturelles, de la fonction publique. La limitation du nombre de juifs lUniversit, dans les professions librales, dans la presse.A partir de 1942, la dportation des Juifs trangers puis franais est opre (Raffle du Vel dHiv le 16 juillet 1942). 76 000 Juifs franais mourront en dportation. 3 - La Rsistance :Le Gal de Gaulle sest rfugi en Angleterre do il appelle au refus de la collaboration avec l Allemagne et la Rsistance contre lennemi ds son Appel du 18 Juin la Radio. Pour lui la France rsistante doit exister pour quatre raisons : Par idalisme (lhonneur). La certitude que le rapport des forces mondiales dans la guerre conduira terme une dfaite des Allemagnes. Le rgime de Vichy na quune apparence de lgalit. Il ne saurait reprsenter la vritable continuit de la souverainet franaise. Si la France ne rsiste pas, elle sera alors dans le camp des vaincus la fin de la guerre en cas de victoire allie et elle sera alors traite en en tant que vaincue.. Dans un premier temps, la rsistance ne concerne que quelques isols qui refusent la dfaite. LAppel du Gnral de Gaulle est peu connu. La radio anglaise joue un rle dterminant pour le faire connatre et pour lutter contre la propagande allemande. De Gaulle et ceux qui lont rejoint sur les Iles Britanniques constituent alors la France Libre ou la rsistance extrieure. Assez vite, des mouvements de rsistance sorganisent en territoire occup autour de journaux clandestins (" Muse de lHomme ", " Valmy ", " Libration Nord ", " Rsistance ", " Ceux de la Rsistance "). Aprs lattaque de lURSS par Hitler, le parti communiste entre dans la Rsistance. Il cre alors ses propres organisations (les " Francs-Tireurs et Partisans " par exemple). Ces mouvements constituent alors la rsistance intrieure.
. A partir de 1942, la rsistance intrieure sorganise en fdrant la plupart des mouvements dans une structure commune le Conseil National de la Rsistance (le C.N.R.). Le maquis sorganise et vient se renforcer de la prsence des hommes qui refusent le STO partir de 1943. Les sabotages et attentats anti-allemands se multiplient. Jean MOULIN prend la direction du CNR jusqu son arrestation et son assassinat par la Gestapo de Lyon. . A partir de 1943, rsistance intrieure et rsistance extrieure dcident de fusionner en se plaant sous lautorit du General de Gaulle qui a dbarqu en Afrique. Le 3 juin 1943, de Gaulle cre le Comit franais de libration nationale qui deviendra en 1944 la Gouvernement provisoire de la Rpublique Franaise, reconnu par les Allis comme le seul organe officiel de la France Libre.
La cration de l'ONU
La Socit des Nations, cre en 1919 aprs la Premire Guerre mondiale pour prserver une paix chrement acquise, a manifestement failli sa mission. Dans le monde de 1945, les Allis vainqueurs de l'Axe remettent sur le mtier l'ouvrage.
I.La cration de l'Organisation des Nations Unies La cration de l'Organisation des Nations Unies (ONU) est voque ds 1941 dans la Charte de l'Atlantique, confirme le 1er janvier 1942 dans la Dclaration des Nations Unies, 26pays unis dans la lutte contre le nazisme. la confrence de Thran, en 1943, les Allis s'engagent crer cette organisation charge de rsoudre pacifiquement les conflits entre tats. La confrence de Dumbarton Oaks, en 1944, labore un projet de charte que la confrence de Yalta finalise en 1945, donnant notamment naissance au Conseil de scurit et au clbre droit de veto des grandes puissances. L'ONU est cre la confrence de San Francisco, le 25juin 1945, par les 50nations en guerre contre l'Axe, qui en sont donc les membres fondateurs (51 avec la Pologne). Elle commence fonctionner le 24octobre 1945, qui devient la journe des Nations Unies. Son sige est fix New York, partir de 1946, marquant ainsi l'engagement des tats-Unis dans la nouvelle organisation, contrairement ce qui s'tait pass avec la SDN. L'ONU est donc ne de la Seconde Guerre mondiale. Les fondateurs en sont les vainqueurs, mais les vaincus sont admis progressivement (Italie en 1955, Japon en 1956, Allemagne en 1973).
II.Objectifs et structure de l'ONU Les quatre buts essentiels de l'ONU sont: maintenir la paix dans le monde; dvelopper des relations amicales entre les nations; aider les nations travailler ensemble pour aider les pauvres amliorer leur sort, pour vaincre la faim, la maladie, l'analphabtisme et pour encourager chacun respecter les droits et les liberts d'autrui; coordonner l'action des nations pour les aider atteindre ces objectifs. L'Assemble gnrale est le principal organe dlibrant de l'ONU, elle comprend tous les membres (51 en 1945, 193 aujourd'hui). Le Secrtariat s'occupe des tches quotidiennes: sa tte, un secrtaire gnral est le vritable reprsentant de l'ONU dans le monde. D'autres organismes compltent l'organigramme: le Conseil de scurit; la Cour internationale de justice, dont le sige est La Haye (Pays-Bas); le Conseil de tutelle; le Conseil conomique et social. Le Conseil de scurit a la responsabilit principale du maintien de la paix et la scurit internationales: il s'agit de l'organe excutif de l'ONU. Il dispose de pouvoirs spcifiques tels que l'tablissement de sanctions internationales et l'intervention militaire. Il rassemble cinq membres permanents (tats-Unis, URSS, puis Russie partir de 1992, Chine, Tawan jusqu'en 1971, puis Chine populaire, France, Royaume-Uni), dots du droit de veto, et six membres non permanents (dix depuis 1963). Enfin, des institutions spcialises sont cres au fil du temps, charges d'actions spcifiques d'envergure internationale: ONUAA, ou FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou Food and Agriculture Organization); FMI (Fonds montaire international); Banque mondiale; OMS (Organisation mondiale de la sant); UNESCO, pour l'ducation, la science et la culture; UNICEF, pour l'enfance; HCR, pour les rfugis; OMT, pour le tourisme, etc.
III.L'ONU: espoir et dsillusions La cration de l'ONU reprsente un immense espoir de paix universelle aprs les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la guerre froide en paralyse rapidement le fonctionnement. L'URSS pratique, jusqu'en 1951, la politique de la chaise vide pour dnoncer la non-reconnaissance de la Chine communiste. Mais cette absence permet l'adoption des rsolutions 83 et 84 du Conseil de scurit, condamnant l'agression nord-corenne et autorisant le recours la force sous l'gide des tats-Unis. Depuis cette date, l'URSS (puis la Russie) a toujours sig. Les deux superpuissances rivales bloquent alors le fonctionnement du Conseil de scurit en utilisant leur droit de veto outrance: 242veto en 45ans! Avec la dcolonisation, le nombre de membres augmente et l'ONU devient une tribune d'expression anticolonialiste, frquemment anti-occidentale, pour les tats nouvellement indpendants, le tiers-monde, contribuant ainsi l'affaiblissement de l'institution.