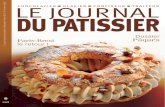JDP N°113
-
Upload
rhea-marketing -
Category
Documents
-
view
247 -
download
13
description
Transcript of JDP N°113

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 1 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
DOSSIER MANAGERp. 16
Journaldes Professionnelsdes ProfessionnelsJdP
JdP
Journaldes Professionnelsdes ProfessionnelsJdP
JdP
LES POINTS DE PRESSE DE L’ENTREPRISE
ÉDITION POITOU-CHARENTES - LIMOUSIN - VENDÉE FÉVRIER - MARS 2013
Numéro 113 | Février - Mars 2013 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
Les entreprises qui bougent !
Actualités Poitou-Charentes,Vendée, Limousin&Formation EMPLOI
Les nouvelles formes de communication
Master dossier :
JDP113.indd 1 07/02/13 08:35

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 2 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
JDP113.indd 2 06/02/13 17:38

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 3 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
REVUES DE PRESSE---------n des professionnels 4
---------n des entreprises 4
---------n internationale 5
---------n européenne 5
ACTUALITÉS---------n Poitou-Charentes 12
---------n Vendée 15
---------n Limousin 15
---------n Les Entreprises qui bougent 18
DOSSIERS--------n Formation p. 6 Les bonnes raisons de suivre une forma tion continueLes grandes écoles et l’internationalLa préparation opérationnelle à l’emploiEclairage sur l’analyse transactionnelle
--------n Communication p. 16 Les nouvelles formes de communicationSpécifi cités de la communication BtoBComplémentarité entre papier et numérique
--------n Juridique p. 21 Conclure une transaction dans le droit du travailLe droit de l’intelligence économique
SO
MM
AIR
E
Une diversité d’horizons qui fait la ri-chesse de cette assemblée, et donne du poids à ses réfl exions. Ses travaux sont le frui t de dialogues, d’échanges des 78 conseillers, représentant 43 organisations socioprofessionnelles, qui recherchent un consensus fort, et dépassent ainsi leurs intérêts propres.
Lieu de débat, force de propositions, le CESER a pour mission principale d’appor-ter aux élus politiques la vision du monde socioprofessionnel sur les grands dossiers régionaux : formation professionnelle, lycées, transport ferroviaire, emploi et dé-veloppement économique, … Il constitue une véritable instance de dialogue, d’où émerge depuis près de 40 ans, le ressenti de terrain.
Assemblée régionale née de la décentra-lisation, le Conseil économique, social et environnemental régional est une assem-blée consultative, chargée d'analyser les dossiers relatifs aux compétences de la Région, apporter des avis motivés et des propositions aux élus régionaux.
Représentant la société civile organisée, le CESER est constitué des représentants des entrepreneurs, des syndicalistes, des salariés, des associations…
C’est là un lieu privilégié d’anticipa-tion, d’expérimentation, de propositions, d’innovations qui intègre l’ensemble des enjeux du développement durable dans ses réfl exions.
Véritable laboratoire d’idées, il effectue des diagnostics, des analyses prospectives et élabore des préconisations concrètes, au plus près de la réalité quotidienne des Picto-Charentais.
C’est avec cette ambition, au service du développement économique et social de la région et de ses habitants, que le CESER Poitou-Charentes se mobilise au quotidien avec conviction et s’investit dans de nom-breux travaux à l’image de ses rapports et propositions en faveur de l’attractivité industrielle de Poitou-Charentes.
Avec par exemple la proposition de mettre en œuvre un tableau de bord de l’industrie régionale, ses travaux en cours sur le lan-cement d’Indicateurs de Développement Durable, ceux sur l’avenir de l’Enseignement supérieur en Poitou-Charentes ou encore ses préconisations ambitieuses à destination des politiques publiques de la jeunesse.
En ces temps de crise-mutation où l’in-certitude et l’aléatoire pourrait dominer, je suis persuadé que les corps intermé-diaires et la société civile organisée dans son ensemble, rassemblés au sein du CE-SER, peuvent et même, doivent jouer tout leur rôle : donner du sens, des repères, faire dialoguer ensemble les forces écono-miques, sociales et environnementales, et construire l’avenir avec ceux qui en sont directement les acteurs !
Jean-Paul MOINARD, Président du Conseil Économique,
Social et Environnemental Poitou-Charentes.
de Jean-Paul MOINARD
ÉDITOCONSTRUIRE L’AVENIR AVEC CEUX QUI EN SERONT LES ACTEURS
Vous complétez notre mission par l’accueil de stagiaires et par l’apport de vos compétences professionnelles dans nos formations.
Ce lien fort entre enseignants,enseignants-chercheurs et entreprisesest primordial pour nos 2000 étudiants.
14 allée Jean MonnetBP 389
86010 POITIERS CedexTél. 05 49 45 34 00
www.iutp.univ-poitiers.frcontact : Service Communication et Relations Entreprises
[email protected] - tél : 05 49 45 34 77
PoitiersI N S T I T U T U N I V E R S I TA I R E D E T E C H N O L O G I EP O I T I E R S C H A T E L L E R A U L T N I O R T
L’IUT, un temps pour apprendre avant d’entreprendre
JDP113.indd 3 06/02/13 17:38

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 4 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
REVUE DE PRESSE DES PROFESSIONNELS
REVUE DE PRESSE DES ENTREPRISES
n ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE
PEUT MIEUX FAIRE
Selon le dernier baromètre Ernst & Young sur l’attractivité de la France, les investisseurs étran-gers proposent un certain nombre de pistes pour en améliorer l’attrait en proposant de faire beau-coup mieux que ce qui a déjà été entrepris :
44%Améliorer le niveau d’éducation et de formation lié aux nouvelles technologies
40%Développer la culture de l’innovation et l’esprit d’entrepreneuriat dès l’enseignement secondaire
36% Soutenir la recherche appliquée et la mise sur le marché des innovations
35%Soutenir la mise en place de pratiques innovantes au sein des entreprises
33% Renforcer la fiscalité favorable aux entreprises innovantes
26% Améliorer la rémunération des chercheurs
23% Mise en place de stratégies industrielles éco-responsables
23%Développer le capital-risque et d’autres outils financiers dédiés à l’innovation
23%Développer des partenariats de la recherche publique et privée ainsi que des clusters
Source : Ernst & Young
FRANCE, LA 5E PUISSANCE MONDIALE
Dans le concert des nations, l’étalon absolu en matière de masse économique (PIB) concerne les Etats-Unis. Derrière eux, la Chine prend la seconde place devant le Japon, l’Allemagne et la France qui occupe la 5e position à égalité avec le Royaume-Uni bientôt rejoints par le Brésil.• Masse économique relative (PIB en dollars cou-rants) des 9 grands pays au sein du top 10 mon-dial, avec le % de leur PIB par rapport à celui des Etats-Unis (base 2012) :
53% Chine38% Japon22% Allemagne16% France, Royaume-Uni15% Brésil13% Italie12% Russie12% Inde
Source : FMI
n STRATÉGIEL’OPEN BOOK MANAGEMENT
Pour booster les profits de l’entreprise, les Américains Jack Stack (entrepreneur) et John Case (spécialiste du Management) préconisent la mise en place d’une nouvelle forme de gou-vernance d’entreprise, dont la baseline (slogan) est : «Quand les employés pensent et agissent comme des patrons, tout le monde est gagnant». Selon eux, l’intérêt de l’«Open Book Manage-ment» consiste à responsabiliser l’ensemble
des acteurs de l’entreprise en leur permettant d’accéder aux principales données habituelle-ment réservées aux directions financières ou à un quarteron de décisionnaires. Il ne s’agit pas seu-lement ici d’être transparent mais aussi de former le personnel à la stratégie globale de l’entreprise. En comprenant mieux les règles du jeu et la réa-lité sous-jacente, les cadres et les non cadres se sentent ainsi davantage impliqués dans le fonc-tionnement de leur entreprise, contribuant ainsi à sa rentabilité financière au lieu de s’y opposer. Déjà 4 000 entreprises dans le monde suivent les conseils formulés dans le document intitulé The Great Game of Business.
n ENTREPRISEUNE VALEUR AJOUTÉE EN BAISSE
A la suite du rapport Gallois et du débat sur la compétitivité des entreprises, il est intéres-sant de faire un premier bilan depuis 2008 sur la dégradation des comptes des «sociétés non fi-nancières», c’est-à-dire de l’ensemble des entre-prises hors banques, finance, assurances, secteur public, travailleurs indépendants.
Les TPE, PME, PMI et grands comptes repré-sentent 15,3 millions de personnes occupant un emploi en France sur un total de 24,5 millions d’actifs. Cet ensemble produit 56% de la valeur ajoutée (VA) totale du pays.
Au sein de chaque entreprise, la VA est le nerf de la guerre puisqu’elle traduit la différence vitale entre le chiffre d’affaires (CA HT) et la somme des achats réalisés auprès des fournis-seurs.
En 2012, selon les comptes trimestriels de l’In-see, la VA moyenne n’a représenté que 39,8% du
CA contre 41% en 2009, avec toutefois de fortes disparités entre le secteur marchand (55,2%) et l’industrie manufacturière (23,3%).
Dans le même temps, la masse salariale au sein de la VA est passée à 68% contre 64,1% en 2008 avec une répartition inégalitaire de 73,9% dans l’industrie manufacturière pour seulement 52,9% dans les services marchands.
UN FREIN À L’INVESTISSEMENT
En terme d’EBE (excédent brut d’exploitation), c’est-à-dire ce qui reste à l’entreprise après les achats aux fournisseurs et les salaires réglés (ainsi qu’après les impôts prélevés sur la produc-tion), le taux moyen a été de 28,2% de la VA en 2012, au lieu de 32,3% en 2008.
Si l’on ajoute à cela l’ensemble des taxes et impôts prélevés sur l’entreprise (7,7% en moyenne de la VA), le poids des intérêts versés aux banques (1% de la VA), les dividendes ver-sés aux actionnaires (8,9% de la VA), les pro-fits restant aux entreprises ne représentent plus, en moyenne, que 13,5% de la VA contre 15,3% début 2008. C’est pourtant avec une partie de cet argent restant (capacité d’autofinancement) que les entreprises doivent financer leurs inves-tissements. Alors que la moyenne d’avant-crise tournait autour de 20% de la VA, ce différen-tiel laisse supposer que soit les entreprises vont s’endetter encore davantage pour financer leurs investissements, soit que ce poste essentiel en matière de compétitivité sera l’une des premières victimes du ralentissement de l’activité écono-mique actuelle.
Principales sources utilisées : Alternatives Economiques - Challenges - L’Express
n PSYCHOLOGIELA SOLITUDE NUIT À LA SANTÉ
Une série d’études américaines menée durant plus de 7 ans par des chercheurs de la Brigham Young University a pu démontrer que le fait de vivre seul est aussi mauvais que de fumer 15 ci-garettes par jour, souffrir d’alcoolisme, être dans un état d’inactivité physique ou encore souffrir d’obésité.
La solitude serait néfaste pour la santé phy-sique et psychique en réduisant de manière sen-sible l’espérance de vie.
Selon le docteur Julianne Holt-Lunstad, le manque de relations sociales peut directement affecter la santé mentale du fait que «Quand quelqu’un est connecté à un groupe et se sent res-ponsable d’autres personnes, cela lui donne des objectifs qui l’amènent à prendre plus soin de lui-même et, ainsi, à prendre moins de risques».
Même avis pour le psychologue social John Cacioppo, de l’université de Chicago, pour qui c’est «Le sentiment subjectif de solitude qui est délétère, pas le nombre objectif de contacts sociaux. La solitude n’est pas du tout ce qu’on croyait et c’est un phénomène beaucoup plus im-portant qu’on l’imaginait».
Les problèmes de solitude sont un enjeu social et sanitaire de société car ils génèrent des états physiologiques et des effets biologiques (taux élevé de cortisol dans la salive et/ou d’adrénaline dans l’urine) qui placent le corps en état d’alerte permanent.
C’est aussi le cas avec une résistance vasculaire plus élevée induisant un durcissement artériel de nature à élever la tension, ce qui oblige le cœur à travailler plus dur contribuant à l’usure préma-turée des vaisseaux sanguins.
Pour ce spécialiste, ce phénomène est de na-ture épidémiologique car il ne touche pas seule-ment les personnes âgées, mais aussi les jeunes, les actifs à tous les âges, les hommes et les femmes de tous les milieux sociaux.
n SANTÉUNE BAISSE DANS L’ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ
Les personnes régulièrement exposées au stress sur leur lieu de travail, c’est-à-dire accomplissant un emploi exigeant, laissant peu d’initiative per-sonnelle, ont 23% de risque supplémentaire de faire un accident cardio-vasculaire (infarctus du myocarde).
Le stress en général associé à des conditions de vie qui se dégradent (pollution, médicaments, chimie alimentaire…) font que si l’on vit de plus en plus longtemps en France, c’est aussi en moins bonne santé. L’âge moyen de vie en bonne santé pour un homme, sans incapacité physique ou mentale, est de 61,9 ans (pour 78,4 ans d’es-pérance de vie) et de 63,5 ans pour une femme (84,1 ans). Un phénomène qui tend à s’accentuer ces dernières années.
• Répartition des principales causes de dé-cès en France (base 2009) :
30% Tumeurs (cancers)27% Maladies de l’appareil circulatoire 21% Autres pathologies6,3% Accidents divers, suicides6% Maladies de l’appareil respiratoire4% Maladies de l’appareil digestif3% Troubles mentaux et du comportement 2% Maladies infectieuses
0,7% Accidents de la route
Source : Insee
n MANAGEMENTLA RECHERCHE DE BIENVEILLANCE
D’après une enquête réalisée par le cabinet Co-mundi, il s’avère que face à la crise économique et à la crise de valeurs actuelle, le retour du fac-teur humain est devenu essentiel dans l’entreprise. 76% des salariés souhaitent que le comportement de leurs managers ne soit pas uniquement concen-tré sur la pugnacité, la créativité ou la prise de risque afin d’atteindre leurs objectifs mais, bien avant tout cela, que ceux-ci soient à leur écoute. Bien que 60% affirment que leur manager direct est un bon manager et que les relations avec lui sont jugées bonnes par 80% des personnes inter-rogées, il n’en demeure pas moins que plus d’un salarié sur deux souhaite recevoir plus de recon-naissance de la part de sa hiérarchie.
Une hiérarchie qui doit leur faire plus confiance en sachant donner des objectifs clairs comme en reconnaissant régulièrement le travail accom-pli. 60% des salariés souhaitent ainsi que leur manager montre du charisme, de la sincérité, de l’honnêteté, du courage et de la bienveillance, afin d’améliorer le dialogue et l’authenticité dans les rapports humains. Il est clair que pour une large majorité de salariés, le facteur humain est devenu l’enjeu primordial de la motivation, donc de la productivité donc du rendement profession-nel, dans un contexte où 48% des collaborateurs déclarent que la charge de travail est leur princi-pale source de stress, devant le manque de vision claire sur la stratégie de l’entreprise et la non-reconnaissance de leur engagement.
COMMENT SE MONTRER BIENVEILLANT ?
Xavier Cornette de Saint-Cyr, coach chez Hexal-to, assure qu’un manager peut être tout aussi efficace en étant bienveillant avec son équipe et ses collaborateurs. Il suffit qu’il mette en place les 7 conseils suivants :• Ne pas avoir d’ego : ou pour le moins le mettre en sourdine considérant que seul l’intérêt supé-rieur du collectif compte ainsi que les objectifs à atteindre.
• Montrer de l’empathie : Il s’agit de ressentir ce qu’éprouve le collaborateur en difficulté ou en conflit. • Agir avec esprit de coopération : Surtout dans un climat de compétition et d’enjeux économiques majeurs pour l’entreprise, la règle doit être celle du compromis équitable en évitant de travailler seul dans le non partage de l’information.• Ne pas être avare de compliments : Féliciter régulièrement ses collaborateurs, leur manière de travailler mais aussi leurs qualités personnelles.• Avoir toujours un regard positif : en prenant de la hauteur et/ou du recul face aux collabora-teurs jugés difficiles ainsi que face aux problèmes rencontrés. • Sourire au lieu de faire la gueule : C’est le signe ostentatoire le plus visible montrant que tout est ok au niveau relationnel, donnant ainsi du plaisir et de la motivation aux collaborateurs tout en rédui-sant de manière consécutive leur stress.• Accepter le droit à l’erreur pour soi-même : La bienveillance vaut aussi pour soi-même en évi-tant de se mettre inutilement la pression par des mimiques, rides et crispations qui se voient nette-ment sur le visage et créent de l’anxiété, voire de la distance relationnelle pour l’entourage.
n COMPORTEMENTUNE BONNE POIGNÉE DE MAIN
Des chercheurs de l’Université de l’Illinois (Etats-Unis) ont démontré par imagerie mentale que la poignée de main influence directement la perception que nous avons de nos échanges relationnels et de nos interactions profession-nelles. Les réactions du cerveau sont différentes selon que la poignée est franche et ferme ou qu’elle soit molle et non sincère. Dans le pre-mier cas, elle renforce le sentiment positif de la rencontre et diminue le niveau de stress, alors qu’une «mauvaise» poignée de main augmente le sentiment de malaise par un signal négatif de reconnaissance de soi et des autres.
Principales sources utilisées : L’Entreprise Nouvel Obs - Sciences & Avenir - www.sante.planet.fr
JDP113.indd 4 06/02/13 17:53

REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE
n ECONOMIELE PARADOXE DE LA TRANQUILLITÉ
Selon les travaux de l’économiste Hyman Mins-ky parus en 1980 «C’est quand tout va bien que les risques se prennent».
Il en résulte le fameux «paradoxe de la tran-quillité» qui dit que le système financier est in-trinsèquement instable et que l’instabilité finan-cière qui se manifeste à l’occasion de crise n’est nullement le résultat d’éléments imprévus, ou d’un choc extérieur subi par le pays, mais le fruit d’un dysfonctionnement intrinsèque permanent propre au système financier et bancaire.
L’explication donnée est qu’en amont de chaque crise (les années précédentes), il y a toujours une invention, une découverte, une nouvelle technologie, un boom économique, une révolu-tion industrielle, qui donne confiance en l’avenir.
Cette situation euphorise alors les agents éco-nomiques et leur fait anticiper des profits impor-tants en les poussant à emprunter et à s’endetter toujours davantage, fragilisant ainsi leur situa-tion financière.
L’état d’euphorie et de réussite apparente fait ainsi progressivement glisser une situation finan-cière prudente vers une situation de plus en plus volatile où le moindre retournement de marché agit en effet domino. Lorsque l’argent commence à manquer et que les opportunités d’investisse-ment se réduisent, le prix de l’argent augmente alors mécaniquement (via les taux d’intérêt).
A ce moment là, les entreprises et les ménages veulent se désendetter à tout prix en bradant leurs actifs, enclenchant ainsi une baisse gé-nérale des prix de ces actifs (actions, immobi-lier…).
Une spirale vers le bas se met en place, faisant que plus les agents économiques cherchent à se désendetter, plus… leur dette augmente, jusqu’à ce que les pouvoirs publics et les banques cen-trales réapprovisionnent le système financier en liquidité pour y mettre fin.
La crise de 2007-2008 en serait la parfaite illustration !
n MONDIALISATIONLES DUELS COMMERCIAUX S’INTENSIFIENT
Dans la guerre commerciale qui fait rage tout azimut, les filouteries et les tricheries sont nom-breuses et régulières avec 1639 cas de protec-tionnisme recensés à l’échelle mondiale depuis novembre 2008. Rien qu’en 2012 le nombre de litiges, différends et conflits au sein de l’OMC est reparti à la hausse avec, notamment, 51 duels commerciaux entre les Etats-Unis et l’Union Euro-péenne, 23 différends entre la Chine et les Etats-Unis ou encore 17 litiges entre l’UE et l’Inde. Globalement, la plupart de ces actions sont diri-gées vers la Chine (168), les Etats-Unis (130), l’Allemagne (115) ou encore la France (102), des Etats qui subissent chaque année des attaques sous forme de mesures protectionnistes et autres rétorsions juridiques prises à leur encontre. Dans le cas particulier de la France, la Russie (64), l’Ar-gentine (45), la Chine (26) ou l’Inde (20) sont les principaux pays ayant engagé des actions contre elle. Depuis 4 ans, le pays n’est pourtant pas en reste en ayant lui-même pris des mesures pro-tectionnistes de rétorsion contre la Chine (35), l’Inde, les Etats-Unis, la Turquie (12 chacun) ou encore le Canada (11). Il existe également une autre manière de se protéger de la concurrence internationale par l’usage de la dévaluation mo-nétaire. L’objectif est double : baisser les prix à l’exportation en vue de créer un accroissement momentané du volume des ventes tout en décou-rageant les importations par la hausse du prix des produits importés. • Nombre de dispositions prises, en moyenne par an, dans le monde depuis 2008 :
93 Aides d’Etat91 Lois antidumping46 Droits de douane additionnels32 Nouvelles barrières à l’entrée23 Quotas d’exportation
Sources : OMC, Global Trade Alert
• Evolution du taux de change par rapport à l’eu-ro depuis 2002 :
-84,8% Peso argentin-49,3% Dong vietnamien-46,3% Peso mexicain-37,4% Rand sud-africain-37,2% Roupie indienne-33,8% Rouble russe-30,4% Real brésilien-27,6% Dollar américain-22,3% Livre britannique
Source : OMC
n MANQUE DE TRANSPARENCE
UN COÛT ESTIMÉ À 1% DU PIB
Le dernier rapport 2012 de l’ONG Transparency International indique que la France n’obtient qu’une note de 71 sur 100 (14 sur 20) en matière de perception de la corruption dans l’Union Euro-péenne.
Elle est ainsi classée au 22e rang mondial et au 9e rang européen des Etats. Les premiers de la classe étant les pays scandinaves et les derniers : la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et l’Italie.
Ce classement reflète les règles de transpa-rence (et non règles) encadrant la vie politique et économique dont notamment : l’écart trop grand entre le mesures annoncées et leurs appli-cations effectives ; la non obligation de décla-ration du patrimoine des élus ; les liens entre le secteur privé et la classe politique ; un lobbying insuffisamment encadré ; le non contrôle des comptes des partis politiques ; la relative dépen-dance du parquet dans les «affaires» impliquant des hommes politiques ; le détournement de sub-ventions au niveau local.
Selon l’ONG, toutes ces pratiques ont un coût estimé à 1% du PIB national en contribuant éga-lement à saper la confiance des citoyens envers leurs institutions.
n RICHESSEUNE BAISSE DE 13% DU PATRIMOINE PERSONNEL
Selon le Crédit Suisse, la richesse mondiale aurait reculé de 8 400 milliards d’euros sur 12 mois entre 2011 et 2012. Cette baisse af-fecterait directement les patrimoines personnels (bourse, immobilier, titres). Elle aurait même entamé, en moyenne théorique, de 30 600 euros la fortune de chaque Français dont le patrimoine moyen est estimé à 202 644€ par personne en 2012, soit une baisse de -13% ! Que l’on se ras-sure toutefois, il existe en France 2,3 millions de millionnaires représentant 3,62% de la popula-tion nationale, ainsi que 2 900 ultrariches (+50 millions de dollars de fortune).
• Nombre de millionnaires avec proportion par rapport à la population (base 2012) :
11 millions (3,40%) Etats-Unis
3,6 millions (2,82%) Japon
2,3 millions (3,62%) France
1,6 million (2,51%) Royaume-Uni
1,5 million (1,78%) Allemagne
• Patrimoine moyen par personne en euros (base 2012) :
357 394€ Suisse
270 982€ Australie
248 847€ Norvège
205 884€ Japon
202 644€ France
Source : Crédit Suisse
Principales sources utilisées : Problèmes Economiques - L’Expansion
n LE DESIR D’ENTREPRENEURIAT A DU PLOMB DANS L’AILE
Une récente étude Eurobaromètre signale une frilosité grandissante des Européens à l’égard de la création d’entreprise : ils ne sont que 37% à vouloir être indépendant contre 45% trois ans plus tôt. Cette tendance est encore plus forte en Suède, Finlande et Norvège où près de 75% des sondés préfèrent être salariés. Ces chiffres sont très loin de ceux qui sont évoqués dans les pays hors UE, notamment en Turquie où 82% des actifs souhaitent créer leur entreprise, mais aussi au Brésil (63%) ou en Chine (56%). Les Etat-Unis occupent une place intermédiaire avec une préférence pour l’entrepreneuriat (+ de 50%) mais une attirance de plus en plus grande vers le statut d’employé (37% en 2009 contre 46% en 2012). Ces tendances reflètent sans doute le contexte économique actuel des pays occi-dentaux, avec pour corollaire, une propension à rechercher un emploi stable plutôt qu’à se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Les princi-paux freins cités dans l’étude sont : le risque de faillite (43% des sondés), les revenus irréguliers (33%), les contraintes administratives (pourtant très simplifiées dans l’UE) et financières.
n NAISSANCE DU BREVET UNIQUE EUROPÉEN
Depuis décembre 2012, soit plus de 10 ans après le début des négociations sur l’unification de la propriété intellectuelle à l’échelle de l’UE (quelle efficacité !), un inventeur peut procéder à un dépôt unique de brevet pour obtenir un titre de propriété intellectuelle valable dans 25 des 27 pays de l’UE. L’Italie et l’Espagne ayant refusé de signer l’accord
car les brevets ne seront traduits que dans les trois langues de travail de l’UE : l’anglais, l’allemand et le français. Avec ce nouveau système, le coût d’un dépôt de brevet européen pourra baisser dans un rapport de 4 à 1. Ce brevet unitaire aligne donc la protection intellectuelle européenne sur les pratiques américaine et chinoise où le dépôt est unique à l’échelle de la zone économique.
63% des demandes de brevets déposés en Europe proviennent de pays non européens.
En 2012, l’Office Européen des Brevets, ins-tallé à Munich, a enregistré 258.000 demandes de brevets et en a délivré 65.700, soit 5,8% de plus qu’en 2011. 63% des demandes proviennent de pays hors Europe. Les cinq pays les plus pro-lixes sont les Etats-Unis (24,7% des dépôts de brevet), le Japon (19,9%), l’Allemagne (13,4%), la Chine (7,3%) et la Corée du Sud (5,5%).
En Europe, loin derrière l’Allemagne, le classe-ment reste stable avec la France en 6ème position (4,6% des dépôts de brevet), la Suisse (7ème) et le Royaume-Uni (8ème : 2,6%).
Un futur terrain de chasse pour les "patent troll" ? Les «Troll à brevets» (en français) sont des
société qui ne produisent ni bien ni service mais utilisent la concession de licence et le litige de brevets comme principale activité économique. Le principe ? Le troll acquiert des brevets, les valorise puis cherche à vendre des licences d’exploitations de ces titres de propriété auprès d’entreprises produisant des biens ou des ser-vices en rapport avec ces brevets. Si celles-ci re-fusent, les trolls les assignent devant un tribunal pour contrefaçon des dits brevets. Ce chantage s’exerce surtout sur des brevets litigieux dont la solidité juridique est fragile: logiciels, méthodes commerciales, novations des starts-up… Pour exemple, en 2006, la société RIM qui fabriquaient les Blackberry a du verser 612,5 millions$ à la société NTP pour régler à l’amiable un conten-
tieux engagé devant les tribunaux américains. Ericsson, Nokia et BAE Systems, entre autres,
s’inquiètent déjà des dérives possibles du « Bre-vet unique européen ». Pourtant, selon les ex-perts, les firmes attaquées ne sont pas des grands groupes mais plutôt des PME ou des entreprises de taille intermédiaire.
n LA CORRUPTION DANS L’UE : LE CONTRASTE NORD-SUD
Selon le récent classement établi par Transpa-rency International relatif au degré de corruption dans 176 pays, l’Italie et la Grèce sont les mau-vais élèves de l’UE, occupant respectivement les 72è et 94è places mondiales. L’Italie affiche ainsi un niveau de corruption équivalent à celui de la Tunisie et la Grèce égale à celui de la Colombie.
Rang Pays Rang Pays1 Danemark 17 Roy.-Uni 1 Finlande 22 France 4 Suède 30 Espagne9 Pays-Bas 33 Portugal13 Allemagne 72 Italie16 Belgique 94 Grèce
L’Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie sont les pays les plus corrompus au monde, occu-pant ex-aequo la dernière place du classement.
Pour réaliser ce classement qui ne reflète que la « perception de la corruption affectant les admi-nistrations publiques et la classe politique », l’ONG s’est appuyée sur des données collectées par treize institutions internationales dont la Banque mon-diale, les banques asiatique et africaine de déve-loppement ou encore le Forum économique mon-
dial. Les différentes formes de corruption prises en compte recouvrent les marchés publics truqués, les emplois fictifs, les abus de pouvoir dans la fonction publique, la corruption d’agents publics, les abus de biens sociaux, les prises illégales d’intérêt, les versement de pots de vin…
n L’UE27 CONSACRE PRÈS DE 30% DE SON PIB À LA PROTECTION SOCIALE
Selon Eurostat, les dépenses de protection so-ciale des 27 pays de l’UE sont passées de 26,1% du PIB en 2007 à 29,4% en 2010, «en grande partie en raison de la crise économique». Cette moyenne masque de fortes disparités puisque ces dépenses sont supérieures à 30% dans sept pays : France (33,8%), Danemark (33,3%), Pays-Bas (32,1%), Allemagne (30,7%) et Finlande (30,6%). A l’opposé, elles sont inférieures à 20% essentiellement en Europe de l’Est, notamment en Roumanie, Lettonie, Slovaquie et en Pologne. Pour l’Institut, trois raisons majeurs expliquent ces écarts : les différences de niveaux de vie, la diversité des systèmes nationaux de protection sociale, les structures démographiques, écono-miques et sociales propres à chaque pays.
Dans l’ensemble des pays de l’UE, les dépenses relatives aux principales catégories de presta-tions (retraites, santé, familles) ont toutes aug-menté d’environ 10% entre 2007 et 2010 tandis que les prestations de chômage progressaient d’un tiers, témoignant de l’impact de la crise.
Les deux principales sources de financement de la protection sociale dans l’UE 27 sont les contri-butions publiques provenant des impôts (40%) et des cotisations sociales (56%).
Sources : La Tribune, Euronews, Le Mag IT, Le Monde, AFP
REVUE DE PRESSE EUROPEENNE
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 5 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
JDP113.indd 5 06/02/13 17:38

MASTER DOSSIER : FORMATION
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 6 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
Seulement 54% des
cadres et dirigeants
de PME accèdent
à une formation au
moins une fois par an
contre 75% dans les
grandes entreprises.
LES BONNES RAISONS DE SUIVRE UNE FORMA-TION CONTINUE p. 6
LES GRANDES ÉCOLES ET L’INTERNATIONAL p. 7
LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI p. 8
ECLAIRAGE SUR L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE p. 9
de sa compétence et/ou de sa rémunération. Dans le cas d’un changement encore plus radi-cal (changement de métier), celui-ci doit être accompagné d’une réflexion approfondie à partir d’un bilan de compétence.
POURQUOI AGIR SUR MON PARCOURS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
C’est pour :• Mieux connaître et comprendre mon environnement• Développer mes capacités d’adaptation• Anticiper un changement de situation• Repérer des opportunités et les saisir• Acquérir des connaissances et continuer à apprendre. Me plonger ou me replonger dans un milieu profes-sionnel• Evoluer professionnellement• Réactualiser mes compétences professionnelles ou
générales• Changer d’orientation pour aller vers un autre métier• Acquérir une qualification professionnelle• Créer mon activité
2. Se remettre en question Pour réussir un changement de vie ou d’acti-
vité, la formation est incontournable. Cela sup-pose nécessairement d’avoir une vision claire de la finalité recherchée. Plus le projet est ambi-tieux, plus il nécessite de se poser la question du pourquoi de cette formation et pas une autre ? Quel est l’objectif poursuivi ? Pourquoi main-tenant ? Quel type de formation suivre (présen-tiel, à distance, e-learning…) ? Il s’agit égale-ment d’être clair dans sa situation personnelle et avoir le soutien de sa famille.
3. Mettre à jour ses connaissances / conso-lider ses acquis
Afin de mettre à jour ses compétences, il est recommandé d’effectuer un point sur ses connaissances professionnelles tous les 10 ans. C’est à l’occasion de l’entretien professionnel avec son employeur que cette question doit être évoquée. Il est important d’évoquer les mobiles de cette volonté de formation comme par exemple : la volonté de reprendre confiance en soi ; se remotiver ; s’armer contre le stress ; mieux gérer son temps…
veille destiné à suivre les nouvelles offres de formation. Il s’agit également de tenir compte de l’interaction entre les 3 interlocuteurs prin-cipaux que sont : l’employeur, les financeurs, l’organisme de formation. Avec chacun d’eux, une négociation s’impose sachant que la durée totale de mise en place du dossier peut s’étaler sur plusieurs mois :
Employeur : Objet de la formation, disponi-bilité, dates d’absence, traitement des dossiers en cours… :
Financeur : Dossier à monter sachant que les financeurs peuvent être multiples (employeur, CIF, DIF, région…) ;
Organisme : Dossier d’inscription à réali-ser dès mars pour envisager une formation en septembre nécessitant l’envoi de CV, lettre de motivation, attestations, test obligatoire pour certains domaines. Par exemple, en gestion, 220 formations universitaires exigent de passer le test Score qui évalue la culture générale, éco-nomique et managériale des candidats. Vient ensuite, après la sélection sur dossier, la phase des entretiens d’entrée qui sert à vérifier que le candidat est motivé et qu’il s’oriente bien vers la bonne formation.
10 BONNES RAISONS DE SE FORMER
A tout moment de la vie professionnelle, il est possible de progresser dans son activité, changer de métier, faire un virage à 180° ou simplement continuer d’apprendre. Les principales raisons pour évoluer dans sa carrière professionnelle sont les suivantes :
1. Donner une nouvelle impulsion à sa car-rière
Dans la pratique de son métier, des évolutions professionnelles sont forcément constatées et/ou nécessaires. Il peut s’agir d’évoluer techni-quement dans sa fonction ou encore d’arrêter de fonctionner de manière plus ou moins empi-rique, en souhaitant alors acquérir des connais-sances précises et/ou académiques dans certains domaines clés. L’acquisition de tout nouveau savoir-faire est une marche de plus qui élève for-cément l’individu vers le haut de sa condition,
n LES BONNES RAISONS DE SUIVRE UNE FORMATION CONTINUE
UNE MARCHE POUR ACCÉDER PLUS HAUT
En France, 1 salarié sur 3 suit tous les ans une formation continue de 30 heures en moyenne. Une durée moyenne qui tend d’ailleurs à bais-ser régulièrement depuis le milieu des années 70 en étant divisée par 2. C’est le contraire pour la dépense globale affectée à la formation profes-sionnelle et à l’apprentissage qui, elle, augmente régulièrement pour atteindre les 30 000 millions d’euros en France (2008) avec une part qui re-présente, en moyenne, 2.9% de la masse sala-riale de l’entreprise. La répartition n’est pas pour autant égalitaire selon la taille de l’entreprise ou sa situation géographique. Par exemple, se-lon une enquête réalisée par l’association Ariane Compétences et management, «Seulement 54% des cadres et dirigeants de PME accèdent à une formation au moins une fois par an contre 75% dans les grandes entreprises».
Ce qui est sûr, c’est qu’une bonne formation au bon moment ouvre des perspectives d’évolu-tion personnelle et professionnelle. Pour Michel Wissler, expert de la formation continue à l’IAE de Lyon, «Dans certaines de nos formations, les deux tiers des participants changent de poste en cours de route. S’ils se sont inscrits dans cette démarche, c’est qu’ils sont moteurs dans leur en-treprise laquelle sent bien qu’ils sont ouverts et capables d’aller loin. Naturellement, l’entreprise leur confie de nouvelles missions». Autant dire que le fait de suivre une formation est un bon départ pour évoluer professionnellement mais aussi que la route est longue et demande un investissement personnel important.
3 INTERLOCUTEURS
D’une manière générale, le fait de vouloir suivre une formation continue nécessite de s’y prendre à l’avance en menant un travail de
JDP113.indd 6 06/02/13 17:38

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 7 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
• Immersion dans une langue et une culture dif-férente (ou plusieurs)• Apprentissage des connaissances académiques clés d’aujourd’hui et de demain • Formation aux carrières du commerce, de la gestion, du management, du marketing, des technologies de l’information, des sciences de l’ingénieur, de la finance, de l’entrepreneuriat…• Parcours d’enseignement libre dans ses diffé-rentes options• Possibilité de vivre des expériences et des ami-tiés inoubliables• Esprit d’équipe et d’entraide de type «promo» de nature servant après les années d’étude• Développement d’un réseau de contacts à l’étranger très utile sur le plan professionnel• Réalisation de stages et/ou de séminaires ci-blés (business, interculturel, rencontres de diri-geants…)• Maîtrise finale de 2 à 3 langues (dont le fran-çais)• Bonne image de marque du diplôme auprès des entreprises• Possibilité d’obtenir un double diplôme en cas de passage dans une autre université
LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Plus de 200 000 étudiants sont actuellement formés dans les établissements supérieurs. Aussi pour bien choisir son école, il est recommandé d’appliquer une première série de critères de sélection :
1. La réputation de l’établissement2. Le niveau de reconnaissance par l’Etat vali-
dant les compétences professionnelles ensei-gnées
3. Le visa qui garantit la qualité pédagogique du diplôme
4. Le grade de master pour les écoles en 5 ans avec l’accréditation internationale AACSB, AMBA, Equis et/ou Epas.
5. Le classement des établissements post bac en 4 ou 5 ans à partir du palmarès réalisé notam-ment par le site letudiant.fr qui permet de réa-liser son propre classement interactif à partir de critères sélectifs.
n LES GRANDES ÉCOLES ET L’INTERNATIONAL
PRÈS DE 400 ÉTABLISSEMENTS EN FRANCE
Ce sont généralement les grandes écoles de commerce, certaines universités ainsi que les écoles d’ingénieurs qui proposent les filières misant sur l’international ou encore les fameux MBA. Elles sont actuellement à peu près 400 en France. Alors que depuis 2000, toutes les écoles de commerce imposent des stages à l’étranger ou des échanges universitaires à leurs élèves durant une partie de leur cursus (au minimum 25% du temps), d’autres ont carrément opté pour au moins 2 séjours distincts à l’étranger. Les éta-blissements les plus impliqués ont même installé des sites «offshore» et campus à l’étranger afin de favoriser une immersion encore plus grande, voire l’obtention d’un double diplôme. L’objec-tif est d’offrir aux étudiants qui souhaitent tra-vailler directement à l’étranger, la possibilité de trouver plus facilement des contacts locaux. Par exemple, en 2012, 16% des diplômés français des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs ont trouvé leur premier emploi hors de France.
LES AVANTAGES POUR L’ÉTUDIANT
Il est clair que les séjours à l’étranger laissent des traces profondes d’intérêt et de motivation qui font que beaucoup n’ont plus envie de reve-nir en arrière, ni même de revenir en France. Se-lon Bernard Belletante, directeur général d’Euro-med Management, «Cette ouverture culturelle est fondamentale. C’est elle qui permettra la différen-ciation de nos étudiants sur le marché du travail. Par exemple pour les compétences techniques en gestion, les jeunes diplômés de Chine ou d’Inde possèdent les mêmes et, en plus, ils sont moins chers !». Bien que le cursus dure en général de 4 à 5 ans, du début jusqu’à la fin dans le même établissement ou 3 ans après un bac+2, l’intérêt de l’international est d’apporter aux étudiants un certain nombre d’avantages tels que :
encore développer leur leadership. Pour cela, un retour à la case «formation» s’avère souvent utile et nécessaire dans une multitude de savoir-faire complémentaires.
7. Changer de fonction/ voie profession-nelle
Dans beaucoup d’entreprises les passerelles entre fonctions sont possibles et gagnent à être soutenues par une formation complémentaire. C’est le cas, par exemple, lorsque l’on souhaite passer de la fonction technique à la gestion d’une activité régionale, d’un poste marketing à la fonction commerciale, de la publicité à la communication.
8. Décrocher un diplôme C’est le cas pour de nombreux autodidactes
talentueux qui ont réussi à gravir les échelons grâce à leurs qualités personnelles en occupant des postes importants mais pour lesquels ils n’ont pas le diplôme académique. Dans ce cas, la meil-leure façon de «mettre les pendules à l’heure» dans un objectif de changement d’entreprise ou simplement pour valider leur expérience, il est nécessaire de sauter le pas en pratiquant la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) et/ou en s’impliquant dans une formation diplômante de niveau II ou III dans le cadre d’un CIF.
9. Créer son entrepriseLorsque l’on est chômeur, licencié pour raison
économique, à la retraite, ou que l’on souhaite se mettre à son compte, la formation permet de faciliter la reconversion en évitant les erreurs de débutant qui obligent à jeter rapidement l’éponge ou à se confronter à de grosses diffi-cultés. Des structures comme l’Adie ou France Initiative aident à tester le concept, trouver un financement et choisir le bon statut pour entre-prendre.
10. Envisager sa retraite avec sérénitéAfin d’éviter que la fin d’activité profession-
nelle soit mal vécue par une perte de repères ou une perte d’identité, certaines entreprises pro-posent à leurs collaborateurs sur le départ de les aider à mettre en œuvre un projet motivant (voyage, création d’activité, découverte de loi-sirs physiques, manuels ou intellectuels…).
4. S’adapter à l’entrepriseLorsque l’entreprise doit être rachetée, qu’elle
se développe à l’étranger et/ou que les échanges professionnels supposent la maîtrise d’une langue étrangère, il est alors vital d’envisager de participer à des modules de formation conti-nue (langue, culture, procédures techniques…) ou encore à ses produits, règles culturelles et juridiques.
CE QUE JE PEUX FAIRE
• Effectuer un bilan de compétences (ou BCA pour les chômeurs)
• Bénéficier du droit individuel à la formation (DIF)• Suivre une formation grâce au plan de formation
de l’entreprise• Demander un congé individuel de formation (CIF)• Me former dans le cadre d’une période de profes-
sionnalisation • Obtenir un contrat de professionnalisation• Effectuer une validation des acquis de l’expérience
(VAE)• Obtenir une formation spécifique (pour les chô-
meurs) • Poursuivre mon parcours par une formation qua-
lifiante • Faciliter mon accès direct à l’emploi (POE)
5. Améliorer son employabilitéL’amélioration de la productivité et de l’effica-
cité suppose une attitude proactive en proposant par soi-même d’apprendre de nouveaux logiciels, connaître les dernières lois, obligations environ-nementales ou méthodes managériales. Cela per-met également d’enrichir son CV en démontrant sa capacité à faire évoluer ses connaissances, ce qui est un véritable plus à l’occasion d’un futur entretien d’embauche ou d’une demande d’aug-mentation de salaire.
6. Acquérir une compétence complémen-taire
C’est le cas notamment pour les cadres et le middle management qui doivent, en plus de la maîtrise d’un savoir diplômé, de l’acquisition d’un savoir-faire maison et d’un perfectionne-ment fonctionnel et/ou opérationnel sur le ter-rain, savoir également dominer dans la finesse les modes relationnels et de management, ou
JDP113.indd 7 06/02/13 17:39

MASTER DOSSIER : FORMATION
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 8 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
3. L’entreprise retient un candidat et élabore avec Pôle Emploi un plan de formation qui pré-cise les compétences à acquérir, ainsi que le contenu et les modalités pratiques de réalisation de la formation. 4. L’organisme paritaire collec-teur agréé (Opca) dont relève l’entreprise peut être associé à l’élaboration du plan de formation.
5. L’entreprise signe une convention POE avec Pôle Emploi et l’Opca concerné en précisant les objectifs de la formation, les modalités de finan-cement, la date prévisionnelle d’embauche et la forme du contrat d’embauche.
6. Pôle Emploi finance la formation dont la durée est plafonnée à 400 heures, laquelle peut être dispensée par le service formation du futur employeur ou par un organisme de formation externe.
7. Si la formation est dispensée en interne, le niveau maximal de financement est fixé à 5 euros par heure. L’aide versée par Pôle Emploi peut donc s’élever à 2 000 euros au maximum.
8. Si la formation est délivrée par un orga-nisme extérieur, Pôle Emploi peut exiger 2 devis. Le financement des coûts pédagogiques peut al-ler jusqu’à 8 euros par heure, soit 3 200 euros au maximum, voire même en cas de POE renforcée jusqu’à 14 euros par heure.
9. L’aide est versée directement à l’entreprise si celle-ci a réalisé la formation au sein d’un service interne. Dans le cas contraire, l’aide est versée au prestataire de formation. Le versement de l’aide est conditionné au bilan de la forma-tion et à l’embauche prévue par la convention POE. Au plus tard 6 mois après la fin de la POE, l’entreprise doit présenter un bilan de la forma-tion, une copie du contrat de travail signé et une facture du prestataire de formation externe. 10. Les situations de non-embauche sont appré-ciées au cas par cas faisant que même dans cette éventualité, l’aide peut être versée :• Si la formation a été réalisée par un organisme externe ;• Si le demandeur d’emploi a abandonné la for-mation ou refusé l’embauche ;• Au vu du bilan de la formation si elle a été dispensée par un service interne.
tant de développer les compétences nécessaires. Si la POE vise plusieurs demandeurs d’emploi pour un même employeur, un plan de formation doit être élaboré pour chacun d’eux. Une période de tutorat dans l’entreprise (ou un de ses éta-blissements) peut être également associée à la formation en organisme interne ou externe.
LA POE COLLECTIVE
La loi du 28 juillet 2011 a créé la POE collective. Son objectif est que les branches professionnelles et les Opca recueillent les besoins de formation de leurs entreprises adhérentes afin de mettre en place les ac-tions de formation afférentes. Son déclenchement ne dépend pas du dépôt effectif d’offres d’emploi mais du recensement des besoins de recrutement expri-més par les entreprises d’une branche ou d’un bassin d’emploi. Ce recensement a pour but de permettre d’anticiper les offres d’emploi effectives et d’organi-ser des opérations de formation afin de préparer les demandeurs d’emploi à y répondre. Les conditions opérationnelles et contractuelles sont les mêmes que pour la POE avec les aménagements suivants :• Ce dispositif bénéficie à tout demandeur d’emploi,
indemnisé ou non, auquel est proposé un emploi nécessitant une adaptation par le biais d’une formation réalisée par l’organisme de formation interne de l’employeur ou un organisme de for-mation externe. Ainsi, un demandeur d’emploi en activité peut bénéficier d’une POE si les horaires de formation et son activité parallèle sont com-patibles.
• L’offre d’emploi doit être située dans la zone géogra-phique privilégiée définie par le Ppae (projet per-sonnalisé d’accès à l’emploi) du demandeur d’emploi.
• La durée de travail est d’au moins 20 heures hebdo-madaires (sauf pour les personnes handicapées).
• Le conseiller Pôle emploi doit vérifier que la for-mation est véritablement nécessaire avant l’em-bauche et qu’elle ne peut être mobilisée au cours du contrat de travail. Pôle emploi peut refuser de mettre en place la POE si l’employeur a précédem-ment bénéficié d’un dispositif de formation de pré-recrutement et n’a pas embauché, sans motif légitime, le demandeur d’emploi ou l’a embauché à des conditions moins avantageuses que celles pré-vues ou qu’il n’a pas assuré, en cas d’embauches rapidement rompues, un reclassement durable en fin de période d’essai.
n LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI
SE FORMER AVANT L’EMBAUCHE
La POE (Préparation opérationnelle à l’emploi) est un dispositif entériné par la loi du 25 no-vembre 2009 dans le cadre du développement de la formation tout au long de la vie, de la professionnalisation et de la sécurisation des parcours professionnels à destination principale des demandeurs d’emploi. Ce dispositif est des-tiné à former les demandeurs d’emploi avant de les embaucher en leur permettant un retour à l’emploi dans le cadre d’actions individuelles ou collectives d’une durée maximum de 400 heures. La mise en œuvre de la POE s’effectue préalable-ment à l’entrée dans l’entreprise et se conclut par une embauche définitive. Elle concerne tous les employeurs du secteur public et privé à jour de leurs contributions d’assurance-chômage qui ont un projet d’embauche qu’ils ne parviennent pas à satisfaire. Dans ce cadre, une convention est signée entre l’entreprise, le Pôle emploi et l’Opca locale, en définissant les compétences que le demandeur d’emploi doit acquérir au cours de l’action de formation pour occuper l’emploi pro-posé. Durant cette action, le bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation profession-nelle. A l’issue de la formation, l’employeur ré-dige un contrat de travail sous forme de contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, CDI ou CDD d’au moins 12 mois, avec le deman-deur d’emploi ayant atteint le niveau requis pour l’emploi proposé.
COMMENT SE DÉROULE LA POE ?
1. Dépôt préalable d’une offre d’‘emploi par l’entreprise auprès de Pôle Emploi.
2. Si aucun candidat ne satisfait aux exigences du poste proposé, Pôle Emploi présélectionne parmi les demandeurs d’emploi inscrits les per-sonnes susceptibles de correspondre au poste, à condition de bénéficier d’une formation permet-
6. La taille de l’association des anciens élèves7. L’appartenance de l’école à un groupe ou
réseau à l’international8. Le nombre d’élèves à l’étranger9. La date de création de l’école10. La pédagogie et son corps enseignant11. La dynamique et qualité du programme12. La participation à des programmes
d’échange
FRAIS DE SCOLARITÉ Principales grandes écoles bénéficiant d’une ou plu-sieurs accréditations internationales avec indication des frais de scolarité pour un Master 1 (4 ans) avec, entre parenthèses, le salaire minimum à l’embauche des diplômés :
10 premiers établissements dont le premier niveau d’entrée est le bac :EBS (Paris) 7 800€ (33 500€)EDC (Paris) 7 500€ (31 000€)EM Normandie 7 525€ (32 000€)ESCE (Paris) 8 000€ (32 800€)Esdes (Lyon) 6 750€ (31 100€)ESG (Paris) 7 400€ (31 000€)Essca (Angers, Paris) 7 350€ (32 000€)Ieseg (Lille, Paris) 7 500€ (32 000€)Ipag (Paris, Nice) 7 200€ (31 000€)Novancia (Paris) 7 200€ (32 500€)
10 premiers établissements dont le premier niveau d’entrée est à bac+2 :Essec (Cergy-Pontoise) 15 000€ (36 000€)HEC (Jouy-en-Josas) 11 900€ (36 000€)ESCP Europe (Paris) 11 500€ (36 000€)Edhec (Lille, Paris, Nice) 11 200€ (36 000€)ESC (Toulouse) 9 900€ (32 500€)ISC (Paris) 9 565€ (31 000€)Essca (Angers, Paris) 7 350€ (32 000€)ESC (Grenoble) 9 440€ (32 500€)Rouen Business School 9 000€ (33 000€)ISG (Paris) 8 990 (31 000€)Etablissements en région Altantique Audencia (Nantes) 8 400€ (33 000€)Escem Tours-Poitiers 8 260€ (32 500€)ESC La Rochelle 7 800€ (31 000€)Source : Palmarès L’Express N°3149
JDP113.indd 8 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 9 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
issues directement de l’enfance de ses patients avec les affects, inhibitions et état d’esprit d’alors. En s’inspirant des travaux de la psychanalyse Freudienne (Ça, Moi, Surmoi), Berne a pu établir une défi nition de la structuration de la person-nalité et de la croissance de l’être humain qui s’éloigne de la théorie de la pensée freudienne sur deux thèmes essentiels :
• Celui du scénario de vie, plan élaboré depuis l’enfance comportant une série de décisions qui vont être mises en œuvre tout au long de la vie autant dans la manière de se comporter que de mener son existence ;
• Celui de l’aspect réversible des décisions prises, donc d’un changement qualitatif et dynamique possible à n’importe quel moment de la vie.
Dans son rapport 2006, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a repris la controverse historique concernant certains aspects de la théorie de l’analyse transactionnelle et a pointé les dérives de certains praticiens de l’ana-lyse transactionnelle à propos des dangers qu’«une pratique inappropriée de l’analyse transactionnelle est susceptible d’engendrer». Ce rapport ne remet toutefois pas en cause l’ensemble des théories et des pratiques de l’Analyse Transactionnelle en mode formation ou thérapeutique.
LES ÉTATS DU MOI
Afi n de simplifi er le discours psychiatrique et permettre au praticien, comme au patient, d’avoir un langage commun, Eric Berne a volon-tairement choisi des termes simples pour prati-quer l’AT avec des mots et des expressions pris dans le registre courant et métaphorique.
L’objectif étant que, grâce à leur usage, chaque patient puisse devenir pleinement conscient de son état mais aussi co-acteur de son propre dia-gnostic et de sa guérison.
En souhaitant créer une sorte de système de «psychiatrie sociale» à grande échelle, Berne
a réussi à caractériser les états du Moi à partir de concepts relativement simples fondés sur les états psychologiques de l’Enfant, de l’Adulte et du Parent.
Pour lui, chaque état du Moi se défi nit comme un «système cohérent de pensées, d’émotions et de comportements associés» se juxtaposant aux préceptes de la psychanalyse moderne.
C’est cette avancée qu’apporte l’Analyse Tran-sactionnelle permettant, en temps réel et de manière beaucoup plus précise, l’observation des interactions entre personnes selon la nature du «contrat» relationnel qui s’établit entre elles.
PARENT, ENFANT, ADULTE
Du point de vue de la structure de la personne, l’AT distingue trois types d’états du Moi ou 3 expressions de la personnalité :
• Le Parent : Cet état du Moi correspond aux pensées, émotions et comportements que tout individu a pu faire siens à partir de l’infl uence et/ou de l’exemplarité des fi gures parentales ou éducatives marquantes. Il s’agit ici d’imitation dans un cadre de normativité destinée à contrô-ler la situation de manière plus autoritaire et rigide.
Parent normatif : énonce des règles et devoirs en utilisant l’autorité pour les faire appliquer ;
Parent nourricier : développe les motivations, réponds aux besoins ;
Parent persécuteur : critique, écrase, abuse de son pouvoir ;
Parent salvateur : agis à la place des autres de manière étouffante.
n ÉCLAIRAGE SUR L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
SAVOIR CE QUI SE JOUE «ICI ET MAINTENANT»
Il est toujours intéressant de mieux com-prendre les mécanismes présidant aux compor-tements humains afi n de se former utilement. En ce sens, l’Analyse Transactionnelle (AT) apporte sa contribution et doit s’appréhender comme une approche de la personnalité et de la commu-nication interindividuelle. Son objet est d’étu-dier les phénomènes intrapsychiques de chaque individu à l’occasion d’échanges relationnels appelés «transactions». Selon son fondateur Eric Berne, médecin psychiatre américain, qui la mise en place dans les années 1950 à 1970, l’AT vise à permettre une prise de conscience ainsi qu’une meilleure compréhension de «ce qui se joue ici et maintenant» dans les relations entre deux per-sonnes ainsi que dans les groupes. Elle propose, pour cela, une grille de lecture permettant la compréhension des problèmes relationnels ainsi que des modalités d’intervention pour résoudre, mais aussi qualifi er les échanges humains. Il est vrai que si tout le monde disposait de qualités relationnelles innées, le monde tournerait avec effi cience et harmonie. C’est justement parce que les relations courantes entre les individus sont le plus souvent imparfaites, rigides, inhi-bées, manipulatrices, que l’approche de l’Analyse transactionnelle peut être utile pour chacun de nous.
AU-DELÀ DE FREUD
A l’origine de cette théorie, Eric Berne a observé que dans certains contextes ses patients agis-saient, par mimétisme, comme le faisait l’un de leurs parents, sans avoir vraiment conscience de l’origine de ces comportements ni des émotions ni de la manière de penser qui les sous-tendent.
Il a également établi qu’à d’autres moments se présentaient des résurgences de comportements
POITOU-CHARENTES
98 % des entreprises adhérentes chez Opcalia se déclarent satisfaites des formations qu’elles ont engagées (*). Nous renforçons constamment nos capacités de conseil, d’accompagnement et de financement pour maintenir et mériter votre confiance.
Comme 110 000 entreprises qui nous font déjà confiance, choisissez Opcalia pour faire le bon investissement et accompagner la Formation de tous vos salariés.
* Source : enquête annuelle Conjoncture Opcalia 2012 - 2013, réalisée en Octobre-Novembre dernier auprès de nos adhérents, ayant recueilli 3 544 réponses d’entreprises de toutes tailles, toutes régions et tous secteurs.
Contactez nos Conseillers Formation
opcalia-pc.com
Plus haut, plus calme, plus simple
JDP113.indd 9 06/02/13 17:39

MASTER DOSSIER : FORMATION
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 10 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
3. L’activité : Il s’agit ici d’un moment d’échange ou de présence dans le but de faire quelque chose au sein du groupe.
4. Le passe-temps : Il caractérise les conver-sations sur des sujets stéréotypés telles que les conversations de salon, la langue de bois, la pluie et le beau temps.
5. Le rituel : Il s’agit d’échanges normalisés, standardisés, codifi és (ex. se saluer) permet-tant d’échanger des signes de reconnaissance destinés à conserver un semblant de bon climat social. En ce domaine, chaque type de groupe a ses propres rituels.
6. Le retrait : L’individu se met volontaire-ment à l’écart physiquement ou psychologique-ment.
LA MÉCONNAISSANCE
Sur le fond, toute l’approche de l’Analyse Tran-sactionnelle repose sur la réparation des défor-mations comportementales et psychologiques issues de la méconnaissance profonde de soi et des autres tout au long de l’évolution person-nelle. Elle a ainsi pour fonction essentielle de comprendre et d’améliorer l’échange entre les individus selon une triple grille de méconnais-sances :Problématiques existentielles issues de 3 do-maines de méconnaissance : • La méconnaissance de soi• La méconnaissance des autres • La méconnaissance de la situation Problématiques d’identifi cation à l’intérieur de chaque domaine distinguant 3 registres de mé-connaissance : • Des signes du problème• Du problème lui-même • Des options de solutions Problématiques cognitives formant 4 niveaux de méconnaissance : • De l’existence du phénomène • De la signifi cation de celui-ci• Des possibilités de changement de celui-ci • Des aptitudes personnelles vis-à-vis du phé-nomène
LA STRUCTURATION DU TEMPS
LA GESTION DES SENTIMENTS
Selon l’Analyse Transactionnelle, en plus du senti-ment pur et authentique, il existe 3 formes de sen-timents dont la manifestation consiste à brouiller les transactions :• Les sentiments accumulés ou «Timbres» : Un
timbre est un sentiment non exprimé sur le coup et conservé qui peut se retrouver avec d’autres dans une «Collection de timbres» de taille variable. Une collection de timbres pleine se transforme alors en violence, maladie, mort, etc.
• Les sentiments parasites ou «Rackets» : Depuis le cercle familial primaire où certains senti-ments sont plus permis que d’autres, l’enfant puis l’adulte utilise plus volontiers le sentiment «au-torisé» plutôt que celui qui est «interdit» mais néanmoins plus pertinent.
• Les sentiments réactivés ou «Élastiques» : C’est le cas dans une situation peu affective mais qui rappelle une situation ancienne fortement chargée affectivement.
Dans l’AT, il est possible de regrouper les sentiments en 4 grandes catégories comprenant chacune des sentiments d’intensité variable :- Joie- Tristesse- Colère- Peur
Il existe 6 manières de structurer les rapports entre les individus en matière d’émission de signes de reconnaissance lorsqu’il s’agit soit de favoriser le rapprochement, la proximité ou, au contraire, entraîner la distance et la séparation entre eux. Ces 6 rapports vont de l’apport quali-quantitatif le plus intense (qu’il soit positif ou négatif) au plus faible (pas d’échange du tout) :
1. L’intimité : Elle correspond aux moments où la communication est ouverte, basée sur la confi ance, le respect et l’acceptation de l’autre. Ce rapport permet des échanges de signes de reconnaissance positifs de grande qualité et de grande intensité.
2. Les jeux psychologiques : Ils permettent des échanges de signes de reconnaissance in-tenses, mais souvent négatifs.
LES CERTITUDESDurant l’enfance, l’individu acquiert des certitudes sur lui, son mode de vie, ses capacités physiques ou intellectuelles, façonnant ainsi son rapport à lui-même mais aussi et surtout aux autres. Ces cer-titudes façonnent des scénarios d’échange et des types de rapports sociaux prenant appui, selon les contextes, sur 4 positions de base :• Je suis OK, vous êtes OK (++) : C’est la relation
idéale entre adultes• Je suis OK, vous n’êtes pas OK (+-) : Ce type de
relation induit le sentiment de supériorité, le mé-pris, la domination
• Je ne suis pas OK, vous êtes OK (-+) : Cette rela-tion induit la frustration, la jalousie, le sentiment d’infériorité
• Je ne suis pas OK, vous n’êtes pas OK (--) : Elle induit le renoncement, le suivisme, la passivité
Les transactions simples croiséesLa communication s’arrête ou change de mode
lorsque les transactions sont croisées. C’est le cas lorsqu’une personne s’adresse à un autre état du Moi que celui dans lequel se trouve son par-tenaire. Cette transaction croisée change l’équi-libre relationnel entre les protagonistes.
Exemple 1 bisA : «Avez-vous pu appeler le client ?» (Adulte - Adulte)B : «Non, j’ai été accaparé par la préparation de la réunion qui a pris tout mon temps» (Enfant - Parent)Cette transaction croisée est susceptible de causer une détérioration de la relation car alors «A» peut répondre avec une transaction de type Parent à En-fant, comme :A : «Si vous ne le faites pas rapidement, je vous retire le dossier»
Exemple 3 bisA : «Vous auriez dû terminer le travail hier»
(Parent - Enfant)B : «Il est disponible depuis ce matin» (Adulte
- Adulte)Transactions doublesDans ce type de transactions, la conversation
se déroule à un niveau social explicite (dit) alors que, dans le même temps, d’autres transactions sont échangées au niveau psychologique du non-dit. Par exemple :
A : «Pouvez-vous venir prendre dans mon bu-reau un courrier en note» (Mots Adulte) alors que le langage corporel indique la complicité et l’intention sexuelle (Enfant fl irtant)
B : «Bien sûr, je fi nis et j’arrive tout de suite» (Réponse à la déclaration Adulte) alors qu’il existe un sourire ou un clin d’œil complice (l’En-fant accepte le motif caché).
LES SIGNES DE RECONNAISSANCESelon Berne, chaque individu recherche en perma-nence des signes de reconnaissance (stroke) consi-dérant que ceux-ci sont vitaux pour lui (écoute, acceptation, oui, regard amical, utilisation du nom ou prénom, poignée de main, contact visuel…). L’observation enseigne qu’à défaut de signes de reconnaissance positifs une personne tend plus également à accepter des signes de reconnaissance négatifs (violence verbale ou physique, irrespect, dénigrement…), prouvant ainsi qu’il existe tout de même dans la vie des autres, que zéro signe de reconnaissance ou une indifférence totale.
Ainsi, le poids du conditionnement éducatif se véri-fi e souvent dans le comportement des individus. Par exemple, une personne habituée dès le plus jeune âge à recevoir des signes de reconnaissance négatifs sera plus encline à en recevoir toute sa vie, voire à refuser les signes de reconnaissance positifs. A l’in-verse, pour une personne habituée aux marques po-sitives du savoir-vivre et de la bonne éducation, tout comportement rustre ou indifférent est pris comme une offense impardonnable. Dans l’AT, la gestion des signes de reconnaissance se fait sur cinq critères :· Donner· Recevoir· Demander· Refuser· Se donner
• L’Adulte : Cet état caractérise les émo-tions, pensées et comportements spontanés et congruents avec la réalité «ici et maintenant» portés par une dimension d’objectivité, d’esprit de responsabilité et d’honnêteté intellectuelle.
L’adulte écoute et interroge avec neutralité en sachant prendre du recul en raisonnant sans préjugé ni illusion en vue d’apporter de manière réaliste des solutions, régler les problèmes.• L’Enfant : Cet état correspond aux pensées, émotions, et comportements qui refl ètent une «reviviscence» du vécu perçu et/ou ressenti durant l’enfance en portant une dimension émo-tionnelle et affective de type :
Enfant adapté : accepte les normes de son environnement ;
Enfant libre : exprime directement ses senti-ments de manière indépendant et créative ;
Enfant rebelle : conteste l’ordre établi en étant impulsif et agressif ;
Enfant tyrannique : exige que les autres se plient à sa volonté ;
Enfant soumis : subis les règles en ruminant dans son coin.
Dans le principe de l’Analyse Transactionnelle les termes Parent, Adulte et Enfant ne sont pas en relation directe avec l’âge de la personne.
Par exemple dans une classe, un enfant qui réexplique la leçon à l’un de ses camarades de la même manière que le fait son maître ou sa maîtresse active son état du Moi Parent.
De la même manière, un individu de 50 ans qui parle fort ou rit de ses propres bêtises, amuse ses collègues de bureau par des histoires drôles, est dans un état du Moi Enfant.
EXEMPLE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Eric Berne décrit les variations de comportement de l’un de ses patients (un avocat) dont le rap-port à l’argent était de 3 types : «Dans son activité d’homme de loi et dans ses opérations fi nancières, il montrait une épreuve de la réalité très sûre. Il ma-niait de grosses sommes d’argent avec l’assurance, le jugement et le bonheur d’un banquier et il était prêt à dépenser de l’argent pour en gagner». C’est l’état Adulte. A d’autres moments, «Il rêvait de tout prodiguer pour le bien public. Il imitait effective-ment la conduite et l’état d’esprit de son père lors de ses activités de bienfaisance». C’est l’état Parent. En outre, il lui arrivait de voler «Des chewing-gums et d’autres babioles dans les grands magasins et il le faisait avec la même attitude désinvolte et la même technique avec lesquelles il volait des chewing-gums étant enfant». C’est l’état Enfant.
LES TRANSACTIONS
La transaction est le nom donné à un échange verbal et comportemental entre deux personnes correspondant à un ou plusieurs états du Moi. Elle comprend deux parties : le stimulus, ou message envoyé d’une personne à l’autre, et la réponse de celle-ci. Il existe 3 sortes de transactions : les transactions simples (complémentaires ou croisées) dans lesquelles se répondent alterna-tivement un état du Moi clairement identifi able et des transactions doubles où se répondent en apparence des états du Moi spécifi ques (exemple Parent) et en même temps, à un niveau sous-jacent, d’autres états du Moi (exemple Enfant).
1. Transactions simples complémentairesLes transactions sont complémentaires lorsque
les deux partenaires s’adressent à l’Etat du Moi dans lequel l’autre se trouve. Les échanges sur ce mode sont considérés comme stables et peuvent durer indéfi niment.
Exemple 1 d’échange Adulte - Adulte :A : «Avez-vous pu appeler le client ?»B : «Oui, il est d’accord sur notre proposition» Exemple 2 d’échange Enfant - Enfant :A : «Je suis crevé, et si on allait boire un
verre ?»B : «Avec plaisir, J’en ai marre aussi ?»Exemple 3 d’échange Parent - EnfantA : «Vous auriez dû terminer le travail hier»
(Parent - Enfant)B : «C’est pas de ma faute, je n’y suis pour
rien !» (Enfant - Parent)
JDP113.indd 10 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 11 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
Ainsi, fort de 35 personnes en équi-valent temps plein, l’ensemble dirigé par Sylvie Carré accueille 450 « apprenants » par an, et réalise 2,450 millions d’€ de chiffre d’af-faires annuel dans les domaines de la formation initiale, de profession-nalisation ou continue.
Rencontre avec le Président Philippe Chassemon et la Directrice de l’ISFAC à La Rochelle, Carine Devaud-Cajon.
Propos recueillis par Nathalie Vauchez
JDP : Quels sont les publics auxquels l’ISFAC s’adresse ?
Philippe Chassemon : Nous avons trois publics principaux.
Les contrats de professionnalisa-tion sur 2 ans, qui représentent 57 % de notre activité, s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d’emplois âgés de 26
les applique à la lettre sans capacité d’autonomie, d’esprit de responsabilité et de discernement.
Illustration des 5 drivers avec un exemple de croyance sous-jacente :
• Faire Plaisir : J’ai besoin de faire plaisir aux autres pour être aimé et recevoir des signes d’intérêt ou d’appartenance.
• Etre Fort : Je peux tout gérer seul, je n’ai besoin de personne pour décider ou agir car sinon je vais paraître incompétent.
• Etre Parfait : J’ai besoin de me sentir irréprochable, que tout soit exécuté de manière parfaite pour être apprécié (groupe, couple, famille, collègues…).
• Faire des Efforts : Plus je m’acharne, plus je trans-pire, plus ce que je fais est important, plus je mérite la reconnaissance des autres, peu importe le résultat fi nal et/ou les conséquences induites.
• Se Dépêcher : Je vais pouvoir tout faire même si je suis débordé afi n d’échapper aux critiques.
Principales sources utilisées : Challenges - L’Entreprise - L’Expansion - L’Express - www.transforme-action.ch
et le discernement) d’une manière adéquate et en fonction de chaque situation. Cela implique notamment d’être capable d’utiliser les 3 états du Moi et non se fi ger dans la dominance de l’un deux (exemple parent normatif) afi n d’enrichir le panel de ses propres vécus et ressentis.• Capacité d’intimité : Il s’agit d’être dans une relation authentique avec soi-même et avec l’autre, c’est-à-dire vraie et appropriée. Cela exclut toute forme de faux semblant, masque, manipulation ou jeux de rôle plus ou moins per-vers. Cette attitude doit concerner aussi bien les moments de sincérité, que les moments de par-tage amical, que les mises au point franches et fermes. Il s’agit ici de développer une capacité à assumer, proposer et/ou recevoir des moments relationnels forts.
LES MOTS D’ORDRE
C’est Taibi Kahler, docteur en psychologie, qui le premier a identifi é que les situations de stress (pression managériale, autorité, peur, pression sécu-ritaire…) peuvent rendre actifs des systèmes «mo-raux» de croyances personnelles. Il a ainsi identifi é 5 groupes de comportement nommés «drivers» qui peuvent conduire à des situations d’échec lorsqu’on
adaptations attendues de lui dans le fl ot de mes-sages dits et non-dits émanant de ses parents, de leurs attentes et de leurs projets le concernant. Dès lors, pour avoir leur attention et recevoir des signes de reconnaissance, l’enfant va s’effor-cer de s’ajuster à ce programme en faisant sien tout ce système de valeurs, en intégrant éga-lement les «répressions» implicites et explicites afi n de s’y conformer au mieux (injonctions ou interdits). C’est à partir de là que l’individu, tout au long de sa vie, met en œuvre ce «scénario de vie» en le justifi ant constamment au moyen de raisonnements plus ou moins contaminés.
CHANGER LE SCÉNARIO
L’une des idées essentielles de Berne et de l’Analyse Transactionnelle est d’agir directement sur l’aspect décisionnel, donc de redevenir actif ou proactif, dans l’adaptation du scénario subi depuis l’enfance afi n de se libérer des multiples infl uences conservatrices de son milieu, de son histoire et/ou de son entourage. Il en résulte que les décisions de survie, ainsi nommées ainsi parce qu’elles ont été élaborées dans un but pro-tecteur afi n d’obtenir les signes de reconnais-sance indispensables à la croissance, peuvent être changées par leur prise de conscience et «re-décidées», dans le cadre d’une sorte de résilience psychologique. C’est l’un des principaux buts de la formation ou de la pratique thérapeutique en AT que de remplacer les anciens comportements «scénariques» par des fonctionnements adaptés à la réalité de la vie «ici et maintenant». Selon Berne, le plus important est que l’individu puisse accéder à l’autonomie en quittant les in-fl uences négatives de son propre scénario de vie en s’impliquant pleinement et entièrement dans les 3 conduites suivantes :• Capacité de conscience : C’est accepter d’être en pleine interaction avec «l’ici et maintenant», comme en prenant la réalité telle qu’elle est, sans la fi ltrer ni la déformer, ni invoquer aucune croyance rassurante.• Capacité de spontanéité : C’est développer la faculté de ne pas réagir à l’environnement par des comportements automatiques, standardisés, stéréotypés (politiquement correct) mais comme nous le souhaitons intimement (par la volonté
La méconnaissance produit directement 3 types d’attitudes négatives formant la passivité, l’agressivité et la manipulation ou, en AT, «Com-ment faire pour ne pas y arriver» impliquant 4 grandes postures :• Ne rien faire • Se suradapter • L’agitation • User de violence contre les autres ou soi-même (incapacitation)
TOUT PART DE L’ENFANCE
Une grande partie de la théorie de l’Analyse Transactionnelle repose sur ce que l’on appelle le développement du «scénario de vie». Celui-ci prend forme au moment de l’enfance, période du-rant laquelle les messages émis par l’entourage de l’enfant ont une résonance toute particulière sur sa construction psychique. Des messages qui sont, à la fois, verbaux, non-verbaux et/ou se présentent sous forme de préceptes moraux, maximes, attributions, commentaires, modèles proposés, comportement d’exemplarité.
LES 13 INJONCTIONS
Selon les analystes Mary, Robert Goulding et Gysa Jaoui, il existe 13 interdits implicites issus de l’enfance bloquant constamment l’épanouissement naturel des individus en leur imposant de ne pas… ou de s’interdire d’aller plus avant dans l’aboutisse-ment de soi de type… :• N’existe pas• Ne sois pas en bonne santé• Ne sois pas toi-même• Ne sois pas un enfant• Ne grandis pas• Ne sois pas important• Ne ressens pas• Ne sois pas proche• Ne fais pas• Ne pense pas• N’appartiens pas• Ne réussis pas• Ne sache pas
Pris dans ce bain relationnel, l’enfant va alors donner un sens particulier à tous ces messages et prendre une «décision de survie». Cette no-tion est fondamentale dans la théorie de Berne indiquant ici, que l’enfant tente de décrypter les
ans et plus. L’ISFAC assure la forma-tion « métier » et l’intégration pro-fessionnelle, le temps de formation représentant 15 à 25 % de la durée totale du contrat.
Les étudiants souhaitant préparer un BTS, en alternant cours et périodes de stages, concernent 20 % de l’acti-vité de l’ISFAC.
Enfi n au titre de la formation conti-nue, l’ISFAC propose aux salariés des formations diplômantes ou qua-lifi antes dans le cadre du CIF (congé individuel de formation), assure la formation des salariés au titre du plan de formation et du DIF (droit individuel à la formation) et permet aux demandeurs d’emplois et parti-culiers de suivre une formation.
JDP : Quelles sont vos formations « phare » ?Carine Devaud-Cajon : Pour
répondre à une demande générale nous proposons une gamme large de BTS dans les domaines commer-
ciaux (BTS Management des Unités Commerciales, BTS Négociation Relation Clients), administratifs (BTS Assistant de Manager, BTS Assistant de Gestion) et comptables (BTS Comptabilité et Gestion).Par ailleurs, nous faisons évoluer nos domaines de compétences en fonc-tion des besoins des entreprises et du marché économique local.Nos 4 sites ne proposent pas les mêmes formations. ISFAC La Ro-chelle privilégie le secteur de l’immobilier (BTS Professions Im-mobilières et Notariat) pour lequel nous nous appliquons à dévelop-per partenariats et fi lières (réseaux nationaux, fédération, homologation CEFI).Depuis 2010, date d’ouverture du BTS Services et Prestations du Sec-teur Sanitaire et Social, nous nous efforçons de créer un véritable ré-seau institutionnel pour proposer à nos étudiants des terrains de stage. Afi n de poursuivre cet élan, nous ouvrons à la rentrée 2013 une prépa concours sociaux et paramédicaux.L’ISFAC Poitiers quant à lui se dis-tingue sur la partie informatique, communication multi média en proposant les BTS Services Infor-matiques aux Organisations, le BTS Design Graphique et une formation courte plus spécialisée « Titre pro-fessionnel Développeur Logiciel
Web ». La fi lière comptabilité est elle aussi en plein développement puisqu’en complément du BTS Comptabilité et Gestion, nous pro-posons une poursuite d’étude vers un DCG (diplôme de Comptabilité Générale) avec une formation sur le site de Niort et une formation à dis-tance via notre partenaire Comptalia avec des regroupements en présen-tiel sur le site de Poitiers. Ces deux formations sont coordonnées par notre directrice fi nancière, Aurélie Rolet.
A Poitiers, nous développons égale-ment des formations métiers sanc-tionnés par des titres professionnels (comptable assistant, secrétaire as-sistant, attaché commercial…)
Notre fi liale IDAIC nous apporte une grande complémentarité en proposant des certifi cats de qualifi -cation professionnelle dans l’immo-bilier (Négociateur, gestionnaire de biens), dans la grande distribution (employé de commerce), ainsi que des titres de niveau II et III avec le Titre Assistant Ressources Humaines et le titre Conseiller commercial en assurances de personnes et produits fi nanciers.
A la rentrée 2013, nous ouvrirons de nouvelles formations BTS Communi-cation, Banque, Assurance et le titre RH (niveau Bac+3) sur le site de La Rochelle.
JDP : Quelles sont les valeurs caractéristiques de l’ISFAC ?
Carine Devaud-Cajon : Notre cre-do est que l’alternance doit déboucher sur un emploi. En termes de méthodes nous accordons une importance énorme au recrutement et à l’accom-pagnement individuel et appliquons une pédagogie adaptée, responsa-bilisante pour les personnes formées afi n de les rendre autonomes. Notre projet pédagogique est organisé pour répondre aux besoins des entreprises, et nos conseillers sont sur le terrain en permanence, au contact des 1000 en-treprises avec lesquelles nous entrete-nons de vraies relations partenariales.
Philippe Chassemon : L’ISFAC, c’est « l’école autrement », avec une pédagogie et une culture centrées sur les métiers. Et surtout, l’esprit d’entre-prise est central dans notre démarche : nous sommes une entreprise et vivons comme celles avec lesquelles nous tra-vaillons, et nous nous faisons forts de transmettre les valeurs de l’entreprise. C’est pourquoi il est demandé à nos formateurs de connaître les métiers, de disposer de réelle qualités péda-gogiques et d’avoir une expérience en pédagogie de l’alternance. L’ISFAC doit garantir tout à la fois l’« employabilité » des personnes formées et la prise en compte des besoins régionaux des en-treprises en termes de compétences.
L’ISFAC, une entreprise de formation centrée sur les valeurs et besoins des professionnels
Créé en 1994 par son actuel Président Philippe Chassemon, l’ISFAC - Institut Supérieur de Formation par Alternance et Continue – est présent sur les 4
départements de Poitou-Charentes, avec son siège à Poitiers et des implantations à La Rochelle, Angoulême et Niort. L’IDAIC a rejoint le groupe le 1er juillet 2011, étoffant encore son offre de formation.
JDP113.indd 11 06/02/13 17:39

ACTUALITÉS POITOU-CHARENTES
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 12 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
16 CHARENTE
CHARENTE : DÉPARTEMENT LE MOINS PEUPLÉ DE LA RÉGION
Selon la livraison 2013 de l’Insee basée sur le recensement 2010, la Charente compte 351.577 habitants, soit 12.033 de plus qu’en 1999 (+0,32% par an). Une hausse qui reste malgré tout la plus faible de la région (+0,70% par an).
Représentant 19,85% de la population régio-nale, la Charente reste donc le département le moins peuplé de la Région, loin derrière la Charente-Maritime avec ses 622.323 habitants (35,15%).
En une décennie, Angoulême a perdu 3,6% de sa population, Cognac 5% et Soyaux 6% au profit de leurs communes périurbaines comme Brie (+34,3% depuis 1999), La Couronne, Saint-Yrieix, Fléac ou Saint-Michel.
Les 14 communes les plus peuplées
Angoulême 41.613 Gond-Pontouvre 5.937
Cognac 18.557 L’Isle-d’Espagnac 5.284
Soyaux 9.561 Champniers 5.168
Ruelle 7.370 Barbezieux 4.768
La Couronne 7.123 Jarnac 4.434
Saint-Yrieix 7.025 Brie 4.002
Roullet 3.939 Château bernard 3.829
NOUVEAU RECORD POUR LE COGNAC, EN 2012
Selon le Bureau National Interprofessionnel du Cognac, 161,8 millions de bouteilles ont été expédiées dans le monde en 2012 (+3,2% sur un an) pour un CA de 2,391 Mrds d’€ (+16,7%).
La croissance a surtout été portée par l’Asie avec 62,6 millions de cols (+7,5%)) et, dans une moindre mesure par la zone Aléna (USA, Canada, Mexique) avec 52,3 millions de bouteilles écoulées (+2,9%). Seul le marché européen a régressé (-2,9%) avec 45,5 millions de cols.
Planter, un pari à long terme Selon une étude menée par l’interprofession et
le cabinet Eurogroup, les expéditions de cognac pourraient encore progresser d’au moins 50% à l’horizon 2026. Ce qui supposerait de doubler dès que possible la surface de production, actuelle-ment de 75.000 ha.
17 CHARENTE-MARITIME
LA POPULATION DE CHARENTE-MARITIME TOUJOURS EN HAUSSE
Avec 622.323 habitants, la Charente-Mari-time représente 35,15% de la population picto-charentaise. Sur les dix dernières années, le département a concentré la moitié de la hausse régionale : 65.000 habitants de plus, soit une croissance annuelle supérieure à 1%.
Cette hausse est surtout sensible sur le littoral et à proximité des agglomérations de La Rochelle et Rochefort, même si La Rochelle-ville (75.170 hab.) continue à perdre des habitants (700 en deux ans).
En 45 ans, la Charente-Maritime a vu sa popu-lation grimper d’un tiers.
Les 8 communes les plus peuplées
La Rochelle 75.710 Aytré 8.914
Saintes 26.011 Tonnay-Charente 7.758
Rochefort 25.140 St Jean d’Angely 7.669
Royan 17.946 Périgny 7.284
2012 : LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ONT PLUTÔT BIEN RÉSISTÉ
Selon la Chambre de métiers de Charente-Ma-ritime, les radiations d’entreprises artisanales ont progressé de 14,5% sur un an, passant de 994 en 2011 à 1.138 en 2012. Pourtant, dans le même temps, 1.757 entités nouvelles ont été créées, soit autant qu’en 2011. Dans 40% des cas, il s’agit d’entreprises de gros œuvre ou se-cond œuvre du bâtiment (maçons, électriciens, carreleurs, chauffagistes…). Pour 2012, le solde des immatriculations par rapport aux radiations s’avère donc positif dans l’artisanat (+ 619), por-tant à 13.880 le nombre d’artisans en activité en Charente-Maritime.
Du côté des CCI et de leurs ressortissants (commerçants et entreprises, sauf auto-entre-preneurs), la bonne nouvelle concerne le nombre de radiations ou de dissolutions qui a baissé de 22,30%: 2.760 en 2012 contre 3.550 en 2011. Si le nombre de créations d’entreprise a lui aussi di-minué (3.115 contre 3.494 en 2011), le solde est tout de même positif avec 355 entités supplé-mentaires créées en 2012, contre -56 en 2011.
L’AEROPORT LA ROCHELLE–RÉ S’AGRANDIT…ENCORE
Depuis quelques années, les vols low-cost qui desservent l’aéroport de La Rochelle-Ré ne cessent de se multiplier (17 lignes régulières en haute saison) et les clients sont au rendez-vous : 236.700 passagers en 2012, soit +3,26% sur un an.
Selon le cabinet nantais Tryom, les retombées économiques de ces vols low-cost ont repré-senté, en 2012, 37 M€ pour l’économie locale. De quoi finir de convaincre la CCI, gestionnaire de l’infrastructure, d’agrandir l’aérogare, actuel-lement prévue pour 40.000 passagers/an alors qu’elle en accueille plus de 230.000.
Les travaux, qui s’étaleront de janvier 2013 au printemps 2014, sont estimés à 2,4 M€, répartis par tiers entre la CCI, la CDA de La Rochelle et le conseil Général. Les services administratifs dé-ménageront dans de nouveaux locaux pour pou-voir agrandir la salle d’embarquement et doubler la surface de la salle d’accès aux avions, tandis que le parking passera progressivement de 250 à 800 places. De quoi aussi satisfaire les compa-gnies aériennes qui commencaient à se plaindre du manque de fluidité des flux de passagers.
UN MARCHE DE L’AUTOMOBILE A LA PEINE
Selon notre confrère Sud-Ouest, en 2012, les ventes de voitures neuves ont reculé en Charente-Maritime de 14,55%, supérieure à la moyenne nationale (13,86%). Une performance d’autant plus décevante qu’elle est à mettre en perspectives avec la baisse déjà enregistrée en 2011 : -6%. Si les trois marques françaises repré-sentent encore 45,2% du marché départemental (-3% sur un an), elles sont toutes en fort recul :
Renault (-25,58%), Citroën (-17,72%) et Peu-geot (-15,2%). Fiat (-27%) et Ford (-18%) ne font pas mieux alors que BMW (-0,19%), Volk-swagen (-4,82%) et Audi (-6,76%) arrivent tant bien que mal à se stabiliser. Heureusement, pour la plupart des concessions, la bonne tenue du marché de l‘occasion a permis de « tenir le coup ».
79 DEUX-SÈVRES
LA DEMOGRAPHIE EN DEUX-SÈVRES CONTINUE DE PROGRESSER
Avec 369.270 habitants au compteur, les Deux-Sèvres est le troisième département de la région après la Charente-Maritime (622.323 hab.) et la Vienne (427.193), soit 20,86% de la population picto-charentaise.
Selon l’Insee, depuis 1999, le département a gagné 24.880 habitants, soit une augmentation annuelle de 0,64%, proche de celle constatée
au niveau national. Niort-Ville (57.325 hab.) et Bressuire (18.615) ont gagné respectivement 664 et 818 habitants tandis que la population de Parthenay (10.478 hab.) est restée stable.
Niort reste la 3ème ville de Poitou-Charentes der-rière Poitiers (87.697) et La Rochelle (75.170), mais devant Angoulême (41.613).
Les 10 communes les plus peuplées
Niort 57.325 Saint-Maixent 7.483Bressuire 18.615 Chauray 5.985Parthenay 10.478 La Crèche 5.449
Thouars 9.822 Nueil-les-Aubiers 5.444
Mauléon 8.172 Celles-sur-Belle 3.753
LA MSA VA S’INSTALLER SUR L’ANCIEN SITE CAMIF
La Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne a conclu avec la Cté d’Agglomération de Niort l’achat d’1,5 hectare sur l’ancien site de la Camif à Chauray, pour y bâtir son nouveau siège (3.200 m2 répartis sur deux étages). L’investissement comprenant l’achat du terrain, la construction et les aménagements est estimé à 7 M€ tandis que l’emménagement des 165 salariés devrait être effectif fin 2015.
Avec cette nouvelle implantation et celle à venir de la CCI, l’ancien site Camif (où sont déjà installés Matelsom, Darva, la Coop Nior-taise, C2C, Inservio, Texa Informatique, Télé-performance, Pôle Emploi, Stock AZ, Xr Pic-tures, Volume Action et le restaurant Le Tévins) comptera bientôt 870 emplois, à com-parer aux 980 perdus par la Camif en 2008.
86 VIENNE
LA VIENNE COMPTE 427.193 HABITANTS
Selon les chiffres de l’Insee parus en janvier 2013, la population de la Vienne s’établit désor-mais à 427.193 habitants. Au total, depuis 1999, le département a gagné 28.000 habitants, soit +0,62% par an, une progression en phase avec l’évolution moyenne nationale.
L’aire urbaine de Poitiers affiche à elle seule 252.381 habitants au compteur, représentant 59% de la population du département. Au niveau régional, elle devance assez largement l’agglomé-ration rochelaise et ses 202.314 habitants.
Les dix communes les plus peuplées
Poitiers 87.697 Chauvigny 6.754 Châtellerault 33.420 Montmorillon 6.387
Buxerolles 10.047 Migné-Auxances 6.053
Saint-Benoît 6.991 Naintré 5.830 Loudun 6.989 Jaunay-Clan 5.811
VINCI : NOUVEL EXPLOITANT DE L’AÉROPORT DE POITIERS
Depuis le 1er janvier 2013 et pour 7 ans, Vinci Airports est le nouveau gestionnaire et exploitant de l’aéroport Poitiers-Biard (130.000 passagers en 2012). La CCI de la Vienne, exploitante depuis 1968, reste propriétaire du site aux côtés du Conseil Général et de Grand Poitiers. Ce nouveau mandat permet à Vinci Airport d’avoir dorénavant dix aéroports en gestion en France.
La délégation de service public d’exploitation attribué pour l’aéroport de Poitiers-Biard com-prend la gestion, l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la plate-forme aéroportuaire : aérogare, pistes, équipements et implanta-tions commerciales. Vinci Airports, qui a repris et intégré les 16 salariés du site, compte bien profiter des synergies possibles avec les autres aéroports et compagnies aériennes de son réseau pour développer de nouvelles lignes au départ de Poitiers. L’objectif commun est d’atteindre 170.000 passagers d’ici à 2019.
NAISSANCE DE CRÉATIV, POUR LES PORTEURS DE PROJETS
Le Centre d’Entreprises et d’Innovation (Pépi-nière d’entreprises située au Futuroscope) et Ini-tiative Vienne (réseau de financement) se sont joints pour créer «Créativ», une structure desti-née à soutenir les porteurs de projets et à favo-riser la création d’activités dans le département. L’objectif est de leur apporter un service complet d’accompagnement allant de l’aide au montage du projet au suivi post-création en passant par le financement et l’hébergement de l’entreprise.
Grâce à cette nouvelle synergie et mutualisa-tion des moyens, «Créativ» constituera « un réel outil d'aménagement du territoire » rappelle Gé-rad Moebs, le président d’Initiative Vienne.
PARC DU FUTUROSCOPE : LE TOURISME D’AFFAIRES COMME RELAIS DE CROISSANCE
En 2012, le Parc du Futuroscope a accueilli 35.000 visiteurs liés au tourisme d’affaires, soit deux fois plus qu’en 2010. L’ambition est de faire progresser ce public de 30% encore en 2013, en incitant par exemple les entreprises, notamment d’Ile de France (grâce à la gare TGV Futuroscope), à venir au Parc pour organiser leurs rencontres professionnelles, séminaires et incentives. Cette diversification a un premier objectif qui est d’op-timiser l’exploitation des équipements pendant les périodes creuses, en dehors des vacances ou des horaires d’ouverture grand public. Le second intérêt est lié au niveau de dépenses de ce type de client professionnel, supérieur de 30% à celui du grand public. Sans compter que chaque pro-fessionnel-visiteur constitue un ambassadeur potentiel vis à vis de sa propre famille.
« Pays du Futuroscope », un bassin tou-ristique à promouvoir
Pour faire profiter de la locomotive « Parc du Futuroscope » à l’ensemble du département, le comité départemental du Tourisme de la Vienne travaille sur la promotion de courts ou moyens séjours sur la destination globale « Pays du Futuroscope». Des séjours packagés seront ainsi proposés sur une quinzaine de sites dont la Vallée des Singes, le Domaine de Dienné, la Planète des Crocodiles, l’Ile aux serpents, le parc de Saint-Cyr ou l’abbaye de Saint-Savin.
Un bar aérien au FuturoscopeAérophile, entreprise française spécialisée dans
la fabrication et la commercialisation de bal-lons dirigeables en Europe, Asie, USA ou encore Moyen Orient, va fournir au Parc du Futuroscope son premier Aérobar : une nacelle métallique de 4 mètres de diamètre suspendue à un ballon gonflé à l’hélium. Dès ce printemps, le dirigeable pourra accueillir douze convives qui, moyennant une dizaine d’euros, pourront ainsi prendre un verre, une crêpe ou un repas léger lors de vols qui dureront une dizaine de minutes, à environ 35 mètres d'altitude.
● POITOU-CHARENTES
1.770.363 HABITANTS EN POITOU-CHARENTES
Selon la revue Décimal de janvier 2013 publiée par l’Insee, le Poitou-Charentes comptait au 1er janvier 2010 : 1.770.363 habitants, soit 2,8% de la population de la France métropolitaine. Depuis 1999, la région a ainsi gagné 130.000 habitants soit +0,70% par an contre +0,64% en moyenne nationale. Avec 65.000 habitants en plus (+1,01%/an), la Charente-Maritime concentre la moitié de cette hausse régionale.
Nombre d’habitants et évolution 1999-2010
Charente 351.577 + 12.033 +0,32%/anCharente-Maritime 622.323 +64.934 +1,01%
Deux-Sèvres 369.270 +24.880 +0,64%Vienne 427.193 +28.063 +0,62%
JDP113.indd 12 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 13 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
12 communes comptent plus de 10.000 habitants
Poitiers 87.697 Rochefort 25.140La Rochelle 75.170 Bressuire 18.615
Niort 57.235 Cognac 18.557Angoulême 41.613 Royan 17.946
Chatellerault 32.459 Parthenay 10.478Saintes 26.011 Buxerolles 10.047
LE POITOU-CHARENTES COMPTE 66.350 IMMIGRÉS.
De source Insee, avec 3,8% de population immigrée, le Poitou-Charentes est l’une des régions de France métropolitaine les moins concernées par l’immigration. Deux raisons principales : la région est peu industrialisée et elle est éloignée des principales zones fron-talières. Parmi ces habitants « nés étrangers à l´étranger », 35% ont acquis la nationalité française et 65% ont conservé leur nationalité d´origine (contre 40%/60% en France). Comme à l´échelle nationale, les femmes sont légèrement surreprésentées : 51% contre 49% d’hommes.
Plus de couples et de grandes familles.Les adultes immigrés picto-charentais vivent
majoritairement en couple (73%), davantage que les non-immigrés de la région (66%). Les familles sont plus grandes : 19% des immigrés ré-sidant en couple vivent avec au moins 3 enfants, contre 9% pour les non-immigrés.
70% d´immigrés de plus, en 10 ansEn 1999, le Poitou-Charentes comptait 39.030
immigrés, soit 2,4% de la population régionale. En dix ans, la région a donc gagné 27.320 im-migrés, et ce, malgré les décès ou départs des immigrés issus d’importantes vagues de migra-tion, d´origine italienne, espagnole et surtout portugaise (20%), arrivées dans les années 60. Si, entre 1999 et 2009, les populations d´origine chinoise, camerounaise, turque, algérienne ont augmenté de plus de 50%, c’est l´évolution de la population immigrée d´origine britannique qui est la plus remarquable.
25% de britanniquesEn dix ans, cette population a été multipliée
par près de cinq et représente aujourd’hui 25% de la population immigrée de la région contre à peine 9% en 1999. Les 16.760 britanniques habitant dans nos quatre départements, dont 39% en Charente, représentent jusqu’à 10,3% des immigrés d´origine britannique résidant sur le sol français.
En revanche, 7,3% d’entre eux seulement ont acquis la nationalité française, à comparer avec les immigrés d´origine chinoise, arrivés égale-ment en moyenne en 2003, qui sont 19,8% à l’avoir obtenu.
ANNÉE 2012 EN DEMI-TEINTE POUR LES PME
Selon la dernière enquête de conjoncture éco-nomique réalisée par Oséo, l’année 2012 aura été une année de stabilité pour les PME de la région: • 36% des entreprises du panel ont affi ché une hausse de leur chiffre d’affaires et 34% une baisse. • en novembre, 41% déclaraient des diffi cultés de trésorerie sur les six derniers mois contre 39% en mai• 66% estiment “bonne ou normale” la rentabi-lité de l’entreprise, contre 72% en 2011 et 68% au plan national.• 31% ont augmenté leurs investissements et 26% les ont réduit.
Des prévisions moins optimistes pour 2013• 19% des entreprises de la région anticipent une croissance de leur activité en 2013 et 28% une diminution. • 9% attendent une amélioration de leur trésore-rie et 32% une dégradation.• 41% envisagent d’investir, contre 56% en 2012.
Rappelons que le Poitou-Charentes représente 2,6% des entreprises françaises de 1 à 250 sa-lariés et contribue à hauteur de 2,2% au PIB national.
« 2013, ANNÉE DE L’INDUSTRIE »
En 2013, les CCI de Poitou-Charentes, à l’ins-tar de toutes les autres CCI de France, mettront l’industrie à l’honneur avec l’ambition de relever le défi de la compétitivité. Au même titre que la création de la Banque Publique d’Investisse-ment, le Plan PME ou le rapport Gallois sur la compétitivité, cette initiative des CCI s’inscrit dans la politique du gouvernement qui place le redressement productif national au cœur des pré-occupations.
Avec l’opération « 2013, année de l’industrie », le réseau des CCI se donne trois objectifs :
• Accompagner les entreprises face aux mutations industrielles.
Les grands défi s sociétaux du XXIème siècle (démographie, changement climatique, énergie, TIC, …) appellent des adaptations industrielles inédites dans des délais très courts et dans un contexte mondial. Les réponses à ces défi s re-lèvent autant de choix industriels stratégiques (politique industrielle nationale et européenne) que d’avancées technologiques ou encore de la formation et de la qualifi cation des hommes qu’il est nécessaire de soutenir et d’accompagner.
• Changer la perception du monde de l’in-dustrie pour en promouvoir une nouvelle image et en renforcer l’attractivité.
L’industrie souffre d’une perception sociétale dé-gradée qui se traduit par un défi cit d’image, des diffi cultés de recrutement, une désaffection des fi nanceurs alors qu’au contraire, l’industrie struc-ture l’activité économique des territoires et reste le moteur de la recherche, de l’innovation et des exportations. Des actions nationales, régionales et territoriales tenteront de modifi er la percep-tion du secteur de l’industrie.
• Faire entendre la voix des chefs d’entre-prise industrielle.
Il s’agit de donner plus d’espace à l’expression des analyses et des propositions de nos échelons régionaux. Il convient aussi de renforcer et de structurer l’offre de services des CCI à destination des entreprises industrielles.
LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE : UNE FILIERE STRATÉGIQUE
Avec 8.800 emplois liés au secteur aéronau-tique, soit 3% des effectifs de la fi lière française, le Poitou-Charentes occupe le 7e rang des régions dans ce secteur d’activité. Vienne : 58 entreprises / 3.200 emplois.Charente-Mar. : 56 établissements / 2.150 salariés.Charente : 30 sociétés / 1.800 employés.Deux-Sèvres : 26 entreprises / 1.650 personnes.
La priorité : continuer de saisir les opportunités
Selon les observateurs, 25.000 avions seront à construire d’ici à 2040 soit, pour les entreprises concernées, des perspectives de croissance à deux chiffres.
Les PME installées en Poitou-Charentes sau-ront-elles en profi ter ?
Pour la majorité d’entre elles, leur petite taille et leur modeste surface fi nancière constituent des points faibles lorsqu’il s’agit de répondre aux exigences des grands donneurs d’ordre que sont les avionneurs et les compagnies aériennes.
C’est pour gommer ces faiblesses que, le 10 janvier 2013 à l’ENSMA, le préfet de Région, Yves Dassonville, a lancé le Comité Stratégique de la Filière Régionale de l’aéronautique (CSFR Aéro-nautique), une structure qui va accompagner le développement de la fi lière, donner une plus grande visibilité aux petites et moyennes entre-prises concernées, et permettre de mutualiser à la fois les priorités et les actions.
CRÉATION DE L’URSSAF POITOU-CHARENTES
Depuis le 1er janvier 2013, les quatre Urssaf dé-partementales se sont regroupées au sein d’une nouvelle et unique entité régionale : l’Urssaf de Poitou-Charentes.
Si le siège de la nouvelle structure est à Poi-tiers, les différents lieux d’accueil restent les mêmes : Aytré, Isle-d’Espagnac, Niort et Poitiers.
CŒUR DES CHARENTES
ZAC DU MAS DE LA COUR
30 min. d’Angoulême, de Saintes sur la N141 (Centre Europe / Atlantique)
• Une démarche environnementale pour la qualité de vie
et de travail dans la valorisation de l’espace.
À CHÂTEAUBERNARD (COGNAC), CŒUR DES CHARENTES
ZAC DU MAS DE LA COUR-BELLEVUE
30 min. d’Angoulême, de Saintes sur la N141 (Centre Europe / Atlantique)
À CHAMPNIERS, PORTES DU GRAND ANGOULÊME
ZAC DES MONTAGNES OUEST
10 minutes du centre de l’agglomération
• Un espace environnemental tourné vers l’innovation
et le loisir dans un bassin économique très attractif.
LES PROJETS D'AVENIR DÉBUTENT ICI :Sur 75 hectares à vocation mixte (commerces, tertiaire, entreprises, loisirs…),
des ZAC Nouvelle Génération en phase avec la dynamique économique, culturelle et touristique locale, dans des environnements privilégiés.
Sur 75 hectares à vocation mixte (commerces, tertiaire, entreprises, loisirs…), en phase avec la dynamique économique,
culturelle et touristique locale, dans des environnements privilégiés.
LGV 2014 !
• Angoulême-Paris en 1h45
Angoulême-Bordeaux en 35 min.• Angoulême-Paris en 1h45
• Angoulême-Bordeaux en 35 min.
A l’intersection des grands axes !
• NORD/SUD (N10) • EST/OUEST (N141)
ACCESSIBILITÉ
LES PROJETS D'AVENIR DÉBUTENT ICI :VISIBILITÉ
ACCESSIBILITÉ
VISIBILITÉ
PROXIMITÉ
30 min. d’Angoulême, de Saintes sur la N141 (Centre Europe / Atlantique)
Une démarche environnementale pour la qualité de vie
30 min. d’Angoulême, de Saintes sur la N141 (Centre Europe / Atlantique)
• Une démarche environnementale pour la qualité de vie
et de travail dans la valorisation de l’espace.
LES ZAC DE TERRITOIRES CHARENTE : DES LIEUX STRATÉGIQUES PROPICES AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISEDocumentation complète sur demande : 05 45 37 12 10 - [email protected] 1, impasse Truffière - 16000 ANGOULÊME - www.territoires-charente.com
Cré
dits
pho
tos
: SV
Lum
a -
Foto
lia.c
om /
Pho
voir.
fr
AP ZAC-280X180-3.indd 1 06/02/13 15:24
JDP113.indd 13 06/02/13 17:39

ACTUALITÉS POITOU-CHARENTES
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 14 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
Un nouveau N° de téléphone commun a été mis en place pour joindre l’Urssaf et permettre d’avoir accès à la gestion des dossiers par les conseillers habituels: 3957 (0,118 €TTC/min de 8h à 18h30).
D’ici au 1er janvier 2014, l’ensemble des Urssaf départementales du territoire sera regroupé en 22 Urssaf régionales, soit une dans chaque ré-gion administrative.
www.poitoucharentes.urssaf.fr
RSI POITOU-CHARENTES RENOUVELLE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 7 décembre 2012, les 30 membres du nou-veau conseil d’administration de la caisse RSI (Régime Social des Indépendants) Poitou-Cha-rentes ont élu leur président et les membres du Bureau pour les six prochaines années. Il s’agit de Robert BERGER (réélu Président), de Yann Rivière et Jean Alemany (vices-présidents), de Danièle Borioli, Patrick Moreau, Olivier Gallet, André Bodin et de Joël Faity.
Rappelons que la Caisse RSI gère l’assurance maladie des 167.135 chefs d’entreprise indépen-dants de la région Poitou-Charentes (artisans, in-dustriels, commerçants, professionnels libéraux) ainsi que les assurances retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès des artisans, commerçants et industriels.
Le Conseil d’administration détermine la po-litique générale de la caisse, vote les budgets, représentent l’entité dans les organismes où elle siège comme les Agences Régionales de Santé (ARS), les commissions conventionnelles des professions de santé ou les Comités Départe-mentaux des Retraités et des Personnes Âgées (CODERPA)….
LE RDT A 10 ANS
Le Réseau de Développement Technologique Poitou-Charentes (RDT), qui a pour mission de « soutenir la performance des entreprises » en les accompagnant et en finançant des projets à caractère technologique ou innovants, a fêté ses 10 ans en fin d’année 2012. Une décennie bien remplie puisque 487 aides ont été apportées représentant 574.000€ versés et 5,5 M€ dépensés en investissements en R&D dans des PME régio-nales.
LA REGION ET POLE EMPLOI S’ALLIENT POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Fin janvier, la Région et Pôle Emploi ont si-gné un accord en vue de simplifier et d’accélérer l’accès des demandeurs d’emploi à une forma-tion professionnelle débouchant sur un métier. Concrètement, il s’agit de mettre en place un guichet unique pour partager clairement l’offre de formation : la Région se consacre aux forma-tions collectives, qualifiantes pour les métiers
qui recrutent et les grands chantiers (LGV, Center Parcs…) tandis que Pôle emploi se concentre sur l’adaptation au poste de travail. «Il s’agit d’un accord inédit au niveau national» souligne Jean Basseres, le Directeur de Pôle Emploi et « Nous allons réduire à deux mois le délai d’entrée dans la formation professionnelle », complète Ségo-lène Royal. D’ores et déjà opérationnelle, cette initiative devrait permettre d’augmenter le taux de retours à l’emploi en s’adaptant aux grands chantiers régionaux et aux PME des secteurs qui recrutent.
116 ENTREPRISES COOPERATIVES EN POITOU-CHARENTES.
Fin 2012, L’Union régionale des Scop Poitou-Charentes comptait dans ses rangs 116 entre-prises à statut coopératif dont 105 SCOP (socié-tés coopératives et participatives) et 11 SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif). Soit un doublement du nombre de Scop depuis la fin des années 90.
Répartition : 21 en Charente, 29 en Charente-Maritime, 32 en Deux-Sèvres et 34 en Vienne.
Taille moyenne : 17 personnes (de 2 à 369).Activités : 39 en BTP, 58 en industrie et 19 en
services.Effectif total : 2.243 salariés dont 85% de
sociétaires.Pérennité : Sur 45 coopératives créées depuis
2007, 39 sont en activité à fin 2012, soit un taux de pérennité de 78%.
Chiffre d’affaires cumulé : 183 M€ (HT) Répartition du résultat : en moyenne, dans
une Scop picto-charentaise, 50% des profits sont distribués aux salariés sous forme de participa-tion et d’intéressement, 9% sont attribués aux salariés associés sous forme de dividendes et 41% sont destinés aux réserves de l’entreprise.
Ces réserves, impartageables et définitives, vont contribuer tout au long du développement de l’entreprise à consolider les fonds propres et à assurer la pérennité de la Scop. Selon Régis Tillay, directeur de l’Urscop, « aujourd’hui, les réserves accumulées sont de 36,4 M€, ce qui permet aux Scop anciennes de traverser les périodes difficiles ». L’annuaire des Scop en Poitou-Charentes est dis-ponible sur le site scop-poitoucharentes.coop
NOMINATIONS EN REGION
• Claude Renard est, depuis juillet 2012, le commissaire au redressement productif en Poi-tou-Charentes. Son rôle de veille consiste à anti-ciper les difficultés des entreprises en utilisant tous les signaux d’alerte que sont les services de l’État (Direccte et Sous-préfectures), les collecti-vités locales, les partenaires sociaux et sa propre connaissance du milieu industriel. Son rôle de facilitateur et de médiateur consiste à accompa-gner et à accélérer des dossiers pour « qu’une entreprise ne passe pas à côté d’un dispositif qui pourrait l’aider : crédit impôt recherche, garantie de prêt, chômage partiel… »
• Dominique Jourde, expert-comptable à Poi-tiers, succède à Jean-Yves Moreau à la présidence de l’ordre des experts-comptables Poitou-Cha-rentes-Vendée. Il est l’un des 21 associés de Duo Solutions, le réseau d’experts-comptables qui emploie 130 collaborateurs en Poitou-Charentes.
• Richard Gendre, Président de l’hôtel-restau-rant-thalasso Le Richelieu sur l’île de Ré, a été élu pour trois ans à la présidence de la nouvelle « UMIH La Rochelle-Ré-Rochefort ». Ont été élus à ses côtés Pascal Eugène, Laurent Favier, Anne Jouineau, Damien Legendre, Nicolas Brossard, Stéphanie Leclère et Rémi Massé, tandis que Thierry Maitre, ancien vice-président de l’UMIH 17, reste administrateur. Rappelons que L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtelerie repré-sente les restaurateurs, cafetiers, hôteliers et métiers de la nuit, et revendique près de 80.000 adhérents au plan national.
• Jean-Paul Dupraz, patron de la menuiserie Ga-tard à Mignaloux-Beauvoir a été réélu pour trois ans président de la Fédération du bâtiment de la Vienne.• Philippe Guettat est le nouveau PDG de Mar-tell Mumm Perrier-Jouët depuis le 1er octobre. Il était auparavant aux commandes de The Absolut Company en Suède. • François Hériard-Dubreuil a été nommé pré-sident du conseil d’administration de Rémy-Coin-treau, en remplacement de sa sœur Dominique Hériard-Dubreuil qui demeure présidente des sociétés Rémy Martin & Cie et Cointreau. • Fernando Almeida, ancien dirigeant de la Scop Steco à Niort, est le nouveau président de l’Union régionale des Scop de Poitou-Charentes, en rem-placement de Bernard Morin. • Serge Espin est à nouveau directeur des Thermes de Jonzac qu’il dirigea dès son ouver-ture en 1986 et pendant 18 ans. Il fut ensuite directeur de l’établissement thermal de Cambo-les-Bains. • Delphine Montero est la nouvelle présidente de la Jeune Chambre Economique de Poitou-Charentes
LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS DU POITOU-CHARENTES FONT REFERENCE
Nés au milieu des années 1980, les Groupement d’Employeurs (GE) sont des structures associa-tives qui permettent à des entreprises, des asso-ciations ou des collectivités territoriales de se regrouper pour employer collectivement des sala-riés qu’elles n’auraient pas, seules, les moyens de recruter.
Avantages pour les entreprisesLes motifs qui conduisent des TPE/PME à se fédé-rer pour créer un GE sont multiples :• disposer à temps partiel d’un salarié possédant une qualification particulière (technicien qualité, comptable…),
• utiliser à tour de rôle un salarié pour effectuer des travaux saisonniers décalés dans le temps, • bénéficier ponctuellement d’un appoint de main-d’œuvre, • remplacer un salarié parti en formation,• maintenir l’emploi d’un salarié que l’entreprise d’origine serait, sinon, obligée de licencier.• répartir les frais salariaux en proportion de l’utilisation du salarié, • être décharger des tâches administratives liées au poste.• bénéficier, de la part du groupement, d’aide et de conseil en matière de gestion RH.
Avantages pour les salariésLes salariés liés à un GE :• relèvent d’un employeur unique (le GE) et ont un seul contrat de travail qui mentionne, entre autres, la liste des adhérents du groupement, c’est-à-dire des utilisateurs potentiels.• sont recrutés majoritairement en CDI et à temps complet.• bénéficient d’une plus grande sécurité d’emploi en raison de la dimension collective du groupement.• ont l’assurance de percevoir leur salaire même en cas de défaillance de l’un des membres du GE.• ont une garantie d’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement et de participation avec les salariés des entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition.
320 Groupements d’entreprises en Poitou-Charentes
1.850 salariés ont un contrat de travail avec l’un des 320 GE de la région et travaillent à temps partagé auprès des 2.300 employeurs membres de ces groupements.
Si plus des deux tiers des GE sont à vocation agricole, de plus en plus de secteurs sont repré-sentés comme l’industrie, l’artisanat, les services, le secteur associatif, les sports & loisirs, le tou-risme ou encore le social et le médical.
Le CRGE Poitou-Charentes, précurseurCréé en 2000 à Poitiers, le Centre de Res-
sources pour les Groupement d’Employeurs de Poi-tou-Charentes fut le premier CRGE en France. Sa mission ? Accompagner et soutenir les ini-tiatives de création et de développement des GE dans la région. Aujourd’hui, le CRGE Poitou-Cha-rentes fait référence au plan national et euro-péen. Au plan national en étant un animateur ac-tif de la création du Centre de Ressources National des Groupements d’Employeurs qui sera créé au 1er trimestre 2013. Au plan européen en ayant été un acteur majeur dans le fait que, en avril 2012, la Commission Européenne reconnaisse officielle-ment les Groupements d’Employeurs comme une solution pour l’emploi. www.crge.com
Sources : Communiqués de Presse, Les Echos, Sud-Ouest, Nouvelle République, Actufax, CCI de la Vienne
• ÉDITION 2013 •
Mercredi 13 mars
JDP113.indd 14 06/02/13 17:39

ACTUALITÉS LIMOUSIN
ACTUALITÉS VENDÉE
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 15 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
MEUBLES GAUTIER TROUVE SA CROISSANCE A L’INTERNATIONAL
Après Casablanca au Maroc et Pointe Noire au Congo, le fabricant et distributeur de meubles Gautier a ouvert sa troisième franchise sur le continent africain. C’est à Nairobi, capitale du Kenya, qu’un nouvel espace de vente de 670 m2 a été inauguré fin novembre 2012. Ce choix se justifie par l’importante classe moyenne présente dans ce pays qui s’affiche comme la première puissance économique d’Afrique de l’Est.
L’entreprise vendéenne est habituée aux terri-toires lointains puisqu’elle compte 33 magasins sous enseigne à l’étranger dont 3 en Russie, 1 en Ouzbékistan, au Canada et, plus récemment, à Dubaï. Soit presque autant que dans l’Hexagone où le réseau compte 39 points de vente exclusifs.
Meubles Gautier distribue sa production sous quatre marques ou enseignes : Gami (meubles de premier équipement), Gautier Office (mobilier de bureau), Galipette (chambres pour enfants de 0 à 2 ans) et Gautier (magasins franchisés). L’entreprise familiale, qui emploie 850 personnes sur ses trois sites de Bou-père, Chantonnay et Saint-Prouant, affiche 140 M€ de CA en 2011, dont 20% à l’international.
BODIN CONFIRME SA POSITION DE LEADER DU POULET BIO
Installé à Sainte-Hermine, l’entreprise Bodin est N°1 français et européen du poulet bio. L’abattoir produit 36.000 volailles par semaine: 70% de poulet, 20% de dinde, 5% du canard et 5% de pintade. Elle ne pèse que 1% du marché du poulet en France mais 37% du marché du bio.
L’entreprise est liée à 90 éleveurs volaillers de proximité qui s’engagent à ne pas utiliser d’anti-biotiques ni de médicaments dans leur élevage, à avoir des bâtiments aux normes et à aménager des parcours pour inciter les poulets à se dépenser. En outre, pour assurer une traçabilité complète, une minoterie dédiée (à Teillé) fabrique et contrôle scru-puleusement l’alimentation bio donnée aux poulets.
PLAN DE REORGANISATION CHEZ VM MATERIAUX
Pour faire face à la persistance d’un environ-nement économique difficile dans le secteur du bâtiment, VM Matériaux a enclenché un plan glo-bal de réorganisation destiné à réduire ses coûts d’exploitation. Il est vrai que l’exercice 2012 risque d’afficher un résultat négatif contre un bénéfice net de 12,7 M€ en 2011. Plusieurs leviers sont activés : les effectifs seront réduits de 5 à 6% dans le cadre d’un plan de départs volontaires, soit 150 personnes concernées, tandis que 20 M€ d’ac-tifs seront vendus, principalement dans l’activité de négoce. Parallèlement, le site de production de Portet-sur-Garonne, près de Toulouse, et le site de négoce de Royan (bois, panneaux et menuiserie) seront fermés. Les investissements internes seront réduits à 5 M€ en 2013. VM Matériaux espère ainsi améliorer sa rentabilité opérationnelle de 8 M€ et, selon les analystes, les trois quarts des écono-mies escomptées seront réalisés dès 2013.
9 agences cédées au Groupe SAMSE…
Déjà, en ce début d’année, VM Matériaux a signé au bénéfice du Groupe Samse la cession de neuf agences de négoce de matériaux, toutes situées dans le Sud-Ouest (Dordogne, Lot et Ga-ronne). Le périmètre cédé représente 110 salariés et 29 M€ de CA. Les agences concernées seront exploitées sous l’enseigne M+ Matériaux.
...mais nouvelle unité de production à Cholet
Le groupe vendéen a investi 3,5M€ dans une nouvelle unité de 5.000 m2 à Cholet, dédiée à la fabrication de blocs de coffrage isolant Biplan, un produit novateur conçu par le canadien Polycrete. VM Matériaux, qui dispose d’une licence exclusive en France et dans plusieurs pays limitrophes, a dé-marré la production en janvier 2013 avec dix per-sonnes. Cet effectif devrait rapidement progresser compte tenu des qualités du concept (approprié aux maisons individuelles, bâtiments tertiaires ou immeubles collectifs) et des attentes du mar-ché (respect des normes BBC et sismiques).
BOUY TRANSFERT LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE AU « PETIT ÉOLIEN »
L’entreprise Bouy, qui emploie 250 salariés à Saint-Hilaire-de-Voust en Sud-Vendée et 70 au Maroc, est spécialiste de la mécanique de pré-cision pour les secteurs aéronautique (Zodiac Aerospace, Thales, Safran…), énergétique (Vail-lant, Saunier Duval) ou la recherche pétrolière. En 2011, fort d’un carnet de commande bien rem-pli et d’un CA de 22,7 M€, en hausse de 21%, Bouy a diversifié ses activités en achetant Eolys, une jeune entreprise évoluant dans le développe-ment durable et plus précisément dans le « petit éolien » destiné aux particuliers, agriculteurs, à l’industrie et aux collectivités.
Bouy a défini une stratégie de développe-ment en trois points d’ici à 2015 : appliquer les méthodes de l’aéronautique au secteur de l’éo-lien, élargir la gamme avec un nouveau modèle d’éolienne de 35 kilowatts (en plus des 6 et 12kws déjà existants) et développer le concept à l’étranger avec une première implantation en Italie. 45 personnes devraient être recrutées dans les trois ans.
UMEA FAIT CONFIANCE AUX « PERSONNES DIFFÉRENTES »
Créée en 2006 et basée à Mortagne-sur-Sèvre depuis mi-2012, UMEA (Usinage et Montage d’Ensemble Aluminium) fabrique des plaques d’aluminium destinées aux bâtiments industriels, hôpitaux, mobiliers urbains, carrosserie, accastil-lage... Sur les 44 salariés de l’entreprise, 35 sont des « travailleurs handicapés » ou plutôt des « personnes différentes » comme aime à le préci-ser Jean-Claude Brangeon, le dirigeant de cette entreprise sous-traitante. Tous sont formés, sui-vis et encadrés au quotidien et quatre d’entre eux ont des postes à responsabilités. Fin 2012, UMEA a reçu le prix régional des entreprises solidaires, catégorie projet social.
CANARD CHALLANDAIS : BURGAUD INVESTIT
Plus de soixante ans après sa création à Chal-lans, l’entreprise Burgaud s’est fait un nom au-près des grands restaurateurs français et étran-gers. Robuchon, Troisgros, la Tour d’Argent et bien d’autres en Angleterre, en Suisse, en Suède et même au Japon, à Singapour ou à Hong-Kong sont séduits par la chair particulièrement savou-reuse des canards sortis de l’entreprise familiale. Son secret ? Une méthode d’abattage particulière qui fait la différence dans l’assiette.
L’entreprise, qui compte 13 salariés et produit en moyenne 3.000 canards par semaine, se four-nit auprès de cinq ou six éleveurs implantés à Challans ou à proximité.
Pour conquérir de nouveaux marchés, Bur-gaud a investi 500.000€ dans la création d’une unité de congélation. Ce nouvel équipement lui permettra de s’affranchir des contraintes liées à l’utilisation de locaux frigorifiques extérieurs en sous-traitance. L’entreprise pourra ainsi aug-menter sa capacité de congélation et accroître sa présence sur le marché international, plus préci-sément asiatique.
Sources : Communiqués de Presse, Ouest-France, Investir,
LIMOUSIN : 150.000 LOGEMENTS DE PLUS EN 40 ANS
Selon une récente livraison de l’Insee, le Li-mousin disposait en 2009 de quelque 442.000 logements dont la moitié en Haute-Vienne, un tiers en Corrèze et un cinquième en Creuse.
78% sont des résidences principales, 12% des résidences secondaires et 10% sont considérés comme vacants, soit le deuxième taux de va-cance le plus élevé de France, derrière l’Auvergne.
La décohabitation porte la croissance du parcAu cours des quarante dernières années, le
parc de logements a augmenté de 150.000 loge-ments, porté en grande partie par les besoins en résidences principales.
En effet, alors que la population du Limousin a diminué jusqu’en 1999, le nombre de ménages n’a cessé d’augmenter sur la période (+ de céli-bat, + de séparations, + de personnes âgées), soit autant de résidences principales en plus.
Cette tendance à la décohabitation explique plus de la moitié de la croissance du parc de logements limousin, le reliquat étant dû au re-gain démographique enregistré sur la dernière décennie.
Propriétaires plus tôt et plus durablementEn 2009, deux ménages sur trois sont proprié-
taires de leur logement, ce qui place le Limousin en troisième position après la Bretagne et le Poi-tou-Charentes.
C’est sept points de plus que la moyenne fran-çaise.
Parallèlement, les nouvelles générations ac-cèdent plus précocement à la propriété : le taux de propriétaires des 25-35 ans a augmenté de plus de dix points entre 1999 et 2009, contre une croissance de seulement cinq points tous âges confondus.
LE REGAIN DÉMOGRAPHIQUE SE POURSUIT EN LIMOUSIN
Selon une étude récente publiée par l’Insee, le Limousin comptait 742.800 habitants au 1er janvier 2010, soit 30.000 de plus qu’en 1999. Avec une hausse de 0,4% en moyenne par an sur ces dix dernières années, la croissance de la population limousine demeure en deçà de celle observée en France métropolitaine, mais reste sans précédent depuis plus d’un siècle.
Cette dynamique démographique est essentiel-lement portée par les gains migratoires (+0,7%) qui fait plus que compenser le déficit naturel et qui profite surtout à la capitale régionale et aux zones périurbaines. La Creuse fait exception avec une population qui s’est repliée de 0,1% par an, les gains migratoires ne compensant pas l’excé-dent des décès sur les naissances.
Des situations diverses selon les communes. Parmi les 747 communes de la région, six sur
dix ont gagné des habitants. Parmi les plus dyna-miques, les arrondissements de Brive, Limoges et Rochechouart ont vu leur population augmenter de 0,7%, 0,6% et 0,5% en moyenne par an.
Tulle a progressé aussi mais à un rythme moindre (+ 0,3%) alors que la population de Bel-lac et de Guéret s’est stabilisée après plusieurs décennies de décroissance. En revanche, le sud de la Creuse et l’est de la Corrèze continuent à perdre des habitants, notamment Aubusson (0,4%/an) et Ussel (-0,2%).
Le périurbain, moteur de la croissance démo-graphique
La population s’est particulièrement accrue dans les couronnes périurbaines des quatre grands pôles urbains de la région, c’est-à-dire ceux qui offrent plus de 10.000 emplois : Li-moges, Brive, Guéret et Tulle (+1,1% par an entre 1999 et 2010).
15 COMMUNES PORTENT LA MOITIÉ DE LA CROISSANCE DE LA POPULATION
Limoges (16,2% de l’évolution totale de la ré-gion), Couzeix (5,1%), Malemort (3,7%), Verneuil (3,6%), Saint-Pantaléon (2,7%), Saint-Junien (2,5%), Boisseuil (2,3%), Feytiat (2,2%), Amba-zac (2,2%), Panazol (2,1%), Ussac, Rilhac-Rancon, Cosnac, Saint-Gence et Saint-Just-le-Martel.
2013 : LA TECHNOPOLE ESTER FÊTE SES 20 ANS
Le 15 octobre 1993, le bâtiment central d’Ester Technopole était inauguré, ouvrant la voie à la créa-tion d’un parc de 210 ha dédié à l’accueil d’entre-prises de technologies innovantes. En 20 ans, la technopole est passée de 7 à 176 raisons sociales, de 120 à près de 1.900 salariés et de 0 à 800 étu-diants. Plusieurs événements sont programmés pour célébrer cet anniversaire, dont les 15 et 16 mai, l’accueil de l’assemblée générale de Retis, le réseau Français des Technopoles, incubateurs et CEEI.
La CRCI Limousin rejoint le Parc d’Ester.« Être au cœur du développement économique
régional, dans un espace où priment l’innovation, l’international et l’esprit d’entreprise » tels sont les arguments qui ont conduit à l’implantation de la CRCI Limousin sur le Parc d’Ester et que Marc Giaco-mini, son Président, a rappelé lors de l’installation finale en novembre 2012. De fait, le rayon d’actions de la CRCI devrait être plus lisible et sa participa-tion plus efficiente. Rappelons que la mission de « facilitateur » de la CRCI concernent aussi bien le développement des entreprises de services que les domaines de l’innovation (stratégie d’entreprise, transfert de technologie, propriété industrielle…), de l’export (via Limousin international), de l’envi-ronnement (éco-conception, diagnostics énergé-tiques ou environnementaux, veille réglementaire, aides à l’obtention des certifications environnemen-tales) ou encore des NTIC avec l’association Aliptic.
PROFIL DE L’AUTO-ENTREPRENEUR LIMOUSIN
Depuis janvier 2009, date d’entrée en vigueur du régime de l’auto-entrepreneuriat, près de 10.000 demandes d’immatriculation ont été déposées en Li-mousin. L’Insee nous donne diverses indications sur le profil général des auto-entrepreneurs de la région :• Les 3/4 déclarent qu’ils n’auraient pas franchi le cap sans l’existence de ce nouveau statut simplifié.• 1 sur 2 était chômeur ou sans activité au moment de la création. • 35% ont choisi ce statut par besoin d’exercer une activité de complément.• 1 sur 2 avait moins de 40 ans lors de la création et 1 sur 4 avait plus de 50 ans.• 1/3 est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supé-rieur et 2/3 étaient ouvriers ou employés. • Moins d’1 sur 6 était cadre au moment de la création.• 2 sur 3 sont des hommes. • Près de la moitié créent leur activité dans un domaine autre que celui dans lequel ils exerçaient auparavant. • Le commerce et la réparation rassemblent près de 22% des créateurs, la construction 16%. Viennent ensuite les activités de services aux ménages, puis de services aux entreprises.• 1 sur 2 a construit son projet seul. • 1 sur 10 a suivi une formation pour réaliser son projet.• Les principaux obstacles rencontrés lors de la créa-tion tiennent à la difficulté d’établir un contact avec la clientèle potentielle (29% des cas), à fixer le prix des produits et services (25%), à obtenir des renseigne-ments, conseils et formations (22%).• 4 créations sur 10 n’ont nécessité aucun moyen fi-nancier. Moins de 6% ont atteint ou dépassé 8.000 € d’investissement. • 1 sur 20 a eu recours à un emprunt bancaire.• 44% exercent leur activité à domicile et 40% chez leurs clients. • 1 sur 4 pratique la vente en ligne de ses produits ou services. • 3 ans après leur immatriculation, 90% des auto-en-trepreneurs tirent de leur activité non salariée un reve-nu inférieur au Smic. . 1 sur 2 gagne même moins de 4.800€ annuels.
Sources : Communiqués de Presse, Insee Limousin, Les brèves d’Ester,
JDP113.indd 15 06/02/13 18:00

DOSSIER MANAGER : COMMUNICATION
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 16 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
Pour Pierre
Musso, il existerait
une croyance selon
laquelle
"On communique bien
parce que l’on dispose
de moyens techniques
sophistiqués"
LES NOUVELLES FORMES DE COMMUNICATION p. 16
SPÉCIFICITÉS DE LA COMMUNICATION BTOB p. 17
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE PAPIER ET NUMÉRIQUE p. 17
partir d’un contenu divertissant ou informatif. Dans cette approche, le consommateur devient alors lui-même le vecteur du message auprès de ses propres relations et contacts, qu’il transmet volontairement à la manière d’un virus de ma-nière plus ou moins consentie et acceptée. La plupart des sites communautaires jouent d’ail-leurs pleinement sur cette «viralité» (FaceBook, YouTube, DailyMotion…). Les principaux points clés du marketing viral sont :
• Un coût bien plus faible que celui d’une opéra-tion de marketing direct
• Une propagation très rapide du message
• Un auto-positionnement sur le public visé
• Un message perçu comme positif car provenant d’une connaissance plus ou moins proche
3. Marketing de communautéIl consiste à créer puis soutenir des commu-
nautés de niche (forum, fan club, blog, groupe d’utilisateurs) dont les membres partagent un intérêt commun pour le produit ou la marque. Cette marque fournira d’ailleurs à la communau-té des outils, du contenu et de l’information sur elle et ses produits, afin de soutenir la commu-nauté et lui donner une raison d’exister et plus encore de susciter le bouche à oreille.
4. Evangélisme technologiqueCette forme de communication s’inspire des
évangélistes religieux en créant un culte qua-si-religieux pour une marque ou un produit (exemple Apple), afin que chaque consommateur devienne un farouche défenseur de la marque et puisse à tout moment tenter de convaincre son entourage de l’adopter. Les évangélistes techno-logiques deviennent souvent des influents-clés, de véritables commerciaux sans commission !
5. SeedingIl s’agit d’une pratique utilisée par un grand
nombre d’entreprises dans le milieu high-tech. Elle consiste à favoriser l’adoption d’un produit en le plaçant entre les mains des bonnes per-sonnes, lesquelles deviennent ensuite des pres-cripteurs indirects par effet de contagion.
6. Blogging de marqueCette méthode consiste à créer une communi-
cation ouverte et transparente sur ses produits à partir de la création d’un blog officiel (entre-prise) ou non officiel (fan). L’objectif est de faire participer de manière active la blogosphère en partageant des informations utiles sur la marque, ou le produit, afin que la communauté puisse les réutiliser et amorcer le bouche à oreille.
7. Cause MarketingL’objectif pour une marque est de participer,
voire de s’associer, à certaines initiatives so-ciales et/ou éthiques afin de gagner en noto-riété et en respectabilité. L’effet recherché est de sensibiliser au produit ou à la marque les personnes impliquées dans la défense de ces ini-tiatives (commerce équitable, environnement, écologie…) et donc de gagner en visibilité dans les milieux concernés.
8. Marketing des influentsCe type de communication consiste à trouver,
au sein de communautés-clés, des leaders d’opi-nion en contact avec un grand nombre d’autres personnes de leur communauté et, par consé-quent, susceptibles de transmettre un message à un public plus large.
9. Street marketingCette technique est à mi-chemin entre l’évé-
nementiel (construit autour d’une vraie mise en scène, proche du théâtre de rue) et la simple dis-tribution de tracts ou d’échantillons, en vue de susciter l’attention d’un public cible mouvant, en créant pour lui des animations interactives afin de marquer les esprits.
L’objectif est également de valoriser la marque ou un message précis en développant une ani-mation et une communication de proximité dans des lieux spécifiques afin de créer du trafic et une augmentation des ventes. Le street marke-ting doit identifier précisément les zones clés de passages de la cible choisie : environs d’une université pour les étudiants, quartier d’affaires
sentent que 17% des investissements publicités atteignent à peine les 7% de temps passé. Cela signifie que lorsque les médias traditionnels sont connus et appréciés ils ont une grande force de persuasion et d’influence face à l’Internet. Toutefois, la question du marketing alternatif est devenue dorénavant essentielle face à un consommateur qui se sait régulièrement mani-pulé par la publicité ainsi que par une partie de l’information médiatisée. Tout le problème de la communication «technologique», via l’Internet et les mobiles, est donc de savoir innover tout en conservant les fondamentaux du message et de la couverture ciblée sur un territoire donné.
Pour continuer à séduire et à étonner, la publi-cité doit impérativement devenir plus créative et se démarquer en permanence. C’est la raison pour laquelle de nouvelles formes de communication aux terminologies souvent anglo-saxonnes ont émergé tout au long de ces dernières années. Elles ont pour commun dénominateur d’être toutes permissives et non intrusives permettant ainsi aux cibles, de se renvoyer entre elles l’in-formation et/ou d’avoir la possibilité d’aller la chercher directement à la source.
Du fait de la crise de confiance et de la moindre adéquation des messages provenant d’organes de communication traditionnelle considérés comme intrusifs, de nouveaux outils regroupés sous l’égide du «Marketing alternatif» sont censés répondre au changement de mode de consomma-tion, de choix et d’achat.
L’intérêt de tous ces outils est qu’ils peuvent être utilisés en synergie pour créer un faisceau élargi de communication :
1. EmailSelon une étude du Syndicat National de la
Communication Directe (SNCD), l’email reste l’un des canaux d’information préférés des inter-nautes permettant de suivre l’actualité d’une marque, à condition que celui-ci ne soit ni trop invasif, ni trop répétitif. 38 % des internautes français déclarent ainsi préférer l’email pour s’informer sur les marques, contre 7,8 % pour les réseaux sociaux et ce, d’autant plus, que les boîtes emails sont principalement consultées sur ordinateur loin devant les appareils mobiles.
Suite à un e-mailing promotionnel près de 46 % des sondés affirment avoir acheté en ligne et 16,8 % en boutique. Aussi pour intéresser l’in-ternaute la campagne e-mailing doit associer :• Un contenu qui s’adapte au contenant : par exemple, les tablettes et les téléphones n’ont pas la même taille d’écran ni les mêmes capa-cités techniques qu’un ordinateur. Il convient donc de créer un contenu qui s’ajuste à chacun d’eux tant au niveau du poids du message que du design.• Eviter de spammer le lecteur en préférant la qualité du message à la quantité. Cela suppose de qualifier et de cibler les publics afin de faire parvenir la bonne annonce à la bonne personne. Plus un email est adapté au récepteur et plus le taux de conversion est élevé. L’inverse est éga-lement vrai !• Eviter les messages répétitifs en renouvelant les offres et les contenus afin de surprendre et d’intéresser les lecteurs. • Créer une landing page (page d’atterrissage) après la première étape du contenu de l’e-mai-ling. Il est recommandé de créer une page de destination de la campagne (fiche produit en pdf, site web ou page web spécifique) qui soit taillée sur mesure afin d’optimiser le taux de conversion (avec reprise des grandes lignes du message afin de ne pas disperser l’attention de l’internaute, un texte clair, une page courte à charger avec élimination de tout élément para-site).
Pour se donner les meilleures chances de transformation, il faut bien baliser le parcours en vue de rediriger rapidement l’internaute vers l’action souhaitée (remplir un questionnaire, acheter le produit...).
2. Marketing viralPour la Commission de Terminologie il s’agit
d’une «Technique mercatique reposant sur la transmission de proche en proche, par voie électronique, de messages commerciaux». Cela s’apparente au bouche à oreille électronique à
n LES NOUVELLES FORMES DE COMMUNICATION
LA COMMUNICATION «TECHNOLOGIQUE»
Depuis l’arrivée de l’Internet, la communica-tion a largement tendance à «être instrumenta-lisée par les technologies de l’information et les outils de télécommunication». Pour Pierre Musso, professeur en Sciences de l’information et de la communication, il existerait même une croyance selon laquelle «On communique bien parce que l’on dispose de moyens techniques sophistiqués (dernière version du logiciel, mobile…)». Pour lui, cette croyance serait fondée en partie sur la philosophie des réseaux (réseau de neurones, réseau sanguin, réseau ferroviaire…) qui per-mettent de relier des entités physiques distantes le tout dans un cadre organisé pour la vitalité de l’ensemble.
C’est la raison pour laquelle les nouvelles formes de communication sont devenues de plus en plus sophistiquées avec l’arrivée de nouveaux codes de communication et de nouvelles façons de penser. Cette évolution s’est largement trans-formée sous l’égide du marketing dit «alternatif» faisant qu’il n’existe plus un seul mode de com-munication dominant mais une communication multicanaux.
En fait, la communication est devenue une pratique complexe associant 4 courants dis-tincts : le message traditionnel (communication stricto sensu), l’information traitée, le marketing alternatif et la technologie.
LE MARKETING ALTERNATIF
Selon une étude réalisée par Clipperton Fi-nance, le ratio investissements pubs/temps passé est 5 fois plus important dans les journaux que sur Internet.
Alors que l’Internet compte pour 36% du temps passé sur un média en captant 19% des investissements pubs, les journaux qui ne repré-
Contact JDP : Nathalie Vauchez
06 71 42 87 88 - 05 46 00 09 19 [email protected]
Journaldes Professionnelsdes ProfessionnelsJdP
JdP
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 1 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
DOSSIER MANAGERp. 6
Journaldes Professionnelsdes ProfessionnelsJd
P
JdP
Journaldes Professionnelsdes ProfessionnelsJd
P
JdP
LES POINTS DE PRESSE
DE L’ENTREPRISE
ÉDITION POITOU-CHARENTES - LIMOUSIN - VENDÉE FÉVRIER - MARS 2013
Numéro 113 | Février - Mars 2013 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
Les entreprises qui bougent !
Actualités Poitou-Charentes,Vendée, Limousin&Formation EMPLOI
Les nouvelles formes de communication
Master dossier :
• Ressources humaines
• Management
• Banque
• Net
26 000 exemplaires, 70 000 lecteurs
THÈMES
Pour communiquer efficacement auprès des Professionnels
de Poitou-Charentes - Limousin - Vendée
Réservez dès à présent vos espaces publicitaires ou publi-rédactionnels dans le JDP N° 114 (sortie le 28 mars 2013, bouclage le 20 mars)
JDP113.indd 16 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 17 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
lers à grand tirage pour équilibrer leurs comptes, les perspectives de cette nouvelle situation ne sont pas rassurantes. Rappelons qu’actuelle-ment, en France, le rapport des ventes de livres papier (97%) sur le numérique (3%) est encore largement en faveur des acteurs de la chaîne papier même si le volume des ventes diminue.
LA PROBLÉMATIQUE DU CONTENU
En fait, le second vrai problème posé par la complémentarité du papier et du numérique est celui du contrôle du contenu, donc du lecteur, donc du marché. Pour le vrai lecteur, le princi-pal est toujours et avant tout le contenu qui transmet l’information, le savoir, l’émotion. C’est d’ailleurs l’une des immenses chances qu’ont les sociétés démocratiques de pouvoir accéder à une offre littéraire merveilleuse et riche provenant de grands penseurs et écrivains, de scienti-fiques, d’explorateurs mais aussi liée à l’histoire, à la connaissance professionnelle ainsi qu’à de très nombreuses formes de savoirs variés et multiples. Force est de constater qu’après une floraison extraordinaire de contenus de qualité pendant plusieurs siècles, la «production cultu-relle» s’est peu à peu académisée et standardi-sée du fait d’une intermédiation très sélective, à la source directe des auteurs, ne faisant au-jourd’hui paraître qu’une très petite partie de la production littéraire, intellectuelle, «compéten-tielle» nationale.
La principale raison tient au rôle décisif de filtration (sélection drastique des auteurs, mes-sages, informations ; fortes barrières à l’entrée dans les circuits de diffusion pour les auto-édi-teurs ; diffusion prioritaire des livres provenant des grands éditeurs du fait de l’importance de leur catalogue et de leurs réseaux de diffusion bien implantés et surtout maîtres de la manoeuvre éditoriale en proposant des ouvrages bien mar-kétés qui se vendent le mieux : romans, cuisine, loisirs…). Dans le cadre de cet appauvrissement culturel, ou pour le moins d’orientation insti-tutionnalisée, au sein de la chaîne papier, les chiffres sont implacables avec la non diffusion de 9 auteurs sur 10 proposant un manuscrit (niveau éditeur) et la diffusion préférentielle (niveau li-braire) de quelques dizaines de grands éditeurs sur les 10 000 existants en France.
UN RÉÉQUILIBRAGE NÉCESSAIRE
Depuis son invention par Gutenberg en 1440, le livre papier a un immense intérêt que per-sonne ne saurait valablement contester. Il donne notamment de l’importance au contenu, du plaisir à lire et à toucher, tout en consacrant sa légitimité par l’observation de nombreuses règles et procédures de réalisation (maquette, structuration, rédaction soignée, correction…) permettant ainsi la transmission du savoir et de l’information dans de très bonnes conditions physiques. En face, le numérique représente une nouvelle race de livre aux contenus, certes souvent secondaires, mais aussi enrichis des différences. Il permet de contourner facilement l’ensemble des murs de pierres et de verre ins-taurés dans l’économie, les esprits et la culture traditionnelle, en permettant à des centaines de milliers de nouveaux contenus de paraître (pro-venant d’autres pays, d’autres langues, d’autres richesses culturelles) rapidement, facilement et sans aucune censure d’aucune sorte.
Le numérique, même avec ses défauts, apporte de l’interactivité avec le lecteur, un accès libre et démocratisé au savoir et à l’expression écrite. Tout le monde peut lire et consulter des milliers d’ouvrages avec le même contenant. Tout le monde peut écrire avec un simple logiciel de bu-reautique (word, pdf…) et voir son «œuvre» ac-cessible dans le monde entier via un simple lien ou site web. En cela, le numérique est un grand progrès, une évolution naturelle, en réorganisant autrement le pouvoir issu du savoir, comme en mettant chacun au même niveau d’information en quasi temps réel. Tout le reste n’est qu’affaire de business !
Principales sources utilisées : L’Entreprise - http://fr.wikipedia.org - www.journaldunet.com -www.techno-science.net
tend à se développer de plus en plus avec le marketing relationnel en se présentant sous 3 formes :
... Marketing direct vendeur visant à provo-quer un achat immédiat (VPC).
... Marketing direct de qualification permet-tant d’identifier des prospects qui seront ensuite traités par d’autres moyens commerciaux et base de données
... Marketing direct de fidélisation dont l’ob-jectif est de créer, puis d’entretenir des relations suivies avec des prospects et des clients au tra-vers d’une communication très personnalisée.
n COMPLÉMENTARITÉ ENTRE PAPIER ET NUMÉRIQUE
UNE VÉRITABLE RICHESSE CULTURELLE
Il est évident que le progrès technologique suppose d’insérer progressivement la dématé-rialisation des contenus (numérique) en com-plémentarité intelligente avec la formalisation classique des contenus (papier). C’est le même type de mariage de raison qu’entre le média et le hors média qui, sous l’effet de l’énorme pression exercée par les technologies de l’information et de la communication, fait que le temps est venu d’apporter aux lecteurs une offre «multiconte-nant», comme il en est de l’offre multicanal en communication, associée en plus à une offre d’«hypercontenus» (en grand nombre). C’est sur le «comment» et «en faveur de qui» que porte actuellement en Europe, notamment en France, le grand débat papier contre numérique ou com-plémentarité entre papier et numérique. D’un côté se trouvent les farouches partisans de la «chaîne papier» et, de l’autre, ceux de la «chaîne numérique» avec, au milieu, les modérateurs qui prônent une complémentarité intelligente, car incontournable à terme. Pour ces derniers, le pouvoir de lire, s’exprimer et de s’informer, doit s’effectuer à tout moment au gré des envies, des moyens mais aussi des urgences d’information de chacun. En cela, la complémentarité c’est en quelque sorte la liberté de choix dans une offre doublement enrichie !
LA PROBLÉMATIQUE DU CONTENANT
Au-delà de la motivation individuelle à pré-férer l’usage du livre papier à l’usage du livre numérique (eBook) ou inversement (comme c’est le cas pour les jeunes générations), la premier grande problématique actuelle se résume dans une guerre de positions entre les acteurs A de la chaîne traditionnelle du livre (fournisseur de papier, imprimeur, éditeur, diffuseur, presse, libraire, grands auteurs traditionnels) et les ac-teurs B de la nouvelle chaîne du livre numérique (éditeurs de logiciels, fabricants de technologies hard et mobile, e-distributeurs, e-plateformes sur l’Internet, sites web, petits auteurs de niche, dissidents). Pour bien comprendre les enjeux, il faut savoir que ces derniers sont avant tout liés à la perte d’hégémonie industrielle, économique et commerciale des acteurs de la chaîne A au profit progressif des nouveaux entrants de la chaîne d’acteurs B. Sur le fond, tout porte quasi essentiellement sur la domination des parts de marchés par le biais du «contenant» livre papier (histoire européenne) contre l’émergence d’une concurrence nouvelle fondée sur les nouvelles technologies de l’information et de la commu-nication.
Pris dans l’engrenage économique de cette nouvelle concurrence, de la crise et du change-ment de comportement du lecteur, les acteurs de la chaîne papier se montrent relativement hos-tiles, et c’est bien compréhensible, du fait direct de l’érosion de leur suprématie et surtout de la baisse de leur CA après des décennies de crois-sance et de positions rentières. Il est vrai que pour le petit libraire qui voit son influence et ses ventes régulièrement diminuer, comme pour les grands éditeurs qui doivent vendre des best-sel-
... Leaders d’opinion 5. Définition des motivations et des freins de
chaque type de cible en prenant en considéra-tion le fait que les clients sont souvent très dif-férents les uns des autres (fournisseur industriel de biens, artisans, services, prestataire, utilisa-teur final…).
6. Élaboration des actions de création en fonc-tion des cibles retenues et du positionnement : axes et thèmes des messages ; idées forces, slo-gans, visuels, symboles, intranet, presse d’entre-prise…
LES DEUX GRANDS TYPES DE COMMUNICATION EN B2B
Il existe deux grands types de communi-cation : la communication média publicitaire (vocation purement publicitaire dans les maga-zines, journaux, radio, TV, cinéma, bannières sur Internet) et la communication hors média (vocation marketing) regroupant l’ensemble de tous les autres outils (mailing, marketing direct, prospectus, réseaux sociaux, salon, foire, télé-phone…). Ces 2 grands moyens de communiquer sont absolument complémentaires sachant que, par principe, on ne sait pas où se trouve la cible le jour j, au moment de l’envoi et/ou de la ré-ception du message. Il faut donc savoir balayer sur le plus large spectre de supports distincts, sachant que chaque moyen de communication renforce l’ensemble du dispositif tout en présen-tant des caractéristiques spécifiques selon l’effet recherché.Exemple d’avantages à retirer avec la commu-nication média en BtoB• Moyen de communication polyvalent• Possibilité d’être délégué à une agence appor-tant ainsi un grand confort à l’annonceur• Faire une audience de masse de manière indif-férenciée• Bonne efficacité pour recruter des consomma-teurs• Bonne efficacité pour valoriser la marque• Effet rapide sur la notoriété et les ventes• Capitalisation des effets• CPM (Coût Pour Mille personnes) faible • Communication contrôlée par l’entreprise • Intégrité du message respectée par les médias (format, code couleur, logo, emplacement…)• Crée l’intérêt et impressionne au moment de la découverte du message par les cibles tièdes ou chaudesExemple d’inconvénients à retirer avec la communication média en BtoB• Déperdition souvent forte si le média ne re-couvre pas suffisamment le cœur de cible• Fort encombrement publicitaire dans les meil-leurs supports pouvant créer un phénomène de saturation• Message forcément réducteur sur l’offre• Réactivité faible en terme de transformation des ventes (cela ne doit jamais être le but pre-mier) • Moindre efficacité pour les produits en phase de maturité et déclin que pour les produits nou-veaux• Moindre efficacité pour fidéliser la clientèle• Action visible qui ne peut être cachée à la concurrence• Risque de surenchère publicitaire
Exemple d’avantages à retirer avec la com-munication hors-média en BtoBC’est une multitude de manières pour faire pas-ser le message :• Relations publiques (RP)• Parrainage et mécénat• Foires et salons• Bâches grand format• Cartes postales• Sponsoring• Communication événementielle• Relations publiques • Relations presse• Marketing direct non adressé (dépôt rue ou boîte aux lettres) : imprimé sans adresse, pros-pectus, offres promotionnelles, journaux de dis-tributeurs… comprenant un coupon-retour afin de constituer un fichier personnalisé• Marketing direct adressé (le plus performant car basé sur des fichiers personnalisés, CRM). Il
pour les cadres… C’est un concept peu coûteux faisant plus appel à la créativité et à l’imagina-tion qu’aux moyens financiers et techniques.
10. Guérilla marketingCe terme décrit un marketing non convention-
nel basé sur des méthodes agressives à petit budget.
Il s’agit le plus souvent d’événements ponc-tuels dont l’objectif est de marquer les esprits, d’amuser, étonner, intriguer, surprendre et/ou susciter la conversation autour d’un événement, d’une marque ou d’un produit. C’est également l’occasion de créer une relation plus proche et moins formelle entre la marque et sa cible. La guérilla marketing s’appuie essentiellement sur le street marketing, le seeding et le marketing viral dans une portée qui se veut à la fois excep-tionnelle, innovante dans le concept, créative dans la mise en application et originale dans le contenu. L’objectif est également d’activer le buzz marketing sachant que toutes les tech-niques sont bonnes pour inciter le passant à s’y intéresser : manifestation factice, affichage mobile, affichage à la craie ou à la bombe de peinture au sol...
n SPÉCIFICITÉS DE LA COMMUNICATION BTOB
La communication en BtoB (business to busi-ness) se distingue sur de nombreux points de la communication envers le consommateur (BtoC) par le fait d’enjeux relationnels et économiques plus stratégiques. La vocation du BtoB est de favoriser un échange durable entre deux ou plu-sieurs entreprises en vue d’établir un contact pérenne dans un langage, des pratiques et une culture professionnelles compréhensibles entre partenaires. Les objectifs poursuivis sont d’installer une relation à distance à finalité contractuelle et/ou partenariale sachant que, en moyenne, une relation BtoB qui s’est installée dure entre 9 et 14 ans. A partir de là, la com-munication BtoB doit établir un socle d’infor-mations et de messages reposant, à la fois, sur la confiance et la crédibilité mais aussi sur le ciblage, l’intérêt technique et/ou commercial à travailler ensemble.
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
A partir de là, la communication doit intégrer différentes phases en apportant, à chaque fois, des réponses pertinentes en terme de position-nement du message et/ou des produits comme en terme de segmentation du marché et des cibles sur lesquels communiquer. Il convient dès lors de mettre en place une stratégie de com-munication articulée sur les 6 étapes suivantes :
1. Analyse marketing de l’entreprise : sa culture, ses valeurs, sa place sur le marché et celui de ses produits, la notoriété de la marque, le contexte concurrentiel, les besoins exprimés ou à susciter, les méthodes de fabrication…
2. Recherche d’un positionnement clair et lisible du «premier coup» dans la présentation du produit, du service et/ou de l’entreprise, en terme d’intérêt ciblé.3. Définition des cibles de communication sa-chant qu’à chaque cible correspond un moyen d’action spécifique. Dans ce cas, les principaux intervenants en BtoB sont :• Prescripteurs (distributeur, leader d’opinion, experts)• Décideurs (dirigeant)• Acheteurs (service commercial)• Utilisateurs (consommateur, utilisateur final)
4. Recherche du cœur de cible sur lequel doit se concentrer tout l’effort de communication en raison de son importance. Il doit bénéficier d’un traitement particulier avec des opérations de marketing direct, de promotion ou de RP. De manière générale, plus la cible est vaste, plus il faut définir un cœur de cible qui se compose alors des catégories suivantes :
... Utilisateurs les plus importants en nombre
... Consommateurs présentant le plus grand potentiel
JDP113.indd 17 06/02/13 17:39

LES ENTREPRISES QUI BOUGENT
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 18 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
16 CHARENTE
COGNAC LARSEN DANS LE GIRON DE REMY-COINTREAU
En décembre 2012, le groupe Rémy Cointreau (cognacs Rémy-Martin) a acquis la société Lar-sen, producteur du « cognac des vikings». Cette opération lui permet de mettre la main sur un stock conséquent de vieilles eaux-de-vie tout en lui ouvrant les portes du marché norvé-gien (40.000 caisses vendues par an) et des duty free où le cognac Larsen est bien implanté. Fon-dée en 1926, la marque au drakkar était reconnue pour être l’une des dernières maisons de négoce indépendantes, et, selon le groupe charentais, « l’une des rares à disposer d’une offre de produits aussi prestigieuse ».
Rémy-Martin prépare l’avenirA partir d’avril 2013, le nouveau chai de Rémy
Martin construit sur 3.000m2, sera en exploitation et la modernisation de l’unité de conditionnement de Merpins (4.200 m2) sera terminée. Ces investis-sements permettront à la Maison de cognac d’aug-menter sa capacité de stockage et de vieillisse-ment des eaux-de-vie de 40.000 hectolitres tandis que l’unité de conditionnement, dotée de toutes nouvelles machines high-tech, permettra une plus grande capacité de production et améliorera les conditions de travail du personnel.
Pour Patrick Piana, directeur général de Rémy Martin, ces deux réalisations ne sont que la par-tie visible pour le moment d’un projet structurant de plus grande ampleur à Merpins.
COGNAC CAMUS S’INTERESSE AU MARCHÉ AMÉRICAIN
Classé au cinquième rang des maisons de cognac en termes de volume, Camus a triplé en trois ans son chiffre d’affaires, dopé notamment par ses ventes en Asie où elle dispose d’un réseau de distribution propre et où elle réalise 40% de son CA. Après avoir posé des jalons sur le marché russe en 2012, la maison Camus a décidé, cette année, de s’attaquer plus franchement au mar-
ché américain, qui s’avère être le premier marché mondial par l’importance des volumes commer-cialisés, notamment pour les séries VS et VSOP.
En trois ans, la maison Camus a plus que dou-blé son effectif pour atteindre aujourd’hui 500 salariés. Avec 180 hectares de vignes, la dernière maison familiale de cognac est un des plus grands propriétaires du Cognaçais mais ce vignoble n’as-sure que 5% de sa production estimée à 460.000 caisses (CA global proche de 150 M€).
LE GROUPE HERTUS VA DEMENAGER A CHAMPNIERS
Hertus, groupe charentais spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces en plas-tique et d’objets promotionnels, notamment pour l’industrie du luxe (L’Oréa, LVMH) va regrouper ses quatre charentaises (AMS, Innomould, Alu-plast, TPSO) sur la zone des Montagnes à Cham-pniers. La nouvelle usine de près de 7.000m2, qui devrait être livrée en août 2013 et mise en service progressivement sur un an, rassemblera à terme une centaine d’emplois. Créé par Jean-Louis et Philippe Sutre, le groupe possède une cinquième filiale, Précis’M (44 salariés/4.500 m2) dédiée à l’emballage agroalimentaire qui, elle, poursuivra ses activités sur le site de Péaule, dans le Morbihan. En 2012, le groupe a réalisé un CA proche de 17 M€.
VÉTALIS S’INSTALLE À CHÂTEAUBERNARD
Trop à l’étroit à Genté, Vétalis va s’installer en mai 2013 dans les anciens chais Prunier de Châ-teaubernard. Un site qu’elle avait acquis en 2010 et qui va lui permettre de voir grand avec 3.200 m2 d’aménagements. Spécialisée dans la nutra-ceutique en santé animale, et plus particulière-ment dans les compléments alimentaires des bo-vins, l’entreprise dispose de nombreux brevets et évolue sur le marché européen. Elle emploie une trentaine de salariés et affiche 5 M€ de CA, en progression de 22% sur les deux dernières années.
En septembre 2011, elle avait reçu le prix In-nov’Space pour le lancement de l’ElectroPidolate, un produit destiné à réduire les fièvres de lait touchant les vaches laitières.
LITHO-BRU ENCORE PRIMÉE
L’entreprise cognaçaise Litho Bru, spécialiste des étiquettes pour le secteur du vins et spiri-tueux, a été sacrée meilleur imprimeur français dans les catégories « offset » et « sérigraphie » lors du 6ème concours national de l’étiquette adhésive organisé au salon de l’emballage, en novembre 2012. Ces deux prix lui ont été attri-bués pour des étiquettes réalisées pour des Mai-sons de champagne. Rappelons que Litho Bru regroupera ses unités de production à Merpins en 2013, sur l’ex site de Schneider Electric.
17 CHARENTE-MARITIME
«ACTION LEARNING»
L’ESC La Rochelle a signé un contrat d’exclu-sivité en France avec l’association américaine «World Institue for action learning» (WIAL) pour développer dans l’hexagone un nouveau type d’« apprenance en entreprise » : l’action lear-ning. Plus encadré que le brainstorming, l’action learning repose sur un modèle de réunion de 5 à 8 personnes dont l’objectif est de répondre de façon concrète et opérationnelle à « un problème complexe, urgent, stratégique et multidimen-sionnel » de tout ordre qui ne peut pas trouver de réponse auprès d’experts. Plusieurs principes caractérisent la démarche WIAL : le groupe doit être constitué de membres aux compétences complémentaires, de différents services, y com-pris ceux qui ne sont pas directement concernés, aucune affirmation ne peut être délivrée sinon pour répondre à une question, une plage de 90 minutes chrono est prévue suivant un timing précis et sous la houlette d’un coach certifié. « Nous sommes dans une logique d’intelligence collaborative et de construction par le question-nement » précise Jean-Michel Cramier, directeur du département formation continue de l’ESC. De fait, la méthode peut être déployée en toutes circonstances : réunion d’équipe, séminaire de réflexion, groupe de travail créatif, organisation d’un événement… Cette méthode de « manage-ment collaboratif » se veut d’autant plus perti-nente qu’elle peut parallèlement constituer une réponse à certains risques psychosociaux ou de démotivation découlant du manque de reconnais-sance et d’écoute des salariés.
SIMAIR CONTINUE SON ASCENSION EN RACHETANT AÉROPROD
L’équipementier aéronautique rochefortais Si-mair s’est offert Aeroprod, une entreprise de 60 salariés et 5 M€ de CA située à Colomiers. Comme Simair, le site toulousain évolue dans la sous-traitance aéronautique et réalise des éléments d’aérostructure pour la Sogerma et Airbus, avec une spécialisation particulière pour les métaux durs comme l’inox et le titane. Une compétence complémentaire à Simair, plus spécialisé dans les pièces en aluminium. Cette opération de crois-sance externe permettra ainsi de mieux répondre à la forte hausse des demandes, tant en termes de capacité, de technologie que d’efficacité com-merciale.
Depuis son rachat en 2010 par ses dirigeants actuels, Bertrand Cointy et Marc Geiger, la Simair est passée de 150 à 220 salariés sur son seul site de Rochefort. Le CA suit la même ascension avec 15 M€ en 2011 et près de 19 M€ en 2012. Avec le site de Colomiers, le chiffre d’affaires attendu pour 2013 pourrait approcher les 30 M€.
SARRION REPREND LES TRANSPORTS BLANCHARD
Créé en 1947 à La Rochelle, le Groupe Sarrion est une entreprise familiale de transports & lo-gistiques qui, aujourd’hui, compte 400 salariés répartis sur 9 sites : Port de la Pallice, Issou-dun, Tours, Nantes, Sète, Aigrefeuille, Saint-Jean d’Angély, Bordeaux et Le Havre. Avec ses 350 véhicules adaptés à tout type de transport et plus de 1.100 semi-remorques, l’entreprise peut effectuer différents types d’intervention : transport conventionnel en plateau, rideaux cou-lissants, transport de conteneurs, de produits industriels, de grumes, transports exceptionnels (nautisme, industrie, mobilhomes avec les filiales Albatrans, Multitrans et Trans Mobil), location de véhicules avec chauffeur, manutention portuaire, ... Spécialisé aussi en logistique, le groupe offre de nombreuses surfaces de stockage, assurant lui-même la manutention. Il ne lui manquait plus que le volet « déménagement – garde-meubles » pour couvrir toute la palette de services liés au transport. C’est chose faite avec la reprise des Transports Blanchard, une entreprise créée en 1890 et toujours installée à La Rochelle, qui comprend une cinquantaine de salariés (tous re-pris lors la cession) et une cinquantaine de poids lourds et véhicules plus légers.
« LA RÉSIDENCE DE FRANCE » DÉCROCHE SA 5E ÉTOILE
Ancienne auberge du XVIe siècle située en plein cœur de La Rochelle (Rue du Minage), « La Résidence de France » est le premier hôtel, dans la ville, à afficher 5 étoiles via la nouvelle clas-sification, juste en dessous du 5 étoiles-palace. La partie ancienne de l›hôtel, qui compte cinq chambres et onze suites, dont une de 100 m2, est classée à l›inventaire des Monuments histo-riques. Le « charme discret de la bourgeoisie » qui caractérise l’établissement séduit surtout les personnalités du show-biz, de la politique, des affaires ou du luxe tandis que la résidence hôte-lière de 38 studios et appartements, qui jouxte l’hôtel, s’adresse plus à une clientèle de touristes ou de réunions familiales (mariages, anniver-saires..). Un parking de 27 places et des salles de séminaires complètent l’offre.
L’établissement appartient depuis 17 ans au groupe parisien Pujos, qui possède également un autre cinq étoiles à Saint-Tropez, « Le Mas des Chastelas ».
« ERNEST LE GLACIER » SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
Fin 2012, les Banques Populaires et les Chambres de métiers ont récompensé huit entre-prises artisanales lors de la 6ème édition du prix national Stars & Métiers. Devant un parterre de plus de 1.000 invités et en présence de Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, l’entreprise rochelaise « Ernest le Glacier » s’est retrouvé dans les feux des projec-teurs en raflant deux prix. Le prix « Dynamique commerciale » lui a été attribué pour son esprit d’innovation : dix nouvelles saveurs développées chaque année dans son laboratoire, conception de triporteurs électriques à partir de 2013 pour aller chercher les consommateurs hors boutiques, retour du bâtonnet glacé artisanal (un marché laissés aux seuls industriels), page Facebook qui fédère plus de 5.000 fans… Le prix « coup de cœur » a été délivré aux deux jeunes dirigeants, Nicolas et Freddy Babin, pour leur success-story qui prouve que l’artisanat et la famille peuvent donner naissance à de belles entreprises.
En 1999, les deux frères achètent un glacier et son local de 15m2 à proximité du port de La Rochelle. Ils le baptisent « Ernest le Glacier » en hommage à leur grand-père et affichent un premier CA de 180.000€. Aujourd’hui, l’entreprise dispose de 5 points de vente sur la ville dont un avec terrasse sur le vieux Port, de 4 laboratoires de production et affiche un chiffre d’affaires de 1,3 M€. La gestion des ressources humaines de l’entreprise constitue un challenge particulier puisque, compte tenu de sa très forte saisonnali-té, l’entreprise emploie de 3 à 45 personnes selon la période de l’année.
MODIFSPage 1
Dossier Manager page 16 (et non 6)
Pub Foire Expo Ré : Thèmes (avec un s)
Page 18 - 3ème colonne - 17 Charente -Maritime :Le 1er titre est juste "Action learning" (enlever dans ce 1er titre la
résidence de France décroche sa 5e étoile )Ce titre la résidence de France... Figure en 4ème colonne et là il est ok
Page 23 Pub Foire Expo Ré : Thèmes (avec un s)
JDP113.indd 18 07/02/13 08:36

LES ENTREPRISES QUI BOUGENT
Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 19 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
LE GROUPE MERLING REPREND CAFE ERREL
En intégrant la société Café Errel, basée à Limoges, le groupe rochelais Cafés Merling (310 salariés) confirme son ambition d’être leader de l’expresso sur le Grand ouest et le Centre de la France. Le rachat de Café Errel (10 M€ de CA, 85 collaborateurs, présent sur dix départements) illustre une fois de plus la politique de croissance externe mise en place par Vincent Merling. De fait, entre 2008 et 2011, le CA du groupe a dou-blé, passant de 17 M€ à 35 M€. L’objectif est d’atteindre, d’ici 5 ans, 70 M€ avec un effectif de 500 salariés. Rappelons que le groupe Merling se déploie autour de trois activités complémen-taires : la distribution automatique de boissons et de produits alimentaires pour les entreprises, la torréfaction et la commercialisation de cafés aux Cafés Hôtels Restaurants (CHR), les bou-tiques Instant Café pour les amateurs de café, thé et produits raffinés.
SAINTRONIC CREE UNE STATION ÉLECTRIQUE INTELLIGENTE POUR VÉLO
Mobiplugs, c’est le nom donné à la station vélo conçu par Saintronic et présenté officiellement lors du Salon des maires à Paris, en novembre 2012. Avec ce nouveau concept, plus besoin de prise électrique ni d’antivol. En effet, le seul fait de positionner son vélo dans la station/borne collective déclenche le processus de charge élec-trique par induction et verrouille le cadenas. Pour le récupérer, il suffit de présenter un badge approprié.
Pour mettre au point cette innovation, qui s’adresse d’abord aux collectivités locales et administrations mais aussi aux entreprises qui veulent jouer la carte écologique, Saintronic s’est allié au fabricant poitevin de vélos électriques Véloscoot et à la société Velexys de Saintes qui a conçu la carte électronique. Une carte pass qui permet, en outre, aux gestionnaires de Mobiplugs de suivre en temps réel le niveau d’utilisation de sa flotte de vélos à des fins pratiques et statis-tiques. Huit villes de Poitou-Charentes, dont An-goulême, Cognac, Niort, Saintes et La Rochelle, seront équipées de stations Mobiplugs dès 2013.
Par ailleurs, l’entreprise saintaise (CA 2012 proche de 58 M€) a décroché le marché d’Aéro-ports de Paris (1,3 M€) pour la fabrication de 200 bornes. Celles-ci serviront à recharger la flotte interne des véhicules électriques d’ADP sur les aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle, Orly et Le Bourget.
LE STUDIO VITAMINE DANS LA COUR DES GRANDS
Créé en 2008 et spécialisé dans la création Web, le Studio Vitamine a élargi sa palette de compétences pour devenir aussi atelier gra-phique et agence de communication. Avec un effectif de six personnes, la société rochelaise a su séduire des clients d’envergure comme Léa Nature, le Parc des expositions de La Rochelle, le groupe NRJ ou encore Valmont France, lea-der français de l’éclairage public. Elle a réalisé entre autres les sites internet de l’Aquarium de la Rochelle, du service économique de la CDA ou de Gregory Coutanceau. Forte de ses belles réfé-rences, la jeune entreprise vient de quitter la pépinière d’entreprises de la CdA pour intégrer le marché locatif traditionnel et jouer dans la cour des grands.
ALSTOM BENEFICIE DU DÉVELOPPEMENT DU TRAMWAY
Depuis une trentaine d’années, l’usine Als-tom de La Rochelle est connue pour être LE site pilote dans les domaines de la conception et de la production de tramways. C’est en effet à Aytré que les bureaux d’études d’Alstom Trans-port conçoivent les rames et que sont réalisés les carrosseries, l‘habillage intérieur et l’assem-blage final. Les parties motrices étant conçus au Creusot (Côte d’Or) et le système informatique à Villeurbanne.
C’est ainsi que la presque totalité des 1.600 tramways Alstom mis en circulation dans le monde (Alger, Casablanca, Tunis, Istanbul, Mel-
bourne, Rotterdam, Barcelone ou Buenos Aires) sont sortis des ateliers d’Aytré. Dans les deux der-nières années, Alstom Transports a produit 60% des tramways mis en service dans le monde.
Et même 100% de ceux mis en service en France, notamment avec le concept Citadis adapté aux grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Angers ou Dijon. Si l’année 2012 constitue une année record avec 130 rames produites, l’année 2013 s’annonce tout aussi prometteuse avec notamment la com-mande ferme de la Région Ile-de-France pour 19 rames de tramway Citadis (sur un projet d’achat total de 70 rames). Ce qui va générer la création d’une centaine d’emplois sur le site d’Aytré et plus de 300 autres chez les sous-traitants.
Par ailleurs, le développement d’une nouvelle gamme de tramways plus courts et moins chers, Citadis Compact, conçus pour les villes moyennes à partir de 50.000 habitants, ouvre de nouveaux horizons à Alstom Transports. Une première li-vraison est prévue au printemps 2014 pour la ville d’Aubagne et l’agglomération rochelaise pourrait bientôt être sur la liste des futurs clients du Citadis Compact. Rappelons que l’usine Als-tom d’Aytré, qui emploie 1.360 salariés auxquels s’ajoutent près de 300 intérimaires et un millier d’emploi chez les sous-traitants locaux, est le premier employeur industriel de la région.
AKIBAG, POUR L’INTERNAUTE NOMADE
Créée en 2009 par Sébastien Turbe, à l’époque autoentrepreneur, la marque Akibag (diminutif d’Akihabara le célèbre quartier de Tokyo où tout passionné d’électronique rêve d’aller) regroupe une ligne de sacoches dédiée aux netbooks, ta-blettes et autres PC portables. Solide, élégante, pratique et plus discrète que les sacoches d’or-dinateur habituelles, la ligne est déclinée en trois formats, 11, 13 et 15 pouces. Petite astuce supplémentaire : les Akibag sont équipés d’un passe-câble dans le rabat, pour pouvoir passer les écouteurs. La marque est référencée dans 15 magasins en France dont 9 Apple Premium Reseller.
En 2012, pour accompagner son développe-ment (3.500 sacoches vendues depuis la créa-tion), l’autoentrepreneur a créé la Sarl Qui Roxx, installée à Aytré, avec pour objectif de tripler le nombre de revendeurs sur le territoire avant cette fin d’année. Par ailleurs, un mini modèle dédié aux liseuses et tablettes 7/8 pouces de-vrait bientôt compléter la gamme.
4 PROJETS SUR 10 FINANCÉS PAR LE CREDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
En 2012, dans un environnement contrasté, la caisse de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a dégagé un résultat financier de 83 M€, en baisse de 9,5% sur un an. Comme tout établissement coopératif, plus de 90% de ce résultat est réinvesti dans l’entreprise en fonds propres et donc au sein de l’économie régionale.
1,4 milliard d’euros de crédit accordésA l’exception de l’agriculture, les demandes de
financement ont reculé sur tous les marchés : habitat -18,2%, consommation -12,7%, profes-sionnels -14,2%, entreprises -13,6%. Les prêts à l’habitat, toujours porté par les primo-accédants, ont représenté 42% des crédits accordés. Au glo-bal et tous marchés confondus, près de 4 projets sur 10 sur les deux départements sont financés par la Caisse régionale.
L’encours d’épargne a progressé de + 2,8%Avec 13,5 Mrds d’€ d’épargne, la caisse de
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres recouvre 36,4% des parts de marché de son terri-toire (33% pour les produits d’assurances).
L’immobilier, le troisième métier du Crédit Agricole
Dans les 29 agences immobilières Square Habi-tat, l’activité de transactions immobilières (530) s’est affichée en baisse de 9% tandis que le nombre de biens en gestion (1.700) a progressé de 3%.
Rappelons que la caisse régionale emploie 1.720 salariés dont 57 ont été recrutés en 2012.
Centre d’affaires FUTUROPOLE : un emplacement qualitatif pour les entreprises
au cœur de la technopôle du Futuroscope
Le Groupe Pierreval, promoteur-aménageur poitevin, a pour volonté de faire de Futuropole LE centre d’affaires de la région, pour accompagner les entreprises en développement, ceci à coût très compétitif.
Location de bureaux, pour tous baux, ou encore à la journée ou à la semaine, domi-ciliation d’entreprises et enfin acquisition pour les entreprises souhaitant devenir propriétaires de leurs bureaux ou simplement investir, telles sont les principales prestations proposées par Futuropole.
Situé en plein cœur de la Technopôle du Futuroscope, à 1h30 de Paris, à la sortie Futuroscope de l’autoroute A 10 et à 5 minutes de la gare, le Centre d’Affaires Futu-ropôle offre un emplacement de choix pour toute entreprise souhaitant accroître sa notoriété et soigner son image.
Entièrement modernisé, le Centre d’Affaires Futuropôle met à disposition des entre-prises des bureaux climatisés (vides ou meublés) d’une surface de 15 à 400 m² divisibles, ainsi que de nombreux services tels une salle de réunion une Hôtesse d’accueil, une signalétique dédiée à votre société, un Accès Wifi, un Service cour-rier, un espace détente, un service secrétariat et copieur optionnels, sans oublier le stationnement privé, un interphone et une télésurveillance.
Les locaux correspondent tant aux activités tertiaires qu’à celles de la restauration, avec notamment une cuisine et une salle de plus de 400 m² disponibles immédia-tement.
La volonté du Groupe Pierreval, professionnel de la promotion immobilière et de la gestion locative, est de faire de Futuropole le Centre d’Affaires de référence et de permettre d’accueillir les entreprises sortant des pépinières d’entreprises, de participer à leur évolution mais également de proposer à toutes sociétés un empla-cement de prestige en bénéficiant de l’image du Futuroscope.
Centre d’Affaires FUTUROPOLE, à la sortie N° 28 de l’autoroute A10
www.futuropole.net - Tél : 05.49.00.62.40
Téléport 4, 1 Avenue René Monory
86960 Chasseneuil Futuroscope
JDP113.indd 19 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 20 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
LES ENTREPRISES QUI BOUGENT
79 DEUX-SÈVRES
OPERATION DE CROISSANCE EXTERNE POUR POUJOULAT
Le groupe Poujoulat a acquis la société da-noise VL Stall (15,5M€ de CA, 90 salariés), un des leaders européens de la fabrication de che-minées industrielles qui dispose notamment d’un savoir-faire unique dans le domaine des grands ouvrages (jusqu’à 6 mètres de diamètre et 130 mètres de haut). Grâce à cette acquisition, Pou-joulat devient leader européen de la spécialité avec un chiffre d’affaires cumulé d’environ 35 M€ et une part de marché européenne supérieure à 20%. Réunissant les sociétés Beirens (construc-tion et installation de cheminées industrielles), MCC2I (audit, maintenance et services) et main-tenant VL Staal, le pôle cheminées industrielles du groupe Poujoulat disposera dorénavant d’une offre complète et réalisera 60% de son chiffre d’affaires à l’exportation. Ce pôle sera doré-navant leader en France, en Scandinavie et en Allemagne et plus actif au Benelux, au Royaume-Uni, en Ukraine, en Russie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il compte près de 250 salariés dont 40 techniciens et ingénieurs et 40 personnes dédiées aux services et interventions sur site.
Pour Poujoulat, dont l’export ne représente que le quart du CA, l’acquisition de VL Staal marque le début d’une stratégie plus ambitieuse à l’interna-tional. En 2012, le groupe deux-sévrien a réalisé un CA consolidé d’environ 190 M€, en hausse de 10% sur un an. Il est présent dans 30 pays à tra-vers 16 filiales et emploie 1.400 salariés.
LES ÉTIQUETTES FAZILLEAU INVESTISSENT
Installée à Cerizay, Etiquettes Fazilleau est spé-cialisée dans la conception et la fabrication d’éti-quettes adhésives destinées aux emballages de produits agroalimentaires (Fleury Michon, Maître Coq…), mais aussi aux bouteilles de vin ou à des produits liés aux secteurs pharmaceutique et cosmétique. Pour accompagner le développement de son activité (400 clients pour 1,6M€ de CA), l’entreprise cerizéenne vient de s’installer dans un nouvel espace de 1.340 m2 sur la zone éco-nomique de Monplaisir, doublant ainsi sa surface de travail. Pour 2014, Etiquettes Fazilleau a déjà prévu d’embaucher deux personnes et de com-pléter son parc de machines avec une nouvelle imprimante « huit couleurs » qui lui permettront de produire quelques millions d’étiquettes sup-plémentaires par jour.
MACIF : UNE STRATÉGIE EN TROIS POINTS POUR LES TROIS ANS À VENIR
Directeur général du groupe Macif depuis avril 2012, Jean-Marc Raby a présenté ses objectifs pour 2015 (7 Mds€ de CA contre 5,6 en 2011) et la stratégie qui va avec. Celle-ci est bien dans l’esprit du temps et tient en trois points. D’abord, il s’agira de vendre plus à des sociétaires dont le nombre risque de stagner : concrètement, l’ambition est d’équiper chaque client de 4 pro-duits contre moins de 3 aujourd’hui. Ensuite, des pistes de croissance externe seront explo-rées, notamment sur le marché de l’assurance-santé où les fusions se multiplient : de nouvelles mutuelles santé devraient ainsi prochainement venir s’adosser à la filiale Macif Mutualité. Enfin, le tryptique « gain de productivité, industriali-sation des méthodes de travail et amélioration des performances » complètera la panoplie. Si la stratégie fonctionne bien, les effectifs devraient continuer de s’accroitre légèrement, essentielle-ment pour des postes commerciaux et au contact direct de l’assuré.
Rappelons que la Macif, n°1 français de l’assu-rance auto et habitation, compte 5 millions de sociétaires, gère 25 Mrds d’€ de placements et emploie 9.000 collaborateurs.
LABEL « ORIGINE FRANCE GARANTIE « POUR C2S
Le fabricant de chemises C2S, installé à Cour-lay, a reçu le label « Origine France garantie » pour son activité de conception et fabrication de chemises sur-mesure pour homme. Rappelons que ce label garantit que 50% du prix de revient du produit est fait en France. Couleurs, col, plas-tron, manchettes, boutons, poches, toutes les options et configurations sont possibles à partir d’un catalogue de propositions pour atteindre une personnalisation quasi unique de la chemise. Les 85 salariés de l’entreprise deux-sévrienne réalisent environ 300 pièces par jour. Cette acti-vité de confection, qui fait de C2S le leader euro-péen du sur-mesure, s’est développée grâce à un réseau de 160 boutiques partenaires réparties dans presque tous les pays de l’UE. Les Etats-Unis et la Russie étant dans la ligne de mire. L’autre activité de C2S (55% du CA) consiste à confectionner des chemises pour homme sous ses propres marques : Lui, Belloni, Kidur, Henri-Duc, vendues dans près de 300 boutiques.
JC CONFECTION PARIE SUR LA VENTE DIRECTE
Depuis sa création en 1979, JC Confection n’a cessé de faire évoluer sa stratégie pour « coller » au marché et faire progresser son niveau d’activi-tés. Le cœur de métier fût d’abord les vêtements de travail (avec une quarantaine de salariés) puis le prêt-à-porter féminin en moyenne gamme pour s’ouvrir, en 1998, à la confection élitiste pour des marques comme Yves Saint-Laurent, Agnes B, Givenchy ou Thierry Muggler. Aujourd’hui, cette activité pour le compte de griffes réputées ne représente plus que 40% du CA de l’entreprise, nécessitant de trouver des relais de croissance.
Parmi ceux-ci, la vente directe représente une solution qui permet de se dédouaner des aléas des donneurs d’ordre et d’être moins dépendant de l’extérieur. C’est pourquoi, dès 2008, JC Confec-tion a créé deux marques « maison » : Isis, des-tinée aux seniors et commercialisée par 80 ven-deuses à domicile, Divilune, distribuée également par 80 commerciales, par vente en réunion. Dans la continuité, en 2010, JC Confection rachète la marque Gérard Matel, autre adepte de la vente directe. Aujourd’hui, l’objectif de l’entreprise est clairement de développer la vente directe puisque la direction envisage de passer de 80 à 300 vendeurs pour les marques Divilune et Matel et de 80 à 150 pour la marque Isis. L’entreprise de Moncoutant, qui emploie 650 salariés dont 300 à Monastir (Tunisie), réalise un CA de 20 M€.
LA MAAF DEVRAIT ENCORE CRÉER UNE CENTAINE D’EMPLOIS EN 2013
Pour la mutuelle niortaise, l’année 2012 s’est plutôt bien déroulée avec notamment 42.000 nouveaux véhicules assurés et 80.000 nouveaux contrats habitation enregistrés mais des résultats financiers en stagnation. En termes d’embauches, la Maaf (7.100 salariés) a de nouveau créé une centaine d’emplois en 2012 et devrait en faire autant en 2013, notamment dans les métiers liés à internet et aux relations téléphoniques avec la clientèle.
TÉDELEC LABELLISÉ ENR
L’entreprise niortaise Tedelec, créée en 1965 et spécialisée dans la vente et prestations de services audiovisuels a obtenu le label «Entre-prise Numérique Responsable». Le label ENR a été créé par France iT, le réseau des clus-ters numériques français. Il récompense les entreprises qui « intègrent des préoccupations éthiques, environnementales et sociales dans leurs activités commerciales ainsi que dans leurs relations avec toutes les parties prenantes internes et externes». Tedelec devient ainsi la deuxième entreprise de la région à obtenir cette distinction après 2S3i, agence de communication interactive installée au Futuroscope. Tedelec, qui emploie une vingtaine de salariés sur ses deux sites de Niort et Poitiers, intervient essentielle-ment auprès d’une clientèle professionnelle com-posée d’entreprises, de collectivités et d’adminis-trations (notamment l’Education nationale), sur le Poitou-Charentes et la Vendée.
TROPHEE NATIONAL POUR BODY NATURE
Body Nature, spécialiste de produits cosmé-tiques et d’entretien écologiques a été désignée « Enseigne de l'année » par le club « Génération Responsable», une association dont les membres sont, entre autres, Nature & Découvertes, Picard Surgelés, Courtepaille, La Mie Câline, Sephora, SFR, Yves Rocher Défi Mode, HSBC, KFC… soit 27.000 points de vente en France. L’entreprise de Nueil-les-Aubiers a été primée pour ses initia-tives en faveur du management environnemental et du développement durable, succédant ainsi à McDonalds (2010) et à la Poste (2011).
L’entreprise, qui emploie 120 salariés sur son site de production et dispose de 750 vendeurs à domicile répartis partout en France, a égale-ment été primée dans la catégorie « initiative sociale, ressources humaines » pour ses actions en faveur de l›insertion des femmes, l›égalité des chances pour les personnes sans diplômes et la reconnaissance de la vente à domicile comme métier à part entière.
FRANCE CHAMPIGNON TRAVAILLE POUR CASSEGRAIN
Pour booster un marché en stagnation du champignon en conserve, l’usine thouarsaise de France Champignon vient d’investir 300.000€ dans une nouvelle ligne de production destinée à la fabrication de recettes en sauce pour la marque Cassegrain. Chaque année, 800 tonnes supplé-mentaires de champignons seront ainsi préparées pour atteindre 3.000 tonnes de « produits élabo-rés » : champignons aux marrons, aux aubergines grillées, à la crème fraîche ou tomate-mascar-pone. Le site, qui appartient depuis deux ans au groupe Bonduelle et emploie 200 salariés, pro-duit chaque année 35.000 tonnes de conserves de champignon de Paris et 5.000 tonnes de frais.
TROPHÉE DE L’INNOVATION POUR MINET
Le fabricant de meubles pour chambre à cou-cher, Minet, a décroché le « Trophée de l’innova-tion 2012 » décerné par la Fédération Française du négoce de l›ameublement pour sa nouvelle collection, baptisée Serena. Une ligne à l’aspect béton ciré avec éclairage des plateaux de tables de nuit par simple vibration. Ce trophée récom-pense les efforts d’investissement (machines à commandes numériques) et d’innovation qui ca-ractérisent l’entreprise de Pamproux. Notamment depuis 2006 où les dirigeants ont clairement misé sur le contemporain orienté sur le moyen de gamme. Les chambres d’inspiration Louis-Phi-lippe, produit historique de l’entreprise créée en 1963, ne représentant plus que 40% de l’activité actuelle (CA de 4,4M€ en 2011).
A THOUARD, CEE SCHISLER EMBALLE POUR MCDONALD’S EUROPE
Après les sacs à soufflet, les sacs avec poignées et les emballages de sandwich, CEE Schisler pro-duit pour McDO, depuis 2012, des gobelets. Le contrat d’un milliard de gobelets sur quatre ans a nécessité la création d’une unité de production capable de délivrer 13.000 gobelets/heure par machine et a permis l’embauche d’une quinzaine de salariés. Aujourd’hui, l’entreprise thouarsaise réalise 40% de ses 78 M€ de CA avec les seuls emballages affectés à McDonald’s, à destination d’une dizaine de pays d’Europe du Nord. Sur les 400 salariés que compte l’entreprise, 180 sont dédiés aux seuls produits McDo.
LA LIGÉRIENNE DE BÉTON MISE SUR CELLES-SUR-BELLE
Pour s’adapter à la baisse de commandes dans le secteur de la construction et pour coller au marché local (LGV Sud Europe Atlantique), la Ligérienne de Béton a revu sa stratégie. Elle a d’abord cédé, début 2012, deux usines de parpaings situées à Saintes et à Thiviers (Dordogne) au groupe borde-lais Duroux. Puis elle a investi 10 M€ à Celles-sur-Belle pour renforcer ses positions dans les dalles et poutres de grande dimension, générant une quinzaine d’emplois. Cette nouvelle usine produit, avec le site de Saint-Pierre-des-Corps, des poutres dédiées à la LGV Sud Europe Atlantique qui com-
prend pas moins de 140 ouvrages d’art, soit un marché d’environ 10 M€. Aujourd’hui, seule l’usine de Dangé-Saint-Romain (86) continue de pro-duire des parpaings en grande série. La Ligérienne de Béton, dont la marque commerciale est LB7, est contrôlée par le groupe tourangeau Basaltes (220 personnes). Si le chiffre d’affaires s’affiche en recul depuis 2008, passant de 45 M€ à 40M€, les résultats de LB7 restent bénéficiaires.
86 VIENNE
LE CEREP ENTRE DANS LE GIRON D’EUROFINS
Le groupe nantais Eurofins Scientific a pris le contrôle de Cerep SA, entreprise d’analyses biologiques et de recherches pré-cliniques ins-tallée à Celle-l’Evescault. Créée en 1986, Cerep emploie 210 salariés dont 165 sur le site vien-nois. Eurofins Scientific est, quant à lui, l’un des leaders mondiaux de la bio-analyse avec quelque 170 laboratoires répartis dans 33 pays et plus de 12.500 collaborateurs.
● POITOU-CHARENTES
DUO SOLUTIONS A CRÉÉ SON CLUB DE CHEFS D’ENTREPRISE.
Duo Solutions, groupe régional d’expertise-comptable, a officiellement lancé son club de chefs d’entreprise lors d’une conférence/dé-bat qui a eu lieu fin Novembre au Futuroscope avec pour thème : « Faire du changement une opportunité ». Une thématique qui caractérise bien le Club Duo dont l’état d’esprit se veut fran-chement optimiste, solidaire et volontariste dans un climat difficile. Le club, dont l’objectif majeur est de permettre à ces membres d’élargir leurs relations d’affaires, organisera deux rencontres thématiques par an. Il met d’ors et déjà à leur disposition un espace internet ainsi qu’une page facebook pour communiquer entre eux. Rappe-lons que Duo Solutions dispose d’un réseau de dix bureaux en Poitou-Charentes, comprenant 21 associés et 150 collaborateurs.
NOTEO, UNE AGENCE DE NOTATION POUR ECLAIRER VOS CHOIX CONSO
Baptiste Marty, jeune Rochelais installé à Nantes, a créé Noteo, une agence de notation de produits de consommation accessible sur inter-net ou par application Smartphone permettant de scanner le code barres d’un produit et découvrir ses notes. Accessible gratuitement, il permet aux consommateurs de connaître les performances de quelques 45.000 produits alimentaires, boissons non alcoolisées, hygiène & beauté ou produits d’entretien à partir de quatre critères : impact sur la santé, respect de l’environnement, respect des conditions de travail et des codes éthiques lors de la fabrication, budget. Lors de son entrée sur la scène médiatique et économique nationale, fin Novembre, le jeune entrepreneur rappelait le cœur de son défi : donner le moyen aux consommateurs d’effectuer des choix éclairés et inciter les indus-triels à produire des produits plus sains, de façon plus responsable. L’objectif de Notéo est d’at-teindre rapidement les 90.000 produits référencés.
Des sources scientifiques fiables et reconnues.Pour concevoir la méthode d’analyse et de
notation (note sur 10), la vingtaine d’experts scientifiques indépendants travaillant pour l’Institut Noteo ont analysé et sélectionné de-puis 2008 les études et sources d’informations disponibles, pour retenir les plus pertinentes et objectives dans les différents domaines. Cette sélection s’appuie sur la littérature scien-tifique récente, les avis officiels d’experts indé-pendants français et européens, la réglementa-tion, les recommandations de santé publique, les publications d’ONG nationales et internationales ou encore les classifications de risques publiées par les institutions publiques. www.noteo.info
Sources : Les Echos, Nouvelle République, Sud-Ouest, Charente Libre, Actufax, Communiqués de presse.
JDP113.indd 20 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 21 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
Dans ce cas, la transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail.
Pour le salarié, l’avantage est d’accélérer l’in-demnisation de son départ en évitant d’attendre les délais souvent longs imposés par les procé-dures judiciaires même si celles-ci sont souvent favorables auprès des Prud’hommes. La transac-tion permet également de recevoir, en plus des indemnités légales, une indemnité de transac-tion calculée en fonction du salaire, de la durée de la présence dans l’entreprise ainsi que de compléments liés à la négociation amiable avec l’employeur. Toutefois pour être valable, la tran-saction avec un salarié licencié ou démission-naire doit respecter plusieurs règles.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VALIDITÉ DE LA TRANSACTION
Dans le cas d’une rupture du contrat de travail, plusieurs conditions sont nécessaires :
1. Les parties doivent avoir la capacité effec-tive de disposer des objets compris dans la tran-saction.
2. L’objet de la transaction doit être licite et certain, bien qu’il puisse porter sur un litige futur.
3. La transaction doit respecter les conditions relatives au consentement (articles 1109 à 1122 du code civil) et que celui-ci doit être exempt de vices (article 2053).
4. La transaction ne doit pas masquer un faux licenciement ni un motif inexistant car elle de-vient alors nulle.
5. La transaction doit être obligatoirement conclue après la rupture du contrat, c’est-à-dire intervenir postérieurement à la rupture défi ni-tive du contrat de travail (licenciement ou dé-mission). Ce point est obligatoire depuis un ar-rêt de la Cour de cassation du 29 mai 1996 (Bull civil V n°215).
6. En cas de licenciement, il est obligatoire de respecter l’intégralité de la procédure (en-tretien préalable, lettre de licenciement, préa-vis…).
7. Une lettre de licenciement doit être adres-sée au salarié au risque alors de voir annuler la transaction (arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 juillet 2007 N° de pour-voi : 06-44335).
8. La transaction doit être établie par écrit en double exemplaire et signée par chacune des parties. Si l’établissement d’un écrit n’est pas une condition de validité de la transaction, elle en constitue le parfait moyen de preuve.
9. Aucune mention obligatoire, ni aucune clause spécifi que unilatérale ne doit fi gurer dans la transaction.
10. La transaction doit faire l’objet de conces-sions réciproques signifi ant ainsi qu’elle doit bénéfi cier aux deux parties signataires en évi-tant qu’une seule des parties puisse en tirer profi t. Pour cela, il n’est pas nécessaire que les
La transaction est
au sens de l’article
2044 du code civil un
« contrat par lequel
les parties terminent
une contestation
à naître ».
Aucune des deux parties n’étant disposée à céder totalement aux prétentions de l’autre, dans un souci d’apaisement et pour mettre défi nitive-ment fi n au litige qui les oppose, il est convenu ce qui suit :
La société s’engage à verser à M/Mme... le…, à titre de réparation du préjudice ci-dessus exposé, une somme globale de… euros.
Cette somme se décompose comme suit :- salaire du mois de : … euros- indemnité compensatrice de préavis : … eu-
ros- indemnité compensatrice de congés payés :
… euros- indemnité de licenciement : … euros- indemnité transactionnelle à titre de dom-
mages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par M/Mme… et en contrepar-tie de sa renonciation à toute action en justice : … euros sur les points de contestation ci-dessus rappelés.
4. Rappel des mentions suivantes :M/Mme… reconnaît avoir été informé(e) que
le versement de l’indemnité transactionnelle ci-dessus mentionnée, entraînera pour lui/elle un différé d’indemnisation de… jours à l’assurance chômage.
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. Il règle défi nitivement le litige intervenu entre les parties et a, entre les parties, conformément à l’article 2052 du Code civil, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En conséquence, sous réserve de l’exécution intégrale du présent accord par les deux parties, et celui-ci réglant défi nitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles, les parties soussignées, renoncent irrévoca-blement à tous autres droits, actions ou préten-tions de quelque nature que ce soit qui résulte-raient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail.
A…, le…Signatures de l’employeur et du salarié
n LE DROIT DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Le développement de la pratique de l’Intelli-gence Economique (IE) par les entreprises et les institutions publiques est devenu une nécessité dans un contexte international très jaloux de ses savoirs, agressif sur le plan économique et dans lequel la maîtrise et le traitement de l’informa-tion constituent une arme stratégique majeure.
concessions soient égales mais elles doivent être réelles et effectives.
11. L’absence de concessions réciproques entraîne la nullité de la transaction (Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982). De la même manière, «Il n’y a pas de transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante» (Cour de cass. Chambre civile, 4 mai 1976).
Pour savoir si les concessions sont effectives, les juges comparent souvent les éventuelles irrégulari-tés de procédure de licenciement avec le montant de l’indemnité versée au salarié. Si le montant des indemnités prévues dans la transaction est inférieur aux indemnités contractuelles prévues normalement en cas de licenciement justifi é, alors les concessions sont jugées comme ne constituant pas une véritable concession de la part de l’employeur (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2008 - N° de pourvoi 07-40.576).
12. Les parties qui ont signé ne peuvent reve-nir sur la transaction car elle a alors «l’autorité de la chose jugée en dernier ressort» (art. 2052 du Code civil).
13. Il n’existe que 3 situations à partir des-quelles le juge peut annuler une transaction :• Le fait qu’une des parties ne remplit pas les engagements pris• Existence d’un vice de consentement (chan-tage, pression, violence, manoeuvre frauduleuse)• Erreur sur la personne ou sur l’objet de la tran-saction
Exemple de lettre formant la transactionCelle-ci se compose traditionnellement de 4
parties :1. Mentions légales : identité, N° de Sécurité sociale et coordon-
nées des deux parties2. Rappel des faits : Il est rappelé ce qui suit :M/Mme… a été embauché(e) le… en qualité
de…A la suite du licenciement de M/Mme... notifi é
par lettre reçue le..., les parties sont en litige sur les points suivants :
Ou A la suite de la démission de M/Mme… notifi ée
par lettre en date du..., les parties sont en litige sur les points suivants :
3. Indication des points précis sur lesquels porte le litige :
M/Mme... considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il a droit de ce chef à des dommages et intérêts, ce que conteste... (nom ou raison sociale de l’employeur) qui s’estime au contraire dispensé d’observer le préavis et de verser l’indemnité de licenciement en raison de la faute grave du salarié.
n CONCLURE UNE TRANSACTION
La transaction est au sens de l’article 2044 du code civil un «contrat par lequel les parties terminent une contestation à naître». Elle est donc particulièrement utile pour traiter certains confl its notamment en matière de contrat de travail, de licenciement ou de démission. Son grand intérêt pour l’employeur est d’éviter les procédures judiciaires lorsque celui-ci décide de rompre le contrat de travail d’un salarié, pour une raison ou une autre, en souhaitant ainsi éviter un futur litige devant le Conseil des Prud’hommes (réclamation de paiement de primes, d’heures supplémentaires…). Il peut alors proposer de conclure une transaction qui permet de régler les conséquences fi nancières.
CONCLURE UNE TRANSACTION DANS LE DROIT DU TRAVAIL p. 21
LE DROIT DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE p. 21
DOSSIER PRATIQUE : JURIDIQUE
JDP113.indd 21 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 22 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
DOSSIER PRATIQUE : JURIDIQUE 1. Rémunérer une personne dépositaire de
l’autorité publique (élus locaux, policiers, doua-niers, magistrats, huissiers…) pour acquérir des informations : Corruption active - Art. 435-1 et suivants
2. User de son influence en vue d’obtenir d’une autorité une décision favorable : Trafic d’influence (corruption passive) - Art. 432-11 et 433-1
3. Appropriation de données stratégiques d’une entreprise concurrente : Vol - Art. 311-1 et suivants
4. Utilisation de manoeuvres frauduleuses (faux nom, fausse qualité) pour obtenir des ren-seignements : Escroquerie - Art. 313-1
5. User de violence ou de contrainte pour ob-tenir la révélation d’un secret : Extorsion - Art. 226-16 et suivants
6. Obtenir sous la menace la révélation d’un secret : Chantage - Art. 312-10 et suivants
7. Captation, enregistrement ou transmission d’échanges oraux : Violation de la vie privée - Art. 226-1 et suivants
8. Se présenter, notamment sur Internet, sous une fausse identité ou sous une identité usur-pée : Usurpation d’identité - Art. 226-4-1
9. Intercepter ou détourner des correspon-dances et en prendre frauduleusement connais-sance. Réaliser des écoutes illégales : Violation du secret professionnel - Art. 226-15
10. Révélation de données confidentielles dé-tenues à titre professionnel : Violation du secret professionnel - Art. 226-13
11. Délivrer des secrets industriels : Violation des secrets de fabrication - Art. 1227-1
12. Détourner des informations au profit d’un tiers : Abus de confiance - Art. 314-1 et suivants
13. Se livrer au traitement frauduleux d’infor-mations (données personnelles, carte de paie-ment…) : Atteinte aux droits de la personne - Art. 226-16 et suivants
14. Livrer des informations ayant trait aux intérêts de la Nation à une autre nation ou à une entreprise étrangère : Espionnage - Art. 410-1 et suivants
15. Révéler des secrets de nature militaire : Vio-lation du secret de défense - Art. 413-9 et suivants
16. Pénétration frauduleuse dans un système informatique ou introduction de fausses données dans un système informatique : Intrusion infor-matique - Art. 323-1 et suivants
Principales sources utilisées : L’Entreprise - http://fr.wikipedia.org www.easydroit.fr
sant ainsi que chaque type information résulte d’un quadruple classement :
• Libre d’accès + libre d’usage : il s’agit de l’in-formation dite totalement libre (principe open source, contenus gratuits sur l’Internet)
• Libre d’accès + usage restreint : Il s’agit de l’information privative (gratuite ou payante mais avec des droits qui en restreignent l’usage non autorisé (droits d’auteur, droits de propriété intellectuelle et industrielle)
• Accès restreint + libre d’usage : il s’agit de l’information à diffusion limitée (documents in-ternes, scientifiques, documentation technique, en faveur de personnes préalablement identi-fiées)
• Accès restreint + usage restreint : il s’agit de l’information secrète (information classifiée, information confidentielle, secret professionnel, secret médical, donnée nominative)
COMMENT SÉCURISER LES SECRETS D’AFFAIRESSachant que volontairement, ou par inadvertance, 80% de l’information divulguée concernant l’en-treprise provient de l’intérieur même de l’établis-sement, il est recommandé d’utiliser des clauses spéciales aussi bien vis-à-vis des salariés, que des partenaires et associés. Principales dispositions sta-tutaires ou contractuelles pouvant être utilisées :• Pacte extrastatutaire• Clause de confidentialité ou de secret• Clause de non-concurrence• Clause de non-débauchage• Clause pénale• Clause d’assiduité aux négociations• Clause de bonne foi et de loyauté• Clause de résultat et de préemption à l’issue de
la R&D• Clause de cession de droits de propriété intellec-
tuelle• Clause de sollicitation et clause de contrôle (audit)• Clause d’alerte et de prévention de risques• Charte informatique
LES PRATIQUES INTERDITES
En matière de collecte d’informations, le nou-veau Code pénal réprime un certain nombre de pratiques illicites et illégales. Principaux exemples de pratiques d’obtention de renseigne-ments que la loi française n’autorise pas, avec indication de la catégorie juridique et du texte légal dans le Code pénal :
mique). Si de nombreux outils techniques existent (banques de données, publications, logiciels de recherche, documentation publique…), c’est du côté des hommes et des méthodes utilisées que le problème se pose en général. Dans la chasse à l’information, il est clair que l’information est la matière première de l’Intelligence Economique bien qu’il s’agisse le plus souvent d’informations dites «ouvertes». Bien qu’il soit admis qu’environ 90% des sources de renseignement sont libre-ment accessibles, ce n’est toutefois pas parce que l’information est «ouverte» qu’elle est libre de collecte et/ou d’usage. Alors que dans la culture du renseignement «l’information ouverte» signifie qu’elle n’est pas classifiée et que son accès n’est pas interdit, il existe un certain nombre de règles communes à respecter dont notamment les obli-gations préventives suivantes :• Copyright• Droits d’auteur• Propriété industrielle, intellectuelle et littéraire• Clause de confidentialité• Obligation contractuelle• Dispositions de la loi Informatique et Libertés• Concurrence déloyale
LE CAS DE LA COLLECTE D’INFORMATIONS FINANCIÈRES
Toutes les sociétés sont obligées de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce de leur lieu d’exercice sur le fondement des articles L. 232-21 et suivants du Code de commerce. Moyen-nant le paiement d’une redevance forfaitaire pour le déposant (aux alentours de 40€), cette collecte légale de données comptables et financières est ensuite librement accessible à toute personne qui en fait la demande moyennant également le paie-ment d’un montant forfaitaire selon l’importance des informations demandées aux Greffes.
NE PAS CONFONDRE ACCÈS ET USAGE
L’activité d’intelligence économique ne peut donc traiter toutes les informations de la même façon en s’obligeant à adopter des stratégies de recueil et d’exploitation différenciées suivant le statut juridique de chaque type d’information, faute de quoi des sanctions judiciaires peuvent en résulter. Il existe 2 grandes caractéristiques en matière d’information : L’accesssibilité (dis-ponibilité ou non des sources et contenus) ; L’usage qui en est fait (utilisation à des fins per-sonnelles, marchandes, concurrentielles…), fai-
En cela, l’Intelligence Economique s’apparente à la «culture du renseignement» mise en place dans les années 50 et 60 au moment de la guerre froide. C’est l’avis de Bertrand Warusfel, Maître de conférences à l’Université Paris V - René Descartes, pour qui les objectifs de l’IE corres-pondent à la «Nouvelle situation stratégique do-minée par la prééminence du facteur économique sur les autres dimensions de la vie nationale et internationale». Plus généralement, il considère que «L’intelligence économique se développe dans un espace juridique encore mal défini situé entre les activités de renseignement proprement dîtes et le simple travail de documentation et d’infor-mation. Les risques de dérive et de complication juridique ne sont donc pas négligeables, car cette nouvelle pratique de l’information va bouleverser toute une culture nationale du secret et de l’ap-propriation privative du savoir.»
Il est vrai que l’Intelligence économique est concomitante avec les pratiques utilisées dans l’économie de marché. Selon l’avocat Bertrand Warusfel «C’est, en effet, un paradoxe intéressant que de noter que les stratégies juridiques sont des stratégies indirectes particulièrement adaptées à l’évolution libérale des relations économiques. Notons d’ailleurs que face au monde anglo-saxon, qui considère l’usage du droit comme une véri-table arme stratégique au service des intérêts pri-vés, le relatif désarmement juridique des entre-prises et institutions françaises constitue une de nos faiblesses majeures, notamment dans le contexte d’intégration européenne». Il est éga-lement observable que «Plus la loi du marché et de la concurrence progresse, plus le recours au droit sous toute ses formes (contrat, transaction, arbitrage, contentieux) devient le moyen ultime de régulation de la compétition économique. On constate ainsi un développement rapide des dif-férentes branches du «droit économique» (droit de la concurrence, de la consommation, de la pro-priété intellectuelle...) faisant que l’acteur écono-mique le plus efficace devient souvent celui qui dispose - à la fois - d’une connaissance approfon-die de l’environnement juridique et de la capacité de l’utiliser à son profit.»
L’importance de l’informationLa collecte des données, leurs croisements et leur éventuelle utilisation à des fins défensives ou offensives est une évidence quotidienne, que ce soit au niveau de la micro-intelligence éco-nomique (veille concurrentielle pratiquée par l’entreprise sur sa concurrence) ou d’une macro-intelligence économique (analyse géoéconomique de la puissance d’un État ou d’une région écono-
Prochaine parution JdP : 28 mars 2013 - Réservation de vos espaces publicitaires avant le 21 mars - Tél. 05 46 00 09 19
INFORMATIONS JdPJDP Sarl19 avenue Philippsburg - 17410 St-Martin-de-RéN°ISSN 1156-8801 - N° Dépôt légal : 367RCS La Rochelle 397 764 358Tél. 05 46 00 09 19 - Fax. 05 46 00 09 55e-mail : [email protected]
POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN VENDÉE : EDITION MASTERDirectrice de Publication : Nathalie VauchezDirecteur de la Rédaction : Didier ReuterDossiers et revues de presse : Didier ReuterDossier "Les conseillers du chef d'entreprise", rédaction actualités régionales, entreprises qui bougent, Europe : Yves GuérinCENTRE VAL DE LOIRE : ÉDITION FRANCHISÉECouplage publicitaire possible entre les 2 éditions
Régie publicitaire : • Rhéa Marketing19 av. Philippsburg - BP 43 - 17410 St-Martin-de-RéTél. 05 46 00 09 19 - Fax 05 46 00 09 55Mail : [email protected]
Sortie JdP N° 113 : 12 février 2013Cet exemplaire ne peut être vendu que par abonnement.SITE : www.journaldesprofessionnels.fr
TECHNIQUE Conception graphique, photogravure, AlphaStudio La Rochelle : 05 46 45 42 26Imprimerie : Roto ChampagneTirage : 26.000 ex.Crédit photos : Fotolia - DRJdP et Journal des Professionnels sont des marques déposées. Les reproductions d’articles sont autorisées en partie ou en tota-lité, avec la mention JdP et l’indication éventuelle des sources.
ABONNEZ-VOUS AU JDP5 numéros par an !
J'ai abonné mes 20 collaborateurs
pour 140 € !
3 bonnes raisons de vous abonner :Recevoir le journal chez vous ou à votre travail, nominativement et en avant-première;Incorporer vos frais d’abonnement dans vos frais généraux ou de formation ;Soutenir le journal et son indépendance ;
Nombre d’exemplaires souhaités par n° : 1 2 3 41 an (5 parutions) 27 € 38 € 52 € 56 €
2 ans (10 parutions) 45 € 63 € 82 € 88 €
O�res valables pour un point de livraison unique
Ci-joint, mon règlement par chèque à l’ordre du JDP - 19 avenue Philippsburg - 17410 St-Martin-de-Ré
Société ...................................................................................... Nom .................................................................Prénom ........................................................................................
Adresse de livraison .....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................Code postal.............................................Ville ................................................................................................
Téléphone ....................................................................................... E-mail : ...........................................................................................................................................................
N° 113
JDP113.indd 22 06/02/13 17:39

Numéro 113 | Février - Mars 2013 | Page 23 Retrouvez tous les dossiers sur www.journaldesprofessionnels.fr
ABONNEZ-VOUS AU JDP5 numéros par an !
J'ai abonné mes 20 collaborateurs
pour 140 € !
3 bonnes raisons de vous abonner :Recevoir le journal chez vous ou à votre travail, nominativement et en avant-première;Incorporer vos frais d’abonnement dans vos frais généraux ou de formation ;Soutenir le journal et son indépendance ;
Nombre d’exemplaires souhaités par n° : 1 2 3 41 an (5 parutions) 27 € 38 € 52 € 56 €
2 ans (10 parutions) 45 € 63 € 82 € 88 €
O�res valables pour un point de livraison unique
Ci-joint, mon règlement par chèque à l’ordre du JDP - 19 avenue Philippsburg - 17410 St-Martin-de-Ré
Société ...................................................................................... Nom .................................................................Prénom ........................................................................................
Adresse de livraison .....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................Code postal.............................................Ville ................................................................................................
Téléphone ....................................................................................... E-mail : ...........................................................................................................................................................
JDP113.indd 23 07/02/13 08:36

*Epargne investie exclusivement sur le support en euros du contrat Winalto.**3,20%, taux servi en 2012, net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux sur le support en euros du contrat Winalto. 20,87%, rendement cumulé sur le support en euro de Winalto du 01/01/2008 au 31/12/2012, soit un taux annuel moyen de 3,86% net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances à venir. ***Possibilité d’investir l’épargne sur le support en euros ou sur les supports à capital variable de Winalto. Les montants investis sur les supports à capital variable ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. MAAF VIE s’engage sur le nombre d’unités de compte inscrites sur les supports à capital variable, mais pas sur leur valeur.
MA
AF
VIE
- So
ciét
é an
onym
e à
Dir
ecto
ire
et C
onse
il de
sur
veill
ance
, ent
repr
ise
régi
e pa
r le
Code
des
ass
uran
ces
au c
apit
al d
e 65
385
600
eur
os e
ntiè
rem
ent v
ersé
- RC
S N
iort
B 3
37 8
04 8
19 -
Sièg
e so
cial
: Ch
aban
791
80 C
haur
ay
Avec Winalto,votre épargne*est une bêtede concours !
Solidité et performances : 3,20%** net en 2012 et 20,87% sur 5 ans**, des performances qui durent** !
Adaptabilité : un choix varié de supports d’investissement*** pour composer votre épargne en fonction de votre profil, de votre horizon de placement et de votre projet.
Simplicité et rapidité : réalisez toutes vos opérations en ligne.
Confiance : MAAF, un assureur solide et reconnu en épargne depuis 30 ans. Winalto, un produit régulièrement récompensé par la presse spécialisée.
Winalto, une vraie marque de confiance.
EpArgnE - AssurAncE viE
Téléphone
30 15APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
Téléphone Internet
maaf.fr Agence
rendez-vous dans l’agence MAAFla plus proche de chez vous
JDP113.indd 24 06/02/13 17:39