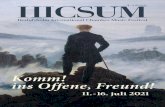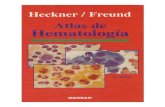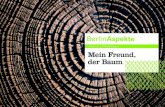Holeindre, FREUND polemologie
-
Upload
martin-pokorny -
Category
Documents
-
view
12 -
download
2
description
Transcript of Holeindre, FREUND polemologie

Julien Freund, la dynamique des conflits
54
Jean-Vincent Holeindre
De la guerre au conflit. Sur l’œuvrepolémologique de Julien Freund
À Jean-Pierre Le Gof, en signe d’amitié.
la guerre a occupé une place centrale pour Julien Freund, dans sa vie d’homme comme dans son œuvre. né en 1921 en Henridorf en Moselle, le jeune Freund a tout juste dix-huit ans lorsque débute la deuxième Guer-re mondiale. la trentaine venue, dans les années cinquante et soixante, il prépare sa thèse en pleine guerre froide, à l’heure où le monde vit dans les conlits idéologiques et la crainte de l’apocalypse nucléaire. Quand Freund meurt en 1993, l’Union soviétique vient d’imploser, ce qui signe la dispa-rition du monde bipolaire. comme beaucoup d’européens de sa généra-tion, Julien Freund a été profondément marqué par les conlits du xxe
siè-cle. Sa relation à la guerre s’est exprimée de plusieurs manières. résistant et militant politique pendant le second conlit mondial, il fut d’abord au cœur de l’événement et de l’histoire en train de se faire. devenu philoso-phe, il prit du recul et s’eforça de comprendre la guerre avec les yeux du penseur politique (notamment dans l’Essence du politique, sa thèse publiée en 19651). nommé professeur à l’Université de Strasbourg, il se consacra enin à l’étude de la guerre dans le cadre plus général d’une Sociologie du conflit, publiée en 19832. nous tâcherons ici de retracer ces trois grandes étapes de l’itinéraire de Julien Freund, qui correspondent chacune à un type d’approche de la guerre : la guerre comme expérience de vie (à travers la deuxième Guerre mondiale et la résistance relatées dans son autobio-graphie intellectuelle, l’Aventure du politique3) ; la guerre comme phéno-mène politique (dans l’Essence du politique) ; enin la guerre comme forme particulière du conflit (dans Sociologie du conflit).� Freund Julien, L’Essence du politique [1965], Paris, dalloz, 2004. � Id., Sociologie du conflit, Paris, Presses universitaires de France, 1983. � Id., L’Aventure du politique. Entretiens avec Charles Blanchet, Paris, criterion, 1991.

55
1. La guerre comme expérience de vie
1.1. Une critique des utopies de la fin de la guerre :Freund dans les pas d’Aron.
la passion de Freund pour la chose politique date de la deuxième Guer-re mondiale. Étudiant en philosophie à l’Université de Strasbourg, alors repliée en zone libre à clermont-Ferrand, le jeune Freund participe à l’ac-tion de la résistance. À l’épreuve des luttes contre l’occupant allemand, Freund acquiert une conviction qui ne le quittera pas : la guerre, et plus généralement le conlit, font partie intégrante de la vie humaine, ils consti-tuent une donnée essentielle de l’histoire universelle ; il est donc utopique et dangereux de prétendre débarrasser les hommes de la guerre par le com-merce (utopie libérale) ou par la suppression des inégalités économiques et sociales (utopie socialiste).
À certains égards, la trajectoire politique et intellectuelle de Julien Freund est comparable à celle de son maître et directeur de thèse raymond aron, qui dénonça l’inconséquence du paciisme face à la montée du péril nazi en allemagne. aron et Freund ne se prononcent pas « pour » ou « contre » le socialisme et le libéralisme, ni même pour ou contre le paciisme. en réa-lité, ils rejettent la part utopique de ces idéologies lorsqu’elles se condam-nent elles-mêmes à l’impuissance politique en préférant rêver à la paix plu-tôt que de regarder en face la réalité de la guerre. certes, Freund est à la fois moins libéral et plus conservateur qu’aron. le premier ne croit pas à l’idée de progrès, et voit dans l’évolution du monde moderne l’expression d’une décadence4. aron, au demeurant très sensible aux illusions et aux « désillusions du progrès5
», ne cessera cependant de croire en lui jusqu’à la in de sa vie6. les deux se rejoignent pourtant pour dénoncer les impasses de l’idéalisme politique lorsque celui-ci consiste à épouser une vision té-léologique de l’histoire, comme si la volonté et la liberté humaine étaient déterminées par une nécessité supérieure. Freund et aron lui préfèrent une forme de réalisme qui se donne pour tâche essentielle de penser l’histoire en train de se faire. la philosophie téléologique de l’histoire vise l’horizon indépassable de la paix perpétuelle, tandis que l’approche compréhensive adoptée par Freund, après Max Weber, cherche à restituer la complexité de l’histoire universelle, partagée entre la guerre et la paix, la concorde et la discorde.
Pour Freund, il n’est question ni de condamner la guerre, ni de la louer. il convient avant tout de mieux la comprendre. de manière générale, Freund pense que la philosophie et la sociologie n’ont pas pour objectif de chan-ger l’homme, mais d’analyser ce qu’il est profondément. c’est en cela qu’il s’inscrit dans la tradition machiavélienne. il s’agit de penser le monde tel � Id., La Décadence. Histoire sociologique et philosophique d’une catégorie de l’expérience humaine, Paris, Sirey, 1984. � aron raymond, Les Désillusions du progrès, Paris, calmann-lévy, 1969. � Id., « Pour le progrès. après la chute des idoles, », Commentaire, automne 1978, vol. 1, n° 3.
de la guerre au conflit

Julien Freund, la dynamique des conflits
56
qu’il est et non tel qu’on aimerait qu’il soit7. il est toujours plus confortable politiquement, dit Freund, de faire comme si le danger n’existait pas. Mais le danger existe – il a pour nom « crise », « conlit », voire « guerre » – et il est constitutif du politique.
�.�. Une conception wébérienne de la sciencePour Freund, l’expérience de la guerre a été celle de la découverte de la
politique et de son caractère irréductiblement conlictuel. Si la guerre a meurtri le citoyen, elle a dessillé les yeux du philosophe et du sociologue : « lorsque j’étais étudiant, la sociologie française me donnait l’impression de s’engourdir dans la bonne conscience de la société. elle entendait par-ticiper à une bonne éducation des groupes sociaux. aussi ses thèmes pré-férés consistaient-ils dans l’étude du droit dans la société, le sacré, la mo-rale, la science des mœurs, les formes élémentaires de la société, bref des thèmes considérés comme positifs parce que leur analyse contribuerait à une réforme de l’homme par la société. au lendemain de la guerre, durant laquelle j’ai été mêlé à des épreuves moins tempérées, depuis l’état d’otage et de résistant jusqu’à deux années de prison et de camp, j’aspirais à une philosophie et à une sociologie moins intellectualisées et plus proche de l’expérience authentique et qui prendraient en compte ce que les bons sen-timents considéraient comme acte ou relations négatives8. » après 1945, Julien Freund forme alors le projet d’écrire une thèse sur le thème « essen-ce et signiication de la politique ». Son but : comprendre l’expérience qu’il vient de vivre avec les moyens de la philosophie politique.
en se consacrant au travail intellectuel, Freund cherche aussi à surmon-ter l’horreur et la déception issues de la guerre. l’horreur d’une part, lors-qu’il assiste impuissant au viol puis au meurtre d’une jeune femme par ses compagnons de résistance : « c’était l’été 1944. J’avais 23 ans. le chef de notre groupe FtP avait comme maîtresse l’institutrice d’un village proche de notre camp, à côté de lurs. cette institutrice, une jolie ille de 23-24 ans, a rompu et notre responsable a voulu se venger en l’accusant d’être passée du côté de la Gestapo. il a fait croire à la plupart des camarades du groupe que la jeune ille était allée à la Gestapo de digne pour le dénoncer. on est allé arrêter cette jeune femme et aussitôt on a institué un ‘‘tribunal du peuple’’ pour la juger avec un procureur et trois juges. alors j’ai deman-dé : ‘‘où est l’avocat ? nous n’allons pas continuer à la manière d’Hitler. il faut un avocat.’’ et j’ai décidé de jouer le rôle de l’avocat. dans ma plai-doirie, j’ai posé une question ‘‘Puisqu’on airme qu’elle était à la Gestapo de digne, comment le savoir si on n’est pas en relation avec la Gestapo de digne ?’’ ce fut terrible. elle était innocente et le tribunal la condamna à mort. il y eut cette nuit d’épouvante où les partisans la violèrent dans une � Machiavel, Le Prince, chap. xv : « Étant mon intention d’écrire choses proitables à ceux qui les entendront, il m’a semblé plus convenable de suivre la vérité efective de la chose que son imagination ». Cf. la postface de taguief Pierre-andré à l’édition 2004 de l’Essence du politique, op. cit., « Julien Freund : penseur du politique », p. 835. � Freund Julien, « Préface » in G. Simmel, Le Conflit, circé, [1re éd. 1990], 2003, p. 7.

57
de la guerre au conflit
grange à foin. et, à l’aube, elle fut exécutée sur une petite montagne ap-pelée Stalingrad. Près du campement, il y avait un ruisseau qui coulait. le matin, pendant que je me lavais le visage, j’ai entendu la fusillade. on avait demandé des volontaires. tous furent volontaires. Je suis le seul à ne pas y être allé. après une telle expérience vous ne pouvez plus porter le même regard sur l’humanité. À partir de là j’ai commencé à réléchir sur cette morale dont on nous parlait, alors que l’on était capable de choses aussi afreuses9. » À l’abomination du crime commis au nom d’une prétendue « justice » succède chez Freund la déception provoquée par l’engagement politique. Secrétaire de section au sein l’Union démocratique et socialiste de la résistance, Freund constate des malversations inancières et d’autres coups bas, qui le conduisent à renoncer à toute activité politique au lende-main de la guerre10.
ces expériences douloureuses sont à l’origine de la vocation universitaire de Julien Freund. chez Freund, la vie imprègne l’œuvre de bout en bout11. dans le discours de soutenance de sa thèse, le jeune docteur explique en efet que sa recherche est « née d’une déception surmontée12
». la joie de l’enquête philosophique est apparue comme un déi à l’amertume provo-quée par l’action politique. Freund adhère à la conception wébérienne du professeur dont la vocation première n’est pas d’enseigner à ses étudiants une doctrine qu’il juge meilleure que les autres, mais de donner du sens à l’afrontement sans in qui opposent ces doctrines. il ne s’agit pas de juger, mais de comprendre ce que Weber nomme le « polythéisme des valeurs », cette « guerre des dieux » qui peut parfois se transformer en guerre réelle, et que seule la politique peut transformer en paix. dans deux conférences traduites par Freund en français sous le titre Le Savant et le politique, We-ber explique que l’homme de science n’a pas vocation à agir sur le monde, mais à enquêter sans in pour saisir la complexité du réel et transmettre ses connaissances à qui veut bien les entendre. de son côté, le politique a vo-cation à agir sur le monde et à gouverner les hommes, en faisant passer son éthique de responsabilité devant son éthique de conviction. tout l’art poli-tique consiste à régler ou à tempérer les conlits par le recours aux moyens adéquats, en tenant compte de la diversité des expériences humaines et des visions du monde qui ne manquent pas de s’afronter.
2. La guerre comme phénomène politique
2.1. La guerre comme moyen politique : une perspective clausewitziennela guerre n’est pas un incident, une anomalie ou un scandale dans l’his-
toire du monde humain. c’est une réalité politique et sociale à interpréter lorsqu’on est théoricien13, et c’est un moyen dont on peut user lorsqu’on est décideur politique. comme le dit clausewitz dans De la guerre « Der � Freund Julien, L’aventure du politique, op. cit., p. 32. �0 Ibid., p. 33. �� Voir todorov tzvetan, La Signature humaine, Paris, Seuil, 2009.�� Freund Julien, L’Aventure du politique, op. cit., p. 44.�� c’est ainsi que se déinit Julien Freund dans L’Aventure du politique, op. cit., pp. 15-20.

Julien Freund, la dynamique des conflits
58
Krieg ist eine blosse Forsetzung der Politik mit anderen Mitteln » (« la guerre n’est rien que la continuation de la politique par d’autres moyens14
»). la guerre est privée de sens si on la considère uniquement comme un duel vi-sant à l’anéantissement de l’ennemi. dans la perspective clausewitzienne, la guerre est un instrument que se donne la politique pour mettre in aux conlits qui n’ont pu être réglés par la diplomatie. Sur ce point, on peut noter là encore la proximité entre Freund et aron, qui voient tous les deux en clausewitz non pas le prophète des guerres totales du xxe
siècle, mais le théoricien de la guerre limitée. Grâce à « l’intelligence de l’État personni-ié », le politique est en mesure de gouverner la guerre : décider l’engage-ment des troupes lorsque toutes les solutions diplomatiques ont échoué ; orienter la stratégie conçue et mise en œuvre par le chef de guerre une fois les hostilités entamées ; mettre in à la guerre en imposant ou en négociant la paix quand les armes ont rendu leur verdict.
Si l’on pousse jusqu’au bout la logique clausewitzienne, le bon politique doit chercher à tout prix à éviter la guerre, sans jamais chercher à la faire disparaître au nom de « valeurs » suprêmes. nul ne sait si la guerre est dans la nature humaine. ce qui est certain en revanche, c’est que les conlits ar-més entre unités politiques appartiennent à l’expérience historique. d’où la dangerosité de l’utopie libérale qui entend substituer le commerce à la guerre : « la guerre est précisément l’un des obstacles qui mettent en ques-tion la validité générale de la pensée libérale15
». le commerce est fondé sur l’échange, et le but du libéralisme est de transformer l’ennemi d’hier en partenaire, ou à la rigueur en concurrent. l’utopie socialiste entend quant à elle déclencher la dernière guerre pour imposer la paix perpétuelle. Pour lénine, la lutte de classes, qui peut passer par la violence révolutionnaire armée, est une étape vers l’établissement d’un nouvel ordre social dans le-quel la paix est produite par la in des inégalités.
Quoi qu’il en soit de ces utopies, la disqualiication de la guerre comme moyen politique est selon Julien Freund dangereuse. Se refuser à faire la guerre, c’est se priver d’un moyen de régler les conlits. Freund reprend à son compte cette phrase de camus : « Je ne dirais point qu’il faut suppri-mer toute violence, ce qui serait souhaitable, mais utopique en efet. Je dis seulement qu’il faut refuser toute légitimation de la violence, que cette légitimation lui vienne d’une raison d’État absolue ou d’une philosophie totalitaire. la violence est à la fois inévitable et injustiiable16. » Freund est opposé aussi bien au paciisme radical qu’aux doctrines de la guerre juste qui se fondent sur des critères moraux, religieux ou juridiques pour justiier l’entrée en guerre. Pour Freund, la guerre n’est pas justiiable moralement, mais elle peut être menée à titre défensif (et non préventif ) pour assurer la survie de l’État en péril. ici Freund se situe dans la tradition hobbesienne �� clausewitz, De la guerre, trad. denise naville, Paris, Minuit, 1955, livre viii, chap. 1. �� Freund Julien, « Guerre et politique de clausewitz à raymond aron », Revue française de sociologie, octobre-décembre 1976, vol. 17, p. 643.�� camus albert, Actuelles I, Gallimard, 1950, p. 184, cité par Freund Julien, Utopie et violence, Paris, Marcel rivière, 1970. p. 125.

59
de la guerre au conflit
et plus encore schmittienne. Pour Schmitt, la disparition de la guerre signi-ierait la in de la politique. l’ordre politique interne se déinit en efet par opposition à l’ennemi extérieur, avec lequel la guerre est toujours possible et parfois inévitable. abolir la guerre, par exemple en la déclarant « hors-la-loi » (comme lors du Pacte Briand-Kellog de 1928), c’est nier la distinction ami/ennemi qui est au fondement du politique.�.�. La guerre et la dialectique ami-ennemi.
Pour Freund, guerre et paix sont deux concepts indissociables, et la paix n’est concevable qu’à partir de la guerre. on signe la paix avec l’ennemi contre lequel on a fait la guerre, non pas avec celui qui est déjà un ami. la paix n’est pas un état permanent ou un impératif moral, mais l’issue po-litique du conlit armé. la paix politique « consiste à la fois dans la paix intérieure ou civile entre les groupes subordonnés à l’intérieur d’un État et dans la paix internationale entre les États17
». dans cette remarque de Freund, on retrouve d’une part l’idée que l’État est un artiice politique et juridique destiné à paciier la communauté politique en s’imposant comme une autorité souveraine, et d’autre part l’idée propre à la tradition réaliste selon laquelle les États se reconnaissent mutuellement dans la paix et dans la guerre dans la mesure où il n’existe aucune instance supérieure capable de paciier le système international. ce dernier reste donc « anarchique » ; il n’existe pas de société internationale gouvernée par un pouvoir politique reconnu comme tel par les diférents États. d’où l’importance du concept d’ennemi et du processus de reconnaissance qui caractérise la guerre en particulier et les relations internationales en général. reconnaître son en-nemi, c’est pour un État se donner les moyens de sa survie. À l’inverse, « se tromper sur son ennemi par étourderie idéologique, par peur ou par refus de le reconnaître à cause de la langueur de l’opinion publique c’est, pour un État, s’exposer à voir son existence mise tôt ou tard en péril. Un ennemi non reconnu est toujours plus dangereux qu’un ennemi reconnu. il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas le reconnaître ouvertement à condition que l’on prenne les mesures indispensables pour parer la menace18 ».
Reconnaître l’ennemi, c’est donc un moyen de ixer à la guerre des bornes politiques et d’envisager avec lui la possibilité d’un accord de paix une fois la guerre terminée. En revanche, « dès qu’on cherche à nier l’ennemi politi-que du point de vue du moralisme juridique, on le transforme immanquable-ment en un coupable. […] Politiquement il n’existe pas d’ennemi absolu ou total que l’on pourrait exterminer collectivement parce qu’il serait intrinsè-quement coupable��. » Considérer l’ennemi comme un ennemi public (hos-tis), c’est en efet lui reconnaître une légitimité politique et militaire en tant que soldat servant la cause d’une nation, et ainsi le diférencier du coupable qui vient de commettre un crime et ne sert que sa propre cause : « Tant que l’élément politique reste prédominant, l’ennemi garde en général sa grandeur �� Freund Julien, « l’ennemi dans la guerre et dans la paix », dans Politique et impolitique, Paris, Sirey, 1987, p. 152. �� Freund Julien, L’Essence du politique, op. cit., pp. 496-497. �� Ibid., pp. 497-498.

Julien Freund, la dynamique des conflits
60
d’homme parce qu’il est reconnu. […] Quand le motif religieux est prédo-minant – guerre sainte, croisade, guerre de religion – l’ennemi est dégradé en être infâme, infernal et impie : l’incarnation du diable ou du mal. Quand une idéologie raciste prend le dessus, il devient un esclave par nature. Quand une idéologie morale et humanitaire est souveraine, il devient un être intrin-sèquement coupable, de sorte que l’on rend un service à l’humanité en le fai-sant disparaître. Dans tous les cas on se donne le droit de l’exterminer comme un malfaiteur, un criminel, un pervers ou un être indigne. C’est que toutes ces sortes d’idéologies comportent un élément étranger au politique : l’air-mation de la supériorité intrinsèque, arbitraire et combien dangereuse d’une catégorie d’hommes sur les autres, au nom de la race, de la classe ou de la religion. Le politique par contre ne reconnaît que la supériorité de la puis-sance�0. » Pour Freund, la guerre n’a pas vocation à la conquête idéologique, mais à la défense du territoire. Il n’y a pas de guerre juste, il n’y a que des guer-res justiiées politiquement au nom de l’intérêt national. Lorsque l’ennemi politique est assimilé à un criminel, aucune paix avec lui n’est par déinition possible. Criminaliser l’ennemi aux yeux de Freund, c’est non seulement nier sa qualité militaire de combattant, mais c’est aussi nier l’une des tâches essen-tielles de la politique qui consiste à régler les conlits et à négocier la paix par les voies diplomatiques.
3. La guerre, un conlit parmi d’autres ?
�.�. La guerre, vérité de la politique ?Dans son approche du politique, Julien Freund n’exclut pas le droit, l’amitié
ou même le bien commun – il fait de ce dernier le « but spéciique du poli-tique »��. Mais lorsqu’il s’interroge sur l’essence du politique, Freund revient toujours à cette idée que le politique naît du conlit. Le risque d’une telle approche, c’est de réduire la politique à la lutte et le monde social au conlit, « la paix n’étant inalement qu’un état exceptionnel de la société�� ». Sur ce point, l’œuvre de Freund reste tributaire du système conceptuel de Carl Sch-mitt, auquel il emprunte la distinction de l’ami et l’ennemi comme critère fondamental du politique.
Dans une lettre adressée le �er octobre ���� à Carl Schmitt au sujet de La Notion de politique qu’il vient de faire traduire en français (précédé d’une pré-face de Julien Freund), Raymond Aron formule à Carl Schmitt une critique qui pourrait tout aussi bien s’adresser à Julien Freund : « De l’opposition en-tre l’ami et l’ennemi on ne peut pas déduire l’objectif spéciique de la politi-que. […] Le politique désigne moins un domaine spéciique que le degré d’in-tensité de l’association et de la dissociation entre les hommes. Mais, du même coup, la question se pose de savoir quelles associations d’hommes méritent d’être dites politiques. Il me semble que beaucoup des malentendus suscités par votre livre tiennent à l’oscillation entre la notion de critère et celle d’es-�0 Ibid., pp. 498-499. �� Freund Julien., L’Essence du politique, op. cit., chap. ix, pp. 650-703. �� Id., Sociologie du conflit, op. cit, p. 50.

61
de la guerre au conflit
sence. L’antithèse ami-ennemi est seulement un critère��. » Dans la dernière partie de la citation, Aron souligne bien que l’antithèse ami/ennemi est per-tinente pour penser le politique à condition de le considérer comme un élé-ment de déinition parmi d’autres. Fonder le politique uniquement à partir du conlit, ce serait non seulement appauvrir la complexité de l’âme humaine, mais ce serait aussi identiier le politique à une lutte sans in pour le pouvoir. La guerre étant le plus extrême et le plus caractéristique de tous les conlits politiques, celle-ci serait dès lors considérée comme la vérité, ou le moment de vérité, de toute politique. La formule de Clausewitz (« la guerre comme continuation de la politique ») serait ainsi renversée ; la guerre ne serait plus le prolongement de la politique, mais sa nature même.
Rappelons cependant que, pour Freund, l’essence du politique ne se ramène pas à un, mais à trois « présupposés » qui sont autant de distinctions fonda-trices : la distinction privé/public ; la distinction commandement/obéissan-ce et enin la distinction ami-ennemi��. Freund ne tombe donc pas complè-tement sous le coup de la critique d’Aron. La théorie de Freund n’est pas identique à celle de Schmitt dans la mesure où on y trouve plusieurs éléments de déinition du politique : la déinition « libérale » (privé/public), la déi-nition « conservatrice » (commandement/obéissance) et enin la déinition « anthropologique » (ami/ennemi). Toutefois, le troisième élément de déi-nition, que Freund emprunte à Schmitt, ne se situe pas sur le même plan que les deux premiers. Il est à la racine de la théorie freundienne du politique et à certains égards, il englobe les deux autres. Chez Freund comme chez Schmitt, le présupposé anthropologique du conlit engage une vision de l’homme et ce faisant de la politique. Certes, Freund reconnaît en se référant à Aristote que « la société consiste en un jeu perpétuel d’harmonies et de discordes�� ». Mais pour Freund l’harmonie est un état exceptionnel, alors que la discorde (à diférentes échelles, dont la guerre) est la situation normale. Freund parle en tout cas d’une « permanence des conlits » qui justiie que les sociétés se donnent des « règles et des procédures de conciliation�� ». Inspiré par l’an-thropologie de Machiavel, Freund voit le conlit comme le fait générateur du social. Mais en retour, cela le conduit à réairmer, dans une perspective aris-totélicienne, le rôle de la prudence en politique. Le gouvernant prudent est précisément celui qui parvient à faire en sorte non pas que les conlits dispa-raissent, mais qu’ils ne détruisent pas l’ordre politique et social��.�.�. Penser les conlits actuels avec Julien Freund.
Fort des résultats de ses premiers travaux en philosophie politique, Freund se consacre, dans la deuxième partie de sa vie intellectuelle, au projet d’une sociologie des conlits. Son but est de forger une polémologie qui n’étudie pas seulement la guerre et la paix, mais l’ensemble des conlits qui traversent les sociétés : « J’entends par polémologie non point la science de la guerre et de �� archives personnelles de raymond aron, Bibliothèque nationale de France.�� nous remercions Philippe raynaud de ces éclaircissements sur ce point. �� Freund Julien, Sociologie du conflit, op. cit., p. 50. �� Ibid., p. 51. �� Voir sur ce point la contribution de delannoi Gil à ce volume.

Julien Freund, la dynamique des conflits
62
la paix mais la science générale du conlit au sens du polémos héraclitéen��. » Dans cette déinition de la polémologie, on retrouve l’idée du conlit comme constante historique, mais également l’idée de la fécondité du conlit pour le monde social. Sur ce dernier point, Freund s’inspire de Georg Simmel pour qui le conlit ne doit pas être considéré comme un élément nuisible dont il faudrait purger la société, mais au contraire comme une source de dynamis-me dans les rapports sociaux��. Le conlit peut contribuer à la vitalité du so-cial, et par exemple faciliter la socialisation.
Le problème majeur posé par une telle approche est le suivant : peut-on étu-dier au sein d’une même science des conlits aussi diférents que les conlits ar-més, les conlits sociaux ou encore les conlits d’héritage ? La guerre est assu-rément une forme de conlit, mais en la considérant comme un conlit parmi d’autres, ne risque-t-on pas de dissoudre sa spéciicité politique sur laquelle insiste tant Freund ? Plusieurs arguments plaident en faveur d’une polémolo-gie élargie, à commencer par les transformations de la guerre elle-même. Pour caractériser le contexte stratégique contemporain, les chercheurs tendent de plus en plus à employer la notion de « conlit » ou encore de « violence » pour désigner des situations conlictuelles confuses, qui n’entrent pas dans le cadre politique et juridique de la guerre classique, c’est-à-dire la guerre interé-tatique�0. Les distinctions classiques, entre l’interne et l’externe, entre le civil et le militaire, tendent à se brouiller au point qu’on en vient à considérer à la violence armée dans le cadre plus général de « systèmes de conlits ». Pour comprendre les ressorts profonds d’un conlit dans une région donnée, il est nécessaire d’étendre l’analyse à l’ensemble des conlits qui touchent la région en question. Il importe également d’intégrer toute une série de paramètres politiques, économiques et socioculturels et de considérer la diversité des ac-teurs de la zone concernée, non seulement l’État, mais aussi les réseaux lo-caux��. Par exemple, pour comprendre le conlit afghan, il est diicile de faire l’impasse sur la situation du Pakistan et de l’Iran. De même, il faut prendre en compte les spéciicités locales du système taliban des tribus, fondé sur la diplomatie de la choura (« concertation »), une économie de subsistance et un fonctionnement clanique, assez diférent de ce que nous connaissons en Europe. Si enin on examine la relation conlictuelle elle-même, on s’aperçoit que le conlit afghan n’oppose pas des ennemis qui se reconnaissent mutuel-lement dans la guerre. Il n’oppose pas davantage l’État afghan à la coalition occidentale envoyée au lendemain du �� septembre. Il oppose des armées �� Freund Julien, Sociologie du conflit, op. cit., p. 52. Voir aussi « observations sur deux catégories de la dynamique polémogène. de la crise au conlit », Communications, n° 25, 1976, p. 112. �� Simmel Georg, Le Conflit, op. cit. �0 Voir notamment Gros Frédéric, États de violence. Essai sur la fin de la guerre, Paris, Gal-limard, 2006. �� ce type d’approche permet notamment de saisir les liens qui unissent les nombreux conlits en afrique, comme le montre Gnanguênon amandine dans sa thèse récemment soutenue sous la direction de charillon Frédéric. Gnanguênon amandine, Étude de la ré-gionalisation en Afrique : les organisations régionales, de nouveaux acteurs dans la gestion des conflits ?, hèse de doctorat en science politique, Université de clermont-Ferrand, 2010.

63
de la guerre au conflit
projetées en opération extérieure à des groupes insurgés relativement hétéro-gènes, qui ne sont pas à la tête des institutions politiques afghanes, mais qui exercent un vrai pouvoir local dans les zones où ils sont implantés.
Le conlit afghan ne ressemble donc pas aux guerres telles que Freund les décrit dans L’Essence du politique, fondées sur la reconnaissance mutuelle de l’ennemi. Il y a certes un ennemi, mais il est très diicile pour des raisons à la fois politiques et stratégiques de le reconnaître comme tel. Dans le même temps, l’approche polémologique esquissée dans Sociologie du conlit est fé-conde, car elle nous incite à ne pas considérer la guerre indépendamment de la société conlictuelle dans laquelle elle s’inscrit. En ce sens, l’œuvre po-lémologique de Freund ne fait qu’annoncer une tendance des études straté-giques contemporaines, qui consiste à partir des dynamiques sociales pour prendre acte de la polymorphie des violences armées��. Néanmoins, parler de « conlit », d’« intervention », voire d’« opérations de paix » pour ca-ractériser l’action des armées d’aujourd’hui, n’est-ce pas une façon de ne pas nommer la guerre, d’« euphémiser » la violence��, et donc de refuser de re-connaître l’ennemi là où il se trouve ? Certes, le conlit afghan n’est pas une guerre interétatique au sens classique du terme, mais il possède plusieurs ca-ractéristiques des « petites guerres », lesquelles font partie intégrante de la tradition militaire depuis l’Antiquité. Ce qu’on observe depuis la in de la Deuxième Guerre mondiale, c’est le renouveau la guérilla et des guerres irré-gulières, dont le terrorisme est à la fois une variante et une technique particu-lière��. En ce sens, ces conlits, aussi singuliers soient-ils, relèvent de la guerre au sens stratégique ; les guerres de notre temps, qui opposent des ennemis qui ne se reconnaissent pas ouvertement, demeurent résolument politiques. N’oublions pas que Clausewitz prévoyait après son monumental traité sur la « grande guerre » de consacrer un volume entier à la théorie de la « pe-tite guerre », qu’il considérait comme une forme de guerre à part entière. De ce point de vue, considérer l’ennemi en Irak ou en Afghanistan comme un « terroriste » et non comme un guerrier à part entière, n’est-ce pas refu-ser de le reconnaître comme un ennemi et du même coup le criminaliser ? Cependant, comment peut-on reconnaître un ennemi sans uniforme, qui se dérobe au combat et qui de son côté ne reconnaît aucune légitimité poli-tique à son adversaire « occidental » ? Est-il même concevable d’imaginer une paix entre des ennemis que tout oppose politiquement, stratégiquement, voire moralement ? L’œuvre de Julien Freund n’apporte pas de réponses à ces questions diiciles, mais elle a au moins le mérite de poser les problèmes po-litiques et stratégiques essentiels.
Nous avons évoqué dans cette contribution trois visages de Julien Freund : le résistant, le philosophe politique et enin le sociologue des conlits. Nous �� Voir notamment Hassner Pierre, Marchal roland, Guerres et sociétés. États et violences après la guerre froide, Paris, Karthala, 2003. �� nous empruntons cette expression à Stéphane audoin-rouzeau. Voir audoin-rouzeau Stéphane, Combattre. Une anthropologie historique de la guerre moderne (XIXe-XXIe siècle), Paris, Seuil, 2008. �� chaliand Gérard., Les Guerres irrégulières. XXe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2008.

Julien Freund, la dynamique des conflits
64
avons vu comment Freund s’est inspiré de la tradition philosophique (Ma-chiavel, Hobbes, Schmitt) et sociologique (Weber, Simmel) pour penser la guerre dans une perspective politique et le conlit avec un regard sociologi-que. Évoquer les sources d’inspiration de Freund et son itinéraire intellec-tuel, c’est une façon de rappeler que ce dernier fut pour plusieurs généra-tions un grand professeur, un éducateur et un « éclaireur » (Pierre-André Taguief ), qui a fait vivre et revivre des auteurs souvent négligés par la pen-sée française. Freund a également contribué, par son œuvre polémologique, à faire de la guerre un objet digne d’intérêt pour les sciences humaines et so-ciales, avec d’autres éclaireurs comme Raymond Aron, Léo Hamon et Alexis Philonenko. Par sa collaboration avec Gaston Bouthoul, fondateur de l’Ins-titut de polémologie, Julien Freund a élaboré une méthode d’analyse pour étudier la guerre, fondée aussi bien sur le questionnement philosophique que sur l’enquête sociologique. En nouant le dialogue entre philosophie et scien-ces sociales, Freund et Bouthoul ont été les précurseurs d’un mouvement qui s’est épanoui dans le monde anglo-américain à travers les « War Studies », et qui, par un efet de balancier, redevient vivant en France aujourd’hui. Cer-tes, Freund avait pour ambition première d’être un « théoricien »��. Il n’a pas mené d’enquête sociologique sur des guerres en particulier. Toutefois, il a montré que la philosophie politique pouvait nous aider à comprendre les guerres d’hier et d’aujourd’hui ; et il a donné aux sociologues, aux anthropo-logues et aux politistes des outils pour décrire et interpréter les conlits ac-tuels. Pour toutes ces raisons, Julien Freund a fait œuvre utile.
�� Freund Julien, L’Aventure du politique, op. cit., pp. 15-17.