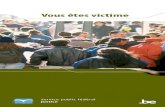GUIDE PRATIQUE ENTENDRE ET ACCOMPAGNER L’ENFANT VICTIME DE ... · Observation générale no 12...
Transcript of GUIDE PRATIQUE ENTENDRE ET ACCOMPAGNER L’ENFANT VICTIME DE ... · Observation générale no 12...
-
ENTENDRE ET ACCOMPAGNER LENFANT VICTIME DE VIOLENCES
G U I D E P R A T I Q U E
-
ENTENDRE ET ACCOMPAGNER LENFANT VICTIME DE VIOLENCES
G U I D E P R A T I Q U E
-
NOTER
Le rgime pnal de la trs grande majorit des pays francophones sinspire du droit continental , rgime qui distingue les parties civiles et le ministre public (le Parquet). En revanche, le systme de common law est diffrent cet gard puisque la reprsentation des victimes ny est pas assure de la mme manire. Certaines parties du guide ny seront donc pas directement applicables. Toutefois, celles qui portent sur les mthodes dcoute et dentretien des mineurs sont dapplication gnrale.
Produit par la Direction de la paix, de la dmocratie et des droits de lHommeDirecteur : Christophe GUILHOUSous-directeur (a.i.) : Michel CARRI Spcialiste de programme : Delphine COUVEINHES MATSUMOTO
Avec une mention particulire Madame Claire BRISSET, consultante, qui a mis sa prcieuse expertise au service de lOrganisation internationale de la Francophonie afin dassurer la production de ce guide.
Avec lappui de la Direction de la communication et du partenariatCharge des publications : Nathalie ROSTINI
Conception graphique et ralisation : Aneta VUILLAUMERvision : Rjane CROUZETPhotographe : Mari SHIMMURA OIFLes enfants, ici photographis, se sont prts librement cette prise de vue avec lautorisation de leurs parents.
Avec laide prcieuse du Rseau international francophone de formation policire (Francopol) et la collaboration de : lAssociation africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF), lAssociation francophone des commissions nationales des droits de lHomme (AFCNDH), lAssociation des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage lusage du franais (AHJUCAF), lAssociation internationale des procureurs et poursuivants francophones (AIPPF), lAssociation des ombudsmans et mdiateurs de la Francophonie (AOMF), la Confrence internationale des barreaux de tradition juridique commune (CIB), le Groupe de travail francophone sur les droits de lenfant.
Avec le concours de : Yao AGBETSE, Pascale ALLISSE, Rachid AMOR, Alessandra AULA, Genevive AVENARD, Naima BADAZ, Ghizlane BENJELLOUN, Hicham BENYAICH, Philippe BONGARD, Vronique BOULAY, Batrice BOURON, Michel CARMANS, Gilles CHARBONNIER, Julie COURVOISIER, Sarah DENNENE, Pierre Alain DARD, Fulbert DIOH, Mame Ngor DIOUF, Philippe DROZ, Souad ETTAOUSSI, Cynthia FAMENONTSOA, Fatima HADDADI, Franois GINGRAS, Khalid HANEFIOUI, Maria LOCHER, Sharona MAUREE, Najat MAALLA MJID, Marco MOMBELLI, Christian Ndanga DOGOUA, Clmence NIEDERCORN, Ouintar OUEDRAOGO, Mona PAR, Lamia RAJJI, Amina RMISSI, Christian ROHAUT, Saadia SERGHINI, Rita SODJIEDO-HOUTON, Franois TOURET DE COUCY, Philippe TREMBLAY, Benot VAN KEIRSBILCK, Christian WHALEN, Chantal ZARLOWSKI.
Imprim en France par STIPA Organisation internationale de la Francophonie, Paris, dcembre 2015. Tous droits rservs. ISBN : 978-92-9028-418-5
-
AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PRFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LES TEXTES ET LES PRINCIPES DE RFRENCE UNIVERSELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
La Convention relative aux droits de lenfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Les Observations gnrales du Comit des droits de lenfant des Nations unies . . . . . . . . . . . . . . . 13
Observation gnrale no 13 (2011) sur le droit de lenfant dtre protg de toutes formes de violences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Observation gnrale no 8 (2006) sur le droit de lenfant une protection contre les chtiments corporels et les autres formes cruelles ou dgradantes de chtiments . . . . . . . . . . 15
Observation gnrale no 12 (2009) sur le droit de lenfant dtre entendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Les Lignes directrices en matire de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tmoins dactes criminels (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Les Lignes directrices relatives la protection de remplacement pour les enfants (2009) . . . . 18
LENFANT ET LES VIOLENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Les tapes du dveloppement de lenfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Avant la naissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
la naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
De 0 3 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
De 3 6 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
De 6 12 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
De 12 18 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Les violences contre les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Typologie des violences contre les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Limpact de la violence sur les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Les auteurs des violences sur les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Les membres de la famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Les adultes en position dautorit (hors du milieu familial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Les rencontres de hasard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Les autres enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Qui protge les enfants ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SOMMAIRE
-
4
LTABLISSEMENT DES FAITS ET LA PRISE EN CHARGE DE LENFANT . . . . . . . . . . . . 39
La pnalisation des violences contre les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Le signalement dun enfant victime de violences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Quest-ce que le signalement ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Qui procde au signalement ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Par quels moyens ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Auprs de qui signaler ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lentretien de lenfant par le/la policier(re) ou le/la gendarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Laudition de lenfant : finalits, conceptions, mthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lexpertise mdico-lgale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
La protection et laccompagnement de lenfant pendant le temps de lenqute . . . . . . . . . . . . . . . . 58
La protection de lenfant pendant lenqute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Laccompagnement de lenfant pendant lenqute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
LENFANT FACE AU PROCS DE SES PRSUMS AGRESSEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Le droulement du procs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Linformation et la prparation de lenfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Laudition de lenfant par la cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
La reprsentation et/ou laccompagnement de lenfant pendant le procs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Les cas particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Lenfant lissue du procs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Linformation de lenfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Laccompagnement de lenfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
La rparation du prjudice, les dommages-intrts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
RECOMMANDATIONS, CONCLUSION ET ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Fiche de premier entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Fiche de signalement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Fiche de suivi judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Fiche de premire synthse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Fiche de synthse finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Bibliographie slective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
-
5
AVANT-PROPOS
Michalle JEANSecrtaire gnrale de la Francophonie
Trop souvent les enfants victimes de violences gardent le secret et ne reoivent aucune assistance. Ceux qui parlent et dnoncent ces gestes sont si rares quon oublie parfois que ces violences peuvent marquer lenfant jamais dans sa mmoire et dans son corps. Cest pourquoi un enfant qui ose parler doit tre entendu dans les meilleures conditions et dans le respect de ses droits.
Lexprience prouve que la mconnaissance de certains principes dans lcoute quon accorde un enfant victime de violences peut altrer du-rablement sa capacit se (re)construire. Il est donc indispensable que des prcautions soient prises et que les professionnels qui interviennent auprs de ces enfants soient forms et puissent sadapter au dveloppement de ces derniers, leur maturit et leur sensibilit.
La ncessit de bien former ces professionnels est rgulirement voque par le Comit des droits de lenfant des Nations unies. En effet, il est indispensable de sensibiliser et de former les policiers, les juges et dautres acteurs aux droits de lenfant et ses spcificits. Cest dans cette optique que lOrganisation interna-tionale de la Francophonie travaille depuis plu-
sieurs annes avec les acteurs institutionnels en participant la formation des profession-nels et en assurant la promotion des droits de lenfant dans lespace francophone.
Llaboration de ce guide sinscrit pleinement dans les actions que mne la Francophonie pour mobiliser, accompagner et convaincre les adultes concerns quant au besoin de protger les enfants victimes de violences.
Ce guide se veut avant tout un outil et un ins-trument de diffusion des bonnes pratiques. En effet, plutt que de mettre en avant des rgles devant tre appliques strictement en toute situation, ce guide est un recueil de pratiques positives lintention de lenfant et des profes-sionnels qui lui viennent en aide. Il a lavantage de runir lexprience dacteurs diffrents et de prendre en compte la diversit des situations de lespace francophone. Il permettra aux pro-fessionnels de disposer dinformations fiables et adaptes, ncessaires la protection effec-tive de lenfant.
Protger les plus jeunes dentre nous, cest protger notre plus grande richesse, nos enfants, notre avenir.
-
7
PRFACE
Ce guide pratique Entendre et accompagner lenfant victime de violences vise partager les pratiques positives constates en matire dcoute, dentretien avec un enfant victime de violences. Les techniques dentretien et daccompagnement de lenfant victime de violences sont, en effet, spcifiques, peu connues et insuffisamment partages. Le prsent guide entend donc rpondre cette lacune en rassemblant ces pratiques et en promouvant leur diffusion. Cest un outil de base qui pourra tre complt par dautres documents plus spcialiss. Il sinscrit dans la continuit des trois guides dj labors par lOrganisation internationale de la Francophonie (OIF) : Guide pratique sur lexamen priodique universel, Guide pratique sur les processus de transition, justice, vrit et rconciliation dans lespace francophone, Guide pratique pour la consolidation de ltat civil, des listes lectorales et la protection des donnes personnelles.
Ce guide sadresse prioritairement aux per-sonnels de la police et de la justice. Mais il est plus largement destin tous les profession-nels susceptibles de prendre en charge des enfants victimes de violences, et de prendre ou faire prendre des dcisions dans leur intrt.
Aprs avoir rappel les textes internationaux et les principes relatifs aux droits de lenfant, lou-vrage identifie et expose les difficults rencon-tres par les professionnels lors de leur entre-tien avec un enfant victime de violences. Pour
ce faire, il liste les types de violences que peut subir lenfant et leur impact sur son dvelop-pement, les profils des auteurs des violences, ainsi que les personnes pouvant assurer leur protection.
Lentretien avec un enfant ayant gnralement lieu, dans un premier temps, lors de ltablis-sement des faits et de lenqute, et, dans un second temps, pendant le procs, le guide dis-tingue ces deux moments en partageant cer-taines rflexions sur les pratiques constates et en les illustrant laide dexemples concrets.
Dune manire gnrale, les informations et les conseils contenus dans cet ouvrage ont vocation tre adapts au contexte de diff-rents pays. En outre, la mise en uvre de ces pratiques et mthodes ne ncessite pas de moyens financiers particuliers. Cest important car, lorsquil est question dadapter le fonc-tionnement de la justice aux enfants, largu-ment de linsuffisance de moyens financiers est souvent invoqu. Louvrage montre, par exemple, que la seule amlioration de cer-taines pratiques et attitudes lors de lentre-tien avec lenfant suffit obtenir des rsultats significatifs dans la collecte de preuves dans le cadre dune procdure pnale contre le prsum auteur de violences exerces contre lenfant entendu.
Le guide insiste galement sur lintrt dadop-ter une approche pluridisciplinaire. Elle est au cur de notre rflexion et a t rendue possible
-
grce au concours dexperts de diverses dis-ciplines, issus de plusieurs pays francophones. Cette approche pluridisciplinaire permet dap-prhender au mieux la ralit des besoins de ces professions pour lentretien avec un enfant victime de violences. Cet ouvrage est le fruit de la collaboration dexperts du Groupe de travail francophone sur les droits de lenfant, dsigns par plusieurs rseaux institutionnels de la Fran-cophonie lAssociation africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF), lAssociation francophone des commissions nationales des droits de lHomme (AFCNDH), lAssociation in-ternationale des procureurs et poursuivants fran-cophones (AIPPF), lAssociation des hautes juri-dictions de cassation des pays ayant en partage lusage du franais (AHJUCAF), lAssociation des ombudsmans et des mdiateurs de la Fran-cophonie (AOMF), la Confrence internationale
des barreaux de tradition juridique commune (CIB), le Rseau international francophone de formation policire (Francopol) et des organi-sations non gouvernementales Bureau inter-national catholique de lenfance, Dfense des enfants international, Bureau international des droits des enfants , que je tiens remercier pour leur prcieuse contribution.
Enfin, ce guide naurait jamais pu voir le jour sans le soutien et lengagement de Martine Anstett, sous-directrice la Direction de la paix, de la dmocratie et des droits de lHomme de lOIF, dcde au cours de lanne 2015, qui jaimerais rendre hommage ici. Mes remercie-ments vont galement Mme Claire Brisset, ancienne dfenseure des enfants (France), qui nous a appuys dans ce travail en tant que consultante externe.
Christophe GUILHOUDirecteur
Direction de la paix, de la dmocratie et des droits de lHomme
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
9
LES TEXTES ET LES PRINCIPES DE RFRENCE UNIVERSELS
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
11
LES TEXTES ET LES PRINCIPES DE RFRENCE UNIVERSELS
Les textes prohibant la violence contre les enfants sont de nature et de porte diffrentes : les uns font partie intgrante du droit international, en particulier la Convention relative aux droits de lenfant1, dautres sont de porte rgionale, tels que la Convention europenne de sauve-garde des droits de lHomme2 ou la Charte africaine des droits et du bien-tre de lenfant3. Dans un souci de concision, les textes trs spcialiss ou de porte rgionale ne seront pas analyss dans le prsent ouvrage.
Le droit national de tous les pays comporte galement des dispositions relatives la violence contre les enfants qui reprennent et compltent le droit international et rgional.
Il sera fait mention ici essentiellement des textes internationaux liant lensemble des pays fran-cophones : tous ont, en effet, ratifi la Convention relative aux droits de lenfant, parfois appele Convention de New York. Plusieurs commentaires apports ce trait par le Comit des droits de lenfant de lOrganisation des Nations unies (ONU) depuis son entre en vigueur (1990) seront galement mentionns dans la mesure o ils traitent du thme de ce guide.
La Convention relative aux droits de lenfantLa Convention des Nations unies relative aux droits de lenfant4 (CDE) qui dfinit comme enfant tout tre humain g de moins de 18 ans a t ratifie par tous les pays du monde sauf un (les tats-Unis). Lun de ses principes directeurs tient ce que chaque enfant doit tre protg de toutes formes de violences. Ds son prambule, il prcise que lenfant () doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, damour et de comprhension .
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE SUR LES VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS
Articles Dispositions
Article 12, 1-2Droit la participation et lexpression
Les tats parties garantissent lenfant qui est capable de discernement le droit dexprimer son opinion sur toute question lintressant, les opinions de lenfant tant dment prises en considration eu gard son ge et son degr de maturit.
cette fin, on donnera notamment lenfant la possibilit dtre entendu dans toute procdure judiciaire ou administrative lintressant, soit directement, soit par lintermdiaire dun reprsentant ou dun organisme appropri, de faon compatible avec les rgles de procdure de la lgislation nationale.
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
12
Article 16, 1Vie prive
Nul enfant ne fera lobjet dimmixtions arbitraires ou illgales dans sa vie prive, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni datteintes illgales son honneur et sa rputation.
Article 19, 1-2Protection contre la violence
Les tats parties prennent toutes les mesures lgislatives, administratives, sociales et ducatives appropries pour protger lenfant contre toutes formes de violences, datteintes ou de brutalits physiques ou mentales, dabandon ou de ngligence, de mauvais traitement ou dexploitation, y compris la violence sexuelle ().
Ces mesures de protection comprendront () des procdures efficaces pour ltablissement de programmes sociaux visant fournir lappui ncessaire lenfant et ceux qui il est confi. Elles comprendront galement, selon quil conviendra, des procdures dintervention judiciaire .
Article 28, 2Discipline scolaire
Les tats parties prennent toutes les mesures appropries pour veiller ce que la discipline scolaire soit applique dune manire compatible avec la dignit de lenfant ().
Article 32, 1Protection contre lexploitation au travail
Les tats parties reconnaissent le droit de lenfant dtre protg contre lexploitation conomique et de ntre astreint aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son ducation ou de nuire son dveloppement physique, mental, spirituel, moral ou social.
Article 34Protection contre lexploitation sexuelle
Les tats parties sengagent protger lenfant contre toutes les formes dexploitation sexuelle et de violence sexuelle (). cette fin, ils prennent toute mesure pour empcher a) Que des enfants ne soient incits ou contraints se livrer une activit sexuelle illgale ; b) Que des enfants ne soient exploits des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illgales ; c) Que des enfants ne soient exploits aux fins de spectacles ou de matriel de caractre pornographique.
Article 35Enlvement, vente, trafic
Les tats parties prennent toutes les mesures appropries pour empcher lenlvement, la vente ou la traite denfants quelque fin que ce soit ().
Article 37Traitement inhumain ou dgradant ; privation de libert
Les tats parties veillent ce que a) Nul enfant ne soit soumis la torture ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants ni la peine capitale ni lemprisonnement vie (), b) Nul enfant ne soit priv de libert de faon illgale ou arbitraire (), c) Tout enfant priv de libert soit trait avec humanit et avec le respect d la dignit de la personne humaine (). En particulier tout enfant priv de libert sera spar des adultes ().
Article 39Radaptation et rinsertion sociale
Les tats parties prennent toutes les mesures appropries pour faciliter la radaptation physique et psychologique, et la rinsertion sociale de tout enfant victime de toutes formes de ngligence, dexploitation ou de svices, de torture, et de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants, ou de conflit arm ().
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
13
EN BREF
La Convention protge lenfant de toutes les formes de violences (qui peuvent tre multiples et maner dauteurs variables, dont ltat), impose ltat de rinsrer les enfants ayant t victimes et surtout de leur donner le droit dtre entendus dans le cadre des procdures.
Les trois articles cls de la Convention en rapport avec ce guide :
Larticle 12 prcise que tout enfant a le droit dexprimer son opinion sur toute question lintressant, en particulier dans les domaines judiciaire et administratif.
Larticle 19 prvoit que les enfants doivent tre protgs de toutes formes de violences, quelles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, y compris de lexploitation conomique ou de la traite.
Larticle 37 prohibe la torture, les traitements cruels, inhumains ou dgradants, ainsi que la privation de libert illgale ou arbitraire.
Les Observations gnrales du Comit des droits de lenfant des Nations uniesCes Observations sont des commentaires autoriss publis rgulirement par le Comit des droits de lenfant des Nations unies, afin de clarifier la porte et linterprtation quil convient de donner des points particuliers de la Convention relative aux droits de lenfant.
Le Comit, compos de dix-huit experts manant des pays membres de lONU, est charg de veiller au respect de la Convention par les tats layant ratifie (les tats parties).
Plusieurs de ces Observations portent prcisment sur divers aspects de la violence contre les enfants, en particulier les Observations nos 13, 8 et 125, tant les plus dtailles. Elles apportent des lments trs utiles concernant les mthodes retenir. On en trouvera ci-dessous la synthse.
Observation gnrale no 13 (2011) sur le droit de lenfant dtre protg de toutes formes de violences
Le Comit souligne que cette observation a t rdige en raison du caractre alarmant de la violence contre les enfants, de son ampleur et de son intensit travers le monde et demande que les mesures destines y mettre fin soient largement renforces et tendues . Le Comit insiste par ailleurs sur lapproche quil juge ncessaire dans ce domaine : considrer les enfants comme titulaires de droits plutt que comme victimes.
Rappelant que la violence contre les enfants mane en premier lieu de leur milieu familial, qui devrait les protger, mais aussi des institutions publiques, le Comit demande aux tats parties de diffuser largement cette Observation gnrale et den faire un outil de formation, de mme que lObservation no 12.
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
14
Le Comit souligne les effets dltres, court, moyen et long terme, de la violence contre les enfants sous toutes ses formes : Les cots humains, sociaux, conomiques de la ngli-gence du droit des enfants la protection sont immenses , quils soient directs (soins mdicaux, services juridiques et sociaux, protection de remplacement) ou indirects (handicaps, consquences psychologiques et ducatives).
Le Comit encourage les tats parties normaliser leur dfinition de la violence au niveau international afin de faciliter la collecte de donnes et changer leurs expriences de bonnes pratiques. Tel est prcisment lun des objectifs de ce guide.
LObservation gnrale donne ensuite des indications sur la manire dont les tmoignages des enfants devraient tre recueillis pour que les lois et procdures judiciaires soient appliques dune manire respectueuse des enfants . Le Comit recommande une fois de plus aux per-sonnels qui travaillent avec et pour les enfants , notamment les mdecins, psychologues, policier(re)s*, magistrat(e)s, avocat(e)s et agents de ltat, de suivre des formations sur les droits de lenfant.
LObservation gnrale dtaille la faon dont les enfants doivent tre entendus tous les stades de la procdure, et ce ds le signalement. Cette dmarche devrait par ailleurs pouvoir tre effectue non seulement par les professionnels mais aussi par les enfants eux-mmes. Pour ce qui concerne laudition des enfants, le Comit encourage llaboration de protocoles adapts. Il convient, ajoute le texte, de faire preuve dune extrme prudence afin dviter dexposer lenfant un nouveau prjudice pendant lenqute . cette fin, toutes les parties sont tenues de solliciter lopinion de lenfant et de lui donner tout le poids ncessaire.
LObservation gnrale analyse enfin les modes de suivi et daccompagnement de lenfant en insistant sur la ncessaire continuit dune tape lautre , et sur l examen priodique du traitement et du placement de lenfant.
Elle conclut en ritrant que lintervention devrait tre la moins intrusive possible () et les enfants et leurs parents devraient tre rapidement et correctement informs par les systmes de justice et de police .
EN BREF
Le droit de lenfant dtre protg de la violence
Les effets dltres de la violence peuvent sexprimer court, moyen et long terme.
Le tmoignage des enfants doit tre recueilli selon des procdures qui les respectent, de manire ne pas les exposer un nouveau prjudice.
* Dans la suite du texte, les mtiers (exercs aussi bien par des hommes que par des femmes) seront mentionns au masculin et au fminin pour la premire occurrence, puis au masculin seulement dans un souci de concision.
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
15
Observation gnrale no 8 (2006) sur le droit de lenfant une protection contre les chtiments corporels et les autres formes cruelles ou dgradantes de chtiments
Les chtiments corporels et autres formes cruelles ou dgradantes de chtiments sont, aujourdhui encore, des types largement accepts et rpandus de violence contre les enfants . Le Comit souhaite leur interdiction et limination () tant dans la famille qu lcole ou dans tout autre contexte . Il regrette leur lgalit gnralise et leur acceptation persistante , sans pour autant remettre en cause le concept positif de discipline . Il ne rcuse pas la notion de discipline mais rappelle ici implicitement que cette dernire doit toujours rester compatible avec la dignit de lenfant.
Le Comit reconnat que lenfant peut se livrer des comportements dangereux et que, dans ce cas, une forme de contrainte est acceptable mais que son usage doit tre aussi rduit que possible, dans sa forme et dans sa dure. Le Comit estime que la voie lgislative est ncessaire mais quelle ne suffira pas ; elle devra saccompagner dactions de sensibilisation, dorientation et de formation .
Enfin, le Comit relve que, dans certains tats, des enfants, parfois ds un trs jeune ge ou quand ils sont considrs pubres, sont condamns des chtiments dune violence extrme, notamment la lapidation et lamputation (). Pareils chtiments sont lvidence contraires la Convention relative aux droits de lenfant et dautres instruments relatifs aux droits de lHomme () et doivent tre interdits . Lenfant, conclut le Comit, nest pas un objet appartenant ses parents ni ltat, ni un simple objet de proccupations.
EN BREF
Les chtiments corporels
En toutes circonstances, les chtiments corporels doivent tre interdits.
Quand lenfant se livre des comportements dangereux (ce qui peut tre le cas lorsquil a t victime de violences) et quil doit tre mis labri, une forme de contrainte peut lui tre applique.
La contrainte ne peut tre applique lenfant que dune manire qui respecte son intgrit et pour un temps aussi bref que possible.
Certains tats appliquent des formes extrmes de chtiments (amputations, lapidations), y compris lgard des mineurs. Elles doivent tre interdites.
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
16
Observation gnrale no 12 (2009) sur le droit de lenfant dtre entendu
Larticle 12 de la Convention nonce un droit dont le Comit souligne le caractre fondamental : celui de tout enfant dtre entendu propos des dcisions qui le concernent, notamment dans les procdures judiciaires ou administratives. Lenfant peut tre entendu, soit directement, soit par lintermdiaire dun reprsentant ou dun organisme appropri . Le Comit regrette que ce droit continue dtre entrav par de nombreuses pratiques et mentalits profondment ancres dont il souhaite lvolution.
Le Comit prcise que lexpression de son opinion, pour lenfant, est un choix, non une obligation . Sur ce point, il souligne que lenfant ne doit tre soumis aucune pression ni manipulation daucune sorte et ne doit pas tre interrog plus souvent que ncessaire , en particulier lorsque lentretien porte sur des vnements nfastes ; par exemple lorsquil a t victime dune infraction pnale, de svices sexuels, de violence ou dautres formes de mauvais traitements .
Laudition dun enfant est un processus difficile qui peut avoir des consquences traumati-santes , aussi, les tats parties doivent tre conscients des consquences ngatives dune pratique inconsidre du droit de lenfant dtre entendu . Cest la raison pour laquelle ceux qui entendent lenfant doivent tre attentifs toutes ses formes dexpression, y com-pris les formes non verbales de communication, le langage corporel, le jeu, les mimiques, le dessin et la peinture . En outre, le Comit ajoute que ces auditions doivent se drouler dans des locaux adapts, tre ralises par du personnel spcialement form qui aura dment inform lenfant du droulement de toute la procdure et de son droit de garder le silence. Les enfants ne devraient jamais tre amens exposer une opinion contre leur gr et doivent tre informs quils peuvent mettre un terme leur participation tout moment . Pour ce faire, lenfant doit tre prpar son audition qui devra prendre la forme dun entre-tien et non dun interrogatoire . Le Comit estime que lenfant ne devrait pas tre entendu en audience publique mais dans des conditions de confidentialit et que le dcideur doit informer lenfant des dcisions prises et de la manire dont son point de vue a t pris en considration.
Le Comit estime quun nombre considrable denfants ne connaissent pas leur droit dtre protgs de la violence parce quils interprtent certains comportements abusifs comme des pratiques acceptes . Il est donc essentiel de leur faciliter laccs aux moyens de signale-ment, notamment par des lignes tlphoniques ddies et des lieux o ils pourraient faire part de leur exprience .
Enfin, le Comit note avec proccupation que, dans certaines socits, les attitudes et pratiques coutumires compromettent et restreignent gravement lexercice du droit des enfants dtre enten-dus et appelle les tats parties faire voluer les mentalits sur cette trs importante question. Le Comit fait ici rfrence aux mutilations gnitales fminines encore pratiques dans certains pays dAfrique, parfois malgr linterdiction lgislative. Plusieurs pays nont pas encore interdit cette pratique par la loi. Une telle interdiction, qui provoque indubitablement une baisse progressive de ces mutilations, serait de toute vidence ncessaire, dautant plus que ces pratiques tendent tre appliques aux petites filles un ge de plus en plus jeune, ce qui interdit lvidence lenfant de faire connatre son refus. La Charte africaine des droits et du bien-tre de lenfant a pris position sur ce sujet dans un sens qui rejoint la position du Comit des droits de lenfant.
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
17
EN BREF
Le droit de lenfant dtre entendu
Lenfant doit tre entendu dans toutes les dcisions qui le concernent, en particulier dans les dcisions judiciaires et administratives.
Pour lenfant, le droit dexprimer son opinion est un choix et non une obligation : il ne doit faire sur ce point lobjet daucune pression.
Ceux qui procdent laudition de lenfant doivent tre attentifs toutes ses formes dexpression, y compris non verbales.
Il est essentiel que les enfants puissent accder facilement aux moyens de signaler les violences dont ils font lobjet.
Les Lignes directrices en matire de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tmoins dactes criminels (2005)Les Lignes directrices en matire de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tmoins dactes criminels de lOffice des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)6 visent aider au rexamen des lois, procdures et pratiques , de telle sorte quelles respectent les droits fondamentaux des enfants victimes de violences, et guider les professionnels et les bnvoles pour quils traitent ces enfants avec sensibilit . Cest dans ce but que les Lignes directrices comprennent une loi type qui pourrait servir en tant que de besoin tous les pays qui souhaitent amliorer leurs procdures policires et judiciaires concernant les enfants victimes de violences.
Cette loi type rappelle les principes gnraux qui doivent systmatiquement tre respects dans les procdures concernant les enfants victimes, savoir leurs droits dtre pleinement infor-ms, dtre entendus, de bnficier dune assistance efficace, dtre protgs contre les preuves que peut comporter le processus judiciaire, dobtenir une ventuelle rparation et le droit au respect de leur vie prive.
La loi type nonce les principales tapes de la procdure, du signalement la manire dont lenfant doit tre protg et inform tout au long de cette procdure. La loi type insiste aussi sur lexigence de formation des personnels afin quils appliquent des techniques dentretien les moins traumatisantes pour lenfant.
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
18
Les Lignes directrices relatives la protection de remplacement pour les enfants (2009)Les Lignes directrices de lONUDC relatives la protection de remplacement pour les enfants ont t labores la demande du Comit des droits de lenfant lissue dune longue consultation sur le thme de la protection des enfants privs de soutien parental. Insistant sur le droit de ces enfants dtre entendus, ces Lignes directrices soulignent la ncessit, pour les tats par-ties, dtre particulirement vigilants envers les enfants vulnrables que sont les enfants privs de famille, surtout lorsquils sont victimes de violences, dexploitation ou dabandon. Comme les autres enfants, ils doivent pouvoir exprimer leur opinion sur les mesures dont ils feront lobjet.
Le retrait des enfants de leur famille devrait tre une mesure de dernier recours, pour la priode la plus brve possible ; la rflexion ce sujet doit tre mene par une quipe pluridisciplinaire. Lenfant doit tre plac, autant que faire se peut, non loin de son milieu habituel de vie pour viter de le priver de ses repres. Il convient de toujours tenir compte du fait que les change-ments frquents de cadre nuisent au dveloppement de lenfant .
Toutes les dispositions qui concernent lenfant doivent lui tre dment expliques. Son avis doit tre recueilli et pris en compte selon son discernement, ses liens avec sa fratrie doivent tre prservs dans toute la mesure du possible. aucun moment, un enfant ne devrait tre priv du soutien et de la protection dun tuteur lgal ou dun autre adulte reconnu comme responsable, ou dun organisme public . Les enfants placs doivent avoir accs une personne de confiance qui ils puissent parler en toute confidentialit . Lobjectif du placement doit tre le retour de lenfant dans sa famille, si celle-ci a t dfaillante. La famille est accompagne afin de lui permettre de soccuper de nouveau de son enfant. Par ailleurs, lorsquelle est ncessaire, la mesure de place-ment doit tre non seulement stable mais aussi priodiquement rexamine et lenfant, ainsi que ses tuteurs lgaux, doivent tre consults chaque tape du processus . Lenfant doit aussi pouvoir exprimer son dsaccord et, le cas chant, contester la mesure devant les tribu-naux. Lenfant plac, conclut le texte, devrait systmatiquement disposer dun cahier de vie retraant tous les lments de son histoire personnelle.
KK SAVOIR
Principes gnraux pour toute action en faveur dun enfant victime de violences
1. La non-discrimination et lgalit entre tous les enfants (article 2 de la CDE) : ce principe vaut en toutes circonstances, aussi bien pour ce qui concerne le genre de lenfant, que son ge, son appartenance ethnique, religieuse, linguistique, son tat de sant ou de handicap, son statut conomique et social, etc.
2. Lintrt suprieur de lenfant (article 3 de la CDE) : il sagit dune considration primordiale pour toutes les dcisions qui le concernent. Cette notion, qui traverse lensemble de la Convention, doit tre prise dans un sens double :
Chaque dcision au sujet dun enfant, quelle soit administrative, judiciaire, scolaire ou mdicale, doit toujours viser ce qui est le plus important pour son dveloppement personnel ;
-
LES
TE
XT
ES
ET
LE
S P
RIN
CIP
ES
D
E R
F
R
EN
CE
UN
IVE
RS
ELS
19
Chaque tat lorsquil lgifre, chaque collectivit locale lorsquelle prend des dcisions doivent sinterroger sur limpact des mesures quils adoptent pour atteindre lintrt suprieur des enfants, considrs collectivement.
3. Le droit la vie, la survie et au dveloppement de lenfant (article 6 de la CDE) : il englobe tous les biens et services dont un enfant a besoin pour vivre et grandir, autant pour satisfaire ses besoins lmentaires, physiques et nutritionnels que psychologiques, ducatifs et motionnels.
4. La participation de lenfant aux dcisions prises pour lui (article 12 de la CDE) : elle suppose que lenfant soit inform de ce qui le concerne dans un langage quil comprenne, dune manire qui soit exempte de toute pression sur lui et que son opinion soit dment prise en considration par les adultes et les institutions.
5. Le respect de la parole de lenfant, de son intimit, de son honneur et de sa vie prive (articles 12, 16 de la CDE) : ce principe requiert de la part de la famille et des professionnels qui entourent lenfant une coute bienveillante de sa parole, le respect de sa personnalit ainsi que la confidentialit des informations qui le concernent.
NOTES
1. Convention relative aux droits de lenfant, New York, 20 novembre 1989, adopte par la rsolution 44/251 du 20 novembre 1989 la 44e session de lAssemble gnrale des Nations unies. Entre en vigueur : 2 septembre 1990. Enregistrement : 2 septembre 1990, no 27531.
2. La Convention europenne de sauvegarde des droits de lHomme est disponible sur le site du Conseil de lEurope : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf, http://www.unicef.org/morocco/french/CDE.pdf
3. La Charte africaine des droits et du bien-tre de lenfant a t adopte lors de la 26e Confrence des chefs dtat et de gouvernement de lOrganisation de lUnit africaine (aujourdhui Union africaine) en juillet 1990, elle est entre en vigueur le 29 novembre 1999. Elle est disponible sur le site de la Commission africaine des droits de lHomme et des peuples : http://www.achpr.org/fr/instruments/child/
4. Dans tous les dveloppements qui suivront, la Convention relative aux droits de lenfant sera dsigne par le terme : la Convention . Si mention est faite dune autre convention dans le prsent ouvrage, sa dnomination complte sera alors cite.
5. Toutes les Observations gnrales du Comit des droits de lenfant des Nations unies peuvent tre trouves sur le site du Haut-Commissariat aux droits de lHomme :http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
6. Les Lignes directrices de lOrganisation des Nations unies en matire de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tmoins dactes criminels, version pour enfants, labores sous limpulsion du Bureau international des droits des enfants et en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour lenfance (Unicef), ont t adoptes par le Conseil conomique et social (Ecosoc) de lONU en 2005. Le Manuel lintention des professionnels et des dcideurs en matire de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tmoins dactes criminels est disponible sur le site de lONUDC : http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/09-8664_F_ebook_no_sales.pdf. Une version des Lignes directrices a t ralise pour les enfants par lUnicef et lONUDC avec laide du Centre de recherches Innocenti et du Bureau international des droits des enfants. Lignes directrices de lOrganisation des Nations unies en matire de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tmoins dactes criminels, version pour enfants : http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_F.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdfhttp://www.achpr.org/fr/instruments/child/http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/09-8664_F_ebook_no_sales.pdfhttp://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_F.pdf
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
LENFANT ET LES VIOLENCES
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
23
LENFANT ET LES VIOLENCES
Les tapes du dveloppement de lenfant Tout enfant se dveloppe de manire intgre : il sopre de constantes interactions entre son
dveloppement physique, cognitif, psychoaffectif et sensoriel. Il est galement en interaction permanente avec le milieu dans lequel il volue ds sa naissance, commencer par son milieu familial. Ces interactions sont en elles-mmes structurantes de la petite enfance ladolescence et comportent une succession dexpriences, parfois conflictuelles, qui conduiront lenfant se dfinir par rapport lui-mme (image et perception de soi) et par rapport au milieu qui lentoure.
Le dveloppement dun enfant nest jamais linaire. Le processus de dveloppement, du nou-veau-n ladolescent, se fait de manire progressive avec des avances, des arrts, des retours en arrire, des expriences vcues et diffrentes interactions avec lenvironnement.
Les diffrences dun enfant lautre sont la rgle.
Les tapes dcrites ci-dessous empruntent diverses sources cites en bibliographie1. Elles reprsentent donc un schma gnral et non une description de la normalit .
Avant la naissance
Les conditions (psychologiques et matrielles) dans lesquelles volue la mre avant la naissance sont essentielles au dveloppement intra-utrin et aux premires interactions. La grossesse est une priode de vulnrabilit psychique pour la mre et en mme temps une priode cruciale du dveloppement de lenfant. On sait aujourdhui que le ftus peroit des sons et ressent des motions lies celles de sa mre. Par consquent, les conditions dans lesquelles celle-ci se trouve (ge, conditions socio-conomiques, solitude ventuelle ou soutien familial, tat psychique, relations au sein du couple) ont un fort impact sur le droulement de la grossesse et la venue au monde de lenfant. Au septime mois, le ftus a dj achev la formation de son systme nerveux central et dispose ds lors denviron dix milliards de cellules nerveuses.
la naissance
La qualit des premires relations de lenfant avec son environnement familial, en particulier sa mre, son pre ou la personne qui en est le substitut, mais aussi la famille largie, est cruciale pour le dveloppement des premires comptences (motrices, crbrales, sociales) du nouveau-n. La dpression post-natale chez la mre peut constituer un risque important pour le futur dveloppement de lenfant.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
24
Celui-ci arrive au monde dj dot de comptences sensorielles, motrices et motionnelles qui lui permettent de lancer des signaux, en particulier vers sa mre ou vers la personne qui soccupe le plus de lui. Ds sa naissance, le nourrisson entre en communication avec le monde qui lentoure et peroit les signaux que celui-ci lui adresse : il tablit ses premiers liens et absorbe le climat dans lequel il est venu au monde.
De 0 3 ans
Lenfant commence prendre conscience de son existence propre : il saffirme comme individu mais, pour ce faire, a besoin de multiplier les interactions. Il communique avec ceux qui lentourent dabord par son comportement (sourires, pleurs, colres). Il est hypersensible aux ractions de son entourage et acquiert progressivement, avec le sentiment de son identit, lbauche de son estime de soi ; il commence percevoir les motions dautrui.
Cette priode intense lui fait vivre de multiples acquisitions et adaptations. Dabord en symbiose totale et quasi exclusive avec son premier objet dattachement (gnralement sa mre), il souvre progressivement au contact avec dautres adultes, le cercle de famille, et avec les autres enfants.
Il demeure dans la pense magique selon laquelle les objets qui lentourent sont dous de sentiments. Lenfant pense quil peut faire oprer des changements par sa seule volont et prte cette capacit aux autres, y compris aux objets. Tourn sur lui-mme et trs dpendant de ses objets dattachement, il reste concentr sur la satisfaction de ses besoins et exprime de fortes frustrations lorsque ses dsirs ne sont pas satisfaits. Cest lge du non , par lequel il exprime son sens de lidentit, lge du je , lge de la rsistance aux premires contraintes.
Pendant cette priode essentielle de sa vie, lenfant fait des acquis fondamentaux : il apprend parler, marcher, courir, sa motricit fine se dveloppe, il commence dessiner, acquiert la propret, accde son identit sexuelle. Il passe dune dpendance totale lgard de ses proches une relative autonomie. Il intriorise la notion de permis et dinterdit et se heurte aux limites de son action sur le monde qui lentoure.
De 3 6 ans
Lenfant matrise dsormais le langage puisquil passe en trois ans de quelques centaines de mots plusieurs milliers, mais continue de recourir beaucoup dexpressions non verbales. Il peroit clairement la diffrence des sexes et des rles, comprend quil nest pas tout-puissant, quil lui faut en permanence tenir compte des autres, notamment des enfants. Son entre lcole saccompagne dun dveloppement intense de ses comptences cognitives. Il revendique son autonomie et se heurte de plus en plus aux interdits, ceux qui sappliquent lui et ceux qui sappliquent aux autres.
Sa vie relationnelle et affective est dsormais bien structure autour de quelques figures centrales auxquelles il pose dinnombrables questions. Son imaginaire se dveloppe considrablement, de mme que sa mmoire et sa capacit retracer des vnements, capacit parfois aug-mente dlments de fiction. Il prouve un grand plaisir aux rcits (les histoires racontes), mme lorsquils lui font peur, ce qui lui permet de matriser ses angoisses.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
25
Son langage est structur, il peroit lavant et laprs , il sait shabiller et se nourrir sans aide, identifie clairement les parties de son corps, soccupe des jeux de complexit croissante dont il comprend les rgles.
Il acquiert le sens des limites et renonce progressivement la toute-puissance infantile. Il souvre de plus en plus la socialisation et intriorise linterdit de linceste. Il marque un intrt accru pour le parent du mme sexe auquel il sefforce de ressembler par des comportements dimitation.
De 6 12 ans
Lenfant accde au raisonnement, la logique et la dduction, il rompt avec la pense magique, mme si son got des histoires reste prononc : il en coute, en raconte et en invente, mais fait de plus en plus la diffrence entre la fiction et la ralit, mme si cette distinction lui est par-fois difficile dans lusage du numrique. Progressivement, il matrise la lecture et lcriture, sexprime par le dessin, montre un got prononc pour le jeu, en particulier le jeu collectif rgul par des limites, des interdits et des codes2.
Lenfant recherche moins les situations conflictuelles. Il souvre la vie sociale : le groupe des pairs prend une importance croissante, son milieu slargit, son sens de lidentit aussi. Il nest plus seulement le membre dune communaut familiale mais aussi celui dune classe et dune cole, dune socit, dun pays. Les activits physiques deviennent un lment essentiel de sa vie, y compris lorsquelles mettent en jeu la comptition entre pairs.
Lenfant recherche de prfrence des amitis avec les enfants du mme sexe que le sien. Il sinter-roge sur la manire dont les tres humains viennent au monde et pose beaucoup de questions ce sujet. Sa curiosit sur ce point peut le conduire des comportements mal compris par les adultes. Mais ses relations avec ses parents marquent beaucoup moins le besoin de la conflic-tualit ou de lopposition. Il admet que certains comportements relvent de linterdit et entre dans une phase active de socialisation.
De 12 18 ans
Ladolescence et la pubert introduisent de profonds bouleversements physiologiques, psy-chologiques et relationnels. Priode de remaniements majeurs, cest lge de la rvolte et de lindividualisation, de laffirmation de lidentit sexuelle, celui aussi dune grande vulnrabilit. Ladolescent sinterroge sur son identit sexuelle et la dcouverte dune ven-tuelle homosexualit peut tre trs mal vcue par lui : cette prise de conscience peut tre perue comme lentre dans un monde interdit par la socit et source de honte lgard de sa famille. Certaines socits, en effet, nacceptent pas lhomosexualit et mme la rpri-ment pnalement.
Frquemment, ladolescent se heurte au monde des adultes quil estime incapables de com-prendre son volution, en premier lieu ses parents et les adultes proches de lui. Ses liens avec ses pairs revtent alors une importance vitale, aussi bien lorsquils sont du mme sexe que lorsquils sont du sexe oppos. La bande , le groupe peuvent tenir lieu de substitut familial, surtout si ladolescent dveloppe une relation conflictuelle avec sa famille.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
26
Ladolescence est une tape dans le processus de dveloppement qui nest pas ncessairement synonyme de difficults majeures. Nanmoins, ce peut tre une priode de comportements trs droutants pour lentourage, notamment lorsquils sont marqus dactes auto-agressifs (anorexie, boulimie, toxicomanie, fugues, tentatives de suicide) ou agressifs envers autrui. Ces difficults peuvent conduire lentre dans la dlinquance, gnralement momentane.
Ladolescent entretient une relation particulire, souvent difficile, avec son corps et limage de lui-mme. Il peut lui arriver de sinfliger des souffrances (rgimes extrmes, scarifications, etc.) dans le but de tester ses propres limites. Lentre dans la vie sexuelle peut aussi saccompagner de comportements que les adultes de son entourage naccepteront pas facilement, source de nouvelles incomprhensions et de nouveaux conflits. ge difficile , ladolescence nen est pas moins le temps dune intense maturation et de production de limaginaire, dont il faut retenir quelle est la fois le temps de la fragilit et de la crativit.
LES STADES DVOLUTION DE LENFANT
tapes Caractristiques
Avant la naissance La grossesse est une priode de vulnrabilit pour la mre. La qualit de son environnement familial et social interagit avec le dveloppement
de lenfant.
la naissance Les conditions de la naissance de lenfant sont importantes pour la qualit de sa relation avec son environnement.
Le nouveau-n sinsre dans un tissu de relations essentielles son dveloppement.
De 0 3 ans Lenfant est hypersensible aux ractions de son entourage. Cest lge des acquisitions essentielles : marcher, parler, prendre conscience de soi. Cest lge des premires rsistances la contrainte.
De 3 6 ans Lenfant revendique son autonomie et prend conscience des limites de son action. Son imaginaire et sa mmoire se dveloppent, avec la capacit de retracer ses actions
et ses souvenirs.
Il multiplie les relations avec les autres, leur donne une place dfinie par rapport lui.
De 6 12 ans Lenfant matrise la lecture et lcriture et rompt peu peu avec la pense magique, mme sil garde un got prononc pour les histoires, relles ou fictives.
Il a besoin du jeu et du contact avec ses pairs, qui prennent beaucoup dimportance dans sa vie.
Il admet lexistence des interdits et recherche moins lopposition.
De 12 18 ans Ladolescence est un temps de profonds bouleversements physiques et psychologiques, qui saccompagnent dune grande vulnrabilit.
Ladolescent peut avoir le sentiment dtre incompris des adultes, y compris de ses parents, et ressent un besoin vital de frquenter ses pairs.
Il peut manifester sa rvolte et son sentiment dtre incompris par des comportements qui le mettent en danger.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
27
KK SAVOIR
Les besoins essentiels dun enfant tous les stades de son dveloppement
Scurit physique et affective, stabilit motionnelle ;
Relations privilgies avec un entourage chaleureux et bienveillant mais capable de fixer des rgles et les positions respectives de chacun ;
Capacit dcouvrir par soi-mme les limites de son action par des expriences structurantes qui ne le mettent pas en danger.
Les violences contre les enfantsLa violence contre les enfants est un phnomne universel et multiforme, qui sexerce priori-tairement mais non exclusivement envers les plus vulnrables dentre eux, tels que les nour-rissons et les trs jeunes, les enfants en situation de handicap, les enfants errants ou rfugis. Contrairement ce que lon pourrait penser, la famille est malheureusement lun des lieux o la violence est la plus rpandue, mais elle sexprime aussi ailleurs (cole, institutions diverses, rue, milieu de travail ou dexploitation).
La violence contre les enfants existe dans le monde entier, dans tous les milieux sociaux. Elle est trs souvent sous-estime du point de vue de sa frquence, de sa gravit et de ses rper-cussions court, moyen et long terme. Elle revt des formes diffrentes (physique, psychique, sexuelle, institutionnelle) et est parfois encourage par les normes sociales (chtiments corporels en famille ou lcole, mariage prcoce, mutilations gnitales par exemple)3. lge adulte, les rpercussions des violences subies dans lenfance, sans tre systmatiques, sont nanmoins importantes, notamment dans la construction de lestime de soi et les difficults nouer des relations stables. Certains anciens enfants battus devenus parents recourront eux-mmes la violence lgard de leurs propres enfants, mme sil ny a l aucune fatalit. Les capacits de rcupration et de rsilience des enfants sont considrables, la condition que les traumatismes aient t dment pris en charge.
Par ailleurs, il est frquent que le mme enfant fasse lobjet de plusieurs formes de violences la fois, les unes aggravant les autres. Il arrive quau sein dune mme famille un seul enfant dune fratrie fasse lobjet de violences, ce qui rend la dtection plus difficile.
Enfin, trs souvent, les violences sur les enfants ont un caractre rptitif, ce qui accrot encore leur impact.
Selon lOrganisation mondiale de la sant (OMS), cette violence peut tre dfinie comme la menace et lutilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre un enfant par un individu ou un groupe, qui entrane ou risque fortement de causer un prjudice la sant, la survie, au dveloppement ou la dignit de lenfant .
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
28
Typologie des violences contre les enfants
Violences physiquesIl sagit dactes qui prennent pour cible le corps de lenfant, tels que le secouement chez les bbs, les coups mains nues ou laide dinstruments divers, les brlures, les piqres, les cheveux arrachs, les suffocations, les dcharges lectriques, les tentatives de strangulation, la privation de nourriture ou encore les jets dacide. Les violences physiques nont pas toujours le caractre extrme de la maltraitance ; elles peuvent tre dapparence plus anodine mais susciter chez len-fant, par leur rptition et leur caractre imprvisible, un sentiment de crainte diffus et permanent.
Lorsque la violence est extrme, la mort de lenfant, notamment des plus jeunes, peut en rsulter. Les homicides denfants sont partout sous-estims et sous-dclars, soit par dissi-mulation dlibre de la part des auteurs, soit parce quil est trs difficile denvisager lhomicide pour ceux qui rdigent les certificats de dcs. Les mdecins en effet hsitent frquemment qualifier de meurtre ce qui est prsent par lentourage comme un accident. Les statistiques pidmiologiques font pourtant apparatre que le meurtre familial sur un enfant concerne surtout la tranche dge de 0 3 ans4.
Violences sexuellesCe sont tous les actes, rels ou tents, sapparentant une activit sexuelle impose lenfant, mme lorsque celui-ci est apparemment consentant et quelle quen soit la forme, homosexuelle ou htrosexuelle. Ces violences peuvent tre commises par une personne adulte, notamment au sein de la famille, mais aussi entre enfants.
Il peut sagir dactes sexuels de toutes sortes : harclement, viol, attouchement, exhibition, expo-sition la pornographie ou des images sexuellement abusives, contrainte la prostitution. La traite et la vente denfants vise dexploitation sexuelle entrent, bien entendu, dans la dfinition des violences sexuelles.
Les violences peuvent tre commises dans le cadre familial (notamment linceste) et en dehors de ce cadre, par exemple au sein dinstitutions (voir plus loin). Il sagit alors de pairs ou dadultes, le plus souvent ceux qui exercent une autorit sur lenfant et qui peuvent linciter accepter les avances sexuelles par la contrainte ou par des comportements de sduction. Il est noter que, si les violences sexuelles sexercent prioritairement contre les adolescents, elles peuvent aussi frapper des enfants trs jeunes, y compris des bbs ainsi que des enfants pr-pubres.
Les violences sexuelles contre les enfants, longtemps sous-estimes, sont dune grande frquence. Selon lOMS, 20 % des femmes adultes et 5 10 % des hommes dclaraient, en 2014, en avoir t victimes au cours de leur enfance5.
Violences psychologiquesElles se dclinent sous forme dagressions verbales, dinsultes, de harclement moral, de menaces, de brimades, de rclusion dans un lieu ferm, dexposition, ponctuelle ou rpte, de lenfant des situations terrorisantes. Les exigences excessives, le dnigrement systmatique, les humiliations, les comportements dexclusion, ainsi que les violences conjugales ou familiales dont un enfant est tmoin entrent galement dans cette catgorie.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
29
Il faut noter que les violences psychologiques accompagnent quasi systmatiquement les autres formes de violences. Mais elles peuvent aussi sexercer seules, sans accompagner les violences physiques ou sexuelles.
Ngligences lourdesIl sagit dun dficit massif dattention et de soins adapts aux besoins spcifiques de lenfant un quelconque stade de son dveloppement. Lenfant est globalement carenc en prise en charge ducative, en nourriture, en attention, en socialisation, en stimulation, et en soins de sant. Dans tous ces domaines, il manque de lattention approprie son ge et ses besoins. L encore, il peut sagir dun seul enfant au sein dune fratrie par ailleurs correctement traite.
Violences socio-conomiquesLexploitation de lenfant au travail un ge infrieur lge lgal, la traite et la vente denfants au dtriment de leur scolarisation sont des phnomnes massifs dans de nombreux pays, notam-ment en voie de dveloppement, mais le phnomne existe aussi dans les pays industrialiss.
Il sagit l galement dune violence puisque lexploitation prive lenfant non seulement de son droit la scolarisation mais aussi lexpose des dangers physiques innombrables, notamment le port de charges trop lourdes, linhalation de produits toxiques et les travaux insa-lubres. Lenfant peut tre contraint de raliser des tches qui dpassent totalement ses capacits physiques et psychologiques, mais aussi de mener des activits dgradantes au dtriment de ses relations avec son milieu naturel et de ses objets dattachement.
Il est trs difficile de connatre le nombre denfants qui travaillent dans de telles conditions travers le monde car les sources varient et la sous-dclaration est importante. Selon lOrgani-sation internationale du travail (OIT), environ 170 millions denfants travailleraient illgalement dans le monde, dont 85 millions dans des conditions dangereuses pour leur dveloppement et mme leur vie6.
Violences scolairesLcole peut tre un milieu de grandes violences, en particulier entre enfants, et ce ds le plus jeune ge. Certains enfants sont stigmatiss en raison de particularits physiques, sociales, eth-niques, religieuses ou dun handicap. Ils peuvent devenir de vritables boucs missaires et faire lobjet dintimidations. Il est souvent difficile pour lentourage, y compris les enseignant(e)s et les parents, de dtecter la mise lcart dun enfant ou mme les violences exerces contre lui pour les raisons prcites.
Lcole peut tre aussi le lieu de violences exerces contre certains enfants par des enseignants : violences psychologiques, physiques, voire sexuelles. Linstitution scolaire nest pas toujours assez vigilante sur ce point, dautant plus que les enfants marquent souvent des rticences dnoncer les violences dont ils font lobjet.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
30
Violences institutionnellesLa violence institutionnelle se produit dans des contextes trs diffrents ; plus particulire-ment dans les orphelinats, les structures daccueil varies, les tablissements pnitentiaires. Il est dmontr que la vie en institution est propice lclosion de la violence, que ce soit celle des adultes envers les enfants ou encore celle entre enfants. Lcole nchappe pas ce risque.
Ce type de violence est aussi prsent dans les institutions dont les enfants sont dpendants : procdures interminables, rglements disciplinaires inadapts ou incomprhensibles, ou encore inadaptation des rgles un public de jeunes ou denfants.
Violences collectivesLa violence peut sexercer contre un groupe denfants, voire une catgorie dentre eux faisant lobjet de rejet ou de stigmatisation. Par exemple, il peut sagir denfants appartenant une mino-rit ethnique, linguistique, culturelle, ou une population autochtone, qui ne bnficient pas de la mme attention ou du mme soutien que les autres enfants.
Violences entre enfantsCette forme de violence a longtemps t ignore ou sous-estime. Pourtant, on sait aujourdhui quelle est frquente, quil sagisse de violences entre enfants du mme ge ou des plus gs lgard des plus jeunes. Ces violences peuvent tre physiques, psychologiques ou sexuelles, ou encore une combinaison des trois formes. Elles sexercent principalement lcole mais pas exclusivement. Les violences entre enfants comprennent aujourdhui diverses formes de cyber-harclement.
Cyber-harclementCe sont des violences exerces sur un ou plusieurs enfants par le biais dInternet, y compris des rseaux sociaux. Elles peuvent maner dautres enfants mais aussi dadultes cherchant exercer un chantage ou entrer en contact avec des victimes potentielles. Cest une forme de violence en pleine expansion.
Violences des images et des contenus mdiatiquesDe plus en plus tt, les enfants, mme trs jeunes, ont accs des contenus inappropris au regard de leur ge, que ce soit par le biais de la radio, de la tlvision, du cinma, des jeux vido, dinternet ou de la presse crite. La rgulation dans ce domaine est trs difficile ou inoprante et les adultes ne sont pas toujours conscients de la violence des images ou des contenus auxquels leurs enfants ont accs.
Violences culturellesLes mariages prcoces, les mariages denfants, les mutilations sexuelles, le non-respect de la volont de lenfant, lignorance systmatique de sa parole et de son avis peuvent sabriter sous le couvert de traditions auxquelles lenfant ne peut se soustraire.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
31
Violences des conflits armsLenfant peut tre expos des situations de guerre, avec ou sans sa famille, et le dbut du xxie sicle connat des situations de conflits intenses qui npargnent en rien les civils et sajoutent aux catastrophes naturelles. De ce fait, le nombre de rfugis et de dplacs ne cesse de crotre, parmi lesquels prs de la moiti a moins de 18 ans. La violence contre les enfants dans ce type de situation est dune brutalit sans pareille.
Par ailleurs, beaucoup denfants sont tus ou blesss lors des combats ou des bombardements. Aujourdhui, 300 000 enfants seraient enrls de force dans des forces armes ou dans des mouvements de gurilla.
EN BREF
Des violences multiformes
Les violences subies par les enfants sont de diffrents types. Il est frquent que le mme enfant en subisse plusieurs de manire concomitante ou successive : Violences physiques ; Violences sexuelles ; Violences psychologiques ; Ngligences lourdes ; Violences socio-conomiques ; Violences scolaires ; Violences institutionnelles ; Violences collectives ; Violences entre enfants ; Cyber-harclement ; Violences des images et des contenus mdiatiques ; Violences culturelles ; Violences des conflits arms.
Limpact de la violence sur les enfants
Les consquences de la violence sur les enfants sont multiples (physiques, psychologiques, sexuelles) et peuvent se rpercuter plus tard dans leur vie adulte. Elles ne sont pas ncessaire-ment lies aux types de violences subies.
Chez le nourrissonLes effets de la violence chez le trs jeune enfant prennent diverses formes : troubles neurologiques graves (syndrome du bb secou ) conduisant parfois au dcs, retard staturo-pondral (retard de croissance, troubles alimentaires), perturbation du sommeil, mauvais tat gnral. Le bb dveloppe de faibles interactions avec son entourage, se replie sur lui-mme, vite le regard.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
32
Chez lenfant dge prscolaireLenfant a des difficults acqurir le langage, la marche, la propret ; il peut prsenter un retard massif du dveloppement. Il est agit ou au contraire abattu et repli sur lui-mme. Il ne fixe pas son attention et peut tre agressif envers les autres enfants.
Chez lenfant dge scolaireSans quil sagisse l dune rgle gnrale, lenfant violent est souvent en chec scolaire, il manque de confiance en lui, est extrmement timide ou au contraire agressif envers les autres. De mme, il exprime une grande avidit affective, des sentiments dangoisse et a une repr-sentation dvalorise de lui-mme. Il peut dvelopper des troubles de lattention et du compor-tement, tels que lhyperactivit.
Chez ladolescent et prolongements ventuels lge adulteLadolescent victime de violences exprime souvent un fort dsintrt pour les matires scolaires, adopte des comportements auto-agressifs (troubles du comportement alimentaire, fugues rptition, tentatives de suicide) ou dlibrment transgressifs (toxicomanie, petite dlin-quance, alcoolisme, prostitution). Il peut aussi montrer des signes de pathologie psychiatrique, des dcompensations aigus, des automutilations et mme entrer dans une pathologie mentale durable et installe . Parmi les squelles figurent aussi les grossesses prcoces, les maladies sexuellement transmissibles, la marginalisation et lexclusion sociale.
KK SAVOIR
Des signes visibles et indirects, des consquences multiples
La violence subie par un enfant peut ne pas tre facile dtecter mme si elle laisse des signes visibles mais aussi des signes indirects du traumatisme subi (les signes directs peuvent dailleurs tre parfois trompeurs car certains enfants sont trs casse-cou et les signes indirects sont trs frquents en cas de violences sexuelles) :
Signes visibles : ecchymoses, douleurs, fractures, bosses, corchures, etc.
Signes indirects : phobie du contact, troubles du comportement (notamment alimentaires), difficults scolaires, retard de croissance, troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, cauchemars, nursie, douleurs inexpliques, dpression, etc.
Consquences multiples, irrversibles pour certains : court, moyen et long terme, ces consquences peuvent affecter tout le devenir de lenfant et revtir plusieurs formes (handicaps divers, maladies sexuellement transmissibles, troubles du comportement, difficults scolaires et relationnelles, addictions, tendances suicidaires, automutilations, stigmatisation, marginalisation, dlinquance, faible estime de soi, sentiments de honte, de culpabilit, de rvolte, dinjustice ou de colre).
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
33
Les auteurs des violences sur les enfantsLimmense majorit des adultes et des enfants ne se livre pas la violence contre les plus jeunes membres de la socit. Il est fait mention ici dune typologie des cas les plus frquemment relevs.
Les membres de la famille
Cest dans la famille que lon trouve, de loin, le plus grand nombre dauteurs de violences contre les enfants, que ce soient le pre ou la mre, voire les deux ensemble, les beaux-parents, ou encore les grands-parents. Dans le cas des abus sexuels, il sagit rarement dune rencontre de hasard, mais frquemment dun adulte (parfois aussi dun autre mineur) que lenfant connat dj et en qui il a confiance.
souligner : plus lenfant est jeune, plus lagresseur provient du milieu familial7. Plus lagresseur est un proche de lenfant, plus ce dernier se sent coupable.
Les adultes en position dautorit (hors du milieu familial)
Il peut sagir dun enseignant, du personnel dune institution autre que lcole, dune personne disposant de lautorit publique ou dune autorit morale. Ce peut tre aussi un chef de bande criminelle, ventuellement mineur ; des adultes exerant une position de domination, mme tem-poraire, par exemple ceux qui contraignent les enfants travailler, se prostituer ou mendier ; des adultes auxquels la garde des enfants a t confie ; ou encore un(e) ducateur(rice) travaillant dans un centre de vacances, de loisirs ou encore dans un club sportif. Ce peut tre, enfin, un(e) religieux(se) charg(e) de lducation spirituelle et morale de lenfant.
Les rencontres de hasard
Les rencontres fortuites peuvent reprsenter un grand danger, notamment lorsquelles se produisent loccasion dune fugue ; ou encore lorsquil sagit denfants errants, vivant dans la rue, de migrants en situation irrgulire, denfants vivant dans un camp de rfugis ou de personnes dplaces. Les enfants peuvent par ailleurs faire lobjet de sollicitations sexuelles en ligne de la part de prdateurs, un phnomne alarmant en pleine croissance. Certains prdateurs sexuels se rendent aux abords des coles, ou se procurent des informations sur un enfant de manire provoquer une rencontre.
Les autres enfants
Il peut sagir de mineurs nettement plus gs que leurs victimes mais aussi de violences entre pairs ; loutil privilgi tant alors les rseaux sociaux. Ce cas peut galement se produire lorsque lenfant est devenu le souffre-douleur de la classe ou du groupe, victime dune pers-cution parce quil prsente une diffrence (enfants trangers, enfants diffrents , surdous, handicaps, orphelins).
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
34
Qui protge les enfants ?Cest la socit tout entire qui doit ou devrait protger les enfants et ragir face la vio-lence. Une violence constate sur un enfant devrait toujours appeler, de la part de ceux qui en sont tmoins, une raction approprie. Toutefois, la ralit est bien diffrente. Cest pourquoi certaines personnes ou groupes de personnes ont la responsabilit particulire de protger les enfants.
Cette protection est par dfinition multidisciplinaire. Elle repose dabord sur la famille, mais aussi sur des professionnels.
La protection de lenfant contre les violences est notamment :
Familiale : la famille est le lieu naturel et privilgi de la protection de lenfant. Elle doit tre sys-tmatiquement partie prenante de la prise en charge dun enfant victime de violences, sauf bien entendu si elle en est elle-mme lauteur ou le complice.
tatique : lensemble des institutions de ltat, comme le rappelle la Convention relative aux droits de lenfant qui voque constamment le rle des tats parties, est responsable de la pro-tection et du bien-tre des enfants. Ce sont les tats qui sont chargs de rendre compte de la manire dont ils sacquittent de leurs obligations cet gard devant le Comit des droits de lenfant des Nations unies.
Sociale : les travailleurs/travailleuses sociaux/sociales sont en premire ligne pour prvenir, dtecter, signaler et accompagner lenfant victime de violences. Se pose alors la question de leur prsence en nombre suffisant et de leur formation. Bien que les travailleurs sociaux dpendent aussi bien des structures tatiques que des collectivits locales ou des associations, la responsabilit de mettre en place un systme intgr de protection de lenfance incombe toujours ltat.
Mdicale : lenfant aura besoin non seulement dune prise en charge mdicale parfois en urgence sil prsente des lsions, mais aussi dune valuation mdico-lgale de sa situation et dun suivi mdical court, moyen et parfois long terme.
Psychologique : lenfant violent ne sera pas seulement pris en charge par la mdecine, il aura aussi besoin dun soutien psychologique tous les stades, de ltablissement des faits au temps du procs, jusqu la phase de restauration de son intgrit. Les experts psychologues ou pdopsychiatres participent aussi ltablissement des faits (voir plus loin).
Scolaire : lcole est en premire ligne pour reprer un enfant en souffrance, alerter, signaler et prvenir dventuelles rcidives de la part des agresseurs. Cela pose la question de la for-mation du personnel au reprage de la maltraitance. Les tablissements scolaires ne disposent pas toujours dassistants sociaux et dinfirmiers.
Policire : outre le rle de prvention de la violence et de la scurisation des lieux publics que jouent les forces de lordre, la police (ou la gendarmerie) a un triple rle : protger lenfant, lentendre pour ltablissement des faits tout au long de lenqute et procder linterpella-tion/arrestation de ses agresseurs.
Juridique et judiciaire : lenfant aura besoin dune protection judiciaire et juridique quassureront les avocats, les magistrats et les personnes nommes par la justice afin de reprsenter lenfant au procs ou de lassister dans les procdures.
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
35
Institutionnelle : en amont, la protection institutionnelle comporte de multiples facettes (services sociaux, structures daccueil et dhbergement, familles daccueil). Ces institutions peuvent tre tatiques, prives ou associatives.
Par ailleurs, un certain nombre de pays ont cr des autorits indpendantes (dfenseur(e)s des enfants/mdiateur(rice)s, Institutions nationales des droits de lHomme conformes aux Principes de Paris). Quand elles existent, ces institutions ne sont gnralement pas charges de partici-per lenqute et nont ni le droit dinterfrer avec une procdure en cours, ni celui de remettre en cause une dcision de justice. Elles peuvent nanmoins signaler les situations denfants en danger aux autorits comptentes.
Associative : de nombreuses associations travaillent dans ce secteur pour promouvoir les droits de lenfant dune manire gnrale dans lopinion publique et, pour certaines dentre elles, assister les enfants au cours du processus judiciaire. Les associations et ONG mnent galement des actions de prvention de la violence envers les enfants et participent des actions de formation, de sensibilisation et de plaidoyer.
Lenfant victime
Les avocats, les auxiliaires de justice et les magistrats
Les enseignants
Les psychologues
Les travailleurs sociaux
Les mdecins
La famille
Les policiers, les gendarmes
Les institutions nationales
Les associations
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
36
PRATIQUE ENCOURAGER
Linterdisciplinarit de la protection de lenfant victime
Dans certains pays, les professionnels intervenant auprs des enfants victimes, notamment les travailleurs sociaux, les mdecins, les psychologues, sont runis dans un mme endroit afin dviter le dplacement de lenfant chaque tape de son accompagnement. Cette pratique reste encore trs rare8 bien quelle soit utile (voir plus loin) ; elle nest pas ncessairement adaptable partout, en milieu rural par exemple.
Au Maroc, il existe des cellules dcoute au sein desquelles les procureur(e)s, juges et travailleurs sociaux collaborent avec la police. Le recrutement de psychologues au sein de la brigade des mineurs se pratique galement.
En France, des Units daccueil mdico-judiciaires (UAMJ) se sont dveloppes progressivement sous limpulsion conjointe des procureurs, des autorits sanitaires et du milieu associatif. Implantes au sein des hpitaux, elles assurent un accueil spcifique des victimes dinfractions pnales en conjuguant les ncessits denqute et dinstruction judiciaires avec laccompagnement mdical, psychologique et social des victimes. Des protocoles entre les structures hospitalires et les tribunaux encadrent laudition de lenfant en prvoyant, aux cts de lenquteur(trice) ou du magistrat, la prsence dune personne nomme par lautorit judiciaire (reprsentant de lenfant en justice, psychologue, travailleur social). Par ailleurs, des assistant(e)s sociaux/sociales sont affect(e)s dans des commissariats de police et des brigades de gendarmerie afin dassurer une prise en charge sociale (si ncessaire) quasi immdiate des victimes, notamment des enfants qui, en raison de leur vulnrabilit, ont besoin dune protection renforce si le milieu familial est carenc.
Des structures analogues, appeles Units de protection de lenfance (UPE), ont vu le jour au Maroc et sy dveloppent dans les grandes villes.
Au Qubec, il existe une entente multisectorielle relative aux enfants victimes qui regroupe des reprsentants des cinq diffrentes administrations concernes par la protection des enfants, y compris bien entendu les instances judiciaires. En tmoigne le travail du Centre dexpertise Marie-Vincent (voir plus loin).
POUR ALLER PLUS LOIN
Une tude mondiale sur la violence contre les enfants a t ralise la demande du Secrtaire gnral de lONU par un universitaire brsilien, lexpert indpendant Paulo Sergio Pinheiro, et publie en 2006 : http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_fr.pdf
Un poste de reprsentant(e) spcial(e) sur la violence contre les enfants auprs du Secrtaire gnral de lONU a t cr. Il est occup, depuis 2009, par Mme Marta Santos Pais (Portugal), qui publie un bulletin rgulier : www.srsg.violenceagainstchildren.org/fr
Un poste de reprsentant(e) spcial(e) du Secrtaire gnral de lONU pour les enfants dans les conflits arms a t cr. Mme Leila Zerrougui (Algrie) a t nomme ce poste en 2012 : https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/
http://www.srsg.violenceagainstchildren.org/frhttps://childrenandarmedconflict.un.org/fr/
-
LE
NFA
NT
ET
LE
S V
IOLE
NC
ES
37
Un poste de rapporteur(e) spcial(e) auprs du Secrtaire gnral de lONU contre la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scne des enfants a t cr et attribu Mme Maud de Boer-Buquicchio (Pays-Bas) en 2014 : http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
Un poste de rapporteur(e) spcial(e) sur les formes contemporaines desclavage a t cr en 2007, il est occup depuis 2013 par Mme Urmila Bhoola, et un poste de rapporteur(e) spcial(e) sur la traite des tres humains, en particulier des femmes et des enfants, a t mis en place en 2004, avec sa tte depuis 2014 Mme Maria Grazia Giammarinaro : http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
NOTES
1. Voir : MJid (N.) et Sbihi (R.), Unit de protection de lenfance, guide lusage des professionnels, Casablanca, Maroc, 2007, pp. 16-19 ; Ferland (F.), Le dveloppement de lenfant au quotidien : De 6 12 ans, Hpital Sainte Justine, Universit de Montral, Canada, 2014, 260 p. ; Ouennich (H.), Limpact de la violence de limage sur le psychisme de lenfant , cycle de renforcement de capacits au profit des professionnels des mdias en matire dthique