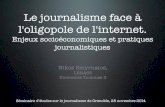Geert Driessen & Hetty Dekkers (2007) Politiques néerlandaises contre les inégalités...
-
Upload
radboud-university-nijmegen-the-netherlands -
Category
Education
-
view
23 -
download
0
Transcript of Geert Driessen & Hetty Dekkers (2007) Politiques néerlandaises contre les inégalités...

POLITIQUES NÉERLANDAISES CONTRE LES INÉGALITÉSSOCIOÉCONOMIQUES ET ETHNIQUES DANS L'ÉDUCATIONGeert Driessen, Hetty Dekkers
ERES | « Revue internationale des sciences sociales »
2007/3 n° 193-194 | pages 505 à 522 ISSN 0304-3037ISBN 9782749213262
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2007-3-page-505.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geert Driessen, Hetty Dekkers, « Politiques néerlandaises contre les inégalitéssocioéconomiques et ethniques dans l'éducation », Revue internationale dessciences sociales 2007/3 (n° 193-194), p. 505-522.DOI 10.3917/riss.193.0505--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour ERES.© ERES. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans leslimites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de lalicence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit del'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockagedans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen et Hetty Dekkers
RISS 193-194/Vol. LIX, n° 3-4
Les politiques néerlandaises visant à lutter contrel’inégalité des chances dans l’éducation ont étéinfluencées non seulement par les changementsd’orientation politique des gouvernements maisaussi par l’évolution de la situation sociale, éco-nomique, démographique, culturelle et politiqueau niveau national comme international (Karstenet meijnen, 2005).
Dans les années 1960, on s’est attaché avanttout à la situation défavorable des enfants de laclasse ouvrière. Sous l’effetdes processus de démocrati-sation, on cherchait à créerune société qui soit davan-tage fondée sur des principesd’égalité et de méritocratie.La position sociale ne devaitdépendre que des compé-tences individuelles ; l’ori-gine socioéconomique nedevait jouer à cet égardaucun rôle et l’éducation sevoyait donc accorder uneplace de premier plan.
À partir des années1980, un grand nombred’enfants d’immigrés, dontles parents étaient des tra-vailleurs « invités », desdemandeurs d’asile ou desréfugiés, ont afflué dans lesystème éducatif néerlandaisen provenance d’anciennes colonies 1. Il estapparu rapidement que ces enfants étaient très enretard sur les autres dans un certain nombre dematières. Si leurs résultats se sont un peu amélio-
rés au cours des dernières décennies, les enfantsd’immigrés sont toujours à la traîne par rapportaux enfants de la classe moyenne blanche.
L’attention considérable attachée au sort desenfants issus des minorités a en grande partie relé-gué au second plan les problèmes des enfants desmilieux populaires, alors que la situation de cesenfants aux Pays-Bas demeure très préoccupante.
nous avons fait allusion dans cette brèveintroduction aux deux optiques différentes qui sont
au cœur des politiques néer-landaises visant à luttercontre les inégalités dansl’éducation : le milieu socialet l’origine ethnique. Ilconvient de noter que la dis-tinction entre ces deuxoptiques est plutôt d’ordreanalytique puisqu’elles sonttrès fortement liées aux Pays-Bas (et dans la plupart desautres pays) : de nombreusesminorités ethniques (ouimmigrées) viennent d’unmilieu social inférieur. nousprésenterons dans les para-graphes suivants un aperçuhistorique plus détaillé despolitiques visant ces groupes.nous nous préoccuperons del’enseignement primaire desenfants de 4 à 12 ans et de
l’enseignement secondaire des enfants de 12 à 18ans puisque ces groupes d’âge ont été les princi-pales cibles des politiques mises en œuvre2. nousconsidérerons ensuite les effets de ces politiques.
Geert Driessen est directeur derecherche à l’Institut des sciencessociales appliquées (ITS) de l’universitéRadboud de nimègue (Pays-Bas). Sesprincipaux domaines de recherche sontnotamment l’éducation en relation avecl’origine ethnique/raciale, le milieusocial et le sexe/genre, l’implication desparents, le choix de l’école, les écolesconfessionnelles, les écoles islamiques,et l’intégration et la ségrégation. Courriel : [email protected]. Web :www.geertriessen.nl.Hetty Dekkers est professeur de sociolo-gie de l’éducation et doyen de la Facultédes sciences sociales de l’université Rad-boud de nimègue (Pays-Bas). Sesrecherches portent principalement surl’inégalité des cursus des élèves selonleur milieu socioculturel. Elle s’intéresseen particulier aux différences entre lessexes en ce qui concerne le choix desmatières et des filières de l’enseignementsecondaire et supérieur, ainsi qu’à laquestion de l’abandon scolaire précoce. Courriel : [email protected].
Politiques néerlandaises contreles inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation
TRIBUNE LIBRE
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page505
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
Puis nous décrirons brièvement la situation danslaquelle se trouvent actuellement les différentsgroupes d’élèves en matière d’éducation. Enfin,nous situerons les expériences néerlandaises dansun contexte international plus large et dégageronsun certain nombre de conclusions.
Politiques visant à remédier aux désavantages dans l’éducation
Programmes de compensation et d’activation
Le point de départ des politiques publiquesvisant à lutter contre l’inégalité des chances dans ledomaine de l’éducation a été d’élaborer et d’éva-luer un certain nombre de programmes de com-pensation. Inspirés d’expériences menées auxÉtats-unis, ces programmes ont été entrepris dansles années 1960 et 1970 dans quelques grandesvilles en direction des enfants néerlandais desouche appartenant aux milieux populaires. Ils’agissait d’améliorer l’accès de ces enfants àl’éducation grâce à des programmes spécifiques, laformation des enseignants, une plus grande impli-cation des parents et l’établissement de relationsplus étroites entre le voisinage et l’école. Les pro-grammes d’activation familiale portaient surdivers aspects de l’éducation des enfants et sur lescomportements problématiques au sein de lafamille. Les programmes de stimulation éducativeportaient sur les caractéristiques cognitives etsocio-affectives des enfants ainsi que sur leursrésultats scolaires en langue et en mathématiques.Sur le plan théorique, la mise en œuvre des pro-grammes de compensation était justifiée par leparadigme du dénuement culturel et l’hypothèsedu déficit, selon lesquels les enfants des milieuxpopulaires grandissent dans des familles et descommunautés qui présentent des carences en cequi concerne l’emploi du langage formel, le capi-tal culturel et éducatif et le mode d’apprentissage.ni le foyer familial ni le milieu dans lesquelsvivent ces enfants ne transmettent les attitudes etles compétences culturelles nécessaires pour letype de caractéristiques d’apprentissage scolairecorrespondant à l’optique de la classe moyenne(Banks, 1993).
Politiques de stimulation éducative
malgré des résultats décevants, ces initiatives,d’abord locales, ont été étendues avec l’adoptionen 1974 d’une politique nationale de stimulationéducative (Onderwijsstimuleringsbeleid). C’estainsi qu’on a commencé à centraliser les poli-tiques afin de remédier aux obstacles rencontréspar les enfants des milieux populaires en accor-dant aux établissements d’enseignement desmoyens supplémentaires. Des liens de coopéra-tion ont été établis entre les écoles, les servicesd’orientation scolaire et d’autres institutionspubliques sociales (comme les bibliothèques oules services de garde d’enfants). Cette réorienta-tion partielle coïncidait avec les conclusions de larecherche sur « l’efficacité de l’école ». Les pro-pos négatifs de Basil Bernstein (1970), pour qui« l’éducation ne peut pas combler les déficiencesde la société », et de James Coleman (1966),déclarant qu’il n’existe pas de relation entre lesmoyens des établissements scolaires et les résul-tats de leurs élèves, ont été réévalués, de nouvellesrecherches ayant montré que, plutôt que des fac-teurs macrosociologiques (les moyens des écoles),des facteurs microsociaux, comme le climat sco-laire, le comportement des enseignants, l’attitudedes élèves et les relations institutionnelles, pou-vaient influer sur les résultats d’apprentissage desélèves (mortimore, 1997). L’évaluation de la poli-tique de stimulation éducative portait uniquementsur les modalités de sa mise en œuvre et non surses effets concrets. on a conclu que l’instructionétait de nature plutôt traditionnelle, avec un accentplus marqué sur les objectifs socio-affectifs et desattentes moindres en ce qui concerne des résultatsen langue et en mathématiques. L’implication desparents n’était pas prioritaire, ni la coopérationavec les services sociaux (mulder, 1996).
Politique en faveur des minorités culturelles
Dans les années 1980, l’afflux d’enfants d’immi-grés dans le système éducatif néerlandais a pris del’ampleur, en particulier dans les grandes villes. Ils’agissait notamment d’enfants d’immigrésvenant des ex-colonies néerlandaises (comme le
506
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page506
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Suriname ou les Antilles néerlandaises) et d’en-fants de travailleurs « invités » originaires depays méditerranéens (comme l’Espagne, l’Italie,la Turquie ou le maroc). La première catégorieétait quelque peu familiarisée avec la langue et laculture néerlandaises. une grande partie de laseconde catégorie n’était guère ou pas instruite etne parlait pas le néerlandais. une troisième caté-gorie d’immigrés, très hétérogène, consistait endes demandeurs d’asile/réfugiés d’Europe del’Est, d’Afrique et du moyen-orient. L’instruc-tion en néerlandais posant de gros problèmespour beaucoup des enfants de ces immigrés, legouvernement a accordé aux écoles des moyenssupplémentaires dans le cadre de sa politique enfaveur des minorités culturelles (Culturele Min-derhedenbeleid).
Cette politique se caractérisait par unedouble stratégie. Certains immigrés étaient cen-sés rentrer dans leur pays d’origine tandis qued’autres étaient appelés à rester, ce qui signifiaitque le gouvernement devait mener simultané-ment une politique de retour et une politique d’in-sertion. L’un des moyens d’y parvenir a été cequ’on a appelé « l’instruction dans la languematernelle » (Onderwijs in Eigen Taal en Cul-tuur), qui était une forme d’enseignementbilingue. Les élèves recevaient un enseignementen turc ou en arabe, par exemple (Driessen,2005), mais apprenaient aussi le néerlandais endeuxième langue (Nederlands als Tweede Taal).D’un point de vue théorique, on justifiait cou-ramment l’utilisation de deux langues en invo-quant les hypothèses de Cummins (1991) surl’interdépendance et le seuil de compétence lan-gagière. Schématiquement, ces deux hypothèsespartent du principe que le niveau de compétenceen néerlandais dépend du niveau de compétencedans la langue maternelle et qu’un certain niveaudoit être atteint dans les deux langues avant quele bilinguisme puisse être considéré comme ayantdes effets positifs sur le développement cognitif.un autre outil employé était « l’éducation inter-culturelle » (Intercultureel Onderwijs), dont lebut est d’apprendre à tous les enfants, qu’ilssoient ou non issus de minorités, à exploiter lessimilitudes et les différences découlant de l’ori-gine ethnique et culturelle. L’éducation inter-
culturelle était en partie une réaction au raisonne-ment sous-tendant l’hypothèse du déficit évoquéeplus haut. Les adversaires de cette hypothèse ontformulé l’hypothèse de la différence, selonlaquelle les élèves appartenant à des familles àfaible revenu (souvent des enfants d’immigrés)connaissaient de graves conflits culturels àl’école, mais que ce soi-disant déficit recouvraitdes différences culturelles riches et variées et nonun déficit en tant que tel (nasir et Hand, 2006).L’approche théorique de l’éducation intercultu-relle était fondée sur une analyse de la manièredont la diversité ethnique et culturelle se mani-feste dans l’éducation, ainsi que des interventionspossibles et des éventuelles contraintes (Leemanet Reid, 2006).
Politique de l’éducation prioritaire
Dans les années qui ont suivi, on était de plusen plus convaincu que les problèmes rencontréspar les enfants d’immigrés dans le domaine del’éducation étaient les mêmes que ceux queconnaissaient les enfants néerlandais des milieuxpopulaires. Les politiques mises en œuvre, cepen-dant, étaient fragmentées, incohérentes et élabo-rées en grande partie au coup par coup. Pourpréserver les mesures en place, instaurer une cer-taine continuité et simplifier les réglementations,les politiques de stimulation éducative et les poli-tiques en faveur des minorités culturelles ont étéintégrées en 1985 dans une politique de l’éduca-tion prioritaire (Onderwijsvoorrangsbeleid). Afinde réduire les difficultés scolaires dues à des fac-teurs économiques, sociaux et culturels, cette poli-tique comportait deux volets : un volet « zonesd’éducation prioritaire » et un volet « personnel »(Driessen et Dekkers, 1997). Dans le cadre du premier volet (« zones d’éducation
prioritaire »), les établissements d’enseignementprimaire et secondaire et des institutions socialescomme les bibliothèques et les garderies d’en-fants devaient coopérer. Les interventions consis-taient notamment en des activités préscolairesavec les parents ; des projets de promotion de lalecture ; des projets d’aide aux devoirs ; et desprojets d’orientation pour les élèves absentéisteset les enfants qui quittent le système scolaire pré-cocement.
Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 507
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page507
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
Au titre du volet « personnel », les écoles primaires ontbénéficié d’enseignants supplémentaires en fonc-tion de l’origine socioéconomique et ethnique desélèves. un facteur de pondération a été attribuéaux différentes catégories d’enfants pour l’alloca-tion des ressources : 1,90 pour les enfants issusde minorités ethniques ; 1,25 pour les enfantsnéerlandais des milieux populaires ; et 1 pour lesenfants non désavantagés. De ce fait, une écoledont les élèves étaient en majorité issus de mino-rités ethniques avait pratiquement deux fois plusd’enseignants qu’une école accueillant majoritai-rement des enfants non défavorisés. Le volet« personnel » se résumait au fond en une poli-tique en faveur des minorités ethniques. Lesécoles étaient libres de décider de l’emploi desressources qui leur étaient allouées mais la plu-part s’en sont servi pour réduire les effectifs desclasses afin que les enseignants puissent consa-crer aux élèves une attention plus individualisée.
Dans l’enseignement secondaire, les enfants issus desminorités pouvaient bénéficier temporairementde certains moyens au titre de programmes visantà faciliter leur insertion dans le système éducatifnéerlandais. Parmi ces moyens, il y avait l’orga-nisation de cours de néerlandais deuxième langueet de cours dits de « transition internationale »,qui étaient des cours spécialement destinés à pré-parer les enfants d’immigrés à intégrer le systèmeéducatif néerlandais ordinaire.
Politique locale visant à lutter contre lesdésavantages dans l’éducation
Au début des années 1990, l’intérêt portéaux problèmes éducatifs des enfants néerlandaisde souche appartenant aux milieux populairess’est affaibli encore davantage. Toute l’attentionétait désormais accordée à la situation des enfantsdes minorités. Il était évident que les politiquesmises en œuvre en faveur des minorités ne pro-duisaient pas les effets souhaités. malgréquelques progrès, les résultats des enfants issusde minorités ethniques restaient très inférieurs àceux des enfants néerlandais de souche.
Pour corriger les désavantages constatésdans l’éducation, de nouvelles dispositions ontété adoptées afin d’établir une planification plusrigoureuse des activités et permettre ainsi auxétablissements scolaires de se concentrer surleurs activités de base. Avec le Cadre de politique
national (Landelijk Beleidskader), les buts géné-raux de la politique de l’éducation prioritaire ontpris la forme d’objectifs plus précis. Le principalobjectif pour la période 1993-1997 était d’amé-liorer les résultats en langue et en mathématiquesdes enfants des différents groupes cibles. Lesautres objectifs consistaient à améliorer l’accueilinitial à l’école, à réduire l’absentéisme et à évi-ter que les élèves quittent le système scolaire sansdiplôme. Il fallait également se préoccuper de lapériode préscolaire.
Du point de vue administratif et organisation-nel, l’idée était que les autorités centrales laisse-raient désormais aux autorités locales, c’est-à-direaux municipalités, le soin de s’occuper des moda-lités pratiques de la lutte contre l’inégalité deschances en matière d’éducation. L’école était enoutre censée être mieux à même de s’acquitter desa tâche première lorsque des liens plus étroitsauraient été établis avec le contexte sociétal pluslarge. Et au niveau local, l’éducation pourrait plusfacilement trouver place dans une politique inté-grée. Les maîtres mots de cette nouvelle approcheétaient : décentralisation, déréglementation etautonomie accrue. Les autorités centrales définis-sent uniquement le cadre général ; la planificationplus détaillée, la mise en œuvre et l’évaluation dela politique incombent ensuite aux autoritéslocales. on pensait qu’une stratégie intégrée,rationnelle et efficace n’était possible qu’au niveaulocal : les municipalités et les établissements d’en-seignement ont donc obtenu davantage d’autono-mie en ce qui concerne l’emploi des ressources etla définition de la politique à mener. En 1998, lapolitique de l’éducation prioritaire a été remplacéepar la politique de lutte contre les désavantageséducatifs au niveau local (Gemeentelijk Onderwij-sachterstandenbeleid). Des moyens financiers ontété attribués aux municipalités sous la forme d’unesomme forfaitaire. Les pouvoirs locaux devaientles utiliser conformément à un plan local prévu àcet effet. Et le plan local devait être fondé sur lesobjectifs fixés par le Cadre d’action national etindiquer uniquement la manière dont les établisse-ments devaient affecter les ressources qui leurétaient allouées par la municipalité.
Pour la période 1998-2002, un nouveauCadre d’action national a été défini. Il reprenait
508
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page508
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

bon nombre des objectifs du cadre précédent, quiprévoyait notamment d’accorder une attentionparticulière à la période préscolaire et au début dela scolarité, à la maîtrise de la langue néerlan-daise, à l’orientation vers l’éducation spéciale età la réduction du taux d’abandon scolaire. Lerecensement et le suivi des initiatives localesconstituaient un nouvel objectif.
Politique d’accès à l’éducation
En 2000, une évaluation critique de la poli-tique de lutte contre les désavantages éducatifs aparu (Tweede Kamer, 2000). L’efficacité de cettepolitique et la situation des établissementsaccueillant beaucoup d’élèves issus de groupesdéfavorisés étaient problématiques. À partir decette évaluation, de nouvelles idées ont été adop-tées dans le cadre de la politique de lutte contreles désavantages éducatifs au niveau local, quiont donné lieu à ce que l’on a appelé la politiqued’accès à l’éducation (Onderwijskansenbeleid).Cette politique visait un groupe choisi de quelque400 écoles désavantagées. une de ses principalescaractéristiques était la personnalisation. La poli-tique locale contre les désavantages éducatifsportait essentiellement sur des projets entreprispar la communauté et n’avait que très peu de liensavec les activités de base menées par les établis-sements mêmes. La politique d’accès à l’éduca-tion demandait en revanche aux écoles deprésenter d’abord un problème, qui était analyséen fonction de leur situation particulière et desbesoins spécifiques des élèves et des parents.À partir de ces informations, les écoles définis-saient les changements durables qu’il était sou-haitable d’apporter à l’aide, si possible, d’uneapproche intégrée (Ledoux et al., 2005). Cetteévolution a marqué une première étape vers unedécentralisation encore plus poussée de la poli-tique et des responsabilités concernant la luttecontre l’inégalité des chances dans l’éducation.
Pour la période 2002-2006, le Cadre d’actionnational a été encore amélioré et précisé. Il s’agis-sait d’établir des objectifs quantifiables pour l’édu-cation préscolaire et l’éducation de la petiteenfance, le soutien de la carrière scolaire, la pré-vention de l’abandon, la maîtrise du néerlandais etl’adoption d’une politique d’accès à l’éducation.
Initiatives récentes
En 2004, une note d’orientation intitulée« Éducation, intégration et citoyenneté » (Onder-wijs, integratie en burgerschap) (moCW, 2004) aparu. Elle annonçait une révision des rôles del’école, de la communauté et du pouvoir centraldans la lutte contre l’inégalité des chances dansl’éducation. En fait, la tendance à la décentralisa-tion se poursuivait, accompagnée d’un renforce-ment de l’autonomie et d’un élargissement duchamp d’action. La responsabilité de la luttecontre les désavantages dans l’enseignement pri-maire et secondaire revenait principalement auxétablissements d’enseignement (c’est-à-dire àl’administration des écoles), sans que la munici-palité intervienne. Les pouvoirs locaux conti-nuaient néanmoins de jouer un rôle importantdans l’éducation préscolaire et l’éducation de lapetite enfance. Le volet « personnel » a d’autrepart été révisé. Jusque-là, les établissements pri-maires obtenaient des enseignants supplémen-taires en fonction de l’appartenance sociale deleurs élèves, c’est-à-dire de l’instruction, de laprofession et de l’origine ethnique des parents.À partir de 2006, l’allocation de ressources sup-plémentaires sur la base de l’origine ethnique aprogressivement été supprimée, l’instruction desparents étant le seul critère retenu.
Des classes de transition ont à nouveau étémises en place. Ces classes sont destinées auximmigrés et aux néerlandais de souche qui, àcause de retards linguistiques, n’ont pas de bonsrésultats scolaires et dont on pense qu’ils serontcapables, après avoir suivi une formation linguis-tique intensive, de poursuivre avec succès leurcursus dans l’enseignement ordinaire. La forma-tion linguistique dispensée dure un an, durantlequel les élèves sont placés dans des classes àpart (mulder et al., 2008). La politique consistantà allouer des moyens supplémentaires aux écolessecondaires accueillant beaucoup d’élèves issusdes minorités a également été adaptée de tellesorte que les ressources aillent aux établissementsdes quartiers défavorisés. Cette évolution marqueune réorientation stratégique notable, la politiquespéciale en faveur des minorités ethniques laissantplace à une politique générale visant l’ensemble
Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 509
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page509
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
des enfants défavorisés. Dans la pratique, cepen-dant, il n’y aura pas de grand changement puisquele groupe cible reste le même. La note d’orienta-tion susmentionnée s’attachait également auxquestions d’intégration, de ségrégation et denationalité. Elle évoquait notamment les effetsnégatifs, tant du point de vue du développementcognitif que du point de vue social, des « écolesnoires », ainsi qu’on les appelle (c’est-à-dire lesécoles accueillant une forte proportion d’élèvesissus de minorités) (Driessen, 2002), ainsi que lesproblèmes posés par les écoles islamiques (merryet Driessen, 2005). Elle recommandait égalementd’accorder davantage d’attention à la nationalitéet à la cohérence sociale.
Efficacité des politiques
Introduction
Dans les paragraphes qui précèdent, nousavons considéré en passant les effets de certainesdes politiques mises en œuvre. nous nous intéres-serons de plus près dans cette section à l’efficacitédes politiques menées. En 2000, le Bureau géné-ral néerlandais de l’évaluation a fait le bilan despolitiques visant à remédier à l’inégalité deschances dans l’éducation (Algemene Rekenka-mer, 2000). Eu égard au coût annuel de ces poli-tiques – soit près d’un demi-milliard d’euros, lesconclusions de cette évaluation sont absolumentnégatives. D’après le Bureau de l’évaluation, lesinformations disponibles ne permettent guèred’apprécier l’application et l’utilité réelle des poli-tiques mises en œuvre. Aucun résultat durable n’aété obtenu ; les handicaps éducatifs n’ont pas sen-siblement diminué. Cela tient peut-être en partieau fait que les objectifs des politiques n’ont étéque rarement traduits en termes mesurables, d’oùla difficulté de déterminer s’ils ont ou non étéatteints. En outre, les liens entre la politique desti-née à lutter contre les désavantages dans l’éduca-tion et les autres interventions (par exemplel’éducation spéciale, la réduction des effectifsdans les classes, la restructuration de l’enseigne-ment secondaire) ne sont pas clairs du tout. on nepeut donc pas attribuer nettement les effets obser-vés à des interventions particulières (cf. Rijk-schroeff et al., 2005).
Il est frappant de constater la faiblesse duvolume de la recherche consacrée à l’efficacitédes politiques 3. nous essaierons dans le para-graphe suivant d’apprécier l’efficacité de la poli-tique mise en œuvre pour remédier à l’inégalitédes chances dans l’éducation, c’est-à-dire de voirsi cette politique a contribué à la réalisation desobjectifs fixés. on analysera à cet effet la poli-tique menée en général, puis on en examineracertains aspects.
Politique de l’éducation prioritaire
Pour évaluer la politique de l’éducationprioritaire (PEP), plusieurs études de cohorte degrande ampleur ont été effectuées dans les éta-blissements d’enseignement primaire et secon-daire, complétées par des études approfondies.Les études portaient sur 700 écoles primaires,avec 35 000 élèves, et 400 écoles secondairesavec 20 000 élèves. Les résultats de l’ensembledes études effectuées au cours de la période 1988-1992 peuvent se résumer comme suit. La perfor-mance des enfants néerlandais des milieuxpopulaires et des enfants issus des minoritésaccusait encore plus de retard par rapport à celledes enfants non défavorisés.
Les données font état de la stagnation et dela médiocrité des résultats en langue et en mathé-matiques de ces enfants en général, et des enfantsturcs et marocains en particulier. La performancedes enfants scolarisés dans des zones d’éducationprioritaire s’est toutefois davantage améliorée,dans l’ensemble, que celle des enfants scolarisésdans des établissements qui ne bénéficiaient quedes ressources supplémentaires accordées dans lecadre de la politique de l’éducation prioritaire oupas de ressources supplémentaires du tout. Lesenfants issus des minorités scolarisés dans leszones d’éducation prioritaire ont rattrapé leurspairs, même si cette évolution n’a été que limitéeet que, dans son étude d’évaluation, mulder(1996) l’attribue non pas à la PEP mais au simplefait que les enfants concernés se trouvaient auxPays-Bas depuis plus longtemps.
En revanche, les élèves issus des minoritésdans le secondaire obtenaient de plus mauvaisrésultats que les élèves néerlandais. Ils avaient en
510
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page510
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

outre davantage tendance à être orientés vers unniveau inférieur de l’enseignement secondaire, àredoubler ou à quitter l’école sans diplôme (cf.Dekkers et Driessen, 1997). D’un point de vuethéorique, on peut en conclure que la PEP a defaçon générale été une approche axée davantagesur des facteurs macrosociaux (structure, budget)que sur des facteurs plus liés au processus éduca-tif. L’échec de la PEP a en outre été en partie attri-bué au fait que les ressources supplémentairesallouées n’étaient pas spécifiquement prévuesdans le budget à cet effet et visaient souvent àcompenser des coupes budgétaires antérieures.
Instruction dans la langue maternelle
Dans le cadre de la PEP, tous les enfants de tra-vailleurs immigrés avaient droit à recevoir uneinstruction dans leur langue maternelle (ILm) jus-qu’à 5 heures par semaine. L’enseignement étaitdispensé aux élèves dans la langue officielle dupays d’origine de leurs parents. En 1995, 91 %des enfants qui suivaient cet enseignement étaientd’origine turque ou marocaine et représentaient73 % du nombre total d’enfants turcs et maro-cains scolarisés dans le primaire.
L’ILm a fait l’objet, dès son adoption, de trèsvives controverses. Jusqu’en 1991, elle comportaitun élément linguistique et un élément culturel.Puis l’élément culturel a été abandonné. Pendant lapremière moitié des années 1970, l’ILm était offi-ciellement conçue comme une mesure temporairevisant à aider les enfants d’immigrés à se réinté-grer dans leur pays d’origine lorsqu’ils y retourne-raient. Vers 1980, le gouvernement a abandonnél’idée du caractère temporaire de cette mesureainsi que l’objectif de réintégration et a pris acte dela présence permanente de ces immigrés auxPays-Bas. Les fonctions de l’ILm ont alors été lessuivantes : contribuer à favoriser une image de soipositive ; réduire l’écart entre le milieu scolaire etle milieu familial ; et contribuer à l’éducationinterculturelle. En d’autres termes, la mission del’ILm était l’acculturation des minorités dans lasociété néerlandaise et la réalisation des objectifséducatifs plus généraux concernant les minorités.L’ILm était de plus en plus envisagée comme unmoyen d’améliorer les résultats scolaires des
enfants d’immigrés et était plus ou moins considé-rée comme un élément de la PEP. En 1991, le Gou-vernement néerlandais a déclaré que le principalobjectif de l’ILm était de faciliter l’apprentissagedu néerlandais et la maîtrise d’autres matières. Sonbut était surtout d’assurer l’accès à la culture d’ori-gine des enfants et de développer ainsi chez eux laconfiance en soi. Le ministère de l’Éducation adistingué deux types d’ILm. Dans les premièresannées de l’enseignement, l’ILm visait à faciliterl’apprentissage du néerlandais par les enfantsd’immigrés. Dans les classes suivantes, elle avaitune fonction autonome en tant que forme d’éduca-tion culturelle. Après le 11 septembre, le climatpolitique aux Pays-Bas a radicalement changé. Lesappels en faveur de l’assimilation, par opposition àla préservation des langues et des cultures minori-taires, ont gagné en influence et inclus à partirde 2004, l’abolition de l’ILm. Selon le ministère del’Éducation, les évaluations réalisées ont montréque l’ILm n’avait pas eu d’effets manifestes et ilfallait désormais privilégier l’apprentissage dunéerlandais.
Bien que l’ILm ait été dispensée pendant unetrentaine d’années, les évaluations sont très peunombreuses. Le bien-fondé des méthodes derecherche utilisées fait en outre largement débat.Les effets de la participation effective à l’ILm nesont absolument pas clairs, qu’il s’agisse desrésultats en langue maternelle ou des résultats del’éducation ordinaire. Pour beaucoup d’enfants,le niveau de compétence acquis en langue mater-nelle du fait de l’ILm s’avère médiocre, encoreque le niveau général de maîtrise orale et écritedu turc soit, par exemple, assez bon. La maîtrisede l’arabe marocain (c’est-à-dire de la langueorale dialectale) par les enfants marocains qui ontbénéficié de l’ILm s’avère limitée et leur maîtrisede l’arabe classique (c’est-à-dire de la langueécrite formelle) pratiquement nulle. Des évalua-tions longitudinales montrent en outre que leniveau de compétence dans la langue maternellese détériore avec le temps (Driessen, 2005).
Le fait qu’aucun effet ou presque de l’ILm
n’ait pu être prouvé n’a pas surpris grand monde.Les hypothèses de seuil et d’interdépendance surlesquelles se fonde cette politique sont en fait trèsabstraites et n’ont pas vraiment été décrites en
Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 511
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page511
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
termes opérationnels. De façon générale, l’hypo-thèse d’interdépendance est trop axée sur lescompétences linguistiques, ignorant le dévelop-pement cognitif général ainsi que les conditionssocioéconomiques et pédagogiques familiales.mise à part cette critique, il n’a pas été possiblede montrer que les hypothèses d’interdépendanceétaient bonnes ou mauvaises pour au moins lamoitié des enfants d’immigrés aux Pays-Basparce que la langue maternelle officielle qu’ilsont dû apprendre dans le cadre de l’ILm n’était pasleur langue maternelle mais une langue étrangère(une troisième, voire une quatrième langue). Pourtous les enfants marocains, par exemple, lalangue de l’ILm était l’arabe classique, qui ne pré-sente guère ou pas du tout de ressemblance avecla langue qu’ils parlent à la maison, en l’occur-rence l’un des nombreux dialectes arabes maro-cains ou variantes berbères.
Éducation interculturelle
Dans le contexte néerlandais, le terme d’éducationinterculturelle (EIC) a été utilisé par le gouverne-ment à partir du début des années 1980. L’EIC estun terme générique et l’on ne sait pas très bien cequ’il recouvre exactement bien qu’il semble êtreplus ou moins l’équivalent de ce qu’on appelle auRoyaume-uni, aux États-unis et en Australiel’« éducation multiculturelle » (Leeman et Reid,2006). Selon le Gouvernement néerlandais, l’EIC
est un important facteur d’acculturation, proces-sus bidirectionnel complexe consistant àapprendre à se connaître, à s’ouvrir à la culture del’autre ou aux aspects de cette culture et à s’ac-cepter et s’apprécier mutuellement. Le postulat debase est que les enfants grandissent aujourd’huidans une société multiculturelle et que ceci doitêtre expliqué dans des matières d’enseignementadaptées.
Pendant une brève période, on a égalementinsisté sur le développement d’une image de soipositive mais cet objectif a ensuite été attribué àl’ILm et l’EIC s’est vu assigner aux Pays-Bas lesobjectifs suivants : combattre et prévenir la stig-matisation, les stéréotypes, la discrimination etle racisme fondés sur les différences ethniquesou culturelles. Au fil des années, l’aspect de l’EIC
relatif à l’acquisition de connaissances a fait
l’objet d’une plus grande attention. Il s’agit d’ac-quérir non seulement des connaissances sur l’ori-gine, la situation et la culture de chacun de la partdes groupes autochtones et des minorités eth-niques, mais également des connaissances sur lamanière dont les valeurs, les normes, les cou-tumes et les circonstances influent sur le com-portement des individus. Des objectifs affectifset socio-psychologiques tels que le respect, l’ac-ceptation et l’image de soi ont été incorporésdans la politique mise en œuvre, de même qu’uncertain nombre d’objets cognitifs. L’EIC est éga-lement jugée utile pour lutter contre les inégali-tés structurelles alimentées par les préjugés et ladiscrimination ethniques.
Pour la mise en œuvre concrète de l’EIC, legouvernement prévoyait les outils et les moyenssuivants : l’information du public, la diffusiond’orientations et de brochures, des subventionspour la mise au point de ressources éducatives,des stages de formation en cours d’emploi pourles enseignants et la prise en compte impérativedans la formation des enseignants des problèmesposés par le fait de vivre dans une société mul-tiethnique et multiculturelle. En outre, certainsétablissements d’enseignement ont expérimentéla conception de l’EIC avant de servir de modèlepour d’autres établissements.
Seules quelques études ont été réalisées surla conception de l’EIC et pratiquement aucunerecherche n’a été consacrée aux effets de l’EIC surles enfants eux-mêmes. Dès 1985, Fase et Van denBerg (1985) ont fait observer que, bien que leministère de l’Éducation se soit dit satisfait de lapolitique de l’EIC, il n’y avait en fait guère demotif de satisfaction. Leurs recherches ont montréque le degré de priorité accordé à l’EIC par lesécoles était faible. on constatait en outre autant depréjugés et de comportements discriminatoiresdans les établissements disant appliquer l’EIC quedans les autres. Dans une autre étude paruequelques années plus tard, Fase et al., (1990) ontajouté que les résultats des expériences menéesdans les écoles n’étaient pas très encourageants. Iln’y avait non seulement pas d’objectifs opération-nels ni de suggestions précises pour la pratiquequotidienne mais pas non plus d’exigence de qua-lité. En outre, la modification des objectifs trèsgénéraux intervenue au cours du temps n’avait
512
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page512
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

pratiquement eu aucun effet sur l’application de lapolitique. Des études empiriques portant sur l’en-seignement primaire et secondaire ont montré quel’EIC n’avait fait l’objet que d’un intérêt trèslimité : seules 10 % des écoles ont dit mettre enpratique l’EIC ; 30 à 40 % prévoyaient de le faireou s’apprêtaient à le faire ; entre 50 et 60 % ontdéclaré ne rien faire au titre de l’EIC. Ces résultatsétaient très surprenants étant donné que cela fai-sait déjà plusieurs années que l’EIC était une com-posante obligatoire de l’enseignement primaire.Au sein des établissements, le flou régnait et desdivergences de vue majeures apparaissaient quantà la valeur et à la nature exacte de l’EIC. L’attitudeet les efforts d’un petit groupe d’enseignants sesont avérés déterminants et, lorsque l’EIC a vérita-blement démarré, c’est surtout dans les écoles oùse trouvaient un nombre considérable d’enfantsd’immigrés. D’après Van der Werf (1995), lespolitiques scolaires comportent parfois un élé-ment interculturel, mais cela se traduit rarementpar des projets précis ou des matériels pédago-giques. En classe, l’EIC prend généralement laforme de brèves discussions qui portent sur cer-taines coutumes culturelles et ne sortent pas ducadre du programme. À l’aide d’un schéma cri-tique du multiculturalisme, Leeman et Reid(2006) ont évalué une récente tentative faite par leministère de l’Éducation pour relancer l’EIC. Ilsont constaté que les enseignants avaient aban-donné le culturalisme et les particularités eth-niques au profit des différences individuelles liéesà l’âge, à la religion et au mode de vie. Les ensei-gnants considèrent principalement l’EIC commeune éducation à la tolérance et un moyen de pro-mouvoir l’empathie et des compétences enmatière de communication. Cet accent mis surl’individu ne tient pas compte des aspects poli-tiques ni du déséquilibre des rapports de forcedans la société.
Éducation préscolaire et éducation de la petite enfance
L’un des constats de la recherche est que lesélèves défavorisés, et notamment les élèvesappartenant à des minorités ethniques, sont sou-vent déjà considérablement à la traîne lorsqu’ilscommencent l’école primaire et n’arrivent tout
simplement pas à rattraper leur retard au coursdes années. Les interventions visant à remédier àl’inégalité des chances dans l’éducation sontdonc de plus en plus axées sur les premièresannées de la scolarité et la période préscolaire.L’idée est qu’un grand nombre des éléments quipréparent les enfants des classes socioécono-miques moyennes et supérieures à la scolaritésont absents du milieu familial des enfants appar-tenant aux minorités ethniques et aux milieuxpopulaires. Les aspects de l’éducation des enfantsqui présentent des similitudes avec l’instructionscolaire formelle sont particulièrement impor-tants. D’un point de vue théorique, le fait demettre l’accent sur les carences du milieu familialéquivaut à un retour remarquable à l’hypothèsedu déficit évoquée plus haut. Toutes sortes deprogrammes d’intervention dans la famille et lacommunauté ont donc été entrepris aux niveauxnational et local en faveur des enfants de 0 à7 ans. L’accent est mis sur le développement lin-guistique et cognitif des enfants et s’accompagneou non de la fourniture d’un appui éducatif auxparents. Les interventions sont souvent fondéessur des programmes et des stratégies de compen-sation tels que les programmes Head Start ouFollow Through aux États-unis. Dernièrement,une impulsion majeure a été donnée dans lesdomaines de l’éducation préscolaire et de l’édu-cation de la petite enfance. Il s’agit notamment defaire en sorte que 50 % des enfants défavorisésbénéficient d’un programme d’interventionen 2006 alors que ce pourcentage n’était que de25 % en 2003. on privilégie les interventionsdans la communauté, deux programmes étant jus-qu’à présent jugés particulièrement efficaces : leprogramme Pyramide (Piramide) et le pro-gramme Kaléidoscope (Kaleidoscoop).
Les différents programmes donnent lieu àdes controverses considérables et, d’un point devue méthodologique, des questions se posentquant aux effets particuliers pouvant être attri-bués à tel ou tel programme ou intervention. Laprincipale conclusion à ce jour est que les effetsconstatés sont très limités et finissent en généralpar disparaître complètement. Certains signesmontrent toutefois que la situation est en train dechanger et que quelques effets positifs peuvent semanifester durablement.
Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 513
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page513
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
un petit nombre d’études portant sur la fré-quentation des garderies d’enfants ont montréque les garderies avaient une influence positivesur le développement cognitif et social desenfants, encore que la qualité des services fournisdans les garderies semble jouer un rôle détermi-nant. D’autres études ont fait état d’une influencenégative, l’une des causes possibles étant l’écartentre le degré d’attention et de stimulation reçu àla maison et celui reçu dans la garderie (GeversDeynoot-Schaub et Riksen-Walraven, 2002 ;Leseman, 2002 ; Singer, 1993). Très peu derecherches ont été menées sur les effets de la fré-quentation préscolaire aux Pays-Bas mais,d’après ce que l’on sait, la qualité des pro-grammes et du personnel semble être détermi-nante pour le développement des enfants.Diverses études ont été réalisées sur les effets decertains programmes. Elles utilisent générale-ment un petit échantillon et une méthode expéri-mentale ou parfois longitudinale pour comparerun groupe d’enfants ayant bénéficié d’un pro-gramme avec un groupe témoin n’en ayant pasbénéficié. Les résultats d’une série de pro-grammes parents-enfants se sont avérés déce-vants. Dans le cadre d’une étude nationale àgrande échelle réalisée récemment, Driessen(2004) a examiné de façon transversale et longi-tudinale les effets combinés et séparés des pro-grammes de stimulation mis en œuvre dans lesgarderies, dans un cadre préscolaire et à la mai-son et dans des centres, sans constater le moindreeffet. D’autres études effectuées par Tesser etIedema (2001) concluent que les programmesparents-enfants ont surtout des effets positifspour les parents participants mais n’en ont pas surle développement cognitif des enfants. Des éva-luations des programmes intégrés Pyramide etKaléidoscope font état de quelques rares effetspositifs sur le développement cognitif et linguis-tique des enfants concernés mais, encore une fois,ces effets disparaissent progressivement et diffè-rent selon les domaines et les programmes (Veen,Roeleveld et Leseman, 2000). Très peu de résul-tats significatifs ont été constatés au niveau dudéveloppement socio-affectif mais il ne faut pasoublier à cet égard que les effets positifs peuventdépendre d’un ensemble particulier de condi-tions, comme la durée et l’intensité de l’interven-
tion, l’effort consenti par le personnel et la conti-nuité du programme avec la prise en charge etl’éducation ultérieures des enfants.
Résultats scolaires et performances des enfants défavorisés
nous avons examiné dans les sections précé-dentes les résultats de quelques-unes des compo-santes de la politique néerlandaise menée pourremédier à l’inégalité des chances dans l’éduca-tion. on peut affirmer de façon générale qu’il estpratiquement impossible de démontrer que lesrésultats observés sont effectivement la consé-quence des politiques menées. nous présenteronsdans le paragraphe suivant un aperçu des donnéesles plus récentes concernant les résultats scolairesdes deux groupes cibles de la politique, à savoirles enfants des minorités ethniques et les enfantsdes milieux populaires.
Le tableau 1 présente les résultats de testsnormalisés évaluant les compétences en langue eten mathématiques (préparatoires), en fonction del’origine socio-ethnique des élèves. La partiesupérieure du tableau présente le pourcentagemoyen de réponses correctes pour les élèves deniveau préscolaire (deuxième année ; 6 ans), tan-dis que la partie inférieure du tableau présente lepourcentage moyen de réponses correctes pourles élèves se trouvant en dernière année de pri-maire (huitième année ; 12 ans).
Comme le montrent clairement les chiffres dutableau, il existe de grandes différences entre lesdeux groupes d’enfants défavorisés et le grouped’enfants non défavorisés. Les enfants néerlandaisdes milieux populaires ont des résultats nettementinférieurs à ceux du groupe non défavorisé ; lesenfants des minorités ethniques enregistrent lesrésultats les plus faibles 4. Il ressort du tableau quela situation en dernière année de primaire est com-parable à celle qui existe au jardin d’enfants. Entermes relatifs, il semble qu’il n’y ait pas beaucoupd’évolution au cours des six années d’enseigne-ment primaire. Ces résultats correspondent auxconclusions de Driessen (1996), qui a montré queles enfants des minorités turque et marocaineavaient près de deux ans de retard en langue parrapport aux enfants non défavorisés en début descolarité. Ces écarts ne se réduisent pas dans les
514
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page514
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

dernières années du primaire. Les lacunes enmathématiques correspondent généralement à lamoitié d’une année scolaire.
on dispose également d’informations sur lenombre d’élèves qui sont en retard en ayantredoublé une ou deux fois. En dernière année deprimaire, ces élèves sont donc plus âgés que lesautres. Les pourcentages correspondants sontprésentés dans le tableau 2.
Les chiffres montrent que plus de 40 % desélèves issus des minorités accusent un retardeffectif. C’est pratiquement trois fois plus que la
proportion concernant les élèves non défavorisés.Le pourcentage des élèves néerlandais desmilieux populaires accusant un retard est deuxfois plus élevé que le pourcentage correspondantdes élèves non défavorisés.
La dernière année de l’enseignement pri-maire, une recommandation est adressée auxélèves concernant leur orientation dans le secon-daire. Le tableau 3 présente un aperçu de cesrecommandations, et plus précisément la propor-tion des élèves à qui il est recommandé de suivreun enseignement professionnel ou supérieur.
Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 515
origine socio-ethnique
Élèves néerlandaisAnnée matière Élèves non des milieux Élèves issus des Etadéfavorisés populaires minorités ethniques
2 Langue 82 % 76 % 66 % 0,38*mathématiques 75 % 70 % 64 % 0,28*
8 Langue 83 % 78 % 72 % 0,38*mathématiques 63 % 53 % 51 % 0,27*
Tableau 1. Pourcentage moyen de réponses correctes dans les tests de langue et de mathématiques(préparatoires) pour les élèves du primaire, selon l’origine socio-ethnique (années scolaire 2004-2205).
* p < 0,001Source : Étude PRImA (Driessen, Van Langen et Vierke, 2006).
origine socio-ethnique
Élèves non défavorisés Élèves néerlandais Élèves issus Etades milieux populaires de minorités ethniques
15 % 27 % 43 % 0,24*
Tableau 2. Pourcentage des élèves accusant un retard dans le primaire, selon l’origine socio-ethnique (annéescolaire 2004-2005).
* p < 0,001Source : Étude PRImA (Driessen, Van Langen et Vierke, 2006).
origine socio-ethnique
Élèves non défavorisés Élèves néerlandais Élèves issus Etades milieux populaires de minorités ethniques
37 % 14 % 13 % 0,23*
Tableau 3. Pourcentage d’élèves orientés vers un enseignement professionnel ou supérieur, par origine socio-ethnique (année scolaire 2004-2005).
* p < 0,001Source : Étude PRImA (Driessen, Van Langen et Vierke, 2006).
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page515
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
Le tableau 4 montre que les deux groupesd’enfants défavorisés sont beaucoup moins sou-vent orientés vers un enseignement secondaireplus poussé que les enfants non défavorisés. Enfait, près de trois fois plus d’élèves non défavori-sés que d’élèves défavorisés, qu’ils soient demilieux populaires ou appartiennent aux minori-tés, sont orientés ainsi.
Pour donner une idée du niveau d’étudessecondaires suivi par les différents groupes eth-niques, le tableau 4 présente le pourcentaged’élèves ayant passé avec succès les examensfinals des différents cycles de l’enseignementsecondaire.
Il ressort du tableau 4 que les trois quarts desélèves des minorités non occidentales ont achevéles deux premiers niveaux de l’enseignementsecondaire, contre près de 60 % pour les néer-landais de souche. En ce qui concerne le niveausupérieur de l’enseignement secondaire, seuls10 % des élèves des minorités non occidentales
ont passé avec succès les examens finals contreprès de 20 % pour les néerlandais de souche.
Lorsqu’on interprète les données du tableau4, il ne faut pas perdre de vue que les élèves desminorités non occidentales sont surreprésentésdans le groupe d’élèves qui abandonnent l’écoleet ne passent aucun examen final (cf. Dekkers etDriessen, 1997). Le tableau 5 présente deschiffres récents sur le taux précoce d’abandonscolaire.
Le pourcentage des enfants des minoritésethniques ayant abandonné l’école est près detrois fois supérieur à celui des néerlandais desouche. Pour les enfants dont les parents ontarrêté leurs études au niveau du primaire, la pro-portion est près de quatre fois supérieure quepour les enfants dont les parents ont fait desétudes supérieures. Les deux facteurs, à savoirl’origine ethnique et l’instruction des parents,sont fortement corrélés : l’analyse montre que,lorsque les effets de l’instruction des parents sont
516
origine socio-ethnique
niveau d’enseignement secondaire minorités minorités néerlandaisnon occidentales occidentales de souche
Élémentaire ou professionnelsupérieur 47 % 27 % 30 %
Professionnel théorique ou mixte 27 % 26 % 28 %
Spécialisé préparatoire 16 % 25 % 24 %
Pré-universitaire 10 % 22 % 18 %
Total 100 % 100 % 100 %
Tableau 4. niveau d’études atteint dans l’enseignement secondaire, par origine ethnique (année scolaire 2003-2004).
Source : mares (2004).
origine ethnique niveau d’instruction des parents
néerlandais minorités Études Études Étudesde souche ethniques primaires secondaires supérieures
6 % 17 % 15 % 10 % 4 %
Tableau 5. Pourcentage d’élèves quittant l’école sans diplôme au cours des trois premières années del’enseignement secondaire, selon l’origine ethnique et le niveau d’instruction des parents (années scolaires1999-2000/2001-2002).
Source : Ven der Steeg et Webbink (2006).
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page516
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

éliminés, les différences entre élèves néerlandaisde souche et élèves issus de minorités ethniquesdisparaissent presque complètement.
Une perspective internationale
La situation des enfants défavorisés en matièred’éducation pose généralement des problèmesmajeurs. mauvais résultats scolaires, arrêt fréquentdes études, absentéisme, problèmes de disciplineet abandon de l’école sans diplôme : ce ne sont quequelques indicateurs de cursus scolaires probléma-tiques qui augurent mal d’une bonne insertion dansla société. Bien que l’on considère ici la situationaux Pays-Bas, on peut évidemment faire des paral-lèles avec d’autres pays, même si le problème esttraité par des politiques et des pratiques diverses,qui varient en fonction des conditions politiques etinstitutionnelles et des structures socioécono-miques plus larges (Day, Van Veen et Walraven,1997 ; EumC, 2004 ; Eurydice, 2000).
Aux États-unis, par exemple, il existedepuis le milieu des années 1960 plusieurs pro-grammes de compensation et d’enrichissement,tels que Head Start, Follow Through et Title One(adapté en 2002 par la loi No Child Left Behind(Aucun enfant laissé pour compte). Ces pro-grammes varient considérablement par leursmodalités d’application en fonction de la situa-tion locale. Ils visent tous en dernier ressort àaméliorer l’accès à l’éducation des enfantspauvres, handicapés, délaissés, délinquants,immigrés ou indiens-américains. L’une des prin-cipales formes d’assistance consiste à attribuerune aide financière supplémentaire. Dans les éta-blissements scolaires, on met en place des coursde rattrapage en langue et en arithmétique (dansle cadre de programmes dits « de démarrage »)ainsi que des projets destinés à l’ensemble del’établissement et prévoyant le recrutement d’en-seignants spécialisés et d’assistants. La plupartdes enseignants recrutés dans le cadre deTitle One servent cependant à réduire l’effectifdes classes. un autre moyen de remédier aux han-dicaps dans le domaine de l’éducation est de pré-voir des programmes bilingues pour les enfantsappartenant aux minorités linguistiques. mais cesprogrammes sont très controversés et des
mesures ont été prises pour supprimer les dispo-sitions relatives à l’enseignement dans la languematernelle.
En France, il existe depuis 1981, des ZEP
(Zones d’éducation prioritaire). Dans les ZEP, desprofessionnels et des bénévoles venant d’horizonsdivers – enseignants, travailleurs sociaux, agentsde santé et policiers – travaillent ensemble. Lesétablissements scolaires classés ZEP bénéficient depersonnel et de ressources supplémentaires. Lescritères d’attribution sont la profession desparents, la taille de la famille, la proportiond’élèves étrangers et le taux de chômage. Les acti-vités mises en œuvre comprennent la promotionde la lecture, l’éducation à la citoyenneté et le sou-tien scolaire. Des mesures particulières sont prisesen direction des minorités ethniques, avec notam-ment des classes d’accueil pour les nouveaux arri-vants dans le primaire et le secondaire et unenseignement dans la langue maternelle pour cer-tains groupes ethniques et linguistiques.
En Allemagne, il n’existe pas de réglementa-tions nationales particulières en faveur desenfants défavorisés, mais il y a des projets locauxd’enseignement dans la langue maternelle pourles enfants d’immigrés. Des classes de soutienspéciales sont également mises en place pour lesnouveaux arrivants, principalement axées surl’acquisition de la langue allemande. Le modèled’intégration – les élèves allemands et les élèvesimmigrés sont regroupés ensemble dans desclasses normales – est prédominant. Le pro-gramme d’enseignement des écoles allemandesn’a pas été modifié pour tenir compte des besoinsparticuliers des enfants d’immigrés ; les écolesallemandes sont en règle générale monolingues.
En Belgique (Flandre), une politique d’édu-cation prioritaire vise depuis 1991 à améliorerl’accès à l’éducation des enfants issus des mino-rités ethniques. Les établissements qui ont mis aupoint un plan d’action approuvé et qui comptentun certain nombre d’élèves du groupe cible ontdroit à bénéficier de personnel supplémentaire.Font partie du groupe cible les élèves dont lagrand-mère est immigrée et dont la mère a unniveau d’instruction faible ou moyen. une atten-tion particulière doit être accordée à l’apprentis-sage du néerlandais comme deuxième langue (le
Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 517
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page517
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
néerlandais est la langue officielle de la Flandre) età la réduction de l’écart entre le milieu scolaire etle milieu familial. Depuis 1995, les écoles mater-nelles et primaires comptant un grand nombred’enfants appartenant à des familles socialementdéfavorisées se sont également vu accorder desenseignants supplémentaires. À côté de la poli-tique d’éducation prioritaire, d’autres dispositionsprévoient une éducation interculturelle et un ensei-gnement dans la langue maternelle.
Si le Royaume-Uni a eu par le passé ses zonesd’éducation prioritaires, depuis l’adoption en 1989du Programme national d’enseignement, qui s’ap-plique à tous les enfants, il n’existe plus de dispo-sitions en faveur des enfants à risque au niveaunational. Le règlement des problèmes particuliersincombe désormais à l’administration locale,c’est-à-dire aux autorités éducatives locales, auxétablissements d’enseignement et aux enseignants.Pour les enfants des minorités rencontrant des pro-blèmes linguistiques, le Département de l’éduca-tion et de l’emploi prévoit un certain nombre dedispositions, transmises par les autorités éduca-tives locales, qui sont chargées de l’élaboration etde la diffusion des projets scolaires, dans leurrégion. Les activités prévues concernent notam-ment l’enseignement de l’anglais deuxièmelangue, la fourniture d’un appui complémentaireaux écoles ordinaires et l’amélioration des contactsentre l’école, les parents et le quartier. Depuis1998, les écoles ont pu unir leurs forces au sein deszones d’action éducative, dont le but est d’amélio-rer l’éducation dans les zones socialement défavo-risées. D’autres mesures en faveur des minoritésethniques consistent à dispenser un enseignementmulticulturel/antiraciste et un enseignementbilingue ou dans la langue maternelle. Ces derniersservices ne sont cependant plus financés par l’État.En 2003, un programme intitulé « Every Childmatters (ECm) » (Chaque enfant compte) a étélancé, représentant une nouvelle approche du bien-être des enfants et des adolescents, de la naissancejusqu’à l’âge de 19 ans. Il s’agit de veiller à ce quechaque enfant, quelle que soit son origine ou sasituation, bénéficie de l’appui dont il a besoin pourêtre en bonne santé et en sécurité, profiter de la vieet réussir, apporter une contribution positive et par-venir au bien-être économique. Les organisations
s’occupant de fournir des services aux enfants – del’hôpital à l’école en passant par la police et lesgroupes bénévoles – vont donc s’associer selon denouvelles modalités, échanger des informations etcoopérer afin de protéger les enfants et les adoles-cents et de les aider à réaliser leurs aspirations.L’un des premiers programmes mis en œuvre, SureStart, vise à assurer pour tous des services de soinset d’éducation de la petite enfance, à améliorerla santé et le développement affectif des enfantset à offrir aux parents diverses formes d’appui(ECm, 2008).
Les programmes en faveur des enfants et desjeunes défavorisés prévoient souvent une formeou une autre d’évaluation, mais la portée et laqualité des évaluations diffèrent énormément. unvolume important de la recherche porte sur lamise en œuvre des programmes, aboutissant sou-vent à la conclusion que les programmes sont unsuccès alors que leur efficacité réelle n’est jamaisévaluée (cf. Day et al., 1997 ; Walraven et Broe-khof, 1998). La plupart des études sont axées surdes données qualitatives et sur de petits projetslocaux. Les États-unis et les Pays-Bas sont appa-remment les seuls pays où des évaluations longi-tudinales de portée nationale ont été effectuées àgrande échelle, encore que de telles études ontaussi récemment été entreprises en Belgique.
De façon générale, on peut affirmer sans setromper que les résultats des études d’évaluationsont souvent inconsistants et que, si des effetspositifs sont constatés, ils sont assez limités et semanifestent seulement au cours des premièresannées suivant l’application du « traitement »puis disparaissent progressivement. Dans certainscas, cependant, des effets durables ont pu êtreobservés. Les évaluations des programmes menésaux États-unis, par exemple, ont d’abord montréque l’influence du milieu familial des enfantsl’emportait largement sur celle des programmesd’enseignement et que les programmes de com-pensation étaient voués à l’échec et étaient de faitinefficaces. ultérieurement, des études plus finesont indiqué que les programmes de compensationavaient des effets positifs, mais que ceux-ciétaient limités et ne se manifestaient qu’au coursdes premières années (par exemple, Day et al.,1997 ; Karsten, 2006).
518
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page518
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Conclusions
Cela fait maintenant plus de 40 ans que lesPays-Bas adoptent et mettent en œuvre des poli-tiques pour remédier à l’inégalité des chancesdans l’éducation découlant du milieu social et del’origine ethnique des élèves. Deux évolutionsimportantes peuvent être observées : l’uneconcerne la spécificité de la politique (politiqueciblée par opposition à politique générale ;groupes cibles) et l’autre la répartition des res-ponsabilités (entre les autorités centrales et lesautorités locales). S’agissant de la première évo-lution, l’accent initialement placé sur les élèvesnéerlandais de souche défavorisés a été réorientédes groupes d’immigrés « anciens » (travailleursimmigrés et ex-colonies) et « nouveaux »(demandeurs d’asile/réfugiés) vers les élèvesdéfavorisés en général. S’agissant de la secondeévolution, on est passé d’une politique locale àune politique centrale avant de connaître un nou-veau mouvement de décentralisation, qui estmême partiellement allé temporairement, jus-qu’au au niveau de l’école. malgré les milliardsd’euros investis et tous les efforts déployés, cettepolitique a donné des résultats décevants. L’ana-lyse des données les plus récentes montre que leretard des enfants ayant des parents peu instruitsissus des minorités est encore assez important,tandis que le retard des enfants dont les parentsviennent de milieux populaires non minoritairesest légèrement moindre mais encore considé-rable. En cela, la situation néerlandaise ne diffèreguère de celle d’autres pays (EumC, 2004 ; Gil-born et mirza, 2000 ; Karsten, 2006 ; Van Langenet Dekkers, 2001). La bonne nouvelle est que, cesdernières années, la situation des enfants desminorités s’est légèrement améliorée. Enrevanche, la situation des enfants néerlandais desouche appartenant aux milieux populaires s’estdétériorée (mulder et al., 2005).
Selon nous, le constat selon lequel la poli-tique visant à remédier à l’inégalité des chancesdans l’éducation n’a guère ou pas d’effet peuts’expliquer en partie par la politique elle-même eten partie par la mise en œuvre de cette politiquedans la pratique éducative. La politique poursui-vie n’a pas une fonction adéquate, n’est pas suffi-
samment ancrée dans la théorie, n’est pas expli-cite et est rarement traduite en termes opération-nels concrets et donc mesurables. Il est rare quedes ressources financières aient été expressémentprévues à cet effet et l’on ne sait donc pas trèsbien à quoi ont servi les fonds dépensés (Alge-mene Rekenkamer, 2001). En outre, la politiquemenée semble résulter de compromis politiquesincessants et, au gré des gouvernements en place,est assez chaotique (mulder, 1996). Par ailleurs,les résultats des recherches qui ont été entreprisesdans les années 1970 et se poursuivent jusqu’àaujourd’hui n’ont presque pas été pris en comptepour l’élaboration de nouvelles politiques : lesenseignements tirés n’ont pas été mis en pratique.Il est également possible que le fait qu’on n’aitpas constaté d’effets significatifs tient à lamanière dont les évaluations elles-mêmes ont étémenées. La méthode expérimentale n’est prati-quement jamais adoptée, d’où la difficulté deprouver clairement l’existence d’effets quel-conques.
on peut se demander ce qu’il en est desautres pays occidentaux. Si la situation histo-rique, démographique et socioéconomique despays ainsi que leur système éducatif présententdes différences marquées, les similitudes sontprobablement plus nombreuses que les diffé-rences. Beaucoup mettent en garde cependantcontre l’« emprunt » de politiques ; copier la poli-tique d’autres pays semble attrayant de primeabord mais risque fort de se traduire par des pra-tiques simplistes et de s’avérer inefficace (voir,par exemple, Leeman et Reid, 2006 ; Luciak,2006). Selon Levin (1997), chaque pays doittrouver sa voie propre. Cela étant, pour reveniraux deux évolutions évoquées plus haut, concer-nant respectivement la spécificité de la politiqueet la répartition des responsabilités, il est intéres-sant de se référer à deux débats récents.
En réaction à un article de Böcker et Thrän-hardt (2003), dans lequel les deux auteurs com-parent les résultats de la politique d’intégrationaux Pays-Bas et en Allemagne, Koopmans (2003)conclut qu’aux Pays-Bas les immigrés sont trèsen retard par rapport aux néerlandais non immi-grés dans les domaines de l’éducation, de l’em-ploi et du logement à cause d’une politique qui
Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 519
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page519
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers520
met l’accent sur l’adoption de mesures et de dis-positifs particuliers pour les immigrés (parexemple, un système de pondération), qui favo-rise la préservation de la langue, de la culture etde l’identité maternelles (avec notamment, l’ILm
et les écoles islamiques), et qui privilégie unestructuration politique des immigrés en fonctionde leur origine ethnique. Les politiques alle-mandes, en revanche, sont beaucoup plus restric-tives et monoculturelles. Pour Koopmans, si lesminorités ethniques sont moins bien intégrées surle plan socioculturel, et par conséquent socioéco-nomique, dans la société néerlandaise, c’est àcause de l’application de politiques ciblant cer-tains groupes. Böcker et Thränhardt ne sont pasd’accord et s’opposent à la conclusion selonlaquelle : (a) la situation des immigrés est moinsbonne aux Pays-Bas ; et (b) les différences derevenus peuvent être clairement attribuées à desdifférences de politiques et de pratiques. Ce débatmontre surtout qu’il est très risqué de comparerdes politiques, des pratiques et des effets d’unpays à l’autre.
Dans plusieurs pays, les notions de décen-tralisation, de déréglementation et d’autonomieaccrue (et de marchandisation) occupent uneplace importante dans la politique des pouvoirspublics. Aux Pays-Bas, le processus de décentra-lisation en est au stade de l’application. Il appar-tient dans une grande mesure aux municipalités etaux conseils d’administration des écoles de déter-
miner de quelle manière et jusqu’à quel pointcombattre les handicaps des élèves défavorisés.on ne connaîtra pas avant un certain temps lesrésultats de cette nouvelle politique. une analysecomparative internationale effectuée parVan Langen et Dekkers (2001) montre cependantqu’en accordant davantage d’autonomie aux éta-blissements d’enseignement, en permettant auxparents de choisir plus librement l’école de leursenfants, en fixant des objectifs éducatifs auniveau national et en publiant les résultats desdifférentes écoles, on aggrave la situation desenfants défavorisés. Au vu de ces conclusions,Van Langen et Dekkers ne sont guère optimistesquant à l’avenir des enfants défavorisés enmatière d’éducation.
Pour conclure, en dépit des nombreusesincertitudes concernant les effets possibles despolitiques éducatives, une question importanteest de savoir si la situation des enfants immigréset des enfants des milieux populaires aurait étépire si de telles politiques n’avaient pas été appli-quées. Le fait que l’on puisse encore parler d’in-égalités marquées en matière d’éducationprécisément pour ces enfants-là – qui semblent enpartie davantage être liées au groupe que releverde la méritocratie – laisse en tout cas penserqu’un surcroît d’attention devra encore leur êtreaccordé à l’avenir.
Traduit de l’anglais
Notes
1. Suivant la définition utilisée,la proportion d’immigrés aux Pays-Bas se situe entre 7 % et19 % de l’ensemble dela population néerlandaise,qui s’élève à 16,5 millionsd’habitants. L’application du critèredu « pays de naissance » en 2005a montré que les principauxgroupes de minorités ethniquesse répartissaient ainsi : Antillais(130 000), Surinamais (328 000),Turcs (358 000) et marocains(315 000). Les deux premiersgroupes sont composés d’immigrésdes anciennes colonies ; les deux
derniers groupes sontprincipalement des travailleursimmigrés arrivés dans les années1960 et dans le cadre des vaguesd’immigration ultérieures à des finsde regroupement familial. Le resteconstitue un groupe très hétérogènedu point de vue de la langue, dela culture et de la religion, composénotamment de travailleurs immigréset de demandeurs d’asile/réfugiés(cf. Guiraudon et al., 2005).
2. Pour une vue d’ensembledu système éducatif néerlandais, on se référera à nmECS (2005).
3. Par souci de clarté, on entendpar « effet » d’une politique touteconséquence de cette politique, etpar « efficacité » d’une politique,la mesure dans laquelle cettepolitique a contribué à la réalisationd’un objectif particulier (mulder,1996).
4. Eta est un coefficientde corrélation ; toutes lesdifférences dans les tableaux sontstatistiquement significativesà 0,1 % près (p<0,001).
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page520
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Politiques néerlandaises contre les inégalités socioéconomiques et ethniques dans l’éducation 521
Références
ALGEmEnE REKEnKAmER. 2001.BestrijdingOnderwijsachterstanden, La Haye,Algemene Rekenkamer.
BAnKS, J. 1993. “multiculturaleducation: Historical development,dimensions, and practice”, Reviewof Research in Education, 19, 3-49.
BERnSTEIn, B. 1970. “Educationcannot compensate for society”,New Society, 26, 344-347.
BÖCKER, A. ; THRänHARDT, D.2003. “Is het Duitseintegratiebeleid succesvoller, en zo ja, waarom?”,Migrantenstudies, 19(1), 33-44.
CoLEmAn, J. 1966. Equality ofEducational Opportunity,Washington, DC: uS Department ofHealth, Education, and Welfare,office of Education/nationalCenter for Education Statistics.
CummInS, J. 1991.“Interdependence of first – and second language proficiency in bilingual children”, in E. Bialystok (ed.), LanguageProcessing in Bilingual Children,Cambridge, Cambridge universityPress, 70-89.
DAY, C. ; VAn VEEn, D. ;WALRAVEn, G. 1997. Children and Youth at Risk and UrbanEducation. Research, Policy and Practice, Leuven/Apeldoorn:Garant.
DEKKERS, H. ; DRIESSEn, G. 1997.“An evaluation of the EducationalPriority Policy in relation to earlyschool leaving”, Studies inEducational Evaluation, 23(3),209-30.
DRIESSEn, G. 1996. “Detaalvaardigheid nederlands vanallochtone en autochtoneleerlingen. De ontwikkeling in hetbasisonderwijs in kaart gebracht”,Gramma/TTT – Tijdschrift voorTaalwetenschap, 5(1), 31-40.
DRIESSEn, G. 2002. “Schoolcomposition and achievement inprimary education: A large-scalemultilevel approach”, Studies inEducational Evaluation, 28(4),347-368.
DRIESSEn, G. 2004. “A large-scalelongitudinal study of theutilization and effects of earlychildhood education and care inthe netherlands”, Early ChildDevelopment and Care, 174(7/8),667-89.
DRIESSEn, G. 2005. “From cure tocurse: The rise and fall of bilingualeducation programs in thenetherlands”, in AKI (ed.),The Effectiveness of BilingualSchool Programs for ImmigrantChildren, WZB Discussion Paper SP
IV 2005-601, Berlin,Wissenschaftszentrum Berlin fürSozialforschung, 77-107.
DRIESSEn, G. ; DEKKERS, H. 1997.“Educational opportunities inthe netherlands. Policy, students’performance and issues”,International Review of Education,43(4), 299-315.
DRIESSEn, G. ; VAn LAnGEn, A. ;VIERKE, H. 2006. Basisonderwijs:Veldwerkverslag,Leerlinggegevens enOudervragenlijsten.Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Zesde Meting2004-2005, nijmegen, ITS.
ECm. 2008. Every Child Mattershttp://www.everychildmatters.gov.uk (6 novembre 2008).
EumC. 2004. Migrants, Minoritiesand Education, Luxembourg,office des publications officiellesdes communautés européennes.
EuYIDICE. 2000. Key Topics inEducation in Europe,Luxembourg, officedes publications officiellesdes communautés européennes.
FASE, W. ; VAn DEn BERG, G.1985. Theorie en Praktijk van
Intercultureel Onderwijs, La Haye,SVo.
FASE, W. ; KoLE, S. ; VAn
PARIDon, C. ; VLuG, V. 1990. Vorm Geven aan IntercultureelOnderwijs, De Lier, ABC.
GEVERS DEYnooT-SCHAuB, m. ;RIKSEn-WALRAVEn, m. 2002.« Kwaliteit onder druk:De kwaliteit van opvang innederlandse kinderdagverblijvenin 1995 en 2001 », Pedagogiek,22, 109-124.
GILLBoRn, D. ; mIRZA, H. 2000.Educational Inequality. MappingRace, Class and Gender, Londres,oFSTED.
GuIRAuDon, V. ; PHALET, K. ;TER WAL, J. 2005. “monitoringethnic minorities in thenetherlands”, International SocialScience Journal, 57(183), 75-87.
KARSTEn, S. 2006. “Policies fordisadvantaged children underscrunity: The Dutch policycompared with policies in France,England, Flanders and the uSA”,Comparative Education, 42(2),261-82.
KARSTEn, S. ; mEIJnEn, W. 2005.Leergeld. Sociaal-democratischeOnderwijspolitiek in een Tijd vanNieuwe Verschillen, Amsterdam,mets & Schilt uitgevers.
KooPmAnS, R. 2003. « uitvluchtenkan niet meer… Een repliek opBöcker en Thränhardt »,Migrantenstudies, 19(1), 45-56.
LEDouX, G. ; oVERmAAT, m. ;BooGAARD, m. ; FELIX, C. ;TRIESSCHEIn, B. 2005.Onderwijskansen Bekeken.De Stand van Zaken in hetOnderwijskansenbeleid,Amsterdam, SCo-KohnstammInstituut.
LEEmAn, Y. ; REID, C. 2006.multi/intercultural education inAustralia and the netherlands,Compare, 36(1), 57-72.
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page521
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S

Geert Driessen, Hetty Dekkers
LESEmAn, P. 2002. EarlyChildhood Education and Carefor Children from Low-Incomeor Minority Backgrounds, Paris,oCDE.
LEVIn, B. 1997. « The lessonsof international educationreform », Journal of EducationPolicy, 12(4), 253-266.
LuCIAK, m. 2006. “minorityschooling and interculturaleducation: A comparison of recentdevelopments in the old and newEu-member states”, InterculturalEducation, 17(1), 73-80.
mARES, A. (dir.). 2004. JaarboekOnderwijs in Cijfers 2005. Feitenen Cijfers over het Onderwijs inNederland tot November 2004,Deventer, Kluwer/Heerlen, CBS.
mERRY, m. ; DRIESSEn, G. 2005.“Islamic schools in three westerncountries: Policy and procedure”,Comparative Education, 41(4),411-432.
moRTImoRE, P. 1997. “Caneffective schools compensatefor society?”, in A. Halsey,H. Lauder, P. Brown, A. Wells,(eds.), Education. Culture,Economy, and Society,oxford/new York, oxforduniversity Press, 476-487.
moCW, 2004. Onderwijs, Integratieen Burgerschap, La Haye,ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Science.
muLDER, L. 1996. Meer Voorrang,Minder Achterstand? HetOnderwijsvoorrangsbeleidGetoetst, nijmegen, ITS.
muLDER, L. ; RoELEVELD, J. ; VAn DER VEEn, I. ; VIERKE, H.2005. Onderwijsachterstandentussen 1988 en 2002:Ontwikkelingen in Basis –en Voortgezet Onderwijs,nijmegen, ITS.
muLDER, L. ; VAn DER HoEVEn,A. ; VIERKE, H. ; LEDouX, G. ; VAn DER VEEn, I. ; ouD, W. ; VAn DAALEn, m. ; RoELEVELD, J.2008. Inrichting en Effecten vanSchakelklassen. Resultaten van hetEvaluatieonderzoekSchakelklassen in het Schooljaar2006/2007, nijmegen, ITS.
nASIR, n. ; HAnD, V. 2006.“Exploring socioculturalperspectives on race, culture, andlearning”, Review of Education,76(4), 449-475.
nmecs, 2005. The EducationSystem in the Netherlands 2005,La Haye, ministère de l’Éducation,de la Culture et de la Sciencedes Pays-Bas. http://www.minocw.nl/documenten/eurydice_en.pdf (15 juin 2007).
RIJKSCHRoEFF, R. ; TEn DAm, G. ;DuYVEnDAK, J. ; DE GRuIJTER,m. ; PELS, T. 2005. “Educationalpolicies on migrants andminorities in the netherlands:Success or failure?”, Journal ofEducation Policy, 20(4), 417-435.
SInGER, E. 1993. Kinderopvang:Goed of Slecht? EenLiteratuurstudie naar de Effectenvan Kinderopvang, utrecht, SWP.
TESSER, P. ; IEDEmA, J. 2001.Rapportage Minderheden 2001.Deel I Vorderingen op School, Den Haag, SCP.
TWEEDE KAmER. 2000. AanpakOnderwijsachterstanden.Bestrijding vanOnderwijsachterstanden, ‘s-Gravenhage, Sdu.
VAn DER STEEG, m. ; WEBBInK, D.2006. Voortijdig Schoolverlaten inNederland: Omvang, Beleid enResultaten, La Haye, CPB.
VAn DER WERF, m. 1995.The Educational Priority Policyin the Netherlands. Content,Implementation and Outcomes,La Haye, SVo.
VAn LAnGEn, A. ; DEKKERS, H.2001. “Decentralisation andcombating educational exclusion”,Comparative Education, 37(3),367-384.
VEEn, A. ; RoELEVELD, J. ;LESEmAn, P. 2000. Evaluatie vanKaleidoscoop en Piramide.Eindrapportage, Amsterdam, SCo-Kohnstamm Instituut.
WALRAVEn, G. ; BRoEKHoF, K.(dir.). 1998. An InternationalComparative Perspective onChildren and Youth at Risk,Leuven/Apeldoorn: Garant.
522
01 Intérieur (369-604):- 22/03/13 17:34 Page522
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 81
.205
.139
.249
- 1
4/11
/201
6 17
h47.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 81.205.139.249 - 14/11/2016 17h47. © E
RE
S