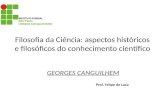François Dagognet. « À l’École de La Matière » • Entretiens, Matière, Médecine,...
-
Upload
pollyana-duarte -
Category
Documents
-
view
51 -
download
0
Transcript of François Dagognet. « À l’École de La Matière » • Entretiens, Matière, Médecine,...

Accueil › Les idées › Entretiens › François Dagognet. « À l’école de la matière »
DOSSIER À RELIRE: LES 10 GRANDS ENTRETIENS DE 2013
43
François Dagognet. « À l’école de
la matière »
© Manuel Braun pour PM
Philosophe, médecin, épistémologue, élève de Bachelard et de
Canguilhem, François Dagognet s’est consacré à la réhabilitation de la
matière. De l’industrie à l’art contemporain, de la chimie organique à la
neuropsychiatrie, son œuvre sans équivalent arpente inlassablement de
très nombreux champs du savoir.
Publié dans
Tags
Matière, Médecine, Écologie, Objet, Canguilhem, Bachelard, Dagognet
24/04/2013
n°
69

1924
1949
1958
1960
1965
1971
1985
François Dagognet en 7
dates
Naissance à Langres
Reçu à l’agrégation de
philosophie
Docteur en médecine
Enseigne à Lyon au
lycée Ampère, puis à
l’université Lyon-3
Publie son premier
ouvrage, sur Gaston
Bachelard
Préside le jury de
l’agrégation de
philosophie
Nommé professeur de
philosophie à la
Sorbonne
« Il y a une
anorexie
intellectuelle
chez certains
philosophes »
À deux heures de Paris et à quelques kilomètres de Vézelay, Avallon est une petite ville bourguignonneceinte de remparts médiévaux. François Dagognet y habite hors les murs, loin du centre, dans unemaison d’allure rurale. Ce philosophe né à Langres, la ville de Diderot, récuse ce qui, à première vue,pourrait résumer son parcours!: un projet encyclopédique. Après un cursus universitaire en philosophie,il cherche très vite dans les sciences sa nourriture conceptuelle. Dans une époque de séparation dessavoirs, il promeut sans relâche les approches transversales, pluridisciplinaires. Sa pensée graviteautour d’un centre qui évolue sans cesse!: le concept de matière dont il explore la richesse. PourFrançois Dagognet, qui se définit comme « matériologue » et non comme matérialiste, le dualisme – quisépare l’âme et le corps – et le monisme – qui entend les unir – sont deux pièges qui ne permettent pasd’accompagner les sciences modernes dans leur évolution. L’intériorité ne peut se prendre comme objet,elle se scrute et s’analyse à partir de ses manifestations extérieures. Pour concevoir ce retournement dudedans en dehors, le médecin, le chimiste, l’artiste plasticien viennent en aide au philosophe. Dagognetausculte les objets comme un médecin ausculte un corps. Dans son œuvre, un sac en plastique ou unepoêle à frire réservent autant de surprises qu’un système nerveux. Strate après strate, se déploie unevision originale de l’objet, où l’on parle de face, de surface et d’interface pour échapper à la dualitéesprit-matière.
Vous avez vécu à Lyon, à Paris, mais aussi dans de petitesvilles, comme Langres, où vous êtes né, et Avallon, où je vousretrouve aujourd’hui…
François Dagognet": Le lieu du philosophe, à mon sens, c’est laville. Aujourd’hui, je dirais que c’est la grande ville car lesagglomérations comme Langres ou Avallon sont en train de dépériret sont en proie à une certaine dépression. Il faut une variété, uneabondance culturelle pour que le philosophe puisse vivre. C’est unequestion de seuil. Pensez à Descartes, à l’importance qu’a eue pourlui la très grande ville d’Amsterdam. La plupart des philosophes seméfient du grand nombre, alors qu’il apporte la richesse et ladiversité.
Votre parcours est unique en son genre. Vous êtes à la foisphilosophe et médecin, mais vous avez aussi étudié la chimie,la neurologie…
Je viens d’un milieu on ne peut plus modeste, sans accès à la culture. À 12 ans, j’ai passé mon certificatd’études, mais je n’ai pas pu aller au lycée. Des années plus tard, j’ai été admis dans une école privéecatholique à Dijon. Rétrospectivement, j’ai le sentiment d’années perdues, surtout pour les langues. J’aisouffert de ne pouvoir lire les auteurs étrangers ou anciens dans le texte. Les langues, si vous ne lesapprenez pas très jeune, c’est irrattrapable. C’est une question d’oreille, une question phonétique etphysiologique.
Ensuite, j’ai étudié la philosophie, j’ai passé Capes et agrégation. Mais quelque chose m’a sembléfrustrant dans le pur parcours universitaire. Il y a un échec sous-jacent dans le fait de consacrer sa vie àun auteur. Passer le reste de ses jours avec Helvétius ou Gassendi… cela risque de tourner à l’éruditionla plus pauvre et la plus minimale. J’ai tout de même engagé un travail de thèse sur Spinoza, mais lelong chemin de l’érudition et les échafaudages théoriques m’ont assez vite rebuté. J’ai eu hâte deretrouver la plénitude du réel. Pour échapper à l’impasse de la pure recherche en philosophie, j’ai passéun doctorat en médecine et je suis devenu neuropsychiatre.
Vous avez souvent dénoncé le mode de vie trop reclus desphilosophes. Au lieu du « Connais-toi toi-même » socratique,vous avez plusieurs fois proposé « Oublie-toi toi-même »comme maxime inaugurale de la philosophie.
Il y a une anorexie intellectuelle chez certains philosophes. Le moi nepeut pas être l’objet du moi. Ce qui m’intéresse n’est pas que vouspensiez, mais ce que vous pensez. La pensée de la pensée évacuele réel, dans un jeu ou un je qui perd sa substance. Le cogito appelle aussitôt l’objet, car il estl’incomplétude même…

«Le médecin
doit faire parler
une maladie qui
ne s’extériorise
pas forcément»
Et donc, pendant six ans, j’ai pratiqué comme neuropsychiatre en plus de ma vie universitaire. J’avais lamission d’évaluer des traumatismes psychiques du travail. De petites tâches assez peu rémunérées,mais c’était déjà une fenêtre sur le monde, une autre nourriture. Tout cela restait encore routinier,bureaucratique. Alors je me suis lancé dans la chimie organique, qui fut ma véritable passion. En chimie,vous comprenez vraiment ce qu’est la pluralité, la pluralité organisée. Vous le comprenez d’une façonque l’étude de la philosophie, toute seule, ne peut vous apporter.
Lorsque vous explorez un champ nouveau du savoir, êtes-vous dès le départ armé d’un conceptcentral ou restez-vous longtemps à l’affût de ce concept, dans son immanence"?
Je laisse venir le concept dans l’immanence. Je cherche un autre mode de pensée. Une nouvellediscipline, c’est l’espoir d’un renouveau théorique. Je travaille avec l’espoir d’une complétude réelle etnon pas fictive. Ce qui compte, comme disait Bachelard qui fut l’un de mes maîtres, c’est la ruptureépistémologique, c’est-à-dire le moment où l’on se délivre des connaissances accumulées et desdiscours antérieurs pour entrevoir quelque chose de nouveau.
Vous mettez l'accent sur le renouveau de la méthode plus que sur l'accumulation du savoir"?
Le nouveau permet de dépasser l’ancien. En tant que telle, la recherche encyclopédique est uneimpasse et même une pathologie de la pensée. Si vous me parlez d’une grande découverte en chimie,ce qui m’intéresse, plus que son contenu spécifique, c’est pourquoi elle a eu lieu. La découverte est néed’une détermination infime. Il y a aussi l’élément sociologique et de nombreuses causes accidentelles. Etparfois une découverte minime dans une science signifie l’émergence cachée d’une autre science.
Philosophe et médecin, vous dites qu’on doit considérer chaquemaladie, hors de tout dualisme âme-corps, comme un destin,une « courbure de l’être ».
Quand j’étudiais la psychiatrie, au début des années 1960, il y avaitun conflit entre les partisans de la pure chimie, avec les premiersneuroleptiques et antidépresseurs, et ceux qui personnalisaient lamaladie dans la tradition d’Hippocrate, ou même qui l’abordaient defaçon radicalement existentielle. On a un peu surmonté depuis, me semble-t-il, cette alternative. On acompris que si la chimie n’atteint que les symptômes, elle est souvent nécessaire, même si elle ne faitqu’apaiser le malade et le sortir de son isolement.
Ce qui m’a intéressé avant tout, c’est la façon dont on déchiffre la maladie. Car c’est dans la visibilitéqu’il faut définir l’acte médical majeur. La médecine n’a cessé de remplacer les symptômes indicatifsd’un malaise par des signes, des signes physiques, qui fondent vraiment le diagnostic, la vraieconnaissance. C’est au début du XIX siècle que s’instaure cette nouvelle relation au corps et à sonextériorité. À partir de Laennec et de l’invention de l’auscultation par stétho scope, vers 1820, un dedanscorporel trouble, incertain, trompeur, va être projeté au dehors, extériorisé et susceptible d’être lu.Pensez à Babinski, qui dans les années 1890, identifiait avec une grande précision les pathologies ducerveau à partir de l’excitation de la plante des pieds. Le médecin doit faire parler une maladie qui nes’extériorise pas forcément et qui excède cette extériorité.
Comment la fonction excède-t-elle sa localisation dans l’organe"?
Considérez la mémoire!: comme pour la maladie, nous percevons une extériorité… mais ce n’est pastout. Là-dessus, je crois que Bergson a toujours raison!: on ne peut pas localiser la mémoire dans lecerveau. La seule chose que l’on puisse y localiser, c’est la faculté de se rappeler, la motricité virtuelledu souvenir. Pour la motricité, on peut agir sur une zone précise du cerveau et exciter la fonction. Mais lamémoire comme telle ne se localise pas. Il vaudrait mieux dire qu’elle relève du corps tout entier, avecson environnement, dans la virtualité, dans le mouvement, l’interaction et la complexité. Le souvenir d’unfait passé est déjà déformé en cours de route, réarrangé, tant il subit d’influences. N’importe quelsouvenir est un moment privilégié, un instant original de l’individu. D’ailleurs, on ne se souvient que dece qui est en accord avec soi-même, là encore la mémoire est une « courbure de l’être ». Essayer desortir du dualisme : tel fut le sens de mon travail. Un processus sans fin, une résistance au penchant quenous avons pour le dualisme.
e

« Pour
s’intéresser aux
objets, il a fallu
une petite
révolution qui
fut industrielle
avant d’être
théorique »
« La santé, je la
définirai comme
ce qui n’est pas
définissable »
Vous aimez philosopher à partir d’un objet – la poêleantiadhésive, le sac en plastique… Y a-t-il d’abord une intuitionliée à la manipulation, au geste, que l’œil ne vous apporte pas"?
Le visuel privilégie la forme pure et non l’emploi. Pour s’intéresser audeux, il a fallu une petite révolution qui fut industrielle avant d’êtrethéorique, celle des arts ménagers, liés à l’industrie à partir de 1850.L’objet y déploie sa face opérationnelle en même tempsqu’esthétique, et ce début de fabrication en masse est un momenttrès important.
Vous avez aussi réhabilité la production de masse, la quantité…
La fabrication en série n’est pas quelque chose que je déplore. J’aime Francis Ponge, qui savait écrire àpartir d’un objet utilitaire et industriel, un cageot, du savon. Ses poèmes montrent l’esthétique del’ordinaire. J’aime aussi la formule d’Arman, qui dit « mille fois une orange, ce n’est pas une orange millefois ». Ça veut dire quoi!? Que mille fois une orange, ça n’a pas de sens, l’orange est perdue au milieudu tas. Alors qu’une orange mille fois, c’est la porte ouverte à de grandes transformations.
Plutôt que comme matérialiste, vous vous définissez comme « matériologue ». Pour vous, lamatière est infiniment complexe, intelligente…
La matière est un processus de métamorphose dont la technologie humaine est un moment. On est loinde la matière que le matérialiste tient pour un absolu inerte, statique et finalement barbare. Regardez lesmatériaux contemporains, qui connaissent tant de transformations. Ils sont flexibles. Il n’est rien en euxqui ne soit susceptible de changement. Nous vivons dans le mythe de la matière immuable, que démentsans cesse la production des matériaux. La matière est un autodépassement perpétuel. Je me suis misà son école. Avec la chimie organique, on crée des matériaux nouveaux, on vit dans la fête despropriétés miraculeuses qui se complètent. C’est le lieu privilégié de la transformation et donc de lacompréhension de ce qu’est la matière, à savoir quelque chose qui se transforme. Le matériologue, à safaçon, reconnaît une certaine sacralité là-dedans. Le moindre caillou est d’une richesse de donnéesinfinie. Sans parler de cette merveille qu’est le plastique, solide et souple en même temps...
La notion de nature a-t-elle un sens pour vous"?
Non, l’idée de nature nous voile le sens et la richesse de la matière. Elle est normative par définition. Lamatière évolutive du matériologue permet de supplanter la notion de nature. À moins de distinguer,comme le fait Spinoza, une nature naturante, c’est-à-dire une instance de production, et une naturenaturée, ce qui est produit. Plus que deus sive natura, « dieu c’est-à-dire la nature », je dirai deus sivemateria, « dieu c’est-à-dire la matière ». Avec l’accent mis sur deus, sur la dimension spirituelle de lamatière.
Mais peut-on penser la santé en dehors de la nature ?
Oui, justement, Georges Canguilhem avait distingué le normal et lenormatif. Le normal, c’est la conformité à une série de normes déjàétablies. La normativité, c’est le pouvoir de produire de nouvellesnormes. Contre le positivisme, Canguilhem montre que le vivant estrempli d’anomalies!: il en fabrique sans cesse, il réinvente sa santé,même si, bien sûr, il y a des limites à l’échelle de l’individu. On voit la maladie différemment. La santé, jela définirai comme ce qui n’est pas définissable.
On croit que la nature ne bouge pas, mais la notion de santé nous montre qu’elle bouge. Pour moi, il fauts’efforcer de tout repenser du côté de cette « nature naturante »… Faire pencher la balance de ce côté-là, tel a été le sens de mon travail.

« La matière
inquiète, par la
solitude qui en
émane. Et ma
démarche avait
aussi de quoi
inquiéter »
Qu’avez-vous cherché à atteindre à travers tant de domaines d’investigation"?
J’ai cherché à creuser la notion d’objet, aussi bien à travers le remède pharmaceutique, capable demodifier le corps, qu’à travers le déchet, avec ses ressources cachées, ou encore la peau. L’art, c’estaussi de l’objet, car vos idées doivent avant tout être montrées. Des plasticiens comme Dubuffet, Arman,Buren sont d’extraordinaires sauveteurs de la matière. Ils nous la montrent dans sa beauté, ils enanalysent les restes. Dans ma quête, les néo-objets, les matières plastiques ont été des alliés précieux.Je sais aussi que trop de directions peuvent mener à l’encyclopédisme, au mauvais sens du terme.
Pourquoi avons-nous tant de réticence à donner sa dignité au support et au déchet"?
Notre relation à l’excrément joue un rôle, bien sûr, c’est l’éclairage de Freud. Mais il faut surmonter cetterépulsion, car un examen plus approfondi de l’excrémentiel amène à voir ses richesses. L’aniline qu’ontrouve au fond des tuyaux, des tonneaux, a donné les couleurs artificielles les plus chatoyantes.Aujourd’hui, on arrive à collecter le plastique abandonné, le carton usagé. Tout est transformable, il nepeut plus y avoir de secteur de désaveu. Le travail du philosophe y est pour quelque chose, à côté decelui du scientifique. Tous deux sauvent la matière. Ils l’innocentent, quels que soient son stade ou saforme.
Où se situe la part du « propre » de l’humain, ce qui ne peut s’échanger"? En quoi l’humain ne seréduit-il pas entièrement à un objet"?
Ce qui caractérise l’objet c’est qu’il est seul. L’humain n’est pas seul, il a pour lui la communauté, oùl’inscription dans la société est première, structurante. Nous ne sommes pas seuls, et en cela nous nepouvons pas être réduits au statut de purs objets.
Que répondez-vous aux écologistes radicaux"? Ceux qui pensent qu’il n’y a pas d’issue dans ledéveloppement"?
J’avoue que c’est une faille chez moi. Bien sûr l’état de l’environnement, le niveau de la pollution sontpréoccupants. Mais la pensée écologiste de la nature ne me paraît pas féconde et trop chargéed’éléments affectifs, de considérations extérieures.
L’enthousiasme scientifique et technologique que vous avezconnu dans les années 1950-1960 n’a-t-il pas laissé place à ladéception et à la méfiance"?
Nous sommes sans doute dans une période de moindreeffervescence. Sans doute est-ce parce que tant d’immensesdécouvertes ont eu lieu dans la première moitié du XX siècle.Prenez Lwoff et Jacob en 1958!: ils découvrent le langage de lacellule. Qui aurait pu imaginer qu’une cellule produise un langage etlui obéisse!? L’effraction scientifique a eu lieu. Ensuite, on s’installededans, on exploite les conséquences, d’où cette impression deralentissement. Cela vaut pour la biologie mais aussi pour la physique ou la psychologie. Peut-être aussifaut-il sortir des premiers enthousiasmes un peu naïfs. Il y a quinze ans, le journal Le Monde a publiéune double page sur la mucoviscidose dont on venait d’isoler le gène et qu’on allait pouvoir soigner dansde brefs délais. Quinze années ont passé et l’on n’est toujours pas venu à bout de la mucoviscidose.
Que pensez-vous du clonage thérapeutique ou reproductif"?
L’avortement est-il devenu un fait de société acceptable!? La réponse est oui. Si vous acceptezl’avortement, vous ne pouvez pas refuser le clonage. L’avortement, c’est déjà la fin de la nature. Leclonage, même reproductif, est une étape supplémentaire. Lui fixer des bornes dans l’avenir n’a pas de
e

© Philo Éditions 2014. Tous droits réservés - À propos - Contact - Mentions légales - Plan du site - Crédits
William T. Vollmann. «Explorer les
frontières»
Daniel Kahneman. «Les gens sont
infiniment compliqués»
sens. Même si une part de moi-même, appelons-la « le vieil homme en moi », condamne telle ou tellepratique, la fin de la nature a toujours été mon horizon.
Vous plaidez pour la production en série, vous réhabilitez la marchandise. Mais le capitalisme demarché ne recèle-t-il aucun piège ?
J’ai beaucoup défendu le commerce, les échanges, que la plupart des philosophes n’aiment guère. Cequi me passionne, c’est cette équivalence en monnaie de toutes les marchandises. Je peux échangergrâce à l’équivalent monétaire. Un objet équivalent de tous les objets du monde, c’est une trouvailleincroyable, c’est le Christ du monde capitaliste. C’est une révolution sans précédent. Bien sûr, il y a lefétichisme de la marchandise, il y a la manipulation publicitaire, mais n’oublions pas que la victoire del’objet à travers l’échange permet à l’homme d’échapper aux systèmes qu’on lui impose.
Mais vous-même n’avez-vous pas échappé, comme universitaire, à la loi du commerce"?
Je me suis consacré à la transmission et j’ai été rémunéré. Ce qui est bien une façon de s’inscrire dansl’échange.
Avez-vous trouvé un apaisement au bout de cette étude de la matière"?
Non, pas un apaisement. La matière inquiète, de par la solitude qui en émane. Et ma démarche, un peuparadoxale, avait aussi forcément de quoi inquiéter. Mais c’était le seul chemin vraiment ouvert à partirdu moment où l’on avait chassé Platon et dans une certaine mesure Aristote, et où l’on s’éloignait du purcogito. Cet « oublie-toi toi-même dans la matière », ça nourrit, ça ne tranquillise pas. Mais selon moi,l’essentiel, pour être philosophe – et je ne suis pas sûr d’y être arrivé –, a été de traverser un milieu nonphilosophique.
Propos recueillis par PHILIPPE GARNIER
Ajouter un commentaire
L'œuvre de François Dagognet