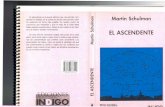Extraits du billet de blog « Craft Quality », par Sarah Schulman
Click here to load reader
Transcript of Extraits du billet de blog « Craft Quality », par Sarah Schulman

Extraits du billet de blog « Craft Quality », par Sarah Schulman
Publié le 6 août 2013 à l’adresse http://sarahschulman.com/craftquality/ Traduction La 27e Région
[…] InWithFor, l’organisation que j’ai cofondé, va bientôt disparaître, l’Helsinki Design Lab a fermé ses portes, et Think Public n’est plus vraiment actif, tout cela pour des raisons très différentes. La première génération de laboratoires de « design social » laisse désormais la place à la seconde génération s’implantant au Canada, à Singapour, aux Pays-Bas, en France. J’ai visité ces lieux pendant les deux derniers mois, j’ai écouté leurs visions, j’ai vu leurs méthodes, j’ai discuté à bâton rompu avec eux. Et il y a du nouveau, il y a eu un apprentissage des erreurs passées, il y a de l’ambition, de la curiosité, du travail – beaucoup de travail. Toutefois, il n’y a pas encore un langage ou une compréhension de ce que signifie « le bien », « la qualité » d’une action, d’un programme. Malgré les différences culturelles importantes entre ces pays, j’ai été frappée des similarités, et notamment de la reproduction des structures et modes de pensées anciens, et du discours désormais classique sur l’innovation et le design thinking […]. La 27e Région, basée à Paris, travaille sur un secteur public plus innovation et plus centré sur l’utilisateur […]. Leur théorie est de commencer par faire évoluer les fonctionnaires eux-mêmes et l’administration dans son ensemble pour engager des changements sociaux profonds. Après 5 ans à expérimenter autour de ces thèmes lors de programmes courts et intensifs en résidence ou des programmes immersifs de plus longue durée, ils souhaitent désormais posséder une approche plus systémique pour faire évoluer la culture du service public. Ils vont essayer de créer des formations pour les écoles de fonctionnaires, de toucher plus d’étudiants d’écoles de design et de déconstruire les notions d’évaluation, d’appel à projet ou encore de contrat. Ce qui est vraiment très rafraichissant dans le travail est leur réel sens de l’expérimentation […]. Toutefois, ce qui constituerait un « bon résultat » ne paraît pas encore tout à fait clair pour eux. L’équipe parle d’agents travaillant de manière plus collaborative, de manière moins top-down, s’épanouissant dans leur environnement de travail, mieux connectés à la sociétés… J’aimerais pousser les questionnements un peu plus loin : pourquoi est-ce qu’un service public plus collaboratif, plus bottom-up, plus connecté est-il nécessairement « bon » par essence ? Il n’y pas encore de réponses explicites à cette question. Un service public centré sur l’utilisateur et innovant contredit apparemment l’idée originelle d’un service public indépendant et bureaucratique. En effet, la bureaucratie a été conçue à l’origine comme un antidote à la corruption. Le service public se devait d’être hiérarchique, impersonnel, et surtout fiable. On l’oublie souvent : si le service public était construit comme cela, c’était pour permettre l’équité, à savoir la même considération pour tous : un processus standardisé, une réponse technique, documentée étape par étape, sans variabilité et sans caprices. L’approche centrée sur l’utilisateur propose une vision différente de l’équité, où la « même chose » n’est pas nécessairement ce qui est le plus juste. Toutefois, elle tombe déjà dans les travers de la pensée bureaucratique : elle est trop centrée sur la standardisation et les

réponses techniques. Certes les processus standardisés ne sont pas de la même nature, et les réponses techniques plus modernes, plus technologiques. Je n’affirme pas que les processus standardisés et les solutions techniques sont nécessairement problématiques, mais je défends en revanche qu’ils ne sont pas non plus bons par essence. Quand l’on est formé à appliqué un processus sans en comprendre le fondement, l’objet premier, en quoi est-ce qu’il permet de une situation plus équitable ou meilleure, on ne peut pas résoudre un problème radicalement : on est coincé dans ce système de pensée.
Prenons par exemple une problématique fonctionnelle comme l’évaluation. Bien entendu, on peut repenser toutes les procédures existantes. Aujourd’hui, l’évaluation arrive à la fin d’une expérimentation, s’appuie sur des focus groupes ou encore des études, et publie ses résultats dans des rapports. On peut bien sûr remplacer toutes ces procédures par des méthodes plus visuelles ou sensibles. On peut utiliser des téléphones mobiles. On peut utiliser un tableau de bord et compiler et analyser les données en temps réel. Mais cela ne repose pas forcément la question du but premier de l’évaluation, de quels sont les résultats à identifier, et comment les interpréter. En d’autres mots, à moins de s’interroger réellement sur la manière de faire une évaluation de qualité, on reste dans la même boucle vertigineuse installée dans la même rationalité scientifique qui renforce nos systèmes existants […].
Dans toutes ces expériences, les laboratoires essayent de mêler méthode et substance, forme et fonction. C’est aussi ce qu’avait essayé de faire InWithFor à l’époque. Mais ce que l’on semble avoir laissé de côté, c’est le « tissu fondamental » (« the connective tissue »). La qualité, l’artisanat, la sensibilité à chercher, comprendre, redéfinir et réinventer ce qui est bon. Et de le faire simultanément avec les fonctionnaires, les politiciens, des prestataires, les utilisateurs… Si on se concentrer sur ce tissu fondamental, je pense que notre langage serait différent : des exemples spécifiques de qualité remplaceraient les mots-valise comme celui « d’innovation » ou de « centré sur l’usager ». On raconterait les histoires différemment : on en dirait moins à propos de ce que l’on fait, et probablement plus sur pourquoi le fait-on. On poserait des questions différentes : non plus rhétoriques ou empiriques mais plutôt dialectiques. On formerait autrement : moins par les méthodes et les outils, et plus par l’interprétation, les points de références, la logique. En fait, on pourrait créer un nouveau secteur professionnel qui traverserait les politiciens, les professionnels et les profanes, à l’image des corporations d’artisans défendant la qualité artisanale. Une corporation qui se caractériserait par un discours éthique affirmé, des maîtres et des apprentis, des routines… […]




![Diana Rut Schulman[1]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/55cf9d34550346d033aca9b4/diana-rut-schulman1.jpg)