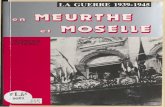ETAT DES LIEUX TERRITOIRES EN TRANSITIONdraaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etat... ·...
Transcript of ETAT DES LIEUX TERRITOIRES EN TRANSITIONdraaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etat... ·...

ETAT DES LIEUX TERRITOIRES EN TRANSITION Fiches de synthèse d’actions par Département Agir vers une transition alimentaire dans la Région Grand Est

INTRODUCTION
Dans le cadre d’une mission confiée à l’association IUFN (International Urban Food Network) par la DRAAF Grand Est de Mars 2017 à Mars 2018, 24 entretiens ont été menés avec des acteurs des Projets Alimentaires Territoriaux de la région ainsi qu’une fiche synthétisant, pour chacun des 10 départements, les actions participant à la dynamique des PAT.
Sans aller jusqu’à l’exhaustivité, les entretiens et synthèses de ce document présentent une photographie à un instant T de ces dynamiques dans la région et donnent des exemples concrets de démarches et d’actions. La finalité est de partager l’existant entre les acteurs concernés et de diffuser des sources d’inspiration et de concrétisation des PAT.
Chaque synthèse présente des chiffres clefs sur le territoire, un résumé des actions par les principaux porteurs de projet puis des éléments plus détaillés ainsi que l’ensemble des partenaires et des liens vers des sources d’informations supplémentaires. Lorsque le territoire présentait des initiatives ayant un intérêt complémentaire aux PAT, elles ont été également résumées sous l’intitulé « hors PAT ». Ces fiches sont complétées par des entretiens avec des acteurs porteurs ou partenaires de ces initiatives. Les entretiens retranscrivent les propos des acteurs le plus fidèlement possible afin de garder vivant leur caractère de témoignage. Les personnes interrogées font état de leur travail, leur avancement, leurs questionnements et leurs difficultés. Elles présentent également, explicitement et en filigrane, leur vision des PAT et leur contribution à une transition alimentaire.
L’ensemble de ces documents sont en ligne sur le site de la DRAAF et seront mis à disposition sur la plateforme numérique du réseau La main à la PAT.
2

SOMMAIRE
Ardennes : 5 o Fiche :
PAT en cours de la Chambre d’Agriculture Initiatives hors PAT : Pays des Crêtes Pré-ardennaises, Festival Sème la culture,
« ateliers vergers » du PNR des Ardennes. o Entretiens :
Chambre d’Agriculture des Ardennes le Pays des Crêtes Pré-ardennaises
Aube : 14 o Fiche :
PNR de la Forêt d’Orient, projet PNA Initiatives hors PAT : les actions du Grand Troyes
o Entretiens : le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient la Ville de Troyes
Bas-Rhin : 21 o Fiche :
PAT de l’Eurométropole de Strasbourg Initiative : PAT en démarrage à Sélestat
o Entretiens : Strasbourg Eurométropole, volet agricole Strasbourg Eurométropole, volet social
Haute-Marne : 31 o Fiche :
PAT en cours de la Chambre d’Agriculture de la Haute Marne Initiatives hors PAT : dive fermier de Saint-Dizier, association Adama pour la diversification,
expérimentation en collège, Pays de Langres o Entretiens :
La Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne Le lycée agricole Fayl Billot La Communauté de Communes Vingeanne Auberive Montsaugeonnais
Haut-Rhin : 42 o Fiche :
PAT de Mulhouse Alsace Agglomération Initiative hors PAT : Dannemarie
o Entretiens l’Agglomération de Mulhouse (M2A) la Fondation MACIF l’association SALSA L’entreprise d’insertion par le maraîchage et la restauration, l’Insef
Marne : 53
o Fiche : Initiatives hors PAT : dynamique autour de Reims,
lutte contre le gaspillage alimentaire par le Département, plateforme des producteurs biologiques (MBCA), approvisionnement local dans les collèges.
o Entretiens : Manger Bio en Champagne Ardenne Communauté Urbaine du Grand Reims
3

Meurthe et Moselle : 60 o Fiche :
PAT du Département Initiatives hors PAT : réseau d’agriculteurs bio, mesure contre le gaspillage dans les collèges, compostage.
o Entretiens : Conseil Départemental de Meurthe et Moselle Grand Nancy
Meuse : 69 o Fiche :
PAT du Pays Barrois Initiatives hors PAT : Centre des Agrobiologistes Lorrains (CGA),
CPIE, Grand Verdun o Entretiens
Pays Barrois Centre des Agrobiologistes Lorrains (CGA)
Moselle : 78 o Fiche :
Initiatives hors PAT : Observatoire Départemental de la restauration collective Ferme collective à Metz
o Entretiens : Direction Départementale des Territoires Ferme collective de Metz
Vosges : 86 o Fiche :
PAT en cours de Mirecourt : le café Utopic Initiatives Hors PNA : le PNR des Vosges, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture
o Entretiens : EcOOparc, co-porté par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges Café associatif Utopic à Mirecourt Pays d’Epinal
4

ARDENNES
5

Département des Ardennes
Emploi agricole et circuits courts
AXE PRINCIPAL
Le projet des Ardennes démarré en juillet 2016 et engagé jusqu’en 2019 est centré sur le lien entre agriculture et distribution. Il met en cohérence les initiatives existantes afin de maintenir et développer la consommation locale et se développe selon 5 axes :
La formation des agriculteurs (coût de production et coût de revient). Depuis 2013, 100 agriculteurs ont été formés.
La création de dynamiques de groupe (Drive fermier : depuis 2016, 140 paniers par semaine…).
La préservation et la création d’outils (Abattoirs, légumerie, production fromagère …) en lien avec de nouveaux débouchés (GMS, cantines).
La professionnalisation des filières courtes (Filière porc : des producteurs aux IGP : relocaliser l’approvisionnement en viande du boudin blanc de Rethel par exemple).
Explorer des nouveaux circuits de commercialisation (restauration hors domicile, restaurants, grandes et moyennes surfaces…).
2 ACTIONS CIBLEES POUR L’APPEL A PROJET
Intégration de produits ardennais dans les établissements scolaires. Commercialisation de produits laitiers locaux dans les GMS.
Le Projet est coordonné par la Chambre d’Agriculture. La demande de financement concerne 2 actions cibles de distribution pour les produits bio et locaux : les cantines et les grandes et moyennes surfaces.
Département des Ardennes: 457 communes 291 000 hab (2013) 54 hab/km² Secteurs concernés : agriculture 4660 emplois commerce de bouche 4000 transformation 2500 Au total 11 160 emplois concernés
Responsable du PAT : Claire Pignon, Chambre d’agriculture des Ardennes Contact : [email protected] Référente projet : Aurélie Renard 03 24 33 71 29 06 89 58 34 11 [email protected]
Carte d’identité
6

Liste des acteurs impliqués dans le PAT
Conseil Départemental Chambre d’Agriculture Communautés de
communes du Pays Rethélois et de l’Ardenne Thiérache
Ville de Charleville-Mézières Manger Bio en Champagne
Ardennes (MBCA) FRAB Fed. Départ. Groupes Etudes
Dév. Agricole des Ardennes France Agrimer Chevilles ardennaises 4 enseignes GMS,
commerces de détails, abattoirs
INITIATIVES HORS PAT
Les « ateliers-vergers » du PNR des Ardennes : préserver le patrimoine fruitier local et sensibiliser le public au maintien des vergers et aux techniques de greffe et de taille. Développement d’un réseau de vergers conservatoires.
« Sème la culture » soutenu par la Chambre d’agriculture et 10 partenaires: festival de spectacles accueillis par des fermes, repas bio et local pour le public. Rencontres entre les urbains et les agriculteurs.
Initiatives dans le pays des crêtes pré-ardennaises : dans ce territoire plusieurs initiatives : produits locaux dans les cantines, rassemblement de producteurs pour créer un atelier de découpe etc (voir entretien).
DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS
1/ Intégration de produits ardennais dans les cantines scolaires
Des groupes de travail vont être mis en place : sur les marchés publics, sur les coûts (matière première et repas), pour la sensibilisation et la formation des gestionnaires et cuisiniers, pour la mise en place d’une plateforme commune.
2/ Commercialisation de produits laitiers ardennais dans la GMS
Les partenaires constatent l’absence de contractualisation entre les producteurs ardennais et la GMS alors que la demande en produit local existe. Le département étant un producteur important de lait, les participants souhaitent démarrer par ce secteur en créant une brique de lait made in Ardennes.
Le projet se développera par une phase d’étude (recenser les producteurs intéressés), puis par une phase technique (marque et packaging), puis l’organisation de la mise en brique et enfin la mise en marché et la communication.
Pour en savoir plus :
http://www.mangerbiochampagneardenne.org/
http://www.drive-fermier.fr/charleville/
http://www.laireagrange.fr/pages/contact.html
http://www.ardennes-de-france.com/ardennes-de-france-assiette-ardennaise
7

Chambre d’Agriculture des Ardennes
Produits locaux dans les grandes et moyennes surfaces et la restauration collective
L’objectif du projet
Le PAT est pour nous un élément structurant de nos initiatives, un levier pour favoriser la consommation locale. A l’intérieur de notre PAT nous avons plusieurs groupes qui correspondent à plusieurs projets.
Nous avons un groupe sur la restauration collective avec le Conseil Départemental pour les collèges et avec la Région pour les lycées. Nous avons mené un état des lieux par accolement de données puis nous avons travaillé sur les appels d’offre, les tonnages et les volumes. La production n’est pas organisée donc nous travaillons là-dessus. Nous avons entre autre été visiter la cuisine centrale de Toul pour voir un exemple de ce que l’on peut faire.
Nous avons également un groupe qui travaille sur les outils, mené par les élus. Dans ce groupe nous avons un projet de légumerie avec un acteur de l’ESS. Il y a des ateliers de réinsertion qui ont également un jardin de cocagne. Nous avons décidé d’établir un pont avec eux, au lieu de faire un investissement supplémentaire. Il y a également un projet de fromagerie collective. Pour cela, nous sommes partis du constat que nous avons des fromages locaux mais qu’ils ne sont pas connus. Nous avons donc décidé de travailler sur un produit qui serait très identifié. Il y a un groupe de producteurs sur la mise en bouteille de lait. Nous allons mettre en place l’organisation de la collecte sur le territoire pour faire de la vente en grande et moyenne surface.
Enfin nous avons un autre groupe qui est sur la dynamique de l’action « les Ardennes dans votre assiette ». Cette action est un temps fort pour mettre nos dynamiques en lien avec la GMS et plus spécifiquement la distribution de viandes et de fruits et légumes. En 2017 nous voulons installer 4 nouvelles filières dans la GMS. C’est une action qui est davantage un enjeu de communication pour que le consommateur identifie ces produits. Nous avons mené une opération fruits rouges qui a très bien marché. Le produit saute aux yeux et de notre côté nous avons pu identifier quel était le volume de production possible par la seule production locale. Le produit existait déjà mais là il avait une place plus importante, plus clairement identifiée avec une dimension d’identité du territoire.
En revanche, nous ne savons pas si suite à ces opérations des produits locaux ont été intégrés dans la GMS. Pour cette opération, nous travaillons avec 10 hypermarchés et bientôt 15. Il y a certaines enseignes qui sont ouvertes et d’autres qui ne le sont pas. Nous savons par exemple que nous ne pourrons pas travailler avec Lidl. Nous voyons bien que la GMS c’est une autre culture, c’est un monde différent. Leur approche est centrée sur le chiffrage mais si nous allons vers eux, les liens vont se construire. Nous avons été aidés pour ces opérations par les producteurs de fruits et légumes qui travaillaient déjà avec eux. Ces producteurs étaient soit en conventionnel soit aussi en vente directe et en magasin de vente directe. Ils nous ont ouvert leurs contacts avec la GMS. Pour ces producteurs il n’y a pas de réelle concurrence car eux aussi ont leurs habitudes de vente dans ce circuit alors que là il ne s’agissait que d’une opération ponctuelle. Par ailleurs la demande excède largement l’offre potentielle si on regarde la production maraîchère du département.
« Le PAT est pour nous un élément structurant de nos initiatives, un levier pour favoriser la consommation locale »
Activité : Accompagnement de la vente de produits locaux dans la GMS et RHD Territoire : 457 communes 9 intercommunalités 291 000 habitants 54 hab/km² 55 480 à Charleville-Mézières 5% Conversion bio Responsable : Aurélie SATTEZI Contact : 03 24 33 71 29 [email protected]
Carte d’identité
8

Nous avons également un groupe de travail sur la viande et les abattoirs car nous avons 2 abattoirs sur notre territoire : un à Charleville-Mézières et un à Réthel. Ils travaillent sur de petits volumes (entre 5 et 8 000 tonnes). En 2016, l’abattoir de Réthel était en liquidation mais les producteurs se sont organisés pour le reprendre. La collectivité, la Chambre d’Agriculture et une coopérative ont travaillé sur cette reprise. Les élus de la Chambre d’Agriculture ont eu la volonté de préserver l’outil. J’ai coordonné et animé la démarche et les producteurs ont construit le projet. Cette démarche a abouti à maintenir l’outil et sur le plan juridique, l’abattoir est repris depuis un mois. L’objectif est maintenant de travailler sur l’approvisionnement de la restauration collective pour le pérenniser. La première étape, celle du sauvetage de l’outil, est bouclée, maintenant nous travaillons avec les producteurs sur la suite.
Pour ce qui est de la restauration collective nous démarrons le travail de recherche bibliographique. Le Conseil Départemental a un service dédié sur les marchés publics et nous avons prévu d’échanger avec eux prochainement. Notre finalité est d’aboutir à une plateforme web ou physique. Nous collaborons avec les outils déjà existants comme Manger Bio en Champagne Ardenne et j’utilise également pour cela mon expérience antérieure de conseillère en production biologique.
Nous menons enfin, des formations et avons créé un forum des opportunités pour les producteurs. Ce sont les outils de la chambre pour avancer vers la diversification de la production.
Il faut aussi travailler sur la concurrence : nous savons qu’il y a de la place pour les autres produits et aujourd’hui nous avançons, autant que faire se peut, pour faire entrer de nouvelles personnes dans le drive fermier. Pour cela, il faut être attentif aux enjeux de concurrence ou ressenti/ crainte de concurrence. Nous savons qu’un magasin de producteurs, comme il y en a un en projet actuellement, ne viendra pas concurrencer le drive existant mais augmenter la part de marché globale du local, sa visibilité également. Le drive et le marché de producteurs capte un public plus urbain. Nous ne touchons les consommateurs ruraux que si ils viennent consommer en ville. 36% des consommateurs du drive viennent de zone rurale. Les ruraux vont plutôt sur les marchés de producteurs de février à octobre. C’est un nouveau marché qui s’ouvre et non une concurrence et il faut que chacun s’approprie cette logique. Il y a une attente locale pour consommer des produits proches mais la plupart des gens continuent d’aller dans les GMS. Nous observons aussi qu’il y a une réelle complémentarité des différents modes de distribution : sur les marchés de producteurs nous voyons davantage de personnes âgées qui souhaitent aussi passer du temps à discuter avec les producteurs tandis que sur le drive c’est un public plus jeune qui cherche des produits de qualité. Le drive de Charleville est proche de la place où se tient un marché mais il n’y a pas eu de baisse de fréquentation du marché. La part de marché prise par le drive est au détriment de la GMS, même si il s’agit d’une faible part pour cette dernière.
Lorsque nous avons travaillé avec la GMS, notre intervention sur les produits locaux était ponctuelle, ce sont des producteurs qui ont l’habitude de partager leur marché et qui ont de grandes échelles de production. Ils ne sont pas dans les mêmes logiques que ceux qui sont d’autres circuits.
Le drive a aussi l’avantage d’être un espace de communication direct entre producteurs et consommateurs via le produit : suite à l’une de nos formations, nous avons fait l’expérience suivante avec une productrice de beurre qui a calculé que son prix de revient se situait 50 centimes au-dessus de son prix initial de vente ce qui revenait à vendre à plus de 3 euros la pièce. Nous avons travaillé avec la productrice pour inclure une explication avec son produit sur cette augmentation pour expliquer que ce prix est nécessaire pour rémunérer son travail. Depuis ce changement, elle en vend trois fois plus et est régulièrement en rupture de stock. Cette augmentation de prix n’est pas possible auprès de tous les consommateurs ni sur tous les produits mais cela montre que les consommateurs sont prêts à comprendre. D’ailleurs notre drive marche très bien, son chiffre d’affaires est juste derrière celui de Bordeaux.
Le plus précieux pour notre démarche ce sont les liens entre les acteurs, le fait de s’ouvrir aux autres progressivement plutôt que de travailler chacun dans son coin. C’est là, la richesse de notre démarche.
« Nous voyons bien que la GMS c’est une autre culture, c’est un monde différent. Leur approche est centrée sur le chiffrage mais si nous allons vers eux, les liens vont se construire»
« Egalement il faut être attentif aux enjeux de concurrence ou ressentie, la crainte de la concurrence »
« C’est un nouveau marché qui s’ouvre et non une concurrence et il faut que chacun s’approprie cette logique ».
9

“Vivamus porta est sed est.”
D’où vient la démarche
La Chambre d’Agriculture est engagée depuis plus de 10 ans sur les circuits courts. Elle en a été initiatrice et coordonne la dynamique. Cette thématique a été bien travaillée avec les élus qui accompagnent plusieurs groupes de travail. Ils souhaitent voir un projet sortir de terre et être identifiés comme acteur porteur. Quand le PAT est arrivé, nous avions les outils pour faire un focus sur ce point mais cela nous aide à mieux structurer et coordonner nos actions. Les partenaires ont tout de suite adhéré.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Concernant l’évolution de la démarche, nous ne pouvons que constater sa lenteur. Nous avons des magasins de producteurs, de nombreux outils, nous avons développé un drive, en quelques années 200 agriculteurs se sont diversifiés mais nous constatons que nous avons touché les producteurs potentiellement intéressés. Au-delà de ce cercle, comment toucher le public que nous ne connaissons pas encore ? Notre cible, ce sont les 2800 producteurs restants. Pour cela nous devons être plus prospectifs. Il faut aller les chercher en allant sur le terrain, par téléphone. Le forum des opportunités permet de toucher de nouveaux producteurs. En février dernier nous avons eu 80 personnes à ce forum. A l’heure actuelle, il est annuel et nous devrions en faire plus souvent. Le prochain est prévu dans un an dans différents lieux.
Il faut aussi tenir compte du niveau de vie moyen sur notre territoire car le pouvoir d’achat est ici plus faible qu’à Reims ou Paris. Certains producteurs préfèrent vendre là-bas car ils y font une marge plus importante mais nous souhaitons montrer que si l’on tient compte du temps de préparation et de trajet la rentabilité de ce débouché extérieur au territoire n’est pas si importante que cela ramené au temps de travail. La difficulté est que les agriculteurs calculent rarement leur rentabilité en tenant compte du temps réel de leur travail, incluant tout ce qui est lié à la vente, même les à-côtés. Nous travaillons dans nos formations sur le prix de vente justement. Dans un drive tout est déjà vendu donc le temps de travail sur la vente s’en trouve diminué.
Si nous pouvions recommencer depuis le début, nous prendrions davantage le temps de réfléchir au chemin à emprunter et surtout à définir nos priorités. Aujourd’hui nous avons plusieurs groupes de travail, beaucoup de choses ouvertes et l’enjeu est de ne pas se disperser. Nous devons tout mener de front pour que les différents projets aboutissent et lorsqu’il s’agit d’une production de lait qui cherche son débouché, on ne peut pas leur demander d’attendre. Chaque projet démarré crée une attente et des besoins auxquels il faut ensuite répondre. Nous avons augmenté nos effectifs mais nous ne sommes pas sûrs que cela suffise. Nous avons un rôle de coordinateur à assurer, les participants des groupes nous attendent. Nous devons définir des chefs de fil par groupe pour qu’ils avancent davantage en autonomie. Sur la légumerie le groupe avance plus vite mais cette question d’autonomie dépend aussi de l’urgence de la question posée. Enfin cela dépend aussi de l’appui d’un élu qui donne une « caution » au groupe.
Par rapport à l’action de la DRAAF, nous nous alimentons les uns les autres donc nous devons nous rencontrer au moins 1 à 2 fois par an. C’est différent de diffuser une brochure ou d’organiser des rencontres.
« Comment toucher le public que nous ne connaissons pas encore ? ».
« Si nous pouvions recommencer depuis le début, nous prendrions davantage le temps de réfléchir au chemin à emprunter et surtout à définir nos priorités. Aujourd’hui nous avons plusieurs groupes de travail, beaucoup de choses ouvertes et l’enjeu est de ne pas se disperser ».
Pour en savoir plus :
http://www.ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/strategie-de-developpement/
10

Communauté de Communes des Crêtes Pré-ardennaises
Relier les ressources locales
L’objectif du projet
Notre action phare est le développement de produits locaux dans la restauration collective.
Dans le cadre du plan climat du Pays mis en place en 2013, nous avons plusieurs champs d’action dont l’alimentation. Dans ce cadre, nous avons signé une convention pour 1an à partir de 2016 avec un collège (58800 repas) qui permet de développer l’approvisionnement local. La Communauté de Communes apporte une participation pour le surcoût d’achat des produits locaux conventionnels et AB.
Nous avons le bilan sur cette convention et nous avons potentiellement 2 nouveaux partenariats avec d’autres restaurants scolaires. Les collèges sont plus libres que les écoles car ils ont leurs propres cuisines. Le gestionnaire s’occupe de faire son marché et voit en direct avec les producteurs. Il y a un potentiel de développement dans la restauration collective car nous avons 2 collèges, 3 écoles primaires qui ont leurs cuisines, 1 Maison Familiale Rurale (MFR) et 1 maison spécialisée pour personnes handicapées. Pour le moment il y a 1 collège qui a répondu favorablement. 1 des écoles et la MFR sont susceptibles d’entrer également dans la démarche.
Dans le collège participant, 8 producteurs locaux sont impliqués. Cela représente 4% du budget annuel des denrées alimentaires. Le surcoût sur ces produits est de 15% sur les produits conventionnels et 30% pour le bio (Pomme, pommes de terre, steak frais, fraises de qualité, boudin blanc confectionné par une charcuterie, yaourt AB). Cette démarche a amené de nouveaux produits dans l’assiette des enfants comme le steak frais qui n’existait pas avant dans les menus.
Ce produit peut être d’origine locale grâce à notre abattoir : ce sont les producteurs qui se sont rassemblés, il y a 13 ans, pour faire cet atelier de découpe (l’atelier des éleveurs). Ils ont embauché un boucher. Cela a créé une dynamique des producteurs en circuits courts.
On observe aussi que les collégiens gaspillent plus que les primaires et maternelles puisque cette cantine sert aussi les repas d’écoles. Il y a une différence de goût avec les produits bio et cela se remarque dans le gaspillage final par les collégiens qui n’y sont pas habitués tandis que les plus jeunes s’adaptent apparemment mieux. Le Département propose d’ailleurs de travailler sur les produits locaux dans le cadre de la semaine du goût pour mener des actions pédagogiques notamment auprès des élèves.
Le gestionnaire est dans une bonne dynamique et continuera même si on ne finance plus le surcoût.
« La collectivité soutient la transition écologique et climatique : l’alimentation est incluse dans cette politique transversale. Notre Vice-Président qui en a la charge est là depuis longtemps. La dynamique politique est faite. »
Territoire : Communauté de Communes des Crêtes Pré-ardennaises 94 communes 22508 hab 21,3 hab/km² Responsable : Nadia Djemouai Directrice Adjointe et Marine Lantenois Référente du dossier Contact : [email protected] [email protected]
Carte d’identité
11

Il lui faudrait mettre en place une station de compostage dans l’établissement pour limiter le coût de la gestion des déchets. C’est un autre versant, complémentaire du travail sur le goût. Il y a encore d’autres aspects sur lesquels ils travaillent comme la prise de conscience des volumes jetés (travail de pesée du pain restant). Enfin ils ont travaillé sur le service et les quantités en proposant différentes tailles d’assiette.
Nous avons aussi sur le territoire, l’école du bio : entreprise d’insertion professionnelle. En 2005 l'atelier d'insertion Pain et Chocolat, un groupement d'économie solidaire, a été créé et suite à cela, Ardennes Gourmandes a lancé il y a bientôt 2 ans l'Ecole du Bio. Elle emploie des personnes en insertion pour les former aux métiers de bouche. Elle a un marché pour les repas de 3 crèches (Fédération Familles Rurales), les centres aérés et enfin les apéritifs de la Communauté de Communes. Ils confectionnent jusqu’à 250 repas par jour (centres aérés). Ils ont une majorité de produits bio et lorsque c’est possible ils privilégient les produits locaux. Pour cela ils travaillent avec MBCA.
Nous avons aussi le Comptoir bio des Ardennes avec un lieu de retrait sur le territoire (Attigny, où se trouve aussi l’école du bio) et un à Charleville. En revanche nous n’avons pas d’Amap ni de ruches et cela est peut être lié aux caractéristiques de notre territoire très rural.
Concernant le volet social et formation, la MFR de Lucquy propose un enseignement des services à la personne. Leur idée est que les élèves travaillent directement les produits locaux. Dans ce cadre, les élèves préparent à manger pour les plus jeunes. Cela représente 250 repas par jour. Cette action va se mettre en place et est inscrite dans le Contrat Local de Santé signé en 2016 pour 5 ans.
Enfin la Communauté de Communes va mettre au format numérique le guide des producteurs. Il s’agit de mettre leurs informations en ligne via un onglet sur le site web de la Communauté de Communes et du Plan Climat.
Nous avons un déficit en maraîchage donc la Communauté de Communes a l’idée de porter un projet de maraîchage : nous avons ciblé des parcelles dont nous sommes propriétaires pour les mettre à disposition à travers un bail environnemental. Nous sommes actuellement en phase d’étude sur l’analyse de sol et le potentiel envisageable pour des débouchés commerciaux ensuite nous rechercherons des candidats. Cette démarche a été Initiée par la Communauté de Communes dans le cadre du TEPCV avec une enveloppe financière de soutien.
Pour cette démarche nous avons surmonté plusieurs difficultés : tout d’abord, une parcelle dédiée à l’horticulture pose des difficultés pour une réorientation vers le maraîchage, ensuite le travail avec la Safer n’a pas permis d’identifier des exploitations en voie de transmission car le territoire de l’étude est fait de plaines de céréaliculture plus intensive.
Nous avons ensuite passé convention avec la Frab qui est intervenue via le CGA et Terre de liens pour rechercher des candidats. 2 communes ont répondu favorablement. Sur les 2 parcelles nous sommes en phase d’étude technico commerciale et juridique avec la Frab.
« Cette démarche a amené de nouveaux produits dans l’assiette des enfants »
« L’idée est d’aller vers des réunions collectives pour faire système. »
12

D’où vient la démarche
Sur notre territoire, le travail sur l’évolution dans la production et l’alimentation remonte à loin. Nous avons commencé par développer les marchés de producteurs de pays. Ils sont aujourd’hui sur 2 lieux. C’est la première forme de circuit court organisé soutenue sur notre territoire. Nous avons ensuite développé cette dynamique dans la restauration collective.
D’une façon générale, la collectivité soutient la transition écologique et climatique : l’alimentation est incluse dans cette politique transversale. Notre Vice-Président en charge de cela est là depuis longtemps. La dynamique politique est faite. Les personnes entrées récemment par le renouvellement dans le bureau y sont sensibles également. Jean Marie Oudart, Vice-Président chargé de la transition énergétique dont l’agriculture, est lui-même agriculteur. Il est également Président de l’ALE Agence Locale de l’Energie.
BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Nous travaillons actuellement sur un outil de l’ADEME pour mener un diagnostic énergie climat sur l’agriculture et la forêt. Cela aboutira à un plan d’action. A partir de là nous réaliserons un programme d’aide qui sera soumis au conseil de communauté. L’alimentation a été notée par le Conseil de Développement comme un volet à développer sous différentes approches : l’aménagement rural pour soutenir les exploitations agricoles, agir sur les nouveaux circuits courts, sensibiliser les enfants et parents et enfin généraliser la protection des aires de captage par l’installation en bio.
Nous sommes au début de pas mal de choses. Les évènements décentralisés prévus par la DRAAF nous aideront beaucoup.
« Nous sommes au début de pas mal de choses. Les évènements décentralisés prévus par la DRAAF nous aideront beaucoup ».
Pour en savoir plus :
https://collectifs.bio/charleville http://locavores.fr/decouvrir-le-mouvement-locavore/
http://www.cretespreardennaises.fr/
13

AUBE
14

Département de l’Aube
Toucher les parties prenantes de la restauration collective
AXE PRINCIPAL
Pour le PNRFO, il s’agit de développer l’approvisionnement de la restauration collective en circuits courts en mobilisant les élus sur cet enjeu mais aussi de toucher le grand public et la GMS. Pour le Grand Troyes, il s’agit de soutenir les initiatives existantes notamment les jardins urbains, également de développer des méthodes et actions pour intégrer les communes rurales dans le Grand Troyes.
3 THEMES D’ACTION
Pour le PNR
Mener un diagnostic des producteurs et de la restauration collective ; Créer un catalogue de produits locaux. Créer des animations, de la sensibilisation et une éducation au territoire
de façon pédagogique.
Pour le Grand Troyes
Soutenir les jardins collectifs. Créer des réserves foncières et tester les activités agricoles. Développer une plateforme de produits locaux pour la restauration
collective.
Initiée par le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, la démarche consiste à mobiliser les élus sur le développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective et établir un plan d’action concret.
La ville de Troyes développe également de nombreuses initiatives.
Département de l’Aube : 433 communes 308 094 hab (2013) 51 hab/km² Service porteur : PNR de la Forêt d’Orient 80 000 ha 57 communes 23 400 habitants 370 exploitations agricoles qui représentent 8,5% de l’emploi du parc Responsable du projet : Meissa Diallo, chargée de mission David Laplanche, chargé de mission développement et circuits courts Contact : [email protected] Responsable du projet Troyes : [email protected]
Carte d’identité
15

Liste des acteurs impliqués
pour le PNR Chambre d’Agriculture PNRFO Regroupement de
producteurs Professionnels des cantines
Pour le Grand Troyes Chambre d’Agriculture Jardins de cocagne Amap Regroupement de producteurs
dans un drive fermier Centre social
DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS
1/ PNRFO
Le projet a pour titre « offre de produits locaux ». Il s’agit d’un projet expérimental : initier, faire émerger des projets, créer des outils méthodologiques transférables. Un poste est entièrement dédié à l’animation. Les producteurs motivés sont déjà engagés dans cette dynamique (drive, point de vente). Un point fort de la démarche est la réalisation d’un catalogue de produits pour montrer qu’il y a une diversité d’offre et que se fournir localement dans une gamme assez large, est possible.
2/ Troyes
Le pôle développement durable soutient les actions dans les jardins collectifs (3 jardins de cocagne, potagers intégrés à un parc, ruche, vergers). Dans le cadre du PCET de l’agglomération et via la Chambre d’Agriculture, la promotion est faite du maraîchage biologique et il y a une dynamique pour créer des réserves foncières. Egalement la création d’un drive fermier est à l’étude, la possibilité de développer une plateforme pour tester les activités agricoles et essaimer le maraîchage à l’image des pépinières d’entreprise.
Au niveau de la restauration collective le Grand Troyes est en délégation de service public avec 20% de produits locaux et 20% en bio inscrit dans le marché public
Pour en savoir plus :
http://www.aube.fr/3-le-conseil-departemental.htm
http://troyes-champagne-metropole.fr/
16

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient
Doter la production d’outils pour favoriser sa visibilité et ses débouchés
L’objectif du projet
Le projet a pour titre « offre de produits locaux » et il s’agit d’un projet expérimental : initier et faire émerger des projets, créer des outils méthodologiques transférables.
Il y a 3 points clefs :
animation, sensibilisation, éducation au territoire de façon pédagogique. Structurer l’offre locale donc établir un catalogue de produits locaux pour la
restauration collective. (il n’y a pas à l’heure actuelle de centrale d’achat). Restituer les travaux
Nous avons établi une grille d’entretien pour faire un diagnostic des producteurs et auprès de la restauration collective. Nous avons également établi un catalogue de produits. La chambre d’agriculture a participé au groupe de travail pour mettre au point ce catalogue.
Le projet est bien accueilli car les gens étaient déjà préparés. On observe qu’il y a de plus en plus de personnes à chaque réunion.
Le plus précieux c’est l’engagement d’un socle d’acteurs qui est déjà mobilisé. Grâce au travail souterrain d’animation et de mise en réseau, nous avons une base stabilisée.
D’où vient la démarche
Le PNR avait déjà répondu à l’appel à projet de 2015. Mon poste a été ouvert en juin 2016 pour la première phase du projet. Il est entièrement dédié. Il y avait avant, un poste sur les circuits courts, les marchés et la route des saveurs. Mon budget est dédié à l’animation (séminaire, évènement, restitution).
Les producteurs motivés étaient déjà engagés dans cette dynamique (drive, point de vente). Les plus moteurs sont ceux qui travaillent sur la restauration collective. Il y a 2 collèges particulièrement motivés. En revanche c’est une agriculture de petits volumes, sauf pour la viande mais celle-ci est déjà dans les réseaux courts. Un exemple type est un agriculteur qui va produire 75% de céréales et qui décide de produire à côté des asperges et lentilles pour se diversifier et se détacher un peu des structures céréalières. Le maraîchage biologique est assez présent sur notre territoire. Ces producteurs ont une philosophie de protection de l’environnement donc ils sont assez ouverts aux circuits courts.
Pour les agents des collèges, c’est intéressant de faire évoluer la manière dont les autres perçoivent leur métier grâce à cette démarche. C’est aussi intéressant pour eux-mêmes. Pour les cuisiniers, c’est un plaisir de travailler des produits de qualité plutôt que d’ouvrir un sachet tout prêt.
« Un des résultats importants de la démarche est d’avoir établi un catalogue de produits pour montrer qu’il y a une diversité d’offre et que se fournir localement dans une gamme assez large, est possible »
Activité : Développer l’offre en produits locaux et les moyens de son écoulement Responsable du projet : David Laplanche Chargé de mission développement - circuits courts Contact : [email protected]
Carte d’identité
17

« Le projet est bien accueilli car les gens étaient déjà préparés »
« Si je devais recommencer la démarche du début, je prendrais davantage le temps de connaitre le territoire »
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Un frein pour nous est de travailler avec 57 élus différents, qui n’ont pas forcément des intérêts convergents. Sur la restauration, 3 Communautés de Communes ont la compétence et sont dans le Parc. Nous travaillons avec le chef du service collège qui les épaule dans leurs décisions.
Notre principale difficulté c’est le fonctionnement en gestion concédée qui livre des plateaux. Ce mode de gestion est présent à 90% sur notre territoire et il est établi par des contrats d’une durée de 3 ans. En effet le passage à la gestion directe suppose de l’investissement, de la gestion, du management. Donc à court terme il n’y a rien de possible. Donc nous menons un travail de sensibilisation auprès des Communautés de Communes et nous avons plutôt investi le travail auprès des collèges.
Un des résultats important de la démarche est d’avoir établi un catalogue de produits pour montrer qu’il y a une diversité d’offre et que se fournir localement dans une gamme assez large, est possible.
Aujourd’hui, le bilan est positif, nous arrivons à la phase du concret : nous allons faire les premiers approvisionnements tests. C’est un virage important pour le projet. Il faut articuler deux logiques : les producteurs qui raisonnent à la saison et les restaurateurs qui raisonnent à la semaine.
Si je devais recommencer la démarche du début, je prendrais davantage le temps de connaitre le territoire avant de démarrer la démarche. Par exemple, mener un travail de plateforme d’approvisionnement à l’échelle du PNR n’est pas forcément pertinent si on connait le territoire. L’offre n’est pas assez large. En revanche, ce serait pertinent à l’échelle du Département.
Nous serions preneurs d’un appui régulier de la Draaf pour recadrer régulièrement le projet. Un comité à l’échelle régionale sur les PAT et se voir tous les trois mois pour un bilan serait utile. Nous pourrions aussi comme cela mutualiser les outils et grilles d’entretien, nous pourrions éviter les doublons et partager nos expériences.
Un PAT consiste à re-territorialiser la consommation, rediriger la production vers la demande, pousser la diversification et toucher également à la question de l’identité.
Pour en savoir plus :
http://www.pnr-foret-orient.fr/fr/content/pnrfo
18

Ville de Troyes
L’objectif du projet
La ville a plusieurs projets sur le thème de la nature en ville. Nous soutenons le développement de jardins via les associations pour la création de jardins de cocagne dès 2012. Ce jardin a un volet insertion sociale et réalise des paniers bio pour les habitants. Nos agents apportent également des conseils aux jardins partagés tenus par des associations.
Dans le Parc des Moulins sur 12ha, nous avons une gestion différenciée avec des ruches et des vergers restaurés. Nous travaillons avec les croqueurs de pommes sur ces vergers. Nous avons également des parcelles de jardins potagers en création avec un paysagiste et enfin un local qu’une Amap nous loue et que nous faisons intervenir pour faire connaître les circuits courts lorsqu’il y a des évènements en ce sens. Nous avons également une démarche des incroyables comestibles (10 dans l’agglomération et 3 dans la ville) en cours de pérennisation. Nous n’avons pas encore de coordination mais à l’échelle de la Ville et de l’Agglomération, nous avons beaucoup d’initiatives émergentes, notamment autour du jardin. Nous avons également un développement des points de vente en circuits courts, ruches, biocoop etc. cette évolution a commencé dès 2010. Il y a de plus en plus de participants aux évènements que nous organisons.
Dans le cadre du PCET de l’Agglomération et via la Chambre d’Agriculture, nous faisons la promotion du maraîchage biologique et avons une dynamique pour créer des réserves foncières. Ainsi, récemment nous avons participé aux échanges concernant la mise en place de 2 maraîchers dans une commune de l’Agglomération qui commencent à vendre leurs produits dans la biocoop et sur leur exploitation. Terre de liens nous a aidé pour cette action.
Avec le passage de notre territoire de 19 à 81 communes, nous sommes devenus un territoire plus rural et nous avons démarré un travail avec la Chambre d’Agriculture. Nous étudions les différentes possibilités pour intégrer au mieux le volet agricole dans les nouveaux enjeux de l’intercommunalité. A l’initiative de la Chambre d’Agriculture, un regroupement de producteurs a été créé pour ouvrir un drive fermier avec des producteurs locaux, pas nécessairement en bio.
Au niveau de la restauration collective nous sommes en délégation de service public avec 20% de local et 20% en bio inscrit dans le marché public. La question de retour en régie ou non se pose actuellement.
Ensuite, dans le cadre de notre Agenda 21 sur 2012-2016 qui sera reconduit à l’échelle intercommunale, les élus souhaitent que les volets santé et alimentation se développent.
« A l’échelle de la ville et de l’agglomération, nous avons beaucoup d’initiatives qui émergent »
Territoire : Agglomération de Troyes 130 588 hab1 005 hab./km2 Responsable : Caroline Lannou Cheffe du service développement durable de l’agglomération et de la ville de Troyes Simon Schraen Chargé de mission au pôle environnement et développement durable ville de Troyes Contact : [email protected]
Carte d’identité
19

Sur le volet social, nous avons des Centres Sociaux qui développent des ateliers pour apprendre à bien manger, reconnaître les plantes et les introduire dans les plats avec une utilisation complète du produit jusqu’aux feuilles.
BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs et cela nous intéresse. Cela nous aiderait aussi à trouver comment intégrer davantage nos communes rurales dans notre nouveau territoire. Nous travaillons avec la Chambre d’Agriculture sur ce sujet.
Par ailleurs, nous avons répondu à un appel à projets qui fait partie du laboratoire péri-urbain du CGET (Commissariat Général à l’égalité des territoires) dans le cadre de notre action : « savoure ta campagne » : Nous avons fait le constat d’une faible proportion d’agriculteurs diversifiés ce qui limite fortement l’offre en produits locaux (incapacité actuelle à fournir quantitativement et régulièrement la restauration collective). Le différentiel entre l’offre et la demande via une étude de la Chambre d’Agriculture a permis de cibler des actions de sensibilisation et d’accompagnement des producteurs. L’objectif de l’action « Savoure ta Campagne » est d’aller au-delà de cet état des lieux et d’inciter au maintien et au développement de la consommation locale dans les années à venir en : sensibilisant les publics (agriculteurs, collectivités, écoles, consommateurs…), en accompagnant les producteurs à des changements de pratiques, à la mise en place de nouvelles productions, en favorisant l’installation de jeunes maraîchers au sein du Grand Troyes, en facilitant l’organisation logistique de cet approvisionnement, en facilitant l’accès des consommateurs aux produits locaux par l’émergence de nouveaux circuits de distribution, en facilitant l’achat de produits fermiers et locaux par les collectivités. Tous ces éléments sont au stade de la proposition.
« Avec le passage de 19 à 81 communes, nous sommes devenus un territoire rural »
« Nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs et cela nous intéresse »
Pour en savoir plus :
http://periurbain.cget.gouv.fr/content/Savoure-ta-campagne-0
20

BAS-RHIN
21

THEMES D’ACTION DE SELESTAT
Fédérer des actions existantes côté producteurs (points de vente directe, coopérative fruits et légumes d’Alsace etc) et accompagner des initiatives émergentes (création d’une marque et d’une laiterie coopérative), évolution des marchés publics de la restauration scolaire, etc.
Démarche de diagnostic et pistes d’action. Création d’un plan d’action abouti à horizon 2019
THEMES D’ACTION DE STRASBOURG
Ensemble d’actions transversales existantes (agriculture urbaine de
production, levier de la restauration scolaire, déchets traités par méthanisation, labels etc) confortées par 4 actions spécifiques intégrées à l’appel à projet. Pour chaque action des indicateurs de suivi sont définis.
2 actions en faveur de l’agriculture biologique : favoriser la reprise d’exploitation en bio, créer une filière pain bio pour les cantines scolaires.
2 actions pour diffuser des pratiques alimentaires équilibrées et lutter contre l’obésité : panier de légumes et jardin santé à destination des familles accompagnées pour des problèmes d’obésité.
Sélestat et Strasbourg : deux projets systémiques. Le premier au stade du démarrage, le second complète une large gamme d’actions développées depuis plusieurs années. Département du Bas-Rhin :
527 communes 1 112 815 hab (2013) 232 hab/km² Service porteur Strasbourg : Ville de Strasbourg 480 000 hab Responsable du projet : Roland Ries, maire de Strasbourg Contact : Anne Frankhauser 03 68 98 65 61 [email protected] Service porteur Sélestat: Communauté de communes de Sélestat (futur PETR pays d’Alsace centrale) 37 200 hab dont 19 300 à Sélestat 12 communes Responsable du projet : Marcel BAUER. Président de la communauté de communes de Sélestat Contact : Daniel Millius 03 88 58 01 60 [email protected]
Département du Bas-Rhin
Transversalité thématique
Carte d’identité
22

“Vivamus porta est sed est.”
Pour en savoir plus :
Sélestat http://www.maisonnaturemutt.org/
Strasbourg http://www.strasbourgcapousse.eu/
DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS A SELESTAT
Des ateliers d’échanges menés et des instances de décision définies
La communauté de communes a mené des ateliers d’échanges au long de l’année 2016 pour définir sa démarche. La gouvernance du PAT a été définie :
Instance de décision : le conseil communautaire de la Communauté de communes étudie les propositions, valide la mise en œuvre et les étapes.
Instance de consultation : comité de pilotage avec des partenaires techniques (chambre d’agriculture, département, OPABA, ADEME, mission locale etc) : émet des avis sur les propositions et peut participer par un avis technique et financier.
Instance de co-construction : groupes de concertation (acteurs concernés par chaque thématique) qui partagent le diagnostic et proposent des actions.
DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS DE STRASBOURG
Action 1/ Favoriser la reprise d’exploitations en bio
Suite à une démarche de sensibilisation menée par l’OPABA et la Chambre d’Agriculture, la collectivité souhaite anticiper sur la reprise de 15 exploitations situées sur des parcelles de la collectivité. Une série de rendez-vous avec ces agriculteurs a été menée pour faciliter la transition.
Action 2 / identifier puis créer une filière de pain bio pour la restauration scolaire
L’OPABA va réaliser une étude pour décrire la situation actuelle et étudier les besoins et le potentiel de développement en pain bio. Une fois tous ces éléments identifiés les acteurs ont prévu la suite et son financement : le montage opérationnel sera assuré par l’OPABA avec les financements de l’Agence de l’eau et Eurométropole.
Action 3/ Panier de légumes et apprentissage d’une alimentation équilibrée
L’action consiste en la mise à disposition de paniers de fruits et légumes pour 10 familles tous les mois associée à une prise en charge coordonnée des enfants obèses et en surpoids à Strasbourg. Cette initiative a été lancée en avril 2014 sur 3 quartiers prioritaires en partenariat avec l’ARS et en lien avec d’autres acteurs de la santé. Il consiste en une coordination entre personnels soignants pour amener des familles identifiées comme en difficulté à découvrir les produits locaux et de qualité. La démarche se base sur des ateliers de cuisine dont les ingrédients proviennent de paniers de produits locaux. La diététicienne travaille alors avec la conseillère en économie familiale et sociale et proposent ensemble ces ateliers cuisine. L’objectif est aussi de montrer que se nourrir de produits frais et de qualité ne coûte pas plus cher.
Action 4 / Jardin de réapprentissage et d’échange pour les familles PRECCOSS
Création et animation d’un jardin partagé dans l’enceinte du centre médico-social, du quartier Neuhof. Ce jardin permettrait à 10 familles du dispositif PRECCOSS d’apprendre le jardinage, la saisonnalité, le goût des légumes frais. Il sera animé par un intervenant spécialisé.
Partenaires du PAT de Selestat Maison de la nature du RIED Partenaires techniques thématiques : Chambre d’Agriculture, Ademe, mission locale, etc
Partenaires du PAT de Strasbourg Action 1: Pilotage : Eurométropole de Strasbourg. Partenaire : Chambre d’Agriculture et OPABA
Action 2 : Pilotage : OPABA Partenaire : Eurométropole et ville de Strasbourg, Chambre d’Agriculture
Action 3 : Pilotage : Ville de Strasbourg. Partenaire : personnel PRECCOSS et Amap à identifier
Action 4 : Pilotage : Ville de Strasbourg Partenaire : Eco conseil et prestataire d’animation des jardins.
23

Ville de Strasbourg
Mission agriculture péri-urbaine
L’objectif du projet
Un projet alimentaire territorial ce sont toutes les actions qui concourent à faire le lien sur un territoire, entre les acteurs. De mon point de vue, nous faisons en réalité un PAT depuis 2010 puisque notre entrée est l’agriculture, ce qui est la belle colonne vertébrale d’un Projet Alimentaire Territorial. Par le prisme de l’alimentation, nous avons également travaillé sur les circuits courts et l’approvisionnement des cantines. Notre usager est l’agriculteur et avec le PAT nous intégrons aussi l’approche par les consommateurs. Nous déportons notre regard et nous voyons les deux points de vue pour qu’ils se rencontrent mieux.
Au début notre entrée n’était pas précisément sur l’alimentation mais les circuits-courts. Les élus avaient la volonté de faire un Plan Climat où il y avait plusieurs champs de réflexion, dont le transport pour diminuer le bilan carbone. Les élus sont donc partis du principe qu’il fallait un approvisionnement local de la ville pour réduire cette pollution. Nous avons ensuite établi un échange sur cette base avec la Chambre d’Agriculture qui a fait un diagnostic. Nous avons vu qu’il y avait essentiellement des grandes cultures céréalières donc comment faire un approvisionnement local ? Nous avons donc souhaité favoriser la diversification et la conversion à l’agriculture bio.
Dans le cadre du PAT, une collègue a travaillé sur la santé. Une action s’est ainsi montée avec l’Agence Régionale de Santé mais c’est l’appel à projet du Ministère qui a créé la transversalité entre nos deux démarches. L’agriculture est structurante d’un projet alimentaire mais elle ne couvre pas la totalité de la question. Mon travail est d’amener des débouchés aux producteurs, qu’ils puissent amener leurs produits à tout le monde. C’est comme cela que j’aborde les habitants, mais le consommateur je ne le caractérise pas. Tous les habitants sont des consommateurs. Pour mes collègues du service social et de la santé c’est différent, ils ciblent des actions en fonction de publics circonscrits.
D’où vient la démarche
Notre élue référente est Mme Buffet. En 2008 elle était en charge des espaces verts, de la réserve naturelle et de l’agriculture. En 2014 l’équipe est reconduite aux élections. Mme Buffet est toujours en charge de l’agriculture mais aussi de l’éducation. Dès l’origine elle a mobilisé la Chambre d’Agriculture au sein de laquelle nous avons ensuite trouvé des interlocuteurs volontaires. Il y a une volonté politique forte, constante.
Nos 4 axes de travail sont le foncier, la production, les circuits de distribution, la communication. L’ambition est de recréer un lien ville-campagne. Notre programme d’actions a été signé lors du premier évènement « ferme en ville » en 2010.
« Notre politique repose sur la pérennisation du foncier, le développement d’une agriculture durable, les circuits courts, le lien citadins-producteurs »
Activité : Mise en œuvre de la stratégie de développement d’une agriculture durable et de proximité sur le territoire de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. Ville : 263 941 habitants 3 529 hab/km² Chef-lieu du Bas-Rhin et capitale régionale 1ère ville de la région par le nombre d’habitants intra-muros et 7ème de France Responsable : Anne Frankhauser Contact : 03 68 98 65 61 [email protected]
Carte d’identité
24

L’Eurométropole et la Ville n’ont pas de compétence en matière agricole mais s’appuient sur des compétences qui leur sont propres pour légitimer leur partenariat avec la Chambre d’Agriculture et l’OPABA. Ainsi, la ville s’est appuyée sur sa compétence de gestion et d’organisation des marchés alimentaires pour valoriser les producteurs et les revendeurs. Ainsi elle a pu établir la charte des producteurs de la ville. Le procédé est le même pour toutes les actions. Pour le magasin d’agriculteurs, comme la ville est propriétaire du local, elle a pu réaliser les travaux de mise aux normes. Elle a, parallèlement, établi un cahier des charges et lancé un appel à candidature pour constituer le collectif d’agriculteurs qui sera son locataire et approvisionnera le magasin. Enfin, la ville a utilisé le levier des marchés publics pour orienter progressivement l’approvisionnement des cantines scolaires vers les produits bio locaux.
De son côté, l’Eurométropole, en tant qu’autorité de planification et d’aménagement du territoire, élabore le PLU et accompagne les communes dans son application via l’instruction des demandes de permis de construire. On a donc une entrée pour intégrer les questions agricoles dans le PLU et utiliser la force réglementaire de celui-ci pour servir la protection des terres agricoles et le développement des projets de diversification. Nous avons ainsi pérennisé 850 ha de terrains agricoles ou naturels. De plus, la Chambre d’Agriculture a recensé les différents projets des entreprises agricoles et les besoins de construction, suite à quoi nous avons défini des paliers de constructibilité : la zone A est en principe non constructible mais si un agriculteur veut mettre des serres, son terrain sera classé en A2. Pour l’élevage les besoins sont différents. Il y a une règle de réciprocité. Il ne peut pas y avoir d’élevage à moins de 100 mètres de zones urbanisées sinon il y a des nuisances, des plaintes, des conflits. Donc nous classons en A5 les zones de constructibilité pour l’élevage en prenant soin de les mettre suffisamment à distance des zones habitables.
Ville et Eurométropole, en tant que propriétaires de foncier agricole, peuvent envisager d’introduire des clauses environnementales dans leurs contrats pour amener l’agriculture à progresser vers plus de biodiversité, établir des liens avec la trame verte et bleue. Sur les 500 ha dont nous sommes propriétaire, nous l’avons fait sur plus de 100 ha. Ces clauses visent la création de haies, le maintien de prairies, la réduction des intrants, la pratique de l’AB etc. Nous avons trouvé un point d’équilibre là-dessus. Le propriétaire peut imposer des clauses au moment de la conclusion du contrat et à l’occasion de son renouvellement (tous les 9 ans). Mais, il nous faut rester pragmatiques : les objectifs sont discutés avec les locataires et co-portés au sein du comité de pilotage.
Ce comité de pilotage intègre des représentants des maires de l’Eurométropole, des représentants du monde agricole et il est présidé par une élue, Mme Buffet. Les financeurs : Agence de l’Eau, DRAAF et la DDT sont là également. Au début du comité de pilotage tout le monde était à la fois curieux et peut-être un peu inquiet. Au fil des échanges, chacun apprend qu’il est possible de faire état des problèmes et différents points de vue. C’est un lieu où l’on apprend à se connaître entre ville et campagne. A chaque réunion, nous voyons l’intérêt de ce lieu d’échange. Les agriculteurs découvrent ce que les élus ont à gérer, les comptes qu’ils doivent rendre aux habitants, les questions auxquelles ils doivent répondre sur les activités agricoles et leur impact sur l’environnement, les nuisances etc. Les élus comprennent que les agriculteurs gèrent une entreprise, sont leur propre patron, quels sont leurs besoins de fonctionnement etc.
Depuis 2010, la Chambre d’Agriculture et l’OPABA passent une convention de financement avec Eurométropole qui leur permet de dégager des ressources humaines pour la mise en œuvre de chaque programme d’actions sur 2 ans. Par ces conventions, des ressources humaines sont dédiées au sein de ces organismes.
Le budget de l’Eurométropole est appuyé de manière significative d’une subvention de l’Agence de l’Eau. Cela permet de financer en interne 2 postes : un au développement économique, le mien, le second à l’environnement. Par ces deux postes, nous traitons de l’agriculture professionnelle. L’agriculture urbaine, envisagée sous l’ange du jardinage amateur, est prise en charge par le service espace vert.
« Le PLU est un outil essentiel pour servir la politique agricole. »
« Nous sommes devenus pragmatiques : les objectifs sont discutés et co-portés au sein du comité de pilotage. »
« Le comité de pilotage est un lieu où on apprend à se connaître entre ville et campagne. A chaque réunion, on voit qu’on a besoin de ce lieu d’échange ».
25

Au cours de la période de démarrage (2010/2014) nous avons posé les principes de fonctionnement, la méthode de travail. S’agissant des projets urbains, nous procédons d’abord à un diagnostic agricole. Nous informons ensuite les agriculteurs du projet envisagé, de son périmètre et de son calendrier. Nous attribuons une indemnisation à l’agriculteur en fonction d’un protocole d’accord établi avec la profession en 2016, ce qui leur donne de la lisibilité. Enfin, nous intégrons dans la mesure du possible une dimension agricole dans le projet par exemple le volet agro-parc (magasin d’agriculteurs, restaurant de produits locaux et surface maraîchère bio) à l’occasion des travaux de modernisation de la zone commerciale nord. Les procédures que nous avons mises en place doivent permettre de tenir compte des besoins des agriculteurs et de les aider à redéployer leur activité alors même qu’ils perdent des terres. La Chambre d’Agriculture nous aide à trouver des solutions acceptables et opérationnelles.
En 2014, plusieurs projets ont abouti comme le magasin de la Nouvelle Douane. Le PLU est amorcé et sera finalisé en 2016. A la Meinau, proche du centre-ville, nous avons installé un jeune agriculteur sur un îlot urbain de 10 ha. En 2012, il y avait là 2 familles d’agriculteurs céréaliers. Par échange de terrains, l’une des familles est sortie du périmètre, laissant l’autre (deux frères) libres d’envisager une diversification des cultures sur le site. Ils ont développé leur projet avec le concours d’un jeune maraîcher, sous couvert d’une société commune. Ce parrainage inédit a facilité l’installation du jeune maraîcher notamment en lui ouvrant les portes des banques. Les parrains, toujours céréaliers, continuent de développer leur activité cœur de métier sur leurs autres surfaces.
Il est important de ne pas monter une agriculture contre une autre. Avec la Chambre d’Agriculture nous avons pris conscience des limites d’une approche clivée. De toute façon, le code rural protège les agriculteurs, et en quelque sorte fige les choses. Donc, plutôt que de fixer un objectif trop élevé et radicalement différent de l’agriculture existante, nous avons pris le parti de travailler avec tous les agriculteurs (céréaliers, maraichers, éleveurs – doubles actifs ou non) pour leur faire monter à tous une ou plusieurs marches, selon leurs capacité et volonté.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Notre principale limite est le temps. Nous aimerions doubler la surface de maraîchage : arriver à 400 ha de plus grappillés sur les 8000 de céréales mais nous n’y sommes pas encore. Il faut du temps pour que les agriculteurs se positionnent et développent leur projet. Nous comptons sur le changement générationnel. De plus, les opportunités foncières sont peu nombreuses. Enfin, d’après le code rural lorsqu’il y a un contrat avec un agriculteur, la ville propriétaire ne peut pas reprendre le terrain pour lui substituer un maraîcher bio. L’éviction de l’agriculteur n’est en effet possible que s’il y a un projet urbain (qu’il déclenche ou non une Déclaration d’Utilité Publique). En cas d’éviction, des indemnités sont dues à l’agriculteur (voir protocole d’accord 2016). On pourrait imaginer qu’en dehors des hypothèses de projets urbains, la collectivité négocie le départ volontaire d’agriculteurs mais cela aurait nécessairement une incidence sur les finances publiques ; s’il est difficile de généraliser, il faut compter une indemnité proche de 100 €/are. Or, le revenu généré par la location de terres agricoles est relativement faible (en moyenne 1€ pour 1 are/an alors qu’un appartement de 50 m² doit rapporter plus de 500 € par mois).
« On aimerait doubler la surface de maraichage mais il faut du temps pour que les agriculteurs se positionnent et développent leur projet. Nous comptons avec le changement générationnel ».
26

Cette situation s’est néanmoins présentée pour un terrain sur lequel allait peser une contrainte environnementale nouvelle du fait du classement du site en réserve naturelle. Pour le locataire céréalier, ce classement allait générer de nouvelles contraintes sur son exploitation. Il a préféré entrer avec nous dans une démarche de collaboration et envisager un arrangement conduisant à la libération du terrain. Celui-ci est aujourd’hui occupé par un troupeau de Highland Cattle.
Il y a aussi une évolution dans les sujets traités. Durant les 4 premières années nous avons parlé de questions économiques, c’est-à-dire de l’agriculture sous l’angle de l’entreprise, sa rentabilité. Nous avons compris qu’il ne fallait pas la contraindre mais l’accompagner dans ses projets. C’est pourquoi le premier poste créé l’a été sur la question du développement économique. Cela a été un signal pour la profession et a facilité la compréhension entre les participants. Les agriculteurs connaissent nos orientations, ils nous font part de leurs projets pour trouver l’appui nécessaire pour les mettre sereinement en œuvre.
Aujourd’hui nous abordons une nouvelle dimension : la qualité de l’air, de l’eau, la biodiversité, et ces sujets semblent plus difficiles. Avec le thème économique, on touche au foncier et le foncier est l’outil de travail des agriculteurs. La question du foncier a été débattue et ça n’a pas été facile. Aujourd’hui sur le thème de l’environnement, il est peut-être plus difficile de rassembler les gens. Il y a par exemple l’enjeu des compensations environnementales : un aménagement urbain consomme du terrain agricole et, parfois, nécessite de mettre en place des compensations environnementales ; il faudra les négocier avec les agriculteurs. Mais, comment mettre ceux-ci autour de la table pour leur faire accepter une contrainte supplémentaire ? Quels sont les leviers ?
En 2010 nous avons fait faire une étude sur l’importance des circuits courts dans les habitudes de consommation. Le résultat était que 90% des ménages de l’Eurométropole achètent leurs produits alimentaires en grande surface et 10% autrement : sur internet, les marchés, les magasins spécialisés. On ne l’a pas refait récemment mais aujourd’hui ce serait peut-être 80 % en GMS au lieu de 90% ? Je pense que la tendance est vers le bio et le local. Entre 2012 et 2014 le nombre de paniers distribués a doublé. Entre 2014 et 2016, il est constant. Mais comment dépasser ces 10% ?
Pour ce qui est de la sensibilisation des consommateurs nous n’aurons jamais fini. Tous les 2 ans il y a de nouveaux scolaires à la ferme en ville. Le travail sur les mentalités est à faire en permanence. La question alimentaire est un travail sans fin alors que le travail sur le foncier a une fin (de manière temporaire du moins) : c’est le basculement dans un zonage à urbaniser ou pas.
Agriculteurs et consommateurs, les deux sont liés. Si les habitants consomment des produits locaux, les producteurs auront des débouchés.
« Le travail sur les mentalités est à faire en permanence ».
« Agriculteurs et consommateurs, les deux sont liés. Si le consommateur est incité à consommer local, le producteur aura des débouchés.»
27

“Vivamus porta est sed est.”
« Il faut aussi un financement pour l’animation qui est plus souvent oubliée. Pour les investissements, on trouve toujours un banquier ».
« Il ne faut pas oublier que la conversion au bio n’est pas dominante dans le système actuel »
Pour en savoir plus :
Exemple d’agroquartier :
http://www.adirobertsau.fr/la-creation-de-notre-projet-agro-quartier-est-en-bonne-voie/
Apparemment, la région va abandonner toutes les aides à la certification en bio pour ne garder que les aides à l’investissement. C’est un parti pris qui évidemment peut se justifier, mais la formation et la certification sont nécessaires. Le financement de l’animation est plus difficile à obtenir que le financement d’un investissement. Or, ces aides à la certification pouvaient nous aider dans nos démarches d’animation et de sensibilisation pour mobiliser des producteurs et les amener à la conversion de leur entreprise à l’AB, même si ce travail reste aléatoire, car l’agriculteur est un chef d’entreprise, libre de ses décisions.
Il ne faut pas oublier que la conversion au bio n’est pas dominante dans le système actuel donc les institutions qui souhaitent œuvrer dans ce sens doivent développer des outils d’incitations forts. Les financements pour accompagner la conversion étaient significatifs dans la région Alsace.
Le fait que la DRAAF ait porté notre projet à l’échelon national est précieux. Ce financement PNA va relancer notre dynamique.
Notre méthodologie est acquise. Nous savons comment faire, les agriculteurs savent qu’ils peuvent compter sur nous et qu’ils doivent compter avec nous. Mais plus globalement, il y a peut-être des acteurs que nous n’associons pas à la démarche et ce serait peut-être une clef pour que la démarche avance plus vite.
28

Ville de Strasbourg Approche sociale et santé
L’objectif du projet
Le Projet Alimentaire Territorial de Strasbourg intègre désormais un volet santé touchant des publics en difficulté sur le plan socio-économique. C’est le sens du programme Preccoss, piloté par la ville de Strasbourg, qui prend en charge les enfants obèses sur la base d’une prescription du médecin traitant. Il s’agit d’une démarche à la fois individuelle et collective avec un suivi adapté (psychologique ou nutritionnel) en fonction du besoin de l’enfant.
Ce programme a démarré en septembre 2017 et est nouveau pour nous : le principe sera de sélectionner des familles par quartier dans 6 quartiers en politique de la ville. La diététicienne qui connaît bien les familles et s’appuie sur une grille d’identification, en sélectionne 10 par quartier puis nous organisons un atelier avec un panier de présentation. Ce n’est pas un projet nourricier. Nous voulions que ce soit à but pédagogique donc nous distribuons les paniers à l’occasion d’un atelier. Ensuite, avec les parents on cuisine, on explique comment cuisiner un potiron et d’autres légumes, et à la fin de l’atelier chacun repart avec son panier. Voilà pour le déroulé prévu.
Nous sommes actuellement en phase de recherche d’une diététicienne et d’un prestataire pour faire le panier, le stocker, le livrer. Nous recherchons un prestataire en circuit court et en bio si possible. Idéalement, nous aimerions passer par un prestataire qui soit aussi une entreprise d’insertion.
D’où vient la démarche
Nous travaillons déjà avec la DRAAF dans le Contrat Local de Santé qui est le document cadre de la politique de santé de la ville et qui entre dans le cadre de la politique de santé de la ville où est développé le Preccoss. L’Agence Régionale de Santé est tête de pont et la DRAAF en est partenaire.
C’est la première fois que nous répondons à l’appel à projet PNA. Nous avons fait une réponse commune avec le service agriculture urbaine pour proposer cette distribution de paniers de fruits et légumes.
Le panier est gratuit pour les familles tout comme le reste du programme Preccoss. Des paniers sont financés par le PNA et nous finançons la diététicienne. Le PNA finance 8000 euros sur les 11600 euros du coût total.
« Le service santé publique et environnementale de la Ville de Strasbourg porte chaque année des actions de prévention et de promotion de la santé en cohérence avec les besoins et les demandes identifiées par les habitants et les relais territoriaux sur les quartiers ».
Activité : Volet social lié à l’approche alimentaire Responsable : Elodie Signorini, responsable du dispositif Precoss Céclia Jagou, chargée de mission santé Contact : 03 68 98 64 88 [email protected] 03 68 98 64 36 [email protected]
Carte d’identité
29

Pour en savoir plus :
http://www.strasbourg.eu/fr/vie-quotidienne/solidarites-sante/sante/prevention-promotion-sante
Autres initiatives hors PAT
Au niveau du service santé, nous menons un travail sur le goûter matinal : la ville depuis les années 50 distribuait des briquettes de lait entier puis est passée au demi-écrémé et pour les écoles volontaires aux fruits et légumes une fois par semaine. Nous avons monté un dossier auprès de France Agrimer pour obtenir un co-financement à 76% de l’union européenne. Il y a 26 écoles concernées en quartier prioritaire ou non. Ces distributions sont inscrites dans des projets pédagogiques qui peuvent prendre différentes formes : jardin pédagogique, centre de sensibilisation à l’environnement avec atelier sur la pollinisation, découverte des goûts etc. Actuellement, nous passons par un nouveau prestataire, une entreprise d’insertion, pour nous fournir.
Mais nous avons arrêté la distribution de fruits à partir de la rentrée 2017 car après un bilan, nous avons réorienté l’action vers l’incitation pour accentuer la prise d’un petit déjeuner avant l’école. En effet, en supprimant la collation de 10h, les enfants ont plus d’appétit donc il y a moins de gaspillage sur le midi.
Nous allons financer des associations comme un centre socio-culturel qui propose d’organiser 3 à 8 petits déjeuners pédagogiques dans certaines écoles. Avec l’entreprise d’insertion le travail continue. A chaque occasion pertinente nous proposons de faire appel à eux. Sur les paniers Preccoss nous préconiserons de faire appel à eux.
Au niveau du service insertion, un travail a été envisagé sur les bons alimentaires : pour permettre aux personnes dans le besoin d’acheter des choses dans les grandes surfaces et avec l’idée qu’ils puissent s’approvisionner sur d’autres types de produits. Peut-être que cela existe dans certains quartiers. Certains centres médico-sociaux proposent des ateliers spécifiques avec paniers fruits et légumes.
« Ce n’est pas un projet nourricier.
Nous voulions que ce soit à but pédagogique donc les paniers sont distribués à l’occasion d’un atelier ».
30

HAUTE-MARNE
31

Département de la Haute-Marne
Circuits courts et demande des consommateurs
AXE PRINCIPAL
La démarche initiée par la Chambre d’Agriculture de juillet 2016 à janvier 2017 visait à développer de nouvelles formes collectives fermières à Saint-Dizier. L’objectif des élus qui supportent la démarche est le soutien à l’emploi local et le développement d’une identité de territoire. Le projet financé consiste en une mobilisation des producteurs et une rencontre avec les consommateurs à travers une série d’évènements. A moyen ou long terme l’objectif est de développer les produits locaux dans la restauration collective.
5 PHASES
Témoignages d’acteurs à proximité (magasin de producteurs à Chaumont, commerce de bouche en Haute-Marne) et voyage d’étude dans les Ardennes et à Dijon.
Analyse des ressources locales et du potentiel de développement par une enquête auprès des producteurs.
Consolidation du groupe projet par 4 jours de formation par VIVEA Ecoute des besoins par une rencontre consommateurs/producteurs lors
de soirées « rencontre du terroir ». Formaliser les projets et actions à prévoir (mise à disposition de foncier
ou immobilier, communication, restauration collective, etc).
D’autres initiatives sur la Communauté de communes de Vingeanne Auberive Montsaugennais émergent et le pays de Langres démarre une réflexion sur un Projet Alimentaire Territorial.
Plusieurs démarches, essentiellement dans le domaine agricole, montrent une volonté de faire émerger de nouvelles démarches et rendre visibles les actions existantes.
Département de la Haute-Marne 437 communes 180 673 hab (2013) 29 hab/km² Secteurs concernés : 23 300ha agricoles (agriculture et élevage) de la communauté d’agglomération Saint Dizier-Der&Blaise Service porteur : Chambre d’Agriculture Responsable du projet : Gratienne Edme-Conil. Contact : 03 25 35 00 60 [email protected]
Carte d’identité
32

Liste des acteurs impliqués
Chambre d’Agriculture de la Haute Marne
producteurs Communauté
d’agglomération de Saint-Dizier
Associations du réseau de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne : ADMA (pour la diversification agricole), Frab, Gab52 (Groupement AgroBio), APVA (association de production végétale et agronomie), HMCE (Haute Marne Conseil Elevage), syndicalisme agricole,
Chambre d’Agriculture de la Marne et de la Meuse
Autres Projets Le drive fermier de Saint-Dizier :
Ouvert en 2015, il rassemble 15 producteurs de la Haute-Marne et de la Meuse qui adhèrent au réseau Bienvenue à la ferme et/ou sont labéllisés AB.
http://www.drivefermiersaintdizier.fr/qui-sommes-nous
Dynamiques individuelles :
Renouveau d’activité comme la Brasserie artisanale du Der, l’élevage d’écrevisse, la culture du safran ainsi que des producteurs en diversification : confiture et gîte à la ferme etc.
Pour en savoir plus :
ADAMA : http://www.terroir-hautemarne.com/
Relais terroir haute marne :
http://terroir-hautemarne.com/relais-terroir-haute-marne.html
AOP Langres : http://fromagedelangres.com/filiere.html
“Vivamus porta est sed est.”
L’essentiel des initiatives se trouvent dans la partie Sud du département : autour de Chaumont et Langres. En dehors de la dynamique autour de l’association ADMA et des démarches de la Chambre d’Agriculture, les actions sont atomisées et sporadiques, sans dynamique collective.
1/ ADMA : association pour la diversification de l’agriculture
créée en 1993. Visant à encourager les projets innovants, elle accueille des agriculteurs ou futurs agriculteurs pratiquant l'accueil à la ferme, la production ou la transformation de produits fermiers mais aussi des entreprises artisanales en lien étroit avec le terroir.
Elle fédère ses adhérents autour de projets communs de développement des filières locales et de promotions des produits locaux. Elle travaille avec la Chambre d'Agriculture et divers partenaires locaux (Collectivités territoriales, Etablissements scolaires, Maison Départementale du Tourisme, Gîtes de France, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre de Métier et de l'Artisanat, Grandes et Moyennes Surfaces ...).
2/ Marque relais terroir Haut Marne
Créée par l’ADMA et la Chambre d’Agriculture, la marque "Relais Terroir Haute-Marne" s'adresse aux restaurateurs, traiteurs, petits commerçants ou artisans. Elle renforce la visibilité des produits locaux et encourage les distributeurs et professionnels de la restauration à les proposer. Les professionnels qui y participent adhèrent à une charte.
3/ AOP de Langres
en 1991, différents acteurs de la filière décidèrent de se réunir au sein d'un Syndicat Interprofessionnel. Créé en décembre 1981, ce Syndicat s’est donné pour mission de défendre et promouvoir le fromage de Langres. En 2014, 19 éleveurs ont produit du lait destiné à la fabrication de l'AOP Langres, assurée par 3 fromagers (dont un producteur fermier) employant 50 personnes.
En Haute-Marne se trouve aussi l’IGP emmental, gruyère, l’appellation époisse.
4/ Expérimentation dans 2 collèges
Une action de lutte contre le gaspillage alimentaire au collège de Bourbonne les bains et approvisionnement local au collège de Châteauvillain notamment, ont été intégré à une démarche d’éducation alimentaire.
33

Mobiliser les agriculteurs
« L’appel à projet de la DRAAF a été très précieux pour nous, cela légitime le travail sur ces thématiques auprès de nos élus et cela remotive pour continuer. Cela crée aussi un fléchage de financement directement et clairement là-dessus. »
Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne
L’objectif du projet
Notre objectif est de mobiliser des agriculteurs pour créer des circuits courts. En effet, nous sommes de plus en plus sollicités par faire de l’approvisionnement local auprès des écoles, EHPAD, GMS. Nous avons répondu à l’appel à projet PNA car d’un côté nous faisions l’accompagnement du drive de Saint-Dizier et de l’autre nous menions une réflexion sur la création d’une AMAP à Saint-Dizier. La Chambre d’Agriculture s’est fait le relai auprès des agriculteurs pour qu’ils s’y intéressent.
Mais il n’y a pas de mobilisation du côté des producteurs qui ont déjà leur organisation avec leur circuit d’écoulement et ceux qui sont en circuits courts se tournent vers Bar le Duc. Dans le Nord de la Haute-Marne c’est une agriculture de céréales/élevage de grande dimension. Comment faire dans ce cas ? Nous sommes preneurs d’idée d’action.
Lors des sessions de chambre, j’interviens pour les sensibiliser mais cela a peu d’effets. En ce qui concerne les collectivités, pour le moment, ce n’est pas dans leurs priorités. Je suis intervenue en réunion auprès des animateurs de collectivités pour créer de la réserve foncière en fonction des types de sol mais il y a de nombreuses restrictions à cette démarche. Le mouvement est plutôt en faveur de la construction, avec l’appui de la DDT.
Le Conseil Départemental a créé des légumeries dans les collèges. Il salarie ainsi du personnel et maintient une population dans le territoire.
Quand il y a une personne qui cherche un terrain et qu’il y a un changement d’affectation, on écrit aux Pays et Communautés de Communes. En 2010 un pépiniériste a réussi à trouver un terrain comme cela, grâce à notre mise en contact. Un maraîcher aussi en 2016. Il y a des communes qui cherchent à capter un nouveau porteur de projet mais à part cela, il n’y a pas de démarche en amont (réserve foncière etc).
D’où vient la démarche
Fin 2015, nous avons répondu à un appel à projet de l’ancienne région Champagne-Ardenne. Le Pays de Langres avait envie de travailler sur l’économie territoriale. Il a choisi de candidater avec 2 projets, d’une part pour accompagner une recyclerie et d’autre part, à la demande de la Communauté de Communes du Bassigny, pour développer des circuits courts et l’approvisionnement local dans les écoles. Ainsi en 2016 nous avons mené une animation sur ce thème dans cette Communauté de Communes.
Activité : Mobiliser les agriculteurs pour s’engager en local, Relier agriculteurs et consommateurs, rechercher la sécurisation des débouchés, mobiliser les élus sur le travail foncier. Responsable du projet : Gratienne Edme Conil Attachée de direction / Responsable des relations territoires et filières Contact : 03 25 35 03 12 [email protected]
Carte d’identité
34

“Vivamus porta est sed est.”
« Chez nous, c’est la relation humaine qui peut être un déclencheur »
Depuis 2008, avec la GMS, nous menons des animations régulières en rayon avec des produits d’épicerie : nous travaillons avec le miel, le vin et le champagne mais nous n’avons rien sur le lait, les légumes, la viande et le fromage. Nous devons rassurer les poducteurs, notamment sur la quête du foncier mais aussi sécuriser les débouchés.
Il y a les assises régionales sur les filières. Nous y allons pour travailler auprès de la GMS. Pour motiver nos agriculteurs, nous avons besoin que la GMS s’engage sur un prix par produit. Il y a l’enseigne Leclerc qui est motivée, très ancrée sur le territoire. Depuis 1993 elle travaille sur les viandes du terroir. Ils travaillent aussi sur le concombre, les laitues, le fromage. Les producteurs ne sont pas non plus motivés par l’approvisionnement des cantines puisque les appels d’offre sont annuels donc remis en jeu chaque année. Plusieurs agriculteurs nous disent que pour investir et avoir l’appui des banques ils ont besoin d’une contractualisation fiable. Nous allons aborder le circuit court autrement, pour aider les agriculteurs diversifiés ou en projet de diversification, à travailler ensemble et à se faire connaître. Nous allons proposer l’organisation de marché fermier à la ferme (souplesse d’organisation, attractivité des sites pour les ménages).
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
L’engagement des consommateurs n’est pas évident non plus. Ce n’est pas évident pour eux de s’engager dans une AMAP. Nous avons mené plusieurs ateliers pour créer une AMAP, nous avons touché 200 personnes et nous avons eu 60 répondants à nos questionnaires, nous avons organisé des rencontres avec les agriculteurs mais très peu de personnes étaient prêtes à s’engager.
Chez nous, c’est la relation humaine qui peut être un déclencheur. Nous pourrions développer la rencontre et la vente à travers des animations « diététiques » mais la Chambre d’Agriculture est-elle légitime pour cela ? De même pour parler avec les acteurs de la transformation, nous devons travailler avec la Chambre des Métiers. Il faut rester dans le périmètre qui est le nôtre et il faudrait plus de possibilités de partenariats avec les autres chambres consulaires.
Si la DRAAF soutenait un club d’entreprise et d’échange, cela nous serait très utile. Nous avons besoin de partage de méthodes et de résultats, de favoriser l’émergence d’interprofessions.
Notre point fort concernant les circuits courts, est que tout le monde en a envie. C’est le facteur de convivialité qui permet de maintenir l’envie. L’appel à projet de la DRAAF a été très précieux pour nous, cela légitime le travail sur ces thématiques auprès de nos élus et cela remotive pour continuer. Cela crée aussi un fléchage de financement directement et clairement là-dessus. L’approche par projet permet aussi d’adapter les actions prévues à la manière dont les choses se déroulent réellement. Contrairement à une politique publique habituelle, nous avons plus de marge d’adaptation. En revanche, comme nous n’en sommes qu’aux prémisses, lorsque le financement s’arrête, il y a un fort risque que la dynamique retombe.
Notre point faible est que les liens ne sont pas encore là. Les consommateurs n’ont pas encore pris conscience que le commerce local ce n’est pas qu’une question de prix, c’est aussi un mode de vie, un cadre de vie. Les GMS font partie intégrante du commerce local : c’est ce que l’on y achète qui fait la différence. Acheter localement suppose de consommer et s’organiser différemment. Les GMS souhaitant vendre du local sont souvent gênées par leurs concurrents pratiquant une politique de prix bas.
Le point faible, c’est de trouver le moyen de sécuriser les débouchés. Par exemple, une Communauté d’Agglomération cherchait un approvisionnement local et a orienté son appel d’offre sur la qualité alimentaire pour justifier le choix du local par la fraîcheur des produits. Le transformateur qui a répondu était une entreprise récente et montrait insuffisamment de garanties aux yeux des élus. Sodexo a obtenu le marché.
Pour en savoir plus :
http://www.haute-marne.chambagri.fr/kit/index.php
35

L’objectif du projet
Nous réalisons de la production maraîchère biologique au sein de notre établissement. Si nous avions un financement pour accompagner les porteurs de projet qui le réalisent, nous pourrions le développer.
Je suis aussi représentante de l’établissement scolaire au Conseil de Développement Territorial du Pays de Langres. Dans ce cadre nous avons une saisine du Président du Pays de Langres (Charles Guéné, également sénateur) pour développer les circuits couts dans l’alimentation collective publique. Cette démarche démarre tout juste et nous allons bientôt avoir notre premier groupe de travail.
D’où vient la démarche
Le centre où je travaille est constitué de 3 centres : un lycée professionnel horticole, une exploitation horticole et le centre que je dirige qui est un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole. Dans le centre de formation pour adulte nous développons le brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole dans une orientation maraîchage biologique.
Sur notre exploitation nous avons un atelier de maraîchage biologique. Cet atelier est le support d’un espace test. Nous accueillons des stagiaires titulaires du diplôme qui peuvent pendant un an préparer leur projet d’installation. Le Conseil Régional Grand Est les rémunère/indemnise à hauteur de 700 euros par mois. Ils ne sont pas forcément issus de cet établissement.
Nous avons développé un circuit court pour notre production de légumes bio. Le reste est de la production florale, une pépinière ornementale et fruitière, la production d’osier et le service en espace vert.
Nous pouvons même parler de circuit extrêmement court car une bonne partie de la production est consommée au restaurant de l’établissement (Lycée, centre de formation, collège et école primaire). Cela représente environ 300/350 repas par jour (le soir avec les internes c’est 100 repas). La part des produits utilisés pour faire les repas provenant de notre exploitation représente 5 à 10 % pour les 90 % restants ils proviennent de notre fournisseur Pomona qui se trouve à Dijon.
Le reste de notre production est vendu sur un petit marché sur l’établissement qui se tient tous les jeudis avec un accueil des gens du territoire. Le personnel de l’établissement peut réserver avant ou aller au marché directement. Nous commercialisons aussi via la Ruche Qui Dit Oui : sur la commune Torcenay (village).
Si il reste encore du surplus nous l’offrons à la régie rurale du plateau de Langres. Récemment nous avons donné 120 salades. Cette régie est dans le réseau jardin de cocagne, c’est une structure d’insertion.
Former les futurs maraîchers biologiques et prendre part aux projets territoriaux
« Le premier angle d’attaque, s’il ne fallait en choisir qu’un, c’est le monde de la formation pour développer la prise de conscience par les jeunes et les adultes ».
Activité : Formation initiale et continue au maraîchage biologique et commercialisation en circuit très court Responsable du projet : Josiane Moilleron Directrice du CFPPA Contact : 03 25 88 59 90 [email protected]
Lycée agricole Fayl Billot et Pays de Langres
Carte d’identité
36

« La population va plus vite que
la décision politique »
Pour ce qui est du Pays de Langres, le Président avait déjà saisi notre commission pour répondre au PACT de la ruralité. Nous avons de l’expertise de territoire grâce à la diversité de composition de notre commission issue de la société civile.
Il est aussi Président de la Communauté de Communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais et a impulsé un changement sur la restauration du collège dans le Prauthoy pour qu’il s’approvisionne en produits locaux. Tout le monde s’y retrouve : les producteurs locaux, les élèves, le personnel et il y a moins de gaspillage alimentaire. C’était associé à des actions pédagogiques pour développer la relation à la nourriture. Dans sa Communauté de Communes il a aussi expérimenté cela dans quelques écoles puisqu’il a la compétence scolaire. Il sous-traite à un restaurateur local et a demandé à ce restaurateur de s’approvisionner auprès de producteurs locaux. Fort de cette expérience il souhaite l’étendre au territoire du Pays de Langres
Dans la communauté de communes où je suis élue ce sujet n’est pas prioritaire. Les priorités sont l’activité économique, le nœud ferroviaire à Challindri, la vannerie à Fayl Billot.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Nous avons eu justement un débat hier en réunion d’établissement sur le fait de développer ou pas la production de notre exploitation. La réponse pour le moment est non car la production de légumes est conditionnée au fait d’avoir un porteur de projet. Le problème est de financer un encadrant du porteur de projet. Actuellement nous n’avons plus ce financement. L’encadrant était financé à temps plein puis mi-temps. C’était un financement Etat / DRAAF/ Conseil Régional et on vient d’apprendre que le financement a été supprimé. C’était un programme Champ-ardennais et il s’est perdu à la refondation des régions.
Notre production de légume ne permet pas de financer le poste du porteur de projet qui touchait 700 euros de la région Grand Est sur convention de pré-installation.
Pour ce qui est du lien contenant/contenu pour travailler avec des Amap, notre exploitation donne à la régie rurale du plateau de Langres et nous les avons initiés à la vannerie via un stage mais cela est resté sans suite.
Je ne connais pas d’Amap qui utilise des paniers de vannerie et il faudrait les consigner : un panier coûte 70 euros. Notre concurrent c’est la cagette gratuite !
Enfin je réalise mon premier mandat d’élue à Fayl Billot. Par rapport au sujet qui vous préoccupe, j’ai déjà essayé d’impulser l’idée de faire tous les vins d’honneur de la mairie avec des produits locaux et de la vaisselle plutôt que de manger des biscuits apéritifs industriels et de boire dans des gobelets en plastique. En réalité c’est assez compliqué, je n’ai pas beaucoup d’écho alors que la personne qui s’occupe de l’évènementiel est elle-même gérante d’une crèmerie-fromagerie. Tant qu’il n’y aura pas de décision politique ça ne bougera pas. La population va plus vite que la décision politique.
37

Pour en savoir plus :
http://lpahorticole.faylbillot.educagri.fr/#ae-image-0
http://www.pays-langres.fr/petr-du-pays-de-langres-56
http://www.groupe-pomona.fr/
Ce dont nous aurions besoin c’est un tissu de professionnels plus dense car le territoire est dépeuplé avec une agriculture polyculture élevage non paysanne. Nous avons peu d’unités de production et elles ont du mal à se fédérer et faire la promotion de leurs produits. C’est difficile d’installer des maraîchers car ils ne trouvent pas de foncier. Par ailleurs les circuits courts n’empêchent pas la mauvaise qualité donc il faut savoir ce qu’on veut développer en priorité.
Nous sommes proches du Jura de la Haute Saône qui ont des plus petites productions faisant une plus-value grâce à leurs fruitières. Chez nous le fromage produit est le caprice des dieux qui vise l’exportation. Nous n’avons plus de fruitières.
Il est indispensable que les collectivités se constituent des réserves foncières, et travaillent avec la Chambre d’Agriculture pour mettre effectivement en œuvre la diversification. Nous avons en Haute Marne la superficie moyenne la plus élevée de France. Par exemple, le Président du Conseil Départemental a une exploitation de plus de 1000 ha. Enfin nous devons aussi repenser nos contenus de formation diplômante et les valoriser auprès de la Chambre d’Agriculture sur le volet environnemental. Elles sont actuellement marginales.
La Haute Marne n’a pas de centralité suffisamment attractive : Saint-Dizier est versé sur la Marne, je n’y vais jamais c’est à 140 km. La ville la plus proche est Dijon. La Haute Marne est écartelée par des polarités extérieures (Bar le Duc, Troyes, Dijon etc). Il y a peu d’identité.
Le Conseil Régional de Champagnes-Ardenne, appuyé par le groupe EELV, a décidé de faire un repas bio par mois dans les lycées. C’est comme cela qu’il a constaté qu’il n’y avait pas de production bio suffisante et c’est ainsi qu’a été créée notre filière de formation en maraîchage biologique.
Le premier angle d’attaque, s’il ne fallait en choisir qu’un, c’est le monde de la formation pour développer la prise de conscience par les jeunes et les adultes.
A la DRAAF, je ne connais que le service formation-développement. C’est une bonne chose d’organiser des rencontres décentralisées. Nous allons apprendre à connaître la DRAAF et les autres porteurs de projet.
38

L’objectif du projet
A partir de plusieurs initiatives pour fournir la restauration collective en produits locaux, nous avons l’ambition de développer un projet plus large, qui va au-delà et qui intègre l’enjeu de plus-value territoriale. Nous voulons aller vers un Projet Alimentaire Territorial même si nous n’en sommes qu’aux prémices. D’où vient la démarche
Il y a 1 an les élus de la Communauté de Communes dont le Président est Charles Guéné, Président du Pays de Langres, également sénateur, décident d’introduire des produits de qualité dans les cantines. L’objectif est triple : ré-ancrer la valeur ajoutée dans le territoire, lutter contre le gaspillage et développer la qualité alimentaire par des produits bio et locaux. En septembre 2016 les marchés ont été confiés à des restaurateurs locaux qui se sont engagés sur la qualité, le local et si possible le bio. 3 restaurateurs indépendants ont répondu. Un mois plus tard, les parents ont fait savoir leur satisfaction et ont remarqué le changement de qualité. Cela se voit aussi au niveau du gaspillage alimentaire qui est nettement moindre (avant, les repas étaient fournis par Sodexo). A partir de cela, 2 des restaurateurs se sont regroupés pour recruter un cuisinier en commun.
Ils fournissent à eux trois, 300 repas par jour pour les primaires et couvrent 50% des écoles du territoire. Les autres écoles sont alimentées par la cantine du collège de Prothoy. D’ailleurs, l’équipe de la cantine de ce collège est à l’initiative de l’introduction de produits locaux dans la cantine. En effet, la directrice, l’intendante et le cuisinier sont vraiment très intéressés par ces démarches. Ils mènent eux-mêmes les négociations avec les producteurs locaux.
C’est de leur initiative, mais on peut dire que cela s’inscrit dans une dynamique globale initiée par un projet de la Région en 2010 qui a amené des changements pour les lycées : davantage de produits bio et locaux, le financement de légumeries et la formation des intendants. Cette démarche ne s’est pas faite en un jour, elle se développe progressivement, à travers le temps. Cela a diffusé dans les différents échelons et le Département s’est approprié cette question. Il a mis en place une formation pour les cuisiniers. C’est le collège de Prothoy qui fait la formation.
Essaimer la restauration collective bio et locale
Activité : Chargée de mission au Ministère de l’Agriculture, autorité de gestion du Réseau Rural National. A été Vice-Présidente de la Région Champagne-Ardenne à l'ESS (EELV), actuellement élue de la CCAVM et déléguée du PETR, en charge d’une mission sur les circuits courts. Responsable du projet : Patricia Andriot Contact : 06 47 04 69 64 01 49 55 54 20 [email protected]
Communauté de Communes Auberive Pays de Langres
« A partir de plusieurs initiatives pour fournir la restauration collective en produits locaux, nous avons l’ambition de développer un projet plus large qui intègre l’enjeu de plus-value territoriale »
Carte d’identité
39

En ce qui concerne la démarche de notre Communauté de Communes, le point de départ est l’évolution d’une fromagerie qui vend du formage de niche (AOC Langres et Epoisses). Ce magasin qui faisait moins de 50m² déménage dans un autre local qui fait 200 m². La Communauté de Communes finance la reconstruction de la fromagerie par un crédit bail et en contrepartie peut discuter afin de décider plus collectivement du rôle de ce local. Nous étions chargés de contacter les producteurs locaux pour achalander ce nouveau magasin.
Le Président m’a confié cette mission et j’ai demandé que nous menions une démarche globale. Nous nous sommes mis d’accord sur une méthode : nous avons réuni les utilisateurs, publics et privés, des produits locaux pour connaître leurs besoins avant de démarrer quoi que ce soit. Il y a eu 8 participants mais plusieurs absents se sont excusés et se sont dits intéressés. Le collège était présent, ainsi que les cuisiniers qui approvisionnent les cantines des primaires, 2 restaurateurs privés, un gérant de l’EHPAD et la gérante d’une micro crèche.
Nous les avons écoutés, et nous avons échangé au sujet de leurs contraintes. Notamment nous voulions savoir si le facteur prix était déterminant. En réalité, ce n’est pas le prix ni le manque de producteurs mais la difficulté d'allotissement parfois pour des petites quantités, la demande de livraison, etc... c'est davantage tout cela qui pose souci que le manque de producteurs
Ensuite, 15 jours après nous avons réuni les producteurs qui ont actuellement une démarche de production finalisée en circuits courts. Les personnes présentes se sont montrées également très intéressées comme les utilisateurs et ceux qui n’ont pas pu venir se sont excusés et ont demandé à être quand même inclus dans la démarche qui les intéresse. 8 à 10 producteurs étaient présents (le potentiel est de 30 sur le territoire). Le Président du groupement multiferme qui travaille en circuits courts était là mais il y en avait aussi d’autres comme un producteur de viande en circuit court, un producteur de bière, un fabriquant d’huile qui démarre son activité, un maraîcher…etc.
Là aussi nous avons écouté leurs besoins. Notre objectif n’est pas de nous limiter à l’approvisionnement des écoles ou de nous focaliser sur la création d’un magasin mais plutôt de rapatrier de la valeur ajoutée sur le territoire, y développer la consommation, lutter contre le gaspillage alimentaire et contribuer à améliorer et protéger l’environnement.
La 3ème étape sera de réunir l’ensemble des gens et de faire témoigner des territoires plus aboutis et de déterminer un plan d’action. Nous sommes en réflexion quant à la création d’un poste pour faire ce travail là dans le cadre du programme Leader.
Ce qui est le plus précieux pour réussir notre démarche, c’est notre capacité à mener un dialogue serein pour rassembler les acteurs, avancer dans la rencontre pour que ce ne soit pas trop politisé.
Difficultés rencontrées et attentes
Pour tous ceux que nous avons rencontrés, utilisateurs comme producteurs, la difficulté est de faire coïncider offre et demande et d’assurer la livraison. Nous avions au départ l’idée de créer une légumerie sur le territoire mais ce n’est pas leur besoin. L’enjeu est plutôt de développer la production et surtout créer la rencontre entre l’offre et la demande.
Nous n’avons pas répondu à l’appel à projet PNA car nous n’étions pas assez avancés. Notre démarche a démarré il y a 1 mois. Nous travaillons bénévolement là-dessus car nous n’avons pas d’ingénierie locale pour ça. La DRAAF et le Ministère doivent être conscients de la différence entre les territoires à ce niveau-là. Nous avons créé un comité de pilotage mais aucun document formel faute de temps. Nous n’avons pas d’ingénierie dédiée. C’est un frein réel.
« Notre objectif est de rapatrier de la valeur ajoutée sur le territoire »
« Ce n’est pas que le prix mais l’approvisionnement qui est un blocage car il n’y a pas assez de producteurs ».
« Nous travaillons bénévolement là-dessus car nous n’avons pas d’ingénierie locale »
40

Pour en savoir plus :
http://www.ccavm.fr/
http://www.val-de-norge.fr/asnieres-les-dijon/12-c-asnieres/79-asnieres-entreprises
A l’heure actuelle, il y a clairement des changements sur notre territoire, notamment côté producteurs. Ce changement est favorisé par les faibles marges que les agriculteurs peuvent dégager sur notre territoire. Ensuite l’initiative de multi-ferme (regroupement d’agriculteurs en circuits courts) fait levier. Leur Président est aussi au Conseil d’Administration d’une Cuma qui réunit 70 producteurs. C’est une bonne base pour cette dynamique.
Ensuite nous avons sur le territoire un projet de Parc National : vu de loin on peut croire que les agriculteurs s’y opposent mais de près c’est plus multiforme que cela. Certains sont pour car ils voient parfaitement que cela va leur permettre de capter de la valeur ajoutée et créer des interrogations sur les pratiques agricoles. Il est important que la DRAAF ait une vision plus fine de cette réalité et n’écoute pas qu’une partie des représentants du monde agricole et soit porteuse d’une vision des nouvelles formes de production agricole.
Le projet de Parc National se situe entre la Champagne et la Bourgogne sur 1/3 de la Haute-Marne. C’est un projet de parc forestier qui existe depuis 2009. L’arrêté de prise en considération existe et le projet devrait aboutir en 2018. Pour les quelques terres agricoles concernées, l’Etat s’est engagé en terme de compensation pour les mesures agri-environnementales.
Au niveau des habitants, nous voyons émerger des initiatives locales comme dans les cantines mais aussi une structure d’insertion en Amap (régie rurale du plateau de Langres) et ils ont un succès croissant. Ils continuent à trouver leur marché. Maintenant, la question que je me pose est la suivante : est-ce que cela impacte profondément les pratiques de consommation ?
Nous sommes un territoire à faible pouvoir d’achat, nous avons peu de CSP+, beaucoup de retraités agricoles. Actuellement il n’y a pas d’engouement ni de prise de conscience massive et nous sommes un territoire où il y a une auto-consommation importante, chacun a son jardin potager, etc. C’est à double tranchant car les gens ont leurs habitudes de cuisine et considèrent qu’ils mangent déjà bien. Cela ne favorise pas la remise en cause. C’est là une hypothèse à explorer. En tout cas, la sensibilisation de la population sera nécessaire.
Notre attente vis-à-vis de la DRAAF est qu’ils prennent en compte la réalité du territoire et qu’ils soutiennent la mise en place d’une ingénierie. Plus que le manque de financement. Quand on a des projets, on trouve les financements. Mais il nous manque en amont l’ingénierie pour monter un projet. Actuellement la dynamique repose beaucoup sur des bénévoles. La DRAAF doit développer une connaissance plus fine des agriculteurs. C’est un monde multi-facette même au sein des conventionnels. Il faut apprendre à dialoguer avec tout le monde agricole.
Notre démarrage est positif car nous ne sommes pas tombés dans le piège de foncer sur le magasin de producteurs et de chercher à élargir ensuite. Nos producteurs sont réticents sur le magasin, ils ne souhaitent pas devenir dépendants d’un groupe, ils veulent garder leur indépendance. Donc ils apprécient que la Communauté de Communes souhaite les accompagner plus loin et se positionne en aide dans le rapport avec le magasin. Ils connaissent ce principe et les négociations qui en découlent car il existe déjà un magasin de producteurs. Les producteurs de lait savent ce qu’est une négociation avec une fromagerie et ils savent comment se construit un rapport de force.
41

HAUT-RHIN
42

Département du Haut-Rhin
Circuits courts-inclusion sociale-tissu productif local et durable
AXE PRINCIPAL
A partir d’une fédération d’acteurs clefs (association réalisant des ateliers culinaires, Amap, entreprises d’insertion), créer une synergie entre acteurs de la transformation de produits bio et locaux en favorisant l’emploi d’insertion. Agréger et essaimer : prototyper une filière locale et bio dans le Sud Alsace, reproductible ensuite.
6 THEMES D’ACTION
Accroissement de la surface vivrière Autonomie alimentaire du territoire Promotion du bio et local dans la restauration collective et l’aide
alimentaire Maintien des terres agricoles Maintien de l’emploi agricole Une alimentation de qualité accessible à tous
Le projet fonctionne via un comité de pilotage pour en garantir la vision politique. Un groupe projet et un comité technique associant des acteurs ressources travaillant déjà sur cette thématique. 3 groupes de travail ont été créés sur les thématiques du foncier, de la logistique et de la distribution ainsi qu’un groupe transversal sur la complémentarité des projets sur l’agglomération.
L’agglomération de Mulhouse démarre un PAT depuis le printemps 2017. Soutenu par la fondation Macif, de nombreuses initiatives ont émergé pour former un ensemble d’actions désormais réunies dans un PAT.
Département du Haut-Rhin : 377 communes 760 134 hab (2013) 214 hab/km² Secteurs concernés : 20 fermes, 5 artisans transformateurs soit au total 70 emplois, potentiel de création de 30 emplois supplémentaires Porteur : Agglomération de Mulhouse et la fondation MACIF Responsable du projet : Elodie Passat Responsable du pôle développement durable Contact : [email protected]
Carte d’identité
43

Liste des acteurs impliqués
Agence d’urbanisme de Mulhouse
Institut Supérieur Social de Mulhouse
Salsa Chambre d’Agriculture OPABA Terre de liens Conseil Départemental FDSEA Ec00parc
Projets PAT en construction Dannemarie :
La mairie de Dannemarie a mandaté la Chambre d’Agriculture pour réaliser une étude de faisabilité sur un point de vente collectif de producteurs. 2 partenaires sont mobilisés : un producteur et le coordinateur du programme Leader. La demande de financement est portée par le maire.
INSEF :
INSEF (Insertion Sociale par l'Emploi et la Formation) est une structure privée à but non lucratif dans le domaine de l’insertion depuis 1985 notamment dans la restauration collective. 35 salariés en contrat aidé, 6 permanents, 2 cuisines d’insertion de 600 repas par jour (périscolaire et restaurant). Avec une association de maraîchage bio et un restaurant, leur objectif est de faire connaître leur source d’approvisionnement en bio et local. Ils sont basés à Ungersheim où le maire s’est intégré au réseau « village en transition ».
DETAIL ET AVANCEE DE LA DEMARCHE
Le PAT repose sur plusieurs projets structurants
1/ Salsa L’association Salsa (Système Alimentaire Local en Sud Alsace) réunit plusieurs partenaires de la chaîne alimentaire sur le territoire (réseau d’Amap entre Rhin et Vosges, entreprises d’insertion dans le maraîchage et l’insertion, micro-brasserie etc). Elle vise à rassembler ces activités dans la friche industrielle du site DMC de Mulhouse.
2/ EPICES Création de liens interculturels et intergénérationnels autour de la cuisine. Le lieu aura aussi vocation à favoriser l’insertion sociale. Créée en 2009, l'association EPICES (Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé) a pour objectif de proposer une éducation nutritionnelle et des liens par le biais de l’école, dans l’esprit d’un partage. Elle favorise la prise en compte des savoirs culinaires de chacun valorisant l'estime de soi et permettant, notamment, la valorisation du rôle des parents.
3/ Légumerie bio Développé par le Relais Est (Scoop d’insertion), l’objectif est la transformation en « cru prêt à l’emploi » de produits collectés chez les producteurs. L’activité intègrera les surplus de production, produits hors calibre et dans un deuxième temps les produits de deuxième choix. Elle contribuera ainsi à la lutte contre le gaspillage. Public visé : restauration et particuliers.
4/ Contrat Local de Santé Programme multipartite piloté par la Ville de Mulhouse et créé avec les acteurs de la santé. Un de ses objectifs est l’accès à une alimentation saine afin de lutter contre l’obésité ou le diabète, avec plusieurs associations qui travaillent dans les quartiers prioritaires du Contrat en Politique de la Ville.
5/ Réseau des Villes Créatives Unesco En juin 2017 Mulhouse a proposé sa candidature au Réseau des Villes Créatives Unesco, catégorie Gastronomie. Elle repose sur la diversité et la qualité de sa restauration, mais également sur un écosystème particulier qui promeut la qualité des produits via les acteurs professionnels (corporations, ARIA…) et des réseaux de circuits-courts et bio, qui promeuvent l’insertion et l’action sociale par la cuisine.
5/Programme Investissement d’Avenir (PIA) La M2A est candidate à la démarche PIA « territoires de grande ambition» avec son projet « nourrir la Smart-City » Sud-Alsace-DMC, et propose un lieu totem en Alsace associant agriculture urbaine, innovation sociale, et accueil de centres de recherche sur le site de DMC
Pour en savoir plus :
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/actualites/m2a-territoire-de-grande-ambition
http://www.rhenamap.org/
http://www.mulhouse.fr/fr/projet-reamenagement-site-dmc/
https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/
44

Agglomération de Mulhouse
E. Passat, Directrice du service développement durable R. Kraemer, Chargé de mission agriculture durable
L’objectif du projet
Depuis 2009 nous travaillons avec différents acteurs du monde agricole (Chambre d’Agriculture, OPABA, Terre de Liens) sur 2 axes : le foncier et la sensibilisation des habitants. Sur le foncier, les communes et les élus se sont bien appropriés l’enjeu de la sauvegarde des terres agricoles. Nous avons évité l’urbanisation de 100 ha qui ont été identifiés par les communes comme devant rester des terres agricoles.
Notre objectif maintenant est de faire émerger une filière et d’accompagner sa structuration.
D’où vient la démarche
Au début nous avons fait un PAT sans le nommer : en 2009 nous avions dans notre plan climat un axe sur la consommation responsable. Notre premier plan climat date de 2007 c’est-à-dire avant les lois grenelle. C’était donc un plan volontariste et non obligatoire. Dans cet axe, les élus voulaient investir la question des terres et la consommation d’espace, deux axes majeurs inscrits dans le Schéma Régional Air/Energie de 2011-2012. L’agglomération a initié la question foncière sous l’angle du lien entre producteurs et consommateurs par un travail sur le « consommer plus juste ».
La sensibilisation des habitants est le fil rouge du service. Par exemple, pour l’opération « climat gourmand », nous avions 2 objectifs : travailler avec les restaurateurs pour qu’ils prennent conscience qu’il leur est possible de se fournir localement et sensibiliser ainsi les consommateurs. Les restaurateurs signaient une charte et proposaient 1 fois par an pendant 3 semaines un menu local. Nous leur fournissions une liste de producteurs et avons réalisé une formation auprès de chefs de cuisine et du personnel de salle pour communiquer ensuite cette opération auprès des clients. Les restaurateurs étaient intéressés pour afficher une traçabilité de leurs produits auprès de leurs clients. Nous avons réalisé 4 éditions de cette opération.
Pour nous c’était précieux de toucher des citoyens sans qu’ils viennent à un évènement spécifique car il est difficile de toucher un public non convaincu d’avance.
Depuis il y a une forte évolution et nous avons 2000 paniers par semaine répartis sur 32 points de vente (Amap, Ruche Qui Dit Oui, point de distribution à la ferme etc). M2A apporte une aide financière annuelle aux porteurs de projet pour aider à l’installation de points de vente et une aide aux producteurs qui peut être financière ou par une mise en lien. Par exemple lorsqu’un producteur cherche des terres pour s’installer nous le mettons en relation avec une commune où il y a du foncier disponible.
« Un PAT est comme un plan climat, il y a un enjeu à l’échelle internationale qui est lui-même lié aux enjeux locaux et réciproquement. Ce n’est ni ascendant ni descendant, cela se construit à la jonction des deux, avec les partenaires. »
L’agglomération : 273 894 hab 1 020 hab/km² 22 communes Fait partie du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar. Nombre d’acteurs : Un collectif de 60 acteurs rassemblés en novembre 2016 Directrice : Elodie Passat Chargé de mission : Régis Kraemer Contact : 03 89 33 79 86 [email protected]
Carte d’identité
45

“Vivamus porta est sed est.”
« La sensibilisation des habitants c’est le fil rouge du service »
« Au niveau du territoire dans son ensemble, il y a des actions parsemées qu’il faut agréger dans des objectifs communs » « Ce que nous avons de plus précieux ce sont nos partenaires, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas seuls ».
En 2014, une Vice-Présidente est nommée à l’agriculture durable, Mme Striffler. Dès 2015 elle a souhaité amplifier les démarches existantes. Nous avons démarré un travail avec les structures de la restauration collective : nous avons lancé un appel à projet auprès d’eux et 6 structures y ont répondu (Lycée, EHPAD, école, structure d’insertion). Celles-ci travaillent avec l’OPABA pour lever les freins de l’intégration du bio, qu’ils soient financiers ou liés au conditionnement des produits. Il y a également une démarche qui se construit avec le périscolaire pour augmenter progressivement la part du bio, qui représente déjà 20% dans les repas.
En 2015, suite à l’opération « climat gourmand », avec la fondation MACIF, a émergé le souhait d’aller plus loin. Nous avons identifié que le lien entre producteurs et restaurateurs était faible par manque de disponibilité des producteurs pour mener un vrai travail commercial et par l’impossibilité pour le restaurateur d’aller se fournir dans 10 sites de producteurs différents.
Il y a une envie des 2 côtés mais il manque des éléments pour consolider le lien. Au niveau du territoire dans son ensemble, il y a des initiatives parsemées qu’il faut agréger dans des objectifs communs. Pour aller plus loin, il nous semble qu’il est nécessaire de rentrer dans une logique de filière. Toutes ces actions, du foncier au consommateur rendent faisable la création d‘une véritable filière.
Ce que nous avons de plus précieux ce sont nos partenaires, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas seuls. Ils se sont approprié les enjeux. Un PAT c’est comme un plan climat, il y a un enjeu à l’échelle internationale qui sont eux-mêmes liés aux enjeux locaux et réciproquement. Ce n’est ni ascendant ni descendant, cela se construit à la jonction des deux, avec les partenaires. Chacun à son niveau est contributeur du PAT qui est une vision territoriale. Nous devons apporter les éléments pour que chacun se sente concerné. Nous devons montrer les complémentarités plutôt que ce qui oppose.
Pour nous c’est un processus qui se construit dans le temps. En 2007 il y avait la première Amap et aujourd’hui, il y a 32 points de vente.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Nous voyons se dessiner des acteurs moteurs et un démarrage de filière, même si celle-ci est de petite échelle. C’est un bon début. Chacun apprend à travailler avec l’autre. Les différents acteurs ont différentes temporalités et il faut collectivement l’accepter.
La fragilité de la démarche, c’est le risque de se disperser. Nous devons assoir une vision, qu’on parte du même point pour arriver au même point. Une faiblesse serait de ne pas avoir de projet à court terme c’est-à-dire dans les 2 ans. Comme pour le plan climat la difficulté c’est de faire le va et vient entre le long terme à 5/10 ans et le court terme, entre une vision et le concret. Il faut donner des signes, au-delà des intentions, que des réalisations se mettent effectivement en place.
Une autre faiblesse est le manque de temps pour être au plus près des acteurs pour établir un lien plus récurrent et avec cette démarche PAT justement cette proximité va se construire.
Pour en savoir plus :
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/actions-du-plan-climat
46

Fondation MACIF
M. Fournier, Chargée de mission
L’objectif du projet
La fondation MACIF définit ses financements sur une durée de 5 ans. Le quinquennat actuel se finira en 2018. Pour l’Alsace la MACIF a travaillé sur la santé et le bien-être. Des actions sur l’alimentation et la production ont été financées dans ce cadre-là. La M2A (Agglomération de Mulhouse) apporte un financement complémentaire et des moyens humains. Ils ont co-financé les rencontres de novembre 2016 sur la dynamique locavore dans notre territoire.
Aujourd’hui, nous souhaitons élargir le territoire : nous sommes partis de Mulhouse puis sa grande couronne et nous souhaitons maintenant élargir jusqu’à l’ensemble du Haut-Rhin et jusqu’à la frontière Suisse.
D’où vient la démarche
En 2014, nous avons soutenu des porteurs de projet dans le sud de l’Alsace. Leur objectif était que plus de citoyens aient accès à une alimentation de qualité. Ces acteurs ne se connaissaient pas. Nous avons donc initié une rencontre entre ces associations. Le but était de favoriser la construction de projets communs et créer une filière d’alimentation saine.
Après cette première rencontre, nous avons appuyé 3 porteurs de projet qui mettaient en place une coopération et la MACIF s’est rapprochée de la M2A. La M2A menait de son côté l’opération « climat gourmand » qui est une action ponctuelle. Cette opération consistait en une démarche auprès des restaurateurs et des producteurs locaux pour développer une filière locale mais cette initiative s’est révélée limitée, pas assez porteuse. La M2A a donc sollicité la MACIF qu’elle avait identifié sur ces questions et nous travaillons avec Pierre François Bernard sur Solivers, c’est un de nos partenaires, il fait partie de notre réseau. En fait, nous avons fait un PAT sans le savoir.
Aux côtés de la M2A et la fondation MACIF, il y a un premier cercle de partenaires moteurs que sont Rhénamap, l’Opaba, Terres de liens, l’ISSM (Institut de Sciences Sociales) sur l’insécurité alimentaire, la Chambre d’Agriculture.
Enfin il y a un troisième cercle constitué de ceux qui ont participé aux rencontres du 18 novembre. Nous avons fait le choix d’être exhaustifs, même avec des acteurs aux objectifs très différents. La FDSEA en fait partie. Il n’y a que les restaurateurs que nous n’avons pas réussi à mobiliser. En, revanche, nous avons fait le choix de ne pas mobiliser la GMS.
« Nous avons fait le choix d’être exhaustifs, même avec des acteurs aux objectifs très différents »
Activité : Finance et accompagne une démarche locavore jusqu’en 2018 Nombre d’acteurs : Un collectif de 60 acteurs rassemblés en novembre 2016 Chargée du projet : Martine Fournier Contact : 03.89.74.42.24 06.24.69.45.17 [email protected]
Carte d’identité
47

“Vivamus porta est sed est.”
« En découvrant l’appel à projet PAT on s’est dit que cela ressemblait beaucoup à ce que nous faisions »
« Nous avons fait un PAT sans le savoir »
Plus précisément au niveau de la collectivité, il y a le service développement durable qui est mobilisé, le développement économique et enfin l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération (AURM) qui travaille sur le foncier.
Ensuite au niveau politique, nous avons une élue pleinement impliquée, l’ancienne Vice-Présidente qui est aujourd’hui conseillère communautaire sur l’agriculture et la transition énergétique, M Striffler. Le nouveau président est sensible aux questions agricoles et aux dynamiques citoyennes mais nous ne l’avons pas encore rencontré. D’une manière générale, l’appropriation politique du sujet n’est pas encore au maximum, notamment par rapport à celle des opérationnels que nous sommes.
Il y a une évolution des mobilisations et nous voyons des liens se créer grâce aux rencontres que nous organisons. Nous avons toujours un rôle central dans la mise en lien. La collectivité avait mis en place une action sur le plan local de santé pour une alimentation saine et aujourd’hui on se coordonne avec eux puisque les acteurs mobilisés sont, pour une part, les mêmes.
Autre exemple de liens : l’ISSM a crée un lien avec l’université de Mulhouse suite à la rencontre que nous avons organisée. Ils souhaitent créer une épicerie solidaire pour étudiants. De même Rhénamap s’est ouvert à d’autres partenariats.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Lors de la rencontre que nous avons organisée en novembre, l’ensemble des partenaires se sont retrouvés dans l’objectif de mieux organiser la filière, par exemple, dans la logistique, mais ils ne se sont pas vraiment emparés de la démarche et ils attendent de voir comment on va avancer. Il y a une attente forte des acteurs de terrain et de la part de la fondation aussi, mais fin 2018 nous finissons notre quinquennat et il est possible après que nous changions de thématique cible donc nous devons anticiper notre retrait. Nous n’avons pas de position de porteur de projet à long terme. Si une structure autonome se met en place nous serons un acteur parmi d’autres. C’est donc un enjeu pour nous que les acteurs se saisissent et s’approprient cette démarche.
A ce sujet, nous verrons qui sera présent lors de notre prochaine réunion. Nous verrons peut être se dessiner des acteurs en retrait qui ne seront peut-être pas là et des acteurs plus moteurs.
Notre besoin actuellement se situe sur le plan méthodologique pour ne pas louper des étapes clefs dans la construction d’un PAT. Nous sommes preneurs d’un regard extérieur pour avoir à l’esprit la place de chacun et comment la collectivité aussi trouve sa place. A ce niveau, il y a aussi une certaine frustration des acteurs qui attendent des retours concrets de la collectivité. De ce fait, même si notre diagnostic n’est que partiel, la M2A craint de passer à nouveau du temps dessus et de perdre les porteurs de projet en route.
Avoir des retours sur d’autres PAT venant d’autres territoires nous serait utile et permettrait de désamorcer des tensions.
Sur les autres acteurs institutionnels non mobilisés, le Conseil Départemental est difficile à capter, la Chambre d’Agriculture est présente mais ne se positionne pas. Ils ne sont pas un acteur ressource pour l’instant. Ils sont bienveillants mais ne sont pas encore porteurs.
Pour en savoir plus :
https://www.fondation-macif.org/
48

Association Salsa – Territoire élargi de Mulhouse
Président de Salsa
L’objectif du projet
Nous avons l’ambition de créer un Projet Alimentaire Territorial et l’Agglomération de Mulhouse a envie d’en créer un, donc nous voulons aller plus loin dans ce partenariat. Nous apportons le lien avec la production tandis que l’Agglomération souhaite faire quelque chose de plus large qui touche également à la question foncière et à la politique de la ville.
Pour ma part, je suis Président de Salsa et Président de l’association Rhénamap qui est une fédération des Amap entre Vosges et Rhin.
Nous avons des Amap depuis 10 ans dans la région. Il y a 6 ans, nous avons éprouvé le besoin de développer une structure chapeau pour notre organisation. C’est comme cela que nous avons créé Rhénamap. Cela a contribué à fiabiliser notre fonctionnement et augmenter le nombre de lieux de distribution. Nous avons aujourd’hui une gamme de produits très large qui va bien au-delà des seuls fruits et légumes sur 11 lieux de distribution pour 900 familles.
D’où vient la démarche
Après 3 ans d’existence une concurrence s’est développée via de nouveaux acteurs comme la Ruche Qui Dit Oui et la multiplication d‘offres par les magasins de producteurs, les paniers de saison pas toujours locaux ni nécessairement bio. Cette évolution a amené une érosion de nos adhérents en Amap.
Nous avons alors animé un forum ouvert au sein de l’association, pour définir la suite à mener. L’objectif était de pérenniser les fermes du réseau et accompagner leur développement (nous avons 22 agriculteurs et 4 artisans dans notre réseau. Les fermes se situent dans un rayon de 40km autour de Mulhouse). Nous avons ainsi ciblé le développement d’une plateforme logistique mutualisée pour de nouveaux segments de marché (restaurateurs ou comités d’entreprise) afin d’amener de la souplesse à l’offre Amap. Cependant la logistique seule ne résout pas les questions liées aux autres étapes : transformation, distribution, vente etc. Nous avons été accompagnés par un consultant dans ce travail pour rassembler ces activités (transformation, distribution, logistique) dans un même lieu. C’est nécessaire pour travailler avec des professionnels et changer d’échelle et créer ainsi une filière locavore.
De nombreux producteurs se trouvent dans le Sundgau et il faut instaurer un dialogue entre Mulhouse et cette partie du territoire. Nous devons définir la notion de territoire concerné par un projet PAT. La Fondation Macif a initié le travail de repérage et de soutien des initiatives et maintenant il faut passer à la mise en cohérence. Une dynamique de projet nous aidera à cela. Nous devons sécuriser les débouchés pour sécuriser la production et la transformation.
« Avoir une vision de ce que l’on veut faire et une vision de son inscription dans le territoire, est essentiel pour aller voir les financeurs »
Activité : Plateforme multi compétences pour développer l’approvisionnement en circuit court Territoire : Entre le Rhin et les Vosges Rassemble 22 agriculteurs et artisans Contact : 06 37 02 56 64 [email protected]
Carte d’identité
49

Pour structurer une filière locavore, nous prenons le parti qu’il faut une accroche projet qui cristallise la démarche. Ce projet doit s’inscrire dans les enjeux de l’ESS, ainsi un de nos partenaires, Solivers est une SCIC ou le Relais Est une Scoop et préfigure la gouvernance du projet. Ils travaillent à l’inclusion de personnes handicapées ou de personnes en insertion par l’activité économique. Donc nous imaginons dans un même lieu des acteurs de l’alimentation durable qui partagent une vision commune de l’ESS.
Une épicerie en vrac, une plateforme logistique, une brasserie etc. Nous amenons les compétences métiers et l’animation de la démarche. Nous trouvons également intéressant l’emplacement de ce bâtiment qui se trouve en plein cœur de Mulhouse, à proximité de quartiers difficiles.
Pour notre projet nous avons 7 partenaires et chacun met de son temps mais au niveau financement, c’est compliqué. Nous allons transformer l’association Salsa en SCIC d’ici fin 2017. Après le changement d’équipe au sein de la Communauté d’Agglomération de Mulhouse et avec la nouvelle équipe en place, nous avons à apprendre à travailler ensemble.
L’aspect le plus abouti de notre projet c’est le montage de l’association Salsa avec 7 partenaires économiques qui ont une même vision. Maintenant nous devons trouver la bonne solution pour notre bâtiment. La société d’aménagement a proposé le prix de 1 euro symbolique mais le coût des travaux est de 1,8 million. Sur le site, il y a actuellement plusieurs projets mais aucune activité n’a démarré concrètement. Pour ce montant-là de coût de travaux, il faut un projet de grande envergure sur le territoire sinon l’investissement n’aura pas d’effet d’entrainement.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Notre point de fragilité c’est le partage d’une vision avec la collectivité et les institutions. Pour le moment les échanges sur le sujet entre les différentes collectivités du territoire ne sont pas nombreux. Nous avons l’exemple du Sundgau où il y a une conscience qu’il faut une vision engagée. Nous ne savons pas par exemple quelle est la vision des élus de Mulhouse sur la part du bio et du conventionnel dans ce qu’ils souhaitent pour les circuits courts par exemple.
Nous avons aussi besoin de savoir s’ils sont prêts à appuyer de la commande publique locale pour les cantines. Pour que M2A et les communes autour se positionnent, cela va prendre du temps alors que les producteurs et transformateurs ont besoin de réponses claires et rapides. Le risque si nous n’arrivons pas à relier ces deux temporalités, c’est l’effritement. Par exemple, notre partenaire Le Relais Est, qui développe de l’emploi pour l’insertion, veut mettre en place une légumerie et il ne pouvait pas attendre plusieurs années, ce sont des emplois qui sont en jeu. Donc il a développé son projet dans un autre bâtiment, tout près de son lieu actuel. Nous pourrons quand même travailler avec lui parce que le site n’est qu’à 10 minutes de Mulhouse mais nous avons perdu un partenaire du projet qui apportait les compétences métier de la transformation sur un même site.
Si nous devions tout reprendre depuis le début, nous impliquerions les élus très en amont, au démarrage du projet. Nous avons été identifiés comme une association de militants et aujourd’hui nous sommes sur un enjeu de développement économique pour le territoire. Nous avons dû construire notre légitimité sur ce terrain économique car on ne prend pas toujours au sérieux les associations. Si nous avions eu cette légitimité depuis le début, nous aurions gagné du temps. Nous aurions pu aussi impliquer plus fortement et plus tôt des partenaires indispensables au développement d’un PAT, comme la Chambre d’Agriculture par exemple.
Avoir une vision de ce que l’on veut faire et une vision de son inscription dans le territoire, est essentiel pour aller voir les financeurs.
« Pour monter une filière locavore, nous prenons le parti qu’il faut une accroche projet »
« Nous devons définir la notion de territoire concerné par un projet PAT »
Pour en savoir plus :
http://www.rhenamap.org/
50

INSEF
Entreprise d’insertion dans la restauration en bio et local
L’objectif du projet
Il y a une évolution de l’attente, on le voit avec l’Agglomération de Mulhouse, les parents comme le personnel attendent plus de bio et du frais, des produits sains. Nous avons beaucoup d’échanges avec eux, on les a tous les jours au téléphone, on a un échange direct, si il y a un problème ils ont le cuisinier en ligne directement. C’est pour cela que dans notre projet nous voulions communiquer sur le bio et le local, pour que les élus et le public où on sert les repas connaissent ce que l’on fait et comment nous travaillons.
C’est pour cela que nous avons proposé ce projet PAT avec le restaurant la table de la fonderie.
INSEF en est membre fondateur mais c’est une société indépendante de nous. C’est un restaurant solidaire avec des tarifs habituels et des tarifs sociaux. Il a récemment intégré une crèche dans sa clientèle. C’est une équipe de 9 personnes qui servent 800 couverts. La crèche représente un nouveau marché qui peut contribuer à pérenniser le restaurant.
On aimerait travailler avec un maraîcher bio mais pour le moment le restaurateur a ses fournisseurs habituels donc on ne peut pas imposer de changement du jour au lendemain.
Nous n’avons pas été retenus dans l’appel à projet de la Fondation MACIF donc nous essayons d’autres pistes de financement. On veut faire entrer du bio et communiquer dessus, faire des affiches, etc. mais pour ça il faut une personne en plus, on n’a pas le temps de faire ça alors que, par exemple, pour la crèche ce sont des parents d’un quartier défavorisé de Mulhouse donc c’est important de leur faire connaître ces filières qu’ils comprennent ce qu’on fait. On s’est rendu compte en échangeant avec eux qu’ils ne connaissaient pas tout ça, même le maire n’était pas au courant de notre démarche.
D’où vient la démarche
L’INSEF a démarré en 2014 la livraison de repas 100% bio à l’Agglomération de Mulhouse (la M2A) sur 8 sites (600 repas/jour) suite à l’initiative du maire d’Ungersheim qui a investi pour construire un restaurant. Ungersheim est le premier village en transition pour préparer la société de l’après-pétrole. Un film de long métrage a été réalisé sur cette initiative. C’est le maire qui a impulsé le projet au départ.
« Notre bilan est positif : on est sur une voie d’avenir, ça tire vers le haut. On sent que les gens se posent des questions qu’ils ne se posaient pas il y a 30 ans »
Activité : INSEF est une structure privée à but non lucratif dans le domaine de l’insertion depuis 1985 : aménagement et entretien d’espaces verts, restauration collective. 2 cuisines d’insertion de 600 repas par jour (périscolaire et restaurant). Nombre de salariés: 35 salariés en contrat aidés, 6 permanents. Responsable du projet : Thomas Dreyfus Contact : 03 89 51 23 60 [email protected]
Carte d’identité
51

“Vivamus porta est sed est.”
« Notre besoin, c’est qu’il y ait plus de producteurs »
« Pour moi un PAT c’est relocaliser »
Ensuite INSEF a investi pour l’équipement à hauteur de 300 000 euros avec l’aide de la Direccte, le FSE etc. Cela nous a permis de relancer notre activité. INSEF fait partie des membres fondateurs des jardins d’Icare pour l’implantation de maraîchage bio. Cette association faisait déjà du maraîchage bio sur un autre site depuis 25 ans. ICARE et INSEF se connaissent depuis le début.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Nous ne pouvons pas tout acheter à ICARE car il faut diversifier et il y a les aléas météo mais on fait quand même du 100% bio et quand c’est possible, de provenance locale en plus.
Les Jardins d’ICARE font des paniers Amap. Il a été créé en 1995 et accompagne 50 personnes en insertion sur 14 ha sur 2 communes (Sentheim et Ungersheim). Pour eux c’est une logique de diversification par un nouveau marché avec la restauration. Ils font partie du réseau Cocagne, mais la restauration collective c’est un autre métier et ils travaillent sans stockage et n’ont pas de moyens logistiques donc on ne peut pas toujours se fournir chez eux alors on achète à la halle de Cernay, ils ont d’importants moyens logistiques.
Notre principal besoin, c’est qu’il y ait plus de producteurs et transformateurs. Par exemple, il n’y a qu’un seul boucher. Nous on a l’agrément sanitaire et ça crée des contraintes : emballage, logistique et chaîne du froid, le repas n’est pas pris sur place donc il y a la question du transport. Il faut une traçabilité très forte. Nos fournisseurs aussi doivent avoir un agrément mais pour le moment on a un problème de quantité : si je demande à mon boucher 600 pilons, je n’ai besoin que des pilons. Qu’est-ce qu’il va faire des 600 carcasses de poulet restant ?
En approvisionnement local le prix varie selon les quantités et selon la production. Pour faire du bio à 100% en local on est obligé de passer beaucoup de temps sur les commandes à cause du côté aléatoire des prix. On est obligé de passer plusieurs coups de fils aux différents fournisseurs, de comparer leurs prix etc…
En Allemagne, il y a une centrale d’achat 100 % bio, ils ont 40 camions de livraisons, ils ont tout. Parfois nous nous approvisionnons là-bas. Ils ont une force de frappe qui fait que quelque soient les quantités c’est toujours au même prix.
Pour en savoir plus :
http://www.insef-inter.fr/nos-bureaux/
https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/
http://icare.reseaucocagne.asso.fr/
52

MARNE
53

Département de la Marne Fiche exploratoire
Carte d’identité AXE PRINCIPAL
Trois thématiques se dégagent du territoire sans qu’il y ait de Projet Alimentaire Territorial à proprement parler. Il existe une dynamique de groupes de producteurs avec une impulsion institutionnelle, une volonté de développer l’approvisionnement local et enfin des actions de lutte contre le gaspillage dans la restauration collective.
THEMES D’ACTION
Production et approvisionnement local : Il existe 7 Amap, un point de vente collectif, des menus de collèges à partir du terroir et enfin une dynamique de producteurs en filière locale qui semble démarrer. Il y a enfin une AOC Champagne.
Lutte contre le gaspillage : Le Conseil Départemental s’est engagé dans la lutte contre le gaspillage dans 3 collèges depuis 2015 et précédemment dans 11 collèges, dans le cadre d’une démarche de l’ancienne région Champagne-Ardenne.
Département de la Marne 70 hab/km² 565 307 hab. Châlons-en-Champagne 47 338 hab. 616 communes 28 intercommunalités Pôle IAR : Industrie et Agro-Ressource, valorisation non alimentaire des végétaux. PNR Montagne de Reims 1% d’exploitation en bio. 6% de conversion de 2014-2015
54

DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS
1/ Approvisionnement local
Il y a 7 AMAPS, des menus proposés à partir de produits locaux sur la plateforme local appro’ par la Chambre d’Agriculture une fois par mois dans 40% des collèges du 51, et un point de vente collectif. Le point de vente (sacrés fermiers, 300m², 43 associés) a été Initié par la Commune de Cernay-lès-Reims et accompagné par la Chambre d’Agriculture de la Marne. Ce projet a vu le jour en septembre 2015 après trois années de travail. Un nouveau groupe de producteurs a émergé lors de la dynamique de la foire agricole et sous l’impulsion de la ville pour développer un point de vente à Châlons en Champagne.
2/ Lutte contre le gaspillage alimentaire : Conseil Départemental
Le Conseil Départemental a évalué le coût du gaspillage entre 20 000 et 70 000 euros par an dans les collèges. Des modifications ont donc été mises en place aux niveaux de la communication (visite des cuisines, installation d’un gâchimètre…), du service (proposition de « taille » d’assiette petite/moyenne/grande faim, pain à la coupe…) et de l’organisation interne (meilleure estimation du nombre de convives, achat de produits locaux…). Le gaspillage par convive a ainsi été réduit de 24 à 15%. La lutte contre le gaspillage alimentaire, les circuits courts et le recyclage alimentaire font partie de l’axe consommation responsable du PCET du Département.
3/ Un pôle urbain actif
Le pôle de Reims rassemble une série d’initiatives : un annuaire de la consommation responsable sur la commune qui inclut un volet sur l’alimentation (Amap, boutique bio, magasin de producteurs) ; le Grand Reims, en lien avec le service économique a financé une étude de marché pour aider un groupement de producteurs qui a réalisé le 1er magasin de producteurs sur la Communauté Urbaine (les sacrés fermiers, 20 producteurs). L’agglomération accompagne les Amap sur des recherches de locaux, une aide pour leur organisation et accompagne depuis 10 ans le marché bio local.
4/ Une plateforme bio et locale MBCA MBCA est un facilitateur de l’approvisionnement en produits bio et locaux sur l’ancienne région Champagne-Ardennes avec une part importante de ses producteurs dans la Marne.
Liste des acteurs impliqués
Conseil Départemental Chambre d’Agriculture AMAP Producteurs des points de vente Ville de Châlons en Champagne Ville et Agglomération de Reims Cernay-lès-Reims MBCA
Pour en savoir plus :
http://www.marne.chambre-agriculture.fr/
http://www.localappro51.fr/
http://id-champagne-ardenne.fr/fr
55

L’agriculture bio et locale
Manger Bio en Champagne-Ardenne MBCA
Le territoire : Ancienne Région Champagne Ardennes. MBCA est Basé à Châlons en champagne Activité : Association de 22 producteurs bio de la région Champagne-Ardenne approvisionnant la restauration collective bio et locale de la région. Responsable du projet : Pia Sauterel Diététicienne et commerciale Contact : [email protected]
Carte d’identité
L’objectif du projet
Manger Bio Champagne Ardenne est une association de 23 producteurs bio spécialisés dans la livraison de la restauration collective qui existe depuis 2008. Nous mettons en relation les collectivités et les producteurs biologiques du territoire, et assurons la mise en œuvre opérationnelle de l’approvisionnement des collectivités (commandes, livraisons groupées, facturation, réponses aux appels d’offre, conseils diététiques, animations…). Nous livrons plus de 75 collectivités partenaires et touchons chaque année plus de 50 000 convives, pour un volume annuel de plus de 265 000 équivalents repas bio. Nous fournissons différents types de restaurants collectifs : restaurants scolaires (écoles, collèges, lycées), restaurants d’entreprises, maisons de retraite, hôpitaux (CHU de Reims et Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne notamment), cuisines centrales (dont celle de Charleville-Mézières). Nous livrons également la Caisse des Ecoles de Reims (8300 repas/jour contenant 17% de produits biologiques. L’activité de l’association MBCA est 100 % biologique et 94 % des produits sont régionaux. Les 6% restants sont des produits que l’on ne trouve pas sur le territoire. Pour ces produits, nous faisons appel à notre partenaire Biocoop Restauration. Nous proposons tous les ingrédients pour réaliser un menu complet : légumes plein champs, légumes maraîchers, produits laitiers, viande (bœuf, volaille, brebis, porc), fruits (pommes, poires), produits d’épicerie (jus de fruits, huiles, pâtes, lentillons et lentilles, farine, biscuits) et pain. Nous avons plusieurs producteurs par type de produits pour assurer des volumes importants. Nous travaillons avec des cuisines en gestion directe, nous répondons à des appels d’offres et travaillons avec des sociétés de restauration collective. Suivant les structures nous sommes en relation avec les gestionnaires, les chefs de cuisine et les diététiciens. Nous réalisons également des évènements pour sensibiliser les jeunes et les adultes à l’alimentation bio locale. Nous sommes présents au moins une fois par mois à travers des animations (restaurants, écoles etc). Nous sommes également présents lors de tables rondes comme lors de la Semaine du développement durable d’Epernay. Cet automne nous participerons aux débats qui suivent la projection du film de Guillaume Bodin « Zéro Phyto100% Bio ».
« Nous couvrons toutes les filières. Nous avons tous les ingrédients pour réaliser un menu complet »
56

D’où vient la démarche
MBCA a été créée en 2008 avec l’aide de la FRAB. C’était au départ une demande de la ville de Charleville-Mézières qui souhaitait approvisionner sa cuisine centrale en produits biologiques de la région. Pour répondre à cette demande d’un point de vue quantitatif et pour des questions de logistique, les producteurs intéressés se sont regroupés. L’aventure a débuté avec 5 producteurs ardennais. L’association a grandi petit à petit, en plus des 23 producteurs, nous sommes actuellement 3 salariés à temps plein. Nous nous inscrivons dans les dynamiques de réseaux régionaux et nationaux, en étant en lien étroit avec les associations de producteurs biologiques régionaux et nationaux, la Fédération Régionale des Agrobiologistes de Champagne-Ardenne (FRAB) et la Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques (FNAB). Nous sommes membre de Manger Bio Ici et Maintenant (MBIM), le réseau national d'approvisionnement bio local pour la restauration collective (collectif de plateformes de producteurs bio locaux). Au sein du réseau, nous mutualisons un certain nombre d’outils, par exemple la méthodologie de réponse aux appels d’offre. Difficultés rencontrées et attentes Introduire du bio local dans les cuisines collectives dépend beaucoup de la sensibilité personnelle de nos interlocuteurs. Il y a un manque de positionnement claire des pouvoirs publics concernant l’alimentation biologique et locale en restauration collective : objectifs, obligations, aides … L’ancienne région avait mis en place une charte d’aide à l’introduction de produits bio locaux dans les lycées. La région aidait les lycées publics via une subvention qui prenait en charge 30% du prix des produits bio locaux achetés. Cela a disparu avec la création des nouvelles grandes régions. Nous voyons une évolution depuis 2008 dans les appels d’offre, la demande en produits bio et locaux est plus présente. Il reste cependant encore beaucoup de chemin à faire. Les appels d’offre ne sont pas rédigés pour des structures comme la nôtre mais pour de grosses entités nationales. Dans un même lot il est possible de trouver des produits bio et conventionnels mélangés et également une grande hétérogénéité dans les typologies de produits. Or lorsque l’on répond à un lot il faut pouvoir être en capacité de fournir la totalité des produits présents dans celui-ci. Des contraintes logistiques très poussées peuvent également compromettre notre positionnement sur certains appels d’offre (horaires de livraison très réduits, quantités commandées par livraison minimes par exemple). Une adaptation des producteurs aux contraintes de la restauration collective mais également une adaptation des cuisines aux contraintes des fournisseurs-producteurs de taille régionale est importante. Il y a donc une nécessité forte d’échanges et de compréhension de ces 2 parties. Nous avons exprimé ces difficultés aux assises du Conseil Régional où il y avait un atelier spécifique sur les appels d’offre. Un réseau régional PAT serait intéressant pour cela aussi. Nous mènerons sans doute une réflexion avec la FRAB là-dessus.
« Introduire du bio local dans les cuisines collectives dépend beaucoup de la sensibilité personnelle des cuisiniers ».
Pour en savoir plus :
http://www.mangerbiochampagneardenne.org/
http://www.mbim.fr/
57

L’objectif du projet
Actuellement nous avons sur le Grand Reims une série d’initiatives et d’actions de la part de notre collectivité et de partenaires mais sans que cela soit formalisé. Notre objectif est justement de mettre en place une politique structurée, c’est la volonté de nos élus car ils sont conscients qu’il y a une dynamique qui se développe là-dessus. Nous avons d’ailleurs réalisé un benchmark sur les territoires ayant des actions en matière d’alimentation durable. Cela nous a amené à faire un voyage d’étude à Saint-Etienne. Ils ont par exemple embauché un AMO à disposition de toutes les petites communes de leur agglomération pour rédiger leur cahier des charges pour intégrer du bio et du local dans leurs marchés publics de restauration collective. Ils font également du soutien aux points de vente de producteurs et ont aujourd’hui plus de 10 points de vente sur la ville. Nous cherchons maintenant quelle est la meilleure réponse à apporter sur ce thème dans notre territoire. D’où vient la démarche
C’est la Direction du Développement Durable qui a la charge des initiatives qui se développent sur notre territoire. La collectivité a apporté soit un soutien financier direct soit une aide par la mise à disposition d’un local etc. Nous apportons de moins en moins un soutien financier en raison de la baisse des dotations budgétaires. Pour le détail des actions : la ville de Reims a réalisé un annuaire de la consommation responsable sur la commune qui inclut un volet sur l’alimentation (Amap, boutique bio, magasin de producteurs). Le Grand Reims, en lien avec le service économique a financé une étude de marché pour aider un groupement de producteurs qui a réalisé le 1er magasin de producteurs sur la Communauté Urbaine. Ils s’appellent les sacrés fermiers et rassemblent 20 producteurs du département.
Nous accompagnons les Amap au coup par coup sur des recherches de locaux, une aide pour leur organisation etc. On accompagne également depuis 10 ans le marché bio local.
Le territoire : 9 intercommunalités 293 000 habitants Activité : Chargé du Développement Durable Responsable du projet : Baptiste Redon Contact : 03.26.35.37.83 [email protected]
Communauté Urbaine du Grand Reims
Carte d’identité
Vers un conseil local du consommer mieux ?
« Une dynamique se développe sur l’alimentation durable, Nous cherchons maintenant quelle est la meilleure réponse à apporter sur ce thème dans notre territoire »
58

Aussi les cantines de la ville de Reims ont 20% de produits bio et local pour lesquels nous travaillons avec MBCA (Manger Bio en Champagne Ardenne). On accompagne aussi des maraîchers qui sont en installation dans la recherche de foncier ou la méthodologie de projet. En effet nous nous sommes aperçus en recevant des maraîchers en cours d’installation, qu’ils intègrent tardivement dans leur projet la question des débouchés. La production agricole dans notre département est polarisée par le système des grandes cultures (céréales, betteraves, vigne, champagne). Nous avons un Cluster agro-alimentaire. Mais jusqu’au début du 20ème siècle nous avions une tradition maraîchère le long des cours d’eau. Ici le sol est très pauvre sauf à proximité des cours d’eau. Ce type d’agriculture a disparu progressivement. Actuellement au niveau des producteurs maraîchers il n’y a qu’une faible dynamique.
En revanche, même si la production de grandes cultures est très présente sur le territoire, ses représentants ne sont pas hostiles à ce que d’autres formes d’agricultures et circuits se développent. Ils ne se sentent pas concernés mais n’y sont pas opposés.
Nous avons aussi une intervention sur le volet social : l’épicerie sociale de la ville de Reims récupère les invendus et les vend à 10% du prix de vente classique. L’épicerie est fournie en fruits et légumes par une Amap, l’école des jardiniers, qui est aussi maraîcher-producteur et terrain de formation et d’enseignement au maraîchage. Ceux qui cultivent sont des réfugiés qui dépendent de la CADA, Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. C’est une opération de petite échelle mais qui a le mérite d’exister. Nous soutenons financièrement ce centre de formation au maraîchage bio. Nous aidons à acquérir le terrain. Nous sommes partenaires dans cette démarche. C’est un centre de petite échelle qui a formé 2 maraîchers en 4 ans qui se sont installés ailleurs dans la Marne.
Difficultés rencontrées et attentes
Pour toutes ces actions nous n’avons pas encore d’instance de coordination. Nous prévoyons de mettre en place un Conseil local du consommer mieux pour réunir tous les acteurs intéressés par la thématique. Il rassemblera les acteurs du magasin de producteurs, les Amap, des représentants des producteurs, la GMS, et des élus, ainsi que la grande distribution.
Notre agence d’urbanisme nous a présenté les démarches PAT mais nous ne nous sommes pas appropriés le sujet immédiatement.
Nous ne sommes pas encore en lien avec l’enseignement agricole mais ce sont des interlocuteurs intéressants.
Nous sommes preneurs de mise en lien et de conseils.
« Même si la production de grandes cultures est très présente sur le territoire, ses représentants ne sont pas hostiles à ce que d’autres formes d’agricultures et circuits se développent. »
« Nous avons actuellement un Conseil local du consommer mieux pour réunir tous les acteurs intéressés ».
Pour en savoir plus :
http://www.grandreims.fr/86/le-territoire.htm
http://www.sacres-fermiers.fr/
59

MEURTHE ET MOSELLE
60

Relier les initiatives locales et consolider la démarche par un diagnostic des flux
Département de Meurthe et Moselle
Carte d’identité
AXE PRINCIPAL
Fédérer et structurer une série d’initiatives locales portées par des intercommunalités. Pour cela le Département va mener une étude pour objectiver l’offre et la demande, définir des scénarii, sensibiliser et engager.
2 THEMES D’ACTION DU PROJET D’ENSEMBLE
Objectiver et formaliser : o Réaliser une étude sur la consommation, l’offre et
l’identification des flux. o Proposer des scénarii de développement d’outils pour
optimiser la chaîne logistique.
Former et engager o Créer des supports de formation adaptés aux projets locaux. o Etablir une charte d’engagement et de co-responsabilité entre
partenaires. o Réaliser des tableaux de suivi de l’avancée des actions.
DES TERRITOIRES LOCAUX DE PROJETS COMPLEMENTAIRES
Accompagner le développement ou la consolidation des projets locaux en cours (détail dans les 3 points suivants).
Le Département porte un projet sur deux dimensions : une démarche globale par un diagnostic sur l’offre, la demande et les flux sur la partie Sud de son territoire et une démarche de mise en lien de différentes initiatives locales.
Département de Meurthe et Moselle : 592 communes 732 153 hab (2013) 140 hab/km² Secteur concerné : Région Sud du Département, bassin de vie autour de la Métropole du Grand Nancy Service porteur : Conseil Départemental de Meurthe et Moselle Responsable du projet : Anne Fortier, chargée de mission transition écologique. Contact : [email protected]
61

Acteurs du Pays Terre de Lorraine et PETR Lunéville
5 intercommunalités sur la prévention pour la réduction des déchets
Associations locales de Lunéville sur les jardins et vergers solidaires et ateliers culinaires.
Département et cuisine centrale de Gerbévillers via un site pilote de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la cantine d’un collège
Paniers à prix réduits par une structure d’insertion en maraîchage et expérimentation de permaculture sur 1 ha.
Groupement d’achat via une fédération d’Amap
Acteurs sur le bassin de Pompey
Communauté de communes du Bassin de Pompey
Chambre d’Agriculture Agence Régionale de
Santé
Autres Initiatives Réseaux paysans :
Réseau paysan bio lorrain crée en 2005 qui rassemble 70 producteurs. Logistique pour la commande hors domicile. Réseau fermier lorrain pour lequel la Chambre d’Agriculture a créé une plateforme web pour faciliter les commandes (collège et lycée, Crous, CHU, EHPAD).
Mesure de l’impact du gaspillage alimentaire : le département a accompagné 11 collèges pour le compostage sur site. Calcul du coût du gaspillage : 1 million d’euro par an et coût du traitement des déchets 30 000 euros par an.
Compostage : la Métropole du Grand Nancy met à disposition des familles des lombri-composteurs à moindre coût et évite ainsi le traitement de 10 tonnes de déchets par an.
DETAIL DES PROJETS TERRITORIAUX
1/ Pays terre de Lorraine et PETR Lunévillois : préfiguration de PAT axés sur le social.
Le projet de territoire de 2015-2020 de Pays terre de Lorraine est centré sur la transition. L’intercommunalité demande un financement suite à une étude d’ATD qui a montré qu’une autonomie alimentaire et une alimentation durable sont moteurs d’inclusion sociale.
Le projet : « se nourrir quand on est pauvre » est piloté par ATD quart monde : il s’agit d’expérimenter des solutions conciliant les 2 rôles, nourricier et social, de l’acte alimentaire.
Le PETR Lunévillois a développé 2 axes : lutter contre le gaspillage alimentaire et donner accès à une alimentation de qualité pour les plus pauvres. Cela passera par un état des lieux et une valorisation des initiatives locales (mise en réseau de banques alimentaires et associations d’aides, ateliers culinaires, création d’ateliers de transformation etc).
2/ Communauté de communes du bassin de Pompey : éducation nutritionnelle dans les cantines
Sur la Communauté de communes du Bassin de Pompey se trouve une cuisine centrale qui a ouvert en janvier 2017 pour livrer 2 500 repas par jour (écoles, maisons de retraites, crèches). Une extension de la production sera possible pour alimenter également les territoires voisins. L’approvisionnement sera pour partie en bio et local (26% du budget alimentaire) ce qui constitue un levier pour la remise en culture et la réimplantation de maraîchage.
Le projet consiste en une expérimentation d’ateliers cuisine. Ces ateliers pédagogiques accueilleront 20 personnes, enfants et adultes, pour valoriser une alimentation de qualité et sensibiliser au gaspillage. Il s’agit de développer le savoir-faire de plats maison et créer la rencontre avec le personnel de la cuisine attenante à la cuisine pédagogique.
62

3/ PETR Val de Lorraine : étude de l’offre alimentaire locale et de la diversification agricole du territoire
Le développement des circuits alimentaires de proximité est un axe prioritaire du programme LEADER 2014-2020 du Parc Naturel Régional de Lorraine. Plusieurs initiatives vont dans ce sens : groupement de commande, approvisionnement de collège, construction d‘une cuisine centrale sur le Bassin de Pompey, réseau des boutiques du parc. Les parties prenantes souhaitent passer d’une logique d’actions ponctuelles à une stratégie de développement à l’échelle de plusieurs intercommunalités, associé à la volonté d’aider à l’installation de nouveaux agriculteurs et préserver les espaces agricoles.
Projet : connaître l’offre et le potentiel de diversification agricole par un diagnostic partagé de l’offre de produits disponibles (gamme, volume, saisonnalité, labels), des débouchés existants, les potentiels et opportunités de structuration de filière de proximité. Sur cette base sera défini un plan d’action.
Le projet porte sur 5 intercommunalités et concerne 110 000 habitants.
4/ Une démarche d’ensemble à l’échelle du Grand Nancy
Un diagnostic global est en cours, préalable à l’élaboration du PLU Intercommunal de la Métropole. Il vise 2 objectifs principaux : formuler un constat sur la situation actuelle de l’agriculture et appréhender son évolution à moyen terme. Le diagnostic a été lancé mi 2016 pour 15 mois. Il est prolongé par l’élaboration d’un diagnostic partagé et d’un plan d’action avec 4 objectifs : - créer du lien entre les acteurs locaux pour coordonner des projets dans une stratégie commune, - disposer de données socio-économiques harmonisées sur le système alimentaire à l’échelle du Sud Meurthe-et-Mosellan, - connecter les différentes problématiques gravitant autour de l’alimentation (social, environnemental…), - sensibiliser les producteurs et les consommateurs aux enjeux de relocalisation du système alimentaire. Le diagnostic complètera et précisera des études déjà menées par l’Université de Lorraine sur la consommation et les déterminants qui amènent les producteurs vers la diversification et la bio, par la Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers. Le diagnostic sera une base de réflexion sur un marché de gros d’intérêt local, outil structurant. Il sera mené par la Chambre d’Agriculture et des Métiers. Le volet formation sera mené par le CPIE de Nancy Champenoux et le Centre des Groupements des Agrobiologistes de lorraine. Le CGA accompagnera les collectivités désireuses de mettre en place des espaces test agricoles permettant aux porteurs de projets d’installation de s’essayer en conditions réelles sur des productions telles que le maraîchage biologique.
Le lien pourra être fait avec une étude en cours sur la méthanisation par l’ADEME et la Chambre d’Agriculture.
Acteurs dans le projet du PETR Val de Lorraine
5 intercommunalités (Bassin Pompey, Pont à Mousson, Chardon Lorrain, Seille et Mauchère, Val de Moselle)
PNR de Lorraine (réseau de boutiques, charte sur les circuits courts)
Département à travers la restauration collective dans les collèges
Acteurs de la cuisine centrale du Bassin de Pompey
Université de Lorraine
Acteurs impliqués sur le diagnostic à l’échelle du Grand Nancy :
Université de Lorraine Chambre d’Agriculture
et Chambre des Métiers de l’Artisanat
CPIE de Nancy Champenoux
Centre des Groupements des Agrobiologistes de Lorraine
Agence du Développement et d’Urbanisme du Grand Nancy
Pour en savoir plus :
https://www.atd-quartmonde.fr/senourrirlorsquonestpauvre/
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2016/10/11/bassin-de-pompey-la-cuisine-aux-petits-oignons
http://www.bioenlorraine.org/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/environnement-agriculture-departement-fleuri
63

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle
Chargée de mission transition écologique
L’objectif du projet
Notre réponse à l’appel à projets du PNA 2016, avait comme objectif d’établir 2 niveaux d’intervention sur le sud du département :
- A l’échelon local, les territoires partenaires de la démarche PAT seront porteurs de projets répondant à des besoins spécifiques et prioritaires à leur niveau.
- A l’échelon sud Meurthe-et-Moselle, l’animation portera sur une démarche de structuration et de coordination des initiatives. L’objectif est de massifier les flux.
Il y a le niveau local donc essentiellement pays et le niveau du sud du département. C’est avec ce double niveau que nous avons fait le plan de financement. Par exemple le Pays Terre de Lorraine a une démarche propre et un financement de la réserve parlementaire, l‘Université de Lorraine a un co-financement Etat, de l’autofinancement etc.
La coordination se matérialise par un comité de pilotage. Au-delà des partenaires, nous avons associé les services de l’Etat : la DDT et la DRAAF et l’Agence de l’eau pour une approche environnementale du PAT.
La Chambre d’Agriculture, pour l’offre de produits agricoles et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour l’offre de produits transformés. Ils sont les plus forts contributeurs de la démarche de diagnostic. Nous attendons d’en sortir la définition d’un scénario d’évolution des flux pour définir des scénarii de développement. Nous savons par exemple que nous avons des difficultés sur la question logistique. Nous aurons sans doute besoin de créer une plateforme intermédiaire de stockage. Nous avons besoin d’un état des lieux pour peser le pour et le contre.
Sur le sud 54 nous allons faire le bilan des consommations et de l’offre de produits locaux. Pour mener le diagnostic nous sollicitons les acteurs : les pays et collectivités ont des données et un stagiaire s’assure de l’homogénéité de ces données existantes sur le périmètre du PAT. Le projet intègre aussi l’Université de Lorraine qui travaille sur les motivations et déterminants conduisant les producteurs à rechercher plutôt des circuits de proximité pour écouler leurs produits. La chambre des métiers n’était pas investie jusque-là, le diagnostic est un moyen de les impliquer.
Nous avons aussi une articulation avec l’appel à projets DRAAF-ADEME concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Notre point fort, c’est la motivation des acteurs. Il y a de nombreuses dynamiques sur le territoire, cela les intéresse.
« Un PAT est une gouvernance alimentaire sur un territoire pour développer les produits de saison et de proximité dans le triple intérêt des transformateurs, agriculteurs et des consommateurs ».
Activité : Accompagnement Territoire : 592 communes 29 intercommunalités 732 153 habitants 140 hab/m² 103 562 à Nancy 14 % de conversion en bio Responsable : Anne Fortier Contact : 03 83 94 56 83 [email protected]
Carte d’identité
64

D’où vient la démarche
Dès 2011, le Département ayant à cœur de développer les circuits alimentaires de proximité, a expérimenté le dispositif « panier collège » avec le Pays Terres de Lorraine. Face à son succès, il a été décidé de déployer la formule sur les autres territoires meurthe-et-mosellans.
Dans le même temps, la démarche devenait une priorité du projet départemental 2015-2021 puisque l’Assemblée Départementale a fixé l’objectif d’atteindre, pour la restauration scolaire, 20% d’achat local par rapport à l’achat global de denrées.
Fort de cette volonté politique, nous avons répondu à l’appel à projets du PNA de 2015 mais nous n’avons pas été retenus.
La démarche se déploie mal sur les autres territoires, des difficultés de logistiques d’approvisionnement et des facturations multiples limitant l’intérêt pour les gestionnaires d’établissement d’avoir recours à de l’approvisionnement local.
Le souhait de relancer plus largement la démarche d’approvisionnement local s’est accompagné par la création de mon poste. Ce poste inclut aussi d’autres thèmes comme la mobilité douce, la performance énergétique des bâtiments… Je fonctionne en mode projet pour animer cette mission avec une collègue en charge de la restauration scolaire, un collègue en charge de l’agriculture et une autre en charge des marchés.
C’est la DRAAF qui nous a mobilisé pour monter une démarche plus large. la coordination des 14 acteurs s’est faite en 15 jours ! Au début nous voulions travailler sur tout le département mais dans la partie nord, une réponse commune à Interreg s’est structurée avec le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique jusqu’en 2022.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Je dirai que les dynamiques locales sont indépendantes les unes des autres. Elles se développent parce que c’est dans l’air du temps et non par capillarité et influence ou dynamiques communes. Chaque projet s’auto-suffisait et le Conseil Départemental aussi sur l’approvisionnement des collèges. Les projets n’étaient pas suffisamment mûrs pour voir les choses à une plus grande échelle. La recherche de financement pousse à travailler ensemble.
Le PAT actuellement concerne 500 000 habitants. Alors qu’à l’échelle Pays il concerne 100 000 habitants. Il ne faut pas que l’échelle sud départementale écrase l’échelle pays mais les deux ont bien leur raison d‘être. Par exemple au niveau local, les acteurs pourraient travailler sur la création d’un magasin de producteurs tandis qu’à l’échelle sud du département nous devrions travailler sur la création d’une plateforme logistique. Nous avons aussi la capacité de redynamiser le marché de gros de l’Agglomération nancéenne.
« Notre point fort, c’est la motivation des acteurs ».
« Il ne faut pas que l’échelle sud départementale écrase l’échelle pays mais les deux ont bien leur raison d‘être ».
65

“Vivamus porta
est sed est.”
Pour en savoir plus :
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/transition-%C3%A9cologique
Nos points faibles sont que nous avons peu de variété de production et nous avons un problème logistique car si chaque producteur livre, ça ne va pas. Le lien entre l’offre et la demande n’est pas suffisamment structuré. Pour les consommateurs, c’est une difficulté de ne pas identifier un lieu pour la production globale et d’être obligé d’aller acheter ses œufs dans une ferme, la viande ailleurs etc. Les magasins de producteurs sont nécessaires.
Le réseau Fermiers Lorrains fait actuellement des livraisons en direct. Pour les collèges ce n’est pas pratique, ils ont 10 livraisons dans la matinée, 10 factures à gérer. Ce problème est perçu par les agriculteurs mais il faut définir d’où vient le problème et identifier la solution. Le réseau Paysan bio lorrain est plus cher parceque ses produits sont centralisés et ces moyens et cette étape intermédiaire a un coût. Leur objectif est de massifier pour baisser le coût. Paysan lorrain a aussi une petite offre bio donc il faut clarifier les choses. Les 2 réseaux sont partants dans la dynamique, ils savent qu’il faut faire évoluer les choses. Fermier lorrain dépendent de la chambre d’agriculture et paysan bio lorrain sont organisés en SCIC. Une personne de la chambre d’agriculture gère leur plateforme et cela est financé par la chambre d’agriculture.
Concernant la DRAAF, nous avons besoin qu’ils continuent d’entretenir la dynamique et nous donner les clefs pour les financements, pour se regrouper et avancer sur d’autres plans comme la formation. Nous avons aussi besoin de retours d’expérience. Donc nous avons besoin qu’ils continuent ce qu’ils font déjà !
66

L’objectif du projet
Nous avons répondu au PAT avec le Conseil Départemental et cela devient le cadre structurant de notre travail. Cela rentre dans une problématique plus globale pour nous sur l’agriculture périurbaine. Notre approche sur l’agriculture urbaine est portée par la planification: via la préservation des espaces agricoles dans les PLU du Grand Nancy (réserve foncière) et le diagnostic agricole et forestier dont le rendu est attendu pour juin 2017 et qui va enrichir le PLUI (La réalisation a été confiée au bureau d’étude Atelier des Territoires, la Chambre d’Agriculture et l’ONF). Il s’agit de connaître le nombre et le type d’exploitations, les terres non exploitées, les perspectives de cession avec les départs en retraite sur le territoire du Grand Nancy. Ce diagnostic sera exploité pour la mise en place du PLUI et pour connaître les leviers d’actions pour l’agriculture (ex. le potentiel de maraîchage pour mettre en place des plans d’actions). La phase 2 consistera à déterminer un plan d’action à partir de fin 2017.
Dans le cadre du PAT et a l’issue du diagnostic, la métropole se positionnera peut-être en terme d’équipements collectifs (marché de gros ou légumerie etc).
Finalement le PAT va être le support d’une démarche plus large. Nous voyons bien que le PAT ne va pas s’arrêter à la période de l’appel à projet de un an et demi, il faut qu’il continue, c’est l’occasion de travailler ensemble.
A côté de cela, le Grand Nancy a d’autres actions. Parmi elles, le soutien aux associations qui développent l’agriculture urbaine comme l’association Racines Carrées (association d’agro-écologie urbaine, potager partagés). C’est davantage un enjeu de cohésion sociale. Le Grand Nancy leur met à disposition des parcelles dans un parc communautaire de Montaigu qui organise la manifestation “Jardin de Ville, Jardin de vie” autour du tri et du développement durable. Nous leur attribuons aussi une subvention globale. Plus largement le Grand Nancy intervient par ses services dans d’autres domaines touchant au PAT (mission déchet, tri, lutte contre gaspillage et compostage, démarche d’aide alimentaire). Il y a d’autres compétences comme la valorisation du patrimoine naturel et paysager (mesures agro-environnementale sur le plateau de Malzeville, trame verte et bleue). Enfin une convention avec la Chambre d’Agriculture est en cours de renouvellement pour structurer une démarche plus globale en termes d’agriculture, pour le PAT mais aussi dans le cadre de l’aménagement, de l’urbanisme ...
Cultiver la rencontre entre la ville et ses territoires alentours
« Finalement cela va être une démarche support d’une démarche plus large. Nous voyons bien que le PAT ne va pas s’arrêter à la période de l’appel à projet »
Activité : Lien avec les territoires agricoles en périphérie du Grand Nancy Responsable du projet : Nathalie Warin Chargée d’écologie urbaine, direction de l’urbanisme et de l’écologie urbaine Contact : 03 83 91 82 49 [email protected]
Grand Nancy
Carte d’identité
67

« Nous avons un rôle de sensibilisation auprès des communes, c’est comme cela que nous nous positionnons »
D’où vient la démarche
En 2008, nous avons signé une convention avec la Chambre d’Agriculture pour mettre en place des circuits courts pour la restauration collective dans les écoles primaires. Cette convention couvrait aussi d’autres thèmes. Il s’agissait d’une convention cadre de partenariat pour un développement équilibré et durable du Grand Nancy. La finalité était l’émergence d’un projet agri-urbain.
Nous étions alors aux prémices de la démarche pour la restauration collective. Le Grand Nancy n’ayant pas de compétence propre en matière de restauration collective, nous avons fait de la sensibilisation (réunion d’information sur les circuits courts, faire connaitre l’existant, auprès des communes) et nous avons été en appui aux collectivités territoriales pour mettre les bonnes clauses dans les marchés publics.
Nous avons senti la sensibilité de la part des techniciens et des élus. Il y avait déjà des communes qui travaillaient dans ce sens comme Vandoeuvre, et avec la Chambre d’Agriculture ils avaient les éléments pour sensibiliser les producteurs. Il y a des communes qui se regroupent pour mutualiser leurs démarches (secteur Heillecourt et Houdemont). Elles passent également par des prestataires extérieurs et regroupent leur offre. Une stagiaire de l’ENSAIA a fait un rapport sur le sujet.
Aujourd’hui Grand Nancy poursuit la démarche, en voulant être un lien entre la Chambre d’Agriculture qui travaille avec les producteurs et le Grand Nancy qui est plus proche des communes. L’objectif est de créer des liens et des démarches communes.
Difficultés rencontrées
Il y a beaucoup de démarches en cours et il faut garder une cohérence. C’est justement la philosophie du PAT de travailler de manière coordonnée sur un territoire cohérent plus large que le Grand Nancy.
Nous serions preneurs de connaître les initiatives qui se développent ailleurs.
Pour en savoir plus :
http://www.grandnancy.eu/grands-projets/les-territoires-a-enjeux/
68

MEUSE
69

OBJECTIFS
Mieux éduquer, moins gaspiller, mieux connaître son territoire et son terroir en conduisant des campagnes d’information, en favorisant une éducation alimentaire dès le plus jeune âge et en mutualisant les bonnes pratiques, à travers huit actions de sensibilisation et de rencontres. Les publics ciblés sont : les jeunes, les professionnels de la restauration collective (élus, gestionnaires, cuisiniers, personnels de services), les producteurs locaux et le grand public. In fine l’enjeu est de capitaliser les expériences et bonnes pratiques afin de pouvoir les diffuser largement et à long terme sur le territoire.
2 THEMES POUR 8 ACTIONS
Lutte contre le gaspillage alimentaire : mallette d’outils
pédagogiques, mise en réseau des cantines et des acteurs du don alimentaire, ateliers de glanage.
Développer le patrimoine culinaire : cuisine mobile pour des ateliers culinaires dans les écoles, journée de rencontres professionnels des cantines avec les producteurs, logistique collective des producteurs locaux, ateliers culinaires grands publics.
L’ensemble des actions répondent à des objectifs chiffrés.
Le Pays Barrois cible deux thématiques à travers 8 actions, qui mettent en réseau les différents partenaires et coordonnent l’ensemble des actions.
Département de la Meuse
Gaspillage et patrimoine alimentaire
Département de la Meuse : 501 communes 191 530 hab (2013) 31 hab/km² Service porteur : PETR du Pays Barrois 66 000 hab 152 communes Responsable du projet : Christophe Antoine, Président du PETR Contact : Isaline Arnould 03 29 75 58 04 [email protected]
Carte d’identité
70

Partenaires du PAT 6 EPCI Barrois La Chambre
d’Agriculture Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole
Syndicat Mixte d’Etude et de Traitement Inter-communautaire
Association Meuse action-qualité
Association Nature Environnement
“Vivamus porta est sed est.”
Pour en savoir plus :
Pays Barrois http://www.paysbarrois.com/le-petr-du-pays-barrois
http://www.les-fermiers-lorrains.fr/
DETAIL DES ACTIONS ET PARTENAIRE REFERENT
Action 1 : Sensibilisation au gaspillage alimentaire en milieu scolaire
Mallette d’outils pédagogiques de sensibilisation, achat de balances de pesée des biodéchets. Pilote de l’action : CFPPA
Action 2 : Valorisation du patrimoine alimentaire et culinaire
Ateliers culinaires thématiques auprès des scolaires : achat d’une cuisine mobile pour les déployer, réalisation d’un calendrier de fruits et légumes de saison ainsi qu’un pictogramme d’identification des produits locaux dans les menus via un concours de dessin. Pilote de l’action : CFPPA
Action 3 : rencontre producteurs / professionnels de la restauration collective.
1 journée par trimestre, les gestionnaires et cuisiniers iront à la rencontre des producteurs du Pays Barrois sous la forme de circuits itinérants. Des rencontres et échanges de bonnes pratiques avec des restaurations collectives de territoires voisins ayant déjà intégrés les produits locaux dans leur chaîne, seront également organisés afin de capitaliser leurs expériences. Formation / information des professionnels (aspects règlementaires inclus) et promotion d’un guide existant sur l’approvisionnement local. Pilote de l’action : CFPPA de la Meuse et Chambre d’Agriculture
Action 4 : Mise en place d’un guide méthodologique type HACCP
Création d’un guide pour la restauration collective en 4 phases : - étude bibliographique pour adapter aux spécificités du territoire et/ou créer un outil de diagnostic - tester l’outil sur différents types de restauration collective - analyser les résultats et valider l’outil - diffuser une mallette d’outils à l’usage des professionnels Pilote de l’action : CFPPA de la Meuse
Action 5 : Valorisation des excédents alimentaires
Réaliser un diagnostic du gaspillage alimentaire et créer une filière de dons alimentaires via les associations d’aide alimentaire en établissant une convention de partenariats. Pilote de l’action : Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
Action 6 : Structurer/consolider la filière des circuits de proximité sur le Pays Barrois
S’appuyer sur la logistique existante pour structurer une offre d’approvisionnement locale collective plutôt que indépendante et individuelle et assurer ainsi des volumes importants, une régularité, un conditionnement adapté etc Pilote de l’action : Chambre d’Agriculture de la Meuse
71

Partenaires du projet CGA hors PAT Porteurs du projet : CGA : Groupement Régional des Agriculteurs Biologistes, accompagnement technique des collectivités sur le développement de l’agriculture biologique CPIE Meuse et Nancy: Centre d’Initiative pour l’Environnement Partenaires : Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, 2 Communautés de Communes, INRA Mirecourt
DETAIL DES ACTIONS ET PARTENAIRE REFERENT
Action 7 : Sensibilisation du grand public
Mettre en réseau les acteurs de la sensibilisation au gaspillage alimentaire et au patrimoine alimentaire et culinaire local. Deux étapes : recenser les pratiques de sensibilisation du public sur les thématiques suivantes - choix des denrées alimentaires (mode de production, lecture d’étiquettes...) - transport, stockage, conservation des denrées alimentaires (chaîne du froid,...) - préparation et transformation des aliments (ateliers culinaires) - gestion des restes de repas, tri et valorisation des déchets
Pilotes de l’action : Meuse Nature Environnement, Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
Action 8 : Ateliers de glanage
Organiser des ateliers de glanage à destination du grand public sur différents types de parcelles (céréalières, maraîchères, arboricoles) chez les agriculteurs, les particuliers ou les terrains des collectivités. Un travail de démarchage et de rencontres sera suivi d’une étape de contractualisation avec les propriétaires volontaires. Ces ateliers de glanage seront organisés par Meuse Nature Environnement (MNE) avec les partenaires publics et privés.
Pilote de l’action : Meuse Nature Environnement
PROJET HORS PAT : CENTRE DES AGROBIOLOGISTES DE LORRAINE (CGA), CENTRE D’INITIATIVE POUR L’ENVIRONNEMENT (CPIE) Le groupement souhaite développer un programme d'animation et de sensibilisation scolaire, des actions pour favoriser l’agriculture biologique et étudier les leviers des collectivités pour l'installation de producteurs biologiques et les circuits courts (espaces tests, baux environnementaux, plan d'action captages d'eau,...).
Actions menées le CGA :
Accompagnement des collectivités pour l’installation de maraichers et éleveurs bio avec point de vente direct (Villers lès Nancy, Metz, Novéant, Ecurey, Pont-à-Mousson) et espaces tests (Metz Métropole, Les Voivres). Enjeu des zones de captage d’eau potable.
Accompagnement des collectivités sur le développement des circuits courts (CC du Saulnois)
Conception et mise place de réseaux de fermes à visée pédagogique (fermes de démonstration « Bio Transparence »)
Accompagnement des collectivités pour le développement de l’AB en réponse aux enjeux liés à l’eau et à la biodiversité (Beuvezin, Communauté de Communes du Saulnois, Thionvillois, plan stratégique captages DDT57)
Sensibilisation et accompagnement des opérateurs de restauration collective (Opération « Manger Bio et Local, c’est l’idéal » et « Manger Bio et Local en Entreprise », Journée « info filière viande bio » pour les bouchers, restaurateurs et responsables restauration collective)
Par le CPIE :
Conception de menus à partir de produits locaux, bio et de saison pour les classes vertes que le CPIE organise. Sensibilisation des publics à l’alimentation responsable et à ses enjeux territoriaux.
Accompagnement de projets sur le gaspillage alimentaire dans les cantines (animations scolaires ou périscolaires, évaluation au moment des repas du gaspillage, recherche de solutions avec les agents et gestionnaires) (Fresnes, Saint-Mihiel).
Montage de projets de développement durable DDMarche : sensibilisation des publics à la consommation responsable, à la préservation des ressources naturelles, sensibilisation des agriculteurs à la préservation de l’eau et de la biodiversité, développement des projets d’économie circulaire(Fresnes, CAGV, plan paysage des Côtes de Meuse, N2000).
Conception et animation de supports pédagogiques sur la production locale, de la prévention déchet et de l’alimentation responsable.
72

PROJET HORS PAT : CENTRE DES AGROBIOLOGISTES DE LORRAINE
Actions menées par les partenaires :
Grand Verdun
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : Deux actions sur les 6 prévues portent sur le développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets, sur la préservation de la biodiversité et la protection des paysages
Création d’un espace test en projet : analyse agronomique en cours afin d’identifier les terrains propices à une telle activité. Il s’en suivra une réflexion autour du dimensionnement des équipements à prévoir puis la recherche de porteurs de projets d’installation. La finalité est aussi d’assurer l’écoulement des produits de cet espace test par les cantines locales.
Programme Locale de Prévention des Déchets (PLPD) depuis 2014. Des actions de sensibilisation sont prévues auprès des 37 écoles.
D’autres actions existantes : Drive Fermier - AMAP solidaire « La Cascade » - Jardin partagé du centre social des Planchettes
La Communauté de Communes du Canton de Fresnes en Woëvre
La collectivité, accompagnée par le CPIE de Meuse a mis en œuvre un programme d’animations à la cantine, d’animations d’ateliers culinaires et de sensibilisation à une alimentation responsable, au gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets.
La restauration collective intègre partiellement des productions locales. La collectivité porte avec la CODECOM Côtes de Meuse Woëvre le plan de
paysage Côtes de Meuse. Elle fait partie du PETR Cœur de Lorraine porteur d’un TEPCV. Elle fait également partie intégrante du Parc Naturel de Lorraine qui porte un programme LEADER portant notamment sur une destination touristique d’excellence s’appuyant sur le terroir et le savoir-faire (produits valorisants les paysages et les productions, circuits courts, ouvertures des exploitations agricoles, …).
La Communauté de Communes de Triaucourt-Vaubécourt :
convention avec des producteurs locaux de légumes et de viande (porc et volaille) puis avec un producteur de fruits afin de fournir la cuisine centrale qui alimente la restauration collective du territoire.
INRA Mirecourt
ASTER-Mirecourt est dotée d’une installation expérimentale en polyculture élevage bovin laitier biologique. Elle est composée de 11 chercheurs/ingénieurs titulaires.
Recherche de complémentarités territoriales pour un développement durable des territoires.
Echanges de savoirs et de savoir-faire entre acteurs pour une production de connaissances pour l’action.
73

PETR du Pays Barrois
Service développement économique territorial
L’objectif du projet
Avant le PAT nous avions déjà beaucoup travaillé sur les circuits courts et en faisant le tour des partenaires nous avons vu qu’il était possible d’élargir les actions, qu’il y avait une attente. C’était même nécessaire pour qu’il y ait plus de cohérence et mettre en place des leviers d’action.
D’où vient la démarche
Le PETR du Pays Barrois est initiateur de cette démarche qui est intégrée à la stratégie du Pays. Il y a 3 acteurs moteurs : la Chambre d’Agriculture, le CFPPA de la Meuse et l’association Meuse Action Qualité qui est une association de cuisiniers de la restauration collective. Au niveau institutionnel nous avons l’appui de la Chambre d’Agriculture ce qui facilite le travail avec les agriculteurs. La chambre les met en réseau et privilégie la mise en relation avec la restauration collective des lycées et collèges via une plateforme de commande en ligne que l’ancienne région lorraine avait mise en place. Le CFPPA nous aide via les études de diagnostic qu’ils ont mené sur le rapport entre offre et demande pour proposer quelque chose d’adéquat. L’association Meuse Action Qualité travaille déjà sur la thématique du patrimoine culinaire donc on s’appuie sur eux pour les prestations auprès des scolaires puisqu’ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas auprès des enfants.
L’association Meuse Nature Environnement fait un travail parallèle auprès des particuliers. Cela permet de toucher aussi des habitants et pas seulement des professionnels. Mais pour le PAT on a dû faire des choix budgétaires donc on n’a pas pu l’intégrer mais ils le font par ailleurs, c’est complémentaire.
Pour ce projet nous avons d’abord des moyens humains : c’est 50% de mon poste et un plan de financement qui rassemble des fonds de la DRAAF et des fonds Etat via le dispositif Territoire à Energie Positif pour la Croissance Verte.
Nous allons former et informer sur les appels d’offre dans la restauration collective. Pour cela nous allons actualiser les connaissances que nous avons établies à partir d’un premier état des lieux.
« Un Projet Alimentaire Territorial, cela met en relation tous les acteurs qui touchent à l’alimentation, toute la chaîne de production alimentaire »
Territoire : 127 communes 66 000 habitants Responsable : Isaline Arnould Chargée de mission développement économique territorial Contact : 03.29.75.58.04 [email protected]
Carte d’identité
74

Pour en savoir plus :
http://www.paysbarrois.com/accueil
Centre de développement durable :
http://www.paysbarrois.com/les-actions-sur-le-territoire/valorisation-des-ressources-locales/centre-du-developpement-durable-en-milieu-rural-ecurey-poles-d-avenir
Tous ces acteurs se connaissaient déjà et avec le PAT les échanges sont plus faciles et rapides mais il n’y a pas de nouvelles mises en relation ou de nouveaux acteurs entrants. L’information circule mieux et par exemple si un agriculteur contact la Chambre d’Agriculture il est facilement redirigé vers nous ensuite.
Par le travail des partenaires nous voyons que des choses se mettent en place toute seule désormais. Par exemple, maintenant il y a un approvisionnement en produits locaux de manière un peu plus régulière qu’avant où c’était plus ponctuel. Pour les producteurs aussi il y a un nouveau magasin de producteurs qui a ouvert récemment. Les producteurs ont vu qu’il y avait une demande et que le drive fermier ne correspondait pas à toute la clientèle. Pour ça ils ont été accompagnés par la Chambre d’Agriculture pour tout l’aspect juridique de l’ouverture du magasin.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Avec le démarrage, on a déjà de nouvelles idées, il faudrait que les délais de réalisations soient plus longs parce qu’on voit déjà ce qu’il faudrait faire en plus donc pas seulement sensibiliser les enfants mais aussi le personnel de cuisine. Pour eux, donner de grosses quantité, c’est une manière de bien faire leur travail, cela fait partie de la qualité de leur travail donc ils ne veulent pas servir moins et ils ont également peur des retours négatifs sur leur travail si ils ne donnent pas assez à manger aux enfants. Il faut aussi faire un travail sur le conditionnement donc cela suppose des moyens supplémentaires.
On touche davantage le milieu rural que les bourgs parce que pour le moment les actions ont surtout démarré sur le gaspillage alimentaire dans les écoles qui sont en zone rurale.
Pour avoir un appui supplémentaire on se tournerait vers la DRAAF et l’ADEME. Il y a eu l’appel à projet en début d’année mais pour nous c’était trop tôt, on a besoin de plus de retour d’expérience pour répondre. On peut également se tourner vers les fonds européens Leader car le Pays Barrois est porteur d’un GAL et les circuits courts sont intégrés dans la stratégie du GAL.
Faire un club ou un forum d’échange des acteurs qui portent un PAT ce serait utile. Une mise en réseau ou des réunions pour connaître et échanger sur les difficultés et avoir les contacts via un fichier commun pour connaitre les autres acteurs et leurs prestataires. Par exemple sur les jeux éducatifs, nous avons un besoin de réaliser du graphisme, ce serait utile d’avoir un répertoire d’adresse. Aussi d’être informé comme ça s’il y a un nouvel outil qui sort comme pour le guide sur la restauration collective.
« Avec le PAT les échanges sont plus faciles et rapides »
« Par le travail des partenaires nous voyons que des choses se mettent en place toute seule désormais »
75

L’objectif du projet
L’objectif de notre réponse à l’appel à projet PNA était de connecter des projets existant en cours sur le Grand Verdun.
Il y a une problématique de protection des zones de captage de l’eau potable donc le Grand Verdun est favorable à installer du bio sur certaines de ses réserves foncières. A partir de la création d’un espace test nous pouvons faire un support pédagogique en travaillant avec le CPIE, également écouler la production du site dans la restauration collective. L’idée était de créer une boucle vertueuse.
Nous n’avons pas été retenus mais certaines choses se feront malgré le manque de soutien. Nous travaillons sur le volet agricole et le CGA prendra part à l’association ou la SCIC qui portera l’espace test. La collectivité met à disposition du foncier pour des jeunes en formation pour qu’ils testent leur projet d’exploitation. L’étude agronomique est en cours sur 4 parcelles dont 2 sont sur la zone de captage d’eau potable.
Enfin nous lançons une étude filière sur le bio sur certains territoires phare de la région Lorraine avec un zoom sur le Grand Verdun car il y a une dynamique. Il s’agit de recenser toutes les productions et filières agricoles pour identifier ce qui est faisable en bio et les potentiels de développement des filières bio sur place. Identifier les freins et leviers au développement de la bio sur le territoire et proposer des actions.
Plus largement, nous travaillons avec l’INRA de Mirecourt sur un projet soutenu par la Fondation de France. C’est un travail sur les mécanismes de la relocalisation de la production et de la consommation. Nous sommes aussi dans le PAT de Meurthe et Moselle. Il consiste essentiellement en un diagnostic des productions et des besoins des consommateurs pour en faire découler des actions de mise en cohérence entre production et consommation. Le risque de tels diagnostics est qu’ils ne prennent en compte que l’existant. Il faudrait une approche plus prospective s’intéressant aussi aux porteurs de projets qui souhaitent s’installer en bio pour avoir une réelle idée du potentiel de production. C’est pour cela que nous prenons part à ce projet. Sinon le diagnostic peut aboutir à une conclusion habituelle que les bio ne cherchent pas à développer leur production car ils ont déjà leurs débouchés et qu’il n’est pas possible d’alimenter la restauration collective en produits bio locaux.
Nous avons aussi un poste financé par l’Agence de l’Eau pour accompagner la conversion bio sur les territoires à enjeux sur l’eau potable. Pour cela nous travaillons avec de nombreux acteurs du territoire : Collectivités, DDT, associations, pêcheurs, …Pour intégrer la bio dans les projets de territoires. La tendance actuelle n’est plus de travailler sur les seuls agriculteurs sur la zone de captage car leur faible nombre (10/15) ne permet pas de créer un changement profond dans la présence de polluants. Seul un arrêt complet ou une remise à l‘herbe ont de réels effets. Du coup la stratégie actuelle est plutôt la structuration des filières. Avec l’outil foncier et filière on veut renforcer économiquement les systèmes qui nous intéressent, à savoir l’élevage à l’herbe, la bio et les cultures bas intrants.
CGA Lorraine
Directeur et chargée de mission
« Les PAT ça permet de faire remonter à la surface des projets et de les rendre visibles. Les PAT sont une occasion formidable mais il faut les ouvrir hors monde agricole »
Territoire et activité : CGA de Lorraine Responsable : Frédéric Mony Entretien croisé avec Patricia Heuze chargée de mission eau et territoire Contact : Frédéric Mony 03.83.98.09.06 [email protected] Patricia Heuzé 07 81 49 19 61
Carte d’identité
76

D’où vient la démarche
Nous sommes un groupement régional, (CGA Groupement des Agriculteurs bio de Lorraine), un syndicat professionnel, administré par des producteurs bio, créé en 1975. Nous fonctionnons avec des fonds DRAAF et Région. Aujourd’hui, nous avons 7 salariés dont certains sont sur des postes liés à la production (maraichage, bovin) et d’autres sur des postes plus transversaux (conversion, communication).
Sur le Grand Verdun il y a une bonne dynamique que ce soit politique ou au niveau des services de la Communauté d’Agglomération malgré des différences de sensibilité marquées des élus vis-à-vis de la thématique agricole.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Il n’y a pas de volonté politique assez forte. C’est ce que l’on constate notamment sur la gestion des aides à l’agriculture biologique. Une aide comme l’aide à la conversion a une utilité cruciale. Elle permet au paysan de pallier le manque à gagner de la mise en place de pratique bio alors qu’il ne pourra pas commercialiser avec la plus-value bio avant 2 ou 3 ans. Malgré nos mises en garde le budget des aides bio sera épuisé en 2017 alors que la programmation PAC courre jusque 2020.
Il faut s’attendre à ce que cela mette un coup d’arrêt brutal à la dynamique de conversion en cours qui a explosé ces deux dernières années. Cela aura aussi de répercussions sur les opérateurs des filières bio qui ont investi pour faire face à la vague de conversions.
Le manque de volonté politique se ressent aussi dans l’activité plateformes de commercialisation de produits bio pour la restauration collective qui tourne à petit régime faute d’engagement des collectivités sur l’utilisation de produits bio locaux dans la restauration.
De même, si, au lieu de faire des diagnostics à plat, on intègre le potentiel d’installation et de conversion de nouveaux agriculteurs bio, on gagne en vision plutôt que d’aboutir au constat que les bio écoulent déjà toute leur production donc il n’y a pas de potentiel pour d’autres débouchés. Pour cela il faut ouvrir ces projets au-delà de la sphère agricolo-agricole, s’intéresser aux porteurs de projets dès leur formation, intégrer les collectifs de consommateurs, avoir une approche sociale et considérer les aspects santé et environnement.
Les PAT ça permet de faire remonter à la surface des projets et de les rendre visibles. Les PAT sont une occasion formidable pour promouvoir les productions bio locales, les seules à nos yeux qui répondent aux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux et de santé publique. Les PAT doivent s’inscrire dans une démarche de progrès (économique, social et environnemental) et ne pas simplement se contenter d’augmenter la part de consommation des productions locales. Enfin, la gouvernance de tels projets doit être élargie au maximum pour capter l’adhésion de tous même si ce n’est pas du goût de toutes les instances agricoles.
Pour en savoir plus :
http://www.eauetbio.org/les-groupes-de-travail/
http://www.bioenlorraine.org/cga-de-lorraine
« Il n’y a pas de volonté politique assez forte »
« Il faut aller voir dans les lycées agricoles et voir dès ce stade ce qui se prépare pour la suite»
77

MOSELLE
78

Département de la Moselle
Initiatives : observatoire de la restauration collective et ferme bio collective à Metz
2 ACTIONS SIGNIFICATIVES
1/ Un observatoire de la restauration collective par la DDT de la Moselle
La DDT a installé en décembre 2016 un observatoire de l'approvisionnement local de la restauration collective, sur demande du préfet. La finalité de l’observatoire est de préserver un maillage significatif des exploitations agricoles sur le territoire, en conservant la diversité des systèmes et préserver les surfaces en herbe pour l’élevage. La création de l’observatoire doit permettre de faire émerger des leviers d’actions et suivre les évolutions.
2/ Une ferme bio et collective à Metz
Une ferme collective en bio a été créé à Metz en 2016. Les objectifs sont le maraîchage bio, l’insertion, la formation et la pédagogie (périscolaire, adultes, maison de retraite). Elle contient un élevage diversifié, mais aussi un verger et un jardin maraîcher. Les produits cultivés sur place, à commencer par les fruits et les légumes, sont vendus dans un local aménagé sur place. Il y aura donc un magasin de producteurs, le tout sur près de 3 hectares. Le parc où est la ferme se trouve à la jonction de plusieurs quartiers aux caractéristiques disparates sur le plan socio-économique. Elle joue donc aussi un rôle de support du lien social.
Plusieurs initiatives notables qui peuvent devenir des briques d’un futur PAT
Département de la Moselle : 1045154 hab. 168 hab/km² 123 704 à Metz 3752 exploitations 4% en bio Responsable de l’observatoire restauration collective DDT 57 Martine Lux 03 87 34 83 78 [email protected] Responsable de la ferme collective Contact Céline et Jean-Philippe Neveux 06 01 74 48 75 [email protected]
Carte d’identité
79

DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS
1/ L’observatoire
Il s’agit de recueillir des données auprès des partenaires (abattoirs, grossistes, distributeurs, restauration collective, Département, Région). Les données remontent tous les 6 mois dans la base de données. Une réunion annuelle en préfecture fixe les orientations.
2/ La ferme collective de Metz
La ville est propriétaire du site et cela se fait en lien avec la vie associative du quartier de Borny. Le couple d’exploitants a crée un statut SCIC pour réunir une diversité d’acteurs (habitant, associations, élus, professionnels). Une souscription a été ouverte depuis février 2017 pour que le capital soit apporté par plusieurs acteurs (particuliers, professionnels, institutionnels, associations…). La moitié de ce capital vient des habitants du quartier.
La ferme fonctionne avec une équipe de 4 salariés en CDI (magasin, ferme pédagogique, maraîcher, chef d’exploitation) et également un chantier d’insertion avec une association locale.
Autre acteur
Le café Fauve
L’association Fauve agit depuis 2015 pour une cuisine durable accessible Via des repas, ateliers de cuisine, dégustations , interventions pour des publics spécifiques (classes du goût en école primaire, discussions en maison de retraite).
Ils animent une cuisine à Paris et ont ouvert en janvier 2017 le Café Fauve près de Metz. Le lieu fait 200 m², pouvant accueillir jusqu’à 65 personnes, et forme des salariés éloignés de l’emploi. Ils s'approvisionnent auprès de producteurs locaux : le réseau « mangeons Mosellan », les Côteaux Gourmands de Norroy-le-Veneur, l’Ayotte, la Ferme Lorraine à Metz, les Jardins Vitrés à La Maxe, les réseaux Paysan Bio Lorrain et Les Fermiers Lorrains ;
Le magasin Inveterre du pré vert
Ce magasin collectif citoyen situé à Dieuze est parti d’une AMAP et de producteurs. L’objectif est de faire un projet sans investissement ni salaire. La MJC de Dieuze a mis à disposition un local et le lieu fonctionne sur la base du bénévolat. L’adhésion est à 1 euro. L’objectif est de développer d’autres projets à partir de ce lieu.
Liste des acteurs impliqués dans l’observatoire
DRAAF Conseil Régional Conseil Départemental Chambre d’Agriculture Direction Départementale
de la Protection des Populations
Direction Départementale des Territoires
Liste des acteurs impliqués dans la ferme collective
Mairie de Metz Metz Pole Service (structure
d’insertion), MJC, Association APSIS de Metz
(Association de Prévention Spécialisée d’Insertion et de Socialisation)
Café restaurant citoyen Fauve CMSEA, Comité Mosellan de
Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des adultes.
Pour en savoir plus :
www.lafermedeborny.fr
http://www.associationfauve.org/cafe-fauve/
80

Activité : En charge de la création d’un observatoire Responsable du projet : Martine Lux Contact : 03 87 34 83 78 [email protected]
L’objectif du projet
La DDT a installé officiellement en décembre 2016 un observatoire de l'approvisionnement local de la restauration collective, sur demande du préfet. Un même projet a été mis en œuvre par la DRAAF en Alsace dès 2015. L’idée est de préserver un maillage significatif des exploitations agricoles sur le territoire, en conservant la diversité des systèmes et les surfaces en herbe pour l’élevage. La création de l’observatoire doit permettre de faire émerger des leviers d’actions et de suivre les évolutions. Il s’agit de recueillir des données auprès des partenaires (abattoirs, grossistes, distributeurs, restauration collective, Département, Région). Les données remontent tous les 6 mois dans la base de données. Une réunion annuelle en préfecture fixe les orientations. Le comité de pilotage est constitué des membres fondateurs (DRAAF, Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture, Direction Départementale de la Protection des Personnes, Direction Départementale des Territoires). Le comité technique sert à communiquer avec les partenaires, mettre à disposition des outils, connaître les attentes des entreprises, les besoins pour la mise en œuvre des actions. C’est au sein du COTECH que des groupes de travail seront constitués, en écho aux données fournies par l’Observatoire et aux orientations prises par le comité de pilotage, afin de répondre aux attentes des différents acteurs : exploitants agricoles, partenaires économiques, consommateurs. Les données sont une somme d’indicateurs sensibles qui engagent les politiques et stratégies économiques des différentes entreprises. Il est donc impératif qu’un climat de confiance soit installé entre les partenaires économiques de l’Observatoire et la DDT. Outre le facteur humain, cela s’est traduit par la signature d’engagements réciproques au travers d’une Charte le 13 juillet 2017 en préfecture de Moselle. Dans ce cadre la DDT s’engage à une absolue discrétion et à l’anonymisation des données. Définir des indicateurs pertinents correspondant peut être difficile.
L’Observatoire est mis en place dans 1 seul département. Le but est qu’il soit fédérateur et facilitateur concernant l’approvisionnement local de la RHD. La DDT a également participé aux travaux du Réseau Rural sur les circuits courts. Cela a permis aux acteurs régionaux de se rencontrer et de développer leurs connaissances.
La problématique en Moselle est l’offre. Seulement 10 % de la production porcine est consommée sur le territoire et il y a peu de production en maraîchage. Le port de Metz est le 1er port céréalier européen. Toutefois, la meunerie fait beaucoup défaut en Lorraine ce qui ne permet pas d’apporter toute la valeur ajoutée à notre matière première (export de blé et colza qui reviennent en produits transformés). Il y a un déficit d’offre en bio plus particulièrement en fruits et légumes locaux. Les producteurs vendent la totalité de leur production en vente directe, AMAP, Ruche Qui Dit Oui ou en direct à des restaurateurs.
Création d’un observatoire
« L’idée est de préserver un maillage significatif des exploitations agricoles sur le territoire, en conservant la diversité des systèmes »
Carte d’identité
Direction Départementale des Territoires de la Moselle
81

« Il manque peu de choses pour que ça
s’accélère »
« La place des communautés de communes et des Pays est essentielle pour donner le tempo sur l’aménagement, la protection des zones agricoles et surtout sur l’aptitude à impulser d’autres formes de réflexion sur le développement locale. »
C’est historique. Ils n’ont donc pas besoin de vendre en RHD. D’autant plus que ce mode de commercialisation comporte des contraintes comme l’obligation d’avoir un agrément CE (pour les produits transformés) et les quantités à apporter régulièrement. Il y a tout de même 4 meuniers pour l’alimentation humaine dans le département 57, ils sont dans l’attente de garanties (traçabilité pour le blé) pour mettre en place une filière AB.
Pour la DDT et le Préfet, la première étape pour développer la RHD est la consultation des partenaires : DRAAF, DDPP, CR, CD, CA et CGA pour rédiger un document stratégique d’incitation à l’échelle du département. Avec les partenaires nous mettons en place un lexique pour partager les mêmes définitions. Nous parlons de Produits de proximité (plutôt que circuit court qui se limite à un seul intermédiaire maximum). 5 échelons de proximité géographique ont été définis du département à l’Union Européenne. Les produits alimentaires de proximité concernent les 3 premiers échelons.
L’objectif est d’endiguer l’hémorragie prévisible des exploitations agricoles et des élevages pour maintenir un système herbager, garder l’image terroir et le savoir-faire. Il y a également une forte attente des consommateurs à laquelle il faut être capable de réponde. Mais les agriculteurs restent sur la réserve. Il y a tout de même 4 meuniers pour l’alimentation humaine dans le département 57, ils sont dans l’attente de garanties (traçabilité pour le blé) pour mettre en place une filière. En ce qui concerne les légumes de plein champ, les parcelles sont bonnes mais il y a besoin d’une structure de conseil pour les producteurs, besoin de mutualiser et cela commence tout juste.
D’où vient la démarche
Le Conseil Régional organise actuellement des assises sur les filières, pour étudier ce qui peut être amélioré. Les Conseils Départementaux sont en train de faire un état des lieux. En Moselle, le Conseil Départemental travaille avec la Chambre d’Agriculture pour faire la promotion des produits du terroir (ex. la marque “Mangeons Mosellan”), pour organiser des marchés fermiers pour faire connaître les acteurs et les sites de vente directe à la ferme.
Le Conseil Départemental soutient un magasin de producteurs (« l’Ayotte ») à Ay sur Moselle. Le maire de la commune est à l’origine du projet grâce à la taxe de l’entreprise Peugeot Citroën implantée sur le territoire. Une étude de marché a confirmé le potentiel de zone de chalandise. La commune a aménagé le terrain et construit le bâtiment. 4 agriculteurs se sont associés pour financer l’intérieur (4 x 20 000 €). De 35 producteurs du début, ils sont actuellement 50 à vendre leurs produits. 46 apporteurs de matières premières pour environ 100 références produit. La Chambre d’Agriculture les a aidés à monter leur statut.
82

Pour en savoir plus :
http://www.moselle.fr/moselleetvous/Pages/Fiche_agriculteurs_aide.aspx
https://www.facebook.com/Ayottemagasindeproducteurs
Quelles sont les difficultés rencontrées
Le manque de producteurs en maraîchage devrait évoluer car le Lycée agricole de Courcelle Chaussy propose une formation à l’installation en maraîchage pour les adultes. Mais il y a 2 freins : les élèves qui repartent chez eux, hors du territoire, et le foncier (certains agriculteurs ne veulent pas rétrocéder leur bail à des maraîchers et encore moins s’ils sont des néo-ruraux).
Nous ne bénéficions pas de la même dynamique que dans le Pays de Sarrebourg et Bitche : ils ont la proximité avec l’Allemagne où il y a une demande. Il y a une population de doubles actifs, les structures sont essentiellement de type herbagère avec une zone de ramassage de lait AOP Munster. Les producteurs profitent de la nouvelle vague actuelle.
Chez nous, il y a de plus en plus de conversion en bio. Mais pour certains on peut craindre que la baisse du prix du lait suite à l’arrêt des quotas en soit le moteur : c’est une “fuite en avant”. Cette conversion se fait très rapidement, sans étude sur sa pérennité. La DDT a encouragé les exploitants à faire des études technico-économique car il y a un risque élevé pour ces nouveaux convertis. Il faut un vrai accompagnement et une vrai politique, avec un accompagnement des collectivités territoriales, de l’Etat, des consommateurs … ça bouge doucement, il manque peu de chose pour que ça s’accélère.
Dans les documents de type PLU on voit apparaître les volets circuits courts, etc … , mais il y a une certaine “frilosité” et peu d’actes. Avec le PLUI, l’échelle territoriale sera plus grande et ces dynamiques auront plus de chance. La place des Communautés de Communes et des Pays est essentielle pour donner le tempo sur l’aménagement, la protection des zones agricoles et surtout sur l’aptitude à impulser d’autres formes de réflexion sur le développement local.
Il faut être vigilants, il y a un déficit de communication par rapport aux agriculteurs et aux citoyens. Il existe beaucoup de terminologie et d’étiquetage qui peuvent perdre le consommateur. Il faut y faire attention. Par ailleurs, les citoyens associent trop souvent le local à une qualité supérieure ce qui n’est pas toujours le cas. Il suffirait qu’un scandale alimentaire éclate dans ce secteur et ce serait un coup de frein terrible à une démarche qui par ailleurs est porteuse de beaucoup de sens à l’échelle du territoire.
83

Pôle d’Agriculture Biologique de Metz
L’objectif du projet
Nous sommes exploitants d’une ferme maraîchère et pédagogique dans le parc de Borny proche du centre ville de Metz. La ville est propriétaire du site et cela se fait en lien avec la vie associative de Borny. Le parc est situé à la jonction de plusieurs quartiers aux caractéristiques disparates : un quartier populaire, le quartier “village” plutôt habité par des cadres et du technopôle (école, université et entreprise). Le parc était une frontière.
On y trouvera à la fois des élevages de poules, de canards, d’oies, de moutons, de cochons, mais aussi un verger et un jardin maraîcher. Les produits cultivés sur place, à commencer par les fruits et les légumes, seront vendus dans un local aménagé sur place. Il y aura donc un magasin de producteurs, le tout sur près de 3 hectares.
Le projet se concrétise depuis avril 2017. Les conditions du projet sont les suivantes: les habitants de Borny participent et acceptent le projet, nous créons un statut SCIC, une souscription a été ouverte en février : 18 500 € indispensable pour créer la société avec une majorité portée par des particuliers et l’objectif de capital est 30 000 € apporté par plusieurs acteurs (particuliers, professionnels, institutionnels, associations…).
Actuellement, nous avons récolté 25 000 € et la moitié vient des habitants du quartier. Enfin nous louons les parcelles pour ne pas faire de spéculation.
Nous avons décidé de faire une SCIC car cela permet de réunir une diversité d’acteurs (habitant, associations, élus, professionnels). Cela permet aux habitants et aux citoyens de s’emparer des sujets en lien avec l’alimentation et l’aménagement. Contrairement aux grands projets, cela permet une réponse locale.
Nos objectifs sont le maraîchage bio, l’insertion, la formation et la pédagogie : créer une ferme ouverte à tous (périscolaire, adultes, maison de retraite). Nous allons refaire du lien entre ce qu’on cultive et ce qu’on achète. La pédagogie passe par le fait de voir. Sur notre site, il y a un chemin qui traverse le terrain est mène vers une grande surface : pour ouvrir les esprits ! Il y a aussi une aire de pique-nique pour que les gens puissent voir les cultures de légumes et les bêtes, qu’ils voient ce que c’est qu’une ferme.
Nous avons une équipe de 4 salariés en CDI (magasin, ferme pédagogique, maraîcher, chef d’exploitation). Nous avons également un chantier d’insertion avec une association locale et nous accueillons des stagiaires de tous niveaux et des contrats saisonniers.
Ferme collective de Metz
« Nos objectifs sont la production maraîchère labellisée Bio, l’insertion, la formation et la pédagogie, une ferme ouverte à tous »
Activité : Ferme collective, pédagogique et productive en bio Responsable du projet : Céline et Jean-Philippe Neveux Exploitants agricoles Contact : 06 01 74 48 75 [email protected]
Carte d’identité
84

« Nous allons refaire du lien entre ce qu’on cultive et ce qu’on achète »
« Il y a plein de chose qui bouillonne. Il faut que les réseaux se mettent en place, il faut créer des liens »
D’où vient la démarche
L’idée est née dans notre tête il y a 5 ans. Nous sommes installés en maraîchage bio depuis 2012 dans un village proche de Metz.
Dans le 57, nous sommes seuls pour nous installer, il y a peu de maraîchage bio dans le voisinage donc peu de possibilité de mutualiser. Nous ne sommes pas aidés techniquement ni commercialement. Il n’existe pas de lieu où les acteurs, professionnels et consommateurs puissent se rencontrer et échanger.
Metz Métropole a lancé un appel à projet pour installer un maraîcher bio avec un lieu d’échange où l’ensemble des acteurs peuvent se rencontrer (consommateurs, producteurs et institutions). A la table était présent un interlocuteur de la mairie de Metz. Il a tout de suite été intéressé car Metz souhaite réinstaller de l’agriculture. Il nous a présenté un endroit mais le sol était pollué par du plomb et des métaux lourd. Un autre lieu a été proposé par un élu aux espaces verts et par un collègue urbaniste, c’est le Parc de Borny (17 ha) où se trouvaient des jardins familiaux sauvages.
Nous voulions changer l’image du bio “bobo” et montrer que manger sainement c’est possible pour tout le monde. Nous avions aussi envie que les gens réapprennent à cuisiner et avec le bio, il faut réapprendre à cuisiner les produits de saison.
Le porteur du projet est la SCIC. La Mairie de Metz, qui a vraiment été moteur, loue les terres et le bâtiment et a aménagé le terrain. Il y a des partenaires associatifs : Metz Pôle Service (structure d’insertion), la MJC, l’association APSIS de Metz (Association de Prévention Spécialisée d’Insertion et de Socialisation) qui intervient sur le site avec des jeunes de 14/16 ans, le café restaurant citoyen Fauve, porté par une association et installé à Norroy le Veneur (cuisine locale (⅔), bio(⅓) et ateliers cuisines pédagogiques), TCRM Blida (lieu de création, de production et d’innovation artistique et numérique). Il y a aussi un projet d’AMAP pour les gens qui travaillent sur place et un projet d’atelier de transformation.
Il y a d’autres initiatives à Metz comme un appel à projet qui a été lancé auprès de jeunes concepteurs pour inventer un séchoir solaire : trouver une technique pour conserver les courgettes en hiver.
Quelles sont les difficultés rencontrées
Pour le moment nous n’avons pas de démarche en restauration collective. Le magasin de producteurs est pour l’instant suffisant pour écouler les produits. Mais nous sommes ouverts à une demande d’une cantine de petit volume. La restauration collective ce n’est pas la même philosophie, il faut de gros volumes, des grosses machines pour éplucher, des légumes calibrés et lavés…
Nous adhérons au CGA de Lorraine (syndicat professionnel des Bios) en tant qu’entreprise “Les Coteaux Gourmands” mais c’est animé par des producteurs et il faut du temps pour participer.
Il y a plein de chose qui bouillonne. Il faut que les réseaux se mettent en place, il faut créer des liens. Il y a tout à créer en France.
Pour en savoir plus :
http://www.lafermedeborny.fr
85

VOSGES
86

Relier le réseau des producteurs bios aux consommateurs via des animations et une démarche d’éducation populaire accessible à tous
Département des Vosges
Carte d’identité
AXE PRINCIPAL
Le café associatif UTOPIC ouvert en 2016, compte plus de 1000 adhérents. Ce lieu crée des animations et joue un rôle moteur de la vie sociale et culturelle de Mirecourt. Il fait partie des partenaires de la station INRA-SAD basé à Mirecourt et rattaché à l’INRA Nancy. Les opérateurs de cette station et leur réseau de partenaires a créé un projet alimentaire territorial soutenu par la fondation de France pour la période 2016-2019 : « Conception d’un projet de territoire agrialimentaire pour une alimentation saine, locale, au service de la création d’emplois en milieu rural ». Les axes du projet café UTOPIC s’inscrivent dans cette dynamique: rencontre avec les producteurs, points de vente, atelier culinaires, jardinage, pédagogie et découverte.
3 AXES PREVUS :
Le café UTOPIC est un lieu de débat sur l’alimentation et un lieu de dépôt pour les producteurs regroupés dans l’association « bios du coin ».
1) Renforcer la proximité entre producteurs et consommateurs : mini-marché bio avec un producteur ou un animateur, visite à la ferme, van à la rencontre des habitants isolés, vente aux touristes via l’office de tourisme, etc.
2) Apprendre à « mieux manger » : appui sur le savoir-faire et la méthodologie du café Fauve de Metz/Paris, ateliers ludiques et pédagogiques, partenariat avec la politique de nutrition de l’IME de Mirecourt, restauration bio et locale lors des évènementiels.
3) (Re-)apprendre à jardiner : mise en place d’échange de savoirs entre jardiniers et producteurs, création de jardinières partagées.
Le café UTOPIC a développé un projet d’animation et de rencontres populaires autour de l’alimentation. Dans le Sud du département, le PNR du Ballon des Vosges soutient des initiatives venant des producteurs.
Département des Vosges 507 communes 373 560 hab (2013) 64 hab/km² Taux de conversion en bio le plus élevé de la région : 7%. Secteur concerné : Commune de Mirecourt et PNR des Ballons des Vosges Service porteur : Café participatif Utopic. Responsable du projet : Céline Schott, Vice-Présidente du café associatif. Contact : [email protected]
87

Partenaires du projet Mirecourt
Associations : Fauve (association qui mène des ateliers cuisines et a ouvert un café à Paris et Metz), Fédération des Foyers Ruraux, association de quartier « la vie ensemble ».
Regroupement de producteurs : association Bios du coin (réseau de 8 agriculteurs bio en vente directe)
Station INRA-SAD de Mirecourt
Acteurs liés aux initiatives du PNR
Communauté de Communes de Rahin et Chérimont, du Val d’Argent, Pays des Vosges Saônoises
Maison de la nature Terre de liens CEGAR Chambre d’Agriculture Fondation MACIF Association « un jardin
passionnément » : ateliers cuisine
Acteurs liés au Conseil Départemental
Entreprises du secteur sous les labels
Travailleurs sociaux de la Maison des Solidarités de Vittel et du Service Social Départemental
Syndicat Mixte des Déchets
AUTRES DYNAMIQUES DANS LES VOSGES
1/ Le PNR du Ballon des Vosges : un acteur clef
EcOOparc rassemble le PNR et une coopérative de production : ils ont monté un groupe-projet de producteurs et artisans de bouche pour ouvrir une boutique de producteurs locaux, un atelier de transformation, créer une marque et développer l’approvisionnement de la restauration collective.
Le soutien aux circuits courts se fait également avec le soutien du Pays des Vosges saônoises, Maisons de la Nature (Malsaucy et Vosges Saônoises). Dans le Val d’Argent, EcOOparc va créer un magasin de producteurs locaux, une monnaie locale et des ateliers cuisine itinérants.
Le PNR sensibilise aussi les jeunes via un appel à projet : « manger local, c’est idéal ! ». 16 projets ont été retenus sur 2016-2017 pour toucher environ 2000 jeunes. Etablissements scolaires, association et communautés de communes ont répondus.
2/Le Conseil Départemental à l’agriculture de Montagne
Le Conseil Départemental soutient la production locale et les circuits courts par la création de marques :
bleu, vert, Vosges qui regroupe 40 producteurs dont le Conseil Départemental est propriétaire depuis 1985,
FORê l’effet Vosges, récemment crée et qui regroupe produits locaux, cosmétiques et équipements touristiques.
Ces marques bénéficient du soutien financier de l’Etat via la convention de Massif.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental a également introduit des produits locaux dans la restauration collective.
Il a également Mis en place un fonds d’initiatives rurales et montagnardes pour encourager la diversification agricole avec un montant plafonné à 10 000 pour contribuer à 20% de l’investissement total.
Il a également lancé le trophée de la transition écologique qui récompense les actions existantes notamment dans la production locale et les circuits courts. Il a également édité un guide sur l’alimentation durable et responsable. Enfin la fédération médico-sociale et le service social du Département ont créé des ateliers cuisine hebdomadaire, les travailleurs sociaux de la Maison Des Solidarités de Vittel ont créé un jeu pédagogique sur l’alimentation.
Le syndicat mixte des déchets développe la lutte contre le gaspillage par des actions au sein d’établissement scolaire et EPAHD.
88

Pour en savoir plus :
http://lesbiosducoin.fr/
http://www.foyers-ruraux-vosges.org/index.php
http://www.associationfauve.org/cafe-fauve/
http://www6.nancy.inra.fr/sad-aster
D’autres dynamiques dans les Vosges
3/ La Chambre d’Agriculture
La Chambre d’Agriculture gère le label Vosges terroir depuis 1987 et anime l’association des producteurs de Munster et autres produits fermiers des Vosges qui regroupe 60 transformateurs, et encadre l’AMF, association des 200 fermiers producteurs de Munster et autres produits fermiers de la Montagne Vosgienne. Elle gère et anime également l’AOP miel de sapin des Vosges (40 apiculteurs adhérents).
Elle appuie l’ouverture de drive fermier : drive fermier de la Vôge, ouvert depuis novembre 2016. Il existe deux lieux de retrait au centre de Xertigny et à Pouxeux près du Super U, et le drive fermier de Saint Dié dont l’ouverture est prévue en avril 2017. Elle anime et organise le réseau Bienvenue à la ferme, ainsi qu’un trail annuel du terroir vosgien avec dégustation.
Enfin elle a créé une plateforme web d’information et de commande en circuit court pour la restauration collective.
4/ Le tissu associatif local
Le groupement des agriculteurs bio des Vosges et des associations comme ETC’terra à Fraize, organisent des évènements dédiés à l’alimentation durable.
Acteurs liés à la chambre d’agriculture
Entreprises du secteur sous labels
Equipements collectifs en restauration locale
Collectivités accueillant un drive fermier
Groupement des Agriculteurs bio des Vosges
89

EcOOparc – Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges
Chargée de mission
L’objectif du projet
EcOOparc réunit le PNR et une structure de co-production : une SCIC qui porte administrativement la démarche concernant le domaine de la coopération économique. Il coïncide avec le périmètre du PNR. Pour chaque territoire il y a un axe fort : dans la lorraine c’est l’éco-construction, dans la vallée de Munster c’est un réseau de créateurs d’entreprise et une ressourcerie etc.
Nous accompagnons depuis quelques années les démarches liées aux circuits courts en agriculture en lien avec la Communauté de Commune mais je n’avais pas identifié cela comme étant partie intégrante d’un PAT. Pour moi, un PAT c’est un plan qui tient compte d’une dynamique globale des acteurs et consommateurs du territoire. Il faut tenir compte de l’impact, des besoins et des enjeux. Il faut travailler à partir de l’énergie des personnes du territoire et de leur demande d’accompagnement.
Nous travaillons sur le Val d’argent qui se trouve sur le versant alsacien des Vosges, nous avons mené une réflexion avec les entreprises et les producteurs pour partir de leurs besoins pour qu’ils puissent monter des initiatives collectives. Ils ont souhaité monter un point de vente collectif qui a ouvert en 2017. A côté de cela nous avons 3 autres projets de plus petite envergure : la création d’une monnaie locale pour valoriser et sensibiliser à l’achat local, un projet d’atelier cuisine gratuit à partir de produits locaux du magasin de production, un livret de recettes avec un focus sur les producteurs locaux et enfin un projet de parc jardin (type jardin partagé) participatif géré par les habitants.
En ce qui concerne la monnaie locale c’est un collectif plus large qui va jusqu’à la vallée de Munster.
Concernant le magasin de producteurs, il y a une évolution vers une implication beaucoup plus forte notamment par la Communauté de Communes qui va faire les travaux donc qui va investir sur le futur lieu de vente. L’étude de marché a montré l’intérêt de la population dans leurs intentions d’achat en tout cas.
Notre prochain projet est de toucher les salariés des entreprises de la vallée qui sont nombreuses (cuisines Schmidt, Hartman, etc…). Ces entreprises sont intéressées pour qu’il y ait un point de retrait chez eux. Nous travaillons dessus avec le même groupe de producteurs que pour le point de vente.
D’où vient la démarche
En 2014 nous avons mené les premières actions expérimentales en allant chercher les personnes pour les amener à travailler ensemble. Nous avons cherché à définir leurs besoins communs. Nous n’avons pas fait de diagnostic mais nous sommes partis des données existantes (travaux d’étudiants, terre de liens aussi qui avait des données sur les exploitations à reprendre etc). Même si ce n’était pas exhaustif, nous sommes partis de ces éléments tels qu’ils étaient, nous n’avons pas récapitulé toutes ces données dans un document commun.
« Pour moi un PAT c’est un plan qui tient compte d’une dynamique globale des acteurs et consommateurs du territoire. Il faut tenir compte de l’impact, des besoins et des enjeux »
Activité : Accompagnement au développement d’activité économique Territoire : Le PNR du ballon des Vosges 2 700 km² 238 000 hab 5 villes portes et 2 Communautés d’Agglomération Responsable : Dominique Rivière Contact : 03 89 77 90 20 [email protected]
Carte d’identité
90

“Vivamus porta est sed est.”
Par exemple, l’étude de marché pour le magasin de producteurs est une partie d’un diagnostic mais on en avait besoin pour définir le prix de vente donc c’était un socle de base pour travailler sur le modèle économique en lien avec les producteurs. Nous sommes donc partis dans l’action très vite, en partant de leur perception et de leurs besoins.
Nous avons mené des rencontres créatives et un accompagnement pour passer de l’idée au projet. L’idée émerge petit à petit de faire un magasin collectif et non un magasin de producteurs d’achat revente. Aujourd’hui, nous démarrons le travail technique avec le SGAR et la Chambre d’Agriculture.
La création d’un point de vente a été un élément moteur. Dans le groupe des producteurs, pendant longtemps, il n’y avait pas de leader donc la mise en place a été longue et l’animation nécessaire. Aujourd’hui on a un groupe projet plus autonome. C’est aujourd’hui une association et peut-être plus tard un GIE. Il y a une ferme leader mais ils sont tous très actifs.
Les producteurs avec lesquels nous travaillons ont de petites échelles d’exploitation : il y a des éleveurs bovins et caprins, certains font de la volaille, des transformateurs (yaourt, fromage) un paysan boulanger, des producteurs de fruits. Il y a aussi une structure atypique, le jardin Giessen qui est une structure d’insertion qui fait du maraîchage en jardin de cocagne. Ils participent en tant que futurs associés. Tous ces producteurs sont souvent assez jeunes et ont repris récemment leur ferme.
Au début ils n’étaient que 5 et aujourd’hui ils sont 9. Les 4 nouveaux se sont installés entre temps, ce ne sont pas des conventionnels qui sont venus nous voir, ce sont ceux qui se sont installés entre temps. Dans notre magasin de producteurs certains sont associés et d’autres juste apportant : ils déposent leurs produits sans être dans le projet.
Nous avons aussi constaté une évolution sur leurs pratiques agricoles : la moitié était engagée sous un label de qualité et cela les a engagé dans du bio ou dans la labellisation Bienvenue à la ferme. C’est le fruit de plusieurs facteurs dont le fait que pour toucher la subvention de la région pour faire l’étude de marché pour le magasin de producteurs, il fallait qu’au moins la moitié soient en bio donc nous avons insisté et pour eux, cela était cohérent avec les méthodes qu’ils avaient déjà. De toute façon ils respectaient une charte implicite dans leurs pratiques : l’agriculture de montagne est une agriculture paysanne. Donc ce n’était qu’un pas de plus à franchir mais ce n’était pas si simple car pour eux ce sont des contraintes en plus.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Si c’était à refaire on les amènerait plus vite à construire leur projet car on a appris entre temps. Aujourd’hui les partenariats sont bien en place et nous travaillons plus étroitement avec la chambre d’agriculture. On a appris par exemple à faire des visites apprenantes c’est-à-dire rencontrer d’autres collectifs qui montent un point de vente, d’autres groupes projet. J’ai aussi acquis des techniques d’animation de réunion plus efficace. Au lancement on a beaucoup travaillé sur la cohésion de groupe et c’était nécessaire. Avec cet apprentissage maintenant on va beaucoup plus vite dans le travail en Franche-Comté.
Au niveau méthodologique, un diagnostic n’est nécessaire que dans certains cas. Par exemple dans le cas de la vente directe, il n’y a pas de risque, il n’y a pas de saturation du marché donc pas de problème de débouché. Cela dépend aussi du territoire : là, il s’agit d’une petite agriculture de montagne, il y a peu de producteurs, c’est facile à connaître. Cela dépend aussi de l’échelle du projet et du type d’action. Par exemple sur l’approvisionnement de cantines scolaires, il y a un enjeu sur des volumes importants.
Par rapport à la DRAAF nous aurons besoin de faire des échanges de pratique avec d’autres structures et aussi sur la méthodologie des actions.
« Nous avons menés des rencontres créatives et un accompagnement pour passer de l’idée au projet ».
« La création d’un point de vente a été un élément moteur ».
« Nous avons aussi constaté une évolution sur leurs pratiques agricoles »
Pour en savoir plus :
http://www.parc-ballons-vosges.fr/agir/les-actions/programme-ecooparc/
91

Activité : Animation et communication autour de l’agriculture bio et locale sur le territoire Territoire : 6 412 hab Baisse de la population de 7,44% entre 1999 et 2008 Responsable : Céline Schott Contact : 06 14 91 29 24 [email protected]
Co-fondatrice et Vice-présidente du café
L’objectif du projet
Un des objectifs du Café est de permettre au plus grand nombre d’accéder à une alimentation plus saine, tout en contribuant au développement local par le renforcement de la consommation de produits biologiques de proximité. Pour favoriser le rapprochement entre producteurs et consommateurs, nous avons proposé un ensemble cohérent d’animations autour d’une agriculture durable et d’une alimentation saine et locale, associant d’une part différents partenaires issus des mouvements de l’Education populaire (Fédération des Foyers Ruraux, Association « La Vie Ensemble », Association Fauve), et d’autre part, un réseau de producteurs bio de l’ouest vosgien, réunis sous le label « les Bios du Coin ».
Aujourd’hui, il y a plusieurs choses acquises : le « Coin des Bios » qui est le dépôt des « bios du coin » au café permettant aux adhérents de venir y chercher leurs commandes, la communication autour de l’agriculture biologique par l’organisation de soirées-débats et le lancement de marchés ou de brunchs bios occasionnels. Comme nous avions envie d’aller plus loin et de toucher des gens moins sensibilisés que les adhérents du Café (public jeune et/ou défavorisé), nous avons déposé un dossier PAT pour nous associer à d’autres partenaires afin de promouvoir l’alimentation et la production biologique à travers des animations pédagogiques (visites à la ferme, jardinage..), ainsi que des ateliers de cuisine au café. Nous voulions aussi faire des ateliers cuisine à l’extérieur afin de montrer qu’il est possible de cuisiner à partir de produits bio sans surcoût pour le consommateur dans la mesure où il n’y a pas d’intermédiaire et que donc le prix est celui du producteur.
Notre dynamique consiste à rendre accessible les produits de qualité et locaux tout en favorisant les rencontres. C’est très demandé par les producteurs parce que les drives font perdre le lien entre consommateurs et producteurs. Pour cela nous voulons développer les visites à la ferme et l’aide sous forme de bénévolat pour que les consommateurs connaissent mieux les contraintes du producteur et sachent d’où viennent les produits qu’ils consomment.
La force de notre dynamique est d’avoir une niche d’adhérents potentiellement motivés. Notre force c’est aussi que ce collectif est hors cadre institutionnel, c’est une démarche participative autonome.
« Pour moi la définition d’un PAT c’est tendre vers l’autonomie locale avec les producteurs, les transformateurs et la distribution, pour développer le territoire »
Carte d’identité
Café associatif Utopic
92

Les partenaires prévus dans le projet sont très impliqués. C’est une petite ville donc tous les partenaires sont liés au café. Le Président de l’association « la Vie ensemble » organise les débats, le Café adhère à la charte de la Fédération des Foyers Ruraux qui sont eux-mêmes par ailleurs très impliqués dans le développement local et les circuits courts. Le montage du dossier a permis de mieux se connaître pour voir ce qu’on peut faire ensemble. Nous n’avons pas eu le financement pour l’appel à projet PAT mais pour les ateliers de cuisine, nous allons voir comment nous organiser sans financement. Concernant la restauration au Café, nous ne ferons pas appel à un restaurateur et proposerons des choses très simples aux adhérents (soupe, tartines etc) à partir des produits des « Bios du coin ». En septembre, il y a un projet de festival et nous comptons contribuer à la partie restauration à partir des légumes issus du jardin familial de « la vie ensemble ».
Contexte du projet
En ce qui concerne l’évolution du territoire, F. Thierry qui fait partie des « bios du coin » et a été Président de la FNAB, fait le constat qu’« à Mirecourt il y a 10 ans, il n’y avait rien et aujourd’hui, il y a tout ». A titre d’exemple, l’Unité de Recherche INRA de Mirecourt ainsi que la Ferme du Lycée Agricole développent depuis plusieurs années des projets autour de l’AB et/ou des circuits courts. A Mirecourt, en un an, se sont ouverts un marché de producteurs, un magasin bio, une Amap et le café associatif. Il y a donc une véritable dynamique qui est en marche, à laquelle nous souhaitons contribuer.
A l’origine de tout cela, il y a eu le projet Vittel qui a conduit la recherche agronomique à travailler sur la zone de captage des Eaux de Vittel à la demande de Nestlé Waters, ce qui a amené à préconiser le cahier des charges en AB pour tous les agriculteurs de la zone de captage afin de préserver la qualité des eaux.
Par ailleurs, l’INRA Mirecourt a déposé l’année dernière un dossier de demande de subvention auprès de la Fondation de France qui a été accepté. Ce projet vise à organiser une « arène de concertation » entre acteurs pour créer un SAT sur le secteur de Mirecourt. Le Café Utopic et les Bios du Coin sont associés à ce projet, ce qui nous a permis de financer les premiers investissements indispensables pour démarrer l’activité de dépôt de produits bio au café par la mise aux normes de la cuisine. Le projet Fondation de France vise notamment à installer des producteurs bios sur une partie des terres de l’INRA afin de consolider l’autonomie alimentaire sur le secteur.
D’où vient la démarche ?
Le café a aujourd’hui 1 an d’existence et, dès le début, nous avons eu la volonté de développer l’agriculture biologique et les circuits courts à partir du Café. En effet, travaillant par ailleurs à l’Unité de Recherche INRA SAD de Mirecourt, je suis très sensibilisée à la question du développement de l’AB. A l’INRA, nous avions ouvert depuis plusieurs années un dépôt pour les Bios du Coin qui fonctionnait très bien pour les chercheurs et quelques personnes extérieures mais je trouvais dommage que si peu de monde ait accès à ce système de commercialisation très pratique pour les consommateurs, faute de moyens de communication.
« La force de notre dynamique est d’avoir une niche d’adhérents potentiellement motivés ».
« Les gens méconnaissent ce qui existe juste à côté de chez eux ».
93

“Vivamus porta est sed est.”
Pour en savoir plus :
http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Mirecourt-10-ans-d-une-experimentation-au-long-cours
Aujourd’hui, avec le café Utopic, nous disposons d’outils de communication opérationnels (newsletter, page Facebook) permettant de toucher très facilement sur le secteur des centaines d’adhérents potentiellement motivés et intéressés par ce mode de consommation. C’était donc l’occasion de mettre en relation producteurs et consommateurs afin de favoriser une meilleure communication autour de l’intérêt pour tous de consommer bio et local pour préserver les ressources naturelles, favoriser l’emploi et le développement économique du secteur.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Le cas de Mirecourt est intéressant à étudier pour les chercheurs car les PAT concernent souvent les grandes métropoles plutôt que les petites villes rurales avec de grosses difficultés économiques et sociales. Ici, même si nous sommes en zone rurale tout proche des producteurs, on ne mange pas mieux que dans les grandes villes, car les gens méconnaissent souvent ce qui existe juste à côté de chez eux, faute de communication. Nous allons voir si le dépôt au Café permet de rapprocher producteurs et consommateurs et si cela permet d’inciter à une autre forme de consommation.
Notre point de fragilité, c’est que nous sommes novices sur le sujet, et que nous manquons de recul. Nous n’avons pas de mode d’emploi, ni d’encadrement technique, ni de moyens salariés. Comment faire un bon projet d’animation avec des bénévoles et un manque de temps et de compétences sur ce qu’il y a à faire, tant du côté des bénévoles que des producteurs ? Nous aurions besoin d’un encadrement technique sur les ateliers de cuisine et la sensibilisation du public jeune et/ou défavorisé. Pour cela, nous aurions besoin d’animateurs professionnels.
Un autre blocage évident pour développer à l’avenir l’autonomie alimentaire sur le secteur de Mirecourt, est le manque d’outils de transformation pour la bio : alors que nous sommes une région laitière et qu’il y a un certain nombre de producteurs en bio, la laiterie refuse de traiter leur lait à part et il est remis dans le circuit conventionnel. Nous avons besoin de créer une micro-fromagerie locale. Avec le temps et en développant des petites unités les choses finiront peut être par bouger. Le lycée agricole est en train de passer en bio pour la production laitière.
Il serait également intéressant d’organiser des échanges d’expérience avec d’autres porteurs de projet qui débutent et ont besoin d’un accompagnement méthodologique, d’autres initiatives citoyennes pour voir comment toucher la population, comment ils ont communiqué autour de la bio, si y a-t-il des outils pédagogiques, etc.
Ce en quoi la DRAAF pourrait nous aider, c’est par exemple à concevoir une plateforme web pour commander les produits en ligne. Il faudrait harmoniser la logistique des commandes pour que cela prenne moins de temps aux producteurs, ainsi qu’aux consommateurs et trouver une manière de pouvoir aider les producteurs à préparer les commandes.
94

Pays d’Epinal
Chargé de mission fonds européens
L’objectif du projet
L’objectif global de ce projet est de rassembler les initiatives existantes sur le territoire afin d’améliorer les pratiques alimentaires au sens large (achat, cuisine, équilibre alimentaire, recyclage) de la population tout en profitant aux producteurs locaux grâce au développement des circuits de proximité.
Notre projet est essentiellement basé sur des ateliers alimentaires au sein de notre réseau de MASP (Maison des services publics) : mise en place d’ateliers nutritionnels bimensuels dans au moins 8 MSAP ; mise en place d’au moins 2 ateliers « sensibilisation à la consommation responsable, au réemploi et à la lutte contre le gaspillage alimentaire » par semestre dans au moins 8 MSAP, mise en place d’au moins 2 ateliers/rencontres de sensibilisation à la consommation de produits agricoles locaux par semestre, dans au moins 8 MSAP. Pendant les ateliers des producteurs locaux sont invités et présenteront leurs produits.
Ensuite dans un deuxième temps et en fonction de la fréquentation de ces ateliers, nous souhaitons développer le volet achat aux producteurs locaux, notamment avec l’outil agrilocal88 mis en place par la Chambre d’Agriculture et le Département pour la restauration collective. Agrilocal 88 démarre en 2017 donc ce sera l’occasion de participer à développer l’usage de ce dispositif.
En effet, lors de notre réunion avec la Chambre d’Agriculture des Vosges sur ce sujet, nous avons décidé de mettre en œuvre le projet en 2 temps : un 1er temps de test des ateliers, 2ème temps d’accompagnement à la consommation locale.
Enfin le PETR du Pays d’Epinal a un label Pays d’art et histoire qui inclus le patrimoine immatériel dont culinaire. Par des actions d’agrotourisme nous voulons agir sur ce volet via des pique-nique du terroir. Ils seront destinés aux touristes et à la population. Cela a déjà été fait il y a 2 ans avec un certain succès. Nous allons les relancer. Ce n’est pas au cœur du PAT mais en complément.
Nous avons mobilisé plusieurs partenaires : le Conseil Départemental des Vosges, le PETR du Pays de Remiremont, le SICOVAD, la Chambre d’Agriculture des Vosges, l’association Les Jardins de Cocagne, le Pôle Eco Terre. Mais notre partenaire moteur est le PETR du Pays de Remiremont avec qui nous avons l’habitude de travailler et qui est notre équivalent dans l’autre partie des Vosges.
Le pôle Eco Terre est un outil neuf qui travaille sur l’économie collaborative avec un volet développement des circuits courts. Le Président de ce pôle est également député de la circonscription d’Epinal et il nous a incités à nous rapprocher d’eux.
« Notre projet est essentiellement basé sur des ateliers alimentaires au sein de notre réseau de Maison des services publics (MASP) »
Activité : Développement d’une alimentation de qualité pour les habitants en appui au réseau des MSAP (Maison des services aux publics)
Territoire : PETR du Pays d’Epinal regroupement de trois intercommunalités 143 000 habitants 80 000 habitants Epinal
Responsable : Stréphanie Rauscent, Directrice du PETR. Coordinateur du projet : Dorian Audo
Contact : 03.29.37.26.76 [email protected]
Carte d’identité
95

D’où vient la démarche
Le déclencheur de notre PAT a été une information transmise par l’ANPP (association des pays) sur le label des PAT, à notre directrice. Elle a souhaité que nous y répondions, ce que les élus ont validé.
Nous avons mis l’accent sur la nutrition dans notre PAT car nous gérons le réseau de maisons de services publics, où se déroule un accueil de publics en difficultés. Nous avons vu qu’il y avait des demandes et besoin là-dessus. Il y a déjà eu quelques ateliers en 2016 là-dessus par un prestataire. Nous avons voulu les généraliser et nous savions que nous avions en interne une diététicienne. Sa présence a consolidé l’idée de développer ce volet en s’appuyant sur elle. Elle y consacrera environ la moitié de son temps. Comme nous voulions les généraliser, nous nous sommes saisis du cadre des PAT pour développer également d’autres volets en compléments comme une offre d’approvisionnement en produits bio et locaux pour les publics de ces MASP.
Actuellement nous ne mobilisons que de l’auto-financement via le fond national aménagement et développement de territoire dont bénéficient les MSAP. Le PETR Pays de Remiremont s’appuie sur le programme Leader. Nous avons un programme Leader mais sur la filière forêt-bois donc nous ne pouvons pas le mobiliser.
Le label PAT est pour nous une reconnaissance des actions réalisées et un caractère plus officiel à ce que nous mettons en place. Cela nous permet également de créer un partenariat qui n’aurait pas eu lieu sans cela avec le Conseil Départemental, la Chambre d’Agriculture et le Pays de Remiremont pour mieux se coordonner et mettre en place des actions communes.
Pour ce qui est de l’évaluation, nous allons mesurer le nombre d’usagers des MSAP qui ont assisté aux ateliers et nous distribuerons des questionnaires en début et fin d’ateliers pour mesurer l’amélioration des connaissances alimentaires et pratiques d’achat. Nous aurons ensuite comme indicateur le nombre de structure public ayant utilisé agrilocal88.
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN
Nous n’avons pas la compétence pour créer un partenariat économique entre les MSAP et les producteurs et par ailleurs les usagers des MSAP ont un faible pouvoir d’achat ce qui pose souci pour développer l’achat de produits locaux. Nous ne savons pas non plus combien de participants nous aurons aux ateliers qui sont dans des zones très peu peuplées. Nous avons une bonne fréquentation (70 000 passages/an sur les 28 MSAP) mais les ateliers intéresseront-ils ? Donc, en fonction de la première phase des ateliers, la thématique consommation locale sera développée.
« Nous avons mis l’accent sur la nutrition ».
« Actuellement nous ne mobilisons que de l’auto-financement ».
Pour en savoir plus :
https://www.lesmerveilleusesetinsolites.com/le-pays-d-art-et-d-histoire-du-coeur-des-vosges-1/le-petr-du-pays-d-epinal/
http://www.poleecotervosges.org/
96

Contact IUFN Maëlle Ranoux, Directrice de projet IUFN // 06 83 06 43 21 // [email protected] IUFN, International Urban Food Network est une association loi 1901, plateforme internationale de promotion des systèmes alimentaires durables pour les régions urbaines, basée à AgroParisTech, à Paris. IUFN vise à accélérer la transition des collectivités vers un système alimentaire local et durable, comme un nouveau paradigme de développement territorial. C’est un processus d’apprentissage progressif, un processus de conduite de changement dont le fil rouge est l’accès à l’alimentation durable pour tous. L’association soutient concrètement cette transition positive à travers des actions de sensibilisation, par la production de connaissances nouvelles et pluridisciplinaires et enfin par des missions d’accompagnement technique des collectivités dans la construction de leur projet alimentaire territorial.