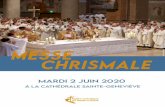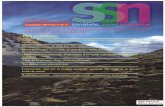Ecozone Nanterre
-
Upload
anonymous-j1fodscz5 -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Ecozone Nanterre
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
1/24Le lien philathélique n°116
Le Lien Philatélique N° 116
Villa des Tourelles
9, rue des Anciennes Mairies92000 Nanterre
D :
Le Président de l’Amicale Philatélique
de Nanterre Jean Grillot
N° SIREN 303 072 946L’APN F F A P
Amicale Philatélique
de Nanterre
Villa des Tourelles
9, rue des Anciennes Mairies
92000 Nanterre
Téléphone : 01 41 37 71 35
E-mail : [email protected]
L’APN sur le web :
://92.-.
Dans ce numéro
Les 10 ans de la Réserve naturelle 1
des TAAF fêtés à l’EcoZone
La Réserve naturelle des TAAF 2
Les émissions philatéliques 7
consacrées à la Réserve naturelle
Le feuillet anniversaire 13
Portraits d’Albatros
Mémoire des TAAF, les animaux 15
autochtones : les albatros
L’arche de Kerguelen 18
Les petites valeurs des TAAF 20
font leur show !
NA N T E R R E S A U S T RA L E S Spécial Ec
o Zone/ TAAF
L °116 .
I î ’
’
’APN92 14 22 .
I TAAF
N.
Le lien entre ce territoire urbain et les terres
’ .
M ’ ’
thème « Cup e chu, cup e fu e cm », les TAAF se posent en z
naturelles majeures concourant
’
’IPEV (I P E V)
R N
de notre pays et de ses territoires
’.
P ,
R N T
A N,
’ F EZ
c’est la 7ème .
L’ « P ’ »
superbement dessiné par Nadia Charles
,
’
« Vyge en Tee Aue ».
Vz
lointaines présen-
tées par l’Union des
Philatélistes Polaires
(UFPP-SATA).
Vz ’ K
P C, H
TAAF,
Vz
P E V.
Vz M A , ’
j ….
M
, C M,
D R N, M
Bkz R P TAAF.
LE LIEN PHILATÉLIQUEMai 2016 N°116
N C
21 N
TAAF
.
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
2/242 Mai 2016
Fg. 1 Ce e éeve nuee ue Fnçe
La Réserve Naturelle des terres australes
Françaises, qui regroupe les archipels
Crozet, Kerguelen et les îles Amsterdam
et St Paul, a été créée en 2006, par
décret interministériel. Cette décisionest l’aboutissement d’une démarche de
protection des îles dont l’origine remonte à
1996.
L’usage terrestre des iles australes a pro-
gressivement évolué depuis leur découverte
vers une protection renforcée, abandonnant
ainsi toute velléité d’exploitation écono-
mique.
En parallèle, la nécessité de protéger les
espèces d’oiseaux et de mammifères marinsa été concrétisée par les arrêtés des 27
juillet 1995 et 14 août 1998, du Ministre en
charge de l’Ecologie.
La philatélie des TAAF a, pendant toutes ces
années, accompagné cette mutation par des
émissions rendant compte de la qualité de
ces territoires d’exception.
1. Pé d RN
Les îles subantarctiques françaises constituent,du fait de leur éloignement des centres d’activitéshumaines, des sanctuaires pour la faune et la
ore. Le patrimoine biologique encore presqueintact de ces îles océaniques est d’une richesse etd’une importance considérables. (Fig.1)
Elle s’étend sur une partie terrestre de 700 000 haet une partie marine de 1 570 000 ha qui comprendles eaux intérieures et la mer territoriale autour deSaint-Paul et Amsterdam, les mers territorialesde l’Archipel de Crozet, à l’exception de cellesde l’île de la Possession, et une partie des eauxintérieures et de la mer territoriale des îlesKerguelen. Elle constitue la plus vaste réservenaturelle de la France représentant près de 80% dela surface des 167 territoires classés en réserves
naturelles nationales en France métropolitaine etdans les DOM-TOM.
Un plan quinquennal de gestion xe les objectifset permet de cadrer les activités nécessaires à la préservation du patrimoine naturel. L’objet dela réserve est de protéger les milieux naturelsmenacés : faune, ore, aquatique et terrestre.
Les champs d’intervention sont larges :
- Préserver les espèces animales ou végétales et leshabitats en voie de disparition ou remarquables,
- Reconstituer les populations animales ou végé-tales ou leur habitat,
- Préserver ou constituer les étapes sur les grandesvoies de migration de la faune sauvage,
- Préserver les biotopes et les formations géolo-giques, géomorphologiques ou spéléologiquesremarquables,
- Mener les études scientiques ou techniquesindispensables au développement des connais-sances humaines.
2. L p u d év
La faune et la ore de l’océan austral présententdes adaptations originales, résultat de plusieursmillions d’années d’évolution dans un isolementextrême. Les milieux naturels terrestres sontconsidérés comme « presque intacts ».
L’endémisme prononcé, la très forte relation
L 10 R N
T A Fç
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
3/24Le lien philathélique n°116 3
Fg. 2
Fg. 3
Fg. 4
trophique entre les domaines marin et terrestre,l’isolement extrême et l’éloignement de toutessources de contamination font de ces îlessubantarctiques des milieux originaux sanséquivalent. Elles présentent un intérêt exceptionnel pour la conservation de la biodiversité.
Les oiseaux et les mammifères
Les îles de Terres australes françaises sont les plus vastes des rares terres émergées de l’océan
Indien sud. C’est pourquoi elles constituent pourdes espèces marines se reproduisant à terre dessites d’importance majeure pour cette phase cléde leur vie.
Ces îles, considérées comme le «poumon» del’avifaune de l’océan Indien sud, accueillent lesreproducteurs de trente-quatre espèces d’oiseauxmarins et deux espèces endémiques d’oiseauxterrestres : le petit bec-en-fourreau, Chionisminor , et le canard d’Eaton, Anas eatoni. (Fig.2et 3 Chionis et Canard d’Eaton)
Parmi ces trente-quatre espèces, onze sont classéesmenacées d’extinction à des degrés divers.Sept sont classées« vulnérables », trois« en danger » et une« en danger critiqued’extinction ». Ils’agit de l’endémiquealbatros d’Amsterdam( D i o m e d e aamsterdamensis) dontl’unique populationactuelle est estiméeà 180 individus (30couples reproducteurssur site par an).(Fig.4 Albatros
d’Amsterdam)
Le Grand albatros, l’albatros à bec jaune,
l’albatros fulgineux, l’albatros à sourcils noirs, bien que non endémiques de ces îles, sontégalement menacés. (Fig. 5, 6, 7 et 8)
Les autres oiseaux, tels les Pétrels, les Prions, leDamier, le Fou austral, les Sternes de Kerguelen etsubantarctiques, le Skua, le Goéland dominicain,le Cormoran de Kerguelen, les Océanites et
d’autres encore sont protégés. (Fig. 9, 10, 11, 12,13, 14, 15)
Par ailleurs, l’archipel de Crozet héberge la plusvaste colonie mondiale de manchots royaux( Aptenodytes patagonicus) (Fig.16). Mais ontrouve également sur les îles d’autres espèces demanchots (papou, gorfou sauteur ou macaroni)qui sont également des espèces protégées.(Fig.17, 18, 19)
Fg. 5
Fg. 6
Fg. 7
Fg. 8
Fg. 10Fg. 11
Fg. 9
Fg. 12
Fg. 15
Fg. 13
Fg. 14
Fg. 16
Fg. 17
Fg. 18
Fg. 19
Les plages de Kerguelen accueillent la seconde population mondiale d’éléphants de mer dusud (Fig.20), et les eaux côtières de l’archipelabritent la seule population d’une sous-espècedu dauphin de Commerson (Cephalorynchuscommersonii ssp) (Fig.21).
D’importantes colonies d’otaries de Kerguelen( Arctocephalus gazella) (Fig.22) et d’otariesd’Amsterdam ( Arctocephalus tropicalis) sereproduisent sur les plages de ces îles. Le léopardde mer fait également quelques apparitions. (Fig.23)
L’essentiel des ressources trophiques de cesespèces se trouve en mer, dans la réserve marineet au-delà. Elle va du zooplancton aux poissons
(Fig.24). Les eaux qui s’étendent de la côte auxgrands fonds de la zone subtropicale hébergent
Fg. 20
Fg. 21
Fg. 22
Fg. 23
Fg. 24
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
4/24
d’Amsterdam (26 espèces de plantes vasculaires)est d’un tout autre type et présente des anités biogéographiques bien diérentes et variées.
À titre d’exemple, le seul arbuste de la réservenaturelle, Phylica arborea (Fig.33), est communaux îles Tristan da Cunha, situées en Atlantiquesud, et Amsterdam.
Les invertébrés
Les invertébrés terrestres des trois archipelsont également fait l’objet de nombreux travauxscientiques. Si leur richesse spécique est
globalement faible, elle varie d’un groupetaxonomique à l’autre et d’une île à l’autre.
C’est ainsi que l’île de la Possession dansl’archipel Crozet héberge trois espècesendémiques de vers de terre et pas moins de dixtaxons non décrits à ce jour, tous appartenant auseul genre représenté dans la zone subantarctique, Microscolex (Acanthodrilisae), alors qu’uneseule espèce est présente à Kerguelen.
L’endémisme strict est également très marquéchez les insectes, notamment chez les charançonsde Crozet, alors que les diptères présentent un
endémisme plus régional. À titre d’exemple,Crozet, Kerguelen et Heard hébergent Anatalantaaptera, la « mouche sans ailes de Kerguelen » (Fig.34), alors qu’un autre diptère, Calycopteryxmoseleyi, n’est présent que sur les deux dernières.
Cette faune subantarctique a développé denombreuses adaptations morphologiques ou physiologiques liées aux conditions climatiquesrigoureuses et au caractère aléatoire et temporairedes ressources trophiques de certains milieux.
pas moins de 205 espèces de poissons marinsdont les endémiques Bovichthys veneris et Neomerinthe bauchotae, et celles de la zonesubantarctique 125 espèces, dont Nototheniacyanobrancha, (Fig.25), Lepidonotothen mizops,
(Fig.26) Channichtys rhinoceratus, (Fig.27) et Channichtys velifer , toutes endémiques du plateau de Kerguelen.
Parmi celles-ci, les deux dernières espèces font partie du très singulier et intéressant groupedes poissons à sang incolore. Les espèces du
groupe des poissons-lanternes (Myctophidae) (Fig.28) sont réputées constituer l’essentiel desressources trophiques des populations d’oiseauxet mammifères marins si emblématiques deces îles. Si l’inventaire de l’ichtyo faune estlargement abouti, celui des invertébrés est loind’être achevé.
Les mollusques,les crustacéset les échino-dermes ont faitl’objet de tra-vaux qui ont ré-vélé la présenced’espèces endé-miques comme Hal icarc inus
planatus, un pe-tit crabe de Ker-guelen, Abatuscordatus, l’our-sin incubeur dumême archipel, Jasus paulensis,
la langouste des îles Saint Paul et Amsterdam(Fig. 29) ou Provocator pulcher , la célèbre vo-lute du Challenger (Fig.30).
La fore terrestre
Si la ore terrestre subantarctique est bien connuegrâce aux travaux des botanistes de renom quiont participé aux grandes expéditions de la ndu XIXe et du début XXe siècle, les travaux
plus récents de paléobotanique, d’écologie, degénétique et de physiologie ont permis d’enretracer l’histoire évolutive et biogéographique.
De ces travaux, il ressort actuellement que lesîles Marion (qui appartiennent à l’Afrique duSud), Crozet, Kerguelen et Heard (cette dernièreappartenant à l’Australie) font partie d’une même province biogéographique, siège d’un très fortendémisme. Par exemple , le chou de Kerguelen, Pringlea antiscorbutica (Fig.31), espèceemblématique de cette province, est présent surla totalité de ces îles.
En revanche l’endémisme strict demeure peudéveloppé chez les plantes supérieures,avec comme seuleespèce Lyalliakerguelensis àKerguelen (Fig.32).
Il apparaît égalementde façon de plus en plus évidente que cesespèces ont survécuà la dernière ère gla-
ciaire dans des zonesrefuges et que descolonisations posté-rieures à la déglaciation sont peu probables. Endépit d’une longue histoire, la richesse spéciquedemeure faible : 24 plantes vasculaires à Cro-zet et 29 à Kerguelen. La végétation autochtone
4 Mai 2016
Fg. 25
Fg. 26
Fg. 27
Fg. 28
Fg. 29
Fg. 30
Fg. 31
Fg. 32
Fg. 33
Fg. 34
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
5/24
Enn, ces communautés autochtonesd’invertébrés sont aujourd’hui confrontéesà l’établissement de nombreuses espècesintroduites (une trentaine à Kerguelen)dont certaines, perturbent profondément lefonctionnement de ces écosystèmes en renforçantdes maillons trophiques minoritaires.
La fore et les habitats marins
La ore marine est encore mal connue en dépit
d’importants travaux menés pendant les années1960 et 1970. Les vastes champs d’algues brunesgéantes constitués par Durvillea antarctica(Fig.35) et Macrocystis pyrifera frangentle pourtour de toutes les îles de la réserve,représentent une biomasse considérable et orentune protection naturelle aux zones côtières et à bien des espèces marines.
Si les habitats terrestres ont été répertoriés etrelativement bien dénis, ce n’est pas le casdes habitats marins. Ils n’en sont pas moinsoriginaux et souvent uniques : canyons sous-marins des fjords de Kerguelen, moulières à seuil,fonds à spicules d’éponges siliceuses, fonds àantipathaires de Saint-Paul et d’Amsterdam,massifs de coraux profonds d’eau froide deCrozet et Kerguelen et « herbiers » à Macrocystis pyrifera. (Fig.36).
3. L v cqu
Les îles australes accueillent ainsi de nombreuses
activités de recherche sur les districts, dans desdomaines très variés, touchant aussi bien lessciences de la vie que les sciences de l’univers, etce depuis plusieurs décennies. (Fig.37).
A titre d’exemple, elles accueillent des programmes visant à mieux comprendre lesstratégies développées par la faune et la oreface aux changements globaux ou aux conditionsclimatiques extrêmes. Dans ce cadre, certaines populations aviaires sont suivies depuis unecinquantaine d’années.
D’une manière plus générale, les îles australessont des observatoires de choix des eets deschangements climatiques. Les espèces animales
et végétales de ces territoires, parfaitement adap-tées aux conditions extrêmes, sont très sensiblesaux perturbations de l’environnement. Ainsiles îles australes sont de véritables laboratoiresnaturels permettantd’étudier la réponsedes populations auxévolutions environne-mentales.
Les observatoires ain-si que le suivi à longterme des populations
animales et végétales ont toujours reçu la plushaute priorité, permettant aux équipes françaisesde disposer des plus longues séries de donnéesdisponibles en Subantarctique.
Plusieurs de ces programmes de recherche sou-tenus par l’Institut Polaire Paul Emile Victor(IPEV) sont indispensables à la gestion de laréserve naturelle des Terres australes françaises.Une convention a donc été signée entre l’IPEV etles TAAF en décembre 2009 an d’y développerdes programmes de recherches ayant une nalité
conservatoire (suivi de population, veille sur l’in-troduction d’espèces invasives, validation scien-tique des actions conservatoires…)
De ce fait, plusieurs laboratoires de re-cherche soutiennent les activités d’in-ventaire et d’observatoire menées parles agents de la réserve naturelle (suivide « l’état de santé » des habitats, de lafaune et de la ore) (Fig.38). D’autres programmes de recherche sont égale-ment mis en œuvre an d’apporter desvalidations scientiques aux actionsde gestion environnementale à mener
(études préliminaire de l’éliminationd’espèces introduites par exemple).
En occupant des points singuliers de la planète, à des latitudes où les espacesémergés sont rares, les îles de la réserve
permettent d’entretenir des observatoires de
5Le lien philathélique n°116
Fg. 35
Fg. 37
Fg. 36
la planète Terre dans de nombreux domainesscientiques : géophysique, physique et chimiede l’atmosphère. Ces observatoires jouent unrôle essentiel dans le maillage établi à l’échelledu globe. La réserve apporte une contributiond’exception par les observations qu’elle permetsur des écosystèmes relativement « simples »car protégés, facilitant leur modélisation dans la
Fg. 38
Fg. 40
Fg. 39
perspective de leur généralisation à des milieux plus complexes. (Fig. 39 et 40).
D’autres actions du plan de gestion impliquent desmodications dans la logistique de ravitaillementdes îles an de limiter l’importation d’espècesexogènes (mesures de biosécurité), ainsi quedans le fonctionnement des bases pour limiter les pollutions et les déchets.
4. L dx d Rév
Depuis maintenant 10 ans, la réserve œuvre pourla connaissance et la conservation du patrimoine
exceptionnel des îles australes.
Les premières années (2006-2011) ont étéconsacrées à la dénition de l’organisation de laréserve au sein des TAAF et à la rédaction du plande gestion. Pendant cette période, la réserve s’estainsi structurée et dotée de moyens nancierset humains. En lien étroit avec l’ensemble des partenaires scientiques et avec les instancesde gestion de la réserve (Conseil consultatifdes TAAF qui tient lieu de comité de gestion, etComité d’Environnement Polaire qui tient lieu deconseil scientique), l’équipe a rédigé le plan degestion qui regroupe 9 grands objectifs à longterme, déclinés en 90 actions de conservation dela biodiversité.
Ce plan validé par les Ministres en charge del’Ecologie et des Outre-mers, constitue unevéritable feuille de route pour la collectivité.
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
6/24Mai 20166
Simultanément, de nouveaux recrutementsont permis de renforcer l’équipe de la réserveet d’envisager, à partir de 2009/2010, ledéploiement d’agents de terrain de la réservesur l’ensemble des districts austraux (Crozet,Kerguelen, Amsterdam et Saint Paul),
Cette équipe multidisciplinaire, travaillant deconcert entre le siège des TAAF, les districtsaustraux et les laboratoires de recherche partenaires représente aujourd’hui une vingtaine
de personnes.
En 10 ans, la réserve a ainsi pu réaliser l’ensemblede ces actions :
- La mise en œuvre et le suivi des observatoiresde long terme de la ore et de la faune terrestreset marine,- L’inventaire régulier des populations du terri-toire pour suivre la dynamique de nombreusesespèces,- La régulation des espèces animales et végétalesintroduites présentant un impact sur l’équilibredes écosystèmes de ces îles,
- La mise en place de procédures et de protocolesde biosécurité pour éviter toute nouvelle intro-duction d’espèce exotique au territoire,- L’identication des sources d’impacts des ac-tivités humaines sur l’environnement et leurréduction à travers une expertise spécique àchaque activité,- Le suivi des pêcheries du territoire, et l’adapta-
tion des techniques et de la règlementation pourréduire de manière continue les eets de la pêchesur les oiseaux, les mammifères marins, les es- pèces accessoires et les fonds marins.
Au-delà du périmètre national, la réservenaturelle bénécie aujourd’hui de plusieurs programmes européens et coordonne le hub polaire du programme BEST qui vise à la mise en place sur les Territoires polaires et sub polaires(Groenland, St Pierre et Miquelon, Territoires
britanniques, TAAF) d’un prol d’écosystème permettant à la commission européenne de mettreen place des nancements pérennes pour la préservation de l’environnement à large échelle.
Lors de la COP 21, l’annonce de la MinistreRoyal d’élargir le périmètre de la réservenaturelle de 550 000 km² et de créer ainsi la 5ème plus vaste Aire Marine Protégée de notre planète,donne à la réserve une dimension internationalede premier ordre. Cette approche est complétée par la préparation du dossier d’inscription de laréserve au patrimoine mondial de l’Unesco. Cetravail sera conduit tout au long de l’année 2016
et représentera une orientation forte du 2ème plande gestion de la réserve.
5. L pé u vc d
Rév
Les activités de préservation de ce patrimoinenaturel inestimable constituent un support de
communication à fort potentiel. La philatéliedes TAAF en est un maillon signicatif parla pertinence et la qualité de ses programmesannuels d’émissions.
Les 10 ans de la création de la réserve constituentun moment fort de ces actions de communication,qui se traduira par une série d’évènements :
- Un logo particulier est créé qui accompagneratoutes les initiatives. Il est réalisé par NellyGravier qui a fait quatre 4 propositions. (Fig.41) :
la n°1 a été retenue. (Fig.42)
- Ce logo est apparu pour la première fois sur lacarte de vœux du Préfet des TAAF. (Fig.43). - On l’a découvert ensuite début avril sur le borddes feuilles des petites valeurs et du timbre « logode Kerguelen » émis à Belfort, lors du salon de printemps de la CNEP. (voir article consacré àces émissions page 7).
- Il gurera enn sur le bloc « Albatros » émisle 21 mai à Nanterre à l’occasion du FestivalEcoZone. (voir article consacré à cette émission page 13).
Jean Grillot
Avec le concours inestimable de Cédric
Marteau, Directeur de la Réserve Naturelle.
Merci à Philippe Blache pour le prêt des pièces.
Fg. 41
Fg. 42
Fg. 43
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
7/24Le lien philathélique n°116 7
.5 : BF 2010 : A
Si la première émission comportant le logo
ociel date du 1/01/2012 seulement, il fautinclure dans les émissions attachées à la Réserve Naturelle les blocs émis entre 2007 et 2010. Ces blocs sont consacrés aux albatros (2007) (fg.1),aux éléphants de mer (2008) (fg.2), aux pétrels(2009) (fg.3), aux otaries (2010) (fg.4) et, ànouveau, aux albatros (2010) (fg.5).
Les émissions philatéliques consacrées à la
Réserve Naturelle
g.1 : BF 2007 : A
.2 : BF 2008 : E
f g. 3 : B F 2 0 0
9 : P é t r e l s
.4 : BF 2010 : O
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
8/24Mai 20168
En 2012, le logo de la Réserve Naturelle apparaîten dehors des timbres. Il en est de même pourles deux autres blocs de 2013 et 2014. Ces trois blocs ont été dessinés et mis en page par l’artisteClaude Andreotto.
Ils sont fabriqués selon le même procédémélangeant Taille Douce (TD) et Oset. Une partie du dessin des timbres est réalisé en TD (lestêtes des animaux) à partir d’une épreuve réalisée par Claude Andreotto. Les dessins des têtes
d’animaux en TD sont ensuite reportés sur uncalque qui est posé sur le Bon à Tirer Oset pournaliser l’assemblage, selon un calage dénitifdicile à réaliser.
Le logo est noté « Réserve Naturelle des Terres Australes Françaises » et non pas TAAF car la partie antarctique des TAAF (Terre Adélie) n’est pas incluse dans la Réserve Naturelle.
La première maquette du bloc de 2012 représentaitun iceberg, symbolisant l’antarctique. Elle a étérefusée, la RN ne couvrant pas cette région. Unedeuxième maquette représentant des animaux et
la ore protégés a été validée. La légende de deuxdes timbres du bloc a également été complétée.(fg.6, 10 images).
g. 6.1 mquee me Pée à menn nc
g.6.2 mquee me Ann
g. 6.3 mquee me Ly
g. 6.4 mquee me Mnch ppu
g. 6.5, BF e 2012, pemèe mquee nn eenue
g. 6.6, BF e 2012, euxème mquee vec égene Ann ncmpèe
g. 6.7, BF e 2012, mquee énve vec égene cmpèe Ann Ape
g.6.8 Epeuve TD u TP 4
g.6.9 BAT gné en 2011
g. 6.10 Bc énIfRN 2012
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
9/24Le lien philathélique n°116 9
En 2013, l’émission est consacrée au « Canardd’Eaton », espèce endémique de la Réserve. (fg.7, 8 images)
Le canard d’Eaton (Anas eatoni) est un canardde petite taille (400-500g) que l’on rencontreuniquement sur les îles Crozet et Kerguelen. Son plumage et sa morphologie sont très prochesdu canard pilet, espèce commune en Europehivernant en Afrique, d’où elle a coloniséevraisemblablement Crozet et Kerguelen. Elle y
est devenue aujourd’hui une espèce à part entière.L’espèce est abondante à Crozet, elle est rare surl’île de la Possession en raison de la présencedes rats, et a disparu de l’île aux Cochons aprèsl’introduction des chats.
A Kerguelen la population reste abondante, en particulier sur la péninsule Courbet et sur les îlesdu Golfe du Morbihan. Des bandes de plus de200 individus peuvent être observées dans leszones marécageuses où elle est à l’abri des chats.
Le canard d’Eatonse nourrit de végé-
tation des zones hu-mides et de petits in-vertébrés, insectes,vers notamment. Lareproduction a lieuau printemps, la fe-melle pond ses œufsdans la végétation,et dès l’éclosionelle part avec sescanetons se nourrirle long des coursd’eau.
g. 7.1 mquee me 1
g. 7.2 mquee me 2
g. 7.3 mquee me 3
g. 7.4 mquee me 4
g. 7.5, BF e 2013, mquee énve
fIg 7.6, BF e 2013, BAT, c Oe,épeuve
g. 7.7, BF e 2013, BAT pe en TeDuce, épeuve
g. 7.8 Bc énf 2013
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
10/24Mai 201610
Pour réaliser le bloc « Dauphins de Commerson »émis en 2014, l’artiste s’est inspiré de photos prises n 2010 dans le golfe de Morbihan auxKerguelen par Baptiste Millereux, cet amoureuxde la nature désormais installé au Québec.L’artiste a créé ses propres dessins pour illustrerle bloc et les quatre timbres.
Le TAD utilisé sur l’enveloppe 1er Jour comportele logo de la RN. C’est le seul TAD comportantce logo. (fg.8, 7 images)
Ce petit dauphin est une espèce en danger. Il présente une répartition géographique étonnantelimitée à l’hémisphère sud. On ne le retrouveen eet que dans le secteur sud-américain, soitles canaux et le Plateau de Patagonie (incluantles îles Falklands), et dans le secteur indien del’océan Austral aux îles Kerguelen. Aucune autredistribution actuelle ne relie ces populationsisolées et l’on peut considérer qu’elles évoluentindépendamment (sous-espèces). Des études de
g. 8.1 Ph u 11 12 2010 e B Meeux. Gfe uMhn à Kegueen Duphn e Cmen
g. 8.2 Ph u 11 12 2010 e B Meeux. Gfe uMhn à Kegueen Duphn e Cmen
g. 8.3 Ph u 11 12 2010 e B Meeux. Gfe uMhn à Kegueen Duphn e Cmen
g. 8.4 Ph u 11 12 2010 e B Meeux. Gfe uMhn à Kegueen Duphn e Cmen
g. 8.5, BF e 2014, mquee
g. 8.6, BF 2014, énf Duphn e Cmmen
g. 8.7 BF 2014, uphn Env Peme Ju TAD RN
génétique le conrment. L’espèce de Kerguelenserait composée d’une (ou quelques) centainesd’individus.
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
11/24Le lien philathélique n°116 11
En 2015, pas de bloc mais deux timbres présentant des insectes de Crozet. Ce sont les premiers TP sur lesquels apparait le logo dela RN. Ils sont dessinés par Mathieu Rapp, biologiste ayant travaillé pour la Réserve, maiségalement artiste indépendant. Il a exposé sesdessins sur la biodiversité de Crozet à Paris en juin 2014.Les deux TP à 0,66€ et 2€ ont fait l’objet de misesen page diverses avant le choix de la maquettedénitive (avec la date en coin à 00.00.00).
Le TP à 2€ a été tiré sur deux papiers diérents :l’un blanc et l’autre jaunâtre. Cette diérencen’a été découverte qu’un an après l’émission demanière fortuite. On ne sait donc pas combien detimbres parmi le tirage de 50 000 sont tirés surl’un ou l’autre papier. (fg.9, 10 images)
g. 9.1 mquee me 2015 ECTEMNORHINUSVANHOEFFENIANUS nn eenue
g. 9.2 mquee me 2015 ECTEMNORHINUSVANHOEFFENIANUS eenue
g. 9.3 pje pu e 2 Tme RN 2015 g. 9.4 pje eenu pu e 2 me RN 2015
g. 9.5 feue e 30 TP Agnée 2€ CD 00,00,00 g. 9.6 TP 2015 nece 2€ feue énve vec CD11 09 2014
g. 9.7 TP 2015 Agnee 0,66€ vec CD 00,00,00
g. 9.9 TP nece ppe nc
g 9.8 TP 2015 nece 0,66€ feue vec CD 11 09 2014
g 9.10 TP nece ppe junâe euché
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
12/24Mai 201612
g. 10.6 me nece 2016 pje eenu g RN03 cmpe
fig. 10.9 Timbre 2016 Insectede Crozet GAO dans la marge
En 2016, une nouvelle émission d’un timbreest proposée sur les insectes de Crozet. Ledessinateur Mathieu Rapp a fait six propositions,en couleurs ou N&B. La mise en page des 6dessins a été réalisée par Nelly Gravier. Le dessinretenu est le n°2. Il est réalisé en GAO (gravureassistée par ordinateur), indication qui gure en bas et à droite du timbre. (fg.10, 9 images) g. 10.1 Den pu TP nece 2016 - g. 10.2 Den pu TP nece 2016 - g. 10.3 Den pu TP
nece 2016 - g. 10.4 Den pu TP nece 2016
g. 10.5 Ppn pu me 2016 nece RN03-01
g. 10.7 TP 2016, nece, e e cueu g. 10.8 TP 2016 nece, feue vec cn é
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
13/24Le lien philathélique n°116 13
L’émission d’un timbre « hors programme » a été proposée pour marquer les 10 ans de la Réserve Naturelle des Terres Australes Françaises.C’est Nadia Charles qui a proposé les premiersdessins à la Commission philatélique des TAAFle 17/12/2015 (fg.1). Elle est une spécialiste des
dessins à caractère scientique et a travaillé pourle Muséum d’Histoire Naturelle à Paris et à LaRéunion, ainsi que pour l’INRA.Trois maquettes permettent de suivre l’évolutionde la composition entre décembre 2015 et janvier2016.Dans un premier temps, la Commission aexprimé le souhait que le bloc soit dédié aux seulsalbatros, le Pétrel a donc été enlevé et remplacé par l’albatros timide (fg.2).
Le texte est rectié (ciel austral au lieu de cielantarctique), le positionnement du logo estnalisé (fg.3).
g.4 : Mquee vec g RN e 10 n nveé.
g.1 : Pemèe mquee enée p N Che(éceme 2015)
g.2 : Den e ’ me e N Che.I empce e pée u mquee.
g.3 : Mquee e p ’
Le dessin est nalisé début février 2016 (fg.5).La réalisation de l’émission est alors envisagéeen « Oset/taille Douce », procédé qui consisteà superposer à une image Oset une maquettegravée (par ordinateur, GAO) ne reprenant queles traits principaux du dessin.
Elsa Catelin est alors sollicitée pour réaliser la partie de la maquette en taille douce. Elle grave
les becs des oiseaux. (fg.6, 7), ce qui permet denaliser le gabarit pour caler la partie TD sur lefond Oset. (fg.8, 9).
Le 25 février le service de Phil@poste proposecertain nombre d’observations relatives audimensionnement du dessin (fg.10, voir pagesuivante).
A cette date, Phil@poste demande un délai de16 semaines pour naliser la fabrication et lalivraison du tirage. Ce délai apparaît incompatibleavec la date de mise en vente prévue le 21 mai.
Le service philatélique des TAAF opte donc débutmars pour une fabrication en oset seulement,avec un renforcement de la partie initialement prévue en TD : Dans le même passage oset qui permet l’impression du fond en quadrichromie,une surimpression est réalisée pour la partie (aux
Le logo RN apparaît sur le bloc et le logo 10anssur le timbre mais un essai est réalisé avec la proposition inversée (fg.4).
g.5 : Mquee énve, en euché.
g.6: Pe u en gvée p E Cen.
g.7 : Pe u en gvée p E Cen.
g.8 : Cge e pe TD u fn Oe.
g.9 : Mquee énve n exe.
L’émission Portraits d’Albatros du
10 anniversaire de la Réserve Naturelle
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
14/24Mai 201614
aux habitudes de Phil@poste) gure en bas sur lefeuillet. Contrairement à la maquette initiale, ellesera placée à gauche, car le bord droit est réservéau code barre. (fg.11).
Le tirage prévu est de 50 000 exemplaires.
A noter pour nir que le dessin du TAD a étéréalisé par Daniel Astoul de l’UFPP-SATA, pour un premier jour à Kerguelen, Crozet etAmsterdam. (fg.12), et une mise en vente à Nanterre le 21 mai 2016.
traits de couleur noire) qui était prévue en taille-douce.
La signature d’Elsa Catelin n’apparait donc pas dans le projet nal. Seule celle de NadiaCharles (en entier pour une fois, contrairement
g.10 : Cge éé p Ph@pe.
g. 11 : Oevn u ’empcemenéevé u Ce Be e gnue àépce à guche.
g.12 : TAD Peme Ju à Kegueen.Den e Dne Au.
D A
21 ’UFPP-SATA
.
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
15/24Le lien philathélique n°116 15
Préambule.
Après un premier chapitre consacré auxmammifères marins de l’archipel de Kerguelen,nous abordons ici les oiseaux mythiques des eaux
australes que sont les albatros. Déjà, pendant levoyage, dès le trentième parallèle Sud, nous prenons l’habitude de les voir voler derrière le« Marion-Dufresne ».
L’administration des Terres Australes etAntarctiques ne s’y est pas trompée puisqu’elle aémis de nombreux timbres les concernant.
Parmi les espèces d’albatros présentes dansl’archipel des Kerguelen, nous pouvons citer les3 espèces les plus facilement observables:
L’albatros hurleur (ou grand albatros),
L’albatros fuligineux à dos clair,
L’albatros à sourcils noirs.
I – GENERALITES.
Les albatros sont des oiseaux marins qui viventen pleine mer en se laissant porter par les ventsdominants d’ouest dans l’hémisphère sud (40èmes rugissants et 50èmes hurlants). Ils peuvent, grâceà l’envergure de leurs ailes (plus de 3 mètres pour certains), survoler l’océan sans eort pendant plusieurs heures et parcourir ainsi jusqu’à 1000 kilomètres par jour. Leurs ailesrestent quasiment immobiles, ils n’ont qu’à enadapter les extrémités (leur main) pour changerde direction et pour tenir compte de la force duvent. Ils se posent sur la mer et en redécollentfacilement grâce à leurs deux pattes fortement palmées. Ne pouvant pas battre leurs ailes trèslongtemps, les albatros sont dépendants des vents pour se déplacer. La nuit, ils se posent sur l’eau pour dormir. On ne se lasse pas d’observer leur
vol tellement c’est magnique lorsqu’ils suiventle Marion Dufresne.
Les albatros ont un bec long corné. Deux narinestubulaires sont situées le long de la mandibulesupérieure qui se termine en crochet très pointu. Ils se nourrissent uniquement de jour principalement de poissons, de calmars pêchésen surface et de cadavres. Il semble que les plus petites espèces (Albatros à bec jaune…) soientcapables de plonger jusqu’à 5 mètres.
Ils se rendent sur terre uniquement pour se
reproduire. Là, les femelles pondent un œuf
unique qui est couvé à tour de rôle par les deux parents sur des nids assez imposants constitués deterre et de végétaux, le tout rembourré de plumeset d’acaena. Puis, les deux adultes nourrissent àtour de rôle leur poussin. Les albatros nichentsoit en colonies (albatros à sourcils noirs) ou
Les animaux autochtones
à Kerguelen
C 2 L b
MEMOIRES DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES24ème mission à KERGUELEN (1974)
« Feuillet n° 17 : Les diérentes espèces d’albatros »
« Tme N° 298.
A en v ».
seuls (albatros hurleur et albatros fuligineux).
Les albatros, comme la plupart des oiseaux demer, sont des espèces à stratégie « K », c’est-à-dire d’espèces dont les individus ont une durée devie importante (de 50 à 60 ans) avec un taux de
reproduction faible impliquant un investissementdes deux parents pour nourrir les poussins. Pourexemple, les albatros hurleurs ne se reproduisentqu’une fois tous les deux ans avec la ponte d’unseul œuf.
En 1974, on savait peu de choses sur les albatros.
« A en v. A e. A hueu.
A guche : A à uc n».
« Bguge ’un gén ».
Seules des observations de dénombrementétaient réalisées (baguage et lectures de bagues).
Ainsi, grâce à la lecture des bagues, on sait queles albatros sont dèles à vie à leur partenaireet qu’ils reviennent nicher au même endroit.Les albatros sont capables de parcourir de trèsgrandes distances en peu de temps. Par exempleun albatros hurleur, bagué très jeune à Kerguelen,au sud de l’Océan Indien, a été retrouvé dixmois plus tard sur la côte chilienne, après avoir parcouru quelques 18 000 kms. On a aussirécupéré des albatros, bagués à Crozet, en merde Tasmanie.
La miniaturisation de l’électronique a permis,depuis 1989, d’équiper certains albatros de balise Argos an de les suivre en mer. Ainsi, ona montré qu’ils peuvent se déplacer de plus de900 kms par jour avec une vitesse de croisièrede 50 à 90 km/h. En 2004, une étude a montréque l’oiseau le plus rapide a parcouru 22 545kilomètres en seulement 46 jours.
Aujourd’hui, l’Union Internationale pour laConservation de la Nature (UICN) considère quele statut de conservation des albatros des TAAFest défavorable et que certaines espèces sontmenacées d’extinction à cause notamment de la
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
16/24Mai 201616
pêche dans l’océan austral remontant à la n desannées 1960 et plus récemment de la pêche de lalégine (*). Les lets maillants dérivants ayant été prohibés à cause du manque de sélectivité dansles prises, les bateaux de pêche de la légine (*)se sont équipés de palangre consistant en uneligne de plusieurs kilomètres de long munie denombreux hameçons avec appâts.
(*) La légine australe est un poisson des mers froides australes
dont la chair est très appréciéedepuis les années 1990, notammenten Amérique du Nord et au Japon.
Les albatros, attirés par les poissons pêchés ou lesappâts, sont pris dans les hameçons et meurent par blessure ou noyade. La mort dans ces conditionsd’un parent entraîne inévitablement la mort du poussin puisqu’il n’est plus nourri que par le parent restant, ce qui est évidemment insusant.De plus, la formation d’un nouveau couple parle parent restant n’est pas immédiate. Ainsi, les populations d’albatros diminuent rapidement.
Cependant, des mesures relatives aux techniquesde pêche à la palangre ont été prises aussi biendans la ZEE de Kerguelen (Zone EconomiqueExclusive) que dans l’océan austral, à savoir :
- Lestage des lignes.- Mise à l’eau des lignes au crépuscule puisqueles albatros se reposent.- Vitesse réduite des bateaux pendant les phasesde pêche.- Mise en place de banderoles ottant à l’arrièredes bateaux empêchant les oiseaux de se jeter surles poissons lors de la remontée des lignes.
Des articles parus dans le courrier de la Nature en
2015 (édité par la Société Nationale de Protectionde la Nature SNPN N° 291 Spécial Pôles) etdans le Supplément du Quotidien de la Réunionconsacré aux 60 ans des T.A.A.F (3 Octobre2015) montrent que ces mesures sont ecaces.
II – L’ALBATROS HURLEUR.
Lors de mon hivernage en 1974, j’admire à plusieurs reprises sur les terrains plats de la presqu’île du Prince de Galles des albatroshurleurs appelés également grand albatros (nomscientique Diomedea exulans). A l’âge adulte,
le grand albatros a une envergure de 2,5 à 3,5mètres, son poids variant de 6 à 11 kilos. Tout le
corps est blanc, à l’exception du bout de ses ailes(rémiges) qui est noir. On estime la population
de l’albatros à environ 1000 couples nicheurs àKerguelen.
Ces albatros géants ont besoin d’un long terrain plat pour pouvoir courir an de décoller faceau vent et de s’envoler car ils ne peuvent pasvoler en battant leurs ailes trop grandes. Quantà l’atterrissage, ils déploient leurs ailes contre le
vent et courent une fois touché le sol (un peucomme des parachutistes).
Les diérentes scènes auxquelles j’assiste àdiérentes périodes de mon séjour comprennentnotamment une parade nuptiale, une femelle entrain de couver et un poussin sur son nid.
La parade nuptiale
La formation d’un couple prend plusieurs années.Mais une fois formé, ce couple ne se rompt qu’à
la mort de l’un des 2 conjoints (et ils peuventvivre 60 ans).
Avant l’accouplement, les albatros s’adonnentà une parade amoureuse qui dure de 15 à 30minutes. Un soir, je vois une parade nuptialedont j’admire la chorégraphie qui comprend descroisements et des claquements de bec, des face à
face avec ou sans déploiement d’ailes, des dansesd’une patte à l’autre, le mâle allongé devant lafemelle… J’en photographie quelques phasesque je vous livre ici.
Si l’œuf est détruit, l’albatros géant n’en pond pas d’autre. Compte tenu du fait que le tempsd’incubation et de croissance de l’unique poussindure 11 mois, l’albatros hurleur ne se reproduitqu’une fois tous les 2 ans.
Le poussin, après l’éclosion est gardé pendanttrois semaines jusqu’à ce qu’il soit assezgrand pour conserver sa température. Le plus photographié à Kerguelen en 1974 est celui quise trouve à une cinquantaine de mètres de lacabane de la Roche verte. Les photos suivantes lemontrent à plusieurs stades de son évolution surenviron 10 mois.
Les premières semaines, le jeune poussin,ayant encore un duvet très important, reste sur
son nid où il est nourri à intervalles réguliersalternativement par chacun de ses deux parentsqui mâchent en régurgitant la nourriture avant dela donner au petit (calamars, petits poissons ethuile fabriquée par les adultes dans leur gésier).
Puis, il est nourri ensuite moins souvent an qu’ilsoit incité à quitter le nid. A ce stade (vers 6-7
« Tme N° 465. Têe e gn ».
« Pe hueu. Cemen e ec ».
« Pe hueu.
Mâe ngé evn femee ».
« Pe hueu.
Dne ’une pe u ’ue ».
« Pe hueu. Cemen e ec ».
« Pe hueu. Mâe evn femee ».
« Accupemen ’ hueu »
« BF N° 15. Tme N°451. A gén u n ».
« A hueu en n e
cuve ».Cemen e ec ».
« A hueu eunn
n œuf ».
« A hueu
eu u n
œuf ».
« Jeune pun
’ hueu
u n n ».
La ponte et la couvaison.
L’albatros hurleur niche isolément et pond un seulœuf (d’environ 500 grammes) sur un grand nidconstitué d’un monticule de boue garni d’acaena.La ponte a lieu vers n décembre et l’éclosion un peu plus de deux mois après. La femelle couveses œufs pendant 20 à 30 jours sans boire et sansmanger. Ensuite, le mâle et la femelle se relaient pour couver l’œuf à tour de rôle pendant une période allant de 70 à 80 jours (la plus longue période d’incubation chez les oiseaux). De tempsen temps, l’albatros géant se lève pour retourner
avec son bec l’œuf qu’il couve.
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
17/24Le lien philathélique n°116 17
« Pun 6-7 m
à côé e n n ».
mois), il a quasiment perdu son duvet et pris son plumage dénitif. Sa croissance est lente.
Enn, après avoir essayé ses ailes (vers 9 mois), le jeune albatros s’envole sans l’aide de ses parents
pour naviguer au-dessus de la mer pendant 5 à 6ans. Il ne reviendra qu’à l’âge adulte sur terre nonloin de là où il est né.
Une fois le petit parti, le couple se sépare pendantune année complète à la n de laquelle ils seretrouvent à l’emplacement de leur ancien nid, etle cycle de reproduction recommence.
III – L’ALBATROS FULIGINEUX A DOS
CLAIR.
Sur la presqu’île du Prince de Galles, entre lacabane de la Roche Verte et le Pointe Suzannese trouve une falaise nommée Cap Milon. On y
trouve quelques couples d’albatros fuligineux àdos clair. Ceux-ci nichent en hauteur sur cettefalaise dicile d’accès plongeant dans l’océan.Du fait de l’exposition de la falaise au vent, ilest très facile pour cet albatros de décoller sansélan en se lançant dans le vide, un peu comme lesadeptes de parapente en montagne.
Il existe d’autres petites colonies de fuligineuxà Kerguelen, notamment l’une implantée à 5-6kilomètres de la mer, en descendant depuis les« Hauts de Hurlevent » dans le cañon des sourcilsnoirs dont il est question dans le chapitre suivant.
Pour être plus précis, l’albatros fuligineuxde Kerguelen est du type « à dos clair ». Nomscientique : « Phoebetria palpebrata ».
Il a une envergure d’environ 2 mètres pour un poids de 3 Kg. Comme sur les photos jointes,il est de couleur grise avec la tête plus foncée.Son bec est noir tandis que son œil est entouréde blanc.
« Tme N°468. A
fugneux ».
« Tme N°12. A
fugneux en v ».
Sur cette photo, il faut remarquer l’acaena qui estvierge de prédation par les lapins.
L’albatros fuligineux, comme les autres albatrosne pond qu’un œuf sur son nid constitué d’unmonticule en terre dont le sommet a une forme
« A fugneux
cuvn u n n»
de cuvette. Cet œuf, pondu début décembre, estcouvé pendant environ 70 jours.
Une fois le poussin né, il est nourri alternative-ment par chacun de ses parents tous les 5-6 jours.Le poussin ne s’envolera que vers n mai, soit4 mois après l’éclosion de l’œuf. Le petit a unduvet très n et une tête ressemblant à celle d’unclown.
Le jeune albatros fuligineux reviendra trois ans plus tard pour former un couple qui durera pendanttoute son existence. Son taux de reproduction esttrès faible puisqu’il ne se reproduit que tous les2 ans. De plus, on estime que le premier oisillonnaîtra au bout de 10/11 ans.
L’albatros fuligineux de Kerguelen ne suit pas les bateaux. Il se nourrit dans les eaux antarctiqueset sa durée de vie est de l’ordre de 50 ans.
L’estimation de sa population dans l’archipel des
Kerguelen varie entre 3000 et 5000 couples.
Note :
En décembre 1975, trois couples d’une autre
espèce d’albatros fuligineux, l’albatros
fuligineux à dos sombre (Phoebetria fusca)
ont été aperçus à Kerguelen semble-t-il pour
la première fois. Ils nichaient dans une des
2 colonies d’albatros à sourcils noirs (cf.
publication L’oiseau et Revue Française de
l’Ornithologie, V48, 1978).
IV – L’ALBATROS A SOURCILS NOIRS.
En décembre 1974, j’ai la chance d’aller, avecquelques autres hivernants, au cañon des sourcilsnoirs qui est situé au Sud-Est de la Grande Terrede Kerguelen derrière la presqu’île Ronarc’h et àl’extrémité de la presqu’île Jeanne d’Arc.
Le bateau nommé « La Japonaise » nous laisseau Halage des Naufragés qui sépare ces 2 presqu’îles. Ce navire abandonné par un navire de pêche japonais et retrouvé échoué a été aménagé pour les activités relevant de la biologie marineavec possibilités de dragages et de mesuresocéanographiques (hauteur d’eau, température,salinité…).
Ensuite, après avoir parcouru une dizaine dekilomètres sur les « Hauts de Hurlevent », nousinstallons notre campement dans une vallée à proximité des albatros à sourcils noirs.
Après avoir passé la nuit sous la tente, nousgrimpons sur la falaise qui tombe à pic dansl’océan indien et sur laquelle nous pouvons ennapprocher ces oiseaux.
« Pen
fugneux e n
pun ».
L’albatros à sourcils noirs ( Diomedea melano- phris) a un poids de 3 à 5 kg et une envergured’environ 2,10 m à 2,5 m. Les signes caracté-ristiques le distinguant des autres albatros sontd’une part la ligne noire prononcée au-dessusde son œil (d’où son nom de sourcils noirs) etd’autre part le dessous de ses ailes comprenant
une assez large ligne noire entourant la plage blanche centrale.
« Vée ’vée u
cñn e uc
n».
L’albatros à sourcils noirs se reproduit tous lesans dans deux grandes colonies dont on estime la population à 1 200 couples et qui sont situées àanc de falaises. Ainsi, il n’a aucune diculté às’envoler contrairement à l’albatros hurleur.
« Tme N°24.
A à
uc n u
n n ».
« Tme N°486. Têe
’ à uc
n ».
« A
à uc
n gué e
n œuf ».
Les couples arrivent en septembre et pondentleurs œufs (1 seul par couple) vers mi-octobresur des nids d’une hauteur très importante faitsde terre. Après avoir été couvé pendant environdeux mois, l’œuf éclot début janvier. On protede la période de couvaison pour réaliser desopérations de baguage.
Les nids étant très proches les uns des autres,il arrive fréquemment que les albatros sechamaillent lorsque l’un n’atterrit pas à côtéde son nid l’obligeant ainsi à marcher entre lesnids des autres. De même, quelques conits ontlieu avec des cormorans qui nichent eux aussien nombre important sur les falaises. Pour semouvoir à l’intérieur de la colonie, nous devonsêtre très vigilants du fait que le terrain à anc defalaise est dangereux et très glissant. De plus, nousdevons déranger le moins possible les albatros.Par exemple, lorsqu’on veut photographier unœuf, il faut déplacer tout doucement l’albatros, puis une fois les photos terminées attendre que
l’albatros à sourcils noirs ait repris sa couvaison,ceci an que les prédateurs ne gobent pas sonœuf.
L’albatros à sourcils noirs peut plonger jusqu’àsix mètres dans l’eau. Il pêche sur le plateaucontinental de Kerguelen dans une limite dequelques centaines de kilomètres autour de lacolonie, donc à proximité des zones de pêche. Dece fait, cette espèce est – ou a été – beaucoup plussensible que les autres aux eets néfastes de la pêche à la palangre.
Au retour du cañon des sourcils noirs, en attendant
« La Japonaise », j’admire avec mes compagnonsun léopard de mer que je photographie sous tousles angles.
Jean-Louis BIZET ( A suivrre)
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
18/24Mai 201618
De nombreuses arches naturelles issuesde l’érosion se donnent à voir sur toutela surface du globe. Les diverses Postesmondiales en ont d’ailleurs consacré plusieurs.
En dehors des géographes et géologues, leshistoriens des ponts leur portent un intérêt particulier : probablement est ce l’observationde ces créations de la nature qui a aidé leshommes à imaginer la forme architecturale del’arc voûté. Peu ont cependant autant frappé lesexplorateurs, navigateurs et hommes de lettresque l’Arche des Kerguelen, qui fut et reste unecuriosité géographique étonnante malgré soneondrement partiel.
Ce monument naturel est situé au nord-est del’île principale de l’Archipel des Kerguelen,exactement à 48°43’ latitude Sud et 69°04’
longitude Est au bout d’une petite langue deterre qui l’isole nettement de l’île. Ce fut d’abordun rocher percé très élevé (103 m. environ audessus de l’île) formant une arche rectangulairecaractéristique qui fut remarquée par tous lesnavigateurs, depuis la découverte en 1774
L’ARCHE DES KERGUELENMichel Krempper, Association Française de Philatélie Thématique
jusqu’à la première expédition des frères Rallierdu Baty en 1908-1909 : lors de la deuxièmeexpédition Rallier du Baty en 1913-1914, onconstata l’eondrement du toit de l’arche. Seulesdeux colonnes verticales subsistent de nos joursqui ont conservé le nom originel d’Arche desKerguelen.
Issues du volcanisme originel, elles sontcomposées de basalte. On peut y voir des morceauxde bois silicié, attestant d’épisodes climatiquesantérieurs nettement plus doux qu’aujourd’hui
Figure 1. Couv er ture du carnet d e v oyage «paysages»
Elle est comme la ported’entrée de l’archipel. Enfait, elle marque l’extrémitésud-est de la Baie del’Oiseau, la pointe nord-est
de cette baie étant le CapFrançais.
Elle fut d’abord nomméeLe Portail sur la carte duchevalier de Kerguelen lui-
même lorsqu’il la voit pour la première fois en janvier 1774, à son second voyage. L’astronome
Le Paule Dagelet qui l’accompagna et t alorsun périlleux débarquement ne manqua pasde la mentionner dans son compte-rendu àl’Académie des Sciences. Deux ans après, le capitaine James Cook arrivedans ces îles qu’il appellera d’abord Îles de laDésolation avant de les baptiser Îles Kerguelenen l’honneur de son prédécesseur. Fair playmais aussi solidarité entre ces navigateurs del’extrême ! Il entre dans la même baie le 25décembre 1776, nomme celle-ci ChristmasHarbour et baptise le monument Arched - Rock :nom qui lui est dénitivement resté, traduit en
français par Pointe de l’Arche. Le Havre de Noëlest l’objet de l’une des plus célèbres gravuresqui accompagnent le récit du troisième voyagede Cook, ainsi commentée : « L’endroit le plusremarquable, la pointe sud, est terminé par untrès haut rocher perforé, de sorte qu’il ressembleà l’arche d’un pont ».Fgue 2. Ce Mxmum, peme ju e ’émn
TAAF u 1e jnve 2001
Le dessin du timbre TAAF PA 47 est intéressantà observer et à comparer avec le précédent. Lasource est la même, à savoir la gravure du récitde Cook. Mais si dans l’illustration du timbre dutriptyque, Béquet avait pris quelques libertés, ilreste cette fois dèle au dessin originel.
Lors de son voyage de 1840 avec ses deux bateaux, l’Erebus et le Terror commandé parCrozier, J.C. Ross conrmera les observationsde ses prédécesseurs. : « La pointe de l’arche, de150 pieds de hauteur, est composée de basalte. Al’intérieur, on voit des fragments de bois siliciéinclus dans le basalte. » C’est cette expéditionque commémore le timbre des Terres Australe etAntarctiques Françaises émis en 1979 (réf YT PA59). Au format 48 x 36 mm, la vignette dessinéeet gravée par Pierre Béquet également nousmontre le navire le Terror face à l’arche, telleque Ross pu les voir depuis l’Erebus.
A la même époque, le monument entre dans lalittérature. Avec son roman: « Les Aventuresd’Arthur Gordon Pym » édité en 1838 EdgarAllan Poe en fait une description détaillée.Sans doute l’écrivain américain en avait-il euconnaissance par les récits des chasseurs baleiniers de Nouvelle-Angleterre, nombreux à se rendre aux
Fgue 3. Ce gégque e Îe Kegueen, pyquee TAAF YT139A
Fgue 4. Ce e Kegueen, Be e ’Oeu/Chm H, e e e ’Ache.
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
19/24Le lien philathélique n°116 19
Fgue 5. Le cheve e Kegueen e e Hâve e Në,pyque e TAAF YT222A
Fgue 6. Gvue u Réc e Jme Ck, 1776,me e TAAF YT PA 47
Fgue 7. me e TAAF YT PA 47
Fgue 8 : TAD Peme Ju u me Y P47,epéenn e nve e Ck evn ’Ache
Kerguelen dans cesannées là. N. Taylor, baleinier, américainé g a l e m e n t ,en laisse untémoignage direct paru en 1851 : « Au port Christmas, uneétroite bande deterre s’avance dansla mer, portant un
rocher où les lamesont creusé un passage lui donnant l’aspect d’unevoûte en ruine. C’est la Pointe de l’Arche maisles marins la nomment communément la Portedu Diable ».En 1874, c’est à la très célèbre expéditionscientique du Challenger d’aborder l’île. Sesrapports s’ouvrent sur une grande gravurereprésentant l’Arche vue du fond de la Baie del’Oiseau : comme si ce monument était le plusremarquable rencontré par ce navire pendant toutson voyage autour du globe. « Nettement coupéede la falaise se trouve une grande arche naturellede 150 pieds de hauteur : un grand phénomène
de la nature… », commentera Campbell, soncommandant, visiblement impressionné.
L’Archipel des Kerguelen devient français en1893. E. Mercié, Enseigne de vaisseau de l’Avisol’Eure est chargé de la cérémonie de prise de possession au nom de la République. Il décriraen détail « la fameuse Pointe de l’Arche …vuecomme… un magnique arc de triomphe quilaisse entrevoir le jour à travers son ouverture ».
Les frères Rallier du Baty le suivent en 1908 etseront témoins privilégiés. Après leur premièreexpédition Raymond précise : « l’entrée de la baie
a un mille de large avec … au sud un rocher de 150 pieds. La mer, sans relâche, y a creusé une archelarge de 100 pieds, par laquelle, d’un certainangle on aperçoit la côte, des falaises et des
rochers imposants s’étendantloin à l’horizon. ».Puis, surprise ! Et de taille !Lors de la deuxième expéditionRallier du Baty en 1913, onne peut que le constater : dansl’intervalle de quatre années, letoit de la fameuse arche s’esteondré. …Constat conrmé en 1931 par
Fgue 10. Ph e pe e pen e Kegueen en 1893(phgphe ncnnu).
le géologue français E. Aubert de la Rue et parudans son « Etude géologique et géographiquede l’Archipel des Kerguelen », ouvrage deréférence fruit de quatre campagnes menéesavec son épouse en 1928-29, 1931, 1949-50 et1952 : « Le recul des falaises et les eets del’érosion marine se traduisent par la présencede rochers aux formes singulières, tels l’Archeaujourd’hui eondrée et formant deux tours
comparables à celles de Notre-Dame à l’entréede la Baie de l’Oiseau. ». Ce sont ces deux toursque, sous le titre : « l’Arche des Kerguelen »,représente le timbre émis par les TAAF le Ier janvier 2001. Référencée par YT sous le n° 296,cette vignette postale dentelée 13 mesure 48 x 36mm. Remercions M. Jubert d’avoir, par la taille-douce, réussi à exprimer la monumentalité desvestiges de ce qui fut la plus extraordinaire desarches naturelles jamais observées sur la planète.Ce vestige exceptionnel a été retenu en 2011 pour
Fgue 9. Tme e TAAF, YT PA 59, 1979
Fgue 11. Tme e TAAF YT 296, 2001
une émission jumelée entre les TAAF et Saint pierre et Miquelon. Il s’agissait d’honorer lesdeux Territoires visités par le Forbin, escorteurde la Marine Nationale. Le dessin et la maquettesont dus au regretté Marc Tarasko.
Pour nir citons et remercions un derniertémoin : Jean-Paul Kaumann. Avec « l’Archedes Kerguelen », l’écrivain a livré en 1993une méditation littéraire et poétique qui acontribué à mieux faire connaître ces terresdésertes et désolées ainsi que l’arche, leur gureemblématique. D’autant que son livre a faitl’objet de plusieurs rééditions.
Fgue 12. Tme e TAAF YT 597, 2011
Fgue 13. cuveue u éc e J.P. Kumnn:Fmmn u equee e uée ’Ache eKegueen.
Bibliographie sommaire :
Ouvrages et conférences de Gracie Delepine Récits de Raymond Rallier du Baty
Ouvrages et rapports d’Edgar Aubert de la Rue
Jean-Paul Kaufmann, ouvrage précité
Notices de l’Administration Philatélique des T.A.A.F.
Cet article est également publié sur le site de Michel
Wagner http://www.timbresponts.fr .
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
20/24Mai 201620
Dans notre article publié en avril 2013 dans leLien n° 107, nous avons tenté de faire le pointsur l’évolution des timbres d’usage courant (dits« petites valeurs ») des TAAF.
Mais depuis ces temps, presque anciens, leschoses ont évolué. Nous en avions parlé enseptembre 2015 dans le Lien n°114 à l’occasiondes 20 ans du Marion Dufresne.
Résumons : En 2013, les TAAF ont émis une sériede timbres de quatre valeurs dites d’appoint entre1 et 4 centimes, que l’on retrouve sur le nouveaulogo des TAAF (fg. 1). Y sont représentés 4images symbolisant les TAAF (voir Lien n°107).
Cette première émission se caractérise parl’indication du millésime 2013 et la signatured’Eve Luquet qui a conçu cette série. Tirée à70 000 exemplaires, elle a connu un grand succèset ces timbres gravés (par ordinateur GAO) ontété rapidement épuisés (fg. 2).
De nouvelles émissions sont parues en 2014et 2015 avec des caractéristiques légèrementdiérentes. En 2014, le timbre est réalisé enoset, il comporte le millésime 2014, mais pas designature. Tirage : 100 000 exemplaires (Image3). Il accompagne l’émission du logo des IlesCrozet, timbre à forte faciale (7€) destinée auxenvois lourds et recommandés (fg. 3).
La troisième émission, mise en vente au Salon dela Porte Champerret en mars 2015, est réaliséeen oset/sérigraphie. Elle comporte le millésime2015 et la signature de Nelly Gravier qui a conçule logo des TAAF. Tirage : 150 000 exemplaires. (fg. 5).
TAAF : les petites valeurs font leur show !
g.1 g e TAAF-26x56 mquee énve 2013
g.2 2013 Zm ven énve
g.3 feue 2014 2ème émn
g.4 TP Lg Cze 2014
g.5 MD 3ème ém-n 2015 g 60 n
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
21/24Le lien philathélique n°116 21
Elle accompagne l’émission du logo des IlesSaint Paul et Amsterdam (fg. 6). Le logo du60ème anniversaire apparaît sur les marges desfeuilles.
Nous indiquions alors qu’il n’était pas excluqu’une nouvelle émission soit réalisée à terme.Le terme n’a pas été long, une nouvelle émission
apparaît en 2016 (fg. 7) accompagnant celle dulogo de Kerguelen (fg. 8).
Les 4 timbres sont regroupés dans une présentation originale de 2 feuilles comportantchacune deux timbres en paires: 0,01 + 0,04€ pour l’une et 0,02 + 0,03€ pour l’autre. (fg. 9, fg. 10 et fg. 11).
g.6 2015 g S Pu e 60 n e TAAF f
g.7 mquee e me eu vecé. Le ce n e uppmé n ’émn énve
g.8 TAAF Lg e Kegueen 1
g.8 TAAF-TP-LOGO KER-mpnVECTO
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
22/24Mai 201622
g.9 TAAF Feue 000 pee veu méme 2016
La signature de Nelly Gravier apparaît en basdes timbres et, sur les marges, le logo du 10 ème anniversaire de la Réserve Naturelle des TerresAustrales Françaises.
Ces nouveaux tirages ont été mis en vente lors duSalon Philatélique de Printemps à Belfort du 1 er au 3 avril 2016.
Décidemment les petites valeurs des TAAFcontinuent de faire parler d’elles !
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
23/24Le lien philathélique n°116 23
g.10 : feue e pee veuvec méme 2016 pu 2017
Dé méme 2016
Dé méme 2017
-
8/17/2019 Ecozone Nanterre
24/24
Fg. 11 : Emn énve
Dé