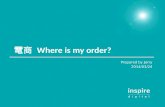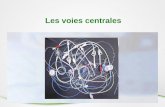COURS IFSI diabete IDE 2014 -...
Transcript of COURS IFSI diabete IDE 2014 -...
LES DIABETES
DEFINITION :
Hyperglycémie ( excès de sucre dans le sang) permanente
Pour rappel: la glycémie normale est de 0.8 g à 1,00 g/l à jeun et peut atteindre 1.40 g/l en post-prandial ( 2heures après début d ’un repas)
Selon la norme OMS le diabète est défini par:
-une glycémie à jeun contrôlée 2 fois > 7 mmol/L ou 1.26 g/L
-ou une glycémie à n ’importe quel moment de la journée supérieure à 2 g/l ou 11,1 mmol/l contrôlée
- ou une glycémie 2h après ingestion de 75 g de glucose per os supérieure à 2g ou 11,1 mmol/l
Définition de la glycosurie( glucose dans les urines)
Normalement PAS de glycosurie
Glycosurie apparaît à partir de 1.8 g de glycémie ( seuil rénal du glucose)
Ce seuil rénal augmente avec l ’âge
CLASSIFICATION DES DIABETES
Diabète de type 1:
en général auto-immun incluant diabète du sujet jeune et diabète auto-immun lent de l ’adulte (LADA) Recherche d ’anticorps anti-ilots de Langherans et/ou anti GAD et/ou anti IA2 en règle positive. Pas d ’hérédité mais terrain prédisposant
Diabète de type 2:
en général lié à la surcharge pondérale avec insulinorésistance avec surcharge pondérale et souvent syndrome métabolique
associéà une perte progressive des capacités sécrétoires des cellules béta du pancréas.
Hérédité et rôle de l ’environnement +++
Survenue en règle à la maturité
quelques cas de DT2 chez les jeunes ( de + en +) et quelques cas de DT2 sans surpoids
Les autres causes de diabète:
Les diabètes par anomalie génétique des cellules béta : diabètes MODY
Les maladies du pancréas
Les maladies des glandes endocrines:
syndrome de Cushing
acromégalie
phéochromocytome
hyperthyroidie
Médicaments (Corticoïdes)
Hémochromatose
Le diabète gestationnel
Epidémiologie
90 % des diabètes sont de type 2
- actuellement environ 3 millions en France + 500 000 qui sont ignorés ( rôle du dépistage +++)
prévision à 10 ans, autour de 4 millions
Rôle majeur de l ’environnement et du mode de vie
moins de 10 % sont de type 1
- soit environ 300 000 sujets
autres diabètes:
- peu fréquents
L ’équilibre glycémique
La glycémie est soumise à une régulation qui permet de maintenir une glycémie à jeun entre 0.8g et 1.1 g et une glycémie post-prandiale au dessous de 1,40g.
Cette régulation permet un équilibre entre les entrées et les sorties de glucose plasmatique
Les entrées sont:
1/ l ’alimentation : intermittente, en principe en France 3 repas/j
2/ La production hépatique de glucose: les glucides sont stockés dans le foie sous forme de glycogène. Le glucagond ’origine pancréatique est libéré tout au long de la journée dès que la glycémie baisse. Il entraine la glycogènolyse qui libère du glucose passant aussitôt dans le secteur plasmatique pour remonter la glycémie. Il s ’agit donc d ’une régulation qui intervient tout au long des 24 heures.
Les sorties:
utilisation du glucose principalement sur 3 sites
- les muscles: le glucose pénètre dans les muscles permettant notre énergie musculaire ( l ’activité physique est grande consommatrice de glucose)
- le tissu adipeux:le glucose est transformé en acides gras qui vont se fixer au niveau du tissu adipeux ( plus les apports alimentaires en sucres seront élevés , et moins il y aura d ’activité physique, plus la masse grasse augmentera
- le foie: une partie du glucose revient vers le foie où est à nouveau formé du glycogène ( glycogénogénèse)
Noter aussi que du glycogène hépatique peut être aussi produit à partir des graisses ( néoglycogènogénèse)
L ’utilisation du glucose par ces organes est soumise à l ’action de l ’insuline seule hormone hypoglycémiante de l ’organisme
Actions de l ’insuline
Hormone produite par les cellules Béta des ilots de Langherans du pancréas
Sa libération est directement liée à l ’élévation de la glycémie plasmatique
Elle agit sur des récepteurs à l ’insuline au niveau des organes cibles permettant l ’utilisation du glucose par ces organes: elle agit comme une clé ouvrant la porte au glucose lui permettant d ’entrer dans les cellules
(1) Vidal 2002.
Régulation de la glycémieHydrates de
carbone
Glucose
Insuline(I)
I
I
I
Adipocytes
Foie
Pancréas
Musclesquelettique
Enzymes digestives
)
Alimentation
Production
hépatique
de glucose
Le diabète de type 1
Présence d ’auto-anticorps( cause indéterminée )
entraine:
- mécanisme de « rejet » des ilots de Langherans avec inflammation ( insulite)
- chute rapide de la sécrétion d ’insuline: insulinopénie
- apparition rapide en quelques semaines de signes cardinaux
amaigrissement malgré polyphagie
polydipsie ( soif intense)
polyurie ( grande quantité d ’urines
Pas d ’héréditémais prédisposition génétique portée par les groupes HLA
Conséquences de la chute de la sécrétion d ’insuline:
- pas d ’utilisation du glucose par les muscles: - hyperglycémie , asthénie
- pas d ’apports d ’Acides. Gras au tissu adipeux et en plus mobilisationdes Acides gras du tissu adipeux avec
- perte de la masse grasse: amaigrissement
- transformation des Ac. Gras en glucose avec hyperglycémie et génération de corps cétoniques
En conséquence
- Hyperglycémie importante
- Cétose puis Acidocétose
Evolution possible versle coma acidocétosique
L ’acidocétoseRisque majeur du diabétique de type 1 insulinopénique
Peut survenir très rapidementdès qu ’il y a un manque d ’insuline
Chez un patient traité par l ’insuline , c ’est la recherche de sucre et d ’acétone dans les urines ( Kétodiaburtest) qui doit alerter ( à faire dès que la glycémie dépasse 2.5 g à 3 g) . Odeur acétonique de l ’haleine
Si le diabète est méconnu, installation rapide d ‘ une odeur acétonique de l ’haleine et des signes cardinaux .
- puis de troubles digestifs ( douleurs abdominales, vomissements conduisant à la déshydratationcar polyurie non compensée). Hypotension
- des signes d ’acidose avec dyspnéede Kussmaul
- des signes neurologiques avec somnolence diurne , insomnies nocturnes , troubles de vigilance puis coma
Biologie: hyperglycémie majeure, pH très bas, réserve alcaline effondrée dans les urines Glycosurie ++++ et cétonurie +++
Le diabète de type 2
Souvent méconnu,survenant insidieusement chez des patients de la « maturité », nécessitant un dépistage:
-dépistage de massegrâce aux campagnes de dépistage avec lecteurs de glycémie capillaire
-dépistage ciblédevant:
- antécédents familiaux
- prise de poids ( ou quelques fois perte de poids rapide)
- infections à répétition ( mycoses, infections urinaires, cutanées, dentaires…)
- soif… Somnolence post-prandiale etc..
Ce dépistage est capital car permet d ’équilibrer le diabète avant qu ’il ne donne des complications
80% des diabètes de type 2 surviennent sur des sujets en surpoids
- rôle certain de l ’hérédité
-rôle aussi important de l ’environnement: mauvaise nutrition, sédentarité
- beaucoup de ces diabétiques présentent ce qu ’on appelle aujourd ’hui un syndrome métabolique:( définition IDF 2005 )
obésité centraleTT>94cm hommesTT>80cm femmes
• plus 2 critères parmi
• TG>1,50g/l ou traitement spécifique
• HDL<0,40g/l ou<0,50g/l ou traitement spécifique
• TA>130/85 mm Hg ou traitement spécifique
• Glycémie à jeûn>1g/l ou diabète de type 2 connu
Les mécanismes d ’action3 éléments vont contribuer à créer un diabète de type 2:
1/ Insulinorésistance: action insuffisante de l ’insuline sur ses récepteurs : il faut plus d ’insuline pour faire baisser la glycémie donc hyperinsulinisme.
Cette insulinorésistance tient au terrain: surpoids, syndrome métabolique avec surcharge graisseuse des organes cibles ( muscle, T. adipeux et foie)
Elle est accentuée par l ’hyperglycémie ( la normalisation glycémique permet de la réduire)
2/ Augmentation de la production hépatique de glucose:surtout fin de nuit expliquant les glycémies élevées du réveil ( phénomène de l ’aube)
3/ Diminution progressive de la fonction Béta-insulaire avec diminution de l ’insulinosécrétion
C ’est lorsque l ’insulinosécrétion devient insuffisante qu ’apparaît le diabète
(1) Vidal 2002.
Mécanismes du diabète de type 2Hydrates de
carbone
Glucose
Insuline(I)
I
I
I
3. Diminution de l ’insulinosécrétion
Adipocytes
Foie
Pancréas
Muscle squelettique
Enzymes digestives
2.Augmentation de la production hépatique de
glucose1 .Insulinorésistance
)
Diminution de l’effet incrétine chez le diabétique de type 2
0
20
40
60
80
In
su
lin
e (
mU
/L)
0 30 60 90 120 150 180
Temps (min)
** *
** **
0
20
40
60
80
0 30 60 90 120 150 180
Temps (min)
**
*
Nauck MA, et al. Reduced incretin effect in type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia 1986; 29: 46-52. Nielsen MB, et al. Determinants of the impaired secretion of glucagon-like peptide 1 in type 2 diabetic patients. J Clin Endocrinol Metab, 2001; 86:3717-23.
In
su
lin
e (
mU
/L)
Diabète de Type 2Témoins
Glucose Intraveineux
Glucose Oral
* Chez la plupart des patients diabétiques de type 2, l’effet incrétine est réduit ou annulé et entraîne un déséquilibre global du métabolisme glucidique. P≤ 0,05 vs la valeur équivalente après une prise orale
Les hormones de l’effet incrétine
• Le GIP et le GLP-1 jouent tous les deux un rôle dans l’homéostasie glucidique après une prise alimentaire (effet incrétine)
• L’effet incrétine est diminué chez les patients diabétiques de type 2, pourquoi ?– La sécrétion de GIP est normale, mais son action est
diminuée
– La sécrétion de GLP-1 est diminuée, mais son action est préservée
Métabolisme du GLP-1 et GIP
Cellule KCellule L
ProGIP
GIP [1-42]
Proglucagon
GLP-1 [7-37]
GLP-1 [7-36NH2]GLP-1[7-36]Actif
GLP-1[9-36]Inactif
DPP-4
Capillaire
GIP [1-42]Actif
GIP [3-42]Inactif
DPP-4
Capillaire
Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)
1. Clive en N-terminal les dipeptides
2. Inactivation du GLP-1 et GIP en ~ min
Cellules bêta du pancréas :
Stimule de façon glucodépendante la sécrétion d’insuline
Cellules alpha du pancréas :Réduit la sécrétion postprandiale de glucagon
Estomac :Ralentit la vidange gastrique
Cerveau :Stimule la satiété et réduit la prise alimentaire
Foie :Réduit la production hépatique de glucose
[1]Adapté de
[1]
[4]
[2]
[2]
[3]
Sécrétion de GLP-1 lors de la prise alimentaire
Le rôle glucorégulateur du GLP-1 chez l’homme
Sécrétion deGLP-1 et GIP
Activités du GLP-1 et du GIP
GIP (1–42)GLP-1 (7–36)Actives
GIP (3–42)GLP-1 (9–36)
Inactives
Dégradation Rapide(minutes)
Repas
DPP-4enzyme
Inhibition de la DPP-4
L’inhibition de la DPP-4 augmente les niveaux de GLP-1 et GIP biologiquement actifs
LEBOVITZ HE. Insulin secretagogues : old and new. Diabetes Reviews 1999 ; 7 : 139- 153 (Adapté de l’UKPDS 16)
Le diabète de type 2Une maladie évolutive, liée à une diminution progressive
de l’insulinosécrétion
Qu ’il s ’agisse d ’un diabète de type 1 ou 2 ou de toutes causes de diabète, il n ’y a pas de petit diabète
le diabète doit être EQUILIBRE pour réduire et si possible supprimer les risques des COMPLICATIONS à long terme qui font toute la gravité de la maladie
Complications microvasculaires: œil, rein, nerfs
Complications macrovasculaires: Ischémie myocardique, AVC, Artériopathie
L ’équilibre du diabète est jugé sur les résultats des glycémies mais surtout sur l’HbA1c ( Hémoglobine Glyquée) qui devrait être le plus proche possible ou même inférieure à 6,5%
L ’HbA1C représente la « glycosylation de l ’hémoglobine et dépend de la moyenne glycémique des 3 mois passés
La prise en charge du diabète de type 2 doit :
� Être précoce.
� Être globale.
� Viser à normaliser la glycémie et à corriger l’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire amendables (contrôle tensionnel strict, contrôle des anomalies lipidiques et arrêt du tabac).
� Être adaptée à chaque patient en étant modulée selon l’age physiologique, les comorbidités, la sévérité et l’ancienneté du diabète.
� S’appuyer sur la participation active du patient*.
� Et faire appel à la complémentarité des différents professionnels de santé.
* Mesures d’hygiène de vie, arrêt du tabac, exercice physique, prise en charge pondérale, observance médicamenteuse.
Comment traiter ?
Prise en charge non médicamenteuse• Diététique et hygiène de vie
La lutte active contre la sédentarité ainsi que la planification alimentaire représentent des interventions irremplaçables à toutes les étapes de la prise en charge du diabète de type 2
– Objectif de prise en charge diététique = correction des principales erreurs alimentaires qualitatives :• Réduction des lipides surtout saturés� les effets bénéfiques sur les glycémies peuvent être
jugés en quelques jours.• Réduction des sucres simples et de la consommation d’alcool.
– Mise en place d’un régime modérément hypocalorique nécessaire. Un amaigrissement même limité (-5% du poids corporel) apporte un bénéfice glycémique très significatif.
– Activité physique � 3 h par semaine d’activité plus intensive adaptée au profil du patient.
– Arrêt du tabac.
• Éducation thérapeutique– Volet fondamental de la prise en charge.– Doit être mise en œuvre dès la découverte du diabète par des professionnels médecins ou
paramédicaux formés à cette activité.
Médicaments utilisés dans le traitement du diabète de type 2
Traitement oral :
• Biguanides
• Sulfamides
• Glinides
• Glitazone (retirées du marché)
• Inhibiteurs de l’alpha-glucosidase
• Inhibiteurs de la DPP IV
Traitement injectable : agonistes du GLP1
• Exenatide
• Liraglutide
Tableau des Médicaments anti diabétiques
Classe Principe Actif Spécialités Dosage Dose/j Nb prises/j Mode Action Effet sur poids Biguanides Metformine Glucophage®
Stagid®
Cp à 500 mg Cp à 850 mg Cp à 1000 mg Cp à 700 mg
500 à 3000 mg/j
1 à 3/j Milieu du repas
Diminue insulinorésistance Diminue production hépatique de glucose
diminution
Glitazones Pioglitazone
Actos®
Cp à 15 mg Cp à 30 mg
15 à 45 mg/j
1
Diminue insulinorésistance foie, muscle, tissu adipeux
augmentation
Inhibiteurs alpha glucosidases Acarabose
Miglitol
Glucor® Diastabol®
Cp à 50 mg Cp à 100 mg Cp à 50 mg Cp à 100 mg
150 à 600 mg/j
150 à 300 mg/j
3 à la 1ère bouchée 3
Diminue absorption intestinale de glucose
Sulfamides Glibenclamide
Gliclazide
Glimépiride
Daonil® Hémi-daonil® Daonil faible® Diamicron LM 60® Amarel®
Cp à 5 mg Cp à 2,5 mg Cp à 1,25 mg Cp à 60 mg Cp à 1,2,3,4 mg
1,25 à 15 mg/j
30 à 120 mg/j
1 à 6 mg/j
2 à 3 1 1
Stimule sécrétion insuline
augmentation risque d’hypoglycémie
Glinides Répaglinides Novonorm® Cp à 0,5 Cp à 1 mg Cp à 2 mg
0,5 à 16 mg/j
2 à 3 10 minutes avant repas
Stimule sécrétion insuline
risque d’hypoglycémie
Inhibiteurs DPP4 Sitagliptine
Vildagliptine
Saxagliptine
Januvia® Xélévia ® Galvus® Onglyza®
Cp à 100 mg Cp à 100 mg Cp à 50 mg Cp à 5mg
100 mg/j
100 mg/j
5 mg/j
1 2 sf + SU 1
Inhibe enzyme qui dégrade GLP1 Augmente concentration de GLP1
neutre
Agonistes du GLP1 Exénatide
Liraglutide
Byetta® Victoza®
Stylo 0,5µg Stylo 0,10µg Stylo Pen
5 µg 2 fois /j SC pdt 1 mois puis 10 µg 2/j
0,6 mg/j SC 1 semaine, 1,2 mg/j SC 1 semaine,
1,8 mg/j
2 injections SC/j 15 minutes avant repas matin et soir 1 injection SC/j indépendamment repas
Agonistes GLP1 : Stimule sécrétion insuline Diminution production hépatique de glucose Ralentissement vidange gastrique satiété
diminution
Biguanides(Metformine)
• STAGID
• GLUCOPHAGE 500
• GLUCOPHAGE 850
• GLUCOPHAGE 1000
• Mode d’action:
– Réduit l’insulinorésistance
– Diminue la production hépatique de Glucose
Les Biguanides
- agissent essentiellement en réduisant la production hépatique de glucose et diminuent l ’insulinorésistance
- ils ne sont pas insulinosécréteurset donc pas hypoglycémiants par eux mêmes
- ils sont à élimination rénale et donc utilisés en fonction de la clairance de créatinine
- ils sont à utiliser en 1ère intention
Biguanides(Metformine)
• À prendre en milieu de repas• Effets secondaires digestifs (diarrhée +++)• CI : hypersensibilité
- Diabète acidocétosique- clairance<30 mL/min, entre 30 et 60 ml/min, ne pas dépasser 1500 mg/j- Affections aigües susceptibles d’altérer la fonction rénale telles que :
déshydratation, infection grave, choc, administration intraveineuse de produits de contrastes iodés.
- Maladies aiguës ou chroniques pouvant entraîner une hypoxie tissulaire- Insuffisance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme- Allaitement
Les sulfamides hypoglycémiants
• DIAMICRON LM 60
• DAONIL 5, hémidaonil, daonil faible
• AMAREL 1 à 4 mg …
Les Sulfamides hypoglycémiants
- Ce sont des insulinosécréteurs
- ils agissent indépendamment de la charge glucosée
- leur action hypoglycémiante peut se prolonger bien au delà des repas: hypoglycémies de fin d ’AM ou de nuit
- ils sont efficaces dès que l ’insulinosécrétion commence à diminuer
- ils sont à élimination rénale et donc dépendants de la fonction rénale. Plus la fonction rénale est altérée plus les sulfamides utilisés doivent avoir une demi-vie courte
- Leur risque principal est celui d ’hypoglycémies sévères
Les sulfamides hypoglycémiants
• CI:
- hypersensibilité
- insuffisance rénale ou hépatique sévère
- diabète type I, acidocétose
- coma diabétique
Sujet âgé : attention aux hypoglycémies+++
Les inhibiteurs de l ’alpha glucosidase
- mode d ’action: l ’Acarbose bloque les sites récepteurs de l ’alpha-glucosidase au niveau de la paroi intestinale
d ’où diminution de l ’absorption du glucosealimentaire et diminution du pic hyperglycémique
- intérêt:diminution de la glycémie post-prandiale
- mode d ’emploi: doit être pris avec la 1ère bouchée à chacun des 3 repas
- efficacité: limitée car pas d ’action sur la production hépatique de glucose, pas d ’effet direct sur l ’insulinosécrétion et la résistance à l ’insuline
- tolérance et contre-indications: pas de C.I , mais flatulences
Glinides
Mode d ’action
- famille des insulinosécréteurs
- site de fixation membranaire spécifique( différent des S.H) sur les cellules béta des ilôts de Langhérans
- l ’action insulinosécrétrice passe exclusivement par ce site
- absorption rapide et demi-vie brève: concentration plasmatique maximale en 1h , élimination en 4 à 6 h
- l ’administration avant chaque repas provoque stimule la sécrétion d ’insuline au moment nécessaire
Glinides
Intérêt: diminuer la glycémie post-prandiale
Mode d ’emploi:
- doit être administré dans les 10 mn qui précèdent le repas.
- chaque prise doit être suivie d ’un repas : « un repas-une prise »
- dosages de 0.5 mg à 2 mg par comprimé: maximum 4 mg par repas soit 12 mg par jour
- le risque hypoglycémique est faible si le patient respecte l ’ajustement des prises aux repas
Glinides
Efficacité: celle des autres insulinosécréteurs
- Peuvent être associé aux Biguanides
- Ne doivent pas être associés aux Sulfamides
Elimination: 92% biliaire , 8% rénale
- le Novonorm peut être prescrit dans l ’insuffisance rénale légère à modérée
- il est contre-indiqué si altération sévère de la fonction hépatique
Tolérance:risques d ’hypoglycémie, troubles passagers de la vision, réactions cutanées, élévation des enzymes hépatiques
Comment utiliser les propriétés du GLP-1 en thérapeutique ?
• Médicaments qui prolongent l’activité du GLP-1 endogène
– Inhibiteurs de la DPP-IV (ou gliptines)• Sitagliptine : Januvia ( MSD) / Xelevia ( Fabre)
• Vildagliptine : Galvus ( Novartis)
• Saxagliptine : Onglyza (BMS/AstraZeneca)
• Médicaments qui reproduisent l’action du GLP-1
– Incrétino- mimétiques ou analogues du GLP-1• Exenatide: Byetta ( Lilly)
• Liraglutide : Victoza ( Novo Nordisk)
Sécrétion deGLP-1 et GIP
Activités du GLP-1 et du GIP
GIP (1–42)GLP-1 (7–36)Actives
GIP (3–42)GLP-1 (9–36)
Inactives
Dégradation Rapide(minutes)
Repas
DPP-4enzyme
Inhibition de la DPP-4
L’inhibition de la DPP-4 augmente les niveaux de GLP-1 et GIP biologiquement actifs
Les inhibiteurs de la DPP 4
Utilisables par voie orale:- Sitagliptine 100 mg ( Januvia , Xelevia) 1/jour- Vildagliptine 50 mg ( Galvus) 2/j- Saxagliptine 5 mg ( Onglyza) 1/j
- Et les associations avec la metformine :JANUMET : Metformine 1000 + Januvia 50 : 2 cp/jVELMETIA : Metformine 1000 + Xelevia 50 : 2cp/j
EUCREAS :Metformine 1000 + Galvus : 2/j
KOMBOGLYZE : Metformine 1000 + Onglyza 2,5 : cp/j
La place des inhibiteurs de la DPP 4 dans le traitement du diabète de type 2 par voie orale
LES INHIBITEURS DE LA DPP 4 ont un certain nombre d ’avantages potentiels par rapport aux autres ADO:
-pas d ’hypoglycémie
-pas de prise de poids
-préservation des cellules Béta
-bonne action sur la glycémie post-prandiale
-peu d’effets secondaires
-prise orale
BYETTA : 1er analogue du GLP-1
• Exénatide (Exendine-4)
– Version synthétique d’une protéine issue de la salive d’un lézard (Gila monster)
– Approximativement 50 % de similitude avec le GLP-1 humain
• Se lie aux récepteurs humains du GLP-1 identifiés sur les cellules β in vitro
• Résistant à l’inactivation par la DPP-IV
Adapté de Nielsen LL et al. Regulatory Peptides. 2004,117:77-88 avec la permission d’ElsevierDrucker DJ. Diabetes Care. 2003,26:2929-2940Ahrén B. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2007,21:517-533
Administration de BYETTA®• Stylo pré-rempli: 60 doses pour 30 jours de traitement
• 2 dosages : 5µg et 10µg
• 2 injections / jour
• Prudence lors de l’utilisation et de l’augmentation de dose de BYETTA chez les patients âgés de plus de 70 ans ou atteints d’insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine: 30 à 50 ml/mn).
Temps (semaines)
% In
cide
nce
des
naus
ées
>12-16 >24-28
100
0-4 >16-20 >20-24 >28 >4-8 >8-12 0
10
30
40
60
90exénatide 10µg 2/j (n=241)exénatide 5µg 2/j (n=245)Placebo (n=247)
20
50
70
80
Résultats ITT à 30 semaines ; n = 733Kendall DM, et al. Diabetes Care. 2005;28:1083-1091 ; (1) RCP
Selon le RCP : • La plupart des épisodes de nausées étaient d’intensité légère à modérée et étaient doses-dépendants (1)• Chez la plupart des patients ayant présenté des nausées lors de l’initiation du traitement, la fréquence et la sévérité des nausées ont diminué avec la poursuite du traitement (1)
Tolérance : Incidence des nausées exénatide vs placebo dans l’étude Kendall (115)
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Exénatide ne doit pas être utilisé:
• diabète de type 1 ou acidocétose diabétique
• patients diabétiques de type 2 nécessitant une insulinothérapie, en raison du non fonctionnement de leurs cellules bêta
• femme enceinte ou qui allaite
• enfants et adolescents de moins de 18 ans (absence de données)
• injection IV ou IM
Pour une information complète se référer au RP de BYETTA
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Exénatide n’est pas recommandé:
• En cas d’insuffisance rénale terminale ou sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).
• En cas de maladie gastro-intestinale sévère, incluant la gastroparésie (expérience limitée et risque accru de troubles digestifs).
• En association avec l’insuline ou les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase (absence de données).
Pour une information complète se référer au RCP de BYETTA
Victoza
• Liraglutide
• 97 % d’homologie avec le GLP1 humain• Auto aggrégation des molécules de liraglutide• Liaison non covalente à l’albumine • Stabilité accrue vis à vis de l’enzyme DPP-IV • Résorption lente après injection
• Demi-vie prolongée (T½ = 13 h)
• 1 injection par jour
Efficacité
Décem
bre
09 –
V016
•Réduction du taux d’HbA1c
• faible risque d’hypoglycémies mineures*•Perte de poids•Diminution de la pression artérielle systolique•Amélioration de la fonction bêta cellulaire
* Les hypoglycémies étaient fréquentes, voire très fréquentes lorsque Victoza® était associé à un sulfamide hypoglycémiant(1).
(1) RCP Victoza®.
Victoza®
• 1 injection SC par jour
• A n’importe quel moment de la journée•Toutefois, il est préférable d’effectuer les injections à peu près au même moment de la journée après avoir choisi l’heure la plus adaptée.
• Dose fixe
• Aucune autosurveillance glycémique n’est nécessaire pour ajuster la dose de Victoza®
•Sauf en cas d’association à un sulfamide hypoglycémiant pour adapter la dose de celui-ci et limiter le risque d’hypoglycémie.
RCP Victoza®.
Posologie
RCP Victoza®.
Le stylo Victoza® contient 18 mg de liraglutide.
Un stylo unique quel que soit le dosage
* En fonction de la réponse clinique, après au moins une semaine de traitement, certains patients pourront être amenés à bénéficier d’uneaugmentation de la dose de 1,2 mg à 1,8 mg afin d’obtenir un meilleur contrôle glycémique.
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
Le Liraglutide ne doit pas être utilisé en cas de :
• diabète de type 1 ou acidocétose diabétique
• injection IV ou IM
• insuffisance rénale modérée
• insuffisance hépatique
• insuffisance cardiaque (classe III-IV NYHA)
• maladie gastro-intestinale sévère, incluant la gastroparésie femme enceinte ou qui allaite
• enfants et adolescents de moins de 18 ans (absence de données)
Tolérance générale
• Dans les 5 études du programme de développement clinique, plus de 2 500 patients ont été traités par Victoza®.• Les effets indésirables les plus fréquemment observés pendant ces études cliniques étaient les affections gastro-intestinales. Ces effets indésirables gastro-intestinaux peuvent survenir plus fréquemment en début de traitement par Victoza®. Ces réactions s’atténuent généralement en quelques jours ou quelques semaines avec la poursuite du traitement.
• Les céphalées et les rhinopharyngites étaient fréquentes également.
• Les hypoglycémies étaient fréquentes, voire très fréquentes lorsque Victoza® était associé à un sulfamide hypoglycémiant.
RCP Victoza®.
Objectif de la recommandation
Amélioration de la qualité de la prise en charge des patients adultes atteints d’un diabète de type 2.
Cette recommandation vise à définir :
• des objectifs glycémiques cibles
• une stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique
• la place de l’autosurveillance glycémique
Cinétique des principales insulines
20 à 30 min 4 à 6 heures 1 heure 12 à 18 heures
3 à 4 heures 1 heure 20 à 24 heures
15 à 30 min 12 à 18 heures
Intermédiaires (NPH)(Umuline NPH°, Insulatard°, Insuman
basale°)
Rapides Mélanges ou prémix(Humalog Mix 25°, Humalog Mix 50°, NovoMix 30°, NovoMix 50°,
Novomix 70°)
Analogues rapides(Humalog°, NovoRapid°,
Apidra°)
Analogues lents(Lantus°, Levemir°)
Les différentes insulines• LES ANALOGUES
– Modification de la structure de l ’insuline afin d ’en augmenter la résorption (rapide) ou la retarder (lente)
– Les insulines rapides contrôlent mal l ’excursion glycémique après le repas ; le maximum d ’action est retardé (3 h), entraînant des risques d ’hypoglycémie d ’où l ’intérêt des analogues rapides
Les analogues• LES ANALOGUES RAPIDES
– Début action : 10’
– Maximum d ’action : 1h30
– Durée action : 3 h
• HUMALOG (LILLY)
• NOVORAPID (NOVO)
• APIDRA (SANOFI)3 à 4 heures
Les analogues
• LES ANALOGUES LENTS
– Début action : 1h30
– Durée action :
• LANTUS (AVENTIS) : 24 h
• LEVEMIR (NOVO) : 18 à 24 h
Les Mélanges• MELANGE= PREMIX (le chiffre représente le
pourcentage d’insuline rapide du mélange)
– Début action : 10’
– Durée action : 8h - 12h
• HUMALOG MIX 25 (LILLY)
• HUMALOG MIX 50 (LILLY)
• NOVOMIX 30 (NOVO)
• NOVOMIX 50 (NOVO)
• NOVOMIX 70 (NOVO) 15 à 30 mn 12 à 14 heures
Mélange
Objectif du traitement : reproduire la sécrétion physiologique de l’insuline
Des pics de sécrétion en réponse aux apports glucidiques de
l’alimentation.
D’après Ciofetta M. et al., DIabetes Care 1999 ; 22(5) :795-800
160
0
320
480
Insu
line
(pm
ol/l)
07:00 12:00 18:00 24:00 06:00 hrs
RepasRepasRepas
Une sécrétion de base d’insuline sur les 24 heures.
50% des besoins en insuline
93
100
80
60
40
20
0- 12 - 10 - 8 - 6 - 2 0 2 6 10 14
Années
Intolérance
au
glucose
Intolérance
au
glucose
Glycémie
à jeun
élevée
Glycémie
à jeun
élevée
Fonctionnalité des cellules β (%)
Diagnostic
Passage à l’insuline nécessaire
Le diabète de type 2 est une maladie évolutive du fait de la baisse progressive de la sécrétion d’insuline
D’après l’UKPDS 16. Overview of 6 years’ therapy of type 2 diabetes: a progressive disease. Diabetes, 1995; 44: 1249-58
Outils pour injecter l'insuline
• La seringue
• Le stylo
• La pompe
La différence est qu'il s'agit d'une injection en continue de petites quantités d'Insuline rapide (NOVORAPID, HUMALOG, APIDRA)
RAPPEL
50% de glucose sanguin provient de l'alimentation (glucides)
50% de glucose sanguin provient de la glycogénèse (réserve)
pour les non diabétiques : sécrétion continue d'insuline (glycogénèse) + flash d'insuline (glucides)
pour les diabétiques : insuline lente →glycogénèse
insuline rapide → repas (= bolus)
L'UTILISATION DES POMPES
►en ambulatoire : le patient gère sa pompe
►en hospitalisation pour désucrage : le patient ne gère pas la pompe
EN AMBULATOIRE
• Avantages :
• Diabète plus stable
• Qualité de vie améliorée
• Possibilités de réagir immédiatement en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie
• Inconvénients :
• 4 à 6 glycémies capillaires par jour
• Réagir rapidement si hyperglycémie –risque d'acidocétose (type I)
• Pompe visible (malade 24h/24)
INDICATIONS
• Diabète de type I
• Demandeur (lassitude des injections)
• Avec son accord (+/-selon le centre) dans le cas de : - diabète instable, -préparation grossesse - grossesse non préparée + diabète mal équilibré -complications
• Diabète de type II
• Demandeur
• Parfois en préparation d'une grossesse
Dans les deux cas, il faut :
* l'adhésion du patient (+/- selon le centre)
* un patient contrôlant ses glycémies
* un patient psychologiquement stable
EN HOSPITALISATION POUR DESUCRAGE
Destiné aux diabétiques de type II présentant soit des hyperglycémies, soit des besoins importants en dose
d'insuline entrainant une insulino-resistance.
La pompe est alors gérée par l'infirmière.
Les doses d'insuline sont beaucoup plus élevées que dans le diabète de type I
les doses d'insuline sont diminuées progressivement sur une semaine à dix jours.
A l'arrêt de la pompe, la dose d'insuline est plus basse et les glycémies nettement améliorées
Le bénéfice de ce traitement est de quelques mois, voire quelques années.
Il est à renouveler en cas :
- d'insulino-resistance importante
- de non observance
- de surcharge pondérale
Les complications du diabète
Complications à court terme
- les hypoglycémies
- le coma hyperosmolaire et par acidose lactique
- le coma acidocétosique
- les infections
Complications à long terme dites dégénératives
- microangiopathie ( œil, rein, nerf )
- macroangiopathie( cœur , cerveau, membres)
DEFINITION
glycémie égale ou inférieure à 0,60g/l avec ou sans signes ressentis à adapter selon l’âge
Manifestations:
Le plus souvent simple sensation de malaise ( pâleur, sueurs, faim, asthénie, équivalents d ’un malaise vagal)
Manifestations neurologiquessurvenant surtout si glycémie au dessous de 0.40 g ( hypoglycorachie)
- lenteur d ’idéation
-troubles de mémoire
-agressivité
-torpeur
-convulsions
-parésies
-troubles visuels avec diplopie
-coma hypoglycémique agité++
CONDUITE A TENIR
1) arrêter l’activité
2) si possible contrôler la glycémie
3) si hypoglycémie confirmée par glycémie capillaire ou signe d’hypo : Se resucrer
PROTOCOLE DE RESUCRAGE
- Si peu d’activité : (hôpital, petite activité à la maison ou au
travail)
Sucre simple ou rapide : 15g de glucides suffisent, soit :
� 3 m de sucre (adulte)� 3 c à soupe de sirop de fruit avec eau� 1 compote� 1 verre de jus de fruit� 15 cl de soda (coca….) petite canette� 1 pâte de fruit …..� 1 c à soupe de confiture ou miel� 3 grosses fraises tagada (mou)
- Si activité plus soutenue : (jardinage, marche rapide, gros ménage, activité physique dans lecadre du travail, activité intellectuelle importante…)
Même quantité de glucides mais en sucre rapide et sucre lent :
� 1 à 2 sucres et 2 gâteaux secs� 1 c à café de confiture+ 30g de pain
avec corps gras (fromage, saucisson, beurre…)
CONSEILS
• TOUJOURS AVOIR DANS LA POCHE DE QUOI SE
RESUCRER QUAND ON QUITTE LA MAISON :
Aliments faciles à transporter et qui sont à la fois rapide et lent, soit :
� 1 barre de céréales aux fruits
� 1 tranche de pain d’épice
� 1 compote et 1 gâteau
� 1 gâteau avec confiture à l’intérieur….
TOUJOURS AVOIR 2 RESUCRAGES A SA DISPOSITION
ATTENTION
• NE PAS SE RESUCRER AVEC CHOCOLAT OU VIENNOISERIELes lipides empêchent une action rapide des glucides
• NI AVEC ALIMENTS DIFFICILES A DEGLUTIR : fruit, bombons durs (risque de fausse route)
• Attendre 15 minutes environ pour que les signes d’hypo disparaissent
• Contrôler si possible la glycémie, 30 mm environ après resucrage, si la glycémie ne remonte pas 2ème resucrage possible
• Un resucrage bien dosé, doit faire remonter la glycémie de 0,50g/l environ dans la demi heure qui suit
Si la glycémie remonte de 1,50 à 2g/l à distance : le resucrage a été trop important
PUIS RECHERCHER LA CAUSE DE L HYPO (1)
1) ALIMENTAIRE
• absence de féculent et/ou pain
pas assez de féculent et/ou pain
� absence du fruit habituellement consommé = moins 20 g de glucides
� repas sauté ( avec mélange d’insuline ou sulfamides hypoglycémiants)
� l’alcool à jeun, sur un estomac vide :
� A l’apéritif : manger des féculents : gâteaux apéro avant l’alcool et ne faire l’injection d’insuline ou ne prendre les comprimés
RECHERCHER LA CAUSE DE L HYPO (2)
2 ) ACTIVITE PHYSIQUE PLUS INTENSE QUE D’HABITUDE :
�APRES REPAS
- Si mélange d’insuline, sulfamides hypoglycémiants (amarel, diamicron, daonil ) manger plus de féculents au repas
- Si insuline rapide au repas (shéma basale – bolus) faire moins de rapide au repas
� LOIN DU REPAS
faire une glycémie , selon le résultat manger une petite collation : 3 0 g de pain beurré ou 2 gâteaux …
RECHERCHER LA CAUSE DE L HYPO (3)
3) La présence de LIPODYSTROPHIES
4) SI NI CAUSE ALIMENTAIRE NI D’ACTIVITE PHYSIQUE NON COMPENSEE, NI LIPODYSTROPHIES :
C’EST LE TRAITEMENT QUI EST EN CAUSE :
• Baisser l’insuline responsable de l’hypo
• Si traitement oral, voir médecin
CHEZ LES DIABETIQUES DE TYPE 1 UNIQUEMENT :
TYPE 1 OU TYPE 2 EN INSULINOPENIE ( prescription médicale)
Dans ce cas : EDUQUER LA FAMILLE A L INJECTION DE GLUCAGEN
LE GLUCAGEN
• Injection IM de préférence dans la cuisse ou le bras
• A administrer en cas de troubles de conscience
• Conservation température ambiante 18 mois après date d’achat ou réfrigérateur date de péremption
• Effet dans les 10 minutes suivant l’injection
• Suivi d’un resucrage PO au réveil
• Chercher la cause de l’hypoglycémie +++
EVALUER OU EDUQUER LE PATIENT AUX HYPOGLYCEMIE LORS DE SON HOSPITALISATION
• Les signes
• Arrêt de l’activité physique
• Contrôler la glycémie
• Resucrage adapté
• Rechercher la cause +++
• Sensibiliser les patients en leur fournissant de quoi se resucrer lorsqu’ils quittent le service
• Port d’une carte diabétique sous insuline
Les autres comasAcidocétose et Coma acidocétosique:en rapport avec la carence en insuline des diabètes de type 1,rares chez les type 2 : perte de poids … chez un sujet habituellement en surpoidsTraitement en milieu de réanimation ou surveillance continue:
-réhydratation massive si grosse déshydratation, éventuellement bicarbonates
-insuline rapide à la SAP IV pendant plusieurs heures avec surveillance horaire des glycémie et de la cétonurie. Surveillance de la kaliémie
Coma hyperosmolaire: sujet âgé , forte hyperglycémie sans cétose. Risque majeur ( ischémie+++) . Réhydratation et insuline à la SAP ( prudente)
Coma par acidose lactique: très rare, lié une mauvaise utilisation de la metformine ( Glucophage, Stagid) en particulier explorations radiologiques avec opacification, situations d ’ischémie aigue, insuffisance rénale
Infections et cicatrisation
Infections buccodentaires: abcès, gingivites etc… ( dentiste +)
Infections urinaires
Infections cutanées:
mycoses ++
furoncles,panaris
infection des plaies +++
Immunodépression: infections virales ( prévention de la grippe). Rhumes, bronchites
Cicatrisation difficile
Atteintes ophtalmologiques
Rétinopathie diabétique
1 diabétique sur 2 à 10ans
Latence clinique: Fond d ’œil annuel ( et angiographie selon avis de l ’ophtalmologiste )
Effet bénéfique préventif et curatif de la normalisation glycémique
Les stades
1/Rétinopathie non proliférante (stade initial)
Microanévrysmes , Hémorragies, dilatations artérielles, microzônes d ’occlusion ( AMIR : anomalies microvasculaires intrarétiniennes)
2/ Rétinopathie oedèmateuse
les AMIR ( stade 1 )
présence d ’exsudats lipidiques
épaississement de la rétine
3/ Rétinopathie ischémique préproliférante
sur angiographie: multiplication des zônes de non perfusion + AMIR+ exsudats
nécessité de laser pour éviter la néovascularisation
4/ Œdème maculaire cystoide
touche la macule donc risque de cécité car altération des cellules rétiniennes
5/ Rétinopathie ischémique proliférative
apparition de néovaisseaux ; risque d ’hémorragie du vitré, de glaucome néovasculaire et décollement de rétine. Panphotocoagulation laser +++ ( destruction des zones rétiniennes ischémiques pour empêcher les néovaisseaux)
NEPHROPATHIE DIABETIQUE
Souvent parallèle à la rétinopathie
Epaississement de la membrane basale du glomérule rénal entrainant d ’abord une MICROALBUMINURIE puis une importante protéinurie
La microalbumine doit être recherchée au moins une fois par an sur les urines des 24 heures:
- normale moins de 30 mg/24h
- peut témoigner du début de la N.D et dans le type 2 est souvent corrélée au risque cardiovasculaire et l ’HTA
La découverte d ’une microalbuminurie impose:
- un équilibre strict du diabète
- un équilibre tensionnel rigoureux TA au dessous de 13/8
- une néphroprotection par les Inhibiteurs d ’Enzyme de Conversion ou par les Sartans qui sont aussi antihypertenseurs et utilisés en priorité.
- Si la néphropathie évolue elle va conduire à l ’insuffisance rénale par glomérulopathie avec élévation de la créatinine et risque d ’évolution vers l ’IRC et la dialyse
Neuropathie diabétique
La Neuropathie périphérique:
- Touche d ’abord les membres inférieurs: polynévrite symétrique souvent latente et devant être systématiquement recherchée par le diaposon et le monofilament au moins 1 fois/an .
Peut s ’exprimer par
paresthésies des pieds et des jambes
perte de sensibilité +++
gêne à la marche
troubles trophiques: mal perforant plantaire, pied de charcot
Le mal perforant survient sur les zônes d ’appui souvent sous une hyperkératose ( pédicurie++, semelles de décharge)
Les risques de PLAIES, d ’INFECTION sont alors majeurs avec risque d ’OSTEITE du pied souvent aggravée par des troubles circulatoires d ’artériopathie oblitérante distale .
Le pied diabétique doit être prévenuet faire l ’objet d ’une éducationprécoce ( ongles, hygiène des pieds , traiter toute infection ou mycose, bien se chausser, éviter de marcher pieds nus etc…)
Autres atteintes neurologiques:
- Atteinte du système nerveux autonome:
- troubles de régulation tensionnelle ( hypotension orthostatique)
- neuropathie autonome cardiaque
- troubles digestifs: hypokinésie gastrique, diarrhées
- troubles de vidange vésicale
- troubles sexuels : insuffisance érectile
- Cruralgies, paralysies des nerfs crâniens etc..
ISCHEMIE MYOCARDIQUE
Elle est souvent SILENCIEUSE
Elle peut entrainer angine de poitrine et infarctus ( 4 fois plus fréquents chez les diabétiques et plus graves ) .
Un dépistage systématique doit être fait:
- ECG annuel dès 45 ans chez l ’homme et 50 ans chez la femme ou,
- Consultation de cardiologie dès apparition d ’un ou plusieurs facteurs de risque: HTA, Tabac, ATCD familiaux, Hyperlipidémie …) avec épreuve d ’effort ou scintigraphie myocardique ou échographie de stress suivi si besoin d ’une coronarographie
ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX
Plus fréquents
Surveillance clinique et échographique des troncs supra-aortiques
Mise précoce aux antiagrégants plaquettaires
Lutte contre l ’HTA +++
ARTERIOPATHIE DES MEMBRES INFERIEURS
Très fréquente , aggravée par le tabac
Essentiellement distale ( artères des jambes et des pieds)
Longtemps discrète:
- palpation des pouls
- mesure de l ’Index de Pression Systolique
-Echodoppler artériel des MI
Facteur d ’ischémie du pied avec possibilité de gangrène aggravé par la neuropathie et les infections.
Risque d ’amputation ++
Prévenue par l ’arrêt du tabac, la lutte contre lipides et HTA, l ’équilibre du diabète, la marche et les antiagrégants plaquettaires