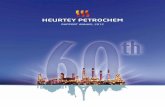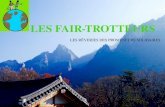corée du sud
-
Upload
thymy-magouillesland -
Category
Documents
-
view
32 -
download
0
description
Transcript of corée du sud

CORÉE DU SUD
Article écrit par Valérie GELÉZEAU, Jin-Mieung LI, Universalis
Prise de vue
La Corée du Sud (République de Corée, Taehan Min'guk ou Daehan Minguk) a été fondée en 1948, dansla partie méridionale de la péninsule occupée par le Japon depuis le début du XXe siècle. La division de lapéninsule de part et d'autre du 38e parallèle entre la Corée du Nord, soutenue par Moscou, et la Corée duSud, soutenue par Washington, eut pour conséquence le principal conflit de la guerre froide, qui scella lapartition en 1953.
Corée du Sud
Carte politique de la Corée du Sud(2005 Encyclopædia Universalis France S.A.)
Corée du Sud : drapeau
Corée (1882 ; off. 1950). Sur champ blanc, au centre un large disque rouge et bleu (rang-ûm) et,aux angles, quatre des huit trigrammes (kwae) du « Livre des mutations ». Le rouge et le bleu dudisque, de part et d'autre d'une ligne en forme de S, représentent les forces antagonistes etcomplémentaires de l'univers : …(2005 Encyclopædia Universalis France S.A.)
Pays traditionnellement agricole, la Corée du Sud est dépourvue de ressources naturelles, et dépendbeaucoup des échanges extérieurs pour importer technologies, capitaux et matières premières, et pourexporter des produits à forte valeur ajoutée.
La densité de population y est très forte et la circulation s'effectue sur l'axe principal Séoul-Pusan(Busan) et sur l'axe secondaire Séoul-Kwangju (Gwangju). La société coréenne a connu une mutation enprofondeur en quelques décennies pour passer d'une société agricole arriérée à une autre industrialisée etinformatique, après un développement économique remarquable.
Séoul (Corée du Sud)
Séoul (Corée du Sud) : en raison de l'encadrement montagneux du site, le prodigieux essor de laville depuis la création de la république a généré un urbanisme vertical.(Tony Stone Images/Getty)
Pour autant, le fonctionnement du système politique n'a pas été à la hauteur du progrès économique.Les Coréens du Sud ont enduré, pendant quatre décennies, des régimes corrompus, autoritaires, répressifset dictatoriaux. Les aspirations à la démocratie sont restées vaines malgré les mouvements violents deprotestation des hommes politiques d'opposition, des intellectuels et des étudiants.
La démocratie et la liberté politique, syndicale et d'opinion sont arrivées en 1987 avec l'adoption d'unenouvelle Constitution, introduisant un mandat présidentiel unique de cinq ans, permettant une alternancedémocratique à partir de 1988.
Jin-Mieung LI
I- Géographie
Avec 48,5 millions d'habitants en 2006, la Corée du Sud, membre de l'O.C.D.E. depuis 1996, apparaît comme un des pays émergents d'Asie qui s'est bien remis de la crise de 1997-1998. Ce « petit dragon », dont la croissance a été dirigée par des régimes dictatoriaux, est désormais un État démocratique et une des quinze premières puissances économiques mondiales. La population sud-coréenne, urbaine à plus de 85 p.

100 et dont 73 p. 100 des actifs travaillent dans le secteur tertiaire, jouit d'un niveau de vie équivalent àcelui de l'Espagne (P.I.B. par habitant de plus de 16 000 dollars en 2006). Rapidement enrichie par le« miracle économique », la Corée du Sud, avec un indice conjoncturel de fécondité de moins de 1,4 en 2006(un des plus faibles du monde), est désormais une société en phase de vieillissement.
Les contrastes du peuplement
La densité moyenne du pays (490 hab./km2 en 2006) masque les disparités spatiales reflétant lescontrastes de la géographie physique et le résultat du développement.
De taille modeste (99 000 km2, environ 1/5 de la France), le territoire sud-coréen, montagneux à 80 p.100, est placé depuis 1953 en situation insulaire par la partition de la péninsule et l'établissement de la zonedémilitarisée D.M.Z., frontière fermée qui la sépare de la Corée du Nord. S'abaissant d'est en ouest et ouvertà l'influence maritime, il est structuré par les chaînes du Taebaek et du Sobaek (où se trouve le pointculminant de la Corée du Sud, le mont Chiri [mont Jiri] à 1 915 m), montagnes aux escarpements vigoureux,malgré des altitudes dépassant rarement 2 000 mètres. Ces zones montagneuses, abris traditionnels destemples bouddhiques et des ermitages confucéens, ont fait l'objet d'importantes politiques de reboisementet accueillent la plupart des vingt parcs nationaux dont le premier, celui du mont Chiri, a été désigné en1967. Peu densément peuplées, ces montagnes s'opposent aux plaines agricoles de la côte occidentale(plaine de Sosan-Asan, plaine de Kimje), où l'assèchement des marais et la poldérisation ont modifié dans ledétail le dessin sinueux des côtes basses et découpées. Les densités humaines sont les plus importantesdans les bassins (bassins de Séoul, de Taegu [Daegu] ou de Taejon [Daejeon]) ou les étroites plaines côtières(plaines de Pusan [Busan] ou d'Ulsan) qui ont concentré le développement urbain et industriel.
Des paysages ruraux transformés par la modernisation
L'agriculture sud-coréenne, comptant pour moins de 4 p. 100 dans le P.I.B. en 2005, est dominée par lariziculture, qui occupe plus de 60 p. 100 des terres arables sur de petites exploitations (moins de 1,4 ha enmoyenne). Lancée par le mouvement « Saemaŭl » (« des nouveaux villages ») en avril 1970, lamodernisation des campagnes s'est concrétisée par la mise en œuvre de grands travaux d'irrigation, deremembrement et d'arasement des collines, la rénovation du réseau routier et la transformation de l'habitatrural. L'augmentation des rendements en riz (de 30 à 50 quintaux/ha entre 1970 et 2006), grâce à lamécanisation et la diffusion des engrais, a permis d'atteindre une production annuelle de 5 millions detonnes en 2005, rendant la Corée du Sud autosuffisante pour cette denrée aujourd'hui menacée parl'ouverture des marchés agricoles et l'évolution des habitudes de consommation locales. Auparavantdominées par l'orge, les cultures sèches se sont spécialisées sur des produits plus rentables, comme lesfruits (2,4 millions de tonnes en 2004) et les légumes (6,6 millions de tonnes), dont une grande partie estcultivée sous serre autour des grandes villes.
La pêche, jusque-là réduite à l'exploitation des rivages proches, a muté également, grâce à l'expansionde la pêche hauturière, si bien que la Corée occupe, selon les années, entre le 7e et le 10e rang mondial.Particulièrement active sur la côte méridionale, aux eaux relativement calmes et parsemées d'îles,l'aquaculture (entre le 5e et le 7e rang mondial) produit environ 1 million de tonnes de produits marins, dontune grande variété d'algues comestibles.
Un espace industriel né de l'aménagement volontariste duterritoire
Dotée de maigres ressources minérales (fer, tungstène et houille), dont l'exploitation, de surcroît, n'estplus compétitive au niveau international, la Corée du Sud doit importer presque toutes ses matièrespremières depuis la fermeture des charbonnages en 1989. L'énergie, fondée sur les importations de pétrole,une modeste production électrique et le nucléaire développé dans les années 1980, est donc l'une desfaiblesses de la puissante industrie coréenne.

Amorcée au début de la dictature de Park Chung-hee par le premier plan quinquennal de développementéconomique (1962-1966), l'industrialisation du pays, portée par la promotion des exportations, a étécontrôlée par un État autoritaire qui a mis successivement l'accent sur les industries légères dans les années1960, lourdes et chimiques dans les années 1970 et de haute technologie dans les années 1980. De 9 p. 100du P.I.B. en 1953, la part de la production industrielle est passée à plus de 39 p. 100 en 1985. Depuis la findes années 1980, le gonflement de la part du secteur tertiaire (de 46 p. 100 du P.I.B. en 1985 à plus de 55 p.100 en 2005) reflète l'importance prise par la haute-technologie et les services.
La construction navale en Corée
Le lancement d'un navire aux chantiers de Pusan. Dans le cadre de son industrialisation rapide,la Corée du Sud est entrée activement sur le marché de la construction navale à partir desannées 1980.(Vito Palmisano, Tony Stone Images/ Getty)
S'appuyant sur les chaebol (conglomérats coréens), l'industrie coréenne est présente sur les marchésmondiaux non seulement dans le domaine de l'industrie lourde (5e rang mondial pour l'acier, 1er rang pour leschantiers navals en 2005 avec plus de 30 p. 100 du marché mondial), mais aussi dans des secteurs de pointecomme l'électronique – le chaebol Samsung est le 2e producteur mondial de semi-conducteurs. L'espaceindustriel sud-coréen s'organise à petite échelle autour de deux grandes régions principales (la région deSéoul et la ceinture industrielle du sud-est), tout en s'appuyant à l'échelle locale sur des complexesd'activités développés par l'État, comme le complexe de Kuro (premier complexe industriel d'exportationinauguré à Séoul en 1964) et les zones franches comme celles d'Iksan sur la côte ouest et Masan sur la côteméridionale (inaugurées en 1970) ou encore les gigantesques complexes industriels intégrés de Posco(Pohang Steel Company, 2e aciériste mondial) à l'Ohang et Kwangyang.
La fin de l'explosion urbaine ?
Stimulée par le développement d'un bon réseau autoroutier dès les années 1970, la croissanceindustrielle rapide du pays a entraîné une mutation urbaine brutale, ce qui a donné lieu à l'émergence d'unevingtaine de villes de plus de 500 000 habitants, dont sept villes millionnaires : Séoul, Pusan, Inch'on, Taegu,Kwangju, Taejon et Ulsan. L'explosion urbaine a d'abord profité aux grandes villes, au premier rangdesquelles Séoul – capitale politique et mégapole d'environ 10 millions d'habitants – mais, depuis lerecensement de 2000, les dynamiques migratoires des grandes villes s'apaisent en direction de leurspériphéries et seule Taejon (stimulée par les décentralisations administratives et le dynamisme dutechnopôle de Taedok) présente un solde migratoire nettement positif. En revanche, la croissance de laprovince du Kyonggi (autour de Séoul) se poursuit au détriment de celle des autres provinces – ce quiconfirme une tendance lourde dans les dynamiques spatiales de la péninsule.
Corée du Sud : villes et activités
Hiérarchie urbaine et activités en Corée du Sud.(2009 Encyclopædia Universalis France S.A.)
Les grandes régions de la Corée du Sud
Une mégalopole sud-coréenne ?
L'espace économique sud-coréen est aujourd'hui structuré par la mégalopole qui se développe de Séoul à Pusan, axe hérité de la colonisation japonaise. Avec 33 millions d'habitants, cet ensemble concentre 70 p. 100 de la population, tout en étant responsable des trois quarts du P.I.B. sud-coréen. La mégalopole est dominée par la région capitale (23 millions d'habitants en 2004) qui se présente comme une conurbation lâche et complexe de cités industrielles (Suwon, Puch'on et Ansan), de villes nouvelles (Pundang et Ilsan) ou de centres administratifs comme Songnam et Kwach'on, gravitant autour de Séoul, ville polyfonctionnelle et surpuissante. Cette première région industrielle du pays (textile, électronique et électrique, industries de pointe), concentrant plus de 50 p. 100 des installations nationales, est ouverte sur l'extérieur par le port

d'Inch'on (Incheon), 3e ville et 3e port de Corée, où sont localisées les industries lourdes (raffinage).
Séoul: scène de rue
À l'ombre des gratte-ciel ultramodernes, Séoul a su conserver des rues étroites avec leurs petiteséchoppes.(DAJ/ Getty)
Au sud-est, Pusan (capitale de la province du Kyongsang Sud, 2e ville et 1er port de Corée) commande ladeuxième grande région industrialo-urbaine du pays, développée sur des axes littoraux à l'est vers lescomplexes industrialo-portuaires d'Ulsan (raffinage, pétrochimie, chantiers navals) et de P'ohang(sidérurgie), à l'ouest vers Changwon (mécanique, automobile), Kwangyang (plus grande aciérie mondiale et2e port de Corée) et Yosu (raffinage et pétrochimie).
Port de Pusan, Corée du Sud
Vue d'une partie du port de Pusan, en Corée du Sud, l'un des plus importants en ce qui concernele trafic de conteneurs.(A. Chambreuil)
Entre ces deux pôles s'amorce une véritable mégalopole, le long d'un couloir de communicationsrenforcé par la circulation du KTX (Korean Train Express, le TGV coréen) depuis avril 2004.
Le sud-ouest : une région rurale stimulée par la proximité chinoise
Fief traditionnel de la contestation politique pendant les dictatures militaires (1961-1987), la région duHonam (provinces du Ch'olla) reste principalement agricole et responsable de plus de la moitié de laproduction de riz. Longtemps restée à l'écart du développement, elle jouit d'espaces naturels relativementpréservés (parc national du mont Chiri, parc national maritime du Hallyo) qui sont un atout pour le tourisme.
Le sud-ouest bénéficie également de la dynamique suscitée par les projets d'ouverture de la côteoccidentale vers la Chine. Une autoroute côtière, reliant Inch'on à Mokp'o, assure depuis 2001 la desserte degrands projets industriels : aménagement de la baie d'Asan, gigantesquepolder industrialo-urbain duSaemangom dans la baie de Kunsan (dont la digue principale de plus de 30 km a été achevée en avril 2006)destiné à accueillir un grand port commercial (conteneurs), développement de la zone industrialo-portuairede Mokp'o.Kwangju, capitale de la province du Ch'olla Sud et seule ville millionnaire située en dehors de l'axemégalopolitain, est une ville tertiaire qui a accueilli des activités de décentralisation industrielle (automobile)dans les années 1990.
Au large, l'île de Cheju, rare témoin volcanique de la péninsule et jouissant d'un climat véritablementsubtropical, apparaît comme une enclave agricole (production d'agrumes) et touristique (voyages de noce).
Le nord-est et la frontière : des régions en mutation ?
Le nord-est autour de la province du Kangwon se présente comme une zone montagneuse dotée deterroirs assez pauvres où champs secs (maïs) et vergers (pommiers) dominent sur la rizière (moins de 50 p.100 de la surface agricole utile), tentant de dynamiser son économie par le développement de l'agriculturecommerciale ou le tourisme. Ouverte sur la mer du Japon (mer de l'Est) par une côte rectiligne etinhospitalière, cette « Corée de l'envers » (référence au « Japon de l'envers », façade maritime nord, moinsdéveloppée) est confrontée aux disputes maritimes qui l'opposent au Japon à propos de cette mer (problèmede dénomination de cette mer bordière, revendications japonaises sur les îlots de Dokdo occupés par lesCoréens).
Bien qu'apparaissant comme une véritable périphérie de l'espace sud-coréen, la zone frontière séparantles deux Corées abrite les projets de réintégration territoriale qui ont accompagné le rapprochementnord-sud depuis le début des années 1990 et dont deux seulement ont donné lieu à des résultats concrets :la zone industrielle de Kaesong, ouverte à l'automne de 2004, et les excursions touristiques au montKomgang, deux projets situés au Nord et contrôlés par une filiale du chaebol Hyundai.

Pôle important de l'axe maritime régional trans-asiatique, la Corée du Sud poursuit son intégrationrégionale par la délocalisation de ses entreprises vers l'Asie du Sud-Est. Sur le plan politique, elle joue,malgré sa faiblesse diplomatique, un rôle important en Asie du Nord-Est où la question nucléairenord-coréenne apparaît de plus en plus comme l'instrument d'une lutte d'hégémonie entre la Chine et lesÉtats-Unis.
Valérie GELÉZEAU
II- Histoire
Les débuts de la république de Corée
Après la Seconde Guerre mondiale, l'échec des travaux du Comité mixte américano-soviétique dontl'objectif était de créer un gouvernement unique sur l'ensemble de la péninsule coréenne amena lesÉtats-Unis à porter l'affaire devant l'assemblée générale de l'O.N.U. Celle-ci adopta une résolutiondemandant l'organisation d'élections générales en Corée sous la surveillance d'une commissioninternationale. La commission ne pouvant se rendre dans la partie Nord, les élections eurent lieu uniquementau Sud, le 10 mai 1948. Le Parti libéral de Syngman Rhee obtint 154 des 198 sièges. L'Assemblée nationalese réunit pour la première fois le 31 mai 1948 et adopta, le 12 juillet, une Constitution qui fut promulguéecinq jours plus tard. Le 20 juillet, Rhee fut élu président de la République au suffrage indirect. La républiquede Corée fut proclamée le 15 août 1948.
La présidence de Syngman Rhee (1948-1960)
Le gouvernement de Syngman Rhee a trouvé une situation sociale et économique extrêmement difficileaprès la division du pays, d'autant plus que les deux parties, le Sud agricole et le Nord industriel, étaientcomplémentaires. La production agricole et industrielle au Sud se situait à un niveau très bas, avec uneinflation galopante et un chômage généralisé. Les Coréens vivaient dans la misère. Les États-Unisaccordèrent une aide économique et militaire de 4,3 milliards de dollars entre 1945 et 1965, ce qui permitd'acheter des produits alimentaires, des matières premières et des biens d'équipement.
Anticommuniste farouche, Rhee dut faire face aux agissements des communistes : soulèvement armédans l'île de Cheju en avril 1948, émeutes militaires à Yosu et à Sunch'on en octobre 1948, lutte despartisans communistes dans le mont Chiri en 1949. Ce contexte troublé fut marqué par des assassinatspolitiques : Song Chin-u (1945), Yo Un-hyong (1947), Kim Gu (1949).
Rhee fut réélu en février 1950, alors que son parti, le Parti national de Corée, n'obtint pas la majorité auxélections législatives de mai. En 1952, il fit amender, de force, la Constitution pour supprimer la clauselimitant à deux les mandats exercés par un même président et pour élire le président au suffrage universel.Les élections générales de mai 1954 donnèrent la victoire au Parti libéral, Rhee fut réélu pour la troisièmefois en 1956, mais le vice-président était un membre de l'opposition, Chang Myun. Les mouvementscontestataires se multiplièrent contre le despotisme de Rhee. La loi martiale fut décrétée en mai 1956, et laloi sur la sécurité nationale, destinée à opprimer la presse, fut adoptée en décembre.
Syngman Rhee et son épouse, en 1959
Le président sud-coréen Syngman Rhee (1875-1965) et son épouse, en costume traditionnel, lorsde l'anniversaire de l'indépendance de la république de Corée du Sud (1948). Chef de l'Étatdepuis cette date, il gouvernera de façon dictatoriale et sera destitué en avril 1960.(HultonGetty)
Le 15 mars 1960, Rhee fut réélu président, sans difficulté, son adversaire, Cho Byong-ok, était mort de maladie quelques jours auparavant. Malgré cela, l'entourage du président organisa des élections truquées pour faire élire Lee Gi-bung comme vice-président dans la perspective de son éventuelle accession à la

présidence, Rhee (1875-1965) étant alors âgé de quatre-vingt-quatre ans. Les manifestations demandantl'annulation de l'élection se généralisèrent. Le 18 avril, la loi martiale fut proclamée. Le soulèvement desétudiants eut lieu le 19, et la police tira dans la foule, faisant 142 morts parmi les étudiants. Les professeursd'université, eux aussi, manifestèrent le 25. La famille de Lee Gi-bung devait se suicider le 28. Rhee finit pardémissionner le 27 et partit, le 29 mai, en exil à Hawaii, où il mourut en 1965.
Sur le plan diplomatique, cette période fut marquée par le renforcement des relations avec lesÉtats-Unis. Un traité de défense mutuelle fut signé entre les deux pays le 27 octobre 1953. Depuis lors, lesÉtats-Unis maintiennent, en Corée, des troupes au nom de l'armée de l'O.N.U.
Rhee étant un antijaponais convaincu, Séoul n'eut pas de relations diplomatiques avec son voisin le plusproche jusqu'en 1965.
La présidence de Yun Po-son
Après la chute du régime de Rhee, l'Assemblée nationale adopta, le 15 juin 1960, une nouvelleConstitution qui instaura un système parlementaire bicaméral (IIe République). Le Parti démocrate obtint lamajorité aux élections des députés et des sénateurs en juillet. Chang Myun (1899-1966) fut nommé Premierministre et Yun Po-son (1897-1990) président de la République sans pouvoir. Les désordres persistèrent. Lesétudiants, forts d'avoir réussi à chasser Rhee, voulaient intervenir dans toutes les décisions importantes.Incapable de faire face à cette situation, le gouvernement changea quatre fois en un an.
Développement économique sous le régime autoritaire de ParkChung-hee
Dans cette situation troublée eut lieu, le 16 mai 1961, un coup d'État militaire, sans effusion de sang,dirigé par le généralPark Chung-hee (1917-1979), secondé par le colonel Kim Jong-pil et ses amis. La junte adissous le Parlement, suspendu toute activité politique, créé le Conseil suprême de la reconstructionnationale, et Park devint son président après avoir écarté le général Chang Do-young, qui avait occupé ceposte avant lui.
En mars 1962, le président Yun Po-son fut contraint de démissionner, et Park Chung-hee devint présidentde la République par intérim. Park fit adopter, par le référendum du 17 décembre 1962, une nouvelleConstitution restaurant le système présidentiel (IIIe République). Il fut élu président de la République enoctobre 1963 avec 46,6 p. 100 des voix, contre Yun Po-son (45,1 p. 100), et son parti, le Parti républicain,obtint la majorité aux élections générales le mois suivant.
En 1962, Park mit en place le premier plan quinquennal qui est à l'origine du développementéconomique de la Corée du Sud, et il inaugura l'autoroute Séoul-Pusan en février 1968.
Il fut réélu en mai 1967. Le Parti républicain gagna en juin des élections générales truquées. En 1969,Park fit amender la Constitution afin de supprimer la clause interdisant le troisième mandat présidentiel,dans l'intention de pérenniser son pouvoir et, le 27 avril 1971, il fut réélu avec 51,2 p. 100 des suffrages,contre Kim Dae-jung (43,6 p. 100). Le Parti républicain obtint 113 sièges sur 204 aux élections législatives enmai.
Il lança, en 1972, le vaste mouvement des « nouveaux villages » (saema ŭl undong) destiné àmoderniser la campagne et l'agriculture : remplacement des toits en chaume par de la tôle ondulée,aménagement des routes et des terres, électrification, mécanisation, culture sous serre, etc. En quelquesannées, le mouvement transforma complètement la physionomie de la campagne coréenne.
Le 21 novembre 1972, une nouvelle Constitution, dite de Yushin (renouveau), fut adoptée par référendum (IVe République). Elle institua un collège électoral, dénommé Conférence nationale pour la réunification, dont le rôle essentiel était d'élire le président de la République ainsi qu'un tiers des députés. Sous le coup des mesures d'urgence et de la loi martiale eurent lieu, le 15 décembre, les élections des 2 359 membres de la Conférence, qui éliront Park président. Les deux tiers des 276 députés furent élus à

raison de deux députés par grande circonscription et un tiers par la Conférence. Ce fut un système taillé surmesure pour Park qui voulait rester au pouvoir « à vie », en disposant à coup sûr d'une majorité auParlement, au mépris de l'aspiration des Coréens à une démocratie qui soit à la mesure de leurdéveloppement économique. Dès lors, il ne parvint à gouverner qu'en prenant des mesures d'exception et endécrétant la loi martiale.
Qui plus est, il persécuta son rival Kim Dae-jung. Le 8 août 1973, Kim fut enlevé d'un hôtel au centre deTōkyō et ramené en Corée. Il fut placé en résidence surveillée chez lui grâce à l'intervention des États-Unis etde l'opinion internationale.
En 1974, Park perdit sa femme dans un attentat perpétré contre lui par un terroriste coréen résidant auJapon, lors de la cérémonie du 15 août qui commémorait la libération du pays.
Park fut réélu en juillet 1978. Son parti enregistra un recul aux élections générales du 2 décembre. Deviolentes manifestations d'étudiants dégénérèrent à Pusan et à Séoul en octobre 1979, alors que la presseétait réduite au silence depuis longtemps. Dans ce contexte tendu, le président Park fut assassiné le26 octobre par son bras droit, Kim Jae-gyu, directeur du K.C.I.A. (la C.I.A. coréenne). Le mobile du crime n'estpas très clair. Kim et quatre autres complices furent arrêtés, jugés et exécutés en décembre.
Sur le plan diplomatique, poussé par des nécessités économiques, surtout pour financer le premier plande développement économique lancé en 1962, Séoul entama des négociations avec Tōkyō dès mars 1964 envue de normaliser les relations. Malgré de violentes protestations en Corée comme au Japon, le traitéd'amitié et de commerce coréo-nippon fut signé le 22 juin 1965 à Tōkyō. Par la suite, le Japon accorda à laCorée du Sud 500 millions de dollars sous forme d'aide économique et de prêt. En contrepartie, Séouls'engagea à ne pas exiger de réparations pour la période de colonisation. C'est aussi à la fin de 1965 que,sous la pression américaine, la Corée envoya au Vietnam deux divisions de soldats qui ne seraient rapatriésqu'en 1973.
Le président Carter annonça, en mars 1977, le retrait progressif des troupes américaines, mais219 soldats seulement quittèrent la Corée en 1978. En novembre de la même année, la Corée du Sud et lesÉtats-Unis mirent en place un commandement commun des forces armées en Corée.
Démocratie bafouée au temps des régimes militaires
La présidence de Choi Kyu-hah
Le Premier ministre Choi Kyu-hah (1919-2006) devint président de la République après la mort tragiquedu président Park. Il commença à prendre des mesures libérales, mais l'espoir de démocratisation s'évanouitlorsque, le 12 décembre 1979, un groupe de militaires, conduit par le généralChun Doo-hwan, sortit del'ombre, après avoir arrêté le général Chong Sung-hwa, chef d'état-major de l'armée de terre.
Des manifestations étudiantes éclatèrent un peu partout au printemps de 1980. Le 17 mai, la loi martialefut décrétée et, le lendemain, une insurrection éclata à Kwangju et se transforma en soulèvement généraldes habitants. Le 27, ces derniers s'emparèrent des dépôts d'armes et de munitions de la police. La ville futisolée de l'extérieur. Puis eut lieu l'intervention des commandos parachutistes contre les citadins armés, quifirent officiellement 191 morts, et beaucoup plus selon des sources officieuses.
La présidence de Chun Doo-hwan
Une fois matée l'insurrection de Kwangju, Chun Doo-hwan se plaça à la tête du Comité spécial de lasécurité nationale, créé le 31 mai 1980 et, après le retrait du président Choi, fut élu président de laRépublique, le 27 août, par la Conférence nationale pour la réunification. Le 17 septembre, Kim Dae-jung futarrêté pour avoir monté un complot subversif. Il fut condamné à mort par une cour martiale – peinecommuée en emprisonnement à perpétuité –, puis libéré et envoyé aux États-Unis en décembre 1982.

Le 22 octobre 1980, une nouvelle Constitution (Ve République) fut approuvée par référendum. Elle portale nombre des membres du collège électoral à 5 000 et institua un mandat présidentiel unique de sept ans.La loi martiale fut levée en janvier 1981, et Chun fut réélu en février. Le couvre-feu qui existait depuis 1945fut levé en février 1982. Le mois suivant, le Parti démocrate de la justice de Chun gagna les électionslégislatives.
Chun lança, en 1980 et en 1981, une campagne d'épuration des fonctionnaires, des magistrats et desjournalistes. Il envoya, au total, 70 000 personnes, y compris des délinquants, dans des camps derééducation. Certains dirigeants politiques se virent confisquer leur fortune illégalement amassée. D'autresfurent privés de leurs droits politiques et mis en résidence surveillée, tels Kim Dae-jung, Kim Young-sam etKim Jong-pil. Pourtant, les proches parents de Chun et de son épouse ainsi que son entourage se trouvèrentmêlés à des scandales financiers et à des affaires de corruption et de trafic d'influence.
L'année 1983 fut marquée par deux drames qui secouèrent le pays à un mois d'intervalle. Dans la nuitdu 31 août au 1er septembre, la chasse soviétique abattit un Boeing 747 de la K.A.L. (Korean Air Lines), avec269 passagers à bord près de l'île soviétique de Sakhaline. La Corée du Sud, n'ayant pas de relationsdiplomatiques avec l'U.R.S.S., se sentait impuissante devant cet acte barbare. Le second drame fut unattentat à la bombe perpétré, le 9 octobre, par des terroristes nord-coréens, sur la personne du présidentChun en visite officielle à Rangoon en Birmanie. Il dut au retard qu'il avait sur son programme d'avoir la viesauve, mais quatre Birmans et dix-sept Coréens, dont quatre ministres, trouvèrent la mort. La Birmanierompit ses relations diplomatiques avec Pyongyang, lesquelles ne seront rétablies qu'en avril 2007.
Pendant cette période, l'économie coréenne connut une forte expansion, et le niveau de vie s'amélioranettement. Les émissions en couleur de la télévision débutèrent le 1er décembre 1980. Les Coréens du Sudorganisèrent en 1986 les Xes Jeux asiatiques, auxquels participa la Chine populaire, et vécurent au rythme dela préparation des jeux Olympiques de Séoul de 1988.
S'agissant des relations extérieures, Chun resserra les liens entre la Corée et le Japon. Le Premierministre japonais Nakasone Yasuhiro visita Séoul en janvier 1980. C'était la première visite officielle d'unchef du gouvernement japonais en Corée. Tōkyō accorda à Séoul un prêt de 4 milliards de dollars. Quant auxrelations franco-coréennes, le Premier ministre français Laurent Fabius se rendit à Séoul en avril 1985. Deuxcentrales nucléaires coréennes, construites avec la technologie française (Framatome), furent achevées en1985. Le président Chun fit un voyage officiel en France en avril 1986.
La présidence de Roh Tae-woo
En 1987, le climat social se dégrada. La mort d'un étudiant au cours d'un interrogatoire policier en avrilprovoqua des manifestations d'étudiants qui dégénérèrent en mouvements de protestation populaire. Face àcette situation, Roh Tae-woo, candidat à la présidence, annonça, le 29 juin, des mesures de démocratisationet de libéralisation : élection du président au suffrage universel tant réclamée depuis 1971, rétablissementdes droits politiques des opposants, suppression de la censure dans la presse, liberté syndicale. Ellesmarquent un tournant crucial dans l'histoire de la Corée du Sud.
Une nouvelle Constitution fut élaborée en concertation entre les députés des partis au pouvoir etd'opposition. Après avoir été adoptée par une large majorité à l'Assemblée nationale, elle fut approuvée parle référendum du 27 octobre (VIe République). D'après la nouvelle Constitution, le président de la Républiqueest élu au suffrage universel pour un mandat unique de cinq ans. Depuis 1972, il était élu par un collègeélectoral de 2 500, puis de 5 000 personnes. La nouvelle Constitution renforçait le pouvoir de l'Assembléenationale et verrouillait le mandat présidentiel par une clause spéciale selon laquelle toute modificationvisant la durée et le nombre des mandats ne s'appliquerait pas au président en exercice au moment del'amendement. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Le 17 décembre, Roh fut éluprésident de la République avec 36,6 p. 100 des voix selon la nouvelle Constitution. Son élection est due à ladivision des candidats d'opposition, Kim Dae-jung et Kim Young-sam, qui n'avaient pu s'entendre sur unecandidature unique.
Fondé sur le monocamérisme, le Parlement (Kukhoe) compte 299 députés élus pour quatre ans, dont 224 sont élus dans les circonscriptions et 75 à la proportionnelle. Aux élections législatives d'avril 1988, le Parti démocrate de la justice de Roh Tae-woo n'a pas obtenu la majorité, avec seulement 125 sièges sur 299, le

Parti pour la paix et la démocratie de Kim Dae-jung en ayant 70, le Parti démocrate de la réunification de KimYoung-sam 59, le Parti républicain de Kim Jong-pil 35, divers partis et indépendants 10. Le gouvernement deRoh était donc obligé de trouver sans cesse des compromis avec les partis d'opposition. Néanmoins, leshommes politiques observèrent une trêve jusqu'aux XXIVes jeux Olympiques qui se tinrent à Séoul du17 septembre au 2 octobre et auxquels participèrent 13 000 athlètes venant de 160 pays, sauf la Corée duNord et Cuba. Les Coréens y virent une sorte de consécration internationale de leur réussite économique.
L'Assemblée nationale, où les partis d'opposition constituaient la majorité, investie d'un pouvoir accru decontrôle sur l'exécutif, mena des enquêtes et demanda des témoignages sur les affaires du régime Chun :répression sanglante à Kwangju, scandales financiers, trafic d'influence et corruption de fonctionnaires.Plusieurs anciens ministres et des membres de la famille de l'ancien président et de son épouse furent jugéset emprisonnés, et le couple présidentiel fut obligé de se retirer dans un temple bouddhique loin de lacapitale jusqu'à la fin de 1990. L'ex-président fut même contraint de témoigner en personne devant unecommission parlementaire.
En février 1990, le Parti démocrate de la justice, le Parti démocrate de la réunification et le Partirépublicain fusionnèrent sous le nom de Parti démocrate libéral.
Aux élections législatives de mars 1992, le Parti démocrate libéral de Roh Tae-woo a obtenu la majoritéavec 149 sièges sur 299, le Parti démocrate de la paix de Kim Dae-jung 97 sièges. Le Parti national del'unification, créé par Chung Ju-yung, fondateur du groupe Hyundai, a obtenu 31 sièges, et les indépendants22. Le grand vainqueur des campagnes électorales a été l'argent. Le président Roh pouvait donc compter surle soutien parlementaire pour la dernière année de son mandat.
Dans le domaine diplomatique, les relations franco-coréennes ont été marquées par la visite officielle duprésident Roh à Paris en novembre 1987 et par celle du Premier ministre Michel Rocard à Séoul en mai 1991.Les deux pays sont liés par des accords de coopération culturelle et scientifique. En outre, un consortiumd'entreprises françaises, conduit par la société G.E.C.-Alstom, était en compétition avec des groupesallemands et japonais, dans le projet de construction d'un réseau ferroviaire coréen à grande vitesse(350 km/h), dont l'achèvement de la ligne Séoul-Pusan était prévu pour 1998.
Hormis le renforcement des relations traditionnelles, Roh entreprit une ouverture en direction des payssocialistes et de la Corée du Nord. En 1988, la Corée du Sud a noué, avec la Hongrie, la Yougoslavie et laPologne, des relations commerciales qui se sont transformées en relations diplomatiques l'année suivante.Quant à l'U.R.S.S., Séoul et Moscou ont échangé une mission commerciale dès le début de 1989. À la suitede la rencontre historique Roh-Gorbatchev à San Francisco le 4 juin 1990, les relations diplomatiques ont étéétablies entre les deux pays le 30 septembre. La Corée du Sud accorda à l'U.R.S.S. un crédit de 3 milliards dedollars. Puis, Roh a effectué une visite officielle à Moscou en décembre 1990, et Gorbatchev fit une courtevisite en Corée en avril 1991.
Pékin et Séoul, après avoir échangé une mission commerciale depuis janvier 1990, ont établi, le 24 août1992, des relations diplomatiques, suivies de la visite en Chine du président sud-coréen Roh en septembre.Le commerce entre les deux pays, qui existait dès le début des années 1980, s'est accru d'année en année,pour passer de 1 milliard de dollars en 1991 à 11,4 milliards en 1996 pour les exportations coréennes et de3,4 milliards à 8,5 milliards pendant la même période pour les importations coréennes (sans compter lecommerce avec Hong Kong). Les entreprises coréennes sont déjà actives aussi bien en Chine que dans lespays de l'ex-bloc socialiste. Le rapprochement diplomatique avec la Chine populaire valut à la Corée du Sudla rupture avec Taïwan.
Démocratie et alternance
La présidence de Kim Young-sam
Lors de l'élection présidentielle de décembre 1992, Kim Young-sam, candidat du Parti démocrate libéral, fut élu avec 42 p. 100 des suffrages, face à Kim Dae-jung du Parti démocrate pour la paix et à Chung Ju-yung du Parti national pour l'unification. Après cette élection, Kim Dae-jung, opposant de longue date aux régimes

militaires, abandonna la politique et son parti fut dirigé par Lee Ki-taek. Chung Ju-yung, écœuré de l'agitationdes milieux politiques, fit dissoudre son parti et quitta la scène politique.
Premier président civil depuis 1962, Kim Young-sam entreprit de lutter contre la corruption, l'abus depouvoir et le trafic d'influence pratiqués par les dirigeants politiques et les hauts fonctionnaires civils etmilitaires. Il mit en application des mesures visant à lever l'anonymat des comptes bancaires et à rendretransparentes des opérations commerciales et bancaires.
Sur le plan politique, il fit adopter, en vue de « redresser les erreurs de l'histoire », une loi spéciale quipermettrait de juger ses deux prédécesseurs à la présidence, Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo, accusésd'avoir organisé un putsch militaire en décembre 1979 après l'assassinat du président Park Chung-Hee par ledirecteur du K.C.I.A. deux mois auparavant (26 octobre), et d'être à l'origine de la répression sanglante(officiellement 191 morts) lors du soulèvement à Kwangju en mai 1980. Ils furent également poursuivis pouravoir extorqué plusieurs centaines de millions de dollars auprès des conglomérats (chaebol). Emprisonnés audébut de 1996 en vue du « procès du siècle », ils furent condamnés, en août 1996 : Chun à la peine capitale,Roh à un emprisonnement de vingt-deux ans et demi. Mais ils furent graciés et libérés en novembre 1997.Pourtant, le président Kim Young-sam lui-même a été impliqué indirectement dans un scandale decorruption, à travers son deuxième fils qui a été jugé et emprisonné, en 1997, pour une affaire de traficd'influence et de corruption. On lui reproche d'avoir conduit l'économie coréenne au bord de la banqueroute,à la suite de la plus grave crise financière et monétaire (novembre-décembre 1997) que la Corée ait jamaisconnue. Entre septembre et décembre 1997, la monnaie coréenne, le won, perdit la moitié de sa valeurvis-à-vis du dollar, et en décembre, Séoul dut recourir à un prêt d'urgence de 57 milliards de dollars auprèsdu F.M.I. Les Coréens ressentirent cela comme une humiliation et une honte nationales. Cette crisefinancière eut des conséquences douloureuses : faillite des banques et des entreprises, licenciementsmassifs, baisse des salaires.
La présidence de Kim Dae-jung
En décembre 1997, Kim Dae-jung a été élu président de la République avec 40,3 p. 100 des voix ; ilaffrontait Lee Hoi-chang du Grand Parti national et Rhee In-je du Nouveau Parti pour le peuple. Ancienopposant aux régimes militaires, il avait failli perdre la vie à plusieurs reprises. Démocrate, issu de la régionde Cholla, longtemps défavorisée, il a bénéficié d'un préjugé favorable dans l'opinion. Son élection étaitsynonyme d'une véritable alternance démocratique en Corée du Sud. Il a hérité d'une situation économiquedramatique laissée par son prédécesseur. La tâche prioritaire du gouvernement de Kim Dae-jung était deredresser la situation économique par la réorganisation des conglomérats, par le regroupement, la fusion etl'échange des activités entre eux selon les secteurs, en vue de résorber leur endettement endémique,d'imposer une gestion plus transparente, de réduire leur taille et de les rendre plus compétitifs.
Après les élections législatives du 11 avril 1996 et la présidentielle de décembre 1997, les partispolitiques se sont réorganisés. À la fin d'octobre 1998, le Parlement était composé de 137 députés duCongrès national pour la nouvelle politique (de Kim Dae-jung) qui venait d'absorber le Nouveau Parti pour lepeuple (de Rhee In-je), de 53 membres de l'Union des démocrates libéraux (de Kim Jong-pil), réunion desdeux partis qui formèrent une coalition gouvernementale dirigée par Kim Jong-pil ; et de 5 indépendants.L'opposition était représentée par le Grand Parti national (de Lee Hoi-chang) qui comptait 104 députés sur299.
Investiture du nouveau président sud-coréen, 25 février 1998
Discours d'investiture du nouveau président sud-coréen, Kim Dae-Jung, élu le 18 décembre 1997,en présence du président sortant, Kim Young-Sam (25 février 1998). Symbole d'une véritable«révolution politique», ce leader de l'opposition de gauche, emprisonné durant plus de six ans etdeux fois condamné à mort, prend donc officiellement ses fonctions.(PA Photos)
Kim Dae-jung a pratiqué la « politique du soleil » (sunshine policy) à l'égard de la Corée du Nord. Il est le premier président sud-coréen qui se soit rendu en Corée du Nord, les 14 et 15 juin 2000, où il a été accueilli chaleureusement par le dirigeant Kim Jong-il et par le peuple nord-coréen. À la suite de cette rencontre au sommet, les échanges de familles séparées ont été organisés. Le 15 août 2000, cent cinquante Coréens du

Nord et cent cinquante Coréens du Sud se sont retrouvés en famille à Séoul et à Pyongyang. Deux autresrencontres ont eu lieu le 30 novembre 2000 et en janvier 2001.
À ce titre, le président Kim Dae-jung a obtenu le prix Nobel de la paix en 2000. Sa politique dite « dusoleil » en direction du Nord a permis un rapprochement spectaculaire entre les deux Corées, mais celui-cifut de courte durée.
La présidence de Roh Moo-hyun
Roh Moo-hyun, candidat du parti Uri, a été élu le 19 décembre 2002, président de la République avec48,9 p. 100 des votes contre Lee Hoi-chang (46,6 p. 100), candidat du parti Hannara, principal partid'opposition. C'est un avocat qui a plaidé pour les pauvres et les opprimés. Son élection a été facilitée par lemouvement des jeunes internautes. Il représente la force politique dite progressiste. Un des points clés duprogramme de Roh était la lutte contre la corruption récurrente dans les puissants chaebol (conglomérats) etles milieux politiques. Son investiture a eu lieu le 25 février 2003, date à laquelle la Corée du Nord a lancédes missiles en mer du Japon (mer de l'Est), une façon de « marquer » la prise de fonctions d'un nouveauprésident au Sud. Roh a nommé Goh Kun, ancien maire de Séoul, comme Premier ministre.
Le début de sa présidence a été mouvementé car il a été destitué par le Parlement le 12 mars 2004 pourparticipation illégale dans la campagne électorale législative. Cette motion du Parlement devait être validéepar la Cour constitutionnelle. L'intérim de la présidence a été assuré par le Premier ministre. C'était un faitsans précédent dans l'histoire de la Corée. Mais, aux élections législatives du 15 avril, son parti a remporté lamajorité, laminant les conservateurs qui contrôlaient l'Assemblée nationale jusqu'alors. Lee Hae-chan estnommé Premier ministre, et le président Roh a été réhabilité par la Cour constitutionnelle le 13 mai.
Un autre désaveu de la politique de Roh a été l'annulation du projet de transfert de la capitale dans laprovince du Chungchông (Chungcheong), jugé non conforme à la Constitution. Tous les plansd'aménagement du territoire liés à ce projet ont dû être abandonnés.
Roh a lancé une campagne afin de faire la lumière sur le passé : établissement de la liste descollaborateurs à l'époque de la colonisation japonaise, enquête sur les violations des droits de l'homme sousles dictatures militaires. Il a nommé une femme au poste de Premier ministre en avril 2006 pour la premièrefois dans l'histoire de la Corée, en la personne de Han Myung-Sook, ancienne députée, diplômée de langue etlittérature françaises à l'université féminine d'Ehwa.
À la fin de son mandat, en octobre 2007, Roh Moo-hyun participe, avec son homologue nord-coréen KimJong-il, au deuxième sommet intercoréen (après celui de juin 2000). Ils signent une « déclaration de paix etde prospérité » en vue de parvenir à un « régime de paix permanente », texte qui comprend également unprogramme de coopération économique.
Jin-Mieung LI
La présidence de Lee Myung-bak
Le 19 décembre 2007, deux jours après la création d’une commission d’enquête parlementaireconcernant son implication dans une affaire de malversations financières, Lee Myung-bak, chef du G.P.N.,ancien maire de Séoul et ancien président de Hyundai, remporte l’élection présidentielle avec 48,7 p. 100des suffrages. En avril 2008, son parti sort également vainqueur des élections législatives en obtenant 153sièges sur 299. Mais le nouveau président conservateur reste impopulaire et son premier gouvernementdémissionne rapidement car il est contesté en raison de sa décision d'autoriser la reprise des importations deviande en provenance des États-Unis, suspendues depuis 2003. Cette impopularité entraîne un blocage dujeu politique, les députés de l’opposition contrant de nombreuses initiatives gouvernementales. Le mandatde Lee Myung-bak est marqué par des incidents avec la Corée du Nord, notamment le torpillage d’unecorvette par un sous-marin nord-coréen en mars 2010.
Universalis

Relations extérieures
Dans le domaine des relations internationales, des Coréens ont accédé, au début du XXIe siècle, à la plushaute fonction dans des organisations mondiales, tel Lee Jong-Wook, spécialiste de la tuberculose, qui aoccupé le poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, de juillet 2003 à mai 2006, ouBan Ki-moon, ministre des Affaires étrangères, qui a été élu, le 13 octobre 2006, au poste de secrétairegénéral de l'O.N.U., pour succéder à Kofi Annan, à partir du 1er janvier 2007. Son élection est ressentie parles Coréens comme une reconnaissance internationale de la démocratisation et du développementéconomique de leur pays qui est devenu la 11e puissance économique du monde en quelques décennies. Cediplomate de carrière, homme de consensus, entend mener à bien la réforme de l'O.N.U. et se consacrer à lapaix mondiale.
Séoul entretient avec Washington des rapports fondés sur des accords de sécurité et de coopération. LesÉtats-Unis maintiennent en Corée 29 500 soldats (octobre 2006). Washington, un des premiers partenairescommerciaux de la Corée, ne cesse de faire pression sur Séoul afin que le pays ouvre le marché des produitsagricoles, et respecte la propriété industrielle et intellectuelle. En août 2004, la Corée du Sud a envoyé destroupes (3 700 soldats) en Irak sur la demande des États-Unis.
Roh Moo-hyun prône, comme son prédécesseur, la politique de rapprochement avec la Corée du Nord. Ilsouhaite avoir plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de défense sans pour autant remettreen cause l'alliance. Le gouvernement de Roh réclame le transfert du droit de commandement des opérationsmilitaires, détenu par l'armée américaine stationnée dans le pays depuis la guerre de Corée. Les États-Unissont prêts à le rendre à Séoul entre 2009 et 2012, mais cette demande de Roh est critiquée par les anciensministres de la Défense, par les généraux retraités et par le parti d'opposition Hannara.
Quant aux sanctions liées à l'essai nucléaire de Pyongyang (9 octobre 2006), Washington et Séoul sontd'accord pour appliquer la résolution 1718 de l'O.N.U., adoptée le 14 octobre 2006, mais les autoritéssud-coréennes montrent une certaine réticence à inspecter les navires nord-coréens. Séoul n'introduiracertainement pas les armes nucléaires tactiques sur son sol, mais entend bénéficier du parapluie atomiqueaméricain.
Dans les années 1980, les relations coréano-japonaises étaient envenimées par la falsification del'histoire pratiquée dans les manuels scolaires japonais ; elles le seront ensuite par l'affaire (surgie en 1991)des « femmes de réconfort sexuel » (estimées à 200 000 pour la Corée) envoyées de force dans les campsmilitaires japonais pendant la guerre du Pacifique. En février 1996, le Premier ministre japonais HashimotoRyutaro a revendiqué la souveraineté japonaise sur les îlots Dokdo (Takeshima, Rochers Liancourt) dans lamer du Japon (mer de l'Est). Son propos a provoqué un tollé antijaponais en Corée. Ces îlots, arides etescarpés, sont situés à 87 kilomètres au sud-est de l'île coréenne Ulleung et à 157 kilomètres au nord-ouestde l'archipel japonais Oki. Convaincue que ces îlots lui appartiennent, la Corée les occupe et exerce sasouveraineté effective aux moyens d'une petite garnison de garde-côtes depuis 1953, d'un quai d'accostageinauguré en novembre 1997, et d'un phare habité depuis mars 1999.
Un nouvel accord sur la pêche entre Séoul et Tōkyō, qui doit remplacer celui de 1965 est entré envigueur, le 22 janvier 1999, et a déclenché immédiatement une « guerre du poisson » entre la Corée et leJapon. Malgré ces points épineux, l'ambiance est plutôt à la détente depuis l'arrivée au pouvoir de KimDae-jung, qui a effectué une visite officielle au Japon en octobre 1998. En novembre, le gouvernement deSéoul a ouvert le marché culturel coréen aux films et à la musique japonais. Par ailleurs, la Corée du Sud etle Japon ont organisé conjointement la Coupe du monde de football en 2002 avec succès.
La tension a resurgi sur la question de Dokdo en février 2005 lors de l'instauration du « jour deTakeshima » par le département japonais du Shimane. Cet événement a coïncidé avec la révision desmanuels scolaires au Japon. Dans certains manuels, les atrocités commises par le Japon pendant lacolonisation et la conquête du territoire en Asie du Nord-Est ont été atténuées. La Corée du Sud et la Chinedénonçaient également la visite du Premier ministre Koizumi au sanctuaire Yasukuni qui renferme lescendres des criminels de guerre condamnés par le tribunal international de Tōkyō, parmi deux millions etdemi de soldats japonais morts sur les champs de bataille. Pendant ce temps, les échanges humains etculturels entre les deux pays étaient très intenses. Les feuilletons télévisés sud-coréens ont provoqué, auJapon, un enthousiasme sans précédent pour la culture populaire coréenne (hallyu).

Le Premier ministre japonais Abe Shinzo a entrepris une visite en Chine le 8 octobre 2006 et en Corée duSud le 9, afin de renouer le dialogue au sommet interrompu depuis près d'un an. Le président Roh aentrepris une visite à Pékin le 14 octobre quelques jours après l'essai nucléaire de Pyongyang. Cesrencontres avaient pour but de parler de la question nucléaire de la Corée du Nord.
Avec la Chine, les échanges économiques se développent très rapidement depuis l'établissement desrelations diplomatiques entre Séoul et Pékin en 1992. La culture populaire coréenne y déferle comme auJapon et dans les autres pays d'Asie. La Chine est un pays de prédilection pour la délocalisation desentreprises sud-coréennes. La Chine est le premier pays destinataire des exportations coréennes depuis2003, devant les États-Unis, et le troisième fournisseur de la Corée, après le Japon et les États-Unis. Séoul estdevenu le deuxième pays fournisseur de la Chine après Tōkyō, et le sixième investisseur en Chine.
Au cours des années 1990, les relations franco-coréennes ont été marquées par la visite en Corée, enseptembre 1993, de François Mitterrand, qui fut le premier chef d'État français à se rendre dans ce pays. Leprésident sud-coréen Kim Young-sam effectua une visite en France en mars 1995. La France est, au sein del'Union européenne, le troisième partenaire économique de la Corée, après l'Allemagne et le Royaume-Uni ;les voitures coréennes sont présentes sur le marché automobile français depuis 1992 ; le troisièmeconglomérat coréen, Daewoo, a investi, en 1993, pour construire trois usines (micro-ondes, tubescathodiques) à Longwy, mais elles ont été fermées en 2002.
Les relations économiques entre les deux pays achoppent sur la fourniture des rames de T.G.V. par leconsortium dirigé par G.E.C.-Alstom, qui a été choisi, en août 1993 (contrat signé en avril 1994), moyennantle transfert de technologie, pour la fourniture de 46 rames de T.G.V. de 20 voitures (2,1 milliards de dollars)pour la future ligne Séoul-Pusan (411 km). G.E.C.-Alstom a livré la première rame en mars 1998, mais lestravaux de construction de la ligne ont pris du retard. La mise en service partiel du KTX (TGV coréen) a eulieu le 1er avril 2004, sur le tronçon Séoul-Taegu. Un autre événement marquant dans le domaine decoopération est la prise de contrôle, en avril 2000, de Samsung Automobile par Renault, après celle deNissan. La société Renault-Samsung Motors est un des cinq constructeurs automobiles en Corée du Sud.
Les échanges dans le domaine culturel sont également actifs : la plupart des principales œuvreslittéraires françaises sont traduites en coréen ; un grand nombre de romans coréens sont traduits enfrançais. Le cinéma coréen est très apprécié en France. Les mangas (manhwa en coréens) coréens font unepercée sur le marché français.
En octobre 2010, la Corée du Sud conclut avec l'Union européenne (U.E.) un accord de libre-échange quiprévoit la suppression des droits de douane à compter de juillet 2011. Le texte est qualifié par le présidentde la Commission européenne d'« accord commercial le plus important jamais conclu par l'U.E. avec unpays ». Les modalités de l'accord inquiètent toutefois les constructeurs automobiles européens.
III- Société et économie
La population sud-coréenne est passée de 29,9 millions d'habitants en 1949 à 48,5 (490 hab./km2) en2006, ce qui place la Corée du Sud parmi les pays où la densité de population est la plus forte.L'accroissement démographique a diminué, passant de 1,70 p. 100 en 1975 à 0,44 p. 100 en 2005, ce qui estdû à la diminution des taux de natalité et de mortalité. Mais cela a entraîné le vieillissement de la population.Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 14,4 p. 100 de la population en 2005, contre 5,2 p. 100en 1966.
Face à la croyance, les Coréens observent une attitude syncrétique. Toutes les grandes religions du monde coexistent avec les religions locales. D'après les résultats du recensement de population de 2005, 25 millions de personnes, soit 53,1 p. 100 de la population, déclarent avoir une religion. Le bouddhisme, arrivé au IVe siècle, compte 10,7 millions de fidèles ; le protestantisme, introduit à la fin du XIXe siècle par les missionnaires américains et anglais, 8,6 millions pour ses quatre-vingt-sept sectes. Le catholicisme, connu en Corée dès la fin du XVIIIe siècle et dont l'évangélisation a été confié aux Missions étrangères de Paris par le Vatican dès 1831, totalise 5,1 millions de fidèles. Les autres religions représentent à peine 1 p. 100 de la population. Parmi elles, l'islam, arrivé avec les soldats turcs pendant la guerre de Corée, possède deux mosquées. Les religions autochtones sont Daejonggyo, Cheondogyo, Wonbulgyo (bouddhisme du Cercle). Le

chamanisme est toujours vivant. Les Églises coréennes de toutes confessions mènent activement leurimplantation un peu partout dans le monde, notamment en Mandchourie, en Asie centrale, en Russie. AuxÉtats-Unis, on compte cinq mille huit cents églises coréennes dont la majorité est protestante. Même à Paris,il existe une quinzaine de petites églises coréennes de toutes confessions.
Sur le plan économique, la croissance a été rapide ; le produit national brut s'est accru de façonspectaculaire, passant de 2,8 milliards de dollars (107 dollars/hab.) en prix courants en 1961, à 480 milliards(11e rang mondial, 10 548 dollars/hab.) en 1996, année où les indicateurs économiques étaient à leur niveaule plus élevé. Pendant ce temps, la part des secteurs dans la composition du P.N.B. s'est fortement modifiée.L'agriculture a vu sa part s'abaisser, de 40,1 à 7,7 p. 100 entre 1961 et 1996. En revanche, l'industrie et lamine ont fait un bond spectaculaire, passant de 15,2 à 29 p. 100 ; le tertiaire, de 44,7 à 63,3 p. 100.
Le taux de croissance économique, qui était très élevé (10,5 p. 100 par an en moyenne entre 1966 et1980), est tombé à 7,5 p. 100 en 1981-1985 avant de remonter à 10,7 en 1986-1990. La Corée a réalisé desrecords de croissance économique avec 11,9 p. 100 en 1986, 12,3 p. 100 en 1987 et 12 p. 100 en 1988. Maisle rythme s'est ralenti à 6,9 p. 100 en 1989, 9,5 p. 100 en 1990 et 9,1 p. 100 en 1991. Le taux moyen annuelde la croissance du P.N.B. est de 7,0 p. 100 entre 1992 et 1996.
Cette croissance extraordinaire résulte des six plans quinquennaux de développement économique, dontle premier remonte à 1962. L'accent a été mis d'abord sur les industries légères à intensité de main-d'œuvre(contreplaqué, chaussures, textile, mécanique, électrique), puis sur les industries lourdes, chimiques et latechnologie de pointe à intensité de capital : sidérurgie (Pohang Steel Co., la deuxième plus grandeentreprise sidérurgique mondiale après Nippon Steel), raffinerie, pétrochimie, chantiers navals, électronique,informatique, automobile. Des sites industriels ont été créés un peu partout. Des conglomérats, tels queSamsung, Hyundai, Daewoo, Lucky-Goldstar (LG depuis 1995), Sunkyung (SK Group depuis 1997),Ssangyong, Korea Explosives, Hanjin, Hyosung, jouent le rôle moteur de l'expansion. Les trente plus grandsconglomérats représentent les deux tiers de la production industrielle et de la valeur des exportations, maison leur reproche de monopoliser les crédits bancaires et le marché. Les restructurations et spécialisationsdont ils font l'objet n'ont pas donné grand résultat.
Industrie électronique (Corée du Sud)
Fabrication robotisée de circuits intégrés à Séoul, Corée du Sud.(Mark Segal, Tony Stone Images/Getty)
Afin de financer les plans, il a fallu recourir massivement à la technologie et aux capitaux étrangers, d'oùun endettement chronique. La dette extérieure de la Corée s'est élevée successivement à 1,2 milliard dedollars en 1963, 10,5 milliards en 1976 et 46,7 milliards, soit 56,2 p. 100 du P.N.B., en 1985. Si bien que laCorée était un des quatre pays les plus endettés du monde. Mais, grâce à son excédent commercial en1986-1989, elle anticipa les remboursements, et sa dette fut ramenée à 29,4 milliards de dollars en 1989,avant de remonter à 31,7 milliards en 1990 et à 105 milliards en 1996.
Le montant cumulé des investissements étrangers en Corée est passé de 0,3 milliard de dollars en 1983à 3,2 milliards en 1996, tandis que celui des Coréens à l'étranger a fait un bond de 0,1 milliard de dollars à4,2 milliards pendant la même période.
La Corée étant pauvre en ressources naturelles, son économie dépend fortement du commerceextérieur. Les exportations constituent toujours la priorité. La valeur des exportations est passée, aux prixcourants, de 41 millions de dollars en 1961 à 129,7 milliards en 1996, soit multipliée par 3 163 en trente-cinqans ; celle des importations de 316 millions de dollars à 150,3 milliards, soit multipliée par 475. La Coréeconnut son premier excédent commercial en 1986 avec 3,1 milliards de dollars, et cette situation a duréjusqu'en 1989, lui permettant de dégager un excédent total de 23 milliards de dollars en quatre ans, ce qui adonné un excédent de la balance des paiements encore plus confortable de 31,4 milliards de dollars. Après1990, la tendance s'est inversée. La Corée continue à enregistrer les déficits, sans cesse croissants entre1990 et 1997, dus aux importations excessives d'équipements industriels et de produits de luxe dans uneambiance de surconsommation ; cette situation est générée par l'économie des « bulles », avec l'affluencemassive de capitaux étrangers fluctuant à un taux d'intérêt extrêmement bas.

Le « miracle économique » de la Corée est dû, en partie, au coût salarial très bas et à la main-d'œuvreabondante, « docile » sous des régimes autoritaires, et instruite (le taux d'analphabétisme était de 2 p. 100en 1996). Mais l'économie coréenne a perdu ces avantages depuis la démocratisation survenue le 29 juin1987. S'estimant être les laissés-pour-compte de la croissance économique, les ouvriers ont réclamé tout,tout de suite. Cela s'est traduit par la création des syndicats libres d'entreprise et des conflits sociaux. Lesgrèves ne se sont pas arrêtées entre 1992 et 1996, mais la plus grande a lieu en décembre 1996, lors duvote de la nouvelle loi sur le travail : flexibilité des horaires et non-paiement des jours de grève. La grèvegénérale a été menée principalement par la deuxième confédération des syndicats (K.C.T.U., KoreanConfederation of Trade Union), illégale aux yeux des autorités, avec une participation passive de la F.K.T.U.(Federation of Korean Trade Union), docile au pouvoir, qui existe depuis longtemps. La loi remaniée a étévotée en mars 1997 au mécontentement général du patronat et des syndicats, et les autorités ontfinalement reconnu la K.C.T.U. La hausse des salaires était de près de 13 p. 100 par an en moyenne entre1988 et 1996. Cette hausse continue a permis aux salaires des ouvriers coréens de se situer au niveau leplus élevé parmi les nouveaux pays industrialisés. La durée hebdomadaire du travail dans l'industrie adiminué : de 54,7 heures en 1986 à 46,7 en 1997. Dans le même temps, les entreprises ont perdu leurcompétitivité sur le marché international, ce qui les a poussées à se délocaliser en Amérique, en Europe del'Est, en Asie du Sud-Est, et notamment en Chine.
La crise économique de 1997-1998
À la fin de 1996, les Coréens étaient fiers de voir leur pays se classer au 11e rang mondial en termes deP.N.B., avec un revenu par habitant supérieur à 10 000 dollars. Premier pays pour la production de puces àmémoire, deuxième pour la construction de navires, cinquième pour la construction automobile et laproduction d'acier, la Corée du Sud est enfin devenue, en décembre 1996, le 29e pays de l'O.C.D.E., « clubdes pays riches », et le deuxième membre asiatique (après le Japon) de l'organisation. Le gouvernement deKim Young-sam vantait les mérites de la mondialisation ou la globalisation.
Mais la crise monétaire et financière, partie de Thaïlande, gagna l'Indonésie et toucha de plein fouet laCorée du Sud en novembre et décembre 1997. Au cours de l'été, la Thaïlande avait bénéficié d'un prêtd'urgence du Fonds monétaire international (F.M.I.) de 17,2 milliards de dollars et l'Indonésie de 33 milliards.Jusqu'au moment de l'éclatement de la crise, le gouvernement de Kim Young-sam, ignorant l'ampleur del'endettement réel des entreprises et des banques coréennes, a considéré le prêt d'urgence du F.M.I. commeune humiliation ou une honte nationale. Mais l'endettement extérieur de la Corée (150 milliards de dollars,que les responsables financiers ont sous-estimé à 100 milliards) était tel qu'elle ne pouvait faire autrement.En 1996 et 1997, les conglomérats avaient beaucoup emprunté auprès des banques étrangères pour fairedes investissements démesurés dans le monde entier.
Aucun responsable politique ni aucun institut de recherches n'avaient prévu cette crise qui allait frapperla Corée. Pourtant, il y avait des signes précurseurs : la faillite en série des conglomérats comme Kia(automobile), Hanbo (acier), Jinro (boissons alcoolisées), Dainong (agro-alimentaire), etc., dès le début de1997.
La Corée voit la notation de sa crédibilité baisser ; les capitaux étrangers commencent à quitter le pays dès octobre ; le 8 novembre le krach a lieu à la Bourse de Séoul. La monnaie coréenne, le won, perd la moitié de sa valeur par rapport au dollar en un mois : de 900 wons pour 1 dollar en novembre à 1 900 wons à la fin de décembre 1997. La 11e puissance économique du monde, au bord de la banqueroute, formule sa demande du « plus grand prêt (57 milliards de dollars, le record) » auprès du F.M.I. le 21 novembre, et l'accord est signé le 3 décembre. Ainsi, elle doit se plier aux contraintes imposées par l'organisation financière internationale. Les conséquences de la « tutelle du F.M.I. » sont douloureuses : fermeture des banques non solvables, faillite en série des entreprises, diminution des salaires de 20 à 30 p. 100, accroissement du chômage, dont le taux est passé de 2,5 p. 100 en juillet 1997 à 7,9 p. 100 à la fin de 1998, soit 1,7 million de chômeurs. L'économie coréenne, après avoir connu tout de même une croissance de 4,9 p. 100 en 1997, a enregistré une baisse de sa croissance de 6,9 p. 100 au cours de 1998. Le P.N.B., qui avait atteint 480 milliards de dollars en 1996, est tombé à 437 milliards en 1997, puis à 283 milliards (niveau de 1991) en 1998, avec un revenu par habitant de 6 309 dollars. Cette baisse est accentuée par la conversion en dollars du montant du P.N.B. exprimé auparavant en monnaie coréenne, à la suite de la dépréciation du taux de change du won. Cette crise a mis en lumière les vulnérabilités du modèle de croissance à la

coréenne, fondée sur l'endettement excessif des entreprises, les emprunts massifs à l'étranger et lastructure financière désordonnée.
En 1998, plusieurs grandes banques ont fusionné sous la forte pression du gouvernement. Lesconglomérats sont amenés à se restructurer. Ils s'engagent à réduire d'un tiers le nombre des firmes sousleur contrôle et à baisser leur taux d'endettement au-dessous de 200 p. 100 (au lieu de plus de 500 p. 100en avril 1998), à pratiquer une gestion plus transparente, à ne pas accorder leur garantie aux prêts d'uneautre société au sein du même groupe.
Après l'éclatement de la crise, le taux de change du won est progressivement remonté à 1 500 wonspour un dollar, en mars 1998, puis à 1 150 wons en janvier 1999. Les exportations sont passées de136,1 milliards de dollars en 1997 à 133,2 (dont 2,2 provenaient de la collecte d'or auprès des citoyens) en1998. Dans le même temps, les importations sont passées de 144,6 milliards de dollars à 93,3. L'excédent de39,9 milliards de dollars dégagé en 1998 est dû uniquement à une forte diminution (30 p. 100) desimportations. La réserve monétaire disponible s'élève à 50 milliards de dollars en février 1999 contre6 milliards un an auparavant. Le nombre des emplois proposés commence à augmenter.
Vers une société informatique
Depuis son adhésion à l'O.C.D.E. en 1996, l'économie coréenne s'accroît à un rythme moins rapidequ'avant. En dix ans, son P.I.B. a connu une hausse de 41,3 p. 100, passant de 557,4 milliards de dollars en1996 à 787,5 milliards (11e rang mondial, après l'Inde et devant le Mexique) en 2005. Dans la composition duP.I.B. en 2005, l'agriculture n'occupe que 3,7 p. 100, l'industrie et la mine 29,0 p. 100, les services 67,3 p.100. La Corée du Sud se place parmi les trois premiers pays membres de l'O.C.D.E. en matière de qualité del'enseignement, mais elle est un des derniers pour le bien-être social.
Grâce au redressement rapide de son économie, la Corée du Sud a non seulement remboursé, en août2001, la totalité du prêt qu'elle avait contracté auprès du F.M.I. en novembre 1997, mais a « égalementrenforcé sa position au sein de cette institution en portant sa quote-part dans les droits de vote de 0,76 p.100 à 1,33 p. 100 au début de septembre 2006 lors de la plus grande réforme du F.M.I. depuis sa création en1945. »
La Corée du Sud est un des pays les plus avancés en matière de technologie informatique du point devue du taux d'utilisation d'Internet, du téléphone portable, du DMB (digital multimedia broadcasting) quipermet de regarder la télévision sur le téléphone mobile et dans les transports en commun. Les grandesentreprises comme Samsung, LG, SK, Hyundai Hynix sont les leaders mondiaux en matière de pucesélectroniques, téléphonie mobile, écrans plasma. La Corée du Sud est aussi le premier pays constructeur denavires, avec 34,8 p. 100 du marché mondial en 2005 (29,4 p. 100 pour le Japon et 14,6 p. 100 pour laChine). L'industrie automobile coréenne (Hyundai, Kia, GM-Daewoo, Ssangyong, Renault-Samsung) occupe le5e rang mondial.
Aujourd'hui le salaire des employés des grandes entreprises coréennes est très élevé, mais legouvernement n'arrive pas à juguler le prix des terrains à bâtir et des appartements, lequel continue degrimper pour atteindre une somme vertigineuse. La bipolarisation de la société coréenne s'accélère, encreusant davantage l'écart entre les riches et les pauvres.
(Cf. Corées-Du rapprochement à la défiance.)
Jin-Mieung LI
Bibliographie
Géographie• C. ARMSTRONG, The Koreas, Routledge, Londres, 2006
• C. BALAIZE, La Péninsule coréenne, Nathan, Paris, 1993
• V. GELÉZEAU, Séoul, ville géante, cités radieuses, C.N.R.S. Éditions, Paris, 2003
• V. GELÉZEAU dir., La Corée en miettes. Régions et territoires, no spécial de la revue Géographie et cultures, automne-hiver 2004

• J. PEZEU-MASSABUAU & A. DELISSEN, « La Corée », in R. Brunet dir. Géographie universelle. Chine, Japon, Corée, Belin-Reclus, Paris,1994
• K. POSTEL-VINAY, Corée. Au cœur de la nouvelle Asie, Flammarion, Paris, 2002
• SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE DE LA CORÉE, Corée. Espace et société, Kyohaksa, Séoul, 2005 (trad. F. Boulesteix & Jae-kyong Lee).
Histoire• J. CHARDONNET, Un miracle économique, la république de Corée, France Empire, 1980
• C. DECHAMPS, Fêtes paysannes et culture populaire : la lutte à la corde en Corée, Centre d'études coréennes, 1986
• LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, La République de Corée, mutation et enjeux, 1997
• A. GAUTHIER, Les Pays ateliers d'Extrême-Orient, Singapour, Hong Kong, Taiwan, Corée du Sud, Hatier, Paris, 1981
• V. GEORGHIU, La Corée, la belle inconnue de l'Extrême-Orient à l'heure des jeux Olympiques, Plon, Paris, 1987
• A. GUILLEMOZ, Les Algues, les anciens, les dieux : la vie et la religion d'un village de pêcheurs-agriculteurs, Le Léopard d'or, 1983
• I.R.E.P., La République de Corée, concurrent ou nouveau partenaire ?, Cahier I.R.E.P. (univ. de Grenoble)-Développement, no 11, 1987
• D. KIRK, Korean Dynasty-Hyundai and Chung Ju-Yung, M. E. Charpe, New York, 1994
• KOREAN OVERSEAS INFORMATION SERVICE, A handbook of Korea, Séoul, 1990
• P. W. KUZNETS, Economic Growth and Structure in the Republic of Korea, New Haven, 1977
• M. O. LACAMP, Le Matin calme, Stock, 1977
• R. LELONG, La Corée intime, Table Ronde, 1978
• P. LOROT & T. SCHWOB, Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapour : les nouveaux conquérants ?, Hatier, 1986
• N. LUCA, Le Salut par le foot. Une ethnologue chez un messie coréen, Labor et Fides, Genève, 1997
• E. S. MASON, KIM MAHN-JE, D. H. PERKINS, KIM KWANG-SUK & D. C. COLE, The Economic and Social Modernisation of the Republic ofKorea, Cambridge (Mass.), 1980
• F. MAX, La Corée du Sud, L'Harmattan, Paris, 1984
• E. G. MEADE, American Military Gouvernment in Korea, New York, 1951
• J. MORILLOT, La Corée. Chamanes, montagnes et gratte-ciel, Autrement, 1998
• O.C.D.E., Études économiques de l'O.C.D.E. : Corée, 1994, 1998, 2002
• OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE (ministère coréen de la Planification économique), Han'guk t'onggye yon'gam (Annuairestatistique de la Corée), Séoul
• SEO ICK-JIN, La Corée du Sud, une analyse historique du processus de développement, L'Harmattan, 2000
• B. N. SONG, The Rise of the Korean Economy, Oxford University Press, 1997
• H. H. SUNOO, La Corée du Sud, économie d'une dictature et enjeux démographiques, Publisud, 1988
• R. TESSIER DU CROS, Les Coréens, frères séparés, L'Harmattan, 1990
• YONHAP NEWS AGENCY, Korea Annual, Séoul.