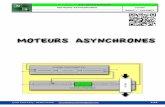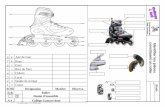Ci3
-
Upload
las-de-pique -
Category
Documents
-
view
7 -
download
1
description
Transcript of Ci3
Fiche de prsentation
109
Cration de Richesses en Contexte de Prcarit: lExprience de lAfrique de lOuest
Cahier collectif
Yao Assogba, Habiboullah Kane, Sambou Ndiaye, et
Youssouf Sanogo
Sous la direction de Louis Favreau
Version provisoire
Cahiers de la Chaire de recherche du Canada en dveloppement des collectivits (CRDC)
Srie Comparaisons Internationales Nord-Sud et Sud-Sud No. 3
ISBN:2-89251-153-4
Universit du Qubec en Outaouais
Mai 2003
ii
Table des matires
Table des matiresii
Avant-propos5
partie I: volution du dveloppement local et de l'conomie sociale et populaire au mali
1.Introduction12
2.Prsentation du Mali13
3.Cadre danalyse: la systmique14
4.Faits majeurs et tendances des politiques de dveloppement du Mali15
4.1.Les interventions des structures de ltat15
4.1.1.Faible respect des logiques et proccupations locales15
4.1.2.Divergences de visions, crise socioconomique et politique, multiplication des initiatives pour plus dautonomie, non-ralisation du dveloppement souhait.19
4.2.Interventions des organisations non gouvernementales (ONG) et actions inities par les populations 21
4.2.1.Grande considration accorde aux proccupations locales, baisse du monopole de ltat sur le secteur du dveloppement, responsabilisation des communauts, multiplication des initiatives dconomie sociale.22
5.Approfondissement de la comprhension de lvolution du dveloppement local et de lconomie sociale au Mali27
6.Proposition de pistes damlioration29
7.Conclusion30
8.Rfrences31
partie II: conomie sociale et dveloppement local en mauritanie
Prsentation gnrale35
I- Des politiques publiques de dveloppement aux stratgies de lutte contre la pauvret:36
1 volution des politiques publiques de dveloppement36
2. Les stratgies de lutte contre la pauvret38
2.1Commissariat aux droits de lHomme, linsertion et la lutte contre la pauvret38
2.2 La mise en place dun Cyber-forum39
2.3 Les Caisses populaires dpargne et de crdit (CAPEC)40
2.4. Cration des centres de formation41
II- Les diffrentes formes dinitiatives conomiquespopulaires:42
1. La tontine comme modle de micro finance informelle.42
2. Les coopratives dhabitat ou TWIZA45
3. Le rle de la diaspora mauritanienne46
4. Les autres initiatives conomiques populaires47
III. Rsultats des initiatives conomiques populaires47
IV Les politiques publiques (nationales ou internationales) vis vis des initiatives conomiques populaires.48
V. Conditions de dveloppement des initiatives conomiques et populaires50
CONCLUSION51
BIBLIOGRAPHIE52
partie III: conomie populaire et dveloppement local au sngal: tat des lieux et perspectives
Introduction55
A) Les initiatives conomiques populaires au Sngal.56
I- Contexte dmergence et dvolution des initiatives conomiques populaires56
II-Typologie des initiatives conomiques populaires59
III- Porte et Dfis des initiatives conomiques populaires62
B) Caractrisation du processus de dveloppement local au Sngal65
I- Lvolution du local au Sngal66
II- Le cas de Saint- Louis du Sngal68
III- Enseignements des processus de dveloppement69
C)- conomie populaire et Dveloppement local, lments de base dun nouveau contrat de socit territorialis.71
Conclusion75
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE76
partie IV: volution du dveloppement local et de l'conomie sociale et populaire au Togo
1.Introduction81
2.Prsentation du Togo82
3.Les actions de dveloppement local au Togo83
3.1.Les actions inities par ltat83
3.1.1.Pratiques autour du caf, du cacao et du coton83
3.2.Les actions impliquant les organisations non gouvernementales (ONG)85
3.2.1.La FUCEC86
3.2.2.Projet dappui aux mutuelles de crdit-pargne au Togo88
3.2.3.Projet hydraulique villageoise: PHV-CUSO89
3.3.Les actions inities par les populations90
3.3.1.Les Nana Benz90
3.3.2.Les banquiers ambulants92
3.3.3.La tontine mutuelle94
3.3.4.Les taxis-motos96
3.3.5.Groupe de rflexion et daction femmes dmocratie et dveloppement (GF2D)97
4.pilogue97
5.Proposition dalternatives98
6.Conclusion99
7.Rfrences101
Annexe A- Programme de recherche Cration de richesses en contexte de prcarit, comparaisons Nord-Sud et Sud-Sud:103
Schma directeur pour la production de monographies nationales compares103
ANNEXE: B - PROGRAMME DU SMINAIRE DES 7 ET 8 MAI106
Avant-propos
La comparaison Nord-Sud et Sud-Sud en conomie sociale et en dveloppement local est-elle faisable, viable et pertinente ?
1. La comparaison internationale: une question sociopolitique, surtout la comparaison Nord-Sud
Le Qubec, socit du Nord, disposant de toutes les caractristiques de ces socits, est-il comparable des socits du Sud comme, par exemple, le Mali, la Mauritanie ou le Sngal? Ces pays occupent le 164e, le 135e et le 154e rang des pays du monde en vertu de lIDH (indice de dveloppement humain du PNUD) alors que le Canada est au 3e rang (il a dj t au premier rang). Le Qubec ne doit pas tre tellement loin et figure certainement dans les 10 ou 12 premiers rangs ct de la France ou des tats-Unis. premire vue, la diffrence est trop forte pour supporter la comparaison. De plus, moralement parlant, certains pourraient sindigner. Dans des discussions improvises sur ce sujet, deux commentaires du mme ordre mont t adresss cet effet. Le premier venait dun Argentin avanant que les problmes de dveloppement de lArgentine sont sans commune mesure avec ceux du Canada ou du Qubec, le second provenant dun Sngalais nous affirmant que lconomie sociale des pays du Nord ne reprsente tout au plus que 10% de lconomie gnrale. Elle navait donc ses yeux que peu de choses voir avec lconomie populaire prvalente en son pays car celle-ci doit bien reprsenter quelque 90% de lconomie gnrale. Il convient donc de sarrter quelque peu sur cette question pose sous son angle sociopolitique.
La mondialisation en cours a ceci de positif. Si dun ct, elle met en vidence les ingalits et les diffrences culturelles trs importantes entre les populations de la plante, elle nous permet par ailleurs de voir se dessiner des problmes communs: la revitalisation de quartiers en difficult, lcologie urbaine, lemploi, le transport collectif, lhabitat et la sant, lducation et les services sociauxsont des problmes similaires mme sils nont pas la mme ampleur et la mme densit.
Il faut surtout ajouter quil existe des pratiques communes de transformation sociale de nos socits quelles soient du Nord ou du Sud. Nest-ce pas le cas historiquement du syndicalisme tant au Nord quau Sud. Les diffrences sociales entre le Nord et le Sud ont-elles conduites la cration spare dorganisations exclusivement du Nord et exclusivement du Sud. Plutt le contraire! Le mouvement syndical a tout fait pour se donner des organisations vritablement internationales. Le mouvement coopratif avec lAlliance cooprative internationale a fait de mme. Il ne sagit pas de nier les diffrences mais de les surpasser lintrieur de dispositifs internationaux qui se disent et se veulent rciprocitaires mme si la chose ne relve pas de lvidence. En tmoignent aujourdhui le Forum social mondial et les nombreux rseaux internationaux dONGD, dentreprises et dorganisations dconomie sociale et solidaire, de dveloppement local. Sans compter linterdpendance croissante des socits qui lgitime encore plus le renforcement de la connexion Nord-Sud.
Finalement, il faut aussi rendre compte des nouvelles dynamiques en cours: laide au dveloppement fait de plus en plus place la solidarit internationale et la cration de rseaux internationaux de dbat, de rflexion et dengagements dans de nouvelles stratgies daction collective cette chelle o gens du Nord et gens du Sud cherchent se sonner des espaces de dialogue interculturels et des espaces dchanges conomiques nouveaux (le commerce quitable en est un). Dans cette perspective, le simple reprage conjoint dinitiatives conomiques populaires innovatrices ici et l, au Nord et au Sud, constitue dj une tche politique et scientifique disposant dune bonne capacit de dmonstration et de mobilisation. Parce quil vient illustrer quune autre mondialisation merge simultanment au Nord et au Sud et que celle-l travaille rendre la plante plus quitable.
Nous savons, comme chercheurs et comme intervenants, que ce nest videmment pas suffisant de sen tenir l. Il faut rassembler des expriences et les analyser, ce qui offre, nos yeux, un trs bon moyen de faire avancer le mouvement gnral mergeant de lconomie sociale et solidaire de par le monde. Car lanalyse offre la possibilit de la mise en perspective favorisant ainsi, par del les diffrences de pays, de culture et de continent, des convergences, des lignes de force communes. Tout cela finit par pouvoir inspirer, voire mme donner lieu de nouveaux projets dautres acteurs un peu partout de par le monde autour notamment de trois enjeuxet de trois dynamiques trs actuelles en matire de relations entre le Nord et le Sud: celle du dveloppement local conduisant celle de la dmocratie locale et participative et celle la coopration dcentralise. Pourquoi ces enjeux en particulier? Cest que, au Nord comme au Sud, le cheminement de beaucoup de praticiens et de chercheurs engags dans des initiatives de dveloppement local et de la nouvelle conomie sociale est, la plupart du temps, le fait de gens qui ont travaill dans des quartiers dlaisss par le dveloppement conomique dominant. Ce faisant, nous tions mme de voir que cela conduisait dcouvrir des logiques socioconomiques et institutionnelles sur lensemble de la ville et donc den arriver poser la question gnrale de la gestion urbaine avec ses problmes demploi, dhabitat, de transport collectif, dquipements socioculturels mais aussi ces problmes de citoyennet urbaine et donc de dmocratie locale et de formes nouvelles de gouvernance dvelopper. Bref, un certain nombre dentre nous sommes passs de lorganisation communautaire de quartiers dits dfavoriss une participation lorganisation de la dmocratie urbaine, conviction fonde sur des expriences du Sud comme du Nord.
2. La comparaison internationale: une question scientifique
Pourquoi Nord-Sud si on pousse un peu plus loin la rflexion? Parce que, par l, il y a la possibilit de vrifier de manire empirique comment les problmes et les contraintes socio-conomiques sont vcus autrement ailleurs que dans les pays du Sud dune part mais aussi de trouver rponse un autre type de questions plus importantes encore: quelles sont les marges de manuvre et les stratgies des acteurs dans un environnement politique et social plus favorable, o le niveau de dmocratisation est plus volu que dans les pays du Sud? Quelle est la porte dinitiatives conomiques populaires de cration de richesses et les conditions de sa redistribution lorsquelles se ralisent dans un cadre politique et conomique plus institutionnalis, comme cest le cas en Europe (Belgique, France et Suisse) et au Canada, pays au cur du bassin de la richesse mondiale. Quelles sont galement les nouvelles avenues de coopration Nord-Sud? Une meilleure connaissance des dynamiques propres de dveloppement des pays du Sud et du Nord peut favoriser des formes de coopration Nord-Sud plus appropries.
Pourquoi Sud-Sud? Comme nous laffirmons dans notre projet de recherche (Fall et Favreau, 2002), la prise en compte des facteurs tels que les caractristiques et dterminants de la pauvret, les liens entre la croissance et les programmes dajustement structurel (PAS), les volutions dmocratiques et les mouvements de la socit civile, permet didentifier des similitudes dans lorganisation socio-conomique de pays de lAfrique de lOuest et de lAmrique latine car ces pays se caractrisent gnralement par des externalits trs fortes, en particulier leur dpendance par rapport aux conomies modernes mondiales europennes et amricaines sous le contrle permanent de la Banque Mondiale et du FMI.
Cette question de la comparaison Nord-Sud et Sud-Sud en appelle donc une autre: celle de la recherche transnationale en sciences sociales (Oyen, 2001). Quon le veuille ou non, les deux premiers obstacles auxquels nous faisons face en sciences sociales lorsquil sagit dtudier lconomie sociale et le dveloppement local sont les suivants: 1) les frontires nationales demeurent encore prvalentes dans la trs grande majorit des travaux en sciences sociales y compris dans les conceptualisations qui se veulent les plus gnrales Par exemple lapproche de la rgulation comme celle de lconomie sociale et solidaire ont bti leur thorie dans le cadre de socits o ltat social est trs dvelopp et o le travail qui prdomine est trs majoritairement salari. Ces approches se heurtent au Sud la prvalence dun travail qui nest pas un travail salari (travail indpendant dans le cadre dune conomie dite informelle) et des tats trs peu dvelopps du point de vue des transferts sociaux.; 2) la recherche en sciences sociales sur des sujets qui traitent des questions de dveloppement comme la ntre est aussi largement domine par des projets court terme souvent hgmoniss par des botes de consultants en gestion qui produisent des tudes de cas senses tre des best practices mais sans quaient t examines plus fond les conditions dmergence et de dveloppement de ses pratiques, cest--dire les systmes dacteurs, les diffrents types de partenariat prsents, les diffrents types de financeurs, les diffrentes approches (stratgies et thories) de dveloppement sans compter les liens avec les conditions sociopolitiques gnrales des pays.
Il faut des activits de recherche plus globales, de moyen et de long terme, car le dveloppement aujourdhui, avec la mondialisation de la culture comme de lconomie et de la politique, posent de faon diffrente de vieux problmes tel le dcollage industriel dun pays par exemple et de nouvelles questions tels limpact social des migrations du Sud au Nord, leffet de retour de flux financiers de ces migrations sur les communauts dappartenance au Sud, le dveloppement des conomies locales sans investissement priv externe... Nous sommes encore bien mal quips pour faire ce type de recherche En dpit defforts louables dans certaines institutions internationales comme le projet MOST lUNESCO ou le programme scientifique de lutte contre la pauvret par lconomie sociale (STEP) au Bureau international duTtravail (BIT) ou dans certains centres de recherche comme le Centre de recherche en dveloppement international (CRDI). . Plus spcifiquement, la contribution de cette nouvelle srie de cahiers dits de comparaison Nord-Sud et Sud-Sud la CRDC cherchera combler le vide notamment par nos travaux de recherche portant sur la cration de richesses en situation de prcarit, et cela, dans des contextes culturels fort varis: que veut vraiment dire dvelopper des entreprises sociales et solidaires et faire du dveloppement local dans des pays comme le Mali, le Prou, le Qubec pour ne citer que ces pays? Ce qui nous conduira, dans les premiers textes de cette srie, des monographies nationales de lconomie sociale et du dveloppement local en Afrique de lOuest (Mali, Mauritanie, Sngal, Togo), puis vers des monographies nationales en Amrique latine (Brsil, Chili, Prou) et vers des tudes sur la coopration internationale dcentralise de la Belgique, du Canada (Qubec), de la France et de la Suisse.
Voil pourquoi ce texte, comme les autres qui suivront dans le cadre de cette nouvelle srie initie par la CRDC et intitule comparaisons internationales Nord-Sud et Sud-Sud, s'inscrit dans le cadre dune programmation transnationale de recherche dont le thme est Cration de richesses en contexte de prcarit. Ce programme est initi et co-dirig par Abdou Salam Fall (IFAN/Sngal) et Louis Favreau (CRDC/Canada). Il se veut un programme de recherche transnational runissant des quipes de recherche dAmrique latine, dAfrique, dEurope et du Canada. Ce programme, qui a un cadre comparatif Nord-Sud et Sud-Sud, porte sur: 1) les pratiques de cration de richesses par lconomie populaire, sociale et solidaire; 2) les gouvernances locales, cest--dire les diffrents formes de collaboration entre associations, ONGD, gouvernements locaux et PME/PMI pour favoriser le dveloppement. En voici la proposition centrale:
Programme de recherche cration de richesses en contexte de prcarit
L'rosion des compromis sociaux et des types dominants de rgulation conomique et sociale qui ont constitu la base des modles de dveloppement de l'aprs-guerre tant au Sud qu'au Nord constitue le cur de la crise actuelle. C'est dans cette mouvance gnrale que les mouvements sociaux ont commenc (recommenc) occuper et crer un espace d'innovation et de transformation sociale au cur de la crise. Ce qui nous amne formuler dans ce cadre comparatif Nord-Sud et Sud-Sud partir de cette hypothse gnrale quatre propositions:
la cration de richesses par l'conomie populaire, sociale et solidaire devient de plus en plus importante dans le nouveau paysage conomique et social mondial. Une partie de la monte d'une socit civile l'chelle mondiale se caractrise par une rsistance la mondialisation nolibrale;
une partie de cette socit civile, moins visible, a merg. Elle est faite de crateurs de richesse inscrits dans lconomie populaire, lesquels sont devenus de nouveaux acteurs collectifs de dveloppement;
cette production de richesses sinscrit dans le local qui est un nouveau local. Il ne s'agit ni d'un dveloppement local par en haut (issu de laide internationale), ni d'un dveloppement par en bas de type alternatif. Il met contribution des acteurs multiples rpondant des logiques dactions diverses. Cette cration de richesses par lconomie populaire obit surtout une logique mixte plutt qu une logique strictement conomique car lconomique est enchss dans le social;
ce nouveau local et cette conomie populaire, sociale et solidaire sont susceptibles d'ouvrir de nouvelles voies au dveloppement et la dmocratisation du dveloppement. Les btisseurs de cette conomie populaire sont surtout des acteurs qui adhrent des idaux et des valeurs de groupe (russite conomique et sociale collective).
LOUIS FAVREAU, titulaire
Chaire de recherche du Canada en dveloppement des collectivits (CRDC)
Universit du Qubec en Outaouais (UQO)
VOLUTION DU DVELOPPEMENT LOCAL ET DE LCONOMIE SOCIALE ET POPULAIRE AU MALI
Par
Youssouf SANOGO
Note sur lauteur:
Youssouf SANOGO est du Mali, o il a travaill dans le domaine de la formation pour le dveloppement rural. Il a termin ses tudes doctorales, en 2001, en Technologie ducative l'universit Laval. Sa thse a port sur l'ducation communautaire. Depuis novembre 2002, il est stagiaire post-doctoral la Chaire de recherche du Canada en dveloppement des collectivits (CRDC) lUniversit du Qubec en Outaouais.
12
1.Introduction
Cette tude porte sur le dveloppement local et lconomie sociale et solidaire au Mali: caractristiques, volution, difficults. Elle sinscrit dans le projet de recherche Cration de richesses en contexte de prcarit, une comparaison Nord-Sud et Sud-Sud (Fall et Favreau, 2002). Dans ce cadre, elle est une tentative de faire ltat des lieux des activits menes dans ces deux domaines, de cerner les conditions qui pourraient entraver ou faciliter la cration de richesses dans les communauts maliennes et, au besoin, proposer des pistes damlioration.
Le dveloppement local et lconomie sociale et solidaire sont deux domaines troitement lis. En effet, Defourny et Develtere (1999) prsentent lconomie sociale comme un ensemble dactivits mises en uvre par des populations organises lchelle locale, selon une thique axe essentiellement sur le social et les principes dmocratiques. Ces activits, ainsi organises, prennent en compte les proccupations du milieu et contribuent au dveloppement local qui, soutient Leclerc (2002), nest pas une chasse garde dun secteur quelconque. Il est aussi la runion dans une action commune des efforts du secteur priv, du secteur public et de lconomie sociale, dont les acteurs doivent se concerter pour tirer le maximum de potentiel physique, conomique, social, culturel et environnemental de leur milieu.
Cependant, les organisations et activits de lconomie sociale et solidaire et de dveloppement local tant le fait du groupe ou de la communaut, elles ne sauraient chapper linfluence des schmas socioculturels des membres initiateurs. Et cela confre aux actions menes un caractre relatif, imprvisible, donc complexe. Cette ralit est encore plus remarquable dans les pays du sud, comme le Mali, o lconomie informelle est encore prpondrante.
Dans cette tude, nous portons une attention particulire au caractre complexe des activits de dveloppement local et dconomie sociale qui, pensons-nous, est li la relativit du contexte et des logiques, stratgies et proccupations locales. Elle comporte huit parties. Aprs lintroduction, nous faisons une brve prsentation du Mali et du cadre danalyse utilis dans cette tude. Nous abordons ensuite la section des faits majeurs et tendances des politiques de dveloppement. Quelques expriences innovantes de dveloppement local et dconomie sociale y sont dcrites. Suivent ensuite lapprofondissement de la comprhension de lvolution des actions de dveloppement local et dconomie sociale, les propositions de pistes damlioration, la conclusion et les rfrences bibliographiques.
2.Prsentation du Mali
La rpublique du Mali peut se prvaloir de lune des dmocraties les mieux russies de lAfrique Nous abordons plus loin lavnement de la dmocratie multipartite au Mali., dune culture riche et varie, hrite dun pass historique glorieux encore chant par les griots. Dailleurs, sa dmocratie, en particulier, fait de lui un pays fort apprci sur le plan international. Lenvironnement sociopolitique y est donc propice lmergence et la consolidation des activits dconomie sociale et de dveloppement local. Nous y reviendrons tout le long de cette tude.
Situ au cur de lAfrique de louest, le Mali couvre une superficie denviron 1 240 000 km2. Cest un vaste pays sahlien enclav, limit au nord par la Mauritanie, au sud par le Burkina Faso et la Cte dIvoire, lest par le Niger et lAlgrie, et louest par la Guine Conakry et le Sngal. Plus du tiers du territoire est occup par le dsert Saharien au nord, pendant que la partie sud reoit une moyenne de 600 mm deau par an.
En 2001, sa population tait estime 11 700 000 habitants, soit environ 70% vit en milieu rural Voir site: http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/webcountry.nsf/VLUDocFr/MALI-Faitsetchiffres. Travers par les deux plus grands fleuves de lAfrique occidentale (le Niger et le Sngal), le Mali connat une agriculture riche et varie, mais constamment soumise aux alas climatiques. Nanmoins, il reste le deuxime producteur africain du coton et occupe galement le troisime rang lchelle du continent pour sa production dor. Le secteur agropastoral (coton, riz, fruits et lgumes, produits de cueillette, btail) et le secteur minier (production de lor) constituent les deux piliers de lconomie nationale Voir site: http://www.izf.net/izf/Guide/Mali/Page1.htm.
Cependant, en 1980, le rapport sur le dveloppement dans le monde de la Banque mondiale (cit par Ciss et al., 1981, p. 9) classait le Mali parmi les six pays les plus pauvres de la rubrique pays faible revenu. En 2000, il tait encore 164e sur 173 pays sous la rubrique indicateur de dveloppement humain Voir galement: http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/webcountry.nsf/VLUDocFr/MALI-Faitsetchiffres. Et depuis 1985, le pays est soumis aux diffrents programmes dajustement structurel, tablis avec le Fonds montaire international (FMI) et la Banque mondiale.
Ces dernires annes, lon semble unanime sur un certain boom socioconomique du pays, qui voit galement une multiplication des initiatives innovantes de dveloppement local et dconomie sociale. Aux dernires nouvelles, il aurait enregistr une croissance conomique moyenne de 5% contre 3% pour toute lAfrique Selon lAFP du 03 avril 2003: Le FMI satisfait de la situation financire du Mali;
site: http://www.izf.net/izf/AFP/francais/topics/mali/030403181548.ukachqxv.html. Les conditions socioconomiques restent cependant trs pauvres et prcaires au sein des communauts, surtout dans les villages.
3.Cadre danalyse: la systmique
La systmique a servi de cadre thorique et mthodologique cette tude sur le dveloppement local et lconomie sociale au Mali. Son utilisation se justifie par le caractre complexe des situations problmatiques lies ces deux domaines. Elle se rvle un outil prcieux pour obtenir une comprhension globale et profonde de lvolution des actions menes et des facteurs dterminants pour la cration des richesses en contexte de prcarit.
Sur la base dune revue de littrature sur le dveloppement local et lconomie sociale et solidaire au Mali, nous avons utilis une forme adapte du modle systmique de Goodman et Karash (1995) Ces deux auteurs sont du groupe de consultation en pense systmique de Innovation Associates, Inc. (Framingham, MA, tats-Unis dAmrique). Leur modle permet daller au-del des faits et des tendances qui se dgagent des situations problmatiques pour lucider leurs causes profondes. pour comprendre davantage les politiques de dveloppement mises en uvre depuis lindpendance de ce pays en 1960. Nous avons ainsi pu:
identifier les faits majeurs et les tendances qui caractrisent ces politiques selon le type dinterventions: dabord les interventions des structures de ltat, ensuite les interventions des organisations non gouvernementales (ONG) et les actions inities par les populations elles-mmes. partir de l, approfondir notre comprhension de lvolution des diffrentes activits de dveloppement menes. proposer des pistes damlioration.
Voyons dabord les faits majeurs et leurs tendances dans les diffrentes politiques de dveloppement du Mali.
4.Faits majeurs et tendances des politiques de dveloppement du Mali
Les faits majeurs relevs dans les crits et leurs tendances sont ici prsents selon les trois rpubliques qua connues le Mali depuis son indpendance, le 22 septembre 1960. La premire, de tendance socialiste, est celle du premier prsident, Modibo Kta, qui dirigea le pays de 1960 1968. La deuxime est celle du rgime militaire du Gnral Moussa Traor, de 1968 1991. La troisime, lactuelle, commena en 1991. De type dmocratique et libral, elle est dirige par le Gnral Amadou Toumani Tour, deuxime prsident lu aprs Alpha Omar Konar (1992-2002).
Deux catgories dinterventions se dgagent: la catgorie des interventions faites par les structures de ltat et la catgorie des interventions des organisations non gouvernementales et des actions inities par les populations.
4.1.Les interventions des structures de ltat
Les interventions des structures de ltat que nous avons retenues touchent surtout le domaine du dveloppement rural. Diverses tendances les caractrisent: faible respect des logiques et proccupations locales, divergences de visions entre populations locales et agents de ltat, crise socioconomique et politique, multiplication des initiatives pour plus dautonomie, non-ralisation des objectifs de dveloppement fixs.
4.1.1.Faible respect des logiques et proccupations locales
Les interventions pour le dveloppement rural, effectues par les structures de ltat, ont volu dune rpublique lautre. Mais en dpit de cette volution, les pratiques sur le terrain restent domines par le peu de respect accord aux logiques, stratgies et proccupations des communauts locales. En fait, au-del des discours officiels, tout se passe comme si le pouvoir public devait dcider la place des producteurs ruraux. Le privilge est gnralement accord aux recettes et dcisions technocratiques, manant des structures hirarchiques. Les points de vue des populations sont le plus souvent banaliss. Certes, il arrive que les agents les coutent, mais leurs dolances restent lettres mortes; du moins elles ne sont prises en compte que si elles ne drangent point les orientations officielles. Les communauts sont, de facto, contraintes de suivre les consignes des encadreurs.
Cependant, en dpit de la tendance gnrale des interventions des structures de ltat, il existe bien des diffrences entre les trois rpubliques:
a.Le dveloppement rural sous la premire rpublique: 1960-1968
Les actions de dveloppement sous le rgime de Modibo Kta taient marques par loption socialiste du rgime (Ciss et al., 1981). Lon sengagea dans un cadre dconomie nationale socialiste planifie, avec pour consquences: la rigidit des structures tatiques mises en place, la forte hirarchisation, le monopole dtat sur le secteur rural et la trs faible association des populations la conception des activits.
Les populations taient contraintes de sorganiser en coopratives. Chaque village avait sa cooprative, charge essentiellement de lorganisation des travaux collectifs dintrt commun, notamment la culture dune parcelle collective dont le produit devait servir lachat dquipements et de fournitures. Lensemble des structures de dveloppement rural mises en place obissait un encadrement trs hirarchis. Animes et contrles par le parti, ces structures devaient servir dassise pour le socialisme malien.
Les paysans ntaient pas libres de vendre leurs produits qui ils voulaient. Ltat dtenait un contrle, sans partage, sur lensemble des secteurs de lconomie nationale, dont la commercialisation des produits agricoles. Des organismes de commercialisation furent crs cet effet : la SOMIEX et lOPAM. Cre en 1961, la SOMIEX (Socit malienne dimportation et dexportation) disposait du monopole sur lexportation des produits agricoles et sur limportation des produits de consommation. Quant lOPAM (Office des produits agricoles du Mali), il tait dabord lOffice des crales, fruits et lgumes, cr ds 1959 avec laccession du Soudan Soudan: nom colonial du Mali. Ce nom fut abandonn lindpendance du pays, le 22 septembre 1960, pour le prsent nom, plus originel. lautonomie interne. Devenu OPAM en 1965, il avait pour tche essentielle la rgulation du march cralier: monopole dachat et de vente sur les crales; drainage des produits agricoles vers les rgions dficitaires.
Cette politique verticale du rgime socialiste tait trs peu apprcie par les producteurs agricoles, dont les produits taient en plus achets vils prix, pour assurer un certain quilibre financier national.
b.Le dveloppement rural sous la deuxime rpublique: 1968-1991
Le rgime dirig par le Gnral Moussa Traor de 1968 1991 mit un peu de souplesse dans la politique socialiste de Modibo Kta, mais accorda lui aussi peu de respect aux proccupations, logiques et stratgies locales. Il opta pour une conomie nationale planifie dans un cadre de centralisme dmocratique (Diarrah, 1990). Sur le plan du dveloppement rural, il y eut de nouvelles orientations conomiques: dabord avec le programme triennal de redressement conomique et financier (1969-1972), ensuite avec le plan quinquennal de dveloppement conomique et social (1974-1978) (Kb, 1981; Dembl, 1981). Comme sous le rgime socialiste, lagriculture devait continuer servir de base au dveloppement national. Loption des coopratives fut garde, quand bien mme les paysans taient dsormais libres dy adhrer ou pas. LOPAM et la SOMIEX continurent fonctionner. La politique de prix dachat des produits agricoles ne changea pas non plus. Les seuls changements significatifs furent la cration des Oprations de dveloppement rural (ODR) et des Associations villageoises (AV).
Les Oprations de dveloppement rural (ODR) constituaient la pice matresse de la politique de dveloppement rural du rgime militaire. Elles furent cres et organises par lordonnance CMLN du 24 mars 1972, qui les dfinissait comme des organismes publics caractre technique, dots de lautonomie financire et de gestion, chargs de coordonner et dutiliser rationnellement les moyens ncessaires lexcution des programmes de dveloppement rural. Elles sont finances par le budget de ltat, par les ressources extrieures, par diverses redevances et taxes et par les recettes de leurs activits (Sanogo, 1989, p. 91). En milieu rural, elles devaient assurer la vulgarisation technique, lapprovisionnement des paysans en intrants agricoles et la distribution du crdit agricole. Dans certains cas, elles se voyaient confier la commercialisation du produit agricole.
Mme si elles pouvaient tre confies une socit dintervention, toutes les ODR devaient tre sous la tutelle du ministre charg du dveloppement rural; ce qui leur donnait une dpendance absolue du pouvoir central. Au moins 24 oprations de dveloppement furent cres: entre autres, la CMDT (Compagnie malienne de dveloppement de textiles) charge de la promotion de la culture et de la commercialisation du coton dans les rgions sud du Mali, lopration riz Sgou et lopration th Sikasso (Diarrah, 1990, p. 109).
Trs tt, cette nouvelle formule montra, son tour, ses faiblesses en dveloppement rural. Obnubiles par les intrts plutt conomiques et essentiellement axes sur la promotion de cultures de rente (coton, arachide, riz), les oprations de dveloppement contribuaient trs peu la croissance des cultures vivrires. Cette carence se dclara au grand jour la grande scheresse de 1973: 38% de sinistrs, 2/5 du cheptel dcims, production vivrire rduite 37%, pche perturbe (Jacquemot, 1981).
Cette situation dramatique motiva l'introduction de l'approche de Dveloppement rural intgr (DRI) dans les ODR, dans le plan quinquennal de dveloppement conomique et social (1974-1978). Lapproche DRI devait permettre daller dsormais au-del de la promotion des seules cultures de rente, en intgrant non seulement les cultures vivrires mais aussi toutes les activits touchant la vie socio-conomique des producteurs ruraux (Sanogo, 1989, p. 94-95).
Cest ce changement de principes d'intervention rurale de l'tat, impliquant une politique de rapprochement des structures d'encadrement aux producteurs, qui aboutit la cration des associations villageoises. Celles-ci, encore appeles tons L'association villageoise est galement appele "ton" en langue bamanan. Au pluriel, on dit "tonw". villageois, sont des groupements volontaires des habitants d'un mme village en vue de l'excution et de la prise en charge de certains investissements caractre communautaire (Sanogo, 1989, p. 100). Elles sont la fois des instruments de dveloppement et des groupements de dfense des paysans (Dombrowsky et al., 1993). Chaque association a un bureau form de responsables villageois, qui sont confies certaines fonctions de base: approvisionnement du village en moyens de production en assurant la dtermination des besoins, la commande, le stockage et la distribution; octroi et gestion des crdits agricoles; commercialisation primaire des produits agricoles et leur livraison aux usines dgrenage.
En dpit de toutes ces rformes, les rsultats obtenus furent en de des objectifs viss travers loption du dveloppement rural intgr. Dans la zone CMDT, o les associations villageoises sont plus nombreuses, les structures restent trs hirarchises et infodes la direction gnrale situe Bamako. Au lieu dvoluer vers leur propre autonomie, les paysans sont plutt amens uvrer dans le sens des objectifs conomiques viss par lODR. Alors, ils se plaignent constamment des pratiques de la CMDT, de la ngligence de leurs dolances dans la fixation des prix dachat du coton et du faible respect de leurs proccupations relles (Dombrowsky et al., 1993).
c.Le dveloppement rural sous la troisime rpublique: de 1991 nos jours
La troisime rpublique se distingue par son caractre dmocratique et libral. Mais elle na pas encore russi liminer la banalisation des proccupations locales dans les pratiques de dveloppement rural des structures de ltat. La politique des oprations de dveloppement continue, celle des associations villageoises aussi, en dpit des problmes qui se dgagent ici et l dans le monde rural.
Cependant, elle a fait des changements majeurs, dont la dcentralisation politique et conomique qui responsabilise davantage les communauts dans la prise en charge de leur propre dveloppement. Et depuis deux ans, un vaste programme de lutte contre la pauvret et lexclusion sociale est en cours. Ces changements pourraient, notre avis, favoriser lintgration des proccupations, logiques et stratgies locales des populations rurales dans les projets de dveloppement mis en uvre par les structures tatiques. Mais cela reste voir.
4.1.2.Divergences de visions, crise socioconomique et politique, multiplication des initiatives pour plus dautonomie, non-ralisation du dveloppement souhait.
Lignorance ou la ngligence des proccupations locales a cr une crise de confiance entre paysans et agents de ltat. Gnralement infantiliss et trs peu couts, les paysans restent globalement insatisfaits des pratiques de dveloppement rural sur le terrain. Leurs visions divergent de celles des intervenants; ils napprcient surtout pas le caractre drisoire des prix dachat fixs pour leurs produits agricoles. Cette situation, entre autres, fut la base de beaucoup de crises socioconomiques dans le monde rural: grognes, jacqueries, exode rural, migration vers des pays voisins et, en bout de ligne, chec global des oprations de dveloppement (Dombrowsky et al., 1993; Niangaly, 2000). On pourrait mme dire quelle explique en partie la crise politique qui secoua le pays et occasionna une multiplication des initiatives de la part des communauts pour prendre en main leur propre destin. Pourquoi?
Dj sous le rgime socialiste de Modibo Kta, la cration des organismes de commercialisation (OPAM et SOMIEX), auxquels le monopole tait donn pour lachat et la vente des produits agricoles, provoqua beaucoup de frustrations et de grognes au sein de la population. taient en dsaccord non seulement les tenants des socits de commerce trangres et les privs, mais aussi et surtout les paysans. En effet, ces derniers taient contraints de vendre leurs produits agricoles un prix drisoire lOPAM. De plus, ils devaient payer des impts, des taxes et des redevances. Nayant pas suffisamment de revenus pour toutes ces dpenses, ils dvelopprent des marchs parallles pour leurs rcoltes, vendant ainsi des prix drisoires une partie de leurs rserves de vivres aux commerants. cela, il faut ajouter les abus de certains agents qui nhsitaient pas tricher les producteurs agricoles pendant les campagnes de commercialisation. Do la critique de Dembl (1981) qui soutient que ltat pratiquait une politique de ponction des revenus des paysans. Cette ponction tait faite non seulement par ltat, mais aussi par les commerants compradores.
La politique dassociation villageoise est une consquence des nombreuses protestations paysannes contre les pratiques des intervenants issus des structures de ltat. En effet, pendant la campagne agricole 1973-1974, ce sont les meutes villageoises de Totanbougou (cercle de Diola), provoques par les abus des quipes de commercialisation de coton, qui ont amen les autorits de la CMDT y exprimenter la premire association villageoise (Sanogo, 1989). Cette politique prit de lampleur dabord dans la zone CMDT, avant dtre rcupre par lUDPM Union Dmocratique du Peuple Malien, parti politique cr par le rgime militaire du Gnral Moussa Traor en 1979. , parti unique alors au pouvoir. la fin des annes 1980, on comptait dj des centaines dassociations villageoises dans la zone CMDT.
Une autre consquence des protestations paysannes est la cration du premier syndicat des producteurs agricoles: Syndicat des producteurs du coton et du vivrier (SYCOV). Insatisfaits de la politique de dveloppement pratique par la CMDT, les producteurs agricoles de Koutiala Une ville dans la rgion sud du Mali. le crrent ds le dbut des annes 1990, pour faire aboutir leurs dolances, axes essentiellement sur une meilleure prise en compte de leurs proccupations (Easton et al., 1999).
Cest cette crise socioconomique du monde rural qui, avec les difficults socioconomiques occasionnes par les programmes dajustement structurel, provoqua une situation encore plus insupportable pour diverses couches sociales: paysans, lves, fonctionnaires, etc. Ainsi, par un effet boule de neige, elle a abouti des mouvements violents presque partout sur le territoire. La principale consquence fut une rbellion Touargue au Nord et la rvolution populaire mene par toutes les couches sociales: tudiants, associations dmocratiques, syndicats (Diallo, 1991; Bertrand, 1992; Bernus, 1992; Chu, 1992).
Cest dans cette situation surchauffe quun groupe de jeunes officiers, avec sa tte le Lieutenant-colonel Amadou Toumani Tour, dposa le prsident de la rpublique le 26 mars 1991. Les lections prsidentielles, remportes par Alpha Omar Konar en juin 1992, marquent la fin de la transition. Ce dernier russit mettre fin la rbellion Touargue. Rlu en 1997, il acheva linstallation des institutions dmocratiques et entama la dcentralisation politique et conomique avant la fin de son deuxime et dernier mandat. Et depuis juin 2002, le Gnral Amadou Toumani Tour (auteur du coup dtat de 1991) est lu deuxime prsident de la troisime rpublique. Cette entre dans lre de la dmocratie multipartite et de la dcentralisation a contribu davantage lclosion et la consolidation des activits de dveloppement local et dconomie sociale axes sur les acteurs sociaux et leurs proccupations.
4.2.Interventions des organisations non gouvernementales (ONG) et actions inities par les populations
Les interventions des ONG au Mali ne datent pas de la troisime rpublique. Nous verrons plus loin quelles remontent aux annes 1970. De mme, au Mali, il existe depuis toujours des organisations traditionnelles dont le fonctionnement et les activits sinscrivent dans le cadre de lconomie sociale. Cependant, cest la troisime rpublique qui, par ses idaux de dcentralisation politique et conomique, a cr un environnement sociopolitique favorable lmergence et la multiplication des activits sinscrivant dans lconomie sociale.
Des interventions des ONG et des actions inities par les communauts, nous relevons les tendances suivantes: grande considration accorde aux proccupations locales, baisse du monopole de ltat sur le secteur du dveloppement, responsabilisation des populations, multiplication des initiatives dconomie sociale.
4.2.1.Grande considration accorde aux proccupations locales, baisse du monopole de ltat sur le secteur du dveloppement, responsabilisation des communauts, multiplication des initiatives dconomie sociale.
Les activits menes par les ONG et les actions issues des communauts se caractrisent par la place centrale donne aux populations, leurs proccupations, logiques et stratgies. Cela a favoris une plus grande responsabilisation des populations, qui prennent ainsi en main leur propre dveloppement. Cette faon de faire, qui prend le contre-pied des interventions des structures de ltat, a facilit dune part la cration de plusieurs organisations de dveloppement local et dconomie sociale(mutuelles, coopratives, etc.) et, dautre part, ltablissement des partenariats entre divers acteurs autour des projets. Certains de ces partenariats ont conduit des jumelages entre villages et villes maliens et ceux de lextrieur. De nos jours, la faveur de la dmocratie, plusieurs partenaires collaborent sur le terrain: services publics, structures politiques, associations locales, associations des maliens de lextrieur, ONG nationales (y compris les Groupements dintrt conomique: GIE) et internationales, et institutions internationales.
Axes sur les proccupations locales et sur la participation active de tous les acteurs sociaux, les activits des ONG et les actions issues des communauts se sont multiplies presque paralllement aux interventions verticales des structures de ltat. Dabord, elles ont commenc de faon timide avec les missions chrtiennes depuis la priode coloniale. Puis, elles ont continu avec les ONG de charit pendant la grande scheresse de 1973. Nous reviendrons ci-aprs sur leur volution et leurs caractristiques.
a.Organisations non gouvernementales (ONG) au Mali: caractristiques et apports lconomie sociale
Raghavan (1992) nous apprend quau dbut des annes 1970, il ny avait que quelques ONG au Mali. Celles-ci, rappelons-le, taient majoritairement chrtiennes et distribuaient des vivres aux sinistrs. Elles sont devenues plus nombreuses partir des annes 1980, la faveur des rformes effectues sous les diffrents programmes dajustement structurel qui occasionnrent des vagues de compressions de travailleurs dentreprises, de retraites anticipes et de chmage massif de jeunes diplms.
Beaucoup de ces anciens fonctionnaires et de ces jeunes diplms, organiss en ONG, sont venus grossir le rang des acteurs de dveloppement communautaire, se soustrayant ainsi du chmage pour mettre leurs comptences au service des populations. Il faut dire que la cration dONG leur facilitait aussi laccs aux financements disponibles. Ainsi, dj en 1991, on comptait au Mali 191 ONG (dont 97 nationales), dont plusieurs sont regroupes au sein du Comit de coordination des associations et ONG (CCA ONG). De nos jours, les ONG, toutes vocations confondues, sont devenues des partenaires actifs dans la conception et la ralisation des projets de dveloppement durable, au-del des actions ponctuelles daide et dassistance.
Sur le terrain, la mthode dintervention des ONG se dmarque de celle gnralement utilise par les agents de ltat travaillant dans le domaine du dveloppement rural. Les ONG sont plus proches des populations. Leur dmarche consiste avoir un contact direct avec les bnficiaires. Lidentification, la conception et la ralisation des projets sont faites avec une participation active de ces derniers tous les niveaux : runions villageoises pour exprimer les besoins et proccupations du village, mise la disposition de main-duvre pour la ralisation des travaux; parfois un apport financier.
Ainsi, les actions menes se situent dans un cadre de dveloppement la base, inspir des principes de dveloppement communautaire: citons, par exemple, les projets de dveloppement rgional des villages de Koni (Assogba, 1993) et de Fereintoumou (Konat et al., 1999), et la construction du barrage du village de B (Assogba, 1988). Ces actions se traduisent gnralement par des microralisations lchelle dun village, dun groupe de villages ou dune rgion, qui rpondent effectivement aux proccupations locales.
Au Mali, les domaines dintervention des ONG sont divers : micro finances, entreprises, sant, levage, agriculture, ducation, radios communautaires, paix sociale, consolidation de la dmocratie et de la dcentralisation, jumelages, mutuelles, etc. Quel que soit le domaine, les actions de ces organisations se rvlent plus favorables un dveloppement bas sur les proccupations locales et sinscrivent dans un cadre dconome sociale et solidaire.
Un autre aspect important, cest que plusieurs de leurs ralisations savrent de vritables produits de la coopration dcentralise, avec un recours non seulement aux ressources humaines et aux pouvoirs publics de la localit mais aussi limplication directe des institutions internationales. Cest le cas des villages de Sanankoroba et de Fereintoumou (mentionn plus haut) o des ralisations ont t faites grce au jumelage avec une ville de Qubec, limplication des populations locales et des pouvoirs publics, et la participation de SUCO SUCO(Solidarit Union Coopration ) est une ONG canadienne. Mali avec lappui de lACDI ACDI: Agence Canadienne de Dveloppement International (Konat et al., 1999).
Toutefois, un document de Ciss et al. (1999) nous signale quil existe encore des problmes darticulation entre coopration et dcentralisation au Mali. Cest dire quil faut toujours faire avec la hirarchie administrative qui reste encore lourde. Malgr la dmocratie et la politique de dcentralisation, cela pourrait retarder ou entraver laction des ONG et institutions internationales sur le terrain et compromettre bien des initiatives de dveloppement local.
b.Quelques expriences innovantes de dveloppement local et dconomie sociale
Les expriences innovantes de dveloppement local et dconomie sociale sont de plus en plus nombreuses au Mali. On en voit dans toutes les rgions du pays. Certaines sont le fruit dun partenariat entre ONG, bailleurs de fonds, populations et pouvoirs publics. Dautres sont inities par les populations, qui assurent elles-mmes lessentiel du financement. Les cas que nous prsentons ici nous paraissent illustratifs de lampleur de cette nouvelle tendance conomique: rseau des caisses dpargne et de crdit Kafo Jiginew; initiatives dorganisation sanitaire; implication de la socit civile (y compris les ONG) dans le rtablissement de la paix au Nord; apports des maliens de la France.
- Micro finances: le cas du rseau des caisses Kafo Jiginew
Sil y a un domaine o les actions des ONG ont t des plus formidables, cest bien celui des micro finances. Des ONG ont russi inciter les paysans mettre leurs pargnes en commun et financer leurs crdits, dans un pays o ils constituent la couche la plus pauvre. Certains de ces paysans, il faut le dire, avaient coutume de garder leurs conomies la maison, parfois dans des jarres quils enterraient ensuite. Dans les villes, la mme dmarche a permis de mettre des services dpargne et de crdit la disposition des populations exclues, de facto, des systmes bancaires formels.
Plusieurs rseaux de caisses existent au Mali. Il y a le rseau de Caisses villageoises dpargne et de crdit autogres (CVCA), cr au milieu des annes 1980 grce lassistance allemande (GTZ: German Agency for Technical Cooperation; DEG: German Development Company; KFW: une corporation financire allemande) et une participation de la Banque nationale de dveloppement agricole du Mali (BNDA) (Adler, 2001). Il y a galement le rseau Nysigiso Voir site: http://microfinancement.cirad.fr/cgi-bin/organismes/excelocp1?exelocp?LOCP=MALI&LAN=fr, cr en 1990 par lONG canadienne Dveloppement international Desjardins. ceux-ci, il faut ajouter le rseau Jemeni CICM (2002). Plate forme dappui. Mali: Jemeni. Adresse Internet: www.cmutuel.com/cicm/actions/malijemi.asp et celui de Kondo Jigima CICM (2002). Plate forme dappui. Mali: Kondo Jigima.
Adresse Internet: www.cmutuel.com/cicm/actions/malikj.asp. Le premier a t cr en 1995 et bnficie de lappui de la Caisse franaise de dveloppement, de la BNDA et du Centre international du crdit mutuel (CICM). Le second, qui a vu le jour en 1991, est une initiative de la Fdration nationale des artisans du Mali (FNAM). Il bnficie de lappui du BIT, de la coopration suisse et du CICM.
Mais, le rseau Kafo Jiginew (Fdration des greniers en langue bambara) reste le premier groupe de financement dcentralis du Mali, avec ses 92 guichets dont cinq caisses urbaines et 83 000 socitaires. En 1999, il avait son actif plus dun milliard de francs CFA de fonds propres. lorigine, cest une banque pour paysans, cre en 1987 avec lappui dun consortium de quatre ONG (Comit franais pour la solidarit internationale, SOS faim Belgique, Mani Tesa dItalie, Agro Action de lAllemagne), auquel se sont ajouts la Fondation du crdit coopratif, le Centre international du crdit mutuel et lUnion europenne. Le rseau Kafo Jiginew repose essentiellement sur lpargne des producteurs de coton et la distribution de crdits ses membres. Il a des caisses dans de nombreux villages du sud, notamment dans les villages encadrs par la CMDT. De plus, depuis 1994 il a ouvert des caisses urbaines pour recueillir les avoirs des petits artisans, commerants, fonctionnaires et micro entreprises du secteur informel. Aussi, pour intresser davantage les femmes, un systme de crdits associatifs pour femmes a t tudi (Serbin, 2000).
Chose encore plus originale, cest que le rseau est dirig par un conseil dadministration reprsentant les associations villageoises et les organisations paysannes socitaires. Il est entour de cadres de haut niveau pour son expansion, notamment vers les rgions arachidires et dlevage.
- Sant: initiatives dorganisation sanitaire
Nous nous intressons ici aux organisations autour des centres de sant communautaires et au sein des mutuelles de sant.
Les centres de sant communautaires ont t crs sur linitiative des populations Bamako, suite une certaine carence de ladministration de la sant. Cette initiative fut adopte par le gouvernement en 1990, comme lment de sa politique sectorielle finance par la Banque mondiale. La population, regroupe en association, cre et gre les centres de sant communautaires. Cest lassociation qui recrute et paie le personnel. Les ressources proviennent de la tarification des activits, de la vente des mdicaments essentiels et des subventions. En 1996, on comptait 25 centres de sant communautaires dans le district de Bamako (Coulibaly et Kta, 1996). Ils sont estims 500 au niveau national (Van Belle, 2002).
Quant la mutualit en sant, elle reste encore embryonnaire. Elle est prsente surtout Bamako. Il y a la Mutuelle des travailleurs de lducation et de la culture (MUTEC) et la Mutuelle des travailleurs de la sant et de laction sociale (MUTAS). La MUTEC est la plus active et ses activits ne cessent de saugmenter. Suite une enqute effectue auprs de ses adhrents, elle a cr un centre de sant en 1990. En 1996, elle couvrait dj 2000 agents et leurs familles. Comme prestations, les membres bnficient de consultations de mdecine gnrale, de soins maternels et infantiles, de soins infirmiers et de quelques examens de laboratoire, ainsi que de la vente des mdicaments essentiels aux malades. Les cotisations forfaitaires des familles et les recettes issues des prestations permettent au centre de couvrir les charges. La deuxime mutuelle, la MUTAS, est plus rcente et sinspire de lexprience de la premire. On pourrait situer sa cration en 1996; elle devait couvrir 2000 agents et leurs familles et offrir les mmes prestations que la MUTEC (Coulibaly et Kta, 1996).
- Paix sociale: implication des ONG
Ce cas est exceptionnel et dmontre le rle prpondrant que peuvent jouer les ONG et autres groupes civils dans la cration dun climat de paix sociale; un facteur dterminant dans le dveloppement dune communaut. Poulton (1996) nous apprend que les ngociations, qui ont abouti la fin de la rbellion Touargue dans le nord du Mali, ont t en grande partie luvre de la socit civile, dont les associations, les ONG (y compris les caisses dpargnes mutuelles et les groupements dintrt conomique), les coopratives, les syndicats, les chambres consulaires et les ordres professionnels. Cest par elle que furent obtenus le dpt des armes, la rintgration dans larme des rebelles et la relance du dveloppement conomique. Certaines organisations non gouvernementales avaient fourni du ravitaillement et des moyens de dplacement, et un travail minutieux de relations publiques avait permis de runir des chefs traditionnels et religieux avec des associations et des membres des mouvements arms. Ont t exclus de ces ngociations ladministration, les forces armes, le gouvernement et les partis politiques.
- Apports de la diaspora: le cas des maliens de la France
Le Mali est un pays grande migration, et les migrs maliens ont toujours jou un rle prpondrant dans le dveloppement de leurs localits dorigine. Ils sont parfois la base des contacts entre leurs villages dorigine et les organisations et villes de leurs pays daccueil. Ainsi ont t nous plusieurs jumelages de villages maliens avec des villes dautres pays, notamment en Europe et au Canada. Mais, laspect le plus important de leur contribution reste les transferts de fonds pour la ralisation des projets de dveloppement dans leurs localits dorigine.
Le cas le plus frappant reste celui des maliens vivant en France. Ces derniers participent au dveloppement de leurs rgions dorigine: construction dcoles, de mosques, provision de mdicaments pour les centres de sant, etc. Dans les annes 1990, on estimait 25 millions de dollars les transferts de fonds des migrs maliens en France, pendant que laide publique franaise au dveloppement au Mali slevait 93 millions de dollars (Assogba, 2002, p. 5).
Alors, que faudrait-il comprendre de lvolution du dveloppement local et de lconomie sociale et solidaire au Mali?
5.Approfondissement de la comprhension de lvolution du dveloppement local et de lconomie sociale au Mali
Cet approfondissement de la comprhension est fait sur la base des tendances releves ci-haut afin de cerner les types dinterventions ou dactions plus favorables la cration de richesses au Mali o, rappelons-le, les conditions socioconomiques restent encore prcaires.
Nous y relevons une diffrence notoire entre la situation cre par les interventions des structures de ltat et celle provoque par les interventions des ONG et les activits inities par les populations. Tout semble se jouer au niveau de la considration accorde ltre social, sa logique et son environnement dans les activits de dveloppement. Dans cette situation, quels types dactions favoriseraient mieux la cration, par les populations locales, de richesses leur permettant de survivre, voire obtenir une amlioration satisfaisante des conditions de vie?
Dabord, quelles interventions le favoriseraient peu? Ce sont celles des structures de ltat, dans lesquelles peu de respect est accord aux proccupations, logiques et stratgies locales. Dans ces interventions, le dveloppement des communauts semble rduit une simple affaire de transfert de recettes. Tout indique quon se soucie peu de la viabilit de celles-ci dans le contexte dapplication. Toute recette ou tout savoir dcoulant du milieu ou des populations bnficiaires est donc banalis. On manque alors de saisir le caractre relatif du dveloppement local. Puisque, de toute faon, les contextes environnementaux, socioculturels et conomiques ne sont pas les mmes, le plus souvent les oprations menes natteignent point les objectifs fixs. Et la situation des communauts reste prcaire.
Par contre, quelles actions contribueraient mieux la ralisation dun dveloppement bas sur les proccupations locales et la cration de richesses par les communauts? Ce sont, daprs notre analyse, les actions impliquant les ONG ou issues des populations. Dans ces actions, une place centrale est accorde aux populations, leurs proccupations, leurs logiques et leurs stratgies. Le caractre relatif du dveloppement local et de lconomie sociale prend toute son importance ici. Les populations sont davantage coutes et responsabilises. Cela favorise une multiplication dinitiatives bases sur les proccupations du milieu et une meilleure organisation des activits dconomie sociale et de dveloppement local. Toute chose qui est favorable la cration, par les populations, de richesses susceptibles de leur permettre de sortir du cycle infernal de la pauvret et de la prcarit. Et, pensons-nous, les actions, ainsi penses et ralises en fonction des proccupations locales, respectent mieux lvolution du contexte et des besoins.
6.Proposition de pistes damlioration
Les pistes damlioration que nous proposons visent viter les interventions, telles que celles menes par les structures de ltat (voir plus haut), peu favorables lamlioration des conditions de vie des communauts. Cela est dautant plus important que, malgr la dcentralisation politique et conomique au Mali et en dpit de la multiplication des expriences dconomie sociale et de dveloppement axes sur des besoins locaux, il existe encore, chez des agents, des habitudes susceptibles dentraver une ventuelle cration de richesses par les communauts. On les retrouve non seulement chez des agents de terrain, mais aussi dans ladministration o, daprs Ciss et al. (1999), il y a encore des difficults darticulation entre coopration et dcentralisation. En regard de ce facteur, nous proposons deux alternatives :
- envisager des sessions de formation lintention des agents de dveloppement: cela pourra se faire en formation initiale ou en formation continue, selon le cas. Une telle intervention permettra dagir au niveau des logiques, de faon provoquer un changement de visions chez les agents qui nont pas encore intgr les pratiques de dveloppement local axes sur les populations et leurs proccupations, et favorables la cration de richesses. Seront viss par la formation non seulement les agents de terrain, mais aussi les dcideurs de politiques de dveloppement et les tudiants voluant dans les domaines du dveloppement local et de lconomie sociale et solidaire.
- crer un cadre plus favorable la coopration dcentralise: cela devrait se faire en concertation avec lensemble des acteurs de dveloppement local. Il sagira de relever les difficults qui se posent la coopration dcentralise et dy trouver des solutions (administratives, politiques, juridiques, etc.) qui soient viables. Un tel cadre favoriserait davantage des partenariats entre les acteurs nationaux (ONG, populations, services publics) et institutions internationales. Bien articuls, ces partenariats favoriseraient non seulement la consolidation des activits menes sur le terrain, mais aussi pourraient provoquer un vritable changement de visions chez les agents tranant encore des habitudes peu recommandables pour lconomie sociale et le dveloppement local.
notre avis, appliques, ces propositions apporteront un appui utile aux efforts dj fournis dans le domaine de lconomie sociale et du dveloppement local au Mali.
7.Conclusion
Dans le domaine du dveloppement local et de lconomie sociale et solidaire, le Mali est en pleine mutation. Les expriences innovantes releves se rvlent des rponses aux difficults vcues par les populations, la suite de lchec global des politiques nationales de dveloppement et des consquences des programmes dajustement structurel. Le plus souvent, elles sont le fruit de la collaboration des populations avec lensemble des partenaires de dveloppement, y compris les pouvoirs publics, les structures politiques, les ONG et institutions nationales et internationales. Elles se rvlent galement un vritable creuset de coopration dcentralise qui permet aux populations locales davoir des contacts plus directs avec les organismes et institutions internationaux de dveloppement.
Un des secrets de la russite reste cependant lapproche dintervention utilise par les ONG sur le terrain; une approche domine par limplication vritable des populations tous les niveaux de conception et de ralisation des projets. Mieux que les interventions des structures de ltat, les actions des ONG et celles inities par les populations se rvlent plus favorables la cration, par les populations locales, de richesses susceptibles de leur assurer une survie, voire une amlioration satisfaisante des conditions de vie. Il reste souhaiter que ltat fasse les efforts qui simposent pour faciliter larticulation des actions relevant de la coopration dcentralise.
8.Rfrences
Adler, M. (2001). Village Banks in Mali: A successful Project of Self-help Promotion, in D+C Development and Cooperation, no 1, January-February, pp.18-20.
Assogba, Y. (1988) Le paradigme interactionniste et le processus du dveloppement communautaire: l'exemple des ONG en Afrique, in Revue canadienne d'tudes et du dveloppement, vol. IX, no 2, pp. 201-218.
Assogba, Y. (1993). Entre la rationalit des intervenants et la rationalit des populations bnficiaires: lchec des projets en Afrique noire, in Cahiers de Gographie du Qubec, vol. 37, no 100, avril, pp. 49-66.
Assogba, Y. (2002). Et si les Africains de la diaspora taient des acteurs du dveloppement de lAfrique?, CRDC, Srie recherche no.25, Universit du Qubec Hull.
Bernus, E. (1992). tre Touareg au Mali, in Politique africaine, Le Mali: la transition, no 47, octobre, trimestriel.
Bertrand, M. (1992). Un an de transition politique: de la rvolte la troisime rpublique, in Politique africaine, Le Mali: la transition, no 47, octobre, trimestriel.
Chu, L. (1992). Politiques conomiques et crises durant les 30 annes dindpendance, in Politique africaine, Le Mali: la transition, no 47, octobre, trimestriel.
Ciss, H. B. et al. (1999). Liens entre la dcentralisation et la coopration dcentralise au Mali. (Document de rflexion ECDPM, no 6), Maastricht, ECDPM.
Ciss, M. C. et al. (1981). Mali: le paysan et l'tat, Paris, ditions L'Harmattan.
Coulibaly, S. O. et Moussa Kta (1996). conomie de la sant au Mali, in Cahiers Sant, volume 6, pp. 353-359, novembre-dcembre.
Defourny, J. et P. Develtere (1999). Origines et contours de lconomie sociale au Nord et au Sud, in Defourny, J. et P. Develtere (1999) (ds.). Lconomie sociale au Nord et au Sud, Bruxelles (Belgique), De Boeck & Larcier s.a., pp.25-56.
Dembl, K. (1981). La dimension politique du dveloppement rural, in Ciss, M. C. et al. Mali: le paysan et l'tat, pp. 103-130, Paris, ditions L'Harmattan.
Diallo, M. C. (1991). Les derniers jours de Moussa Traor au pouvoir: comment Bamako a chass son gnral , in Jeune Afrique, no 1580, du 10 au 16 avril, pp. 18-21.
Diarrah, C. O. (1990). Mali: bilan dune gestion dsastreuse, Paris, LHarmattan.
Dombrowsky, K., G. Dumestre et F. Simonis (1993). L'alphabtisation fonctionnelle en Bambara dans une dynamique de dveloppement: le cas de la zone cotonnire (Mali-Sud), Montmagny, Qc, Marquis.
Easton, P. et al. (1999). Le dveloppement dun syndicat agricole au Mali; accrotre la responsabilisation au niveau local, in Notes CA (Notes sur les Connaissances Autochtones), juin, no 9.
Fall, A. S. et L. Favreau (2002). Cration de richesses en contexte de prcarit: une comparaison Sud-Sud (Afrique et Amrique Latine) et Nord-Sud (Canada, Afrique et Amrique Latine), Chaire de recherche du Canada en dveloppement des collectivits (CRDC), Universit du Qubec en Outaouais, novembre.
Goodman, M. et R. Karash (1995). Six Steps to Thinking Systemically, in The Systems Thinker, vol. 6, no 2, March.
Jacquemot, P. (1981). Introduction: une conomie de partage du surplus paysan, in Ciss, M. C. et al. Mali: le paysan et l'tat, pp. 9-20, Paris, ditions L'Harmattan.
Kb, Y. G. (1981). L'agriculture malienne, le paysan, sa terre et l'tat, in Ciss, M. C. et al. Mali: le paysan et l'tat, pp. 21-102, Paris, ditions L'Harmattan.
Konat, M. et al. (1999). Sur les petites routes de la dmocratie: lexprience dun village malien, Montral, Les ditions cosocit, En collaboration avec SUCO.
Leclerc, Y. (2002). Les CLD et le dveloppement local: dfis et enjeux, in Favreau, L., M. Robitaille et D. Trembray (dir.) (2002). Quel avenir pour les rgions? Chaire de recherche du Canada en dveloppement des collectivits (CRDC), Universit du Qubec en Outaouais, pp. 291-299.
Niangaly, A. (2000). CMDT: la rvolte des paysans de Bougouni, in Le 26 mars du 14/02/2000, Bamako, Mali.
Poulton, R. E. (1996). Aprs cinq ans de guerre: vers la rintgration des Touaregs au Mali, in Le Monde diplomatique, novembre, p.13.
Raghavan, N. (1992). Les ONG au Mali, in Politique africaine, Le Mali: la transition, no 47, octobre, trimestriel.
Sanogo, B. (1989). Le rle des cultures commerciales dans l'volution de la socit Snoufo (Sud du Mali), CRET, Universit de Bordeaux III.
Serbin, S. (2000). Kafo-Jiginew prisonnire de la crise du coton?, in Grain de sel, Inter-rseaux dveloppement rural, n 15, juillet.
Van Belle, V. (2002). La mutualit au Mali, En route vers les campagnes!, in En Marche, Le journal de la mutualit chrtienne, n1264, 7 novembre, Site Internet: http://www.enmarche.be/Cooperation/Mali.htm
conomie sociale et dveloppement local en Mauritanie
Par
Habiboullah KANE
Note sur l auteurs:
Habiboullah KANE prpare un diplme d'tudes Suprieures Spcialises(D.E.S.S) en Dveloppement rgional l'Universit Jules Verne Picardie d'AMIENS en France. Il poursuit actuellement son stage la Chaire de Recherche du Canada en Dveloppement des Collectivits depuis octobre 2002.
35
Prsentation gnrale
La Mauritanie couvre une superficie de 1030700 km2. Elle est limite au nord par le Sahara occidental et lAlgrie, lest par le Mali, au sud par le Mali et le Sngal et louest par lOcan Atlantique. Plus de la moiti du territoire national au nord est dsertique et faiblement peupl. La zone sahlienne stend douest en est sur une bande de 200 km traversant le pays dans sa partie mridionale. Au centre et au nord, le relief est constitu de massifs montagneux tels que ceux de lAdrar et du Tagant qui culminent entre 400 et 800 mtres. Le sud connat quelques priodes de pluies (3 mois) qui deviennent de plus en plus faibles au fur et mesure de lavance du dsert.
La population mauritanienne est compose de Maures (arabo- berbres), de Haratines Les Haratines sont littralement des anciens esclaves affranchis, culturellement arabes, mais de race noire. La controverse autour de leur statut soulve la question de savoir si lesclavage existe toujours en Mauritanie ou pas?(maures noirs majoritaires), de Halpoularen (ethnie peulh), de Soninks, de Wolofs et de Bambaras. Elle est estime 2 680 463 habitants au 30 avril 2003 (Rapport spcial de la Mission FAO/PAM du 3 dc.2002). Cette estimation est fonde sur les rsultats du recensement gnral de la population en dcembre 2000. Selon ces donnes, la population en dcembre 2000 tait de 2 548 157 personnes avec un taux de croissance annuel de 2,6 %.
Sur le plan conomique, la Mauritanie fait partie du groupe des PMA (Pays les Moins Avancs.) Son Produit national brut (PIB) par habitant, soit $380 par an, est faible. Plus de 50% de sa population vit en dessous du seuil de pauvret. En 2001, son Indice de dveloppement humain (IDH) est de 0,437 et correspond au 139ime rang sur les 162 pays classs par le rapport 2001 du PNUD. Le taux de chmage avoisine les 30% selon le rapport CECO CONSEILS. La faiblesse des ressources internes de la Mauritanie est comble en grande partie par le recours l'aide extrieure.
Avec les checs des politiques publiques mises en place aprs lindpendance et les effets ngatifs des programmes dajustement structurel ( partir de 1985), les pouvoirs publics ont mis au point, avec laide des partenaires au dveloppement, les lments dune stratgie de lutte contre la pauvret (1994). En mme temps, les initiatives de la socit civile, longtemps banalises, trouvent un cho favorable au niveau des pouvoirs publics et des partenaires au dveloppement.
Nous tudierons successivement lvolution et limpact des politiques publiques de dveloppement qui ont conduit une remise en question ou un amnagement de ces stratgies et ltat des lieux des diffrentes initiatives conomiques et populaires. Ensuite nous analyserons les rsultats atteints par ces initiatives (emplois crs, qualit et impact de ces initiatives dans la communaut, etc.), leurs atouts, leurs limites et surtout leur apprciation par les politiques publiques (nationales et internationales). Enfin, nous tudierons les conditions de russite ou de dveloppement des initiatives conomiques populaires.
I- Des politiques publiques de dveloppement aux stratgies de lutte contre la pauvret:
1 volution des politiques publiques de dveloppement
Jusqu' une priode rcente (1985), le contexte politique mauritanien tait caractris par une centralisation du pouvoir, entranant une mfiance, voire lhostilit aux initiatives individuelles et collectives ayant pour objet la constitution dONG. Le mouvement associatif ntait tolr que dans le cadre de pr coopratives et coopratives.
Ltat sest engag dans des projets de dveloppement agricole avec la cration de la Socit nationale de dveloppement rural(SONADER) et plus rcemment, dans les annes 1990, la mise en place dInstitutions financires non bancaires en faveur du monde rural: UNCACEM(Union nationale des coopratives agricoles, de crdit et dpargne en Mauritanie) et UNCOPAM(Union nationale des coopratives de pche artisanale en Mauritanie). Ces deux structures proposent des services divers de conseil, dexpertise, de subvention, de mise en uvre de projets et de financement sous forme de micro crdits. Elles sont ingalement rparties sur le territoire national et fonctionnent sur le mode de lassistance avec des financements extrieurs distribus sous forme de subventions ou de crdits la plupart du temps non rembourss. Donc, elles contribuent peu la mobilisation de lpargne locale et ne sont pas coordonnes entre elles.
Par ailleurs, lenjeu foncier met aux prises depuis deux dcennies (rforme agraire de 1983), les populations ngro africaines de la valle du fleuve ltat mauritanien qui entend mettre en valeur cette rgion selon un projet prcis de modernisation reposant sur lagriculture irrigue. Selon le systme coutumier, la terre nappartient pas lindividu mais au groupe lignager. Elle est gre par le doyen du lignage qui rpartit les parcelles entre les familles. Le heurt de la logique modernisatrice et le systme traditionnel particulirement vivace est au centre de la tension. Au niveau conomique, ltat entend entreprendre des projets de dveloppement agricoles sans tre paralyser par les prtentions foncires des propritaires traditionnels. Le passage la proprit prive (voulue par les institutions financires internationales) doit permettre de librer les initiatives et accrotre la production. Les populations y voient plutt un motif dexpropriation car, cette rforme profite essentiellement aux Maures (privs, fonctionnaires, commerants) habitant le Nord et particulirement Nouakchott B.Crousse La Mauritanie, le foncier et laprs barrage, Politique africaine n30, juin 1988, cit par P.Marchesin. Ces individus disposent non seulement des moyens financiers consquents permettant une rapide mise en valeur, ce qui va videmment dans le sens de limpratif gouvernemental dautosuffisance alimentaire mais encore, ils bnficient dappuis en haut lieu, ltat, rappelons le, tant avant tout aux mains des Maures. Cette situation entrane une mfiance des populations de la valle du fleuve envers les logiques dautosuffisance alimentaire prnes par ltat. Elles dfient les autorits en dveloppant les cultures traditionnelles vivrires sous pluies au dtriment des cultures irrigues, refusant ainsi de devenir des ouvriers agricoles la solde des privs. Cette situation entrane des mouvements de migration et lappauvrissement de la paysannerie qui na dautre choix que daccepter cette loi car les pluies se font de plus en plus rares. Ce mouvement de migration vers les pays du Nord a fait que de nouvelles alliances entre migrs se sont tablies afin de dvelopper des projets de dveloppement agricoles avec, pour et par les populations du Sud dans le but de rtablir la cohsion des communauts branles par les actes des pouvoirs publics. Avec les cots des intrants (semences, carburant, entretien moto pompes,) de la culture irrigue, les paysans deviennent dpendants de ltat au lieu dtre partenaires.
Dans le domaine des soins de sant primaires, des progrs ont t raliss grce lapplication de lInitiative de Bamako(IB) L'Initiative de Bamako est un ensemble de rformes politiques labores en rponse la dgradation rapide des systmes de sant dans les pays en dveloppement pendant les annes 70 et 80 de 1987 qui prconise la participation des populations la gestion des services de sant locaux (via un comit de gestion lu) et aux dcisions prises pour lamlioration des services. Ceci cre un sentiment dappartenance et didentification de la communaut au systme. Dans cet esprit, il est gnralement admis que les fonds gnrs par la communaut (avec lachat des mdicaments essentiels) doivent rester dans celle-ci (au niveau des centres ou postes de sant villageois). Ces fonds issus de la vente des mdicaments sont rpartis comme suit: 30% pour la motivation du personnel infirmier, 30% pour le rapprovisionnement en mdicaments et 40% pour le fonds de scurit. Avec ces 40%, les populations peuvent en disposer pour financer de petites activits gnratrices de revenus comme le marachage. Cependant, des progrs restent faire quant la cration de mutuelles de sant car elles nexistent pas encore en Mauritanie ou lexprience ny a pas t encore tente comme au Sngal par exemple o on en dnombre plus dune trentaine. Cependant, toutes les mutuelles existantes aujourdhui intgrent dans leurs projets un voletsant.
2. Les stratgies de lutte contre la pauvret
Ltat, toujours avec ses partenaires au dveloppement, explore de nouvelles pistes susceptibles de satisfaire les demandes sociales qui se font de plus en plus pressantes. Cest seulement partir de 1994 que les autorits ont commenc laborer des stratgies de lutte contre la pauvret.
Les actions les plus rcentes engages par ltat et ses partenaires au dveloppement pour cibler les populations les plus vulnrables afin de rduire les cots sociaux dus aux effets des programmes dajustements structurels sont la cration dun Commissariat aux droits de lHomme, linsertion et la lutte contre la pauvret, la cration dun Cyber forum pour la mise en rseau des diffrents acteurs de la socit civile et la cration des Caisses populaires dpargne et de crdit(CAPEC).
2.1Commissariat aux droits de lHomme, linsertion et la lutte contre la pauvret
La cration du Commissariat aux droits de lHomme, la linsertion et la lutte contre la pauvret(CDHLCPI) a eu lieu en 1998. Le voletDroits de lHomme est plutt politique car les subventions et dons accords par les bailleurs de fonds trangers sont lis au respect des droits humains. Le voletInsertion concerne les diplms chmeurs et surtout, linsertion des couches populaires pauvres qui ont quitt les campagnes et sont venues sinstaller la priphrie de la capitale esprant y trouver du travail. Ce phnomne frappe beaucoup plus la composante Haratine dont les terres sont accapares par les hommes daffaires maures qui, profitant soit de leur statut de matres, de leur puissance financire ou de la rforme agraire, les ont dpossds et ont emmnag sur leurs parcelles. Cela pose le problme de la question foncire en Mauritanie.
Le voletlutte contre la pauvret embrasse plusieurs domaines (programmes en milieu rural et urbain, insertion des diplms chmeurs, formation professionnelle, habitat social, projets dappui aux coopratives) Lintervention en milieu rural a rellement commenc en 2001 suite lincidence de la pauvret dans cette zone qui concentre 76,5% de la population pauvre, selon les rsultats des enqutes ralises par lOffice National de la Statistique(ONS) en 2000.
Les bnficiaires de ces services ne sont pas associs au financement de leurs projets car ltat sest fix lui mme ses priorits. Les bnficiaires sont confins leur statut dassists.
2.2 La mise en place dun Cyber-forum
La mise en place du Cyber forum constitue une rponse institutionnelle aux besoins de la socit civile pour un accs peu coteux lInternet pour les ONG, les journalistes et les maires de communes en dehors de Nouakchott. Rebaptis Cyber forum de la socit civile, il a vu le jour avec lappui du PNUD. Aujourdhui, 383 ONG y sont inscrites (Quotidien NKC INFOS N0 368 du 13 mars 2003).
Autour des diffrents thmes dintrt des ONG (femmes, ducation, sant, environnement, etc.) et en fonction des vnements extrieurs (actualits, colloques, confrences, campagnes de sensibilisation), une session de formation est organise avec le groupe et sur ses propositions. Les groupes dfinissent galement leurs besoins en accompagnement et en formation professionnelle (besoins spcifiques, meilleure structuration dune association, techniques de sensibilisation et de mobilisation sociale, etc.). L'ensemble de ces besoins est pris en considration et ngoci avec les partenaires dsireux d'appuyer le Cyber Forum y inclus travers lInternet..
Lesprit du Cyber forum tait de crer un outil de contrle des diffrentes ONG et leur mise en rseau. Mais, tous les acteurs de la socit civile ne sont pas reprsents, tels que ceux qui travaillent dans lombre ou qui sont lintrieur du pays, loin de la capitale. Certaines ONG se sont appropries cet outil et ce titre, Le Quotidien NKC- INFOS du 24 fvrier 2003 cite le dpart de lancien grant, prsident de long Eco Dveloppement, souponn lpoque davoir profit dappuis, de subventions et de contrats pour son association sous le couvert du cyber forum. Les diffrentes ONG inscrites ne cooprent pas entre elles et sont plutt tournes vers la recherche de partenaires trangers. Les liens historiques forts, la culture, nont pas servi aux acteurs des ONG de travailler ensemble dans une atmosphre de coopration qui a fait par exemple le dveloppement des districts industriels en Italie (Kane, 2002).
2.3 Les Caisses populaires dpargne et de crdit (CAPEC)
Le systme bancaire mauritanien se dsintresse totalement des petits pargnants. Il accorde des crdits court terme aux gros commerants et aux entrepreneurs de pche industrielle sans chercher largir sa clientle ni innover sur le plan financier. Ainsi, les franges les plus vulnrables de la socit sont exclues du systme. Les CAPEC sont nes de la volont de ltat de cibler essentiellement les populations vulnrables des quartiers de Nouakchott et de certaines villes de lintrieur mais aussi et surtout, de drainer lpargne informelle que les experts (Marouani, 2000) estiment 30 milliards dUM en 1996 si on inclut les transferts sans contrepartie selon lexpert (soit environ 105 millions $US) Malgr les performances conomiques et sociales enregistres en Mauritanie ces dernires annes, le phnomne durbanisation a entran une pauprisation croissante de la population mauritanienne.
Les ressources des CAPEC proviennent essentiellement de trois sources: lpargne des socitaires, le budget de ltat et le concours des bailleurs de fonds, essentiellement la Banque africaine de dveloppement, la Banque Mondiale et lACDI (Agence canadienne de dveloppement international)
Au cours de lanne 1997, quatre CAPEC ont t mises sur pied: 3 Nouakchott et une Nouadhibou. Lobjectif affich tait datteindre 20 caisses en 2003 mais aujourdhui, on en est 15 et elles ne couvrent pas toutes les rgions du pays.
Ladhsion aux CAPEC est ouverte toute personnequi a son domicile, son travail, une rsidence ou une place daffaires dans le territoire de la caisse, qui fait une demande dadmission, sengage respecter les rglements et qui souscrit au moins une part sociale dun montant 5000 UM. (environ 18$ US). Il faut souligner que ce montant peut tre considr comme lev pour les plus pauvres (notamment les femmes) qui ont aussi parfois des difficults comprendre le mcanisme de fonctionnement des CAPEC. Il arrive que des socitaires qui ne remplissent pas les conditions dobtention de crdit, se dsengagent pour obtenir le remboursement de leur contribution initiale afin de pouvoir satisfaire une dpense urgente(nourriture, soins mdicaux, etc.) (Marouani, 2000)
La cration des Caisses d'pargne et de crdit, puis leur gnralisation dans le pays, visait un but social de premier ordre : aider les personnes faibles revenus faire face aux cots de la vie et peut-tre, grce au systme de crdit intrt faible, leur permettre d'amliorer leurs revenus et de subvenir en toute indpendance leurs besoins. Au dpart, les Caisses semblaient s'orienter dans le sens dfini par la politique gnrale de lutte contre la pauvret, mais depuis peu, ces caisses ont chang leur condition doctroi de crdits et appliquent dsormais le mme systme onreux que les banques.
Aujourdhui, lintrt pour tout prt est de lordre de 17% Le taux dintrt fix par les banques se situent entre 17 et 22%. Certains taux atteignent mme 28% . Les prts sont court terme. comme dans toutes les banques. Plus que cela, les retards de paiements sont sanctionns par des amendes pouvant aller jusqu la moiti du crdit contract. On est bien loin du but social et de la quasi-gratuit des services tant chants au moment de l'ouverture de ces caisses. Ces caisses poursuivent aujourdhui un but de rentabilit financire comme les banques de la place.
2.4. Cration des centres de formation
Par ailleurs, des structures de formation ont vu le jour pour permettre aux acteurs de la socit civile (les jeunes et les femmes en particulier) de matriser les outils de gestion, de sinsrer dans la vie active par lapprentissage de diffrents mtiers . On retiendra entre autres les centres de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP) rparties dans 8 rgions et dispensent une formation pour les besoins immdiats du secteur informel comme la mcanique auto, plomberie, menuiserie, maonnerie, soudure, couture et confection des vtements, etc. Le Centre de formation et de promotion fminine (CFPF) apporte conseil et assistance aux associations fminines. Mais, ces centres de formation manquent de structures en aval comme les Coopratives Jeunesse de Services (CJS), ou les Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) que lon retrouve au Qubec pour laccompagnement des jeunes dans leurs projets dinsertion sociale par le travail.
II- Les diffrentes formes dinitiatives conomiquespopulaires:
Avec les cots sociaux des programmes dajustement structurel, les initiatives conomiques populaires comme les tontines, les mutuelles ou les coopratives de travail (Twiza) se sont renforces au point dtre reconnues par les pouvoirs publics et certaines ONG nationales. A ct de ces formes dinitiatives populaires, dautres formes de solidarit sociale continuent exister mme si elles ne sont pas reconnues officiellement par les autorits.
1. La tontine comme modle de micro finance informelle.
Une rflexion sur la tontine nous parat ncessaire, d'une part en raison de son importance en Mauritanie ( Nouakchott seulement, on en dnombrait plus de 60 (Marouani, 2000), d'autre part en raison du fait que ces tontines vont constituer une base pour la mise en place des mutuelles en Mauritanie. Cette pargne liquide est estime quelques 9 milliards douguiyas (UM) En 1973, la Mauritanie sest retire de la zone franc et a cr sa propre monnaie indexe sur le dollar amricain: louguiya(UM). 1 $US quivaut aujourdhui environ 275 UM ., soit environ 30 millions de dollars US, selon le rapport Albert Marouani. La tontine permet ses membres dpargner leurs excdents de trsorerie et si besoin de bnficier de prts pour investir dans de petits projets comme la teinture, la couture, le marachage, etc. Cependant, ces tontines souffrent dun manque de coopration entre elles pour une plus grande capacit de financement et une meilleure reconnaissance de la part des autres acteurs du dveloppement (tat et ONG internationales). Cest cette limite organisationnelle que la mutuelle des Associations Fminines dEpargne et de Crdit (MAFEC) La MAFEC a reu de la part du FNUAP (Fonds des Nations Unies pour lAide la Population) le prix femme en 1997 pour rcompenser ses efforts., cre en 1994 par 30 femmes, tentera de dpasser en fdrant plusieurs tontines et adapter les modes de fonctionnement par rapport aux demandes sociales. Elle sera suivie par dautres groupes de femmes telle que la Nissa Bank ou (la banque des femmes), de jeunes et mme par ltat avec la cration des caisses populaires en 1997.
- La Mutuelle des associations fminines dpargne et de crdit (MAFEC): une exprience innovatrice
La cration de la Mutuelle des associations fminines dpargne et de crdit remonte 1994. La cration de la Mutuelle AFEC rpond des besoins exprims par un groupe de femmes ( vingt femmes au dpart) confrontes aux problmes de scurisation de l'pargne et d'accs au crdit. Elle s'appuie sur un capital d'expriences issues des formes associatives traditionnelles (tontines).
Lapproche adopte vise la rvision de l'organisation interne des tontines et des autres associations traditionnelles afin:
-de mobiliser lpargne des femmes
-de faciliter laccs des femmes aux services financiers
-de contribuer lducation conomique et financire des femmes
-de promouvoir une micro assurance fminine novatrice
-de contribuer au renforcement des capacits entrepreunariales des femmes.
L'initiative a suscit l'mergence de huit groupes communautaires d'pargne et de crdit ayant totalis 178 membres entre 1994 et 1997.
Aprs avoir test le recyclage des sommes collectes par le systme tontinier classique sous forme de prts rmunrs orients vers des activits gnratrices de revenus, les groupes communautaires dpargne et de crdit ont constitu une Mutuelle pour se conformer au cadre lgal rgissant les activits dpargne et de crdit en Mauritanie (Sokhna LY). En plus de ces organes statutaires classiques, la Mutuelle issue des pratiques financires traditionnelles dispose dune catgorie spciale de grantes la base appeles Mres sociales. Elles assurent lorganisation et la supervision des activits travers les groupes de solidarits constitus par les membres. Ces groupes de solidarit composs de 20 30 membres permettent une meilleure participation et une implication des clients/bnficiaires des services de la Mutuelle et assurent le contrle social lment f