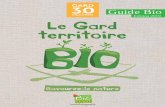Assises 2014 – L’essentiel - le-ser.ch · Au risque de stimuler les fractures, la perte de...
Transcript of Assises 2014 – L’essentiel - le-ser.ch · Au risque de stimuler les fractures, la perte de...
L’entier des Assises peut être (ré)écouté sur: Dossier réalisé par Dominique Eggler www.assises-education.ch
galéRAGE, séquence émotion et prise de conscience La réflexion des Assises 2014 s’est appuyée sur la projection d’un film, galéRAGE – récits de jeunes sur la touche, lequel a touché et interpellé intelligemment la salle. Une base d’échanges précieuse, concrète, des témoignages vrais et francs.
La voie royale, vraiment? Le film galéRAGE, comme le débat y relatif, ont mis en lumière la propension générale à favoriser envers et contre tout l’entrée en école, quelle qu’elle soit, dès après la scolarité obligatoire. Au risque de stimuler les fractures, la perte de confiance, la marginalisation même.
A 15 ans, la question qui tue Entre perte de confiance, manque patent d’information et absence de lien, face aux affirmations souvent contra-dictoires des adultes, à leurs préjugés et aux exigences parfois floues du monde du travail, les dangers sont multiples...
La polarisation des emplois n’aide pas la transition... José Ramirez, professeur à la HEG et membre du groupe d’experts analystes en économie de l’éducation, a brossé un tableau complet et pointu de la situation, basé sur une étude genevoise.
Assises 2014 – L’essentiel
La Glâne tape dans le mille Original et parfaitement dans l’axe des préoccupations, des questions et des espoirs exprimés durant ces Assises, le projet Transition de la Glâne.
Le partenariat, sinon rien! Associée à l’organisation de ces Assises, la FAPERT y a présenté ses souhaits, lesquels s’appuient, sans excep-tion, sur un partenariat de tous les instants, entre les nombreux acteurs de l’éducation et de la formation, qui doit favoriser aussi les solutions individuelles.
L’économie doit aussi s’inviter à l’école Les porte-parole de la CLACESO ont insisté sur la nécessité de réseaux impliquant aussi les patrons. Ils mettent en garde aussi contre le risque de double discours, entre inclusion et lecture des tests PISA, tout en affirmant que sans les parents, tout projet professionnel est perdu d’avance.
Une forme d’échec social, un défi pour l’école Conseillère d’Etat en charge de l’école vaudoise et présidente de la CIIP, Anne-Catherine Lyon a salué le taux très élevé de jeunes Helvètes obtenant un titre du secondaire II, donc ce faisant la qualité de l’instruction publique en Suisse.
Etre vrai sans croire détenir la vérité Pour un regard large et ouvert sur cette journée, le SER a fait appel à Simon Darioli, qui dirigea durant 19 ans le Service social valaisan. Ses impressions, ses pensées, et surtout une réflexion très intéressante.
2
4
5
8
9
10
12
14
16
2 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
E ntrée immédiate dans le vif du sujet et séquence émotions d’emblée, pour ces Assises ouvertes sur un film remarquable de vérité, galéRAGE,
suivi d’un débat avec l’un des trois coréalisateurs, ainsi qu’un des jeunes apparaissant dans le documentaire. Animateur de la journée, Laurent Bonnard évitait les longues palabres d’introduction, mais remarquait tout de même le caractère «pas particulièrement positif» du titre, «Formation sans avenir»... Et d’affirmer que ce pessimisme ne saurait résister au fil rouge de la mani-festation, à savoir l’échange, les échanges.galéRAGE – récits de jeunes sur la touche relate les par-cours sinueux de trois jeunes adultes, Séverin – pré-sent aux Assises –, Mohamed et Stéphane. Réalisé à travers la Permanence Jeunes adultes de la Maison de Quartier de Saint-Jean (MQSJ, voir ci-contre), ce docu-mentaire offre au spectateur un tête-à-tête avec chacun des protagonistes, lesquels s’arrêtent avec beaucoup
La galère brise la parole
w Réalisé en six mois, depuis les premières inter-views, le film donne donc la parole à trois jeunes adultes. «Au départ, nous en avons contactés et interrogés une quinzaine, dont la majorité vivaient alors une véritable galère; pour la plupart d’entre eux, il était conséquemment trop difficile de par-ler. En fait, nous nous sommes arrêtés aux trois seuls jeunes qui avaient déjà entamé un processus de sortie de galère. Ainsi leur était-il possible de prendre un peu de recul.» Aleksandr Thibaudeau le souligne, les réalisateurs avaient pris le pari d’une parole de jeunes, de dé-clarations certes subjectives mais vraies. Ils avaient opté pour le vécu et non pour l’analyse froide. l
galéRAGE, séquence émotion et prise de conscienceLa réflexion de ces Assises s’appuyait sur la projection d’un film, galéRAGE – récits de jeunes sur la touche, lequel a touché et interpellé intelligemment la salle. Une base d’échanges précieuse, concrète, des témoignages vrais et francs, afin que la jour-née abandonne complètement les hautes sphères théoriques pour se pencher sur la réalité de ces parcours chaotiques, dont une partie seulement bifurquent aussi bien que celui de Séverin...
de franchise (et de maturité, aussi!) sur leurs itiné-raires depuis l’adolescence. Des itinéraires marqués par la déscolarisation, les échecs, le doute, la perte de confiance en soi: la galère en somme! Réalisé à trois dans le cadre d’un bachelor obtenu en emploi à la Haute école de travail social de Genève, ce documentaire est signé Laurent Emaldi, responsable de secteur au Groupement intercommunal des activi-tés parascolaires, Marc Remund, animateur sociocul-turel à la Maison des jeunes de Vernier, et Aleksandr Thibaudeau, responsable de la Permanence Jeunes adultes à la MQSJ, où il travaille comme animateur de-puis onze ans.
«Pour les nuls»«Pour tout le monde, y compris pour mon père, il n’y a que le collège qui marche, tout le reste c’est pour les nuls.» «Ce serait bien de se faire suivre jusqu’à 18 ans par l’école, non? On devrait, je pense...» «Ce que je ressentais? L’impression d’être quelqu’un qui ne sert à rien à la société.»L’émotion était évidemment profonde dans la salle, durant le visionnement. Et chaque adulte présent de se sentir directement interpellé, en écoutant les pro-tagonistes de galéRAGE regretter leur manque de connaissances sur la voie de l’apprentissage. Une voie mal promue à leurs yeux, un CFC qu’on ne met pas en évidence. Et d’estimer que les adultes, en particulier les spécialistes de l’éducation et de l’orientation, fail-lissent à leurs devoirs en ne parlant pas suffisamment des possibilités de formation par apprentissage.Appelé à mettre en exergue un message du film par-ticulièrement important à ses yeux, Séverin Porquet affirmait que le suivi des jeunes est capital, après la scolarité obligatoire. «Un accompagnement est néces-saire, on ne devrait pas être lâchés dans la nature avant 18 ans.» Pour sa part, c’est à la Maison de Quartier qu’il est allé chercher cet accompagnement, après un parcours d’errance sans doute évitable. Aujourd’hui au bénéfice d’une formation réussie dans le secteur santé-social – «Et je ne m’arrêterai pas là» –, il a non seulement saisi toutes les chances qui se sont présentées et mené au bout ses projets, mais a surtout mis à profit ses compé-tences personnelles et sociales.
3Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
Toutes compétences que l’école obligatoire n’avait à l’évidence pas révélées, que le processus d’orientation n’avait pas prises en compte... «Mon travail me plaît, mes loisirs aussi», souligne Séverin, professionnel ap-précié dans une crèche et entraîneur de football pour des préadolescents.
Edifiant: «Nous étions une vingtaine, en classe du cycle (n.d.l.r.: le secondaire I), et aujourd’hui nous sommes cinq, tout au plus, à avoir décroché un travail fixe et à temps complet.»
l
w La Maison de Quartier de Saint-Jean a été créée à l’initiative des habitants, lesquels ont souhaité (re)donner une vie socioculturelle à leur quartier. Les premières démarches concertées datent des années 80. Une associa-tion ad hoc a été créée dans la foulée, qui a très vite réuni un grand nombre d’adhérents. La ville de Genève a mis à sa disposition deux maisons acquises dans ce but, et grâce à un soutien financier cantonal et communal, des animateurs ont été engagés. Partenaire à la fois de la ville et du can-ton, l’association appartient à la FCLR, la Fédération cantonale des centres de loisirs et de rencontre, laquelle réunit quarante-trois centres, dont quinze dans la cité même. Elle est intégrée également à la FASe (Fondation gene-voise pour l’animation socioculturelle).Des programmes spécifiques aux di-verses tranches d’âge d’habitants (en-fants dès 4 ans, adolescents, jeunes
adultes, aînés) y sont proposés et les rencontres intergénérationnelles favorisées.Sur le site de l’association, on dé-couvre que la Permanence Jeunes adultes, inaugurée voici quatre ans presque exactement, s’adresse un soir par semaine à tous ceux qui sou-haitent trouver des renseignements ainsi qu’un appui dans leurs dé-marches personnelles, administratives et/ou professionnelles. Elle appartient aux structures mises en place pour les jeunes peinant à s’émanciper et à s’in-tégrer dans le monde du travail. Les animateurs facilitent le passage vers des structures habilitées à répondre au mieux aux besoins identifiés. Ils assument dans ce mandat un rôle de «référent-relais» auprès du réseau interprofessionnel et accompagnent les jeunes pour leur permettre de rac-crocher aux différents dispositifs exis-tants d’insertion professionnelle. Lieu
d’écoute fonctionnant sur le modèle de l’accueil libre et de la libre adhé-sion, la MSQJ assure des suivis inscrits dans la durée, de manière à dépasser le schéma habituel d’aide ponctuelle et répétée. l
galéRAGE, séquence émotion et prise de conscience
Le public était attentif lors de la projection: toutes et tous ont été touchés par les parcours des protagonistes du film.
© n
iro
4 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
L es protagonistes de galéRAGE l’affirment à plu-sieurs reprises: la voie de l’apprentissage ne leur a pas été suffisamment présentée. D’où la
première interrogation traversant la salle: les élèves du cycle ne sont-ils donc pas en contact avec les spécia-listes de l’orientation professionnelle?«J’ai personnellement rencontré un conseiller, préci-sait Séverin Porquet. Il m’a affectivement expliqué que le SCAI (n.d.l.r.: classe de transition professionnelle à Genève, qui correspond souvent ailleurs à une année de préapprentissage) prépare à l’apprentissage. Mais parmi mes camarades de classe, la plupart ont été moins informés: tous ceux qui avaient des notes suffi-santes pour entrer à l’école de commerce, notamment, y ont été dirigés sans autre forme de procès et sans qu’on leur parle d’apprentissage.»En tant que responsable de la Permanence Jeunes adultes à la MQSJ, Aleksandr Thibaudeau entend régu-
La voie royale, vraiment?
Le film galéRAGE, comme le débat y relatif, ont mis en lumière la propension générale à favoriser envers et contre tout l’entrée en école, quelle qu’elle soit, dès après
la scolarité obligatoire. Au risque de stimuler les fractures, la perte de confiance,
la marginalisation même. Quelques remarques émises et autres échanges à ce sujet...
lièrement les remarques émises dans le documentaire. Et de comprendre «qu’il est difficile, pour les ensei-gnants, de vendre l’apprentissage. Il est bien plus aisé de présenter une voie qu’on connaît pour l’avoir suivie, c’est on ne peut plus normal». Ce d’autant que «dans l’esprit général, l’école est la voie royale», le documen-taire l’exprime d’ailleurs très clairement.La voie royale, vraiment? «Les routes sont complète-ment brouillées, pour les jeunes terminant le cycle. Et nous en portons la responsabilité», s’exclamait un participant. «On inscrit bien trop facilement dans des écoles, qu’elles soient de commerce, ECG (Ecole de culture générale) ou autres, des jeunes qui ne sont pas du tout motivés par la voie scolaire. Résultat: ils manquent les cours, sèment la zizanie en classe, sont donc sanctionnés, voire expulsés, et ils s’enfoncent vers le néant.»Les ruptures de ce genre sont souvent évitables, selon plusieurs intervenants convaincus que la société n’est pas suffisamment claire, en matière de chemins ou-verts aux jeunes en fin de scolarité obligatoire. L’un d’entre eux affirmait la nécessité de fermer la moitié des classes, à l’ECG, et de proposer des apprentissages aux élèves dès lors libérés d’une voie sans intérêt et sans avenir pour eux.Enseignant du secondaire II depuis peu, après des an-nées passées au secondaire I, un autre participant en appelle les uns et les autres à tirer un trait sur leurs représentations d’adultes, qui sont en déliquescence. «A chaque élève qui ne peut (ou ne veut) pas faire d’études, nous devons clairement proposer un appren-tissage. C’est à nous autres adultes de nous remettre en cause.»Tandis qu’un ressortissant de ce canton soulignait la nécessité d’améliorer l’orientation professionnelle au Aleksandr Thibaudeau: «N’oubliez pas de présenter les apprentissages!»
© n
iro
5Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
«Q ue faire, entre la fin du cycle (secondaire I) et l’apprentissage, lorsqu’on n’a pas trouvé de place de formation et qu’on
n’est pas un bon élève? C’est aux plus faibles que l’on impose un choix. Que veux-tu faire de ta vie? A 15 ans, c’est la question qui tue!»
Sous-titreUne affirmation entendue durant le débat: les élèves en difficultés ont besoin de temps, après le secondaire I, pour atteindre une certaine maturité. La maturité qui leur permettra ensuite d’effectuer un choix, de se fixer des objectifs et de consacrer toute leur énergie à l’at-teindre. Il reste qu’en amont déjà, cette «maturation»
A 15 ans, la question qui tueEntre perte de confiance, manque patent d’information et absence de lien, face aux affirmations souvent contradictoires des adultes, à leurs préjugés et aux exigences parfois floues du monde du travail, les dangers sont multiples...
Tessin, un ancien professeur du cycle d’orientation (le secondaire I genevois) traduisait un sentiment visi-blement partagé largement: «A ce niveau, on ne peut pas parler d’orientation, mais bien d’un système de sélection par écrémages successifs. De fait, l’école externalise le problème, vers les passerelles et autres filets mis en place. Une école qui veut coller au monde du travail, alors même qu’elle doit viser la citoyenneté dans la soutenabilité.» Et de conclure qu’une sérieuse remise en question s’impose...Prise à partie dans le film et dans le débat, l’ECG n’est pas forcément une voie de garage, rappelait un partici-pant: «Cette école sauve la moitié des élèves en échec au collège et tire en avant 50% des élèves libérés du cycle sans perspective immédiate pour la suite. Pour une moitié des jeunes, l’ECG est l’école de la deuxième chance.» l
© n
iro
Séverin Porquet: «Il faudrait définir les désirs de chacun.»
6 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
Bienvenue dans la jungle!
w C’est apparu à plusieurs reprises durant la journée, l’orientation et le soutien des jeunes en fin de scolarité (et en formation) relèvent d’un partenariat indispensable entre divers acteurs. Or parmi ces partenaires, les parents ne sont pas toujours armés pour la tâche qui les attend: «Pour les parents, le monde de la formation est aujourd’hui d’une infinie complexité», relevait-on. Et par ailleurs: «Le réseau est capital. Les parents qui n’en ont pas, du moins pas dans le monde de la formation, rencontrent bien des difficultés dans l’accompagnement de leur enfant.»Quant aux jeunes eux-mêmes, le passage n’est pas plus aisé, quelle que soit leur situation: «Le marché du travail est une jungle, à laquelle il n’est vraiment pas facile de se confronter lorsqu’on a 15 ans! Dès lors, un suivi très indivi-dualisé est nécessaire, qui fait encore défaut.» l
demande à être préparée et même lancée. Séverin Porquet: «Durant le cycle d’orientation (secondaire I), on devrait travailler davantage les compétences indi-viduelles, les cerner et les développer, et définir les désirs réels de chacun. De surcroît, il faudrait aider les élèves à dénicher des stages.»
Identification et valorisationCes stages, susceptibles à la fois de leur ouvrir des possibilités de formation et d’enrichir leur information sur le monde du travail, les futurs acteurs de la société
en ont besoin, et pas uniquement durant les dernières années d’école obligatoire. Une remarque importante faite en effet au cours des discussions: «Il faut abso-lument offrir des stages aux jeunes de plus de 15 ans également, les aider à trouver des places de ce type et les encadrer ensuite.»Par ailleurs, on a entendu à plusieurs reprises, du-rant ces Assises, que l’identification et la valorisa-tion des compétences pèchent à l’école obligatoire. On y attache si peu d’importance, semble-t-il, que de nombreux élèves sortants se sentent tout bonnement incompétents et risquent, de fait, d’être jugés comme tels.
L’appartenance au quartierL’expérience engrangée, à ce sujet, par Aleksandr Thibaudeau: «A la Permanence Jeunes adultes, nous devons consacrer une majorité de temps et d’éner-gie à reconstruire la confiance en soi. Les jeunes que nous accueillons ont perdu leur confiance sur les bancs d’école, et sont tombés conséquemment dans une sur-valorisation du quartier, de l’appartenance emprison-nante à celui-ci. Cette appartenance excessive handi-cape leur émancipation, crée de véritables barrières dans toute démarche de recherche. Elle pose problème lorsqu’il s’agit de faire appel à des structures canto-nales, municipales même.»
Retrouver la motivationAutre gros problème soulevé durant le débat, l’écart entre les attentes des employeurs et la réalité du monde l’école, tel que l’exprime également Aleksandr Thibaudeau: «Contrairement à ce qu’imagine et ap-
© n
iro
© G
iann
i Gir
ingh
elli
Laurent Bonnard (au centre), animateur de ces Assises, convaincu que les débats de la journée ouvriront de nouvelles perspectives.
7Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
Des liens à recréer
w La notion de lien est ressortie du débat, où l’on a regretté que l’individualisme et l’égoïsme gangrènent la société in globo, école malheureusement comprise. «Il faut impérati-vement sortir de cette pensée en silo, où l’on s’invective les uns les autres, où l’on se juge sur des présupposés. Il faut recréer du lien, des liens», s’exclamait un enseignant.
La confiance en soi, toujoursDes propos auxquels le coréalisateur Aleksandr Thibaudeau ajoutait: «J’ai appris, au fil des entretiens menés pour ce documentaire, que la notion de lien est effectivement fon-damentale.» Des liens nécessaires pour pouvoir conserver la confiance en soi, pour affronter sereinement l’extérieur et pour appréhender positivement l’avenir. l
plique l’école obligatoire, les maîtres d’apprentissage ne demandent pas des apprentis surformés, mais des jeunes motivés et faisant preuve d’une maturité encore inexistante à 15 ans...» Paradoxe, encore...Quant aux contacts entre le secondaire I et le monde du travail, les enseignants sont parfois confrontés à des situations très dérangeantes. «L’école fournit par-fois des renseignements sur des élèves, à la demande de potentiels futurs employeurs-formateurs ou maîtres de stage. Ces renseignements incluent par exemple les absences enregistrées durant la scolarité obligatoire, ou d’autres éléments du genre, qui aboutissent à ce qu’un dossier soit écarté d’emblée.» Une élimination immédiate, alors même que le jeune concerné réunirait toutes les compétences personnelles nécessaires dans la branche en question... «Chaque année, huit cents jeunes terminent leur sco-larité obligatoire sans aucune solution pour leur ave-nir immédiat. Ils sont alors confrontés à une quantité d’injonctions, souvent paradoxales. Handicap supplé-mentaire: dans 95% des cas, leur dossier donne une image d’eux qui ne correspond pas du tout à la réa-lité», relevait un case manager du canton de Vaud. Non sans souligner la vanité de discuter sur le système, en sachant que ces huit cents cas sont tous des cas par-ticuliers, qui doivent donc être abordés comme tels et exigent un suivi personnalisé...Le mot de la fin, dans le même ordre d’idée, à Aleksandr Thibaudeau: «Il n’existe plus de voie royale, il est grand temps que sorte des mœurs le sempiternel «le collège, sinon rien». Il y a aujourd’hui des voies, et surtout une voie personnelle!» l
© n
iro
© G
iann
i Gir
ingh
elli
8 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
José Ramirez: «La discrimination à l’embauche est réelle!»
© n
iro
S ’attachant à la situation générale, José Ramirez soulignait que la tertiarisation de l’économie suisse, ces quatre à cinq dernières décennies, a
bien évidemment induit de gros changements en terme de demandes de compétences sur le marché du travail. D’une moitié en 1970, les jeunes formés dans l’indus-trie et le bâtiment ont passé à quelque 23% en 2005, au bénéfice évidemment de ceux qui sont engagés dans les services.
La polarisation des emplois n’aide pas la transition...José Ramirez, professeur à la HEG et membre du groupe d’experts analystes en écono-mie de l’éducation, brossait un tableau complet et pointu de la situation, basé sur une étude genevoise. Une conférence de haut niveau, dont nous extrairons ici quelques élé-ments marquants.
wAlors même que leur nombre explose - dans certains can-tons, 15% des élèves sortants y passent un temps -, les solutions transitoires ne seraient pas forcément de bonnes solutions... «Ce type de solution, quelle qu’elle soit, consti-tue déjà en soi une trajectoire non linéaire. De surcroît, les statistiques révèlent que la fréquentation d’une solution transitoire ne contribue pas à diminuer les ruptures tout au long du parcours ultérieur de formation, tout au contraire»,
souligne José Ramirez. En ajoutant que le redoublement à l’école obligatoire, lui aussi, augmente la probabilité d’une trajectoire de formation non linéaire. Toujours quant à l’augmentation du recours aux solutions transitoires, l’économiste ajoute que l’Allemagne précède la Suisse dans cette évolution: «Un gros tiers des jeunes y passent, alors même que l’école y est obligatoire jusqu’à 18 ans!» l
Des «solutions» transitoires, vraiment?
Ces quinze à vingt dernières années s’est ajoutée à ce phénomène la polarisation extrême des emplois, par ailleurs concentrés en milieu urbain: les emplois créés le sont tout en haut ou tout en bas de l’échelle, en terme de niveau de compétences exigé et donc égale-ment de salaire versé. Voilà qui n’est évidemment pas pour faciliter la transition des élèves libérés de l’école obligatoire, dans leur grande majorité. Pour les élèves dits moyens, la situation s’aggrave encore par le fait que les entreprises choisissent, pour apprentis, les meilleurs élèves scolairement parlant. Un choix parfaitement justifié par les statistiques: en effet, les notes du cycle (secondaire I) sont très géné-ralement confirmées à l’école professionnelle et aux examens finaux...Quant au poids numérique de l’apprentissage, par can-ton, le spécialiste ne manquait pas de mettre en exergue les considérables disparités: tandis que 20% seule-ment des élèves libérés suivent un apprentissage en terre genevoise, ils sont 65% dans le canton de Berne, à peu près autant dans ceux de Fribourg et du Valais, et quasiment 90% en Appenzell Rhodes-Intérieures!José Ramirez s’y arrêtait durant son exposé et on y revenait dans le débat: la discrimination à l’embauche est bien réelle, selon l’ethnie ou la nationalité. La po-pulation étrangère est d’ailleurs guettée davantage par les ruptures, les facteurs de risques se multipliant pour elle. Et l’orateur de préciser que la question demeure ouverte de savoir si les élèves étrangers s’en sorti-raient mieux dans le cas d’une sélection tenant moins compte du français.
9Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
R achel Descloux, travailleuse sociale, coordina-trice du projet, et Christophe Brulhart, ensei-gnant et médiateur, en ont présenté les fon-
dements. En rappelant que le projet Transition est né d’une longue réflexion, induite par l’inquiétude des autorités et de la population face aux incivilités crois-santes. Une réflexion menée par un groupe très pluri-disciplinaire, puisqu’y étaient représentés notamment les communes, la préfecture, la police et la justice, les établissements scolaires, les parents d’élèves, les ser-vices de l’enfance et de la jeunesse. Transition offre depuis un an et demi un suivi obliga-toire à tous les jeunes qui terminent le secondaire I sans projet professionnel, facultatif à tous ceux qui le demandent, y compris des plus de 20 ans. Les besoins ne manquent pas, les réponses touchent au but. Pour les apporter, le projet s’appuie sur un réseau qu’il a créé avec les entrepreneurs de la région, afin de pro-poser les stages nécessaires à un véritable choix, les préapprentissages susceptibles d’ouvrir une entrée se-reine dans le monde du travail et autres mini jobs per-mettant de raccrocher avec la vie professionnelle et ses rythmes. Exemples d’actions menées pour atteindre ces buts: au Comptoir régional, Transition a organisé une rencontre entre une trentaine de chefs d’entre-prises et les jeunes en demande, avec pour résultat probant la mise sur pied de quatre-vingt-huit stages. Par ailleurs, il propose régulièrement un genre de tables rondes, qui mettent en lien quelques jeunes et un ou deux patrons, ces derniers explicitant clairement
La Glâne tape dans le milleOriginal et parfaitement dans l’axe des préoccupations, des questions et des espoirs exprimés durant ces Assises, le projet Transition de la Glâne.
leurs attentes, leurs critères de choix et leurs offres, en matière d’apprentissage.Le financement de Transition est assuré jusqu’à fin 2016, pour moitié par l’association des communes glânoises, pour un quart par l’Etat fribourgeois et pour le dernier quart par la fondation privée Jacobs. Son fonctionnement s’appuie non seulement sur des travailleurs sociaux, mais également sur des ensei-gnants. Parallèlement aux cours qu’il dispense au cycle d’orientation (sec. I), Christophe Brulhart coache à la fois des élèves sortis de l’école obligatoire, dans leurs recherches d’une voie de formation, et des apprentis qui ont besoin d’appui dans certaines branches. Le suivi est dense et durable, le lien solide, l’expérience visiblement fructueuse! l
Autre handicap pour ces jeunes issus de l’immigration récente, mis en exergue durant le débat: leurs familles sont souvent très mal informées quant au système d’éducation et de formation helvétique; pire, elles portent parfois un jugement très négatif sur l’école publique, qu’elles assimilent à celle de leurs contrées d’origine. Tel est notamment le cas de certains pays d’Amérique du Sud, où les parents se saignent pour scolariser leurs enfants dans le privé. Toujours dans le cas des migrants, José Ramirez insis-tait sur l’«effet Kindergarten». En affirmant que pour éviter un retard important aux enfants étrangers de milieux non favorisés, la meilleure solution consiste-rait à les scolariser de deux à quatre ans. Les pays du Nord ont expérimenté avec succès cette scolarisation hâtive, dont l’effet positif est augmenté encore par une nouvelle méthode d’évaluation.Quant à la quasi-sacralisation des titres académiques et donc des filières éponymes, particulièrement pré-sente en terre genevoise, l’orateur soulignait qu’elle est pourtant démentie sur le marché du travail lui-
même. Un marché qui privilégie par exemple les déten-teurs d’un bachelor HEG obtenu en emploi. Le choix des entreprises est logiquement vite fait, lorsqu’il implique d’opter pour un employé avec ou sans expérience du monde du travail! Et José Ramirez de souligner que le collège n’est pas la seule voie pour arriver à une formation de niveau tertiaire. Pour preuve le nombre croissant de gymnasiens qui rallient la HEG, après une année de stage.Nécessité unanimement reconnue durant ces Assises, celle de prendre en compte les compétences non co-gnitives, persévérance, estime de soi, concentration, capacité à collaborer et consorts. Or aux yeux de José Ramirez, comme à ceux de nombreux autres inter-venants, cette prise en compte s’accompagne d’un temps un peu plus long laissé aux jeunes pour choi-sir leur voie. Non sans ajouter que le locus de contrôle interne est inversement proportionnel au risque de se voir contraint à emprunter une voie de formation non souhaitée... l
10 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
tervention très imagée, il décrivait les deux catégories d’outils nécessaires pour construire cette vie profes-sionnelle, à savoir un PC et les programmes adaptés. En ce qui concerne les programmes, le nouveau pré-sident de la FAPERT se déclarait d’emblée très satisfait: «Le PER convient très bien!» Quant au PC nécessaire pour appliquer ledit PER (Plan d’études romand), il détrompait rapidement son auditoire. Pas question ici de matériel informatique, mais bien de l’abréviation utilisée pour exprimer le duo «partenariat et collabora-tion», en soulignant que pour éduquer un enfant, on a besoin de tout un village ou presque. Paul Majcherczyk insiste en effet sur la nécessité d’im-pliquer tous les acteurs concernés de près ou de loin par l’éducation, à commencer par l’école, les ensei-gnants et les parents évidemment, mais également les spécialistes de l’orientation professionnelle ainsi que les nombreux protagonistes de diverses associations possiblement influentes. «Tous ces partenaires colla-borants doivent non seulement pouvoir s’exprimer, mais également s’écouter les uns les autres.»Pour le président de la FAPERT, la scolarité obligatoire, dans son ensemble, s’apparente à un voyage en train. Emmené par la locomotive «école», le convoi est formé des partenaires cités plus haut, auxquels sont «accro-chés» les enfants. «Tous les partenaires sont liés, mais certains liens sont parfois ratés.» Comme dans un des-sin de très jeune enfant, rien n’est parfait, le train est charmant, mais la ligne parfois chaotique... Le train part à l’heure prévue, son mécanicien s’efforce d’arri-ver à temps au terminus, mais derrière lui, certaines voitures peinent à garder leurs roues sur les rails, cer-tains wagons subissent des accidents de parcours, sans que la locomotive jamais ne puisse s’arrêter...Chaque parent surveille le voyage de son enfant et en cas d’accident, son premier besoin consiste à com-muniquer avec la tête du convoi, à pouvoir même décrocher temporairement la voiture pour la réparer. Décelé et remédié tôt, un problème n’empêchera pas le voyage de se terminer au mieux, devait souligner l’ora-teur. Mais pour cela, la communication doit fonctionner sans interruption, la possibilité d’un voyage personna-
w Tout en saluant les initiatives collectives récentes prises ici et là pour valoriser la formation duale (Cité des métiers, Capa’cité, etc.), la FAPERT estime que ce n’est pas suffi-sant. A l’attention des élèves en rupture au secondaire I, elle estime indispensable, avec tous les intervenants de ces Assises d’ailleurs, d’apporter des réponses individuelles. Des réponses à prolonger de surcroît après la scolarité obli-gatoire, durant même l’intégralité de la formation.Dans le même ordre d’idée, la FAPERT en appelle à l’innova-tion, pour résoudre le problème des toujours plus nombreux
adolescents arrivant en fin de scolarité obligatoire sans être déterminés du tout quant à leur avenir. Innover pour leur offrir une solution qui leur évite de décrocher complète-ment, et leur donne un temps de maturation nécessaire. «Il faut que ces jeunes continuent à découvrir des domaines, des métiers, tout en grandissant suffisamment pour pouvoir s’engager dans une formation qui leur corresponde.» Petits jobs évitant l’attente inactive et dévalorisante, stages, etc., toutes les solutions constructives méritent d’être étudiées et adaptées individuellement. l
Des réponses individuelles
Dessin réalisé par William, 2H
P our donner la parole aux parents, un duo: l’ancienne présidente de la FAPERT, Judith Vuagniaux, et son successeur, Paul Majcherczyk.
Ce dernier lançait son exposé en affirmant que tout parent souhaite voir son enfant démarrer dans la vie adulte avec une activité professionnelle qui lui plaise vraiment, qui soit adaptée au mieux à ses compé-tences personnelles et qui lui permette évidemment de mener une existence indépendante. A travers une in-
Le partenariat, sinon rien!
Associée à l’organisation de ces Assises, la FAPERT (Fédération des associations
de parents d’élèves de Suisse romande et du Tessin) y a présenté ses souhaits, lesquels s’appuient, sans exception, sur un partenariat
de tous les instants, entre les nombreux acteurs de l’éducation et de la formation.
Un partenariat qui doit favoriser aussi les solutions individuelles.
11Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
lisé doit être offerte, jusqu’à la gare terminus où sont annoncées les correspondances pour la suite.Dans le train de la scolarité obligatoire, les besoins sont nombreux. Judith Vuagniaux en faisait le tour, à commencer par le développement de la confiance en soi, de l’estime de soi. Ces deux valeurs, les parents attendent de l’école qu’elle les nourrisse, en tant que besoins fondamentaux. La motivation, elle aussi, pour-rait croître durant ces années de formation de base, à travers un projet personnel par exemple et même surtout.Autre et grande attente des parents, durant ce voyage scolaire: être eux-mêmes mieux informés, explications détaillées à la clé, sur un système de formation devenu extrêmement complexe. Et Judith Vuagniaux de souli-gner combien la tâche des parents est ardue, lorsqu’il s’agit d’orienter un enfant vers une transition, respec-tivement une formation, qui lui permette un dévelop-pement non seulement professionnel, mais également personnel! Ce d’autant qu’à la complexité générale du problème s’ajoute la difficulté de discerner quelles formations débouchent réellement sur une possibilité d’emploi...Non moins important, aux yeux de tous les parents, la diversité indispensable du panel de formations pos-
sibles, des apprentissages aux écoles à plein temps, en passant par des écoles supérieures. La FAPERT n’a nullement envie ni de dévaloriser, ni de survaloriser une filière ou une autre. Tout au contraire, elle sou-ligne le besoin, au niveau de la Suisse romande, d’une vision non pas (plus...) hiérarchique, mais complémen-taire de toutes les formations offertes. «Cette vision doit changer, non seulement au sein de l’école, de ses directions, mais également aux yeux des parents, de la société en général.» Un véritable défi, après des dé-cennies d’idées et de principes aujourd’hui dépassés... L’évolution de la société, de l’économie, l’accumula-tion des jeux de pression, ont contribué à changer fon-damentalement la donne, à l’heure où l’on rencontre par exemple des jeunes qui abandonnent la voie uni-versitaire, où ils réussissent pourtant fort bien, mais où ils ne s’épanouissent pas, pour entreprendre un apprentissage artisanal.Judith Vuagniaux souhaite par ailleurs que les jeunes en rupture familiale, ou privés de l’encadrement fami-lial susceptible de leur insuffler confiance en soi et va-leurs personnelles, puissent trouver quelqu’un sur qui s’appuyer. Et d’insister, en conclusion, sur l’importance du partenariat éducatif avec l’école. l
w Parmi les problèmes auxquels sont confrontés les parents, il ne faut pas négliger la hausse continuelle des coûts de formation, hausse nourrie par divers facteurs tels que l’aug-mentation des transports, les exigences croissantes en termes de mobilité, l’allongement de nombreux cursus... Judith Vuagniaux mettait le doigt sur la question, en y ajou-tant les inégalités entre régions. Exemple: pour un jeune Neuchâtelois souhaitant suivre une école d’art, non sélectionné à La Chaux-de-Fonds, mais ac-cepté dans un établissement vaudois ou bernois, le canton
de domicile refusera de payer les coûts de formation. Ainsi, même parmi les jeunes nourrissant un projet précis et se donnant les moyens de le réaliser, il existe des situations difficiles, voire inextricables... La FAPERT lance un appel, à ce sujet, pour que les instances concernées s’efforcent de mettre en place une égalité de traitement au niveau romand.
l
Casser les frontières
Judith Vuagniaux et Paul Majcherczyk: la FAPERT ne veut favoriser ou dévaloriser aucune filière
© n
iro
12 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
A riane Denonfoux, qui dirige un établissement primaire dans le canton de Genève, et Hassan Bugnard, à la tête d’un cycle d’orientation
(secondaire I) en terre fribourgeoise, présentaient les préoccupations, en matière de transition, de la toute nouvelle CLACESO. Une association des directeurs d’établissements représentant désormais toute la sco-larité obligatoire et en ce sens porteuse de forts espoirs, soulignait au passage Georges Pasquier, président du SER; lequel émettait le vœu que des quasi amicales connues jusque-là, on passe désormais à une véritable représentation professionnelle des directions.
Sur le thème de ces Assises, la CLACESO dirige sa réflexion vers trois axes. Cherchant premièrement à définir les profils des besoins manifestés par les élèves sans solution au terme du cycle obligatoire, elle planche ensuite sur les aides à créer (ou à activer, lorsqu’elles existent) en fonction précisément de ces besoins. En ne perdant jamais de vue qu’il s’agit de cas individuels, de situations différentes, de probléma-tiques très typées. Pour troisième étape de réflexion, la CLACESO s’intéresse à la marge de manœuvre que le cadre légal laisse effectivement aux directions, en matière d’accompagnement personnalisé.
L’économie doit aussi
s’inviter à l’écoleLes porte-parole de la CLACESO (Conférence
latine des chefs d’établissement de la scolarité obligatoire) insistent notamment sur la
nécessité de réseaux impliquant aussi les patrons. Mais ils mettent également en garde
contre le risque de double discours, entre inclusion et lecture des tests PISA, tout en affirmant que sans les parents, tout projet
professionnel est perdu d’avance.
w L’orientation professionnelle (dont l’absence des débats a été regrettée à plusieurs reprises) a subi durant ces Assises de nombreuses critiques constructives, adressées plutôt au système en lui-même qu’aux acteurs de cette spécialité. En première partie de journée, on a notamment entendu les protagonistes du film regretter de ne pas avoir été suf-fisamment informés sur la voie de l’apprentissage. Ceci expliquant sans doute cela, les directeurs d’établissement, pour leur part, se sont penchés sur la composition même de l’équipe d’orientation: la CLACESO s’étonne, et même regrette d’y rencontrer exclusivement des spécialistes for-més par la voie académique. Personne n’y a vécu la voie duale, une filière qui est donc «vendue» sur la seule base de connaissances extérieures... l
Quelle orientation, sans le dual?
© n
iro
© n
iro
Ariane Denonfoux et Hassan Bugnard: «De très intéressants projets sont déjà sur pied.»
13Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
Or comme aux autres participants de ces Assises, il est apparu d’emblée aux directeurs que le partenariat de tous les acteurs est primordial. Un partenariat qui doit permettre aussi, pour première étape, d’étouffer tous les possibles dénis, de la part des parents en particulier.Quant à l’anticipation de l’orientation, souhaitée de toutes parts ou peu s’en faut, la CLACESO s’interroge sérieusement sur la capacité des plus jeunes à se pro-jeter dans l’avenir, eux qui sont nés dans cette société du clic immédiat... Et de souligner que la faculté à mobiliser ses propres ressources est souvent liée à une certaine maturité. Le temps nécessaire à chaque individu n’est pas compres-sible, on le rappelait une fois encore.Dans leurs réflexions, les directeurs mentionnent eux aussi l’importance d’accompagner les parents, dans des démarches parfois complexes pour eux; mais ils jugent surtout primordial d’intégrer les patrons à l’orientation. En précisant l’importance à la fois que ces patrons comprennent le langage de l’école et que les écoliers secondaires comprennent celui de l’économie. Et de saluer dans ce sens la Semaine de sensibilisation individuelle, qui induit l’entrée du concret à l’école; lorsqu’un patron explique comment il va lire un dossier personnel, son jeune interlocuteur touche de près le fonctionnement du monde du travail. Pour Hassan Bugnard et ses confrères, le partenariat avec les patrons, les réseaux qui les intègrent et les stages professionnels avec feed-back sont particulière-ment porteurs. Dans la foulée, la CLACESO met en exergue l’intérêt des dispositifs déjà mis en place, notamment par la Confédération. Parmi eux, le système du case manage-ment, qui permet un accompagnement plus serré dans les situations sensibles, ou encore le projet Lift, qui
offre aux jeunes de se distinguer par leurs compétences personnelles; une certaine lenteur d’apprentissage im-porte-t-elle vraiment aux yeux d’un patron, lorsqu’un stagiaire fait preuve de ponctualité, de motivation évi-dente et d’un engagement sans faille, jusqu’au bout d’une tâche ou d’un contrat?Conclusion de la CLACESO à ce stade: il existe diffé-rents possibles, de très intéressants projets sont déjà sur pied, notamment dans plusieurs cantons romands. Aussi s’agit-il à son sens de les mutualiser, de les faire arriver dans toutes les écoles, avant de vouloir tout réinventer. Un bémol, à ne surtout pas négliger, exprimé par Ariane Denonfoux. Laquelle rappelle que s’il met bien l’accent sur les compétences et non seulement sur les connaissances, ce qui est unanimement salué, le PER n’a encore que peu de vie dans les écoles. «Il faudra encore quelques années pour arriver au fond de ce pro-gramme, en particulier au cycle 3 (n.d.l.r.: fin du secon-daire I).»Plus avant, la directrice tire la sonnette d’alarme, qui craint le risque d’un double discours: «Alors même que l’on nous demande de plus en plus d’être atten-tifs à l’individu, les autorités, elles, se basent sur les seuls chiffres tangibles disponibles, à savoir PISA, les épreuves de références...»Son confrère du cycle ajoute que certains cantons offrent des aides concrètes dans la prise en charge des élèves aux besoins différents, parfois en lien avec des soutiens communaux. Reconnaissant qu’il y a certes là une solution, il préci-sait qu’à son sens, ce n’est pas dans un type de classe que l’on trouvera la meilleure, ou du moins la seule réponse efficace à ces besoins spécifiques, mais plutôt dans la marge de manœuvre laissée à chaque établis-sement pour gérer la différence. l
w Dans le débat qui a suivi les interventions de la FAPERT et de la CLACESO, une intervenante a regretté une avalanche d’informations, au niveau post-obligatoire, et un manque de coordination dans les différentes offres possibles. Un manque de clarté dommageable, pour des jeunes et des parents soumis au stress d’une transition mal négociée.Sur question, Hassan Bugnard affirmait que les directeurs du cycle dirigent clairement leur focale sur l’après-scolarité obligatoire. Leur mission perdrait tout son sens, si elle se considérait comme une fin en soi. «Dès lors qu’on appar-tient à un cycle qui sert de transition, on prépare l’avenir. Et on le prépare non seulement en 11e, mais en amont.» Et de souligner qu’en suscitant la mobilisation des ressources, le plus tôt possible, les établissements du secondaire doivent
appliquer les principes de l’inclusion et adapter les moyens de cette mobilisation à chaque situation, à chaque individu.Plus avant, tandis que Judith Vuagniaux soulignait le temps considérable consacré par la FAPERT, elle aussi, à sensibi-liser les parents sur la nécessité d’engager très tôt une ré-flexion sur l’avenir professionnel de leurs enfants, le même Hassan Bugnard affirmait sa conviction d’une responsabi-lité conjointe en matière de transition. «La sensibilisation est clairement de la responsabilité de l’école, tandis que l’accompagnement incombe aux parents. Mais pour la mo-bilisation, nous devons compter sur les jeunes, qui doivent demeurer les acteurs de leur avenir. Nous devons impérati-vement travailler en réseau, mais tout aussi impérativement savoir garder chacun son rôle.» l
A chacun son rôle!
14 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
M ême si elle était tenue éloignée des débats matinaux par une importante manifestation culturelle, un domaine dont elle assume éga-
lement la direction cantonale, Anne-Catherine Lyon ne manquait pas d’intervenir durant ces Assises, elle qui préside pour la deuxième fois, depuis ce printemps, la CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction pu-blique de la Suisse romande et du Tessin).Affirmant en préambule que le thème des jeunes sans formation ni projet professionnels lui tient très à cœur depuis bien longtemps, l’élue socialiste soulignait pourtant immédiatement ensuite que les systèmes scolaires de Suisse se donnent visiblement les moyens de leurs grandes ambitions: «Parmi les jeunes qui ont suivi toute leur scolarité dans ce pays, de quelque nationalité ou origine qu’ils soient, 95% obtiennent un titre du secondaire II.» Saluant ce chiffre très élevé, l’oratrice exprimait son souhait que l’on ajoute, à la photographie de fin de scolarité obligatoire, un autre état de la situation effectué celui-là à 20, voire même
Une forme d’échec social,
un défi pour l’écoleConseillère d’Etat en charge de l’école vaudoise, Anne-Catherine Lyon soulignait son intérêt pour
le thème de ces Assises 2014. Non sans saluer le taux très élevé de jeunes Helvètes obtenant
un titre du secondaire II, donc ce faisant la qualité de l’instruction publique en Suisse.
w PISA 2012 désigne une fois de plus Fribourg et le Valais comme les cantons les plus performants. «Or parmi les «recettes» de leur succès, ces deux cantons mettent eux-mêmes en exergue le climat de classe, la confiance des élèves face à la discipline», relève la présidente de la CIIP. En ajoutant que les compétences sociales, dont le dévelop-pement est incontestablement favorisé par un meilleur cli-mat de classe, sont des éléments centraux de l’éducation, elles qui se traduisent par la confiance en soi.
Quant au canton de Fribourg en particulier, Anne-Catherine Lyon s’arrêtait sur le projet Transition, présenté en matinée aux participants des Assises et qui permet d’optimiser le choix d’une profession ou d’une formation. Une manière fort intéressante, à son sens, de répartir les responsabilités, d’améliorer l’organisation générale de l’orientation, donc de préparer au mieux les jeunes à entrer dans le monde du travail. l
Valais et Fribourg pour exemples
© n
iro
Anne-Catherine Lyon: «Accordons une attention particulière à l’individu.»
15Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel Assises 2014 – L’essentiel
La schizophrénie des patrons politiciens...
w Anne-Catherine Lyon s’arrêtait, en le déplorant, au paradoxe vivant que personnifient nombre d’élus et patrons à la fois. «Pour la majorité des acteurs du monde politique, en particulier ceux qui sont issus des partis proches des milieux économiques, les compétences sociales des jeunes continuent à compter pour beurre, alors même que les acteurs du monde économique, eux, y attachent une grande importance. Ainsi certains élus arrivent-ils à rejeter, en tant que politiques, ce qu’ils exigent en tant que patrons...» Et d’estimer que la Suisse romande aurait sans doute beaucoup à apprendre, dans ce domaine, des cantons de Fribourg et du Valais. l
25 ans. «Les parcours sont parfois sinueux, qui em-pruntent des passerelles ou des chemins de traverse. Sans doute cette photographie ultérieure nous réser-verait-elle des surprises.»Aux décrochages temporaires et autres bifurcations, le système actuel n’est sans doute pas étranger, selon une conseillère d’Etat soulignant que son immédiateté complexifie le passage entre le cycle d’orientation (se-condaire I) et le secondaire II. Décrochage, exclusions, ces mots sont très forts et touchent le cœur même du pays, pour l’oratrice affirmant clairement qu’il s’agit bel et bien d’une forme d’échec social. «L’école n’en est surtout pas la seule responsable, ni même le seul remède, mais elle doit pourtant contribuer grandement à résoudre» ces difficultés.L’hétérogénéité de la population constitue un véritable défi pour l’école, ne manquait pas d’affirmer plus avant Anne-Catherine Lyon. En rappelant que pour les élèves qui rejoignent l’école helvétique en cours de parcours, le taux d’obtention d’un titre du secondaire II descend un peu en dessous de 90%. Toute action doit conséquemment passer d’abord par l’identification des groupes à risques. «En Suisse romande, la dernière enquête PISA l’a révélé une fois encore, il n’y a aucun souci à se faire pour les meil-leurs élèves. Les proportions d’élèves très faibles, par contre, varient sensiblement, de 5 à 16 pour cent.» Et c’est justement d’eux qu’il faut impérativement et sé-rieusement se préoccuper.«PISA l’a également mis en lumière: le niveau socio-économique des élèves – plus nettement encore que l’allophonie! – est en corrélation directe avec leurs ré-sultats.» En prolongement de celui de l’hétérogénéité, il s’agit donc pour l’école de relever un autre défi tout aussi élevé: celui de pallier les difficultés liées au ni-veau socioculturel! En n’oubliant pas que les problèmes
d’accès au degré post-obligatoire trouvent également d’autres sources précises, notamment les redouble-ments ou les difficultés de lecture et d’écriture.Quoi qu’il en soit, «les entreprises ne choisissent plus celles et ceux pour lesquels l’apprentissage a juste-ment été créé», déplorait la conseillère d’Etat vaudoise en estimant que ce qui se joue au niveau de la forma-tion est très complexe, les freins venant même parfois des syndicats et du secteur privé. Et de citer les difficul-tés rencontrées par son département, avec les milieux concernés au premier chef, pour l’introduction des Certificats fédéraux de capacité d’assistant en soins communautaires et d’animateur socioculturel...Pour conclure son intervention, la présidente de la CIIP revenait au taux très élevé d’obtention de titres du secondaire II. Un résultat dont elle estime qu’il doit demeurer la ligne à suivre, en cherchant à l’améliorer encore, mais tout en accordant une attention particu-lière à l’individu, aux individus, aux cas particuliers. l
© n
iro
16 Educateur 11.14
Assises 2014 – L’essentiel
A près les parcours d’errance découverts et inter-rogés dans une ambiance très émotionnelle – et qui l’ont profondément interpellé, tout
comme l’auditoire en général –, puis les questions plus structurelles et organisationnelles, la journée a fermé la boucle en retournant à l’errance. Cela dit, rien n’est pourtant clos ni résolu sur le sujet et Simon Darioli de poser un postulat: «Je ne connais aucun jeune qui sou-haite être exclu ou malheureux, ni aucun parent qui ne souhaite le meilleur pour ses enfants. Je ne connais pas davantage un enseignant qui ne regrette l’échec de n’importe quel élève.» Un postulat éminemment optimiste en soi; chacun visant le même but, une vraie collaboration devrait indubitablement conduire à une amélioration de la situation.Il n’en reste pas moins qu’en bons professionnels, «nous disons très vite ce que nous savons, sans tou-jours nous rendre compte que parfois, ce faisant, nous exacerbons l’exclusion, la révolte, la colère, que nous voulions justement toutes trois éviter…»Si tout système tend à assimiler un corps étranger, il tend aussi à l’expulser lorsqu’il ne parvient pas à le «di-gérer». Famille, école, groupe, entreprise et consorts, aucun n’échappe à des limites de tolérance. Mais dans
le cas de jeunes au seuil de la vie adulte, que propo-sons-nous après ces limites? s’interroge Simon Darioli. Et d’avertir que si nous ne faisons rien pour eux, les exclus se bâtissent un monde hors du monde. Leur reconstruction personnelle passe par l’appartenance, à une bande par exemple, avec un risque énorme de rupture collective et donc de situations toujours plus difficiles à gérer...«S’ils sont en échec, nous le sommes partiellement aussi. Nous pouvons certes les expulser, mais ils restent là.» Quant aux pistes émergeant de cette journée, Simon Darioli met en exergue la nécessité de changer un peu les règles du jeu, de notre propre jeu. «Il faut s’asseoir et écouter, non pas dans l’optique habituelle de poser un diagnostic et de prescrire des médicaments, mais dans celle de comprendre la souffrance, et surtout les aspirations de ces jeunes personnes!»Des aspirations à respecter, car «ni notre savoir, ni nos compétences, ni même nos souhaits ne les aideront à avancer. Seule peut les porter leur propre capacité à mobiliser de l’énergie pour transformer leur rêve en espoir.»Et l’ultime intervenant d’insister sur la nécessité d’un accompagnement dans la continuité, sans projection, mais avec des limites et des règles, en acceptant que la rupture soit inhérente au processus de reconstruction, cette dernière n’étant jamais linéaire. Si une expulsion est parfois possible et même néces-saire, elle ne doit jamais devenir rejet, selon un orateur convaincu que l’essentiel consiste à proposer ensuite des pistes pour commencer à reconstruire le rêve sur d’autres bases.En conclusion, le «grand témoin» en appelle à l’ouver-ture d’esprit, à la remise en question et à la franchise. «Dans cette problématique de l’accompagnement des jeunes en recherche de leur voie, celui qui pense déte-nir la vérité peut être certain qu’il fera fausse route. De même, la voie demeurera sans issue tant que chacun ne cherchera pas à être vrai.» l
w Pour aider les jeunes en rupture, il faut trouver une autre ma-nière de travailler, selon Simon Darioli, qui en appelle à sortir de la monoculture professionnelle. «En processus d’errance, on ne comprend plus notre déclinaison de valeurs. Il faut donc travailler sur les espaces communs et essayer de les élargir. Il faut impé-rativement agrandir le plus grand dénominateur commun, pour mener l’importante mission qui consiste à ne laisser personne au bord de la route.» En soulignant que dans cette optique, la pluridisciplinarité constitue une véritable méthode de résolution de conflits. l
Sus à la monoculture...
Etre vrai sans croire
détenir la véritéPour un regard large et ouvert sur cette
journée, le SER a fait appel à Simon Darioli, qui dirigea durant dix-neuf ans le Service social
valaisan. Ses impressions, ses pensées, et surtout une réflexion très intéressante. Simon Darioli, «grand témoin» de ces Assises.
© n
iro