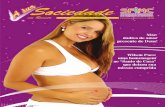Article sfmc courrier cauchois
-
Upload
jan-cedric-hansen -
Category
Health & Medicine
-
view
693 -
download
2
Transcript of Article sfmc courrier cauchois

SPÉCIAL ATTENTATS12 LE COURRIER CAUCHOISVENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
Courrier Cauchois : La Sociétéfrançaise de médecine decatastrophe (SFMC), dont vous
êtes membre associé du conseil d’ad-ministration, a-t-elle été sollicitéeaprès les attentats de vendredi der-nier ?
Jan-Cédric Hansen : Non. Maisc’est normal. La SFMC est unesociété scientifique. Elle n’a pas encharge l’organisation et la mise enœuvre des secours. Elle contribue àla conception des plans de réponseaux agressions, qu’elles soient natu-relles, technologiques ou, commec’est le cas avec ces attentats,humaines.
La Société française de médecinede catastrophe a été fondée en1983 par le médecin général RenéNoto, ancien médecin-chef dessapeurs-pompiers de Paris, lePr Pierre Huguenard, fondateur duSAMU 94 (Val-de-Marne), et lePr Alain Larcan, ancien présidentde l’Académie nationale de méde-cine.
CC : Comment s’organise le plande secours après de si tragiquesévénements ?
JCH : Justement, il ne s’organisepas après mais avant. Depuis lesannées 80, les pouvoirs publicssont sensibilisés à la nécessité de sepréparer à répondre à des situationsexceptionnelles, reproduisant lesconditions de la médecine de guerresur le territoire national. Dans cessituations, les acteurs sont confron-tés à un nombre important de victi-mes avec, comme à Paris vendredi,des blessures par balle ou par explo-sions. Ce sont des victimes qui onten commun d’être criblées par desprojectiles à grande vélocité.
CC : Hasard du calendrier, il yavait le matin même de l’attentat unexercice de grande envergure.Comment se prépare-t-on pour réa-gir à une telle catastrophe ?
JCH : On se prépare en imaginantl’improbable. J’ai participé moi-même les 3 et 4 novembre auxEntretiens du risque, dont le thèmeétait justement : penser l’impensa-ble. C’est sur la base de ces scéna-rios, conçus par les pouvoirspublics, que l’on va bâtir les plansd’organisation des secours avec tou-tes leurs déclinaisons : plan Blanc,plan Rouge, etc.
« Il faut inviter la populationà se former aux gestesqui sauvent »
CC : Justement, après les derniersattentats de Paris, on a entendu
parler de plan Blanc. Qu’est-ceque cela veut dire concrètement ?
JCH : La réponse en cas de situa-tions exceptionnelles, elle est sym-boliquement « bleu-blanc-rouge ».« Bleu », ce sont les forces de sécu-rité (police, gendarmerie, etc.) ;« blanc », ce sont les services desanté (médicaux et paramédicaux) ;« rouge », ce sont les sapeurs-pom-piers.
Concrètement, vendredi, les victi-mes ont bénéficié des plans Blancet Rouge Alpha qui ont étédéployés conjointement par leSAMU de Paris et la BSPP (Brigadedes sapeurs-pompiers) sous l’auto-rité du préfet de Paris pendant queles forces de l’ordre sécurisaient lesdifférents lieux.
Les plans Blanc et Rouge serventà réorganiser les moyens existantset à mobiliser des moyens supplé-mentaires pour assurer les réponsesen matière sanitaire et de secours.
CC : À Paris, dans la nuit de ven-dredi à samedi, l’organisation choi-sie a-t-elle permis de sauver desvies ?
JCH : La Société française demédecine de catastrophe n’a pas àjuger. Elle s’intéresse au retour d’ex-périence et on n’en est pas encorelà (l’entretien a été réalisé diman-che, NDLR). Ce que je peux dire,c’est que la planification permetd’identifier les ressources mobilisa-bles et les logistiques nécessairespour faire face. Les urgences del’AP-HP (Assistance publique desHôpitaux de Paris) ne sont pasdimensionnées au quotidien pouraccueillir trois cents victimes d’uncoup. L’organisation a donc unecaractéristique particulière et quipeut surprendre le grand public,c’est la notion de triage. Les pre-miers secours arrivant sur placedressent avant toute chose un bilande la situation, du nombre de victi-mes et de la gravité des blessures.Le temps que les sapeurs-pompierset les équipes médicales arrivent,ce sont, dans l’idéal, les personnesprésentes qui devraient porter lespremiers secours. C’est pour celaqu’il faut inviter la population à seformer aux gestes qui sauvent.
CC : Il y a eu les plans mais aussila mobilisation des médecins, desinfirmières, des paramédicaux quiont proposé volontairement leuraide...
JCH : C’est la culture des soi-gnants mais aussi des secouristes,qu’ils soient des sapeurs-pompiers,de la Croix-Rouge, de la Croix deMalte, de la Protection civile, etc.C’est vrai pour les services publicsmais aussi pour les professionnels
privés : par exemple, les médecinslibéraux ont arrêté leur conflit.
« Le stress post-traumatiquepeut se révéler quelques heuresmais aussi quelques moisaprès l’événement »
CC : Qu’est ce qu’on peut etqu’est ce qu’on doit apporter psy-chologiquement aux victimes et àleurs proches ?
JCH : Dès l’intervention, lessecours s’intéressent aux victimesqui ne sont pas atteintes dans leurintégrité physique mais qui ontbesoin d’une prise en charge psy-chologique. C’est un apport de laSFMC ces dernières années : lesméthodes de prévention du stresspost-traumatique. Ce dernier peutse révéler quelques heures maisaussi quelques mois après l’événe-ment, cela dépend des personnes. Ilapparaît quand l’épisode devient lathématique principale du discoursde l’individu et non pas seulementun élément parmi d’autres de sabiographie.
CC : Comment peut-on luttercontre ce phénomène ?
JCH : On lutte contre ce stress endemandant aux gens de raconterleurs émotions et non pas seule-ment leur récit de l’événement. Lepsychologue ou le médecin n’est niun journaliste, ni un policier.
CC : Qui doit écouter les victi-mes ?
JCH : Tout le monde peut le faire,si c’est effectué avec bienveillance.On appelle cela la psychothérapiede soutien. Pour les victimes qui ontsubi un traumatisme physique etceux qui en ont été les prochestémoins, il faut que cette écouteémane également de psychologuescliniciens et de médecins-psychia-tres qui sont formés à cela. Ils inter-viennent alors dans les cellulesmédico-psychologiques. Ça fonc-tionne souvent bien. On n’entre pasdirectement dans le vif du sujet. Oncommence par offrir un café ou onpropose à un enfant de dessiner. Lebut, c’est de susciter l’expression del’émotion qui permet la cicatrisationpsychique. On s’oriente alors vers larésilience, c’est-à-dire le dépasse-ment de l’événement.
« L’événement du 13 novembrefait partie de notre existence »
CC : Là, on évoque les victimesdirectes ou les témoins. Mais com-ment prépare-t-on la population à lapériode qui arrive, avec les menacesd’autres attentats ?
JCH : C’est le rôle et la responsa-
bilité des politiques. Nous quittonslà le champ de la médecine decatastrophe pour entrer dans celuides cindyniques, c’est-à-dire lessciences du danger. Ces sciencesdonnent aux pouvoirs publics desoutils pour développer cette culturecindynique au sein de la population.
CC : Comment fait-on ?JCH : En faisant prendre
conscience que la vie expose auxdangers et aux risques aléatoires. Ledrame de vendredi est un nouvelaléa qui fait irruption dans notresociété. Il a un impact sur notresociété. Mais il reste un aléa et onpeut vivre avec. C’est le cas dansdes pays comme le Liban, Israël ouqui connaissent des guerres civiles.Les gens se sont adaptés.
CC : Ne nous a-t-on pas bercédans une certaine illusion ?
JCH : Nous étions dans l’illusiondu risque zéro alors que le risqueest partout dans notre quotidien.L’événement du 13 novembre faitpartie de notre existence. Il y en aeu avant ; il pourrait y en avoir d’au-tres après.
Il faut s’organiser. L’entraînementa une vertu. Même si son scénarione correspond jamais à la réalité, ildonne un sentiment de déjà vu quidiminue l’impact de l’événement. Ily a une triptyque fondamentale faceà une catastrophe.
Il faut l’affronter, la réguler et êtrecapable de la dépasser. C’est-à-direéviter qu’elle soit un traumatisme etla rendre, au contraire, constitutivede notre cohésion sociale.
■ INTERVIEW RÉALISÉEGHISLAIN ANNETTA
Jan-Cédric Hansen
« Des conditions de médecinede guerre »Ancien médecin coordonnateur de l’hôpital d’Yvetot, désormais à Pacy-sur-Eure, le Dr Jan-Cédric Hansen est membre de la Société françaisede médecine de catastrophe. Nous l’avons interrogé après les attentats qui ont marqué Paris le vendredi 13 novembre.
Jan-Cédric Hansen : « Susciter l’expression de l’émotion permet la cicatrisa-tion psychique » (photo d’archives)
L’ENTRETIEN DE LA SEMAINE