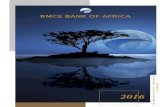Accompagner une personne en fin de vie: un témoignage d’humanité?
-
Upload
jean-philippe -
Category
Documents
-
view
218 -
download
1
Transcript of Accompagner une personne en fin de vie: un témoignage d’humanité?

Med Pal 2006; 5: 139-146
© Masson, Paris, 2006, Tous droits réservés
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
Médecine palliative
139
N° 3 – Juin 2006
Accompagner une personne en fin de vie : un témoignage d’humanité ?
Jean-Philippe Pierron, Maître de conférences en philosophie, faculté de philosophie, Université Jean-Moulin Lyon 3. Enseignant dans le DU de soins palliatifs
des universités de Dijon-Nancy.
Summary
Accompanying a terminally ill patient: an expression of humanity?
Accompanying the terminally ill, which may involve profes-sional or benevolent caregivers or both, has, within the frame-work of palliative care, lead to a new setting of death. The ac-companying process changes our approach to death, the accompanying person becoming a new kind of mediator. In this new setting, mediation has lost its former religious (priest) and even medical (psychophysiological) coloration. From salvation to sanitation, this new setting attests to the reality of an injured, but maintained, humanity. It is the expression of human empa-thy for others weakened by a long death. Accompanying the terminally ill thus invents, together with a new approach to me-diation, a transitional space-time where the dying person can escape the functional approach of dying well and let death be a real expression of his-her humanity.
Key-words:
accompanying, accompanying person, experience, presence.
Résumé
Dans le cadre des soins palliatifs, l’accompagnement de la fin de vie, de la part des professionnels comme de celui des bé-névoles, s’est progressivement structuré et imposé jusqu’à construire une nouvelle scène du mourir. Dans le cadre de la sécularisation, l’accompagnement de la fin de vie modifie notre approche de la mort, l’accompagnant devenant un mé-diateur. Mais cette médiation n’est plus religieuse comme l’assumait avant-hier le prêtre, ni même uniquement médicale, au sens psychophysiologique du terme. Entre le discours salu-taire d’hier et le discours sanitaire d’aujourd’hui, entre salut et santé, l’accompagnant atteste d’une humanité blessée mais maintenue. Il est témoin d’humanité de et pour un autrui fragilisé dans la mort longue. L’accompagnement de la fin de vie invente ainsi, avec la médiation de l’accompagnement, un espace-temps transitionnel qui atteste de l’humanité de celui qui se meurt jusque dans son désarroi, résistance ultime à une approche fonctionnelle exigeant du « mourant » qu’il fasse bonne figure.
Mots clés :
accompagnement, accompagnant, témoignage, pré-sence.
Q
u’on s’imagine un nombre d’hommes dans les chaî-nes, et tous condamnés à la mort, dont les uns étant cha-que jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restentvoient leur propre condition dans celle de leurs semblables,et, se regardant les uns et les autres avec douleur et sansespérance, attendent à leur tour. C’est l’image de la condi-tion des hommes
[1].
De fortune ou d’infortune, les hommes sont les unspour les autres des compagnons. Nous ne devenons hommesqu’en leur compagnie. Compagnon ! Belle et ancestraleformule signalant que nous avons à partager ensemble lemême pain ; que c’est à cela que l’on reconnaît les hom-
mes. Le compagnon est un co-pain
1
. Les compagnonspartagent un monde commun, prennent part ensemble.Partager ensemble le monde c’est certes partager des choses,— faire des affaires — mais c’est surtout partager unmonde de décisions et d’actions faites par d’autres hom-mes. Car ce qui caractérise l’humanité du monde humainn’est pas qu’il soit un monde de choses mais un mondede relations entre sujets qui s’affairent. Ainsi exister pourl’homme n’est pas seulement être en vie (
Zoé
) mais bien
Pierron JP. Accompagner une personne en fin de vie : un témoignage d’huma-
nité ? Med Pal 2006; 5: 139-146.
Adresse pour la correspondance :
Jean-Philippe Pierron, 9, rue Brillat Savarin, 21000 Dijon.
e-mail : [email protected]
1. Companionem en latin est construit sur la préposition « cum », avec et « panis »,pain, signifiant « qui mange son pain avec ».

Médecine palliative
140
N° 3 – Juin 2006
Accompagner une personne en fin de vie : un témoignage d’humanité ?
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
partager, échanger avec d’autres sur les affaires humaines(
Bios
), sur ce qui fait que notre vie est valeur.L’accompagnement d’une personne en fin de vie prend
ici tout son sens. Il s’agit de maintenir la possibilité, pourl’un des nôtres, de partager encore les affaires des hommes.Si les compagnons sont bien des personnes, la particularitéde l’accompagnement en soins palliatifs, tiendra donc àl’asymétrie de cette relation interpersonnelle, puisqu’unedes deux personnes se trouve placée dans une situation dedépendance qui justifie d’ailleurs la présence d’un accom-pagnement. On accompagne celui qui n’est plus en mesure,du fait de la maladie ou du grand âge, d’aller retrouver seulses compagnons mais qui tient toutefois à leur compagnie.L’accompagnement ambitionne donc de maintenir l’espace-temps d’un monde commun.
Mais là est l’ambivalence de l’accompagnementd’autrui. L’alter ego est pris entre altérité — l’autre est unautre que moi — et intersubjectivité — l’autre est un autremoi —. D’un côté,
on vit et on meurt seul
dirait Pascal,rendant tout accompagnement vain s’il a pour ambitiond’approcher la fin de vie et la mort de l’autre commel’autre l’approche et la vit. L’accompagnement se heurteà une forme d’illusion, si l’on croit comprendre l’autre,touchant alors du doigt les limites de la sympathie. L’ac-compagnement se muerait en une figure de l’infantilisa-tion s’il prétendait saisir le vouloir d’autrui et se saisir delui pour vouloir pour lui. D’autrui, je n’approche qu’indi-rectement ou par analogie, l’expérience et le ressenti, lerenvoyant à sa liberté, ce qui est parfois interprété commeune manière de le condamner à sa solitude. D’un autrecôté cependant, l’accompagnement de la personne en finde vie apparaît précisément comme l’ultime manière pourles humains d’approfondir leur compagnonnage.
Laparole, cela va de soi, est un remède efficace contrel’angoisse. En brisant l’enfermement dans la solitude, ellepermet de faire passer dans les mots le poids excessif desaffects et de les répartir sur plusieurs sujets. Mais la sim-ple écoute, voire la présence muette, peuvent aussi bienremplir la même fonction, cette fois sur le mode de l’os-mose. Dans tous les cas, on procède à une
«
prise encharge
»
de l’autre : on porte alors sur ses propres épaulescelui qui continue à porter un fardeau dont on ne peutpas le dispenser
[2]. Ici la notion d’accompagnement est,en ce qu’elle suppose de modalité du temps traversé en-semble, d’exercice de la durée, une catégorie plus large etriche que la seule discussion. Accompagner, plus que dis-cuter, c’est cheminer ensemble dans les surprises, les len-teurs, les impasses et les retours que toute route entrepriseréserve. L’accompagnement est en ce sens une modalitédu temps traversé ensemble. Il prend ainsi la mesure dela dimension incarnée de notre rapport à autrui : échangede deux consciences qui se décline sur le plan rationneldans la discussion, sur le plan affectif dans l’expression
des émotions, sur le plan sensible dans le toucher et lacaresse. Ici l’accompagnement est présence. Mais une telleprésence est-elle seulement possible ?
La difficulté de l’accompagnement de la personne enfin de vie tient à ce qu’il est pris dans la polarité entredistance et proximité, oscillant entre une significationhaute et une signification basse. Dans sa signification laplus pauvre, la moins ambitieuse mais peut-être sans il-lusion voire désabusée, l’accompagnement consiste à
faireacte de présence.
D’autrui finissant sa vie, l’expérience etla situation me sont radicalement étrangères. Je ne peuxqu’être là dans la pauvreté à laquelle me livre l’impossi-bilité de partager. Faire acte de présence : proximité spa-tiale dans la localisation au chevet d’autrui, mais distanceexistentielle dans l’impossibilité de prendre part, de par-tager. Être avec : « être-là », à défaut d’« être comme ».Mais l’accompagnement a aussi sa signification haute etexigeante contenue, nous y reviendrons, dans l’idée d’untémoignage d’humanité. L’accompagnement fait présentde la présence. C’est cela que signifie se rendre présent,disponible, offrant d’
acter la présence.
Être une présence,comme l’on dit parfois, n’est-ce pas expérimenter uneforme de solidarité humaine charnelle, pré-rationnelle (ex.le tact) ou post-langagière (le silence qualifié) qui main-tient des capillarités avec le monde des vivants ? Si l’ac-compagnement est un témoignage d’humanité, quellehumanité atteste sa présence ?
Petite phénoménologie de l’accompagnement de la fin de vie
Notre hypothèse est que l’accompagnement de la finde vie, fait des soignants ou des bénévoles, maintient lelien interhumain dans ce qu’il a d’irréductible à tout soucide professionnalisme ou d’expertise. Il maintient — tienten main, et cette figure de la main n’est pas neutre ici —dans ce passage qui va de « prendre en main » à « prendrela main » ou « tenir la main » — le point de rencontre fon-damental de l’humain : la présence. L’accompagnementinaugure une manière de se tenir avec l’autre qui se tientbien en amont, bien plus profond que toutes les intentionsd’agir, de s’activer : être une présence. Il interroge, aufond, ce que signifie se tenir auprès d’autrui.
L’accompagnement de la fin de vie inaugure une mo-dalité spécifique de la relation à autrui. Qu’on le veuilleou non, qu’on déclare l’humanité du mourant non moinsconsistante que celle du bien portant, on ne se tient pasface à celui qui meurt comme face à l’homme de l’ordi-naire des jours. Une raison à cela : l’apparaître d’autrui yest donné dans la dissolution de la gloire des apparences.

Med Pal 2006; 5: 139-146
© Masson, Paris, 2006, Tous droits réservés
141
www.masson.fr/revues/mp
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
Jean-Philippe Pierron
Entrer
Premier élément notable, l’expérience d’accompagne-ment répond comme une disponibilité à la relation à laquelledispose l’attente. Accompagner, c’est oser entrer chez l’autrequi nous désarme par sa fragilité. Démuni, il nous renvoie ànotre propre condition d’homme précaire. En ce sens, l’ac-compagnement n’a pas le même sens pour le valide et l’in-valide : disponibilité dans l’attente pour celui-ci ; découverteet confrontation à sa précarité pour celui-là. L’accompagne-ment vient rompre possiblement le temps de l’attente auquelassigne la fin de vie. En effet, fragilisé et précarisé, l’autruien fin de vie entre en solitude, tenu en retrait des affaires dumonde. Il fait là une expérience du désert, la vulnérabilitél’ayant condamné à déserter les scènes de la socialité mon-daine. De ce fait, l’entrée en solitude réduit l’habiter dumonde à l’entour de la chambre, dans un espace clos, auxactivités limitées et où la principale surprise relationnelle estinscrite dans la régularité prévisible des interventions soi-gnantes. Aussi, l’accompagnement est-il une manière de sur-prise relationnelle dans la continuité routinière des soins. Ilouvre le temps à la possibilité de l’étonnement à défaut depouvoir élargir l’espace. Frapper avant d’entrer alors : ouvrirce temps de l’échange suppose l’acceptation de cette fracturede l’intimité qu’est l’entrée dans la chambre. Quelqu’un passealors où il ne se passe rien. Quelqu’un entre, qui fait sonentrée, là où autrui n’a plus ses entrées. Qu’est-ce à dire, si-non que l’accompagnement est une fracture relationnellemaintenant vivante la possibilité de l’inattendu qui fait lavie humaine, et sans lequel l’existence disparaît sous la pla-nification mortifère de la prévision ?
S’asseoir
En fin de vie, la relation à autrui se donne dans lecadre intime de la chambre, la précarité de la fin de vieassignant à résidence, dans la fragilité d’une position al-longée. De ce fait, la relation intersubjective n’a pas l’éga-lité qu’on peut attendre de nos partenaires ordinaires.Ainsi, l’un se tient debout lorsque l’autre demeure allongé.Dissymétrie dans la relation où l’un trace l’horizontale dela fragilité dans l’alitement tandis que l’autre se dressedans la verticalité de la station debout. Regarder de hautou voir d’en bas, dans une contre-plongée désigne etconstruit une logique des places, sinon un rapport de sou-mission/domination, du moins de disponibilité ou devulnérabilité à l’égard de l’initiative d’autrui. Or, l’accom-pagnement choisit souvent de s’asseoir, de se tenir au che-vet, comme pour réduire cette fracture du haut en bas, etinstaurer une espace transitionnel médiateur, un entredeux qui soit facteur d’équilibre ou de réduction duvertige relationnel. S’asseoir comme pour surseoir à latentation du pouvoir qui hante ceux qui regardent dehaut.
Toucher
Troisième élément significatif, la figure quasi archétypalede l’accompagnement de la fin de vie est concentrée dansl’expérience du tact : toucher et accepter d’être touché, pren-dre la main. Cette porte d’entrée relationnelle par le toucherest bien différente de celle que propose le regard. Autant l’ex-périence du regard met à distance, objective en construisantun panorama, une scène — je vois l’autre allongé comme unechose étendue dans l’espace (on pense aux analyses de Sartresur le regard qui chosifie) –, autant le toucher dans ce qu’ila d’immédiat, met en présence dans une forme de proximitémaximale, d’intimité, de mise en présence. Mais alors, le tou-cher dans le « prendre la main »pour accompagner n’est réductibleni à l’efficacité du prendre en mainque suppose l’acticité soignante (laprise en main de la palpation mé-dicale ou de l’intervention infir-mière), ni à l’effet soulageant dumassage. Jamais neutre relation-nellement, « prendre la main » dansle contexte de l’accompagnementsuppose une résorption des frontières de l’intime, comme sil’intériorité venait désormais à fleur de peau. Un tel tact sup-pose de la part des protagonistes une relation singulière, laproximité intime du toucher rompant avec les conditions or-dinaires d’expression de l’intimité. Cela tient à ce que dansl’expérience du prendre la main, se fait l’épreuve du toucherqui rappelle chacun à la dimension de son intégrité et de sonintimité : conscience de soi incarnée dans l’espace et letemps. Le toucher ramène à soi sans pour autant y enfermer.Telle est l’effet de la caresse, lorsqu’elle est un geste débar-rassé du projet qui habite le geste thérapeutique, la prise enmain professionnelle, ou la visée érotique.
La caresse qui seveut apaisante tente de ramener l’autre à lui-même lorsqu’ilne s’appartient plus, elle cherche donc à opérer une conver-sion de l’autre pour le détourner de l’obstacle insurmontableauquel il s’affronte et le guider vers une place nouvelle où lamain qui le touche lui propose un repos
[3]
2
. N’est-ce pascela le tact : toucher sensible qui prend la mesure de l’autresans jamais vouloir prendre sur lui le dessus ? Prendre lamain, ni pour posséder dans une attitude instrumentalisante,ni pour aliéner dans quelque posture infantilisante, maispour rencontrer. Il y a dans le tenir la main une forme derésistance à la technicisation de la relation. Tenir la mainn’est pas un geste professionnel ou intentionnel, il est pureprésence, irréductible mesure du lien humain. Tenir la mainne requiert pas de compétences, ne s’apprend pas ; il n’estque la manifestation de la pure présence de l’humain àl’égard de l’humain.
2. Plus largement sur ce point, nous renvoyons le lecteur à un travail de mas-ter de philosophie non encore publié, rédigé par une philosophe exerçantcomme infirmière en soins palliatifs. Marmilloud L. Relation au corps souf-frant, Une approche phénoménologique et éthique de la fin de vie, Faculté dephilosophie, Université Jean Moulin Lyon 3, 2005.
Accompagner, c’est oser entrer chez l’autre qui nous désarme par sa fragilité.

Médecine palliative
142
N° 3 – Juin 2006
Accompagner une personne en fin de vie : un témoignage d’humanité ?
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
Parler et se taire
La fin de vie se reconnaît aussi à la diminution de lapuissance vitale reconnaissable à un rétrécissement despouvoirs de soi déployés sur le monde. Cette diminutiondes possibles exercée sur l’au-dehors de soi s’accompagned’une intensification du rapport à soi. Approfondissementde son monde intérieur contemporain d’une diminution dupouvoir sur le monde extérieur. De ce fait, le type d’échan-ges que sollicite l’accompagnement est moins dans une ca-pacité de faire ensemble des réalisations objectives, quedans l’investissement du champ du langage ouvert au récit
de soi, à la possible unificationnarrative de soi. On peut encorefaire récit, de soi et/ou du mondelorsqu’on ne peut plus faire ouagir sur lui. Parler et se taire icisont communication par-delà lafonctionnalité des échanges d’in-formations. Les diverses déclinai-sons du champ langagier sontainsi sollicitées. L’accompagne-
ment ritualise une pratique sociale singulière : la conver-sation.
La conversation a un caractère unique, car elle créepour celui qui y prend part un monde et une réalité oùd’autres participent également. Cet engagement spontané etconjoint est une
unio mystica,
une transe socialisée. Il fautvoir aussi qu’une conversation a ses exigences propres.C’est un petit système social qui tend à préserver ses fron-tières ; c’est un îlot de dépendance et de loyauté, avec seshéros et ses traîtres
[4]. Forme codifiée des interactions so-ciales, la conversation est une petite cérémonie intime quine déroge pas l’étiquette, y compris dans le cadre de l’ac-compagnement de la fin de vie. Une conversation se nour-rit, puisant dans une réserve de banalités qui satisfont àl’attente d’échanges, mais qui maintient la possibilité des’en retirer lorsqu’elle devient pesante. Entrer dans uneconversation, l’alimenter convoque la fonctionnalité immé-diate du langage dans l’échange d’informations dérisoires.Parler de la pluie et du beau temps, pour bien se tenir etpour distraire mais également pour maintenir un lien vifavec l’autre. « Faire la causette » est une scène sociale ju-bilatoire où le lien interhumain se célèbre dans la joie dela proximité échangée non dupe de sa futilité. Toutefoisl’accompagnement n’est pas une conversation ordinaire,car il se construit sur l’arrière plan de la fin de vie qui re-lativise grandement le poids de l’étiquette. C’est pourquoile langage est investi aussi sur d’autres registres que celuides codes de bonnes conduites, — même si l’éducation etles catégories sociales forcent parfois jusque-là à fairebonne figure. Qu’on pense aux traits d’esprit que l’on rap-porte de mourants célèbres ! Dans l’accompagnement, l’in-vestissement du langage se fait aussi dans une mise en récitde soi telle que raconter c’est aussi se raconter, travail
d’anamnèse contribuant à se ressaisir dans la constitution-reconstitution narrative de soi. Mais l’accompagnement in-tègre enfin la possibilité du silence comme une conditionde l’échange. Le silence du se taire ensemble est commeune respiration de l’échange, et outre cette ponctuation,une ultime manière de faire. Le silence dans l’échange, estun silence qualifié, habité parfois par la fatigue, la lassitude,la pénibilité, mais c’est aussi un silence performatif. Ne riendire c’est faire ; c’est marquer dans le langage la présenceactive du sujet du langage (ultime exercice d’un pouvoirsur l’autre dans la condamnation à supporter un silencemais aussi expérience d’une participation silencieuse). Lacommunication non verbale signale parfois d’intensescommunions,
unio mystica
dit Goffman, et pas uniquementdes échecs relationnels. Présence à soi et à l’autre dans laqualification d’un silence.
Ainsi entrer, s’asseoir, toucher et parler/se taire sont leséléments majeurs de rites d’interactions construisant cette li-turgie relationnelle singulière qu’est l’accompagnement. Lesconvenances, les règles tacites de la bonne conduite ne sontpas moins présentes dans cette acticité sociale qu’est l’ac-compagnement, que dans la conversation ordinaire. Ces ritesdéfinissent des règles de conduites ayant leurs conventions.Il y a socialement des « obligations » des malades à l’égarddes soignants et des accompagnants qui modèlent lesconduites et les forcent à une bonne tenue : les « bons » etles « mauvais » malades. Mais la fin de vie force à entendresous ces rites une liturgie de l’élémentaire, retrouvant la per-sonne globale sous la fonction « malade » (
Lorsque nous exa-minons comment l’individu participe à l’activité sociale, ilnous faut comprendre que, en un certain sens, il ne le faitpas en tant que personne globale, mais plutôt en fonctiond’une qualité ou d’un statut particulier ; autrement dit, enfonction d’un moi particulier. Ainsi, un malade qui se trouveêtre une femme peut se voir obligé d’oublier toute pudeurdevant un médecin qui se trouve être un homme, dans lamesure où c’est la relation médicale et non la relationsexuelle qui est alors définie comme socialement pertinente
[4]). Ce faisant, ils livrent, dans la simplicité même de cesactions élémentaires, à la mise en présence. Ces verbes d’ac-tion, dans la fragilité même de leur simplicité, font le présentde la présence. Ils donnent d’entrer dans le mystère de l’autre,en le rencontrant tel qu’il se donne : fragile et dénudé, « dansle plus simple appareil ». C’est alors que se formule et seconstruit le témoignage d’humanité : présence à l’hommesans qualités, tel qu’en lui-même.
L’accompagnement : nouvelle modalité d’affrontement de la mort
Solitaire dans le suicide, technique dans le combatthérapeutique, salutaire dans les rituels religieux, commu-
Le langage est investi aussi sur d’autres registres que celui des codes de bonnes conduites.

Med Pal 2006; 5: 139-146
© Masson, Paris, 2006, Tous droits réservés
143
www.masson.fr/revues/mp
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
Jean-Philippe Pierron
nautaire au temps des associations charitables, l’affronte-ment de la mort se décline de façon plurielle, la figure del’accompagnement en étant une récente modalité. Parceque mourir est un fait universel, — il est sans exception— mais une mort toujours un événement singulier — c’estun quelqu’un qui se meurt –, l’accompagnement de la finde vie est épreuve d’humanité : l’universelle condition hu-maine de mortel livrée dans la singularité d’une histoirepersonnelle. Sur le front de la mort prochaine, une foisles douleurs soulagées, l’accompagnement de la fin de vieest une manière d’affrontement, faisant front communface à la mort dans un compagnonnage humain.
L’accompagnement de la fin de vie est concomitant d’unesécularisation des moeurs et d’un désenchantement de lamort, d’une rationalisation et d’une médicalisation du mourir,d’un pluralisme éthique, contemporain de l’individualisme.C’est dire que l’accompagnement est contemporain d’un dé-senchantement de la fin de vie (voir les travaux de PhilippeAriès), porteur de ce fait, d’une forme d’expertise technique,tentant d’assumer la pluralité des positions éthiques de cha-cun dans la singularité de son histoire Mais lorsque l’on parled’affronter la mort, qu’affronte-t-on au juste ? La mort estune confrontation à son propre néant, pour les non-croyants,et à son anéantissement, ils l’espèrent provisoire, pour lescroyants. Épreuve du non-sens ou de l’absurde, confrontationà la fracture de l’être et du néant, affronter la mort est enaval une question spéculative — qu’en est-il d’un au-delà dela mort ? —, et en amont, une pressante question existentielle— qu’en est-il du sens de ma vie et de ce que vivre a signifiépour moi ? — Ce qui est à affronter, c’est la signification dece qu’être a voulu dire, signification qui fait la grandeur d’uneexistence dans l’exercice de sa liberté.
Mais cette figure de l’accompagnement est-elle sus-pecte ? Serait-elle inhumanité cachée sous le masque ver-tueux de la philanthropie ou de la miséricorde ? Sans donnerà la critique inutilement véhémente et totalement partiale deMichel Onfray plus d’importance qu’elle n’en a, tant elle estelle-même suspecte par son unilatéralisme caricatural
3
, onpeut néanmoins exercer une forme de soupçon à l’égard des
soins palliatifs et de la dynamique sociale de l’accompagne-ment. La formule même d’un « témoignage d’humanité »n’est-elle pas douteuse en ce qu’elle recèle de bons senti-ments, de projections misérabilistes, typiques du langage descharitables ? Encore qu’on ne voit pas pourquoi il faudraitsuspecter et rejeter définitivement les bons sentiments, c’est-à-dire au fond la part de l’affectivité dans la vie morale etla relation affective à l’autre, personne n’est dupe du fait quel’accompagnement de la fin de vie révèle des blessures chezsoi. Inquiétante étrangeté du mourir : la fin de vie fascine etfait peur. Mais précisément, il a une déontologie et uneéthique de l’accompagnementdans la construction d’une pos-ture d’accompagnant qui consisteà se prémunir des effets de sa pro-pre subjectivité (culpabilité du sur-vivant, mécanismes de défense,processus de transfert, etc.) dans larelation à l’autrui mourant. Cetteéthique de l’accompagnement re-pose sur l’altérité irréductible et laliberté inaliénable d’autrui quechercher à isoler la petite phéno-ménologie esquissée ci-dessus.Prétendre savoir mieux que l’autrece qui est bon pour lui, est un abusde pouvoir, surtout lorsqu’il s’agitde décider pour lui de sa manièrede conduire sa vie et sa fin de vie.Si accompagner signifiait détour-ner autrui de son propre projet et refuser son altérité, ycompris dans des choix, des options ou des postures contrai-res aux nôtres, cela reviendrait à refuser de faire en sorte quel’autre soit un autre. Or ce qui rend l’accompagnement sidifficile et si humain, c’est qu’il accepte précisément d’êtreconfronté à l’humanité dans son
incondition
aurait dit Lévi-nas, c’est-à-dire à l’accueil inconditionnel d’autrui avantmême tous les projets que j’ai pour lui. L’idée d’un témoi-gnage d’humanité ne signifie pas autre chose que le maintiende cette altérité et la manifestation de la liberté qu’elle sup-pose jusque dans la grande dépendance.
L’accompagnement dans le contexte d’une médicalisation de la fin de vie
La relation humaine dans l’accompagnement estsingulière. S’y expérimente une dépossession de soi,celle d’un sujet mis à nu, qui prépare sa sortie mais quin’a plus ses entrées. Cette fragilité de l’homme démuni,brise une manière d’être en relation, construite sur lafonctionnalité des jeux sociaux et des personnages.L’approche de la mort se décrit ainsi triplement, selonqu’il s’agit de l’individu, de la société et de la relationduelle d’accompagnement.
3. On voudrait donner ici un extrait de cette posture de la dénonciation qui cèdeparfois à la facilité rhétorique, tant elle est ignorante de la déontologie et de l’éthi-que de l’accompagnement œuvrant en soins palliatifs. Les soins palliatifs recyclentdonc avantageusement la mythologie judéo-chrétienne, activent dangereusementles travers de la psychanalyse sauvage, mais révèlent aussi les psychopathologiespersonnelles de soignants qui utilisent des patients pour effecteur une autothérapieimprovisée parce qu’elle aussi sauvage… En chrétiens ignorants des maximes deLa Rochefoucauld, les amants du corps pneumatique mettent en avant des vertusréductibles à des vices déguisés… Charité, compassion, amour du prochain, al-truisme, miséricorde, philanthropie dissimulent l’amour de soi, l’intérêt, l’égoïsme,les dividendes éthiques obtenus en rétribution du temps donné au mourant sousforme d’assurance ontologique sur l’éternité… Le malade se trouve instrumentalisépour le salut du soignant. D’où l’intérêt de dénier la volonté de l’agonisant dési-reux d’en finir ! [5]. Prendre prétexte du fait que le pallium est un ornement li-turgique papal pour en conclure que « le palliatif » est d’essence chrétienne – c’est-à-dire forcément moyenâgeux – est, sur le plan argumentatif, un peu court !Qu’aurait écrit le même Michel Onfray, si prompt à sacraliser les mots en leursétymologies, – si ce n’est peut-être l’inverse de son propos –, s’il avait retenu cetteautre définition du pallium utilisée en zoologie pour qualifier le manteau blan-châtre qui recouvre la masse viscérale des mollusques ? Figure faustienne, voireérotique du pallium alors ?
Ce qui est à affronter, c’est la signification de ce qu’être a voulu dire, signification qui fait la grandeur d’une existence dans l’exercice de sa liberté.

Médecine palliative
144
N° 3 – Juin 2006
Accompagner une personne en fin de vie : un témoignage d’humanité ?
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
Pour l’individu, la vieille leçon pascalienne vaut en-core. La proximité de la mort rappelle la contingence etla vanité de nos divertissements ou de nos occupa-tions qui finissement par confondre l’urgent et l’essentiel.
En société, il s’invente aujourd’hui de
nouveaux ritesd’interactions
autour de la fin de vie. Face à la profession-nalisation et à la médicalisation des personnels prenant encharge la fin de vie, celui qui meurt aujourd’hui est tenu defaire face dans la bonne mort, inventant une nouvelle figuredu bien mourir. « Faire bonne figure » ? Non plus mourir desa belle mort dans l’esthétique rurale du mourir, ni mêmeaffronter la mort dans la figure solaire, légère et apaisée dusaint. Nos rites d’interaction autour de la fin de vie déve-loppent une liturgie de la mort saine, où la distribution desrôles est déjà faite. Des rôles pour chacun et pour tous : lafigure du professionnel, la figure du « mourant » et la figurede l’accompagnant, du moins s’il n’y prend garde. Chacunjoue un rôle : le médecin annonce le pronostic et les psy-chologues tiennent un discours sanitaire sur la fin de vie(description des phases de la fin de vie : révolte, réconcilia-tion, faire son deuil, acceptation de la séparation, etc.) ; celuiqui meurt doit aussi tenir son rôle (faire ses adieux, êtreapaisé, bien mourir en somme), interrogeant quelle placel’accompagnement tient dans cette liturgie. Faire bonne fi-gure ? Cette notion de figure est à la fois économiquepsychiquement — chacun sait quel rôle il doit jouer — etconstituante, voire porteuse pour les identités, sans que pourautant elle prétende en tenir lieu. On sait qu’il y a une hy-pocrisie des jeux sociaux qui pourrait forcer le malade àbien mourir. Mais dans sa « sociologie des circonstances »,Goffman isole dans les relations intersubjectives, la présencede modèles comportementaux ordonnés (« faire bonne fi-gure », « bien se tenir », « faire une tête d’enterrement », etc.),tels qu’il apparaît combien, au-delà des critiques convenuesde l’hypocrisie, le personnage porte la personne dans les co-médies du monde, y compris dans la relation à la fin de vie.Ces rites d’interactions sont porteurs pour les professionnelsdu soin qui, sans eux, seraient psychiquement épuisés parla confrontation répétée à ce qu’a d’extraordinaire et de dra-matique l’approche de la mort.
Quant à la relation d’accompagnement proprementdite, l’approche de la mort est enfin accompagnement del’homme sans qualités dont l’humanité n’est pas disqua-lifiée mais requalifiée.
Car bien loin de se réduire au cré-puscule d’une vie s’acheminant vers la mort, le mourirconstitue un lieu d’affrontement violent entre la nature etle monde. Une vie animale abolie demeure toujours dansla nature, où elle sera reprise dans le mouvement généralde la vie. En revanche, quant une personne unique et in-substituable quitte ce monde, elle accomplit un double sautpérilleux d’une part en rompant avec la nature, d’autrepart en vivant une expérience unique, en première per-sonne, dont on ne sait (hors les certitudes de la foi ou les
spéculations de la raison) si elle débouche sur un non-monde, c’est-à-dire le néant ou sur un monde supérieur.Autant dire que l’expérience du mourir justifie un accom-pagnement à la hauteur de l’angoisse qu’elle engendre. Ons’élève alors au dessus du niveau des soins prodigués àla naturalité défaillante
pour pénétrer dans le registre del’être, par delà les manières d’être.
Or, au niveau de l’être,ce qui importe au plus haut point se traduit en termes deparole, d’écoute, d’échange et de présence
[2]. Sans ma-gnifier l’accompagnement de la fin de vie, on peut direqu’il s’y joue quelque chose de la grandeur de la relationhumaine, tant la ressemblance de ce qui fait notre communehumanité s’impose en partage au-delà ou par-delà lessemblants et faux semblants de l’ordinaire des jours. Lafin de vie, clôturant des possibles, force à ne pas tricher,la triche spéculant précisément sur l’existence d’autrespossibles à venir. L’humanité ici se serre les coudes, res-serre les rangs non par frilosité mais en reconnaissancequ’il se vit là des essentiels.
La mort en Occident a opéré progressivement un glis-sement de la mort à domicile à la mort à l’hôpital,accompagnant une mutation de la privatisation de la mortà l’exposition du mourir dans la mort longue. Lié, de plus,à un lent processus de sécularisation
4
, au chevet du ma-lade ne se tiennent plus la famille, les intimes et le mi-nistre du culte, mais des professionnels du soin. La fin devie est devenue, sinon une scène publique, du moins aquitté la relation de stricte intimité pour une formed’extimité. La fin de vie à l’hôpital, parce qu’elle a étémédicalisée, institutionnalise les relations jusqu’à les pro-fessionnaliser face à celui qui meurt. Laïcisation du gestesoignant qui désolidarise santé et salut, laissant celui-cià l’intimité de la conscience (de la pastorale des servicesde santé à la prise en compte de besoins spirituels nonreligieusement formalisés), et celle-là aux soignants pro-fessionnels (de l’anesthésiste au psychologue). Telles sontdonc la relation soignant/patient du côté du souci de santéet la relation accompagnant/mourant du côté du souci du« salut » (au sens large qu’a ce mot ici, c’est-à-dire priseen compte de la question éthique de la valeur d’une vieet de la question métaphysique et spirituelle du sens decette vie). Il y a là comme une figure de Janus
5
. En forçant
4. Jean Baubérot, dans le souci de construire une sociologie historique de lalaïcité prend en compte les effets du processus de sécularisation- laïcisationsur d’autres institutions que l’institution religieuse. Parmi les institutions sé-culières, l’école et l’hôpital occupent ainsi une place privilégiée en ce qu’elles sontdes « institutions de socialisation » véhiculant une conception du vivre ensem-ble dont l’action laïcisatrice a été légitimée par le politique. Baubérot J. Médecine,école, laïcisation et sécularisation. In : Laïcité 1905-2005, entre passion et raison.Paris, Seuil ; 2004 : 50-68.5. Soignant et accompagnant sont pour nous des postures, bien plus que desfonctions. Il s’ensuit que l’on peut parfois quitter la posture soignante pour sefaire accompagnant, comme le manifeste toutes ces situations de rencontresinformelles qui investissent et habitent l’institution hospitalière.

Med Pal 2006; 5: 139-146
© Masson, Paris, 2006, Tous droits réservés
145
www.masson.fr/revues/mp
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
Jean-Philippe Pierron
le trait, on dira que le soignant objectivise autrui à desfins d’expertise, là où l’accompagnement resubjectivise aunom d’un témoignage d’humanité. La relation soi-gnant/patient, pour pouvoir être opérationnelle, objecti-vise autrui, le réduisant momentanément à son corps ouà son psychisme afin de pouvoir le soulager. Il ne s’agitpas là de faire du geste thérapeutique un geste nécessai-rement déshumanisant — sa caricature serait l’acharne-ment thérapeutique que Paul Ricœur a plus justementqualifié de
poursuite déraisonnable des soins
—, mais dereconnaître que la fin de vie peut être appréhendée ducôté objectif des lois de la nature. Si autrui n’est pas unobjet, encore moins une chose, il est par son corps donnédans le monde comme soumis à ces lois de la nature (labiologie) qu’utilise la médecine devenue « biomédecine. »Le caractère incomparable d’autrui disparaît alors au pro-fit du comparable porté par les phénomènes organiques.Le prix à payer de l’hospitalisation de la fin de vie, enmultipliant les tiers prenant en charge le traitement, estla perte du vis-à-vis, ce que d’ordinaire on désigne par le« caractère déshumanisant » des institutions médicales.
Dans le cas de la médecine hospitalière, le vis-à-vis dumalade tend à devenir l’institution hospitalière elle-même,au prix d’une fuite incontrôlable de la responsabilité
[6](Anonymat de la relation médecin/patient, fuite devantl’annonce du diagnostic et du pronostic, course éperdueaux moyens thérapeutiques, numérisation du rapport àl’autre).
Or, figure inverse, la notion d’accompagnement déve-loppée dans les soins palliatifs tient à ce qu’elle restaurela figure du vis-à-vis
6
. Elle atteste de la présence continuede l’humanité d’autrui sous la fonctionnalité des prises encharges techniques. Retrouver l’irremplaçable d’autrui(son identité plus que son intégrité psychophysique, sonrécit de vie et son histoire) sous le comparable des phy-siologies. Bref le compagnonnage tient à ce qu’il témoignedu caractère ininterrompu de cette biographie insubstitua-ble qui tend à disparaître sous la biologie du comparable(les taux globulaires, les numérisassions et comptages desanalyses médicales, etc.). Sans doute qu’une nouveautédans l’histoire de la fin de vie est cette place faite àl’accompagnement bénévole. Témoignage d’humanité,l’accompagnement n’est pas une affaire de professionnels— la fraternité et la solidarité sont des requêtes qui pré-cèdent et excèdent tout contrat —, mais il suppose une
compétence, ne serait-ce que pour apprendre à conquérircette posture d’accompagnement et préserver chacun destentations manipulatrices, y compris pour des intentions« louables ». En effet, la fin de vie confronte à d’angois-santes questions métaphysiquestraduites dans des affects et despsychologies : suis-je voué aunéant ? Quel a été le sens de mavie ? Que restera-t-il de moi et demes réalisations ? Ces questionsmétaphysiques ne sont pas desexercices scolaires mais l’occa-sion d’« exercices spirituels » ten-tant d’unifier une existence, d’ensaisir l’essence et les essentiels enétant pris au feu dévorant de lamort prochaine. Tel est bien le té-moin. Sans assumer pour l’autreles réponses aux questions qui comptent, il est capable deles entendre ou de les formuler, restaurant les capacitésde sujet sous les incapacités et les invalidités liées auxdésordres organiques et psychologiques de la fin de vie.
L’accompagnement est également une forme de ré-ponse à la technicisation d’une médecine, parfoisoublieuse du fait que la médecine a toujours été accom-pagnante. De la sorte, on pourrait présenter le témoignaged’humanité présent dans l’accompagnement de la fin devie comme une résistance politique à la technicisation dusoin. Accompagner une personne en fin de vie pourraitêtre entendu comme un problème technique : commenttraiter un « produit fini » ? Le mourant est, techniquementparlant, un produit fini. Outre le cynisme qui fait du mou-rant un objet ayant fait son temps, parler de produit finisignifie également que la fin de vie est techniquementconstruite. La fin de vie apparaît comme au bout d’unechaîne de production qui connaît son terme. En effet, sil’hôpital est, dirait Michel Foucault,
une machine à guérir
,les soins palliatifs et la fin de vie révèlent cette part ré-siduelle du soin qui fait que le malade en fin de vie esttraité et retraité techniquement. Il est ce que l’on a finitechniquement par produire dans des dispositifs médicauxhypertechnicisés. Pensé et construit dans un système tech-nicien qui met « la vie en miettes », le mourant en estl’ultime reste. La tentation est alors, pour les intervenantsautour de la fin de vie, de justifier leur positionnementpar une technicité. Cela est vrai pour le psychologue,l’anesthésiste, mais aussi pour l’accompagnant labellisépar les associations. La fin de vie est une constructionsociale, et aujourd’hui une construction technique, tentéede croire que le problème humain qu’est la fin de vie s’estmué en un problème technique. Comme si la bonne mortétait une mort techniquement ou psychologiquementréussie !
6. Cette figure du vis-à-vis revêt, dans la fin de vie, une signification parti-culière pour celui qui meurt mais aussi pour son entourage soignant et safamille. La famille découvre souvent l’accompagnant comme un acteur et unvis-à-vis inattendu pouvant être un interlocuteur. L’accompagnant devient, ence sens, un nouveau Charron, un nouveau passeur de la vie vers la mort etun médiateur, dont le témoignage est souvent l’occasion pour les famillesd’envisager autrement la fin d’un des leurs.
La notion d’accompagnement développée dans les soins palliatifs tient à ce qu’elle restaure la figure du vis-à-vis.

Médecine palliative
146
N° 3 – Juin 2006
Accompagner une personne en fin de vie : un témoignage d’humanité ?
S O I N S P A L L I A T I F S E T É T H I Q U E
Témoignage d’humanité, l’accompagnement de la finde vie l’est donc à plusieurs titres. Maintenir la continuitédu lien interhumain sous la discontinuité des soins et desinterventions techniques fait tout d’abord de l’accompa-gnant une
butte témoin
.
Témoigner c’est faire mémoire dela continuité du sujet dans un compagnonnage temporeltourmenté, faisant en sorte que l’errance d’un parcoursmédical n’entrave pas la possibilité d’un itinéraire exis-tentiel. Par ailleurs, l’accompagnant a le statut d’un
témoin auriculaire.
Le témoin est celui qui entend et quirapporte ce qu’il a entendu. C’est une oreille dont l’écoutejoue un rôle unificateur. La singularité de la relation d’ac-compagnement est témoignage en ce qu’elle permet à cha-cun, qui pourrait n’être qu’une collection de faits, desymptômes et de plaies, de faire recollection de soi.L’écoute sert alors un travail d’anamnèse contribuant àl’unification de soi dans les récits de vie que livrent cesmoments douloureusement privilégiés. Mais plus profon-dément encore, l’accompagnement est
attestation
de l’hu-manité d’autrui, même lorsqu’il ne peut plus la porterseule, dans l’actualisation d’une humaine présence. Attes-
ter que celui-là est un homme qui ne peut plus dire sonnom, dans le silence exténué ou dans l’impassibilité ducoma, mais qu’il demeure pourtant des nôtres. Accompa-gner la fin de vie ? Ni prendre en main dans la dominationdes expertises ; ni prendre par la main dans l’infantilisa-tion manipulatoire ; mais prendre la main dans l’attesta-tion d’une humanité.
Références
1. Pascal. Pensées, pensée 434. In : Œuvres complètes. Paris, Leseuil : 556.
2. Folscheid D. Philosophie, éthique et droit de la médecine.Paris : PUF ; 1997 : 246.
3. Brun J. La main et l’esprit. Paris : PUF ; 1963 : 142.
4. Goffman E. Les rites d’interaction. Paris : Les éditions de mi-nuit 1974.
5. Onfray M. Féeries Anatomiques, Généalogie du corps faus-tien. Paris : Grasset 2003.
6. Ricœur P. Les trois niveaux du jugement médical. In : LeJuste 2. Paris, Éditions Esprit ; 2001 : 238.