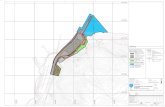74
-
Upload
emiliorenzi -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 74
GUY LE GAUFEY
Le pli cass de lacte, p.9
Guy Le Gaufey
Le pli cass de lacte
Certains mots de la langue sont parfois gorgs dun imaginaire sensiblement diffrent de leur signification ou leur richesse mtaphorique. Leur sens non plus nest pas directement en cause: cet imaginaire tourne plutt autour de la posture nonciative de qui lance le mot, des espoirs peine secrets lis sa profration, lascendant quil pourrait prendre sur lauditeur. Sournois, cet imaginaire se planque volontiers derrire lapparente clart du sens. Il correspond en partie ce quon pourrait appeler la charge motive du mot, mais cette dernire expression noie dans le flux de lmotion des formes quil est encore permis de distinguer, reconnatre et articuler.Ainsi en va-t-il aujourdhui du mot acte qui rencontre, un peu partout, un franc succs. Il suffit dun rien dans leur nonciation pour que, de ces deux pauvres syllabes, on en ait soudain plein la bouche. Il semble mme quen provenance directe des milieux psychanalytiques une toute nouvelle expression soit en train de sinstaller dans la langue franaise. Pour parodier un instant Damourette et Pichon qui, dans leur monumental Essai de grammaire de la langue franaise, sappuient sur des fragments dnoncs en provenance, tantt de la grande littrature franaise, tantt de locuteurs quelconques dans la rue, la vie de famille, une consultation mdicale,etc., je ferai ici part de ce quil ma t donn dentendre, dans une rue dAix-en-Provence, en juin1995, la sortie dune runion, venant de la bouche dune certaine Madame D.: Et alors, tu comprends, ce moment-l, jai pos un acte: je lui ai dit. Il semble donc que, de nos jours plus quavant, chez les psychanalystes plus quailleurs, lacte se pose, et mme quil se pose un peu l, voire quil prend la pose. Souffrirait-il donc dune sorte de complexe dinfriorit, bien propre mouvoir le psychologue? De quelle phallicit faudrait-il le draper pour quil tienne de lui-mme (car cest bien l le fond de lambition nonciative qui anime ces emphases faussement discrtes).
I. La tenue de lactePlutt que de me tourner demble vers ceux qui posent un acte, passent lacte, engagent des actes ou, plus modestement, agissent, jaborderai la question de ce qui permet un acte de tenir en interrogeant dabord ceux qui ne font pas mystre de leur chec notoire en ce domaine: les obsessionnels.A travers la nvrose obsessionnelle de lhomme-aux-loups et celle de lhomme-aux-rats, Freud nous a livr une quantit impressionnante de jugements psychologiques qui tournent presque tous autour dun lment constant: lambivalence des sentiments. Ce qui arrterait demble tout mouvement de lhomme-aux-rats vers sa Dame, vers son Pre, vers lanalyse ou quoi que ce soit dautre, ce serait inexorablement le conflit amour/haine. Pas moyen davancer lun des termes sans mettre en uvre le second, et voil notre homme-aux-rats, tel lne de Buridan, bloqu dans linhibition rsultant du jeu de forces contradictoires.On a un peu tendance oublier aujourdhui la place dcisive quoccupe cette ambivalence dans lensemble de la construction freudienne. Elle est en plein cur de Totem et tabou, servant aussi bien expliquer lvitement/fascination du tabou qu justifier le meurtre du totem ador. A quatre pages de la conclusion de son ouvrage, Freud crit:Nous ne savons rien des origines de cette ambivalence. On peut faire lhypothse quelle est le phnomne fondamental de notre vie affective. S.Freud, Totem et tabou, Paris, Payot, p.180..Loin de moi lide den nier lexistence, ou mme limportance. Mais partir du moment o cette ambivalence joue le rle dargument explicatif, elle devient extrmement dangereuse: il nchappera personne quelle peut servir expliquer nimporte quoi et son contraire, et lon aurait du mal compter les ravages quelle a ainsi pu produire dans le champ freudien. Je chercherai donc dans ce qui suit montrer que la problmatique obsessionnelle face leffectuation dun acte prend ses sources ailleurs que dans ce suppos donn premier, et que lambivalence des sentiments, pour perceptible quelle soit dans le dcor obsessionnel, nest pas concevoir comme une origine obscure, mais comme un donn second et, du coup, partiellement intelligible.De mme que Lacan objectant Melanie Klein: Il ny a pas de bon et de mauvais objet; il y a du bon et du mauvais, et puis il y a la chose, je mefforcerai de montrer quun certain tourner-court de lobsessionnel face lacte tient, bien plus qu une ambivalence premire, sa soudaine prise en compte de la dimension symbolique comme telle, et lembarras dans lequel elle plonge tout sujet. Mais dabord: quelques faits, pour quitter la prilleuse gnralit de lobsessionnel et entrer dans la singularit plus praticable du cas. Voici ce que Freud raconte, entre autres choses du mme acabit, concernant son homme-aux-rats:Le jour o elle [sa cousine dUnterach] partit en voyage, il heurta du pied une pierre qui se trouvait dans la rue et il dut lenlever de l aprs que lui soit venu lide que, dans quelques heures la voiture de son amie pourrait passer dans cette mme rue, et que cette pierre pourrait provoquer un accident, mais quelques minutes aprs il sentit que ctait absurde (Unsinn), et il dut alors revenir sur ses pas et remettre la pierre sa place antrieure au milieu de la rue. S.Freud, Remarques sur un cas de nvrose obsessionnelle, Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1971, p.222, traduction revue, et Lhomme-aux-rats, Journal dune analyse, PUF, Paris, 1974, p.219..Bien des annes plus tard, crivant le chapitreVI de Inhibition, symptme, angoisse, Freud inscrit ce genre de comportement dans ce quil nomme alors le Ungeschehenmachen, que lon traduit par annulation rtroactive, laquelle consiste, selon le dire de Freud, enune magie ngative, qui vise effacer en soufflant dessus (wegblasen), par un symbolisme moteur (durch motorische Symbolik), non pas les suites dun vnement (impression, exprience vcue), mais cet vnement lui-mme. S.Freud, Hemmung, Symptom und Angst, Studienausgabe vol. VI, Fischer Verlag, Frankfurt, 1975, p.263..Le premier problme, dans ces quelques lignes, tient dabord cette expression, curieuse sous la plume de Freud, de motorische Symbolik; il est vrai aussi que cet adjectif motorische apparat trois fois dans le mme paragraphe, ce qui est assez inhabituel chez lui, mme si lon garde en mmoire ses motorischen Neuronen de lEsquisse. La deuxime fois, il est question du fait que, bien souvent, on semploie considrer comme non arriv (en franais dans le texte de Freud) un vnement dplaisant. Mais dans la nvrose, poursuit-il, on cherche supprimer le pass lui-mme et le refouler de faon motrice. [] whrend man in der Neurose die Vergangenheit selbst aufzuheben, motorische zu verdrngen sucht. Sudienausgabe, vol. VI, op. cit., p.264.. Ce qui le conduit conclure: Nous acqurons ainsi un aperu inattendu sur une technique nouvelle, motrice, [] du refoulement. Wir erhalten so unerwarteten Einblick in eine neue, motorische Technik [] der Verdrngung. Ibidem..Vers quoi se dirige donc cette hte qui ne se contente pas de manipuler des reprsentations pour faire triompher le refoulement mais doit, au dire de Freud, mettre en uvre la motricit afin de faire que ne soit pas advenu quoi donc, au fait?Le pass lui-mme, rpond Freud. Devons-nous le croire sur ce point? Si lon sen tient au petit exemple de lhomme-aux-rats avec sa Dame, linluctable nest pas que la pierre soit l mais que, tant l, il devient possible quelle heurte la voiture et quil y ait ainsi accident. Lhomme-aux-rats dplace donc la pierre pour quil ny ait pas accident. A sarrter l, il naurait rien fait dautre que lutter contre un futur contingent. Nous faisons tous a, longueur de temps, cest mme le principe de lassurance: nous payons effectivement, et fort cher, en vue de quelques futurs contingents. Jusque l, rien dire.Maintenant vient la volte-face: cest elle qui nous intresse et fait problme. Lhomme-aux-rats, nous dit Freud, trouve que lestimation selon laquelle la contingence de ce futur serait dune telle vraisemblance quil urgerait dy contrecarrer, cette estimation lui parat soudain Unsinn, absurde. a ne se peut pas: ici gt une inconnue de taille: la pierre et-elle fait vingt kilos, a naurait eu rien dUnsinn de la dplacer. Si par contre elle faisait vingt grammes, videmment Et ceci nest pas immdiatement rductible lambivalence amour/haine. Un jugement sur la ralit extrieure est venu ainsi sintercaler dans une squence jusque-l apparemment imprieuse: pierre-voiture-choc-accident, pour la rendre hautement invraisemblable. Cest alors que surgit vritablement le Unsinn: si la pierre ntait plus considre comme capable de gnrer un accident, il en allait de mme a fortiori quant labsence de cette mme pierre. Pourquoi diable aller la remettre en place, pourquoi dployer cette motricit, et au service de quel refoulement?Pour effacer lvnement de pense qui a fabriqu la squence pierre-voiture-choc-accident. Ici, le moi flaire soudain que cette pense, dsormais peu et mal soutenue par limagination qui lui prtait jusque-l un rfrent, laisse trop bien deviner ce quelle a dagressif. En ce sens, et en ce sens seulement, la pierre doit revenir l o elle tait, comme de mme dans Les trois mousquetaires les ferrets de la Reine doivent revenir dare-dare dAngleterre. Bien des hros, linstar de DArtagnan, ont pour tche essentielle daccomplir de faon motrice un refoulement, un effacement de traces. afin quelle puisse les arborer au bal du Roi, montrant ainsi que Buckingham nest pas son amant, en dpit des insinuations du mchant Richelieu. Labsence de cette pierre est identiquement compromettante vis--vis du surmoi de lhomme-aux-rats.Tant quil sagissait dimaginer ce qui pouvait arriver, dimaginer un possible, la responsabilit en tait au premier chef dvolue la ralit, et tout allait bien; mais sil faut en venir imaginer ce qui ne peut pas arriver, imaginer un impossible, la responsabilit en choit pleinement alors celui qui imagine. Un lger changement de focale, en faisant passer du possible limpossible (sans pouvoir aucun moment se rgler sur le contingent), a dplac compltement laccent quant la cause: ctait la faute la ralit, dsormais cest la faute au moi, qui va dclencher ses activits motrices pour faire que ne soit pas advenu le travail de pense qui a t le sien lors de la motricit premire, travail de pense qui, trs littralement, le met en cause.Ce quil sagit deffacer en soufflant dessus, cest proprement ce travail de pense qui a dj laiss sa trace, qui sest dj compromis en retirant la pierre de la rue. Dans un premier temps, la ncessit suffisait faire loi, et la squence pierre-voiture-choc-accident relevait alors, disons, dune physique lmentaire et parfaitement contraignante. Quand cette physique sest dissipe pour se rduire son trognon de conscutions littrales, son pur appareillage symbolique, la perte du rfrent mondain a conduit la recherche dun autre fondement, et cette recherche a chou. Personne nest l pour soutenir cette squence ds lors quelle nest plus arqueboute sur sa vraisemblance mondaine, ce que jai appel sa physique. De l que cette squence ne tienne plus, et quil faille quelle nait jamais exist. Elle nest plus quune reprsentation sans objet, mais qui plus est sans sujet non plus dsormais. Elle na donc plus lieu dtre.
2. Une squence sans objet en qute de son sujetJe laisserai ici lhomme-aux-rats et son wegblasen pour appauvrir encore un peu lesquisse de lacte que nous lui empruntons, via Freud. Au centre de laffaire se tient une squence littrale qui se prsente comme un scnario au sens o il sy passe quelque chose, et mme quelque chose de dramatique: un accident, avec ses relents mortuaires immdiats. Nous voil ici dans le champ classique de la reprsentation: un chiffrage symbolique plus ou moins quelconque vient re-prsenter une ralit elle-mme plus paisse, plus obscure, plus complexe. Cette reprsentation a besoin dun sujet, qui nest autre en son fondement que lego cartsien, lequel, une fois assur dans son existence par le cogito cest--dire hors toute reprsentation peut les voir dfiler sans se dire que cest elles quil doit son existence. Cette reprsentation a non moins imprativement besoin dun rfrent pour tre alors valide, et ne pas apparatre comme une lointaine cousine du cercle carr, de lactuel Roi de France (qui est chauve), ou du Pre Nol (qui vit au Pole Nord). Mais ce sujet, et un rfrent non contradictoire une fois donns, la reprsentation tient remarquablement le coup.Peut alors surgir un problme hirarchiquement suprieur: si jajoute un certain nombre de reprsentations valides, la squence obtenue sera-t-elle valide? Pas forcment! Cest mme tout le problme de la constitution dun savoir, o se dvoile une nouvelle fois ce que chaque reprsentation cache assez bien dordinaire: la ncessit dun sujet pour donner corps la perspective dune srie dvnements contingents. Lego cartsien a, pour sa part, remarquablement soutenu la constitution du savoir scientifique. Mais certaines apories rencontres au sein mme de ce savoir scientifique, aussi bien vers la fin du sicle dernier que tout au long de celui-ci, ont remis sur la sellette lempire de cet ego et du palais que lui a construit Kant avec son esthtique transcendantale.Or cest autour de ce terme de sujet, et dans une critique constante du terme de reprsentation, quaura tourn la rvolution opre par Lacan dans le champ freudien, tandis que la distinction des registres du symbolique, de limaginaire et du rel lui permettait dappauvrir plus encore le sujet que ne lavait fait les Mditations de Ren Descartes.On se souvient en effet qu peine le cogito produit lissue des deux tapes successives du doute qui suspendent tout savoir, peine profr le Je pense, jexiste, Descartes demande: Mais quest-ce donc que je suis? pour rpondre aussitt: Une chose qui pense. Or, dj, cette chose qui pense nintresse plus Lacan: il le dit en clair Henri Ey ds Bonneval, et nen dmords pas par la suite. Le dualisme cartsien ne retient pas une seconde son attention.Ds 1957 linverse, on peut lentendre articuler des formules commentes dans leur dtail bien plus tard, en 1966, 1967 et surtout 1968 dans le sminaire LActe analytique formules selon lesquelles: Je pense l o je ne suis pas; Je suis l o je ne pense pas, bref: tre et pense sont bien lis, mais dans un vel exclusif du style: La bourse ou la vie.Il faut ici se rappeler que cette chose qui pense prsente au yeux de Descartes peu prs la somme des activits de la conscience psychologique: Quest-ce quune chose qui pense? Une chose qui doute, qui conoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent.Toute cette richesse psychologique, Lacan nen veut pas pour son sujet; le moi spculaire, rflexif, suffit la tche psychologique. Le dcollage du sujet et du moi permet Lacan daller sparer, au sein de cette chose qui pense, ce qui revient au sujet psychologique, cest--dire au moi spculaire, et ce qui revient au sujet en tant quil serait dabord dtermin par le symbolique. La coupure cartsienne entre lme, sige des passions, et ego, sujet psychologique, se trouve ainsi dplace vers une nouvelle coupure entre le moi spculaire et un sujet dgraiss de toute psychologie, autrement dit: dune extrme pauvret. Lacan ne sintresse, dans les Mditations, quau rejet de tout savoir.Il comporte en lui, disait-il en parlant du cogito le 17janvier 1968, cet lment particulirement favorable y reloger le dtour freudien [] regarder de prs le cogito de Descartes, observez bien que le sujet qui y est suppos comme tre, il peut tre celui de la pense, mais de quelle pense en somme? de cette pense qui vient de rejeter tout savoir.La seule chose qui retient Lacan dans toutes les Mditations, cest le moment mme de profration du cogito puisque ce dernier ne surgit qu lexpresse condition quait t suspendu tout savoir. Il ne sagit pourtant pas de faire le vide pour atteindre au cogito, mais de concevoir clairement que les figures qui se prsentent la pense se prsentent la pense. Au lieu que ces figures regardent vers leur prototype mondain pour justifier de leur existence, comme limagination y pousse obstinment, elles se mettent chacune se retourner telle Eurydice vers ce qui, soudain, assiste alors furtivement la rflexivit dont il est lun des termes. Je pense, jexiste, cette jaculation dit le lien qui attache cet ego ces figures lorsquelles-mmes ne font plus mine dtre attaches quoi que ce soit dautre.Cet ego-l, dans le bref battement temporel peine rflexif o il fait face aux figures de ses penses et elles seules, celui-l pourra tre dit reprsent par un signifiant pour un autre signifiant. Avant que le sujet psychologique ne revienne faire son miel cet endroit en sy installant sous lappellation de chose qui pense, il faut, aux dires de Lacan, prendre en compte ce lieu du sujet comme la place la plus vide entre toutes, la plus pauvre, aussi dcisive pourtant que la pice manquante au jeu du taquin. Et ici, ce niveau dextrme appauvrissement du sujet, nous pouvons en revenir notre homme-aux-rats et sa squence.
3. Le sujet mis en causeIl ny a pas proprement parler refoulement de cette squence, mais tentative (motrice, en effet) dradiquer son sujet aprs quelle soit apparue comme sans objet: travers cette pense, rien naurait t pens mais, qui plus est, par personne. Voil le redoublement que vise le Ungeschehenmachen de lhomme-aux-rats: le sujet psychologique, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent, celui-l, en ramenant la pierre en place, a ray de la carte le sujet de la squence pierre-voiture-choc-accident.En venant ainsi remettre ni vu ni connu je tembrouille sa pierre au milieu de la rue, lhomme-aux-rats nous est sa faon aussi prcieux que le bruyant dipe se crevant dramatiquement les yeux; au lieu de faire disparatre dfinitivement son image spculaire comme son anctre athnien il se refait discrtement le pli du pantalon. Le souci moque de son image aura prvalu sur ce quil pressent trop bien! de sa dchance subjective. tre ce qui a pens cela (pierre-voiture-choc-accident): NON! Plutt ne pas tre: ici prend place un mefuna, plus discret srement, mais de la mme trempe que celui du boiteux. Plutt ne pas tre qutre le produit de cette dtermination dans laquelle je ne parviens pas me reconnatre.Avec ce ne pas sy reconnatre, nous pouvons maintenant retrouver les voies, toujours prcaires, de la contingence, si essentielles pour dire quoi que ce soit qui vaille de lacte.Retournons pour ce faire sans vergogne lexemple canonique dAristote: la bataille navale aura-t-elle lieu demain? Quelle ait lieu est certes possible, et ouvre toute grandes les voies de mon imagination: le choc des navires, les cris dans la pagaille, le sang maculant le bleu de la mer, ce bleu dont Claudel notait quil est parfois tellement bleu quil ny a que le sang qui soit plus rouge , comme la bataille navale est possible! Peut-tre aussi naura-t-elle pas lieu: les flots calmes, cette ternit rimbaldienne de la mer alle avec le soleil, les nuages, si souvent presss, comme nous , comme labsence de bataille navale est possible, elle aussi! Mais comment donc me reprsenterai-je pour finir la contingence de cette foutue bataille navale? En prcipitant mon esprit dune image son contraire, et vice versa, jusqu me donner le vertige? Ou resterai-je interdit, en arrt sur le seuil de tout ce charroi imaginaire, si incertain sur lordre du monde que je ne parviens plus y intgrer ces images de ma fabrication?Pour apprcier la contingence de cette bataille, il va falloir que, dans un mouvement en deux temps trs proche de celui par lequel je maventure vers le cogito, je me la donne comme reprsentation, et je ne me la donne pas comme effective, autrement dit que je ne me la donne que comme reprsentation. Mais que signifie un tel ne que, sinon quavec lui je perds limage incruste dans la reprsentation, un peu comme je me mets regarder lcran du rcepteur de tlvision uniquement quand limage se brouille et que se perd cet arrire-plan o il se passait tant de choses, o je ne cessais de my reconnatre, quoi que ce fut qui sy donnt voir?Ce drangement de la vision, cette soudaine opacit de ce qui jouait jusque-l comme mdium transparent, cest la situation rgulire assez peu confortable du sujet lacanien, et il ne tient quau moi de ly soustraire ou pas. Le moi est donc lui aussi dans le coup de lacte, qui nest pas certes pas le privilge du sujet tout seul, sinon concevoir une nouvelle fois ce dernier sous les espces du sujet transcendantal habituel, roi de son libre-arbitre et de sa volont. Le moi est dans le coup de lacte, mais dabord dans la position de ce qui pourrait empcher son accomplissement. Cest mme la raison pour laquelle la mort est si souvent lhorizon de tout acte digne de ce nom, comme la marque dune exclusion, dune mise hors jeu enfin assure du moi. Une fois mort, plus question de se livrer aux agissements espigles et inquiets de lUngeschehenmachen; enfin sera venu le temps de lacte pur, de lacte sans retenue. Quel dommage, simplement, quil faille dabord tre mort pour se trouver enfin de plain-pied avec lacte!Mais il est vrai quen attendant, je ne lance jamais que des moitis dacte qui quand bien mme elles ne seraient pas touffes dans luf par un moi aux aguets narrivent pas non plus sadditionner pour tomber juste, rveillant sur leur passage laphorisme de Karl Krauss selon lequel un aphorisme, prcisment, nest jamais une vrit: seulement une demi vrit, ou une vrit et demie. De mme, il arrive que nous sortions quelque pierre de nos chemins, la suite de rveries, calculs, estimations, vux et hypothses diverses, mais cette moiti dacte que nous commettons alors ne fait, au mieux, quattendre sa sanction, attendre cette deuxime moiti qui ne nous appartient pas, qui viendra ou pas, comme la bataille navale.Quil y ait donc quelque chose plutt que rien non pas en gnral, mais en rponse la mise constitue par lexpression de tel agencement de pense propre dterminer un sujet, cette contingence-l nest pas le fruit de lambivalence des sentiments. Elle touche bien plutt ce mystre dont Einstein smerveillait en se demandant pourquoi diable la nature rpondait aussi obstinment certains agencements de nos petites lettres. Lambivalence, elle, est dj une faon den finir par anticipation avec ce suspens, cette interrogation trop vive, en effectuant imaginairement les deux versants possibles de la rponse, et en sy collant alternativement pour surtout, surtout, ne pas sarrter sur le pli aigu o chacune des reprsentations contradictoires vacille et sestompe.Sur larte mme de la question, nulle image ne vient r-instaurer si vite le sujet psychologique, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. Seul reste actif ce moment celui que jaimerais pour conclure appeler le sujet de la loterie. Quelques lments de la discussion suivant cet expos ayant laiss penser que je renvoyais ici notre Loto national et bi-hebdomadaire, je voudrais encore prciser quelle loterie javais en tte au moment o jcrivais cette expression. Plutt celle que Pascal dveloppait en soutenant sa faon ( propos des expriences sur le vide) que la Nature ne sait que rpondre une chose nos montages exprimentaux: non. Ou bien elle se tait, invitant lexprimentateur poursuivre jusqu ce quil se heurte un non ultrieur, ou bien elle dit non tout de suite. Car seule lerreur est certaine, nous obligeant rebrousser chemin pour explorer de nouvelles voies qui ne seront pas si vite scandes dun tel non. Bien sr, quand un chercheur heureux commence collectionner une srie de non- non, comme un joueur de roulette qui la boule dirait plusieurs fois de suite continue, continue, les regards se tournent vers lui, mais lui peut savoir quil va perdre. Une loterie, en somme, o le gagnant serait celui qui voit son numro ne pas sortir le plus longtemps possible. Une loterie un peu la Borges, quand celui-ci crivait La loterie Babylone, mutique, statique, mme pas anxieux, le sujet de pendant le tirage (lexprience), espoir et crainte en suspens. Avant aprs oh oui! De lambivalence il y en a eu et il y en aura. Mais pas l, pas pour ce trognon de sujet reprsent par un numro pour un autre numro qui viendra? viendra pas?