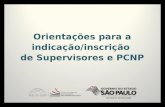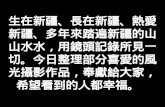171 PCNP 16 F bis - La Chine dans un monde en … · Web viewLa RPC se sent menacée par le...
Transcript of 171 PCNP 16 F bis - La Chine dans un monde en … · Web viewLa RPC se sent menacée par le...

PC171 PCNP 16 F bisOriginal : anglais
Assemblée parlementaire de l’OTAN
COMMISSION POLITIQUE
LA CHINE DANS UN MONDE EN MUTATION
RAPPORT
Paolo ALLI (Italie)Rapporteur
Sous-commission sur les partenariats de l’OTAN
www.nato-pa.int 19 novembre 2016

171 PCNP 16 F bis
TABLE DES MATIÈRES
I. INTRODUCTION : LE RÔLE CROISSANT JOUÉ PAR LA CHINE DANS LES AFFAIRES INTERNATIONALES.......................................................................................1
II. LES PRIORITÉS EXTÉRIEURES ET SÉCURITAIRES CHINOISES À LA LUMIÈRE DES FACTEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX...................................1
III. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE...........................................................................................3A. LES RELATIONS AVEC LA RUSSIE........................................................................5B. LES MERS DE CHINE ORIENTALE ET MÉRIDIONALE.........................................6C. LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE..............................9D. L’AFRIQUE.............................................................................................................10E. L’ARCTIQUE...........................................................................................................11F. LA CHINE ET L’OTAN............................................................................................12
IV. CONCLUSIONS...............................................................................................................13
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE.........................................................................................15
i

171 PNCP 16 F bis
I. INTRODUCTION : LE RÔLE CROISSANT JOUÉ PAR LA CHINE DANS LES AFFAIRES INTERNATIONALES
1. Bien que les priorités des dirigeants chinois continuent d’être le développement économique du pays et la stabilité politique et sociale de celui-ci, la République populaire de Chine (RPC) n’a cessé, depuis la fin des années 1970, parallèlement aux progrès spectaculaires de son économie, d’accroître son rôle sur la scène internationale. Aujourd’hui, la Chine est un acteur véritablement mondial, notamment dans les domaines économique et financier, mais aussi, de plus en plus, sur le plan de la sécurité internationale. Selon son propre discours, la politique étrangère du pays, sous la conduite du parti communiste chinois (PCC), reste principalement axée sur le maintien d’un environnement régional stable permettant à l’économie chinoise de croître, de même que sur la gestion de son « essor pacifique » de telle sorte qu’il n’entraîne pas de situations conflictuelles. Cependant, les récentes actions menées par la Chine, en particulier ses revendications territoriales et ses mouvements dans les mers de Chine (orientale et méridionale), font craindre à ses voisins qu’elle n’adopte une attitude plus ferme à leur égard.
2. Si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) n’a pas de politique officielle à l’égard de l’Asie ni ne joue de rôle manifeste dans la région, il n’en demeure pas moins que le poids croissant exercé par la Chine sur les affaires mondiales a d’importantes répercussions sur la sécurité individuelle et collective des Alliés, de même que sur leurs intérêts politiques et économiques. L’instabilité régionale découlant de l’aggravation des tensions entre Beijing et certains pays de l’Asie-Pacifique aurait une incidence concrète sur les États membres de l’OTAN, notamment en raison des liens politiques, économiques et financiers étroits qui existent entre plusieurs de ces pays et les pays occidentaux. L’objet du présent rapport, assez bref, est d’apporter des éléments d’information aux membres de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP-OTAN) sur l’essor de la Chine et ses implications possibles pour la sécurité des Alliés. À cet effet, le rapporteur proposera une analyse succincte des priorités chinoises en matière de politique étrangère et des facteurs nationaux qui les déterminent. Le présent document donne suite aux rapports antérieurs de la commission politique sur l’interdépendance, en matière de sécurité, entre les régions Asie-Pacifique et euro-atlantique, ainsi qu’au rapport général de la commission politique en 2011 sur L’essor de la Chine et ses répercussions possibles pour l’OTAN [183 PC 11 F rév. 1] .
II. LES PRIORITÉS EXTÉRIEURES ET SÉCURITAIRES CHINOISES À LA LUMIÈRE DES FACTEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
3. Pour assurer la survie du régime, qui dépend dans une large mesure de la poursuite de la croissance économique, le principal objectif des dirigeants chinois est la stabilité politique intérieure. Depuis la fin des années 1970, les responsables politiques n’ont cessé de mener des réformes progressives, qui ont permis à la Chine de s’orienter graduellement vers l’économie de marché. Ces réformes ont connu un remarquable succès, faisant du pays la deuxième puissance économique mondiale et un acteur économique et financier influent à l’échelle planétaire. L’idéologie communiste ayant perdu de sa pertinence après la fin de la Guerre froide, les dirigeants politiques se sont également parfois servis du nationalisme pour s’assurer l’appui de la population. Il s’ensuit que toute analyse des principales préoccupations liées à la politique étrangère chinoise doit s’inscrire dans le cadre des contraintes et priorités nationales. Xi Jinping, secrétaire général du parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine et président de la Commission militaire centrale, a fait de sa conception du « rêve chinois » (le renforcement, d’ici 2050, de la puissance militaire, économique et culturelle du pays, par « [la mise en œuvre d’une modernisation] forte, (…), démocratique, harmonieuse et culturellement avancée ») le signe distinctif de son gouvernement. Il importe de comprendre la façon dont les responsables nationaux envisagent de faire de la Chine, en l’espace de quelques décennies
1

171 PNCP 16 F bis
seulement, une économie pleinement développée et une puissance véritablement mondiale pour appréhender et analyser l’orientation des politiques économique, étrangère et de sécurité chinoises.
4. Le XIIIe Plan quinquennal (2016-2020) du Conseil des affaires d’État, approuvé par le Comité central du PCC en octobre 2015 et officiellement adopté par l’Assemblée nationale populaire en mars 2016, permet de mieux comprendre le nouvel axe de développement économique retenu par la Chine pour les années à venir. Il met l’accent sur les objectifs consistant à parvenir à un développement « durable, écologique, équilibré et sans exclusive », à bâtir une « société respectueuse de l’environnement » ainsi qu’une Chine « modérément prospère ». Ce dernier objectif se comprend d’une façon générale comme consistant pour le gouvernement chinois à doubler d’ici à 2020 le produit intérieur brut (PIB) et le revenu par habitant de 2010. De manière plus générale, le nouveau plan quinquennal fait ressortir le bien-être des citoyens et, notamment, la nécessité de s’employer à relever le niveau des salaires, à moderniser l’agriculture, à réduire les différences de revenu et à améliorer les services de santé.
5. Sous la conduite du nouveau président, la Chine connaît une transformation politique ayant entraîné une centralisation des pouvoirs entre les mains de Xi Jinping. Dans le cadre de cette conception nationale, M. Xi a, plus que tout autre dirigeant depuis le président Mao, consolidé son autorité personnelle au sein de l’appareil politique chinois. Le pouvoir politique qu’il détient a été renforcé depuis son entrée en fonction, notamment par la voie d’une campagne médiatisée de grande envergure visant à éradiquer la corruption au sein du parti communiste chinois, campagne qui a visé de nombreux hauts responsables depuis son lancement il y aura bientôt trois ans. Il convient d’observer que cette campagne de lutte contre la corruption est, selon certains analystes, une façon pour M. Xi de se débarrasser de ses adversaires politiques et que la centralisation des pouvoirs entre les mains de celui-ci a par ailleurs suscité de vives réactions de la part des cadres du parti, bien conscients que la dernière fois que les pouvoirs avaient été centralisés de la sorte, sous Mao, cela avait conduit à la catastrophe. Le système que le PCC avait soigneusement ajusté pour essayer d’équilibrer les intérêts politiques a été ébranlé par M. Xi. Cette centralisation des pouvoirs illustre la fragilité de ce système.
6. En effet, depuis plusieurs décennies, le PCC s’en tient avec ses citoyens à un « contrat social non écrit » en vertu duquel la participation à la vie politique reste limitée, en échange de quoi le gouvernement continue de favoriser une croissance soutenue et l’augmentation rapide du niveau de vie. Toutefois, la viabilité de ce compromis implicite entre l’accroissement de la prospérité et les droits politiques, de même que la réputation de compétence en matière économique dont jouissent les dirigeants du pays, ont été malmenés ces derniers temps. Un krach boursier et une série de mesures politiques maladroites ont accentué le ralentissement de la croissance économique de la Chine, qui dure depuis plusieurs années déjà. De surcroît, malgré l’adhésion du pays à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les multiples promesses de réforme, les efforts déployés par celui-ci pour s’approcher de l’économie de marché ont été ralentis. Environ 60 % du PIB chinois sont générés par les entreprises d’État, qui absorbent près de la moitié des crédits bancaires mais n’assurent que le cinquième de la production industrielle. Si le nombre des entreprises d’État a été réduit depuis les années 1990, le programme de relance initié par le gouvernement au lendemain de la crise financière et économique de 2007/2008 a généré construction d’usines et nouveaux équipements, sans que la demande ne suive. Ainsi, malgré les nombreuses promesses de réforme, la part des entreprises d’État n’a pas diminué ces derniers temps, ce qui pose des problèmes importants non seulement pour la Chine mais aussi pour l’économie mondiale.
7. En 2015, le taux de croissance du PIB officiel a reculé à 6,9 % – soit le taux de croissance le plus faible de ces 25 dernières années –, fragilisant les prévisions des responsables chinois selon lesquelles un taux de croissance de 8 % et au-delà serait la norme pour au moins les deux décennies à venir. Pour 2016, les prévisions des économistes varient de 6,5 % (objectif officiel) à
2

171 PNCP 16 F bis
5 % et même en-deçà. Suivant un grand programme de relance monétaire en 2009, les entreprises du secteur privé et les entreprises d’État ont massivement emprunté, ce qui a fait passer le ratio dette publique/PIB de 170 % environ en 2007 à 280 % à la mi-2015. Comme indiqué plus haut, les entreprises d’État non financières chinoises absorbent près de la moitié des crédits bancaires mais n’assurent que le cinquième de la production industrielle. Un rapport du Fonds monétaire international (FMI), paru en août 2016, met en garde contre l’« augmentation des risques à la baisse » et rappelle la nécessité de prendre des « mesures décisives » pour réduire la dépendance de l’économie chinoise à l’égard du crédit, y compris de réformer voire de fermer les sociétés par trop endettées. La forte volatilité du marché boursier, apparue au cours de l’été 2015, a eu de graves répercussions sur les marchés financiers internationaux et a entraîné des interventions d’urgence de la Banque centrale. À plus long terme, l’économie chinoise sera également soumise aux pressions démographiques et sociales. Les progrès économiques, inégalement répartis au cours des 30 dernières années, ont favorisé les régions côtières de la Chine, y provoquant une urbanisation grandissante et engendrant des inégalités très marquées entre les zones rurales et les villes.
8. Les quelque 280 millions de travailleurs migrants dont les possibilités d’accès à l’éducation et à l’aide sociale sont limitées, constituent un autre enjeu social auquel se heurte la RPC. En outre, la politique de l’enfant unique s’est soldée par le vieillissement rapide de la population. Le renversement de la pyramide des âges qui en découle et le passage du modèle social traditionnel de type familial à l’État providence risquent d’influer sensiblement sur le budget de l’État. L’abandon de la politique de l’enfant unique et la possibilité pour les couples d’avoir un deuxième enfant, annoncés à la fin de 2015, marquent la reconnaissance de la nécessité de remplacer une main-d’œuvre vieillissante et d’accroître la consommation. Cependant, cette possibilité d’avoir un deuxième enfant arrive trop tard ; peu de gens en profiteront et il faut s’attendre à ce que la Chine vieillisse avant de s’être enrichie. Qui plus est, le très grand nombre d’hommes privés de conjoints en raison de l’avortement sélectif des fœtus féminins a suscité de telles inquiétudes que le gouvernement a lancé une campagne publicitaire visant à inciter les couples à élever des filles.
9. Des difficultés sont de toute évidence à prévoir, dans la mesure où le pays cherche à opérer un rééquilibrage important de son modèle économique – passer d’un modèle essentiellement tributaire de l’investissement public et des exportations industrielles à un modèle davantage axé sur les services, soutenu par la consommation – dans un contexte de faiblesse de la demande mondiale. En tout état de cause, certains analystes estiment que les difficultés économiques actuelles de la Chine, considérées dans leur ensemble, annoncent une stagnation plus profonde et plus longue, aux conséquences imprévisibles pour la légitimité politique du PCC. D’autres insistent sur le fait que la Chine reste la deuxième puissance économique mondiale et que son programme de transformation économique semble en très bonne voie, compte tenu des turbulences sur les marchés financiers mondiaux et de la réduction des échanges. Le rôle de la consommation intérieure privée dans l’économie augmente chaque année, entraînant une explosion du secteur des services à travers le pays.
III. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
10. Les priorités générales affichées par la Chine en matière de politique étrangère consistent à maintenir un environnement régional stable et à gérer son « développement pacifique » en tant que puissance mondiale. Vu l’attention accordée par le PCC au développement de l’économie et de la société du pays, et le fait que la Chine est tout à la fois une puissance économique et financière de premier plan et un pays en développement, la politique étrangère chinoise est, par nécessité, en partie déterminée par la question des ressources. À ce titre, elle consiste essentiellement à faciliter et à promouvoir la coopération internationale afin de répondre aux besoins économiques du pays. À la lumière des développements intérieurs actuels et des
3

171 PNCP 16 F bis
contraintes évoquées plus haut, bon nombre des priorités de la politique étrangère et de sécurité chinoise s’éclairent. 11. Témoignant d’un sens aigu de l’histoire et de son rôle en tant qu’acteur majeur sur la scène internationale dans les domaines économique, financier et, de plus en plus, politique, la Chine devient plus ambitieuse dans ses engagements internationaux. Cela se manifeste en particulier dans les relations accrues qu’elle entretient avec des organisations internationales comme le FMI et l'ONU. La décision du FMI, annoncée en novembre 2015, d’inclure la monnaie chinoise (le renminbi) dans le panier de devises servant à fixer la valeur des droits de tirage spéciaux (DTS) – l’actif de réserve international du Fonds – qui, ce faisant, rejoint le dollar, l’euro, la livre sterling et le yen, souligne le poids financier et économique de plus en plus important du pays et devrait augmenter l’utilisation du renminbi dans la finance et les échanges mondiaux. D’un côté, le fait que le renminbi ait intégré le panier des devises du FMI est une façon de reconnaître que la Chine est désormais un « acteur mondial » et a été utilisé par les dirigeants chinois comme approbation par la communauté internationale de la capacité du PCC à gérer l’économie du pays. De l’autre, son inclusion dans le panier des devises servant à fixer les DTS a eu un effet secondaire négatif, puisqu’il a également provoqué un décaissement de devises et a créé des difficultés d’ajustement entre les comptes en Chine et hors de Chine libellés en renminbi.
12. En même temps, Beijing se demande si les organisations internationales existantes sont bien adaptées au monde d’aujourd’hui. La Chine établit donc également de nouveaux cadres de coopération internationale, qu’elle considère comme étant plus à même de promouvoir ses intérêts dans un monde de plus en plus multipolaire, tels que la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Nouvelle banque de développement et le projet d’infrastructure Belt and Road (« Ceinture et route ») 1. Certains analystes voient dans ces nouvelles initiatives une remise en question des institutions de Bretton Woods mises sur pied par les États-Unis et leurs alliés européens après la seconde guerre mondiale, voire une opposition à celles-ci. D’autres, en revanche, considèrent leur apparition comme une conséquence logique aussi bien d’un glissement opéré dans l’équilibre mondial des forces économiques et politiques, que d’une frustration face à la lenteur des réformes de la gouvernance au sein des institutions de Bretton Woods, réformes censées refléter cette évolution. Reste à savoir si ces initiatives déboucheront sur des blocs commerciaux régionaux pouvant porter préjudice aux échanges mondiaux, ou sur le renforcement des institutions et une intégration plus poussée via l’Asie-Pacifique.
13. Conçue comme une reconstitution moderne de la Route de la soie, l’initiative Belt and Road présente une composante terrestre (la Ceinture économique de la Route de la soie) et une composante maritime (la Route maritime de la soie). Le développement de réseaux routiers et ferroviaires continus entre la Chine et l’Europe qui traverseraient l’Asie centrale et le Moyen-Orient, ainsi qu’une route maritime reliant les installations portuaires chinoises à la côte africaine qui emprunterait ensuite le canal de Suez vers la Méditerranée y sont envisagés. En consacrant les capitaux et la capacité de production excédentaire nationale (notamment dans les secteurs manufacturier et sidérurgique) au développement d’infrastructures régionales, Beijing entend améliorer les échanges et les relations avec les pays d’Asie, d’Asie centrale et d’Europe.
14. Belt and Road est une initiative ambitieuse à l’énorme potentiel économique – et singulièrement politique – qui pourra renforcer le rôle international de la Chine et influencera en tout cas les relations qu’elle entretient avec ses voisins, lesquelles sont parfois tendues. S’il se concrétise, Belt and Road concernera des dizaines de pays, soit une population totale de plus de trois milliards de personnes. Au cours de la visite que la sous-commission a effectuée en Chine en juillet 2016, les interlocuteurs chinois ont comparé ce projet au plan Marshall en Europe au sortir de la seconde guerre mondiale, soulignant qu’il offre des possibilités à toutes les parties
1 Ce projet était auparavant appelé One Belt, One Road (« Une ceinture, une route »).
4

171 PNCP 16 F bis
concernées, y compris aussi à l’Inde, même si New Dehli reste peu encline à y participer. Certaines analyses ont souligné la possibilité que la Chine accroisse sa sphère d’influence, voire augmente le nombre de ses représentants à travers les 60 pays qui, au bout du compte, pourraient être associés au projet, et ce en dépit des affirmations contraires de Beijing. La Route maritime de la soie, en particulier, pousse d’aucuns à soupçonner la Chine d’avoir des arrière-pensées militaires, son objectif final pouvant être de permettre à sa marine de guerre d’accéder à toute une série de ports depuis la mer de Chine méridionale jusqu’à la côte orientale de l’Afrique. Il s’agit de la « stratégie dite du collier de perles », qui pourrait concerner notamment les ports de Colombo au Sri Lanka, Gwadar au Pakistan, Chittagong au Bangladesh, l’île de Maday au Myanmar et Port-Victoria aux Seychelles.
15. L’initiative Belt and Road aurait inévitablement des effets manifestes en Asie centrale, où la Russie et la Chine se disputent l’influence. L’approche de Beijing à l’égard des Républiques d’Asie centrale porte principalement sur les échanges et l’aide financière. La relative réserve qu’elle observe en matière d’ingérence dans les affaires intérieures de la région a fait recette et lui a permis de gagner, sur la Russie, beaucoup de terrain dans la région. Cependant, si la Russie et la Chine rivalisent en Asie centrale pour y conforter leur influence, elles partagent les mêmes préoccupations quant à l’extrémisme religieux – lequel s’explique en grande partie par la mauvaise gouvernance et la faiblesse des économies – et la même volonté de limiter l’influence des États-Unis et des Alliés dans la région.
16. La Russie s’est tout d’abord tenue à l’écart de l’initiative Belt and Road, essentiellement parce que Moscou se disait préoccupée par les incidences négatives que celle-ci pourrait avoir sur son propre projet d’Union économique eurasiatique (UEEA), qui comprend l’Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. Cette dernière continue de considérer l’Asie centrale comme sa sphère d’influence, que l’expansion économique chinoise dans la région pourrait fragiliser. Plus concrètement, Moscou estime devoir être la seule puissance à assumer la responsabilité de la sécurité régionale. Beijing ne conteste pas cette revendication et s’est jusqu’à présent abstenue de s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Asie centrale. La Russie a publiquement déclaré dans l’intervalle qu’elle reconnaissait les possibilités et les avantages qu’il pourrait y avoir à participer au projet Belt and Road. En mai 2015, les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping ont signé une déclaration établissant un lien entre l’UEEA et le projet Belt and Road. Pour l’heure, toutefois, ces derniers doivent encore aboutir à des résultats économiques et politiques concrets.
5

171 PNCP 16 F bis
A. LES RELATIONS AVEC LA RUSSIE
17. Si l’on peut avancer que l’importance de la Russie pour la Chine a diminué après l’effondrement de l’Union soviétique, elle demeure un élément à prendre en compte dans le cadre de la politique étrangère de Beijing. Les relations sino-russes, qui avaient connu des tensions pendant la majeure partie de la Guerre froide car Russes et Chinois se disputaient le contrôle du mouvement communiste à l’échelle planétaire, se sont sensiblement améliorées au cours des années 1990. Ces dernières années, Beijing et Moscou ont consolidé leurs relations bilatérales dans un certain nombre de domaines, allant des ventes russes de systèmes d’armement perfectionnés et des transferts de technologie militaire à de grands projets de coopération dans le domaine énergétique. Cette coopération s’inscrit également dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une organisation de sécurité régionale qui inclut également quatre pays d’Asie centrale et qui, à l’origine, se consacrait à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux. Entre-temps, le mandat de l’OCS a été élargi et prévoit désormais la stabilité régionale, la coopération économique ainsi que le développement énergétique.
18. La détérioration des relations entre Moscou et les Alliés – et, de manière plus générale, les pays occidentaux – après l’annexion de la Crimée par la Russie a incité cette dernière à poursuivre son virage vers l’Asie, accentuant par là-même l’importance des relations bilatérales qu’elle entretient avec la Chine et qui visent à compenser certaines des pertes engendrées par les sanctions occidentales (lesquelles lui ont fermé l’accès aux principaux marchés financiers et ont notablement réduit les investissements occidentaux en Russie). Si Beijing n’a pas reconnu l’annexion de la Crimée par la Russie, ni l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, elle s’est abstenue de condamner les actions de Moscou. La position de la Chine sur ces questions concerne de près non seulement les membres de l’Alliance mais aussi certains pays partenaires. Lors d’une visite au Japon de la sous-commission sur les partenariats de l’OTAN en 2015, les interlocuteurs du pays hôte ont laissé entendre que les mouvements chinois en mer de Chine étaient comparables aux actes d’agression menés par la Russie contre l’Ukraine et la Géorgie.
19. Outre l’expansion des possibilités d’échanges économiques et de coopération dans le domaine énergétique, la Chine et la Russie ont toutes deux intérêt au remaniement de la gouvernance (économique) mondiale ainsi qu’à limiter – ou à restreindre – l’influence des pays occidentaux, en particulier celle des États-Unis. Cependant, si Moscou et Beijing ont manifesté leur intention de faire passer leurs relations bilatérales à la vitesse supérieure, et si leurs liens économiques, diplomatiques et militaires se sont effectivement développés, les deux parties semblent actuellement peu désireuses de constituer une alliance politique et militaire ou de conclure d’autres ententes officielles. Les relations entre la Chine et la Russie demeurent un mariage de convenance et restent dominées par l’ambiguïté et la lutte pour l’influence régionale, surtout en Asie centrale. Qui plus est, Beijing n’ignore pas que son interdépendance économique avec les pays occidentaux importe bien plus pour son essor pacifique qu’un renforcement de la coopération avec la Russie.
B. LES MERS DE CHINE ORIENTALE ET MÉRIDIONALE
20. Il ne fait aucun doute que les tensions dans les mers de Chine (orientale et méridionale) sont préjudiciables aux intérêts des Alliés. Vu le volume des échanges commerciaux qui transitent par la mer de Chine, garantir la liberté de navigation et préserver les voies de communication maritime d’un bout à l’autre de la mer de Chine orientale et de la mer de Chine méridionale touchent à l’intérêt national non seulement des États-Unis mais également des autres Alliés. On estime que les échanges transitant par la mer de Chine méridionale représentent chaque année 5 300 milliards de dollars. Si l’antagonisme sino-japonais à propos des îles Senkaku/Diaoyu en mer de Chine orientale s’est atténué ces derniers mois grâce aux
6

171 PNCP 16 F bis
pourparlers de haut niveau, les archipels des Paracels et des Spratleys en mer de Chine méridionale font, depuis peu, l’objet de différends territoriaux dans la région.
21. La Chine a revendiqué des droits de souveraineté sur une grande partie de cette mer, dont on estime qu’elle recèle 11 milliards de barils de pétrole et 190 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel, provoquant la Malaisie, le Vietnam, le Brunei, Taïwan, l’Indonésie et les Philippines, lesquels ont leurs propres revendications. La région représente aussi un point de passage obligé en matière de navigation et abrite des stocks de poissons d’autant plus précieux que cette région est largement dépendante des protéines de la mer. Le différend remonte au début des années 1970, lorsque ces pays ont commencé à se prévaloir d’un droit de souveraineté sur certaines îles et différentes zones, tel l’archipel des Spratleys. Le Vietnam revendique les deux archipels (Paracels et Spratleys) et les Philippines sont encore traumatisées par ce que le président Benigno Aquino III a appelé « l’annexion » du récif de Scarborough par la Chine, il y a quatre ans.
22. Fin juillet 2016, à l’unanimité, la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye ne s’est pas prononcée en faveur de la Chine et a donné gain de cause aux Philippines, arguant qu’en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), il n’y avait aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits historiques sur la plupart des eaux de la mer de Chine méridionale. La Chine a boycotté la procédure, soutenant que le tribunal n’avait pas compétence en l’espèce et indiquant qu’elle ne tiendrait pas compte de ses décisions. En même temps, au lendemain de la décision de la CPA, les responsables chinois ont déclaré à plusieurs reprises – y compris aux membres de la sous-commission sur les partenariats de l’OTAN qui se sont rendus en Chine juste après la décision – que le différend devait être tranché par la voie de la consultation et de la négociation, et que la RPC poursuivrait le dialogue afin de parvenir à un accord. La réaction de la RPC face à sa défaite juridique et, plus important encore, son attitude future envers ses voisins en ce qui concerne la mer de Chine méridionale montrera bien dans quelle mesure Beijing a l’intention de se conformer au droit international.
23. Paradoxalement, les tentatives chinoises de s’imposer dans la région, si elles y ont fait reculer l’influence des États-Unis, n’ont fait que renforcer les perspectives à long terme d’influence états-unienne à l’échelle régionale. Les pays riverains de la Chine et les États-Unis contestent les revendications de Beijing et continuent de mener des opérations « d’affirmation de la liberté de navigation ». Défendant leur interprétation généralement admise du droit international, et de la liberté des mers en particulier, les États-Unis ont déployé des navires en mer de Chine méridionale dans le cadre de missions d’« affirmation de la liberté de navigation » et ont renforcé leur présence militaire dans la région. Répondant aux demandes des États riverains, Washington y a en outre resserré ses liens en matière de défense. Ainsi le Vietnam a commencé à acheter des armes aux États-Unis ; après les avoir expulsées il y a 25 ans, les Philippines ont invité les forces américaines à se réinstaller sur leur territoire et Singapour autorise à présent les aéronefs de surveillance des forces navales des États-Unis à utiliser plusieurs de ses bases. En même temps, pour ménager ses relations avec la Chine et poursuivre la coopération sur différentes questions, Washington a intérêt à désamorcer les tensions. Pour y parvenir, les États-Unis ont exprimé leur appui à l’égard de l’accord entre pays de la région portant sur un code de conduite contraignant et d’autres mesures de confiance.
24. A contrario, pour la Chine, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer interdit aux forces militaires étrangères de procéder à des activités de collecte de renseignements telles que des vols de reconnaissance dans sa zone économique exclusive (ZEE), tandis que les États-Unis soutiennent que les pays doivent bénéficier de la liberté de navigation dans les ZEE et ne sont pas tenus de notifier aux États des activités militaires. Beijing a mis en garde ses voisins de l’Asie du Sud-Est contre l’exploration pétrolière et gazière dans la région contestée, perturbant la prospection pétrolière et les activités de surveillance sismique qu’y mènent d’autres pays.
7

171 PNCP 16 F bis
25. Qui plus est, dès 2014, la Chine a entamé des opérations de dragage en vue de construire des îles artificielles sur certains récifs coralliens dans l’archipel des Spratleys et a accéléré le rythme au cours de l’année écoulée, bâtissant des ports en eau profonde et des pistes d’atterrissage capables d’accueillir des navires de guerre et des avions de combat. En février 2016, des images satellites ont révélé la présence de batteries de missiles sol-air sur les îles Paracels, ainsi que des installations radar qui pourraient augmenter la portée des missiles balistiques « tueurs de porte-avions » basés en Chine continentale.
26. Outre les États riverains des mers de Chine orientale et méridionale qui sont préoccupés par leurs propres intérêts économiques et territoriaux, des pays alliés des États-Unis dans la région (comme le Japon et la République de Corée) s’inquiètent des incidences, sur la sécurité, du déploiement par la Chine de matériel de guerre dans les archipels contestés. Les experts militaires états-uniens et de la région craignent que ses capacités de déni d’accès et d’interdiction de zone (A2/AD), telles que ses sous-marins et ses missiles balistiques et de croisière antinavires, ne retardent l’arrivée des États-Unis ou ne les empêchent de se porter à la défense de leurs alliés régionaux si un conflit venait à éclater. Cela étant, malgré le rythme soutenu de ce renforcement militaire, les observateurs estiment que la Chine n’est pas prête d’obtenir les capacités lui permettant d’interdire l’accès des forces des États-Unis dans la région.
27. Néanmoins, malgré les préoccupations largement répandues sur la scène internationale concernant les revendications territoriales chinoises dans les mers de Chine orientale et méridionale et les mesures que Beijing a prises pour promouvoir ces revendications, nombre d’experts s’accordent à dire que le principal objectif de la politique étrangère de la Chine reste de favoriser des relations « stables, cordiales et, si possible, positives » avec ses nombreux voisins et, surtout, d’éviter le risque de conflit armé, alors qu’elle poursuit son essor et s’applique à mener à bien sa transformation économique. Les conséquences d’un conflit seraient dévastatrices pour les activités des entreprises chinoises et l’économie du pays. De surcroît, ses capacités militaires sont, pour l’heure, très inférieures à celles des États-Unis, dont la présence militaire dans la région est forte et qui a conclu des pactes de défense mutuelle avec plusieurs voisins de la Chine – voisins avec lesquels cette dernière a des relations posant relativement problème. Il n’en demeure pas moins que les efforts soutenus et accrus déployés par Beijing pour faire valoir ses revendications territoriales, litigieuses, en mer de Chine orientale ainsi qu’en mer de Chine méridionale soulèvent des questions sur les intentions chinoises dans la région.
28. Les différends entre la Chine et Taïwan portant sur la souveraineté de l’île, que la RPC revendique comme faisant partie de son territoire souverain, ajoutent à ces tensions. Les relations s’étaient améliorées entre 2008 et 2016, lorsque le président Ma Ying-jeou et le Kuomintang étaient au pouvoir, et le dialogue politique et la coopération économique s’étaient intensifiés. Cependant, les tensions se sont exacerbées après l’arrivée au gouvernement, en janvier 2016, de Tsai Ing-wen et du parti démocrate progressiste, qui, depuis toujours, met davantage l’accent sur l’indépendance de Taïwan. La présidente taïwanaise, Mme Tsai, a réaffirmé qu’elle maintiendrait le statu quo dans les relations que Taïwan entretient avec la RPC, tout en promettant de réduire la dépendance économique de l’île à l’égard de la Chine. Lors de son discours d’investiture du 20 mai, la présidente Tsai n’a pas avalisé le « consensus de 1992 » - dans lequel Taipei et Beijing sont convenus qu’ils appartiennent à « une seule Chine » mais avec des interprétations différentes. Beijing a souligné à plusieurs reprises que l’acceptation du « consensus de 1992 » était nécessaire à la poursuite, comme par le passé, des relations économiques et politiques. Mme Tsai n’ayant pas officiellement reconnu le « consensus de 1992 », la Chine a suspendu ses relations diplomatiques avec Taïwan le 25 juin 2016, bien que la présidente Tsai ait indiqué le 20 août que des canaux de communication officieux demeuraient.
29. Ces dernières années, la Chine a considérablement augmenté ses capacités militaires. Le fait de ne plus se concentrer sur la guerre terrestre en Asie mais de privilégier la puissance maritime et aérienne est consigné dans le très récent livre blanc sur la défense (mai 2015) de
8

171 PNCP 16 F bis
l’Armée populaire de libération (APL) : « La mentalité traditionnelle selon laquelle la terre l’emporte sur la mer doit être abandonnée et une grande importance être attachée à la gestion des mers et des océans ainsi qu’à la protection des droits et intérêts maritimes [du pays]. » Dans ce but, la Force navale de l’Armée populaire de libération (marine de l’APL) poursuit sa transformation d’une force de défense côtière à une marine de haute mer, dotée notamment de frégates modernes, de destroyers et de sous-marins à propulsion nucléaire. Fin 2015, le ministère chinois de la Défense a fait savoir que le premier porte-avions de conception entièrement chinoise (le second dont la marine de l’APL disposera après que le Liaoning a été admis au service actif en 2012) est actuellement en construction.
30. L’amélioration des capacités navales s’inscrit dans un processus plus large de modernisation des forces armées chinoises, visant à créer une force professionnelle capable de projeter ses forces dans le Pacifique occidental, sur internet et même dans l’espace. Cette modernisation consiste en la restructuration des commandements militaires régionaux, en l’attribution à la marine, à la force aérienne et aux forces de missiles stratégiques de leurs propres structures de commandement et en la suppression de leur contrôle par les forces terrestres, ainsi que dans le renforcement des cybercapacités et des capacités dans les domaines spatial et des missiles. Dans le cadre de la modernisation de ses forces armées, la Chine prévoit également, dans les cinq prochaines années, de réduire de 300 000 le nombre des non-combattants au sein de son armée, forte de 2,3 millions d’hommes et de femmes.
31. Au milieu de cette campagne d’amélioration de l’efficience, les responsables chinois ont récemment annoncé un ralentissement des dépenses de défense pour 2016 – soit une hausse de 7 à 8 %, contrairement à la progression à deux chiffres observée au cours des deux dernières décennies. Bien que le fléchissement de la croissance économique puisse en être l’une des causes, les analystes rappellent que le budget militaire de la Chine est opaque, les acquisitions hors budget représentant 50 % du total des dépenses publiées. À cela s’ajoute le fait que la Chine pourrait à présent récolter les fruits des efforts poursuivis depuis plusieurs dizaines d’années en matière de recherche et développement d’armes de nouvelle génération, au nombre desquelles un chasseur furtif, le gros porteur Y20 et le destroyer Type 052D, ce qui expliquerait aussi en partie le ralentissement des dépenses de défense.
C. LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
32. La République populaire démocratique de Corée (RPDC ou Corée du Nord), et singulièrement son programme d’armement nucléaire, est un sujet majeur de préoccupation pour la sécurité internationale et les Alliés. Au fil des ans, la Corée du Nord a effectué avec succès plusieurs essais d’armes nucléaires et réussi à lancer plusieurs missiles balistiques, dont un missile mer-sol balistique. Selon un rapport établi par l’Institut pour la science et la sécurité internationale, en 2011 elle avait produit entre 34 et 36 kg de plutonium, soit une quantité suffisante pour fabriquer 12 dispositifs nucléaires. L’Agence états-unienne de renseignement de la défense a estimé « probable » que la RPDC a également en sa possession des missiles balistiques capables d’emporter des armes nucléaires. Pour la Chine, la stabilité dans la péninsule coréenne figure au nombre des priorités régionales car la Corée du Nord est son partenaire le plus proche et son partenaire commercial le plus important. La Chine est une source majeure d’approvisionnement en nourriture, en armes et en énergie du régime de Pyongyang. Considérant les sanctions comme contre-productives, la Chine avait jusqu’à présent résisté aux pressions exercées par Washington pour qu’elle durcisse le ton envers la Corée du Nord. Dans l’ensemble, Beijing a mené une politique visant à faire repousser les sanctions internationales et à soutenir le gouvernement, afin d’éviter la chute du régime nord-coréen ainsi que l’arrivée massive de réfugiés sur le territoire chinois qui, vraisemblablement, en résulterait. L’effondrement du régime risquerait aussi de faire disparaître la zone tampon stratégique dont la Chine peut se prévaloir entre son territoire et les 30 000 soldats états-uniens stationnés en Corée du Sud.
9

171 PNCP 16 F bis
33. Il n’en reste pas moins que les actes de provocation et les actions agressives poursuivis par la RPDC – y compris les essais nucléaires auxquels elle a procédé depuis que l’actuel Guide suprême Kim Jong-un a succédé à son père en 2011 – ont mis cette politique à rude épreuve. Beijing a commencé à appuyer les résolutions punitives du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) – et ce, à partir de 2006, au moment où la Corée du Nord a procédé à un essai nucléaire – tout en s’employant au sein du CSNU à vider ces résolutions d’une bonne partie de leur substance avant qu’elles ne soient adoptées. Tout récemment, la Chine s’est associée aux États-Unis pour l’élaboration de la résolution 2270 (2016) du CSNU, qui, après l’essai nucléaire du 6 janvier 2016 et le tir de fusée du 7 février de la RPDC, impose les plus lourdes sanctions à ce jour à l’encontre des secteurs financier, commercial et minier nord-coréens. La nouvelle résolution exige que tous les États fassent inspecter les cargaisons en provenance ou à destination de la Corée du Nord, interdit le transfert à celle-ci de tout article pouvant contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC et place sur une liste noire les individus, entités et navires qui ont concouru à la mise en place et au financement du programme d’armement nucléaire du pays.
34. La Chine espère que ce dernier volet de sanctions suscitera une reprise du dialogue, notamment dans le cadre des pourparlers à six, actuellement dans l’impasse. En même temps, les récents efforts chinois de rapprochement avec la Corée du Sud, engendrés en partie par le « pivot [des États-Unis] vers l’Asie », et la vive protestation élevée par Beijing contre le déploiement éventuel, en Corée du Sud, d’un système états-unien de défense antimissile THAAD (système de défense en phase terminale à haute altitude) témoignent de la dynamique complexe à laquelle la Chine se trouve confrontée dans la péninsule coréenne. La participation chinoise à la coopération internationale face à la question nord-coréenne est tempérée par les préoccupations selon lesquelles cette approche entraînera le renforcement de la présence militaire états-unienne dans la région et consolidera les alliances régionales des États-Unis. Comme les interlocuteurs du pays hôte l’ont fait savoir aux membres de la sous-commission sur les partenariats de l’OTAN lors de la visite que ceux-ci ont effectuée en Chine en juillet 2016, Beijing considère en outre que les États-Unis et la Corée du Sud se partagent la responsabilité de l’accroissement des tensions dans la région.
35. Le comportement belliciste du régime de Pyongyang et les froides exactions qu’il inflige aux citoyens nord-coréens vont à l’encontre des efforts déployés pour encourager la paix et la stabilité en Asie orientale. Le tout dernier essai nucléaire nord-coréen, le 9 septembre 2016, et la série de tirs de missiles balistiques de différentes portées au cours de l’été 2016 ont avivé les tensions dans la péninsule coréenne et la région. La plupart des observateurs considéraient les menaces de la Corée du Nord et les précédents essais d’armes sous Kim Il-sung et Kim Jong-il essentiellement comme des gesticulations et du chantage afin d’obtenir plus d’aide, davantage d’attention ou un assouplissement des sanctions. Il semble, en revanche, que Kim Jong-un veuille se doter d’une dissuasion nucléaire, une évolution très dangereuse et fortement déstabilisante pour la région. Malgré son incapacité manifeste à juguler le comportement très provocateur de la RPDC, la Chine reste de loin l’acteur exerçant le plus d’influence sur Pyongyang. L’évolution de sa politique à l’égard de la péninsule coréenne est assurément d’un grand intérêt et d’une grande importance pour les Alliés et la sécurité internationale en général.
D. L’AFRIQUE
36. Les engagements de la Chine en Afrique constituent un exemple supplémentaire du rôle accru qu’elle joue et de l’influence croissante dont elle jouit dans les affaires internationales. Beijing, qui a continué d’élargir et d’approfondir ses liens économiques avec les pays africains, a établi une modeste présence militaire sur le continent et a participé plus activement aux initiatives de paix et de sécurité menées dans le cadre de l’ONU.
10

171 PNCP 16 F bis
37. En effet, la Chine est, parmi les États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, le pays qui fournit le plus de soldats aux missions onusiennes de maintien de la paix, un bataillon entièrement chinois étant actuellement déployé dans des conditions difficiles en Afrique. En septembre 2015, le président Xi Jinping a fait savoir que la Chine participerait au nouveau Système de préparation des capacités de maintien de la paix de l’ONU, prenant ainsi la tête des efforts visant à instituer une brigade policière permanente de maintien de la paix et fournissant aux Nations unies une force de réaction rapide de 8 000 hommes pour des déploiements internationaux à tout moment.
38. La Chine a récemment établi en Afrique son premier avant-poste militaire extérieur. En même temps qu’elle annonçait sa participation au développement de la Route maritime de la soie, la République de Djibouti a indiqué qu’elle accueillerait une base navale chinoise pour une durée de 10 ans, laquelle servira de base principale pour les navires de la marine de l’APL qui effectueront des opérations de lutte contre la piraterie au large des côtes yéménites. Cette base, qui permettra à Beijing de disposer à l’avenir de capacités de projection, constitue un exemple concret de l’assomption par la Chine de responsabilités accrues en matière de sécurité internationale.
39. L’engagement militaire chinois qui se dessine en Afrique, mais surtout les investissements économiques que la Chine y effectue, ont conduit certains à qualifier le continent d’« incubateur stratégique pour le rôle futur de la Chine sur la scène internationale ». Le commerce bilatéral entre la Chine et l’Afrique a atteint 300 milliards de dollars en 2015 et Beijing détient d’importants investissements sur tout le continent dans le secteur des matières premières essentielles, fournissant des emplois à plus de 2 millions de Chinois. L’ouverture de la base de Djibouti ainsi que le déploiement susmentionné de troupes de combat au Sud Soudan sous les auspices des Nations unies pourraient laisser entrevoir une présence militaire chinoise en Afrique encore plus étendue. Une telle évolution pourrait laisser présager un changement dans la manière de penser chinoise, la Chine étant plus encline à protéger ses intérêts en Afrique et la vie de plus d’un million de ressortissants chinois qui y sont installés, ainsi qu’à asseoir sa réputation de bonne citoyenne du monde.40. Avec le ralentissement de l’économie chinoise et la multiplication des questions sur la pertinence des investissements passés dans le secteur des ressources naturelles africaines, les relations commerciales et financières pourraient se détourner du secteur des matières premières. De fait, les partenariats économiques de la Chine avec les pays africains ont déjà soulevé des préoccupations d’équité et de pérennité. Pour les pays désireux d’échapper à la dépendance enregistrée jusque-là à l’égard des matières premières, les relations commerciales avec la Chine strictement axées sur les produits de base, de même que le spectre d’un endettement insoutenable découlant des accords d’emprunt contre ressources, ont suscité une certaine inquiétude.
41. Au 6e Forum sur la coopération sino-africaine qui s’est tenu à Johannesburg en décembre 2015, le président Xi Jinping a annoncé des promesses d’investissement d’environ 60 milliards de dollars, ce qui, de facto, triple l’engagement dévoilé lors du précédent Forum en 2012. Les ressources naturelles, qui n’ont, cette fois-ci, pas figuré au premier plan des déclarations de politique générale de la Chine, ont été remplacées par des mentions concernant la « coopération en matière de capacité industrielle » et la « complémentarité stratégique ». Compte tenu de la transformation économique en cours de la Chine et de la nécessité d’une industrialisation, d’une modernisation et d’une urbanisation de l’Afrique, la Chine a commencé à expédier en Afrique certaines de ses industries à forte intensité de main-d’œuvre, en même temps qu’elle exportait ses excédents de capacité afin de financer des projets d’infrastructures africains. Si la majorité des exportations africaines vers la Chine au cours des trois premiers trimestres de 2015 ont concerné les ressources naturelles – le pétrole brut, le minerai de fer, les diamants et les produits agricoles ont représenté 56 % des exportations – les relations entre la Chine et l’Afrique semblent se complexifier encore et être de plus en plus interdépendantes. Cela
11

171 PNCP 16 F bis
dit, les conséquences à court terme du ralentissement de la croissance chinoise sur les échanges entre la Chine et l’Afrique ont été très importantes, le fort recul des investissements directs étrangers et des importations en provenance de Chine en 2015 causant du tort aux économies de nombreux pays africains. Si le ralentissement persiste, il pourrait avoir un impact déterminant sur ces relations. Les acquisitions foncières par les entreprises chinoises – qui ont considérablement augmenté depuis la hausse, après 2007-2008, des prix internationaux des denrées alimentaires – représentent un autre aspect de l’engagement de la Chine sur le continent africain. Dans certains cas, ces acquisitions foncières ont entraîné la réinstallation à grande échelle de populations, suscitant parfois des protestations locales.
E. L’ARCTIQUE
42. L’Arctique est une autre zone dans laquelle un accroissement de l’engagement de la Chine sur la scène internationale a été enregistré. Les incidences du changement climatique, ainsi que la possibilité de nouvelles routes maritimes et les perspectives qu’offre l’exploitation des ressources, ont placé l’Arctique au centre des préoccupations des « intervenants dans l’Arctique », et de la Chine en particulier. Même si la région Arctique peut ne pas sembler être une priorité de la politique étrangère chinoise, Beijing a pris des mesures ces dernières années pour protéger ses intérêts dans le Grand Nord. Comme beaucoup de pays, la Chine s’intéresse aux conséquences possibles, sur le plan géopolitique, commercial et des ressources, de la lente ouverture de routes maritimes arctiques en raison du réchauffement planétaire. À cela s’ajoute le fait qu’elle souhaite également renforcer sa capacité, en tant qu’État “non arctique”, à accéder aux ressources minérales de même qu’aux zones de pêche de l’Arctique. Dans ce but, elle a exprimé son engagement en faveur de « relations respectueuses, concertées et avantageuses pour tous » avec les autres acteurs de la région. Reconnaissant que la fonte des glaces polaires risque d’avoir un impact déterminant sur les voies navigables et les échanges commerciaux mondiaux, la Chine a développé ses relations diplomatiques avec des pays nordiques comme l’Islande, le Danemark, la Norvège et la Suède et s’est vu accorder, en mai 2013, le statut d’observateur permanent auprès du Conseil de l’Arctique.
43. Vu l’importance habituellement donnée par la Chine au respect de la souveraineté et au principe de non-ingérence, et ses propres affirmations de souveraineté sur les mers de Chine orientale et méridionale, il est improbable qu’elle adopte dans un avenir proche un ton plus résolu, notamment en contestant les revendications des États riverains de l’Arctique. Malgré son statut juridique d’État non arctique, elle préférera vraisemblablement jouer par petites touches la carte de la diplomatie et de la coopération scientifique, qui favorisera son inclusion dans les décisions touchant la gouvernance et l’exploitation des ressources de l’Arctique. Cela étant, il y a contradiction dans la politique chinoise, la RPC plaidant en faveur de la CNUDM pour l’Arctique mais la dénigrant pour son voisinage immédiat.
F. LA CHINE ET L’OTAN
44. L’influence croissante de la Chine sur la scène internationale a de nombreuses incidences sur les pays membres de l’OTAN. Ses politiques peuvent avoir des effets directs et indirects sur la sécurité individuelle et collective des Alliés, de même que sur leurs intérêts politiques et économiques. C’est ainsi que l’instabilité régionale, engendrée par l’aggravation des tensions entre la Chine et certains pays de l’Asie-Pacifique, pourrait avoir des répercussions concrètes sur les membres de l’Alliance, ne fût-ce qu’en raison des liens politiques, économiques et financiers étroits qui existent entre plusieurs de ces pays et les pays occidentaux. Bien qu’il n’y ait eu aucune relation officielle entre l’OTAN et la République populaire de Chine et que dans le passé leurs rapports aient été limités, les deux parties ont reconnu la nécessité d’engager un dialogue et d’établir des liens et des contacts politiques dans la continuité. Cela inclut une rencontre annuelle entre représentants chinois et responsables de l’OTAN. Qui plus est, les représentants
12

171 PNCP 16 F bis
chinois ont participé à un petit nombre de séminaires et de conférences de l’OTAN, en particulier à la conférence annuelle de l’OTAN sur la maîtrise des armements, le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive. Au niveau militaire, les contacts se sont intensifiés entre la marine de l’APL et les forces de l’OTAN effectuant des missions de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden et au large de la Corne de l’Afrique. La coopération pratique a porté notamment sur l’accès au réseau MERCURY de partage d’informations maritimes ainsi que sur l’harmonisation et la coordination des efforts en matière de lutte contre la piraterie par le biais des réunions SHADE (Shared Awareness and Deconfliction) sur le partage des informations et la prévention des interférences, tenues entre acteurs concernés. Le renforcement du dialogue et, dans l’idéal, de la coordination présente un intérêt à plus d’un titre. En premier lieu, la République populaire de Chine et les Alliés sont confrontés aux mêmes difficultés, par exemple le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, la piraterie maritime et la sécurité régionale (surtout en Afghanistan et en Asie centrale). De plus, la Chine étant désormais un acteur international, les deux parties doivent se pencher sur les questions d’instabilité régionale et mondiale. C’est ainsi qu’en Afrique, les investissements chinois peuvent aider les pays à résoudre leurs problèmes économiques et, ce faisant, à stabiliser la région – ce qui, par ricochet, pourrait avoir une incidence sur le nombre de migrants économiques qui partent pour l’Europe. Enfin, des échanges plus fréquents entre l’Alliance et la Chine permettraient d’offrir à celles-ci et aux partenaires de l’OTAN à travers le monde, dont certains comme le Japon, la République de Corée et l’Afghanistan sont des voisins immédiats de la RPC, une transparence par ailleurs indispensable.
13

171 PNCP 16 F bis
IV. CONCLUSIONS
45. La Chine est de plus en plus active et compte de plus en plus dans le voisinage de l’OTAN, en particulier en Asie centrale, en Afghanistan, dans la région MOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et dans l’Arctique. Pourtant, si les Alliés et la République populaire de Chine partagent un nombre croissant de préoccupations en matière de sécurité, cette dernière est le seul membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies avec lequel l’Alliance n’a aucun mécanisme officiel d’engagement ni de consultation. Un dialogue politique accru entre Beijing et l’Alliance donnerait aux deux parties la possibilité de collaborer de façon constructive à l’apaisement des tensions et au renforcement de la stabilité régionale. Des organisations terroristes actives au niveau international, telles que Daech2 et al-Qaida, représentent une constante menace ; l’OTAN et la Chine partagent donc un intérêt commun en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. La RPC se sent menacée par le terrorisme, notamment dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, et l’on estime que 100 individus environ ont rejoint les rangs de Daech. Si la coopération en matière de lutte contre le terrorisme pourrait être profitable, sa mise en œuvre est difficile dans la pratique. Cependant, les Alliés et la Chine pourraient évaluer la possibilité de partager des renseignements sur ces groupes, comme le directeur de l’Institut des affaires internationales de Shanghai, Chen Dongxiao, l’a suggéré aux membres de la sous-commission lors de leur visite en Chine en juillet 2016.
46. De plus, tenter de venir à bout de la menace que posent ces organisations nécessite une véritable coordination des efforts internationaux. Jusqu’à présent, la communauté internationale ne s’est attaquée qu’aux symptômes du terrorisme international. Avec plus d’un million de ressortissants résidant et travaillant en Afrique et les gros investissements qu’elle y a consentis, la Chine voit dans la stabilité du continent un intérêt marqué. Partant, l’OTAN et la Chine, de même que les partenaires de l’Alliance, pourraient entamer un vaste dialogue sur la façon de répondre à la mauvaise gouvernance dans la région MOAN et d’aider les pays de cette région et d’Afrique à améliorer leur situation économique et sociale.
47. Pareillement, le projet Belt and Road de la Chine pourra avoir un énorme impact géopolitique, car il pourrait favoriser l’essor économique des Républiques d’Asie centrale et les aider à relever les considérables défis qui sont les leurs sur le plan social. Là encore, les intérêts de la Chine et des Alliés – mais également de la Russie – se rejoignent, dans la mesure où l’instabilité persistante et croissante en Asie centrale se répercute sur la sécurité au-delà de la région. Il serait important que le projet chinois améliore aussi la gouvernance dans ces Républiques. L’OTAN et les Alliés devraient examiner les possibilités de faire participer la Chine, du moins en Asie centrale, à son initiative pour « le renforcement de l’intégrité ».
48. Qui plus est, la Chine et l’OTAN ont toutes deux intérêt à faire respecter le droit international. Dans un contexte de mondialisation qui s’amplifie, l’instabilité existant dans une région peut facilement compromettre la sécurité à l’échelle planétaire. C’est particulièrement vrai dans les mers de Chine méridionale et orientale et dans l’Arctique, d’une importance géostratégique majeure. Les Alliés et l’OTAN en tant qu’organisation devraient donc suivre l’évolution de la situation dans ces régions et s’en tenir aux dispositions du droit international et à la CNUDM en particulier. Plus concrètement, les Alliés devraient engager la RPC à se conformer à la décision sur la mer de Chine méridionale rendue par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye.
49. Davantage de consultations, voire une plus grande coordination, entre les Alliés et la RPC sont en outre nécessaires s’agissant de la Corée du Nord. La RPDC est un important pays proliférateur d’armes nucléaires et de la technologie des missiles ; par ailleurs, elle poursuit activement l’élargissement de son arsenal de missiles balistiques et met au point des missiles
2 Acronyme arabe utilisé pour désigner l’organisation terroriste « État islamique ».
14

171 PNCP 16 F bis
balistiques intercontinentaux, avec lesquels elle menace les États-Unis et les partenaires de l’OTAN que sont le Japon et la Corée du Sud. La République populaire de Chine est le principal fournisseur d’aide alimentaire, de carburant et d’équipements industriels à la RPDC. Si un pays peut exercer ne serait-ce qu’un minimum d’influence sur la Corée du Nord, c’est bien la Chine. Cette dernière est donc extrêmement importante pour l’efficacité des sanctions internationales à l’encontre de la RPDC et plus encore pour la reprise des négociations visant à enrayer le programme nucléaire nord-coréen.
50. Enfin, un renforcement du dialogue, et le cas échéant de la coopération, entre l’OTAN et la RPC ne devrait pas exclure les partenaires de l’Alliance dans la région, en premier lieu le Japon et la Corée du Sud, ni non plus l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Au contraire, une intensification du dialogue entre l’OTAN et la Chine pourrait contribuer à atténuer les tensions qui existent dans cette région d’une importance capitale.
15

171 PNCP 16 F bis
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
lbert, Eleanor and Xu, Beina, “The China-North Korea Relationship”, Council of Foreign Relations, mis à jour 8 février 2016, http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097
Bradsher, Keith, “China’s Renminbi Is Approved by I.M.F. as a Main World Currency”, New York Times, 30 novembre 2015, http://www.nytimes.com/2015/12/01/business/international/china-renminbi-reserve-currency.html
Carlson, Benjamin, “The World According to Xi Jinping”, The Atlantic, 21 septembre 2015, http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/xi-jinping-china-book-chinese-dream/406387/
Carlsson, Märta, Oxenstierna, Susanne and Weissmann, Mikael, “China and Russia – A Study on Cooperation, Competition and Distrust”, Swedish Defence Research Agency, juin 2015, http://www.foi.se/Documents/foir4087.pdf
Charbonneau , Louis and Nichols, Michelle, “U.N. imposes harsh new sanctions on North Korea over its nuclear program”, Reuters, 3 mars 2016, http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-un-idUSKCN0W41Z2
Dollar, David, “China’s Rise as a Regional and Global Power: The AIIB and the “One Belt One Road”, Horizons, no. 4 été 2015,
http://www.brookings.edu/research/papers/2015/07/china-regional-global-power-dollar Ferchen, Matt, “China Keeps the Peace: How Peaceful Development Helps and Hinders China”,
Foreign Affairs, 8 mars 2016, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-03-08/china-keeps-peace
Forsythe, Michael and Perlez, Jane, “South China Sea Buildup Brings Beijing Closer to Realizing Control”, New York Times, 8 mars 2016,
http://www.nytimes.com/2016/03/09/world/asia/south-china-seamilitarization.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSouth%20China%20Sea&action=click&contentCollection=world®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection
Financial Times, "In-depth: China’s Great Game," http://www.ft.com/intl/indepth/china-great-game Kleven, Anthony, “Is China's Maritime Silk Road A Military Strategy?”, The Diplomat,
8 décembre 2015, http://thediplomat.com/2015/12/is-chinas-maritime-silk-road-a-military-strategy/
Martina, Michael and Brunnstrom, David, “China's Xi says to commit 8,000 troops for U.N. peacekeeping force”, Reuters, 28 septembre 2015, http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-china-idUSKCN0RS1Z120150929
South China Morning Post, “UN Security Council condemns ‘unacceptable’ North Korean missile tests”, 19 mars 2016, http://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/1927524/un-security-council-condemns-unacceptable-north-korean-missile
Sun, Yun, “Xi and the 6 th Forum on China-Africa Cooperation: Major Commitments, but with Questions”, Brookings, 7 décembre 2015,
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2015/12/07-china-africa-focac-investment-economy-sun
Wang, Helen, ‘’Xi Jinping's Mideast Trip to Push "One Belt One Road", Forbes Business, 30 janvier 2016, http://www.forbes.com/sites/helenwang/2016/01/30/xi-jinpings-mideast-trip-to-push-one-belt-one-road/#2502906a4f27
________________________
16