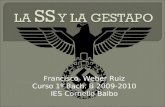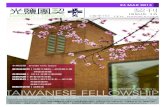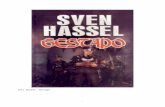10 LE ATRIOTE ÉSISTANT N 0 mar 016 « Il n’est gestapo qui … · 2016. 3. 31. · LE ATRIOTE...
Transcript of 10 LE ATRIOTE ÉSISTANT N 0 mar 016 « Il n’est gestapo qui … · 2016. 3. 31. · LE ATRIOTE...

LE PATRIOTE RÉSISTANTN° 906 - mars 20161010 mémoire
« Du silence de la Mer » aux « Chroniques interdites »
« Les “Editions de Minuit” ont, dès main-tenant, gagné une bataille difficile. Après “Le silence de la Mer” de Vercors, dont le succès fut tel qu'il faudra en donner une nouvelle édition, après l’étude de Jacques Maritain, “A travers le désastre”, voici un troisième volume “Chroniques interdites”. Un quatrième ouvrage est sous presse : “Indications”, de Champaigne. D'autres sont annoncés et paraîtront. Il n'est ges-tapo qui tienne : La pensée française par-vient à s'exprimer et à se présenter dans une tenue qui, en temps normal, aurait contenté le bibliophile le plus délicat. Ce n'est pas là un des moindres mérites des “Editions de Minuit” que ce souci de la présentation de ses ouvrages et que sa réussite en dépit de toutes les difficultés du travail clandestin. Et tous les artisans du livre qui ont partici-pé à ce travail, imprimeurs, brocheurs, etc. ont droit à notre admiration sans réserve. C'est bien là une affirmation de la ténacité et de la volonté de vivre de l'esprit français que ce travail de qualité, cet ouvrage bien fait en dépit de l'ennemi.
L'expression libre de la pensée française est une autre victoire puisque cette guerre est essentiellement une guerre spirituelle.
Le nazisme, en effet, a su engager au service d'intérêts de classe, de race et de nation, une foi, au même titre qu’une armée. Cette foi est la négation forcenée, presque désespé-rée de toutes les valeurs humaines et spiri-tuelles que notre monde civilisé a reçues par l’humanisme, par la philosophie grecque et par la Bible, de la plus haute anti quité. Il s'agit pour le nazi de tuer tout ce qui, dans l'homme est humain, comme il saisit son révolver s'il entend prononcer le mot culture. Surprenant sursaut d'un obscur et bestial instinct ancestral à qui doit peser lourde-ment le respect de la dignité humaine et dont les théoriciens nazis sont parvenus à tirer une “philosophie” de la brute triom-phante qui se dresse et s’oppose à l’humain, à tout progrès moral et social.
Vaincus, nous ne pouvions opposer tout d'abord qu’un silence méprisant à cette apologie de la haine de toute liberté, du mépris du droit, du refus de la culture, de l’idolâtrie sadique de la violence impor-tée par nos conquérants. Notre silence gê-nait ces maîtres avides de nous convertir. Ce silence, sur l'ordre d'Abetz (1), les Drieu La Rochelle, les Châteaubriant se sont ef-forcés, à l'aide de quelques complices va-niteux ou vénaux, de le rompre. Ce silence sacré, nous savons qu'il fut pendant de nom-breux mois le refuge de la patrie piétinée.
L'inspiration de Vercors fut heureuse d’avoir fait du silence le thème essentiel de son admirable récit. Avoir su exprimer ce refus muet et obstiné du peuple français aux avances de l'ennemi, tel est le secret de la puissance d'émotion du “Silence de la Mer”. Quelle sobriété et quelle fermeté que celles de ce simple et admirable tableau.
Dans une maison de campagne, une jeune Française, à peine entrevue, oppose un si-lence obstiné aux avances sincères et déli-cates d'un officier allemand. Quel officier. Musicien, épris de culture française, apôtre d'une vraie collaboration où l’amour joue-rait son rôle. Mais il est chez elle par droit de conquête. Elle se tait devant l’ennemi. Lutte ardente, épuisante, jusqu'au jour ou l‘officier s’effondrera, ayant enfin compris que les siens ne voulaient pas d‘une récon-ciliation sincère et désiraient seulement faire de la France “la chienne rampante” de l'ordre nouveau.
L'éloge n'est pas à faire de ce petit volume, de ce récit si puissant à force de simplici-té, de ce style si sobre, si réservé, de cette prose limpide qui, clandestinement, a fait la conquête d'un public étendu.
“A travers le désastre” de Jacques Maritain est paru à New-York le 21 novembre 1940. Deux ans après, les “Editions de Minuit” le pu-bliaient chez nous “afin de témoigner plus tard
Bethel le 1er septembre 1940, il définit un certain nombre de critères pour dis-tinguer parmi les pensionnaires ceux qu’il allait falloir transférer. Quelles que soient les réticences, la direction de Bethel était prête à céder : ayant passé en revue 41 éta-blissements, Bodelschwingh conclut que, selon ces critères, 446 pensionnaires dont 79 enfants étaient impliqués. En 1941 les « experts T4 » procédèrent aux examens pré-vus, et on ne peut aujourd’hui qu’estimer à quelque 600, environ 20 % de l’ensemble, le nombre de pensionnaires soumis à la procé-dure prévue, dont personne ne prononçait la nature réelle. Pour Schorsch, tel qu’il le formula bien après la fin du nazisme, « une résistance active à tout prix n’avait aucune chance de succès dans l’Etat totalitaire », et il définit à sa façon en 1983 la voie choisie : « Coopération pour saboter. Une voie que choisit aussi le pasteur von Bodelschwingh ».
L’ouvrage de Barbara Degen (dont un grand-père a été « euthanasié » en 1941) est un acte d’accusation, en même temps qu’une mise au point cherchant à recti-fier la « légende de Bethel », dans laquelle Bodelschwingh affirmait « J’ai risqué (en résistant) aussi bien ma vie que l’existence de l’œuvre qui m’était confiée. J’ai atteint le but recherché. Aucun patient ne me fut ar-raché des mains ». Un aveu du Dr Schorsch en 1955 est certainement plus près de la réalité, lorsqu’il admettait une « certaine faute due à l’impuissance », reconnaissant que « nous sommes tous devenus coupables en laissant faire passivement et en ne résis-tant pas suffisamment ».
On peut ajouter au passif de Bethel la constatation qu’après la guerre, un nombre non négligeable d’anciens nazis furent héber gés dans les centres de Bethel, tels la veuve et la fille de Himmler ou la femme de l’ancien dirigeant national du Sport, von Tschammer und Osten, de même l’adjoint du médecin d’Hitler, Brandt, Dr von Hasselbach, fut nommé direc-teur d’un des centre de Bethel en 1949. L’ancien chef de la Gestapo de Breslau et Prague, Gerke, fut longtemps employé par l’administration de Bethel, de même qu’un des médecins du centre d’« eutha-nasie » d’Hadamar, Gorgass, trouva refuge en sortant de prison dans un logement appartenant à Bethel.
On ne peut porter de jugement simpliste sur les actes et attitudes résultant d’un contexte politique tel que le régime nazi. Il est pourtant instructif de voir comment des hommes et femmes, en principe de bonne volonté, deviennent les instruments du mal. Les descriptions d’après-guerre sont trop souvent complaisantes. L’ouvrage de Barbara Degen est sévère, mais les faits décrits sont graves, et les « légendes » inac-ceptables. Chacun doit pouvoir se faire une opinion. Cette étude y contribue.
Jean-Luc BeLLanger
(1) Grafeneck fut justement le premier des centres comportant une chambre à gaz où furent pra-tiquées les « euthanasies ».
n Barbara DEGEN, Bethel in der NS-Zeit, Die verschwiegene Geschichte (Bethel au temps du nazisme, L’histoire cachée), Ed. VAS, Editions pour les publications académiques, 2014, (non traduit).
lll
A quelques semaines des épreuves individuelles du Concours national de la Résistance et de la Déportation, nous avons voulu revenir sur un des aspects du thème proposé cette année : « Résister par l’art et la littérature ». Dans l’article des Lettres françaises clandestines du 15 juin 1943 que nous reproduisons ci-dessous, l’auteur (Jacques Debû-Bridel) fait l’éloge des dernières parutions des Editions de Minuit, clandestines elles aussi. Celles-ci traduisent « la volonté de vivre de l’esprit français » et représentent une victoire sur « la négation forcenée, presque désespérée de toutes les valeurs humaines et spirituelles » par l’occupant nazi.
Les Lettres françaises n° 7 (15 juin 1943)
« Il n’est gestapo qui tienne : la pensée française parvient à s’exprimer »
Fac-similé des pages 1 et 5 (sur 6 au total) des Lettres françaises du 15 juin 1943.
In Les Lettres françaises et les Etoiles dans la clandestinité 1942-1944, présentée par François Eychart et Georges Aillaud, Ed. Le cherche midi, 2008.

LE PATRIOTE RÉSISTANTN° 906 - mars 2016 11mémoire
aux yeux du monde de la constance spirituelle d'une France qui n’a pas démissionné”. Symbole précieux de l'unité de la pensée française qui se retrouve identique à elle-même dans sa volonté de vaincre, sa haine de l'oppression, sa foi en la dignité de la per-sonne humaine. Voix de l'exil qui vient, par son affirmation, confirmer l'éloquent refus qu'exprimait le silence de la France envahie.
Mais cette France opprimée et résistante, elle parvient, elle aussi, en dépit des efforts conjugués de ses maîtres allemands et de leurs complices, à se faire entendre. Le silence est rompu. Autrement, certes, que ne l'en-tendaient les valets de plume de M. Abetz ! C'est là une phase nouvelle de la guerre. Et le troisième volume des “Editions de Minuit”, “Chroniques interdites” nous y introduit.
C’est par le souvenir de Jacques Decour, fusillé le 30 mai 1942, dont Lemagne, en des pages pénétrantes et lourdes d'émo-tion contenue, évoquera l'œuvre littéraire, que s’ouvre ce volume de chroniques. Ce souvenir du compagnon tombé au champ d'honneur nous engage mieux que ne le saurait faire aucun discours.
Dans le même numéro, deux beaux poèmes : “Les morts”, longue revue des
morts et “Détestation”, un cri de douleur. Un apologue philosophique de Comminge, où le Juste, un disciple de Socrate qui s’est attardé chez Spinoza puis chez Voltaire, condamne avec sérénité la vanité des forces d'oppres-sion, tel est le “Rapport d’Uriel”. Plus vé-hément, Queyras fait appel à l'indignation. “Les pages de journal” d'Argonne, extrait d'un roman de guerre qui paraîtra plus tard, évoquent le 10 mai 1940, la surprise de Paris en ce beau matin printanier et la complai-sance étrange de la censure française pour les discours d'Hitler. “Désespoir est mort” par Santerre, nous montre comment le dé-filé de trois petits canards suffit à rendre foi en la destinée de la patrie à trois officiers, dans les mornes et accablantes journées de juillet 1940. Trois petits canards… Mystère des images qui font songer à ces pavés iné-gaux de l’hôtel de Guermentes contre les-quels buta le héros du Temps Perdu et dont la sensation brusquement vint lui rendre la joie et la confiance perdues.
Chroniques fort diverses, soit, mais toutes empreintes de la même sérénité et de la même ténacité (2).
Il s'agissait pour les “Editions de Minuit”de prouver que la pensée française continuait
de vivre, indépendante, libre et riche.Cette preuve est faite. »
(1) Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris de 1940 à 1944.(2) Les noms des auteurs des Chroniques interdites, cités sous leur pseudonyme dans l’article étaient : Jean Paulhan pour le texte sur Jacques Decour,
Francis Ponge pour le poème Détestation, Jacques Debû-Bridel, pour les Pages de journal, Julien Benda pour Le Rapport d’Uriel, Yvonne Desvignes pour Indignation, et Vercors pour Désespoir est mort.L’auteur de l’article Jacques Debû-Bridel était en 1943 membre du Conseil national de la Résistance au titre de la Fédération républicaine, parti de la droite catholique.
« Il n’est gestapo qui tienne : la pensée française parvient à s’exprimer »
Fac-similé de la page 3 du numéro 13 de février 1944 des Lettres françaises. Le poème Le Vent est de Jean Tardieu, l’article La poésie, conscience de la France, est de Max-Pol Fouchet qui à Alger publie la revue résistante Fontaine.In Les Lettres françaises et les Etoiles dans la clandestinité 1942-1944, présentée par François Eychart et Georges Aillaud, Ed. Le cherche midi, 2008.
« Les Lettres françaises » : 19 numéros de septembre 1942 à août 1944
Les Lettres françaises sont nées en 1942. L’idée en revient à Jacques Decour qui créa en zone Nord avec Jean Paulhan et Jacques Debû-Bridel un « Front national des Ecrivains » et commença à préparer ce qui devait être le premier numéro des Lettres françaises. Mais la parution fut empêchée par l’arrestation de Decour en février 1942. Trois mois plus tard, le 30 mai, il était fusillé par les nazis, avec ses amis Politzer et Solomon, comme lui universitaires et militants communistes.Pourtant le projet de Decour s’accomplit, sous la direction de Claude Morgan. Les Lettres françaises furent publiées à partir de septembre 1942, date anniversaire de la victoire de Valmy en 1792. Il devint un an plus tard la « revue des écrivains groupés au Comité national des Ecrivains », émanation du Front national pour la libération de la France, et ouvrit ses colonnes à des auteurs de toutes tendances politiques, tels Louis Aragon, Jacques Debû-Bridel, Paul Eluard, Elsa Triolet, Jean Guéhenno, François Mauriac ou Jean-Paul Sartre.Les Lettres françaises publieront 19 numéros dans la clandestinité, jusqu’en août 1944.


![Nippur de Lagash 016 - E016 - Hacia El Mar [Woodiana]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/577cc78e1a28aba711a14d1f/nippur-de-lagash-016-e016-hacia-el-mar-woodiana.jpg)